B. UNE PROCÉDURE ET UN SPECTRE NORMATIFS QUI MARGINALISENT LES OUTRE-MER DÉPOURVUS DE LA MAÎTRISE
1. Les RUP : une dépendance normative qui creuse les différentiels de compétitivité sans contrepartie suffisante
a) Une réglementation européenne stricte qui pénalise des producteurs ultramarins laissés dans l'angle mort
(1) L'articulation des responsabilités entre les niveaux européen et national
Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques (RUP) françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leurs origines pour l'essentiel dans des règlements européens qui, à la différence des directives, ne nécessitent pas de transposition. L'application directe des règlements européens laisse moins de marge de manoeuvre aux États membres en aval. C'est donc plus en amont, dès les consultations pour l'élaboration des normes que la France doit intervenir pour faire prendre en compte par la réglementation européenne les spécificités des outre-mer.
Toutefois, le cadre actuel pour l'emploi agricole de pesticides qui découle du règlement ( CE) n° 1107/2009 abrogeant la directive précédente de 1991 ménage un rôle important aux autorités nationales . Celles-ci exercent des responsabilités essentielles dans l'évaluation des risques, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'octroi de dérogations, le contrôle et l'information du public .
Il convient de distinguer deux étapes dans l'homologation d'un pesticide, d'abord l'approbation de la substance active au niveau de l'Union européenne , puis l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique qui comprend la substance active approuvée au niveau des États membres .
L'approbation européenne de la substance active ne laisse pas hors-jeu les instances nationales. La décision d'approbation relève des pouvoirs exécutifs de la Commission européenne mais elle nécessite un vote des États membres regroupés au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Elle est préparée par la direction générale de la santé qui s'appuie sur l'avis scientifique de l'Agence européenne de sécurité des aliments ( EFSA ), créée en 2002. Cependant, cette dernière s'appuie à son tour sur les travaux des autorités compétentes au niveau national, l' Anses dans le cas de la France.
Globalement, la procédure d'évaluation d'une substance active débute par le dépôt par la société phytosanitaire pétitionnaire d'un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente d'un État membre, qui est alors désigné comme État membre rapporteur . Dans le cas où la France est désignée comme État membre rapporteur, lorsque le dossier est déclaré recevable, l'Anses dispose d'un délai d'un an pour évaluer le dossier et rendre à l'EFSA un projet de rapport d'évaluation . L'EFSA assure la diffusion de ce projet auprès des agences compétentes des autres États membres. L'EFSA et les autres États membres disposent alors d'un délai de deux mois pour commenter l'évaluation rédigée par l'Anses. Passé ce délai, l'EFSA renvoie tous les commentaires à l'Anses qui les consolide dans un tableau formaté et les transmet à la société phytosanitaire pétitionnaire en l'invitant à répondre aux différentes observations. Une fois renseigné par le demandeur et annoté par l'Anses, le tableau est retourné à l'EFSA qui a la responsabilité de valider ou d'invalider les réponses apportées. Autant que de besoin, l'EFSA peut réunir des experts mandatés par les agences de l'ensemble des États membres pour discuter certains points particuliers.
À l'issue de cette procédure de revue par les pairs, où les différentes agences nationales débattent et évaluent mutuellement leurs conclusions sous la supervision de l'agence européenne , il revient à l' EFSA de rédiger des conclusions . Ce document sert de fondement scientifique à la prise de décision d'approbation ou de non approbation de la substance active . L'EFSA porte la charge de l'évaluation globale du risque mais n'a pas de contact avec la société pétitionnaire et ne réalise elle-même aucune analyse. Elle joue plutôt un rôle d'arbitre, de garantie et d'harmonisation pour trouver le point d'équilibre entre les agences des États membres.
Au niveau européen, l'évaluation de la substance active se limite à une ou plusieurs « utilisations représentatives » 3 ( * ) . La notion de représentativité n'est pas clairement définie dans la règlementation et ne renvoie qu'à la notion vague de culture répandue. En pratique, le choix est laissé à l'initiative de la société pétitionnaire. Comme l'a reconnu l'EFSA lors de son audition du 26 mai 2016, certaines évaluations sont parfois conduites a minima au niveau européen, l'utilisation représentative étant choisie par le demandeur de façon à minimiser l'impact de l'usage de la substance active, tant au niveau de l'environnement que des écosystèmes.
Un produit phytopharmaceutique contenant une substance approuvée par l'Union européenne doit ensuite faire l'objet d'une deuxième procédure pour autoriser sa mise sur le marché . Cette procédure relève de la compétence des autorités nationales . Il faut toutefois distinguer l'évaluation du produit et la décision d'autorisation. Pour l'évaluation du produit , l'Union européenne est divisée en trois zones Nord, Centre et Sud 4 ( * ) . La France appartient à la zone Sud. Les RUP françaises ne forment pas une zone à part et sont considérées comme faisant partie de la zone Sud en tant que parties intégrantes de la France. 5 ( * ) Lorsque la France est désignée comme rapporteur du produit, l'Anses réalise une évaluation pour l'ensemble de la zone Sud. Les décisions d'autorisation de mise sur le marché ( AMM ) sont en revanche prises pays par pays , la décision de la France n'engage pas les autres pays et réciproquement.
Il n'existe donc pas en principe de libre circulation des produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne. Il existe une base de données des substances approuvées et non approuvées au niveau européen accessibles à tous et une base de données des produits phytosanitaires autorisés dans chacun des pays de l'Union est en cours de développement. Au-delà du cadre commun établi par la liste des substances actives approuvées et les procédures, l'harmonisation complète et la reconnaissance de l'équivalence des AMM entre États membres de l'Union demeurent en chantier .
Cette relative disparité peut causer des distorsions de concurrence entre États européens et même entre RUP, puisque l'Espagne ( Canaries) et le Portugal (Madère, Açores) peuvent faire des choix phytopharmaceutiques différents de ceux de la France. Les conséquences pour les RUP françaises demeurent limitées car leurs agricultures n'entrent pas globalement en concurrence frontale avec les productions des Canaries, des Açores et de Madère, en particulier pour des raisons de différences climatiques. Par exemple, la banane des Canaries est d'une variété très particulière essentiellement consommée sur le marché intérieur espagnol et ne s'écoule pas sur les marchés clients des producteurs martiniquais et guadeloupéens.
Depuis le 2 juillet 2015 , c'est l' Anses et non plus le ministre de l'agriculture qui a compétence pour délivrer ou retirer les AMM en France .
|
La répartition des compétences en matière de normes et de procédures phytosanitaires entre l'Anses et le ministre de l'agriculture Il appartient à l' Anses de : - recevoir, instruire et évaluer sur le plan scientifique et technique, dans le cadre des dispositions règlementaires nationales et européennes, les demandes d'AMM des préparations phytosanitaires (produits chimiques et micro-organismes), des macro-organismes utiles aux végétaux, des produits biocides, des matières fertilisantes et des supports de culture ; - délivrer ou retirer les AMM pour les produits phytopharmaceutiques depuis le 2 juillet 2015 et les permis pour les matières fertilisantes et les supports de culture depuis 1 er août 2015, ainsi que pour leurs adjuvants. - réaliser des inspections sur la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques. Il appartient au ministre de l'agriculture de : - représenter la France au niveau européen pour l'approbation des substances actives ; - donner suite aux avis de l'Anses relatifs aux macro-organismes ; - délivrer des dérogations pour l'utilisation en urgence de produits phytopharmaceutiques pour une période de 120 jours, au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; - apprécier le caractère d'intérêt public d'une demande d'autorisation de produits phytopharmaceutiques pour usage mineur, au titre de l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le ministre peut également s'opposer à une décision de l'Anses, ce qui en provoque la suspension et le réexamen au bout d'une période maximale de 230 jours. |
Les autorités françaises - agence pour l'évaluation du risque et ministère pour la gestion du risque - sont donc au coeur des procédures européennes, même si leur action est contrainte par la stricte réglementation européenne. La constitution du dossier d'autorisation et les procédures d'évaluation sont en particulier strictement encadrées par le règlement (UE) 283/2013, listant l'ensemble des études à fournir pour faire approuver une substance active et par une notice 2013/C 95/01 décrivant les lignes directrices à suivre pour la réalisation des études réclamées. Le règlement (UE) 284/2013 et la notice 2013/C 95/02 déclinent les mêmes principes pour l'AMM d'un produit phytopharmaceutique.
L'architecture qui résulte de l' imbrication des interventions successives des organes européens et nationaux est complexe, mais l'échelon national demeure pertinent pour soutenir et faciliter l'adaptation des normes et des procédures phytosanitaires aux singularités des agricultures des outre-mer, soit directement par l'exercice des compétences dévolues à l'Anses et au ministre de l'agriculture, soit indirectement en portant une demande d'évolution de la politique de l'Union européenne auprès de la Commission et des autres institutions. Ce besoin d'acclimatation se fait d'autant plus ressentir en la matière que les normes et les procédures sont les mêmes en Europe continentale et dans les RUP, sans que soient prévus de dispositifs spécifiques à leur intention .
Cela s'explique par le souci de garantir la même sécurité alimentaire à tous les consommateurs européens, qu'ils résident outre-mer ou non . Si cet objectif doit rester un principe cardinal exclusif de tout infléchissement, ignorer les contraintes spécifiques des RUP françaises est précisément générateur de risque : aussi faut-il faire évoluer les politiques européennes et nationales.
En premier lieu, l'élaboration du contenu des normes et la construction des procédures ne tiennent pas compte des caractéristiques de l'agriculture en contexte tropical si bien que l'application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées sans forte pression de maladies et de ravageurs conduit à des impasses. En second lieu, les caractéristiques économiques des RUP, en particulier la faible structuration des filières de diversification et la faible taille de leur marché pour les firmes phytopharmaceutiques, les empêchent de mener à leur terme les procédures d'homologation, même pour des substances et des produits qui ne posent pas de problème sanitaire.
(2) Des cultures tropicales pénalisées par un cadre rigide et inadapté
Les filières agricoles des outre-mer souffrent dans leur globalité d'être enfermées dans une impasse phytosanitaire due à la prégnance des usages orphelins, à la fragilité de la couverture phytopharmaceutique, à l'absence de réponse contre des ravageurs dévastateurs, à une réglementation des conditions d'utilisation des produits inadaptée à une utilisation en climat tropical, à des dérogations difficiles à mettre en oeuvre et à des interprétations françaises particulièrement rigoureuses des normes européennes.
De nombreuses filières agricoles ultramarines sont caractérisées par un faible choix ou par l'absence de produits phytopharmaceutiques homologués et adaptés aux contextes des cultures tropicales outre-mer. Selon le ministère de l'agriculture, seuls 29 % des usages phytosanitaires 6 ( * ) sur cultures tropicales étaient couverts en 2013 , ce qui reste très insuffisant pour garantir la sécurité des récoltes des producteurs et relancer certaines filières. La moyenne nationale qui a récemment baissé avec le tournant de l'agroécologie est d' environ 80 % de couverture.
La lourdeur du cadre réglementaire entraîne l'existence d'usages orphelins. En effet, la démarche d'homologation d'un produit phytopharmaceutique dépend de l'initiative des firmes productrices . Étant donné le coût et la complexité des procédures , ces sociétés décident de l'opportunité de demander une AMM en fonction de leurs espérances de chiffres d'affaires et de bénéfices. Or, les cultures tropicales des RUP françaises constituent des marchés modestes en comparaison aussi bien des grandes cultures d'Europe continentale que des mêmes cultures dans les pays tiers concurrents comme le Brésil par exemple. Le problème réside moins dans l'inexistence ou le faible développement de solutions phytopharmaceutiques pour des usages tropicaux que dans l' indisponibilité des produits dans les RUP dès lors que les firmes ne souhaitent pas s'engager dans les procédures européennes et françaises.
L'étroitesse des marchés ultramarins n'incite pas les opérateurs à engager les démarches nécessaires à l'homologation de produits au niveau national ou de substances actives au niveau européen . De fait, les opérateurs ne s'intéressent pas, ou très peu, aux outre-mer. Cette étroitesse des marchés est exacerbée dans le cas des cultures de diversification dont les filières sont particulièrement peu organisées et les surfaces cultivées très réduites.
Analyse des usages par culture
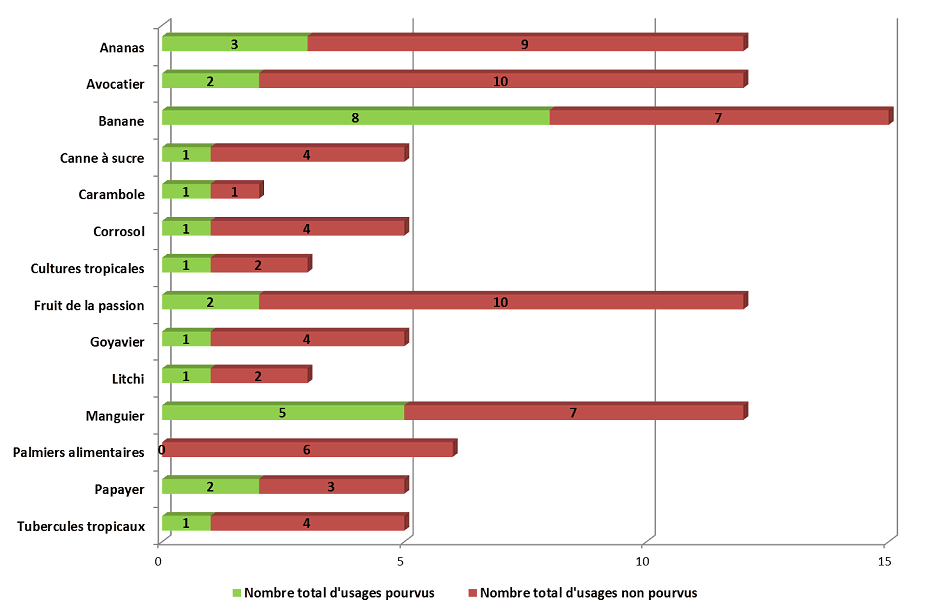
Source : document IT2 - Préparation du bilan d'étape des actions relatives à la protection des cultures tropicales
L'exemple de l'ananas est certainement le plus évocateur depuis le développement d'un champignon, le phytophthora, qui fait fortement chuter les rendements, dans une des variétés les plus recherchées par le consommateur. Des traitements fongicides réguliers pendant la période de production, tels qu'ils sont pratiqués dans des pays tiers, sont efficaces, mais ils ne sont pas autorisés en France. Par ailleurs, cette culture est victime d'autres usages orphelins et les producteurs ne peuvent que difficilement contenir d'autres bioagresseurs tels que fourmis et cochenilles. C'est pourquoi on note un net recul de cette culture aux Antilles, au profit d'importations.
Les racines et tubercules vivrières souffrent également de l'indisponibilité des solutions chimiques de désherbage qui permettraient aux producteurs de diminuer le poste de dépenses en main d'oeuvre.
Une culture plus importante en termes de volume produits et de valeur des échanges comme la banane bénéficie d'un taux de couverture plus favorable de 60 % et la plupart de leurs usages prioritaires couverts. Toutefois, même dans ces cas plus favorables, la couverture est insuffisante et peut laisser craindre des risques de résistance à force de n'utiliser qu'une gamme très réduite de produits .
Même pour des usages sur le bananier ou la canne à sucre, la complexité de la procédure d'AMM dissuade les firmes phytosanitaires de déposer une demande. Pour minimiser leurs coûts, elles ne se lancent dans l'homologation auprès de l'Anses d'un produit phytopharmaceutique sur cultures tropicales utilisable dans les DOM qu'à une double condition :
- le produit est déjà autorisé sur une autre culture en France ;
- le produit est déjà développé et utilisé sur la même culture tropicale ailleurs dans le monde 7 ( * ) .
La première condition permet d'utiliser l'article 51 du règlement ( CE) 1107/2009 pour solliciter une extension d'autorisation d'un produit disposant déjà d'une AMM en France pour certains usages vers des utilisations mineures sur d'autres cultures. Même la banane et la canne au vu des surfaces cultivées dans les DOM peuvent bénéficier d'un usage secondaire et de faible ampleur d'un produit utilisé sur une culture représentative très répandue dans l'Hexagone. Par exemple, les firmes homologuent des produits sur différentes céréales comme le maïs et le blé et demandent ensuite des extensions d'homologation sur la canne à sucre.
La seconde condition permet de disposer immédiatement d'un corpus de données techniques et scientifiques nécessaires pour monter un dossier d'autorisation. Cependant, certains essais et tests doivent encore être réalisés pour satisfaire les exigences de l'Anses.
Ces procédures d'extension pour usage mineur constituent moins des dérogations souples et fluides pour accélérer le traitement des dossiers que des voies obligées et indispensables sans lesquelles les usages orphelins se multiplieraient au détriment des agricultures ultramarines. Elles constituent donc de vraies nécessités sans lesquelles la réglementation européenne et nationale se révèlerait totalement paralysante . C'est le cas pour la banane comme pour la canne et a fortiori pour les filières de diversification végétale, même s'il demeure plus difficile pour ces dernières de s'organiser pour soutenir une demande d'extension d'usage.
La maîtrise des dégâts provoqués par divers ravageurs ou maladies ne peut pas toujours passer par des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques, souvent difficiles à mettre en oeuvre. De plus, les procédures d'homologation étant particulièrement longues et complexes, des solutions trouvées sur le terrain et à l'efficacité démontrée ne peuvent être appliquées à temps pour répondre aux besoins urgents des producteurs qui doivent faire face à des retraits de produits pour lesquels les procédures sont beaucoup plus rapides.
Il convient de distinguer la question de la rentabilité des filières et celle de leur existence même : certaines maladies ou ravageurs font de tels dégâts que le retrait ou le non-renouvellement de l'homologation d'un produit phytopharmaceutique efficace, par exemple contre la cercosporiose du bananier ou l'enherbement de la canne, risquerait d'entraîner l'effondrement de la filière.
En effet, la canne est une graminée qui souffre de la concurrence foisonnante des autres graminées de la zone tropicale. À La Réunion , environ 210 espèces de mauvaises herbes ont été recensées. Après un mois sans traitement herbicide, un champ perd en moyenne entre 300 kg et 500 kg de canne à l'hectare par jour, ce qui équivaut à une perte de 10 % du potentiel de production après 15 jours de retard.
C'est pourquoi les producteurs de canne des Antilles et de La Réunion sont particulièrement inquiets de l'évolution du dossier de l' asulox , un herbicide indispensable dont la substance active, l'asulam, s'est vue retiré son autorisation au niveau européen en 2011. La date de fin d'utilisation de l'asulox en France était fixée au 31 décembre 2012 . En cas d'urgence phytosanitaire, l'article 53 du règlement (CE) 1107/2009 permet au ministre de l'agriculture de délivrer des AMM temporaires d'une durée maximale de 120 jours . Étant donné l'impact économique majeur de la filière canne-sucre-rhum dans les DOM, l'asulox a bénéficié de plusieurs AMM dérogatoires uniquement à des fins de désherbage dans les champs de canne, encore dernièrement le 20 mai 2015 et le 3 février 2016. Parallèlement, un dossier de réapprobation de la substance active, l'asulam, a été déposé. Il a été jugé recevable par l'Union européenne et devait être examiné par le Royaume-Uni désigné comme État membre rapporteur, avant le référendum du 23 juin 2016.
Parfois, malheureusement, le ministre de l'agriculture oublie d'étendre correctement, c'est-à-dire par exemple en tenant compte des contraintes saisonnières, les AMM temporaires aux outre-mer, lorsque la même culture existe dans l'Hexagone. Le melon de Guadeloupe en fournit un exemple très récent. Le produit fongicide dénommé Switch à base de cyprodinyl et de fludioxonil bénéficie d'une homologation temporaire de 120 jours jusqu'au 30 août 2016. Le problème est que cette homologation est basée sur les périodes de production métropolitaines (Charente, Vaucluse) et ne couvre pas la période de production antillaise. Ce fongicide ne peut donc pas être utilisé en Guadeloupe, ce qui menace la production melonnière.
La méconnaissance des caractéristiques de la production agricole dans les RUP nuit considérablement à la lutte contre les ravageurs inconnus en Europe continentale. La fourmi manioc est ainsi présente à la Guadeloupe et en Guyane. Cet insecte constitue un problème majeur pour les agriculteurs, voire un frein au développement ou au maintien de certaines cultures. Les petits planteurs sont complètement démunis face à un ravageur qui peut défolier complètement une culture en l'espace de 24 heures : c'est le cas de la patate douce, de l'igname ou des agrumes par exemple. Or, actuellement, les produits disponibles contre la fourmi manioc sont classés comme biocides 8 ( * ) et ne peuvent donc être utilisés sur des cultures de plein champ. C'est une lacune dans la réglementation européenne et nationale qui n'a pas prévu d'usage agricole des moyens de lutte contre la fourmi manioc. Il appartient au ministère de l'agriculture de créer cet usage pour permettre à l'Anses d'autoriser une préparation phytopharmaceutique.
Si la fourmi manioc est un ravageur direct pour les cultures, d'autres espèces de fourmis sont sources de dégâts indirects qui nécessiteraient aussi des usages agricoles manquant à l'heure actuelle : on peut citer le cas des cultures d'ananas, où les fourmis contribuent à maintenir une forte population de cochenilles. Dans les champs de canne à sucre, les fourmis peuvent être des sources de nuisance importantes pour les ouvriers agricoles. À cet égard, le retrait de l'approbation au niveau européen du fipronil , une substance active présente dans des insecticides, est perçu avec inquiétude par les producteurs guadeloupéens auditionnés le 12 mai 2016.
|
La gestion du dossier du fipronil au niveau européen Le fipronil a été évalué au niveau européen en 2005-2006, la France étant l'État membre rapporteur. Les usages représentatifs considérés ont été le traitement des semences de maïs et de tournesol. La substance active sera réévaluée dans le cadre du renouvellement des autorisations en 2017, la soumission du projet de rapport d'évaluation préparé par l'Autriche et les Pays-Bas étant prévue fin janvier 2017. L'usage de cette substance active pour la lutte contre la fourmi manioc n'a donc pas été pris en compte au niveau européen et par l'EFSA . Si un usage agricole du fipronil contre la fourmi manioc était envisagé, il conviendrait de déposer un dossier d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre, comme l'Anses en France. L'EFSA ne sera saisi sur ce dossier que dans la mesure où l'usage revendiqué nécessiterait une modification des LMR pour la culture concernée. Conformément au règlement (CE) 396/2005, cette évaluation se limiterait à une proposition de LMR et à l'évaluation du risque pour les consommateurs. L'impact sur l'environnement (transfert dans les eaux...), l'impact sur les écosystèmes (abeilles, faune aquatique...) ne seraient pas examinés par l'EFSA, ces points devant être pris en compte par l'État membre lors de l'examen du dossier d'autorisation du produit phytopharmaceutique. De même, l'exposition des consommateurs aux résidus de pesticides tenant compte de la spécificité des régimes alimentaires des populations des RUP ne serait pas prise en compte par l'EFSA. En outre, l'EFSA n'a pas compétence pour l'évaluation de l'utilisation des substances actives dans le cadre d'un usage non-agricole (ex : usage domestique du fipronil pour lutter contre les fourmis...). Ce type d'utilisation relève de la réglementation biocides (règlement (EU) 528/2012) dont l'évaluation est assurée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
Source : EFSA
Par ailleurs, les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés par l'Anses sont généralement adaptées à un usage en climat tempéré . Dans les DOM, les conditions météorologiques (vent, température, pluviométrie) sont nettement différentes et jouent sur la rémanence des matières actives. Elle est bien souvent inférieure à 8 ou 10 jours en raison d'une évaporation supérieure. Lorsque le nombre d'applications autorisées par saison, calculé dans les conditions « normales » de l'Hexagone est limité, les agriculteurs se retrouvent dans des impasses techniques. En effet, le nombre maximal d'applications est défini sur une période végétative plus courte que celle qui prévaut en contexte tropical alors qu'une réduction des doses couplée avec une augmentation de la fréquence de traitement permettrait d'adapter les conditions d'utilisation aux périodes végétatives plus longues que connaissent les DOM .
De nombreuses restrictions d'utilisation très contraignantes se sont empilées ces dernières années, que cela soit la réduction du nombre d'applications, l'extension des zones non traitées (ZNT) ou l'allongement des délais de traitement avant récolte. Ces restrictions sont en partie dues au manque de données disponibles pour évaluer les risques en milieu tropical , tant au niveau de la France que de l'Union européenne.
Compte tenu du faible nombre de substances autorisées, il semble donc que les productions de banane et de canne dans les RUP françaises soient à la merci du moindre retrait de produits phytosanitaires , et que les autres productions connaissent déjà une impasse phytosanitaire qui précipite leur déclin et grève toute possibilité de développement.
b) Des pays tiers favorisés à la production et à l'exportation
(1) Un différentiel normatif qui renforce la compétitivité des pays tiers
Les pays tiers bénéficient de différentiels de compétitivité considérables par rapport aux RUP, quelle que soit la filière agricole considérée, en raison d'un coût du travail très faible et d'une législation du travail souvent sommaire. D'après le ministère de l'agriculture, la main d'oeuvre représente 27 % des coûts de production des bananeraies françaises et le salaire d'un employé de bananeraie en Afrique (Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun) ou en Amérique latine (Costa Rica, Colombie, Équateur) est 15 fois moins élevé qu'en France. Pour la filière canne, la faible taille des exploitations qui restreint les économies d'échelle est un désavantage net, y compris par rapport aux exploitations betteravières de l'Hexagone. Par comparaison avec le Brésil, les coûts de production de sucre sont trois plus élevés dans les DOM.
L'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN) a estimé à 150 euros par tonne de banane le surcoût global lié aux normes en incluant les normes sanitaires et environnementales, en matière de protection des salariés (tenues, équipements), de conditionnement et de recyclage des déchets. Les surcoûts liés aux normes phytosanitaires, calculés après déduction des surcoûts de main d'oeuvre, représentent 15 à 20 % du prix de vente.
L'importance des usages phytosanitaires non couverts dans les DOM amplifie les distorsions de concurrence avec les producteurs de cultures tropicales des pays tiers, qui peuvent avoir accès à des itinéraires techniques recourant à des traitements chimiques non disponibles pour les agriculteurs ultramarins. Les cultures des pays tiers concurrents des productions des RUP françaises sont favorisées par la conjonction d'une palette plus large de produits phytopharmaceutiques autorisés et d'une politique commerciale européenne favorable . En outre, lorsqu'il n'existe pas de traitement chimique autorisé pour certaines maladies, la contrainte normative renforce la contrainte salariale, puisque le recours à des traitements manuels comme l'effeuillage contre la cercosporiose revient beaucoup moins cher dans les pays tiers.
D'une part, les producteurs des RUP ne peuvent pas recourir à certains produits librement utilisés dans les pays concurrents voisins, mais pour lesquels aucune demande d'AMM n'a été déposée en France. D'autre part, des autorisations d'usage sont accordées dans les pays tiers pour des substances interdites dans l'Union européenne ou des produits non autorisés en France et les productions ainsi traitées sont exportées vers le marché européen .
Pour traiter la cercosporiose , les producteurs des Antilles ne peuvent utiliser que deux produits autorisés, issus d'un laboratoire suisse et homologués pour dix ans. Ils procèdent à environ 7 traitements par an . Par comparaison, les concurrents africains et sud-américains peuvent utiliser au moins 50 produits . Le Costa Rica procède à un traitement tous les cinq jours, soit 65 applications par an et l'Équateur à 40 traitements par an . En outre, les planteurs de Guadeloupe et de Martinique ne peuvent plus recourir à l'épandage aérien depuis son interdiction en réponse à des contestations locales, qui ne doivent rien à l'intervention de la réglementation européenne. Les traitements terrestres sont plus coûteux que l'épandage aérien autorisé dans tous les pays concurrents, qui ont d'ailleurs racheté le matériel des bananeraies françaises qu'ils utilisent au traitement de leur production bio, notamment en République dominicaine.
Plusieurs produits phytosanitaires ont été retirés d'Europe ou très sévèrement contraints et continuent à être utilisés ailleurs. Au Costa Rica et en Colombie, de nombreux producteurs de bananes destinées à l'exportation continuent d'appliquer trois ou quatre traitements nématicides par an en alternant des produits à base de terbufos, de cadusafos ou d'oxamyl , des nématicides 9 ( * ) qui sont interdits en France depuis plusieurs années. Les producteurs de canne mentionnent ainsi le recours à l'atrazine , qui n'est pas autorisée dans l'Union européenne. Ils invoquent également le cas du diuron , qui est autorisé mais en fixant des limites maximales de résidus à la limite de détection, ce qui implique qu'aucune trace ne doit être retrouvée dans le sucre issu de la canne traitée. Ces produits peu onéreux sont également à large spectre , ce qui est particulièrement avantageux dans la compétition internationale féroce sur le marché du sucre de canne, qui s'accroîtra encore en 2017 avec la fin des quotas sucriers de l'Union européenne. De fait, les planteurs guadeloupéens, martiniquais et réunionnais ne traitent pas leur canne avec ces substances à la différence de leurs concurrents du Brésil, de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, grands producteurs de sucre avec lesquels l'Union européenne ouvre des négociations commerciales.
D'autres produits, utilisables sans contrainte dans les pays tiers , sont autorisés en France mais sont soumis à des restrictions d'utilisation importantes. C'est le cas par exemple du diquat , un herbicide restreint à une seule application par an et uniquement la première année de plantation, ou du glufosinate autorisé pour deux applications par an alors qu'il est utilisé à 6 ou 7 applications par an ailleurs. Ces restrictions touchent aussi des produits à plus faible risque compatibles avec l'agriculture biologique : le nombre d'applications autorisées d'huile minérale paraffinique, le banole , sur la banane est très restreint aux Antilles, alors que cette huile est utilisée quasi systématiquement dans les pays tiers.
L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires dit « accord SPS » a été négocié dans le cadre du cycle de l'Uruguay du GATT. Il est entré en vigueur le 1 er janvier 1995 au moment de la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il prévoit que les membres de l'OMC doivent établir leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur la base des normes et recommandations internationales fixées dans le Codex Alimentarius créé par la FAO et l'OMS, dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et par l' Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Toutefois, dans le domaine sanitaire et phytosanitaire, les règles européennes sont plus strictes que les normes et recommandations internationales, en particulier lorsque les conclusions de l'analyse de risque effectuée par l'Union européenne diffèrent de celles des organismes internationaux. Malgré le travail de rapprochement des normes alimentaires entrepris au sein du Codex alimentarius , de nombreuses différences persistent donc au niveau international en matière de « bonnes pratiques agricoles » (GAP). Ainsi les limites maximales de résidus (LMR) proposées par les États-Unis ou le Canada sont souvent plus élevées que les valeurs européennes . Elles reposent sur des doses d'application plus élevées. Surtout la réglementation nord-américaine permet le même jour d'appliquer une substance active, puis de récolter.
Les filières ultramarines , notamment celles qui sont exportatrices et fortement structurées comme la canne et la banane, ne demandent pas le démantèlement de protections sanitaires française et européenne, même si un allègement des procédures serait bienvenu. Dès lors que la pérennité des cultures est assurée par la garantie d'une couverture phytosanitaire de base , elles sont prêtes à poursuivre les démarches inspirées par l'agroécologie qu'elles ont engagées et désirent plutôt valoriser leurs efforts et leur mieux-disant environnemental auprès du consommateur .
Depuis le scandale du chlordécone, avec le plan « banane durable » de 2009, les planteurs ont entrepris une diminution volontariste de l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques . Entre 2006 et 2013, l'emploi des pesticides sur la banane a ainsi diminué de 50 %, grâce au développement de techniques alternatives . Lors de son audition du 17 mars 2016, Mme Olivia Meiffren, consultante du cabinet Blezat Consulting mandaté par les ministères de l'agriculture et de l'outre-mer fin 2013 pour évaluer le plan banane durable sur la période 2007-2013, a ainsi résumé ses résultats :
« Ce plan, qui a bénéficié de gros moyens financiers, est exemplaire dans le sens où il a intégré des actions sur l'ensemble de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Il y a eu de la recherche et du développement, les producteurs ont été accompagnés, des actions sur la communication et la commercialisation ont été menées. On peut citer la création de l'Institut technique tropical (IT2) ou les 525 000 heures de formation des producteurs et des salariés. C'est un plan intégrateur comme il en existe peu dans les filières agricoles françaises. Fin 2013, les efforts se sont traduits par une forte baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires, insecticides et nématicides, et une réduction plus faible sur les herbicides. Nous avons constaté un léger retard de la Guadeloupe par rapport à la Martinique sur la diffusion et le transfert des pratiques mais la dynamique était identique. Des pratiques culturales plus durables ont été relevées comme la lutte « bio » sur certains insectes, l'effeuillage des bananiers pour maîtriser la cercosporiose, la jachère pour assainir les parcelles, l'utilisation de plantes de couverture pour limiter les herbicides ou en matière de conditions de travail dans les exploitations, notamment liées à la certification. Notre étude s'achève sur le constat du retour de la biodiversité dans les exploitations, du maintien de la production et des emplois, avec cependant une baisse certaine bien que modérée du rendement. »
La filière de la canne de La Réunion partage les mêmes orientations, ainsi qu'elle l'a rappelé lors de son audition du 21 mars 2016. Grâce aux solutions variétales développées dans le seul centre européen de sélection de canne à sucre , qui se trouve à La Réunion, et grâce aux efforts menés dans le cadre de la lutte biologique contre le ver blanc et le foreur, la culture de la canne ne requiert plus de fongicide ou d'insecticide . Enfin, les itinéraires techniques des herbicides tendent à faire baisser l'indice de fréquence de traitement (IFT) 10 ( * ) a un peu plus de 3, ce qui est très inférieur à l'indice utilisé dans le maraîchage qui oscille entre 28 et 30.
Pour réduire le différentiel de compétitivité normative qui grève l'économie des outre-mer , il faut à la fois résoudre la question des usages phytosanitaires orphelins qui mettent en péril l'existence des filières agricoles et obtenir une égalité des armes sur les marchés internationaux en relevant les standards applicables aux conditions de production dans les pays tiers . L'écart de coût de main d'oeuvre ne peut pas être résorbé avant un très long terme, c'est donc en imposant à l'entrée du marché européen des normes environnementales et sanitaires de production exigeantes que l'on peut rétablir un certain équilibre entre les DOM et les pays à bas salaires. Plutôt qu'un alignement sur le moins disant, qui serait incompatible avec les légitimes attentes du consommateur européen et des salariés ultramarins, il faut reconnaître et soutenir le travail de réduction des phytopharmaceutiques. Cependant, cette démarche ne peut réussir que si l'on s'assure de la cohérence entre elles des politiques agricole, sanitaire et commerciale . En particulier, les contrôles à l'importation en provenance de pays tiers qui utilisent des substances sans AMM, voire positivement interdites dans l'Union européenne, représentent un enjeu crucial.
(2) Des contrôles des importations en trompe l'oeil
En matière de contrôle des importations, il peut à première vue sembler que le système européen est solide et contraignant pour les pays tiers concurrents des outre-mer.
En vertu de l'accord SPS précité, les pays tiers s'engagent à respecter les normes sanitaires et phytosanitaires de l' Union européenne pour les produits qu'ils exportent vers ce marché. Dans le cadre de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), les pays membres de l'OMC sont aussi tenus de notifier l'adoption de normes agricoles.
Pour l'exportation d'animaux et de produits animaux , chaque pays tiers doit être autorisé par l'Union européenne pour chaque filière . Pour cela, il doit s'engager à mettre en place des plans de surveillance sanitaire en conformité avec les dispositions européennes. De plus, chaque établissement de produits animaux doit être également autorisé par les autorités européennes. L'émission d'un certificat sanitaire par le pays tiers , contrôlé lors de l'importation par les services français, est censée garantir le respect de ces conditions pour chaque lot exporté.
Pour l'exportation de végétaux et de produits végétaux , le respect des normes portant sur la santé humaine repose sur un plan de surveillance à l'importation dans un cadre européen, mis en oeuvre par les autorités françaises . Devant l'impossibilité matérielle de contrôler chaque lot au regard des volumes échangés, il est procédé par sondage selon des analyses de risques par filières d'importation et des prélèvements pour analyse en laboratoire sont réalisés pour contrôler le respect des LMR . Pour un certain nombre de végétaux à risques, qui pourraient être porteurs de maladies ou de parasites nouveaux, un certificat phytosanitaire émis par le pays tiers doit garantir qu'une inspection a été conduite en vue de vérifier la conformité aux normes européennes du lot exporté. Théoriquement, si le pays tiers n'a pas la capacité de délivrer les certificats phytosanitaires, il ne peut exporter vers l'Union européenne.
Cependant, la construction au niveau européen du système de contrôle des importations est faussée par plusieurs biais, qui empêchent de rééquilibrer l'écart de compétitivité normative dont souffrent les RUP et qui créent les conditions d'une concurrence déloyale des pays tiers.
D'une part , tout l'édifice repose sur les limites maximales de résidus (LMR) . Même si les LMR de pesticides applicables pour les produits alimentaires sont les mêmes pour les produits d'origine européenne que pour les produits importés des pays tiers, cela ne permet pas de considérer qu'il existe une équivalence entre les normes de production sur le sol européen et celles qui prévalent dans les pays tiers. Les denrées importées des pays tiers ne sont pas couvertes par les mêmes contraintes et garanties sanitaires et phytosanitaires que celles qui sont produites dans l'Union Européenne, y compris dans les RUP. Le degré d'exigence des normes de production sur le sol européen n'est pas le même que celui des normes de mise sur le marché des produits en provenance des pays tiers . Cette évidence doit être rappelée contre la fiction parfois entretenue par certaines déclarations imprécises tant des services de la Commission européenne que des ministères français, selon lesquelles tous les produits destinés au marché de l'Union européenne doivent respecter les normes européennes.
Il faut en fait distinguer trois niveaux de réglementation selon que la denrée est produite en France, dans l'Union européenne ou dans un pays tiers :
- les denrées d'origine française doivent respecter les LMR, ne pas contenir de résidus de substances actives non autorisées au niveau européen et ne pas avoir été traitées avec un produit phytopharmaceutique n'ayant pas reçu en France d'AMM pour l'usage considéré. Les délivrances d'AMM prennent en compte d'autres critères que la santé du consommateur ; elles considèrent aussi les effets sur les producteurs qui utilisent le produit et les effets sur l'environnement (pollution des sols et des eaux par exemple), difficilement opposables à des pays tiers ;
- les denrées en provenance de pays de l'Union européenne doivent respecter les LMR et ne pas contenir de résidus de substances actives non autorisées ;
- les denrées en provenance de pays tiers n'ont que les LMR à respecter, sans que soient prises en compte les conditions de production. En effet, les pays tiers bénéficient de tolérances à l'importation prévues spécifiquement pour permettre l'entrée de produits agricoles traités avec des substances interdites dans l'Union européenne . Pour toute substance active non approuvée au niveau de l'UE ou non autorisée en France, une LMR par défaut peut être fixée sur demande d'un importateur ou d'un fabricant de produit phytosanitaire. C'est cette LMR par défaut qui est opposée aux produits importés alors que les producteurs ultramarins sont tenus à un strict respect de la réglementation. Même si la LMR est très basse, il existe donc bien des cas où les produits agricoles des pays tiers peuvent être commercialisés auprès des consommateurs de l'Union européenne après avoir subi des traitements phytosanitaires avec des substances interdites en Europe ou en France.
En se bornant uniquement aux contrôles des résidus de pesticides , on constate que les denrées issues des pays tiers présentent un taux de non-conformité supérieur aux productions européennes . D'après les données du ministère de l'agriculture et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF) , l'analyse des taux de non-conformité observés dans les plans de surveillance des fruits et légumes fait apparaître des taux systématiquement supérieurs pour les produits en provenance des pays tiers : 3,3 % contre 1,6 % en moyenne en 2014 .
Au niveau de toute l'Union européenne , d'après la DG Santé de la Commission européenne, en 2013, 80 967 échantillons de produits agricoles et de produits alimentaires fabriqués ont été analysés pour les résidus de 685 substances distinctes. Le pourcentage des échantillons de produits en provenance de pays tiers qui dépassaient en 2013 les limites légales était de 5,7 %, soit presque 4 fois supérieur à celui constaté sur les produits européens qui s'élevait à 1,4 %. Le taux de non-conformité était encore plus élevé, soit 6,5 % en 2014, pour les pays tiers soumis à des contrôles renforcés en application du règlement (CE) n° 669/2009.
Les difficultés fondamentales qui grèvent la gestion des importations sont amplifiées dans les RUP qui subissent une double concurrence de la part des pays tiers :
- à l'export sur le marché européen sur les produits phare que sont la banane , le sucre et le rhum ;
- sur les marchés locaux des DOM sur les produits issus de filières de diversification végétale et animale.
La porosité des outre-mer aux importations des pays tiers est avérée. Elle contribue à enfermer les économies ultramarines dans un cercle vicieux qui mine leurs capacités de développement endogène et les fait dépendre toujours davantage de subventions. En effet, plus la concurrence sur le marché local est rude et plus les filières de diversification persistent dans leur relative inorganisation et ne peuvent dégager les ressources pour résoudre le problème des usages orphelins, s'engager dans des démarches de labellisation ou d'agriculture bio, si bien que les économies des outre-mer restent éminemment dépendantes des grandes cultures de la banane et de la canne. Or, celles-ci sont elles-mêmes fragilisées par le changement climatique (salinisation, sécheresse, épisodes violents) et surtout touchées de plein fouet par la multiplication des accords de libre-échange de l'Union européenne qui troque les productions agricoles tropicales des RUP contre l'ouverture putative des marchés industriels et de services des pays tiers. La seule réponse de l'Union européenne est alors de prévoir des compensations financières via le POSEI, tant que le contexte budgétaire le permet .
Du point de vue économique comme phytosanitaire, les flux mal contrôlés en provenance de l'environnement régional immédiat peuvent entraîner des conséquences désastreuses. Rien qu'en 2015, au moins trois nouvelles crises phytosanitaires sont apparues qui risquent de provoquer des dégâts dans les DOM : la crise provoquée par la détection de xyllela fastidiosa une bactérie ravageuse de nombreux arbres fruitiers (orangers, citronniers, avocatiers, pruniers) ; la crise en République Dominicaine due à la détection de la mouche méditerranéenne des fruits ( ceratitis capitata ) ; la prégnance en Amérique du Sud de deux maladies des bananiers transmissibles par de la terre contaminée, la fusariose et la maladie moko .
Une mobilisation des autorités françaises et européennes paraît donc nécessaire pour repenser les échanges avec les pays tiers , très favorisés au détriment des RUP.
2. Les collectivités dotées d'un statut d'autonomie : une adaptation qui combine exigence et insertion régionale
a) Saint-Pierre-et-Miquelon
Bien que Saint-Pierre-et-Miquelon constitue une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution, les normes qui s'y appliquent en matière d'agriculture, d'élevage et d'aquaculture (recours aux pesticides et herbicides, intrants, AMM, LMR, vaccinations et conditions d'abattage) sont les normes françaises . L'article L. 273-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que : « la réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière » .
Aucun impact négatif du cadre réglementaire sur la production n'a été démontré à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes françaises ne semblent pas un obstacle à la production locale, à l'exportation ou à la rentabilité des exploitations.
La raison de cette exception parmi les outre-mer soumis à la réglementation nationale tient essentiellement aux particularités géographiques de l'archipel. En effet, Saint-Pierre-et-Miquelon se distingue en étant la seule collectivité ultramarine dont le climat n'est pas tropical. Les conditions météorologiques rigoureuses ne sont pas favorables à l'agriculture intensive, si bien qu'il n'y existe pas de culture céréalière ou légumière, la totalité de la surface agricole utile étant composée de prairies permanentes ou temporaires. Le recours aux produits phytosanitaires est donc très restreint en agriculture. Les contraintes pour la culture sous serre sont les mêmes que dans l'Hexagone. On peut d'ailleurs considérer que la période plus longue de gel et les températures plus basses réduisent significativement la diffusion des maladies par rapport à l'Europe continentale. L'agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon ne souffre donc pas particulièrement des normes sanitaires françaises, et par ricochet européennes, qui lui sont appliquées.
Par ailleurs, les exportations concernent essentiellement les produits de la pêche, et très majoritairement sous la forme surgelée . Les marchés cibles sont la France , le Canada et les États-Unis . Les importations proviennent des mêmes pays . Saint-Pierre-et-Miquelon est donc imbriqué dans un réseau d'échanges commerciaux avec des pays à niveau de normes sanitaires élevé. Ses concurrents sont aussi ses clients, en particulier le Canada, sans qu'il existe de véritable distorsion de concurrence due aux normes. C'est pourquoi le régime français et européen ne constitue pas un handicap ; il est même au contraire adapté pour répondre aux exigences des contrôles à l'importation américains et canadiens.
Du point de vue du droit communautaire, Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la catégorie des pays et territoire d'outre-mer ( PTOM ). Dans ses échanges avec l'Union européenne , cette collectivité est assimilée à un pays tiers . Elle a dû être inscrite sur la liste des pays et territoires autorisés pour pouvoir exporter des produits de la pêche vers l'Union Européenne. En revanche, l' absence de laboratoire capable sur place d'effectuer toutes les analyses requises pour contrôler la qualité des coquillages a fait échouer la demande d'agrément pour l'exportation de mollusques bivalves vivants et d'échinodermes sur le marché européen. De même, Saint-Pierre-et-Miquelon est reconnu comme station de quarantaine agréée par l'Union européenne, ce qui lui permet de figurer sur la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation d'animaux et viandes fraîches est autorisée.
De ce point de vue, les relations commerciales de Saint-Pierre-et-Miquelon avec l'Union européenne ne diffèrent pas sensiblement de celles qui prévalent avec le Canada. La collectivité est en effet reconnue également comme station de quarantaine agréée par le Canada . Elle peut également exporter des produits de la pêche vers le Canada et les États-Unis . Un protocole spécifique a été établi pour pouvoir livrer des buccins vivants, issus de la pêche locale, au Canada.
Depuis 2010, Saint-Pierre-et-Miquelon a engagé des discussions avec le Canada et l'Union Européenne pour se voir autoriser l'exportation de viandes de volaille en conserve vers ces deux marchés. Le dossier est en bonne voie grâce au travail réalisé par les services et les mises aux normes canadiennes des installations par les entreprises. La difficulté majeure ne relève pas en effet de l'application des normes sanitaires françaises et européennes sur l'archipel, mais de la nécessité d'appliquer les normes canadiennes pour une éventuelle exportation nécessaire à l'essor des entreprises locales. La reconnaissance par le Canada du statut zoosanitaire de l'archipel et des conditions de préservation de l'hygiène des viandes est très importante pour le développement économique de l'industrie agroalimentaire du territoire.
Vos rapporteurs ont également examiné avec attention le développement du secteur aquacole de Saint-Pierre-et-Miquelon . L'entreprise EDC, qui porte l'aquaculture locale, développe depuis 2002 l'élevage de coquilles Saint-Jacques ( placopecten magellanicus ) en pleine mer . Après plusieurs années de recherche sur la biologie de l'animal et de mise au point technique, elle maîtrise la production de naissain et l'élevage des animaux au stade de juvéniles, ce qui permet un ensemencement en mer pour achever le grossissement et obtenir un produit de taille satisfaisante selon les critères de mise en marché. Avec le soutien de la collectivité territoriale un plan d'ensemencement en mer débuté en 2005 sur des zones contrôlées est suivi dans la durée, sachant que le cycle d'une coquille en mer est d'environ 5 ans. Le soutien public dans ces phases de recherche et développement reste primordial. L'augmentation régulière des volumes ensemencés doit progressivement aboutir à une quantité significative de récolte. Il reste à finaliser les protocoles de recapture pour obtenir une chaîne de production industrielle viable.
Ce produit haut de gamme à forte valeur ajoutée est destiné à l'export , la consommation locale ne permettant d'écouler que de petits volumes.
Le marché européen et en particulier français est un débouché naturel en coquilles surgelées d'autant que la production hexagonale ne couvre pas la demande, notamment en contre-saison. L'interdiction d'exporter vers l'Union européenne des mollusques bivalves vivants issus de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon, faute de moyens de contrôle suffisants, déjà évoquée, ne constitue pas un obstacle pour la coquille Saint-Jacques pour deux raisons :
- dès lors qu'elles sont ensemencées en mer, au bout de trois ans en milieu naturel , les coquilles entrent dans la catégorie des produits de la pêche qui subissent beaucoup moins de restrictions à l'entrée sur le marché européen que les produits de l'aquaculture stricto sensu ;
- en l'absence de possibilités logistiques sûres et à tarif raisonnable sur le frais vers l'Europe, seule l'exportation de surgelés est économiquement viable .
La proximité de marchés nord-américains constitue également une opportunité. Le marché de Boston est à la fois proche et important en matière de volumes de produits frais mis sur le marché. Les exportations réalisées sur le marché américain n'ont pas posé de difficultés en matière de standards alimentaires et de certificats sanitaires.
D'après M. Benoît Germe, représentant de la société EDC, et Mme Carole Coquio, adjointe au chef du service de l'alimentation à la Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, auditionnés par visioconférence le 21 mars 2016, le marché canadien est beaucoup plus protectionniste que le marché américain. D'ailleurs, les vétérinaires européens et canadiens ne reconnaissent pas les tests qui sont utilisés dans leurs pays respectifs pour analyser les phytotoxines. De ce fait, les exportations vers le Canada ne peuvent concerner que les coquilles surgelées, alors que la logistique permettrait de livrer des produits frais sur le marché canadien.
Saint-Pierre-et-Miquelon est donc placé dans la situation inverse des RUP françaises : au lieu de devoir lutter contre des concurrents avantagés par des normes moins exigeantes et une politique commerciale européenne d'ouverture maximale, l'archipel doit au contraire se conformer à des normes différentes mais de niveau équivalent, voire plus sévères pour pénétrer ses marchés cibles nord-américains .
b) La Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie dispose d'une complète autonomie en matière de normes applicables à l'agriculture et de règles sur le contrôle des importations, tant du point de vue du cadre français que de la réglementation européenne. Elle est située loin de l'Hexagone qui ne constitue pas un marché important pour ses productions agricoles. Elle se trouve, en revanche, à proximité de deux pays développés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui possèdent d'autres modèles sanitaires que l'Union européenne.
Sur le fondement des articles 4 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 qui fixe son statut, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une réglementation autonome en matière zoo- et phytosanitaire. Les grands principes de la réglementation ont été posés, même si les textes d'application demandent encore à être perfectionnés.
La Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans une recherche de normalisation rigoureuse afin de mieux protéger ses productions agricoles , qui sont essentiellement tournées vers la satisfaction de son marché intérieur . Globalement, en matière de protection des consommateurs et de sécurité alimentaire , le modèle suivi est celui de la France et de l'Union européenne , qui apparaît localement comme celui qui offre la meilleure garantie. À l'inverse, en matière de biosécurité et de protection de la santé des végétaux et des animaux, le modèle suivi pour le contrôle des importations est celui de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie . L'enjeu calédonien est de parvenir à trouver un point d'équilibre entre l'influence européenne et l'insertion régionale.
Les normes zoosanitaires de la Nouvelle-Calédonie sont majoritairement reprises de l'organisation mondiale de la santé animale ( OIE ), dont la Nouvelle-Calédonie est partie depuis 1949. Toutefois, pour certaines maladies qui ne sont pas couvertes par l'OIE, la Nouvelle-Calédonie prend des mesures propres le plus souvent partagées avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est ce qui aboutit à l'interdiction d'importer de la viande de porc crue pour protéger le territoire du syndrome dysgénésique respiratoire porcin, maladie d'élevage en Europe.
En matière de protection des végétaux , la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas signataire de la Convention Internationale sur la Protection des Végétaux (CIPV), fait partie d'une organisation régionale dédiée , la Pacific Plant Protection Organisation . Les mesures phytosanitaires qu'elle applique peuvent être plus exigeantes que les normes internationales de la CIPV. Par exemple, une norme régionale stricte sur les containers devrait être adoptée prochainement en lien avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, alors qu'au niveau mondial cette norme reste au point mort.
La Nouvelle-Calédonie a fait le choix de construire un système très strict de protection zoo et phytosanitaire aux frontières . Ce système est fortement inspiré des mesures australiennes et néo-zélandaises et concerne les marchandises à risque sanitaire, les vecteurs qui transportent ces marchandises (contenants, navires, aéronefs...), et les lieux par lesquels elles transitent (ports, aéroports, agence postale). Tous les objets susceptibles d'être contaminés accidentellement tels pneus, poteries, meubles en teck, véhicule d'occasion ou engins de chantier sont couverts. Les contrôles s'opèrent sur les flux commerciaux et privés (effets personnels, colis postaux, courrier express). Toutefois, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas des capacités pour projeter ses activités de contrôle hors de son territoire, contrairement à la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui réalisent des inspections dans les pays tiers avant l'exportation vers leur marché.
D'une manière générale, les normes zoo et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie sont plus strictes que les normes européennes et moins strictes que les normes australiennes . Par rapport à l'Union européenne, la rigueur des normes vétérinaires et phytosanitaires (hors alimentation humaine) vise à protéger le statut sanitaire exceptionnellement bon du territoire. Ainsi, des filières importantes pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie comme les porcins, l'aquaculture, le maïs ou les alliacées (ail, oignon, poireau) sont protégées avec soin de l'entrée de parasites et d'agents infectieux répandus en Europe. Sont explicitement empêchées les importations de porcs vivants et de charcuterie, de crustacés vivants et de crevettes crues, de bananes et de papayes, et en général toutes les espèces animales non présentes en Nouvelle-Calédonie .
Le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) de Nouvelle-Calédonie, auditionné par visioconférence le 12 mai 2016, a indiqué à vos rapporteurs que le taux d'interception de ravageurs lors des contrôles réalisés sur les plantes ornementales importées 11 ( * ) était très élevé, de l'ordre de 70 à 80 %. Pourtant, les envois sont accompagnés des certificats phytosanitaires censés garantir l'efficacité des traitements phytosanitaires effectués dans le pays de départ. Pour certains imports considérés comme présentant un haut risque sanitaire, la prudence justifie alors l'interdiction d'importation de matériel reproductif, comme les arbres fruitiers, notamment les bananiers.
Ces normes sont moins strictes que celles de l'Australie en matière phytosanitaire. Les Australiens interdisent l'entrée de certaines semences sur leur territoire sans même passer par une quarantaine. L'importation en Australie de plants mères est également très difficile : certains passent un an en quarantaine. La Nouvelle-Calédonie n'est pas encore dotée d'une quarantaine végétale.
En matière de normes de sécurité sanitaire des aliments , ce sont les normes européennes ont été globalement retranscrites en droit local . Les dispositions réglementaires prévoient qu'en l'absence d'une norme calédonienne spécifique ce sont les normes internationales du Codex alimentarius qui s'appliquent par défaut.
Un projet de réglementation est en cours pour permettre la reconnaissance des substances actives autorisées dans l'Union européenne et des AMM des produits phytopharmaceutiques à usage agricole . Un alignement sur les LMR européennes est également prévu. Cette orientation s'explique par les plus faibles capacités propres d'analyse de la Nouvelle-Calédonie.
Se pose cependant la question des usages orphelins car l'Union européenne autorise moins de substances actives que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ces deux pays, la couverture des besoins des agriculteurs en traitements phytosanitaires est meilleure, car la gamme est à la fois plus large et mieux ciblée pour des usages dans la zone Pacifique Sud. L'adoption des décisions d'homologation européenne à l'exclusion de toute autre poserait des problèmes agronomiques sérieux et empêcherait de traiter les problématiques de ravageurs ou d'adventices propres à la Nouvelle-Calédonie. On peut citer le cas de l'herbe à oignons qui nécessite l'utilisation de l'herbicide Totril sur les cultures d'alliacées, ou celle du papillon piqueur des agrumes ou du puceron de la laitue qui pourrait nécessiter l'emploi de néonicotinoïdes. Les extraits de plantes sont également largement utilisés par les exploitants calédoniens , alors que le cadre européen en rend l'homologation très ardue.
Par conséquent, le cadre réglementaire calédonien doit laisser la possibilité, sur des productions végétales victimes d'usages non pourvus ou fragiles, d'agréer des substances ou d'homologuer des produits sans s'aligner systématiquement sur les décisions de l'Union Européenne. C'est toute la différence avec les RUP qui ne peuvent pas se doter des moyens appropriés pour lutter contre les ravageurs tropicaux.
* 3 Article 8 du règlement (CE) 1107/2009.
* 4 Pour certains usages de produits comme le traitement des semences et le traitement post-récolte, le règlement de 2009 prévoit que l'Union européenne soit considérée comme une zone unique. L'État membre désigné rapporteur évalue alors les effets du produit phytopharmaceutique pour l'ensemble des autres États de l'Union.
Zone A - Nord : Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède.
Zone B - Centre : Belgique, République tchèque, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni.
Zone C - Sud : Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Malte, Portugal.
* 5 De même que l'Espagne et le Portugal et leurs RUP, si bien que l'ensemble des RUP européennes sont classées dans la zone Sud.
* 6 Un usage correspond à un emploi défini d'une préparation phytopharmaceutique, caractérisé par un couple plante-organisme nuisible et complété par des précisions sur le mode ou le champ d'application. L'ensemble des usages agricoles est rassemblé dans un catalogue.
* 7 Ou sur une autre culture très proche dont on peut considérer qu'ils appartiennent à la même sous-famille végétale et réagissent de façon très proche aux pesticides.
* 8 Substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou neutraliser, préventivement ou à tire curatif, des organismes nuisibles, par une action chimique ou biologique. L'Anses procède à leur évaluation. Elles sont soumises à une réglementation européenne de 2012, différente de celle qui porte sur les pesticides et contrôlée par l'ECHA et non par l'EFSA.
* 9 Biocides contenant une ou plusieurs substance(s) active(s) ou une préparation ayant la propriété de tuer les vers parasitaires de la famille des nématodes.
* 10 L'IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d'une campagne culturale.
* 11 250 000 plantes par an.







