Rapport d'information n° 452 (2013-2014) de M. Serge LARCHER , fait au nom de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer, déposé le 11 avril 2014
Disponible au format PDF (1,5 Moctet)
-
OUVERTURE
-
Serge Larcher, Sénateur de la Martinique,
Président de la Délégation sénatoriale à
l'outre-mer
-
Justin Daniel, Professeur de science politique
à l'Université des Antilles et de la Guyane, Directeur du Centre
de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe
-
Antoine Delblond, Professeur de droit public
à l'Université de Nantes, Directeur du séminaire sur
l'autonomie locale, coordonnateur scientifique du colloque (CRPLC)
-
Serge Larcher, Sénateur de la Martinique,
Président de la Délégation sénatoriale à
l'outre-mer
-
ATELIER 1 - AUTONOMIE, THÉORIE POLITIQUE,
CONSTRUCTION JURIDIQUE
-
Sous la présidence de Jean-Claude
Fortier
-
Jean-Claude Fortier, Professeur des facultés
de droit émérite, fondateur du CRPLC - Autonomie, théorie
politique, construction juridique
-
Pierre-Yves Chicot, Maître de
conférences en droit public à l'Université des Antilles et
de la Guyane Habilité à Diriger les Recherches - Autonomie
locale : liberté et responsabilité
-
Vincent Roux, Professeur agrégé
à la Faculté de droit et de science politique de
l'Université d'Aix-Marseille, secrétaire général de
l'Institut de droit d'outre-mer (IDOM) - Autonomie, gestion locale et
gouvernance
-
Marthe Le Moigne, Maître de
conférences en droit public à l'Université de Bretagne
occidentale - Autonomie locale et clause générale de
compétence
-
Edwin Matutano, Docteur en droit - La
légistique pour l'autonomie des collectivités
territoriales : une nécessité et un enjeu
-
Jean-Claude Fortier, Professeur des facultés
de droit émérite, fondateur du CRPLC - Autonomie, théorie
politique, construction juridique
-
ATELIER 2 - AUTONOMIE LOCALE : PRINCIPE
EUROPÉEN, MISE EN oeUVRE NATIONALE - Sous la présidence de Justin
Daniel
-
Justin Daniel, Professeur de science politique
à l'Université des Antilles et de la Guyane - Autonomie
locale : principe européen, mise en oeuvre nationale
-
Danielle Perrot, Professeur de droit public
à l'Université des Antilles et de la Guyane, Chaire Jean Monnet
CRPLC - UMR CNRS 8053 - L'autonomie dans la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne
-
Carlos Pacheco Amaral, Professeur à
l'Université des Açores, Chaire Jean Monnet - Autonomie dans
l'État unitaire : le cas des Açores et de Madère au
Portugal
-
Annie Fitte-Duval, Maître de
conférences en droit public à l'Université de Pau et des
pays de l'Adour - Autonomie régionale et identité politique en
Espagne
-
Hervé Rihal, Professeur de droit public
à l'Université d'Angers - Autonomie locale et action
sociale
-
Justin Daniel, Professeur de science politique
à l'Université des Antilles et de la Guyane - Autonomie
locale : principe européen, mise en oeuvre nationale
-
ATELIER 3 - AUTONOMIE LOCALE, QUELS MOYENS POUR
L'OUTRE-MER ? - Sous la présidence de Valentin Josse
-
Valentin Josse, Conseiller général de
la Vendée - Autonomie locale, quels moyens pour
l'outre-mer ?
-
Antoine Delblond, Professeur de droit public
à l'Université de Nantes - Autonomie dans la
propriété des personnes publiques outre-mer
-
Joël Boudine, Maître de
conférences en droit public à l'Université des Antilles et
de la Guyane - Autonomie financière des collectivités
territoriales outre-mer
-
Arlette Pujar, Docteur en droit, directrice du
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Martinique -
Autonomie dans le management des fonctionnaires territoriaux d'outre-mer
-
André Néron, Administrateur
territorial à la retraite, chargé de mission au conseil
général pour la mise en place de la collectivité
territoriale de Guyane - L'autonomie confrontée à des contraintes
particulières : l'expérience de la Guyane depuis la
départementalisation
-
Valentin Josse, Conseiller général de
la Vendée - Autonomie locale, quels moyens pour
l'outre-mer ?
-
ATELIER 4 - AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE
OUTRE-MER : DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ - Sous la
présidence de Ferdinand Mélin-Soucramanien
-
Ferdinand Mélin-Soucramanien, Professeur de
droit public à l'Université de Bordeaux - Autonomie
institutionnelle outre-mer : diversité et
complexité
-
Maude Elfort, Maître de conférences en
droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane -
Autonomie et identités autochtones dans les Guyanes
-
Olivier Gohin, Professeur de droit public à
l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur de l'Institut
de préparation à l'administration générale (IPAG)
de Paris - Approche comparée des autonomies polynésienne et
calédonienne
-
Véronique Bertile, Maître de
conférences en droit public à l'Université de Bordeaux -
Statut, institutions et ressources humaines : le cas de
La Réunion
-
Bertrand Beauviche, Président de section
à la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France,
Chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon - L'autonomie
fiscale sous le regard du juge financier
-
Ferdinand Mélin-Soucramanien, Professeur de
droit public à l'Université de Bordeaux - Autonomie
institutionnelle outre-mer : diversité et
complexité
-
CONCLUSION
-
LE PROGRAMME DE LA RENCONTRE
N° 452
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 avril 2014 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer (1) comportant les actes du colloque organisé le 10 avril 2014 sur « Un kaléidoscope de l' autonomie locale : théorie, pratique institutionnelle et déclinaisons ultramarines »,
Par M. Serge LARCHER,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Serge Larcher, président ; MM. Éric Doligé, Michel Fontaine, Pierre Frogier, Joël Guerriau, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Requier, Mme Catherine Tasca, MM. Richard Tuheiava, Paul Vergès et Michel Vergoz, vice-présidents ; Mme Aline Archimbaud, M. Robert Laufoaulu, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jean-Étienne Antoinette, Mme Éliane Assassi, MM. Jacques Berthou, Jean Bizet, Jean-Marie Bockel, Gérard César, Mme Karine Claireaux, MM. Christian Cointat, Jacques Cornano, Félix Desplan, Mme Jacqueline Farreyrol, MM. Gaston Flosse, Jacques Gillot, Mme Odette Herviaux, Jean-Jacques Hyest, Jacky Le Menn, Jeanny Lorgeoux, Roland du Luart, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Néri, Georges Patient, Mme Catherine Procaccia, MM. Charles Revet, Gilbert Roger, Abdourahamane Soilihi et Hilarion Vendegou.
OUVERTURE
Serge Larcher, Sénateur de la Martinique, Président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Monsieur le Directeur du Centre de recherche pour les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, Cher Justin Daniel,
Madame la Déléguée interministérielle et Chère Sophie Élizéon,
Monsieur le Directeur du séminaire sur l'autonomie locale, Cher Antoine Delblond qui êtes à l'origine du présent colloque,
Mesdames et messieurs qui, nombreux, avez accepté d'apporter votre contribution à notre rencontre de ce jour,
Chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi, à titre personnel et en ma qualité de président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer, de vous souhaiter la bienvenue au Sénat. Je me félicite de la fructueuse collaboration que nous avons nouée, pour la réalisation de cette rencontre, avec le CRPLC, unité mixte de recherche (UMR) entre le CNRS et l'Université des Antilles et de la Guyane.
Je me réjouis tout particulièrement que cette manifestation permette d'orienter les projecteurs sur le CRPLC, un des fleurons de l'Université des Antilles et de la Guyane qui traverse à ce jour, quant à elle, une crise profonde.
Cher Justin Daniel, votre laboratoire de recherche, créé en 1982 par le professeur Jean-Claude Fortier qui présidera le premier atelier de notre matinée, c'est-à-dire au moment même où l'UAG naissait en tant qu'université de plein exercice, déploie aujourd'hui une intense activité à travers, notamment, un ensemble de partenariats extérieurs qui dénote son souci d'ouverture et de rayonnement. Ceci est extrêmement bénéfique à notre université qui, actuellement en plein chamboulement, devra lors de sa restructuration prochaine intégrer cet objectif.
Je me permets de vous informer au passage que notre délégation sénatoriale à l'outre-mer, très préoccupée par la situation universitaire aux Antilles et en Guyane, a créé avec la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat un groupe de travail dont le rapport sera présenté la semaine prochaine devant la délégation et la commission réunies en formation plénière. La notion d'autonomie est d'ailleurs au coeur de cette crise universitaire et des schémas qui permettront de la dénouer.
Un dicton créole affirme qu'« il faut un bon désordre pour mettre en ordre » : « sé en gwo désod ki ka mété lod ». La condition paraît largement satisfaite en ce qui concerne le désordre... et la mise en ordre devra prendre appui sur les valeurs sûres de l'université, comme le CRPLC, qui tiennent le cap dans la tempête.
Cher Justin Daniel, le colloque d'aujourd'hui marque votre fidélité au Sénat ! J'ai encore en mémoire celui de février 2011 intitulé « Les outre-mer à l'épreuve du changement : réalités et perspectives des réformes territoriales » : notre délégation à l'outre-mer n'était pas encore née mais la mission sénatoriale d'information sur la situation des DOM créée en 2009 en était déjà la préfiguration ! Le colloque de 2011 avait dressé un panorama très éloquent des évolutions statutaires des collectivités ultramarines dans le cadre de la réforme territoriale, et le professeur Ferdinand Mélin-Soucramanien, qui présidera notre second atelier de l'après-midi, y avait déjà présenté, avec le brio qu'on lui connaît, la question de l'autonomie des collectivités territoriales situées outre-mer.
Il s'agit d'une question centrale de notre organisation institutionnelle et du dialogue entre l'État et les collectivités.
Désormais, formellement inscrite à l'article 74 de notre Constitution pour définir la catégorie des collectivités ultramarines dont le statut relève de la loi organique, la notion d'autonomie occupe une place de plus en plus importante dans le débat sur l'évolution de la décentralisation, en matière d'organisation comme en matière normative. Et les outre-mer, reconnus pionniers et précurseurs en matière d'innovation institutionnelle, continuent à jouer un rôle moteur dans cette évolution. Qu'il s'agisse de l'autonomie normative avec une mise en oeuvre de la procédure d'habilitation de l'article 73 qui commence à se développer et devrait connaître un essor accéléré avec la naissance des collectivités de Guyane et de Martinique en 2015, qu'il s'agisse de l'autonomie statutaire illustrée en particulier par l'avenir du dossier calédonien ou encore, par exemple, de l'autonomie financière des collectivités territoriales, la notion d'autonomie, aux multiples facettes, est au coeur de l'actualité.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour en sonder les fondements et tenter d'en cerner les contours.
Mesdames, Messieurs, sur ce thème très sénatorial de l'autonomie locale, je nous souhaite une passionnante journée d'exploration en forme de kaléidoscope !
Je vous remercie et cède la parole à Justin Daniel.
Justin Daniel, Professeur de science politique à l'Université des Antilles et de la Guyane, Directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe
Monsieur le Président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté notre invitation.
Ce colloque résulte de la volonté commune de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer et du CRPLC de porter à la connaissance d'un public élargi le fruit de plusieurs années de réflexions, d'observations et d'analyses parfois complexes. Il s'agit donc de restituer les études menées à partir d'expériences de recherche bien souvent partagées avec des collègues des universités de métropole.
Le CRPLC a été créé dans les Caraïbes dans les années 1980 et a depuis développé une abondante activité scientifique autour des pouvoirs locaux. Il bénéficie aujourd'hui d'une expertise reconnue dans ce domaine. Malgré la diversité des situations, le positionnement géographique du CRPLC l'a plus particulièrement incliné à porter sa focale sur les territoires antillais et caribéens, tout en demeurant attentif à ce qui se passe dans les autres outre-mer. Ses travaux se trouvent donc en parfaite congruence avec les interrogations qui peuvent émerger au sein de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer, et plus largement au sein de la haute assemblée. Ce colloque se trouve à la jonction précise entre ces deux séries de préoccupations et je me réjouis de constater qu'il résulte de la collaboration entre les services du CRPLC et de la Délégation.
Permettez-moi d'ajouter que les activités réalisées au sein du CRPLC s'enrichissent de l'inscription de l'unité de recherche dans de nombreux réseaux nationaux de recherche, mais également des réseaux internationaux. Ce choix assumé de notre part permet d'assurer une montée en généralité de nos travaux, au-delà du cas spécifique de l'outre-mer.
Le président Larcher l'a mentionné : la période actuelle est à la fois riche et pétrie d'incertitudes. En effet, plusieurs collectivités situées outre-mer, je pense en particulier à la Guyane et à la Martinique, se trouvent engagées dans un processus de réforme institutionnelle qui pose de façon renouvelée la question de l'autonomie locale et préfigure, si j'en crois les récents propos du Premier ministre, les changements à venir dans la carte administrative de la France.
Ce colloque nous offre donc plusieurs opportunités : celle de procéder à une mise à jour théorique et conceptuelle d'une notion incontournable, mais difficile à saisir, car historiquement marquée par une certaine instabilité, tout en étant placée au coeur d'enjeux politiques ; au-delà, nous avons pour ambition de confronter les expériences aussi bien en France qu'à l'étranger.
Antoine Delblond, Professeur de droit public à l'Université de Nantes, Directeur du séminaire sur l'autonomie locale, coordonnateur scientifique du colloque (CRPLC)
Sur le plan scientifique, notre présence ce matin est le symbole d'une évolution remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord, l'autonomie part de très loin. Dans les années 60, elle n'était qu'une revendication politique dans un état unitaire et l'outre-mer a « payé le prix fort » de la revendication autonomiste, Justin Catayée, défenseur d'un projet d'autonomie en 1962, ayant connu le destin tragique que l'on sait. L'autonomie en tant que revendication politique a donc dans un premier temps été ignorée par le centre.
Dans les années 1970, l'autonomie devient une évolution possible, car l'État est parvenu aux limites de ses capacités d'administration décentralisée dans un contexte européen favorisant les régionalismes. L'autonomie devient alors un possible dans un État unitaire. Retenons à ce propos certaines grandes figures, au premier rang desquelles Olivier Guichard.
Enfin, l'autonomie devient une réalisation dans une troisième étape. Tout du moins, elle apparaît comme une démarche autorisée par le pouvoir. C'est l'acte un et l'acte deux de la décentralisation, qui permet pour la première fois à l'État unitaire de reconnaître l'autonomie de gestion des collectivités territoriales, c'est-à-dire leur capacité à élaborer des normes dans un certain nombre de champs.
L'autonomie se trouve partout et nulle part. Vous aurez beau chercher sa présence dans la loi ou le décret, elle n'y figure pas à l'exception de l'article 74 de la Constitution. En dehors de cette autonomie constitutionnelle, il n'existe aucune trace de l'autonomie dans la loi. Pourtant, l'autonomie est partout, y compris dans l'acte deux de la décentralisation ou dans la loi du 27 juillet 1993, ou encore dans tous les transferts de compétence de l'acte deux véhiculés par la loi d'août 2004. C'est le décalage entre une omniprésence de l'autonomie fonctionnelle et l'absence institutionnelle de l'autonomie dans la loi qui nous réunit aujourd'hui.
Le colloque de ce jour donnera lieu à la publication d'un rapport qui, espérons-le, inspirera le législateur. Nos travaux de ce jour vont nous permettre, en toute modestie, de faire le point sur ce qu'il est possible de faire et de réaliser certaines projections.
Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque.
ATELIER 1 - AUTONOMIE, THÉORIE POLITIQUE, CONSTRUCTION JURIDIQUE
Sous la présidence de Jean-Claude Fortier
Jean-Claude Fortier, Professeur des facultés de droit émérite, fondateur du CRPLC - Autonomie, théorie politique, construction juridique
Je voudrais tout d'abord vous exprimer le bonheur que j'éprouve d'être associé, par la complicité et l'amitié du professeur Justin Daniel, à une nouvelle manifestation scientifique du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC). Ce bonheur est, cette fois, mêlé d'incompréhension, de tristesse, et - pour être tout à fait franc - de colère, devant la perspective du démantèlement, de la disparition de l'Université des Antilles et de la Guyane, dont le CRPLC est - je ne veux pas dire était - non seulement le fleuron, comme le rappelait le président Serge Larcher, mais aussi, je le crois profondément, le symbole universitaire de l'union caribéenne des deux îles avec la Guyane.
La rencontre d'aujourd'hui sur l'autonomie locale, notamment dans ses déclinaisons ultramarines, constitue un curieux retour de flamme des premières journées d'étude de Fort-de-France que le CPRLC naissant avait organisées, il y a près de 30 ans, autour de la décentralisation outre-mer. À l'époque, l'idée de décentraliser l'outre-mer faisait rire. C'est pourtant de ces journées d'étude que sont issus le premier ouvrage du CRPLC (auquel avaient participé Justin Daniel, Antoine Delblond, Annie Fitte-Duval, Maude Elfort, Danielle Perrot, Joël Boudine, présents dans ces lieux en 2014) et la labellisation du centre par le CNRS.
La mission de ce premier atelier est de procéder à un cadrage théorique, doctrinal de l'autonomie locale. Le professeur Delblond rappelait à juste titre que l'autonomie est partout, mais n'existe pas juridiquement, en tant que formalisation théorique, à l'intérieur de la république unitaire qu'est la France. Ce n'est pas l'effet du hasard. L'autonomie a souvent été regardée, surtout depuis que l'on a appris qu'elle n'était pas l'indépendance, comme la porte de l'indépendance. L'autonomie des territoires, la République française a toujours eu du mal avec ça. Et elle n'est pas près de se l'approprier si j'ai bien compris le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, il y a deux jours. Je souhaite bon courage à Marthe Le Moigne qui doit nous parler de la clause de compétence générale dont la suppression est annoncée. Notre collègue interviendra après que l'autonomie locale aura été envisagée sous l'éclairage fondamental de la liberté et de la responsabilité par Pierre-Yves Chicot, puis sous celui de la gestion et de la gouvernance par Vincent Roux et avant qu'Edwin Matutano ne parle de la logistique de l'autonomie locale, c'est-à-dire de la méthode d'élaboration et de rédaction des textes qui y sont relatifs.
Pierre-Yves Chicot, Maître de conférences en droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane Habilité à Diriger les Recherches - Autonomie locale : liberté et responsabilité
Comment penser le couple liberté locale et responsabilité locale dans le cadre d'une approche juridique consacrée à la notion d'autonomie qui se veut d'abord une théorie du droit ? On aura pris la précaution de souligner que le propos d'ensemble est consacré à la décentralisation, notion que le doyen Georges Vedel 1 ( * ) , en accord avec la pensée du doyen Hauriou 2 ( * ) qui l'a précédé, définit comme un processus, ayant pour criterium essentiel : l'élection des organes politiques locaux dotés de compétences administratives, et dans certains cas, de collectivités disposant de la compétence normative.
Bien que le sujet de la décentralisation fasse l'objet d'une particulière prospérité dans la sphère politique, juridique, administrative et financière, celui-ci ne leur est pas exclusif. La décentralisation témoigne de l'existence d'un mouvement dynamique qui consiste à changer de lieu, d'espace, tout en rendant compte d'une évolution psychologique caractérisée par l'autonomie, dans la manière d'envisager l'art d'agir.
Dans « Les vies d'Alexandre » , le héros, Marius Jacob, cambrioleur membre du courant anarchiste qui opéra en France à la fin du XIX e siècle, répondait de la façon suivante à la question qui lui était posée, lors de son procès en 1905 devant la cour d'assises de la Somme : « Pourquoi alliez-vous cambrioler en province ? -- Je faisais de la décentralisation », répondit-il. En effet, à l'époque, « le bandit recherché à Nantes pour meurtre et pris à Verdun en flagrant délit de cambriolage avait toutes les chances, pourvu que son identité de rechange fut solide, de n'être condamné que pour ce dernier méfait » 3 ( * ) .
En fait, Alexandre Marius Jacob mettant en oeuvre un esprit d'autonomie s'émancipait de la dépendance d'un lieu unique d'intervention. Il cultivait la liberté, en changeant à sa guise de centres d'intervention. Il cultivait aussi la responsabilité, en s'affranchissant de la facilité qui le contraignait vraisemblablement à faire usage de modes opératoires différents, mais présentant l'avantage de brouiller davantage les pistes.
Rapportés au droit public, les couples autonomie/décentralisation d'une part, et liberté locale/responsabilité locale d'autre part, sont à intégrer dans un discours global relatif à la théorie de l'État, dont Carré de Malberg 4 ( * ) est certainement celui dont l'oeuvre à ce sujet est la plus connue du grand public averti.
Les épithètes « autonomique » , « décentralisé » , peuvent être choisies à loisir pour qualifier les grands traits de l'État. Et là où il y a octroi de libertés et de responsabilités aux collectivités infraétatiques, l'organisation politique et juridique consacre, à des degrés variables, la décentralisation et/ou l'autonomie. À ce stade du propos, comment peut-on résister à la tentation de citer la très célèbre formule de Maurice Hauriou, développée abondamment dans la belle thèse de François Fournier 5 ( * ) : « La décentralisation est une manière d'être de l'État ».
Autrement dit, une volonté étatique qui peut aller jusqu'à aspirer et à consacrer à l'autonomie locale, en décentralisant. Une manière d'être dont le témoignage coïncide sur le plan juridique avec l'inscription dans la loi constitutionnelle ou ordinaire des concepts de liberté locale et de responsabilité locale.
Le théoricien du droit allemand Hans Kelsen indique que le degré de décentralisation d'un État, « ordre juridique relativement centralisé » peut varier sans que cela soit prévu par sa Constitution. Dans le cas qui nous occupe, si la liberté locale est expressément constitutionnalisée, il n'en est pas de même de la responsabilité locale. Autrement dit, pour la responsabilité locale, il n'existe pas de principe général inscrit dans la Constitution qui la définit. Toutefois, la loi ordinaire, se référant à la mention ajoutée dans l'article 1 er de la Constitution par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 6 ( * ) : « Son organisation est décentralisée », nous fournit le cadre de référence qui convient pour énoncer la définition 7 ( * ) .
Aussi, la responsabilité locale pourrait être définie sur la base du corpus de compétences exercées par le niveau infraétatique. On en veut pour preuve ce que dit le Sénat à ce propos : « Les nouvelles responsabilités confiées aux échelons décentralisés touchent des secteurs essentiels intéressant l'ensemble de la population : développement économique, tourisme, formation professionnelle, transport et infrastructures, logement, action sociale » 8 ( * ) .
Dans le raisonnement scientifique de Kelsen « le degré de centralisation et de décentralisation est indiqué par le nombre et l'importance des normes centrales et des normes locales » 9 ( * ) . Dans le cas français, les pays d'outre-mer (POM) 10 ( * ) mis à part, il est de doctrine constante d'affirmer que la décentralisation française est de nature administrative et non politique, alors même que l'article 72 alinéa 3 de la Constitution dispose que « Les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Mais, il est vrai que cette disposition est davantage prometteuse que précise.
Même si la France se distingue par son modèle légicentrique, on ne peut pas écarter l'approche kelsénienne pour analyser le cas français. Le recours à l'argumentaire kelsénien est pertinent mais insuffisant pour apporter la preuve de l'existence de l'autonomie locale en droit public français dans la mesure où le constituant énonce la notion de pouvoir réglementaire local sans qu'une loi organique ne la mette encore réellement en oeuvre. Dans le même temps, la compétence normative au bénéfice des collectivités de droit commun constitue bien une réalité, si on se réfère aux habilitations législatives prévues par l'article 73 alinéa 5 de la Constitution.
En attendant que la compétence normative autorisée pour les collectivités françaises d'Amérique soit généralisée à leurs homologues de France hexagonale 11 ( * ) , il nous semble que pour apporter la preuve de la compatibilité de la notion d'autonomie avec le droit français de la décentralisation, les notions de liberté locale constitutionnalisée, et de responsabilité locale légalisée nourrissent substantiellement la possible définition d'une autonomie en droit public français. La liberté locale serait à la fois une construction sociale symbolisant l'émancipation administrative (I). La responsabilité locale pour sa part, pourrait être mise en lien avec la notion de décentralisation-autonomie (II).
I. - La liberté locale : entre construction sociale et émancipation administrative
Les collectivités territoriales sont le résultat de l'ordre social au même titre que l'État. Même s'il demeure encore un rapport d'asymétrie entre le pouvoir central et les collectivités infraétatiques, la conception et la mise en oeuvre de nombre de politiques publiques sont davantage une affaire de coproduction. À la faveur des principes de liberté locale et de responsabilité locale énoncés dans la loi, l'échelon local peut être désormais désigné, moins comme un obligé de l'État que comme un partenaire de celui-ci.
L'émancipation administrative mise en oeuvre peut signifier que le pouvoir d'impulsion n'est, plus uniquement, l'apanage du centre. De ce fait, la marge d'initiative des organes périphériques s'en trouve confortée et gagne en fécondité. L'émancipation administrative signifie, par ailleurs, la reconnaissance de l'autonomie de gestion et de décision dont les fondements sont à rechercher dans le principe de liberté locale procédant d'un construit social (A) et équivalant à une liberté d'agir (B).
A. La liberté locale procède de l'ordre social
La construction de l'État résulte-t-elle exclusivement d'un processus juridico-normatif ? L'histoire des faits 12 ( * ) sociaux nous enseigne que le principe de libre administration est enraciné dans un processus social qui dépasse les frontières des sciences juridiques. L'État peut être perçu « comme une institution qui s'agrège à la société civile et qui tend à en prendre les rênes, sans s'y identifier, ni même totalement la dominer » 13 ( * ) .
Le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 34, et surtout par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution est un principe à valeur constitutionnelle 14 ( * ) . Les principes à valeur constitutionnelle prennent leur source dans ce que le doyen Hauriou appelle la Constitution sociale 15 ( * ) . Issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou du préambule de la Constitution de 1946 ou tout simplement de la tradition républicaine et législative, le législateur ne peut y porter atteinte.
Cette qualification juridique du principe de libre administration n'altère pas l'unité de l'État. Pour autant, celui-ci va progressivement contribuer à affadir la centralisation des affaires publiques, au fur et à mesure que les collectivités territoriales vont être fondées à jouer un rôle de régulateur social de plus en plus grand en direction du territoire local.
Pour certains membres de la doctrine du droit public français, le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait être réduit à un simple principe d'organisation mais constitue bien une liberté inhérente des collectivités locales 16 ( * ) . Cette conception remonte au début du siècle dernier. Certains publicistes soutiennent que la décentralisation équivaut à l'affirmation des libertés locales, suivant toujours le sort des autres libertés 17 ( * ) .
L'insertion du principe de libre administration dans la Constitution du 27 octobre 1946 exprime la volonté des constituants de consacrer les libertés locales et pas simplement un principe d'organisation administrative, parce qu'en réalité l'octroi de ces libertés s'adresse à des communautés humaines. Pour autant, cette liberté n'est pas sans limite. Elle s'exerce sous le contrôle administratif du représentant de l'État. On est en présence d'une régulation sociale de la collectivité locale soumise le cas échéant à la censure de la collectivité supérieure.
Pour Maurice Bourjol, il s'agit d'« une liberté publique, parmi les plus anciennes, les libertés locales » 18 ( * ) . Elles inspirent le principe de libre administration présenté comme une liberté constitutionnellement reconnue et garantie, dont le respect s'impose au législateur. « La libre administration met l'accent par ailleurs, sur l'existence des libertés locales, attachées au groupe humain, à la « société de citoyens» constituant la collectivité territoriale, lesquelles doivent être préservées non seulement des empiétements de l'État lui-même mais aussi de ceux pouvant émaner d'autres personnes publiques » 19 ( * ) .
La mise en relation du principe de libre administration avec la régulation sociale est pertinemment soulignée par Constantinos Bacoyannis lorsqu'il évoque « le droit de s'administrer librement comme n'étant pas conféré à la personne morale, « collectivité territoriale» , mais au groupement naturel qui est délimité grâce à son rattachement à un territoire et qui préexistait à sa reconnaissance par l'État » 20 ( * ) .
La référence « au groupement naturel » et qui renvoie également à un groupe social induit un raisonnement sur la manière de faire d'un État démocratique. Si la particularité ne doit pas contrarier la vision commune, cette dernière ne peut pas non plus déployer ses effets par le droit, sans tenir compte de l'aire de transplantation de la règle. Au surplus, compte tenu de la légitimité démocratique des organes délibérants locaux, le Conseil constitutionnel tire toutes les conséquences et consacre dans une jurisprudence plutôt abondante, la liberté d'agir qui entretient un lien de proximité avec la notion d'autonomie.
B. La liberté locale, l'équivalent de la liberté d'agir
La liberté des collectivités territoriales s'arrête là où commence celle de l'État et du peuple et inversement. En vertu de la Constitution, en effet, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit de manière directe, soit de manière médiatisée. Expression et garant de la souveraineté, l'État dispose d'un droit d'évocation qui pourrait s'opposer à toute limitation de ses pouvoirs.
Par ailleurs, la France malgré les inflexions subies au fil des années demeure un État unitaire dont les soubassements reposent aussi sur l'affirmation du rôle du délégué du Gouvernement ayant « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » 21 ( * ) .
Enfin, s'il en était besoin, il est utile de rappeler que l'un des fondements essentiels de la République est l'article 3 de la Déclaration de 1789 qui dispose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ».
Après avoir consacré la valeur constitutionnelle du principe de libre administration, sans se référer à une disposition constitutionnelle précise (décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979), le Conseil constitutionnel a veillé au respect de ce principe en procédant à une démarche casuistique.
Aussi, le principe de libre administration implique que chaque collectivité territoriale « dispose d'un conseil élu doté d'attributions effectives » 22 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a également considéré que le législateur ne pouvait imposer aux collectivités locales des contraintes excessives et qu'il ne pouvait rester en-deçà de ses compétences en renvoyant à une convention conclue entre collectivités le soin de fixer les conditions d'exercice des compétences 23 ( * ) . Il a jugé non conforme la faculté reconnue au représentant de l'État de provoquer la suspension des actes des collectivités locales pendant trois mois 24 ( * ) .
En matière financière, le Conseil constitutionnel a posé les limites dans lesquelles le législateur pouvait imposer des charges aux collectivités locales. Il a ainsi précisé que « si le législateur est compétent pour définir les catégories de dépenses qui revêtent pour les collectivités territoriales un caractère obligatoire..., toutefois les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration ». S'agissant des ressources, le Conseil constitutionnel a établi que « le législateur peut déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses » 25 ( * ) . Enfin, il a clairement affirmé que « les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration » 26 ( * ) .
Il apparaît donc bien que le principe de la libre administration peut être considéré comme la liberté pour des collectivités de gérer leurs propres affaires. « Certes, la libre administration comporte diverses facettes ; elle englobe plusieurs composantes, telle une liberté-gigogne : liberté de gestion du personnel territorial, liberté contractuelle, liberté de prendre des actes directement exécutoires, liberté d'organisation et de fonctionnement des organes des collectivités, liberté de percevoir des impôts et liberté de dépenser, etc. En forçant un peu le trait on pourrait d'ailleurs considérer que la libre administration est aux collectivités territoriales ce que la liberté individuelle est aux personnes physiques » 27 ( * ) .
En philosophie morale, l'autonomie signifie que « la volonté est législatrice », qu'elle « va poser par elle-même ses lois » 28 ( * ) . La centralisation française ne s'accommode guère d'une telle conception dès lors qu'il est question des collectivités territoriales. Pour autant, la doctrine française a depuis longtemps soutenu l'idée de la logique de « décentralisation autonomie » 29 ( * ) .
II. - La responsabilité locale : la logique de « la décentralisation-autonomie »
Michel Verpeaux, en commentant la fameuse décision du Conseil d'État du 18 janvier 2001, Commune de Venelles c./M. Morbelli, considère que « le principe de libre administration des collectivités territoriales constitue... une garantie, au même titre que le principe de la séparation des pouvoirs. L'un comme l'autre ne constituent pas des droits mais peuvent être conçus comme des conditions jugées constitutionnellement nécessaires, par l'article 72 de la Constitution pour l'un, par l'article 16 de la Déclaration des droits pour l'autre, pour l'affirmation des libertés reconnues dans d'autres dispositions qui ne sont plus alors organiques mais qui concernent des droits substantiels ».
Les droits substantiels dévolus aux collectivités territoriales évoqués par celui qui revêt pour l'occasion les habits de l'arrêtiste permettent de nourrir une autre notion développée par la doctrine : la décentralisation-autonomie qui est à la fois mue par l'exercice des compétences locales (A) et l'exercice du pouvoir normatif local (B).
A. La logique « décentralisation-autonomie » mue par l'exercice des compétences locales
Une des premières définitions du principe de subsidiarité dans la littérature politique et juridique française a été apportée par le rapport Vivre ensemble, dit « Rapport Guichard » 30 ( * ) :
« Il conduit à rechercher toujours le niveau adéquat d'exercice des compétences, un niveau supérieur n'étant appelé que dans les cas où les niveaux inférieurs ne peuvent pas exercer eux-mêmes les compétences correspondantes. L'État doit ainsi déléguer aux collectivités tous les pouvoirs qu'elles sont en mesure d'exercer ».
L'exercice des compétences locales toujours plus nombreuses, s'il ne rend pas obsolète la relation verticale entre le pouvoir central et les collectivités infraétatiques, témoigne de l'émergence de ce que la doctrine qualifie de « puissance territoriale » 31 ( * ) . Elle rompt ainsi avec la conception selon laquelle il n'existerait en France que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tout en vidant de son sens la notion de centre d'impulsion unique, qui est le meilleur signifiant de la relation de dépendance des collectivités territoriales vis-à-vis du pouvoir central.
Benjamin Constant avait déjà évoqué en 1815 l'idée d'un pouvoir local et/ou d'un pouvoir municipal et indiquait : « que l'on a considéré le pouvoir local comme une branche dépendante du pouvoir exécutif : au contraire, il ne doit jamais l'entraver, mais il ne doit point en dépendre » 32 ( * ) . L'expression d'un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir local l'emporte sur la relation asymétrique, donnant de ce fait de la substance à la notion de décentralisation-autonomie.
Alexis de Tocqueville 33 ( * ) et Benjamin Constant, imprégnés de leur conviction libérale, en glosant sur le pouvoir local, se posent en défenseur de la décentralisation qu'ils considèrent comme une garantie de la liberté tout en étant un vecteur du développement de la responsabilité locale. En effet, l'élection des organes représentatifs de la collectivité territoriale favorise l'éducation de la population.
L'importance de l'élection des organes délibérants locaux fait l'objet de toutes les attentions de la part du doyen Hauriou. D'après ce qu'il rapporte, la décentralisation « consiste en la création de centres d'administration publique autonomes où la nomination des agents provient du corps électoral de la circonscription et où ces agents forment des agences collectives ou des assemblées » 34 ( * ) . Il décrit donc très clairement comme une relation de cause à effet l'autonomie de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les collectivités territoriales, avec le critère de l'élection des organes de décision.
L'attribution de compétences à des organes non centraux autonomes ne suffit pas à caractériser la décentralisation. Il faut également que ces organes soient élus pour que leur autonomie soit garantie. Aussi, pourrait-on considérer que la décentralisation, ainsi que l'autonomie des organes non centraux, n'existent pas dans les sociétés qui ne connaissent pas ou ne pratiquent pas la démocratie. À la vérité, dans une société démocratique, l'élection n'est pas seulement une technique ou un procédé de nomination. Elle met en oeuvre des forces politiques et des structures sociales qui vont s'inscrire dans un processus global de responsabilité locale.
Aussi dans un État unitaire centralisé ou décentralisé, il est possible d'affirmer le principe de la décentralisation administrative qui nie l'autonomie locale en général, tout en consacrant dans la norme l'autonomie financière des collectivités territoriales 35 ( * ) . Par ailleurs, le pouvoir central va jusqu'à consentir l'attribution du pouvoir normatif à une partie des collectivités territoriales. C'est la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. Certains auteurs parlent « d'ordre public autonomiqu e » 36 ( * ) pour expliquer cet état de fait.
L'ordre autonomique semble s'établir sur la base de considérations endogènes, c'est-à-dire propres à l'État visé, par exemple la nécessité d'adapter 37 ( * ) , mais aussi par des considérations issues de l'ordre public international. C'est ainsi que l'autonomie locale, concept politique en vogue dans les États unitaires européens, puise largement ses racines juridiques dans la Charte européenne de l'autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 38 ( * ) par le Conseil de l'Europe. Un document politique 39 ( * ) , certes, mais susceptible d'avoir une valeur contraignante pour les États à la double condition de signature et de ratification par les Parlements nationaux. Le professeur Auby a certainement raison lorsqu'il dit que ces documents politiques « ne sont pas des textes froids. Ils sont chargés de résonances » 40 ( * ) .
Au prisme de la notion « d'autonomie administrative et financière », « la fonction de l'autonomie locale consacrée peut être atteinte dès lors que les conditions d'exercice de la liberté d'action recherchée s'accompagnent d'un ensemble de règles et de pratiques harmonisées qui tendent à conférer plus d'épanouissement aux collectivités territoriales décentralisées dans leurs rapports avec l'État » 41 ( * ) .
Les règles et les pratiques les plus emblématiques de l'affirmation de l'autonomie locale sont certainement la construction d'un droit de la décentralisation qui accepte sous certaines conditions le pouvoir normatif local.
B. La logique « décentralisation-autonomie » mue par le pouvoir normatif local
Marc Joyau 42 ( * ) , plus que d'autres, avait proposé d'adopter une stricte répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales pour permettre à ces dernières d'édicter des normes de nature politique prise non pas « en exécution » de la loi, mais « en application de la loi ». Ladite proposition parce qu'elle entraîne les collectivités territoriales françaises sur le terrain de la décentralisation politiques se trouve limitée par la philosophie centralisatrice, héritée de la Révolution et des réformes napoléoniennes.
En droit français, l'autonomie n'est ni la souveraineté, ni l'indépendance. La souveraineté et l'indépendance étant rapportées à l'État, quel obstacle existe-t-il à décréter l'autonomie des collectivités territoriales françaises ? C'est l'impossibilité pour les personnes publiques locales de décider pour elles-mêmes en créant du droit. La conception défendue par Charles Eisenmann est pourtant moins rigide. Il formule une définition originelle de l'autonomie locale en invoquant la décentralisation qu'il fait reposer sur la notion de compétences des organes non centraux 43 ( * ) .
Il faut se rappeler qu'à l'origine, l'existence ou la reconnaissance de la commune et donc de l'autonomie locale n'entretient aucun lien avec une quelconque soumission de cette communauté humaine locale à l'ordre du pouvoir politique en place. L'autonomie locale n'est donc pas une expression qui suscite des craintes. Concept positif au départ, l'autonomie locale sera dénaturée tout au long de la période révolutionnaire jusqu'à la fin d'une période récente qui verra l'émergence d'une République française dont l'organisation est désormais décentralisée.
Par autonomie locale, l'article 3, alinéa 1 er de la Charte de l'autonomie locale entend « le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, une part importante des affaires publiques ». La part importante des affaires publiques des collectivités infraétatiques à gérer peut aller jusqu'à la capacité de produire de la norme locale.
Aussi, il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre la forme de l'État unitaire et l'affirmation d'une décentralisation territoriale qui intègre l'autonomie locale, à l'égard de laquelle a été manifestée bien des peurs. Les exemples les plus illustratifs sont certainement les collectivités de droit commun de l'article 73 de la Constitution ainsi que les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, notamment celles qui adoptent le statut d'autonomie. Par conséquent, le chemin parcouru par l'autonomie locale est déjà bien plus long outre-mer que dans l'hexagone.
Depuis la révision constitutionnelle de 2003, donnant naissance à un nouvel ordre public décentralisé, il est plus aisé de conceptualiser la norme dite locale qui n'est pas elle-même autonome de la norme centrale, précisément en raison du strict respect de la hiérarchie des normes. L'intérêt de la chose ne réside pas dans le rapport de subordination évident de la norme dite locale à la norme centrale, mais bien dans le fait que les organes non centraux peuvent produire de la norme locale. Soit dit en passant, dans la théorie développée par Charles Einsenmann, on en arrive à une autonomie de la norme non-centrale qui conteste le principe d'unité 44 ( * ) .
Il a même été évoqué « la propriété des normes qui pourront être édictées » 45 ( * ) par les collectivités territoriales. En référence à la décentralisation moderne, Maurice Bourjol traduit de manière limpide cette idée en affirmant que « la libre administration implique en effet, le pouvoir de prendre des actes administratifs et parmi ces actes, des règlements... » 46 ( * ) .
Sur la base de la définition de la norme livrée par Michel Troper, l'épineuse question à résoudre est de savoir si le système juridique français est un système de justification permettant à l'acte juridique local d'acquérir la signification de norme 47 ( * ) . On peut tenter une réponse que l'on va emprunter à la doctrine de Bertrand Faure qui estime que « la présence d'un pouvoir réglementaire local n'est pas distincte de l'apparition des notions de collectivités locales et de décentralisation, elles-mêmes concomitantes à l'essor du centralisme » 48 ( * ) .
Marcel Waline, soutient pour sa part, que « décentraliser, c'est retirer des pouvoirs à l'autorité centrale pour les transférer à une autorité de compétence moins générale » 49 ( * ) . Aussi, la faculté d'adaptation conférée aux collectivités françaises d'Amérique depuis la révision constitutionnelle de 2003 par le procédé des habilitations législatives n'emporte pas pour conséquence un retrait de la faculté d'adapter au Gouvernement et au Parlement, mais davantage un partage de compétence normative. C'est moins vrai pour les collectivités d'outre-mer de l'article 74 ou pour la Nouvelle-Calédonie, mais avec cette limite constante d'un toujours possible retour en arrière qui aurait pour effet de reverdir le légicentrisme.
D'une manière générale, si le pouvoir réglementaire local contenu à l'article 72, alinéa 3 de la Constitution demeure plus prometteur que prolixe pour ce qui le concerne, le nouvel article 72, alinéa 4 de la Constitution, complété par la loi organique du 1 er août 2003 50 ( * ) autorise désormais les collectivités territoriales à « déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
Il ne s'agit plus pour les autorités locales d'expérimenter une nouvelle compétence dans le cadre d'une loi ou d'un règlement dérogatoire, mais d'élaborer elles-mêmes la norme, en s'affranchissant de la règle nationale générale. La constitutionnalisation de l'expérimentation locale constitue une double nouveauté parce qu'en France aucune collectivité territoriale de droit commun n'avait été autorisée à exercer, fût-ce à titre expérimental, un pouvoir normatif dans le domaine de la loi. La décentralisation législative était jusqu'en 2003 exclusivement réservée aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
La doctrine tire les conséquences de cette avancée considérable de l'autonomie locale grâce à cette consécration constitutionnelle qu'est l'expérimentation locale. Il est constaté qu'« en oscillant entre une fonction de rationalisation de l'élaboration des règles de droit et une expression directe de l'autonomie locale », l'expérimentation locale apparaît « comme les prémices d'une décentralisation politique » 51 ( * ) .
Le contexte actuel de l'acte III de la décentralisation peut-il faire l'économie d'un débat sans arrières pensées régionalistes et sans peur d'un quelconque délitement de l'État, sur les perspectives en droit français d'une compétence législative d'attribution aux collectivités territoriales ? La question n'appelle pas ipso facto de réponse immédiate mais a pour objet d'ouvrir de manière franche les discussions sur ce sujet, objet de développements dignes d'intérêt sous la plume de Jacqueline Domenach 52 ( * ) .
Conclusion
L'affirmation de « l'État stratège » 53 ( * ) , couplée à une logique d'approfondissement de la décentralisation et de territorialisation de l'action publique, notamment locale, fait le lit d'une montée en légitimité juridique de l'autonomie locale. La Commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par Pierre Mauroy faisait observer « qu'il n'existe pas aujourd'hui de politique publique qui ne doive faire sa part à la dimension territoriale. Il est de moins en moins possible d'agir uniformément sur l'ensemble du territoire » 54 ( * ) .
Par ailleurs, « le pari d'une société mature permettant la clarification du rôle de l'État et la construction des progrès sur la confiance » 55 ( * ) nourrit le développement de la logique « décentralisation-autonomie » par la multiplication des politiques décentralisées reposant sur les principes de libertés locales et de responsabilités locales.
En étudiant les recommandations-injonctions de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) en matière de gestion publique, la conviction livrée consiste à encourager le rapprochement entre « autonomie et responsabilité » pour en faire un « couple nécessairement vertueux » 56 ( * ) . Il s'agit de confier une plus grande liberté d'action à l'échelon local en matière de gestion ainsi qu'une plus grande autonomie dans la mise en oeuvre des programmes dont il a la charge. Cette plus grande liberté s'exerçant dans un cadre défini et limité au sein duquel le décideur public local est comptable des résultats à l'égard du pouvoir central et supranational, mais également devant les citoyens.
Pour s'emparer de la prospective susceptible de devenir la réalité demain, référons nous à un rapport parlementaire qui n'a certes pas de valeur normative mais dont la nature prénormative ne peut pas être écartée. L'avenir de l'organisation décentralisée de la République imaginée par le Sénat comporte la volonté de franchir le cap du pouvoir réglementaire local d'ici 2025 57 ( * ) .
À ce propos, Geneviève Koubi, dans une de ces nombreuses productions invite à « examiner les frontières psychologiques de notre droit public en s'interrogeant, notamment, sur la possibilité d'attribuer aux collectivités locales un véritable pouvoir normatif ou bien encore sur la possibilité de se représenter l'intérêt général en dehors du seul État. Au-delà du système légal, il convient d'examiner les procédures techniques du pouvoir qui se trouvent au centre de « l'art de gouverner » » 58 ( * ) .
Vincent Roux, Professeur agrégé à la Faculté de droit et de science politique de l'Université d'Aix-Marseille, secrétaire général de l'Institut de droit d'outre-mer (IDOM) - Autonomie, gestion locale et gouvernance
La gestion et la gouvernance des collectivités territoriales posent la question de leur autonomie. Si cela est particulièrement vrai pour les départements, régions et collectivités d'outre-mer, qui pourraient verser dans la revendication d'une autonomie qui flirterait avec l'indépendance, cela est aussi vrai pour l'ensemble des collectivités territoriales françaises et dans une moindre mesure pour un grand nombre d'établissements publics.
L'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée (...) » contient dans sa rédaction le germe des difficultés de conciliation entre le concept d'organisation décentralisée qui devra s'appliquer aux collectivités territoriales et qui sous-tend l'acceptation d'une certaine autonomie dans la gouvernance de ces entités et le concept de République indivisible qui douche tout espoir d'autonomie politique radicale pour les collectivités territoriales.
Au-delà de cette tension des concepts d'autonomie des parties face à l'existence affirmée d'un tout, il convient de s'interroger sur les problématiques multiples et incertaines qui entourent la notion d'autonomie dans la gestion locale et la gouvernance des collectivités territoriales. Quelle autonomie pour quelles structures administratives ?
Cette question amène à réfléchir aux différentes acceptions du concept d'autonomie et à se questionner sur le sens de la notion d'autonomie des collectivités territoriales au regard du « mille-feuille » que ces dernières constituent et au regard de l'enchevêtrement de collectivités territoriales correspondant à des territoires communs qui nécessiteraient une gouvernance unique ou au moins concertée.
Le principe de subsidiarité issu du droit communautaire permettra-il de sortir par le haut de cette trop grande complexité qui gangrène l'efficacité dans la mise en oeuvre des missions de service public qui restent la raison d'être des collectivités territoriales ?
En effet, l'autonomie, si importante puisse-t-elle être pour les acteurs et les femmes et hommes politiques qui font vivre les collectivités territoriales, ne devrait pas être l'objectif principal de ces dernières. En effet, l'autonomie des collectivités territoriales n'est qu'un moyen au service des objectifs clairs mais non atteints de la gestion locale et de la gouvernance. Ces objectifs devraient être une gestion irréprochable au service de l'intérêt général, orientée vers un développement endogène et durable des territoires concernés.
Les problématiques sont multiples et incertaines autour de la notion d'autonomie dans la gestion locale et la gouvernance des collectivités territoriales. Cela est particulièrement vrai outre-mer. Car les questionnements qui agitent les départements et collectivités d'outre-mer s'apparentent quelquefois à des questionnements étatiques.
Faut-il qu'une collectivité territoriale soit autonome pour que sa gestion et sa gouvernance soient performantes ?
Les termes de « bonne gouvernance » ou de « bonne gestion », n'emportent pas de définitions unanimes dans la doctrine économique, juridique ou de gestion 59 ( * ) . De même, la notion d'autonomie pour un territoire ou une structure juridique peut revêtir plusieurs acceptions 60 ( * ) .
Dans le cadre de l'Union européenne, le concept de subsidiarité, lui aussi complexe et sujet à interprétations, pourrait peut-être représenter une solution pour l'autonomie des collectivités territoriales et autres entités administratives plus ou moins bien identifiées, à condition d'une réforme en profondeur de ces dernières qui permettrait d'en réduire radicalement le nombre et d'en clarifier les compétences.
I. - Quelle autonomie pour quelle gouvernance ?
Les concepts de gouvernance et d'autonomie doivent être précisés. Il faudra se demander si une « bonne gouvernance », à supposer que l'on s'entende sur ce que cela signifie, nécessite impérativement une autonomie de la part de la structure qui exerce cette gouvernance. De même, une interrogation sur le type d'autonomie que les collectivités territoriales doivent revêtir dans le cadre d'une république décentralisée ne peut être évitée.
A. Le nouveau concept de gouvernance 61 ( * ) territoriale.
Le concept de gouvernance territoriale désigne un mode de gestion des affaires publiques qui n'est pas seulement le fait d'une hiérarchie administrative étatique juridiquement établie. Dans cette notion, les lieux de décision publique, qu'ils soient institutionnellement reconnus ou qu'ils aient émergé de l'action spontanée des acteurs de la société comme les associations, les entreprises, les individus, doivent coopérer ensemble dans un même objectif de performance et d'amélioration des conditions d'existence des populations. De même, dans le concept de « gouvernance territoriale », la notion administrative qui découpe les territoires en frontières bien délimitées : communes, cantons, départements, régions... devient illusoire. Ce qui compte, ce n'est pas la qualification juridique du territoire en tant que commune, département ou région... mais c'est son existence réelle en terme géographique et identitaire. La bonne gouvernance implique ainsi la coopération interrégionale. Elle implique de faire fi des frontières juridiques pour laisser exister les fortes ressemblances et synergies locales mêmes transfrontalières, si cela va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Cette question de l'efficacité ou de l'inefficacité des frontières entre deux collectivités territoriales est particulièrement présente dans les collectivités et départements d'outre-mer qui ont un environnement spécifique souvent distinct du standard européen.
Le territoire devient un système ouvert en relation avec le monde et influencé par ce dernier. Il existe, progresse, se développe, mais aussi se met en danger, s'autodétruit, se recroqueville par les échanges et les relations qu'il choisit de mettre ou de ne pas mettre en oeuvre.
Avec la notion de système, le territoire devient un tout cohérent mais changeant, constitué d'un nombre très important de sous-systèmes qui sont autant de territoires spécifiques. Le territoire développe sa propre identité, sa propre histoire, sa propre dynamique économique. Il y a une forme d'autonomisation et d'auto-organisation qui sont à l'oeuvre 62 ( * ) .
À côté de la réflexion sur la nature et l'étendue du territoire à prendre en compte pour une gouvernance optimale, le concept de « gouvernance territoriale » interroge aussi sur ce que veut dire être efficace ou être performant en matière de conception, de mise en oeuvre, de contrôle et de suivi des politiques territoriales.
C'est dans cet axe de définition que se situe la résolution n° 2 sur la gouvernance territoriale adoptée à la 14 e session de la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire (CEMAP) des États membres du Conseil de l'Europe, à Lisbonne, le 27 octobre 2006. Cette résolution en cinq points donne une définition assez précise de ce que l'Europe entend par « gouvernance territoriale », notamment dans son premier point : « La gouvernance territoriale peut être perçue comme la manière de gérer les territoires d'un État et de mettre en oeuvre des politiques, notamment en ce qui concerne la distribution des rôles et des responsabilités entre les différents niveaux du gouvernement (supranational, national et régional) et les processus sous-jacents d'établissement de relations, de négociation et de création de consensus. À cet égard, les principes de subsidiarité et de réciprocité préconisés dans les principes directeurs de la CEMAT revêtent une importance toute particulière. La gouvernance territoriale peut également être considérée comme l'émergence et la mise en oeuvre de nouvelles formes communes de planification et de gestion de la dynamique socio-territoriale. Le rôle directeur traditionnel de l'État est remis en question par un engagement beaucoup plus global et coresponsable des acteurs clés dans le domaine de l'aménagement du territoire. La culture sociopolitique, le cadre législatif, la capacité institutionnelle, les grandes structures organisationnelles, les traditions de création de partenariats et de mise en oeuvre de stratégies de développement de chaque pays entraîneront des perceptions et des attitudes différentes face à la gouvernance territoriale et aux difficultés à surmonter pour son application effective.
« Une gouvernance territoriale saine vise à gérer la dynamique territoriale en indiquant les conséquences, au niveau territorial, des diverses politiques prévues par les acteurs des secteurs public et privé. Le but est de convenir d'un ensemble d'objectifs et de responsabilités partagées en ayant recours à des stratégies et à des politiques d'aménagement du territoire » 63 ( * ) .
Dans le même sens, l'accord de Cotonou de juin 2000 définissait aussi la « bonne gouvernance » comme la « gestion transparente et responsable, des ressources humaines, naturelles, économiques et financières dans des buts de développement équitable et durable » 64 ( * ) .
Au regard du concept de gouvernance qui affaiblit la notion de centre décisionnel et qui met l'accent sur la nécessaire coopération de réseaux complexes d'acteurs et d'institutions différents selon les territoires considérés, la recherche de l'autonomie n'a de sens que si elle permet effectivement de mieux atteindre les objectifs de la bonne gouvernance : un développement équitable et durable du territoire.
B. Quelle autonomie ?
La question de l'existence et du degré d'autonomie des collectivités territoriales ou des établissements publics 65 ( * ) par rapport à l'État central, n'est pas simple. Elle va de pair avec le concept de libre administration des collectivités territoriales et est souvent reliée en droit public au processus de décentralisation 66 ( * ) à l'oeuvre depuis 1982 67 ( * ) .
L'autonomie est : « la possibilité de décider, pour un organisme, un individu, sans en référer à un pouvoir central, à une hiérarchie, une autorité » 68 ( * ) ; « C'est le droit de gouverner par ses propres lois » 69 ( * ) .
La notion d'autonomie remonte au droit que les romains avaient laissé à certaines villes grecques de se gouverner elles-mêmes. D'un point de vue étymologique, le mot provient de la combinaison de deux mots grecs : auto (à soi-même, pour soi-même) et de nomoï (la loi). C'est se donner à soi-même sa propre loi.
Depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 70 ( * ) , la notion d'organisation décentralisée de la République est consacrée dans l'article 1 er de la Constitution.
La décentralisation suppose l'existence d'une certaine autonomie pour les collectivités territoriales sans aller jusqu'à remettre en cause l'unité de l'État. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales 71 ( * ) semble donner un certain contenu à cette notion d'autonomie tout en prenant le soin d'exclure les compétences régaliennes qui demeurent l'apanage de l'État central.
La notion d'autonomie pour un territoire peut se décliner entre une autonomie faible ou de simple façade jusqu'à une autonomie forte qui ressemblerait à l'indépendance.
Ainsi peut-on distinguer, l'autonomie institutionnelle, l'autonomie de gestion, l'autonomie politique, l'autonomie constitutionnelle 72 ( * ) ...
Quant au contenu du principe d'autonomie des collectivités territoriales, on distingue de manière classique l'autonomie juridique, l'autonomie organique, l'autonomie fonctionnelle.
L'autonomie juridique se confond avec l'autonomie institutionnelle. Elle signifie la reconnaissance juridique par l'État d'une collectivité humaine, sur un territoire. Les collectivités territoriales, personnes juridiques distinctes de l'État, sont créées par la Constitution. En tant que personnes morales de droit public, elles disposent d'un patrimoine, de la capacité d'accomplir des actes juridiques et de la possibilité d'ester en justice.
L'autonomie organique signifie que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus (article 72 de la Constitution de 1958) alors que les autorités administratives déconcentrées sont nommées par l'État.
L'autonomie fonctionnelle se confond avec l'autonomie de gestion. Elle signifie que l'assemblée locale délibérante doit avoir une compétence normative.
Cela se traduit pour les outre-mer depuis la réforme de 2003 par la distinction entre principe d'identité législative et principe de spécialité législative contenus respectivement dans les articles 73 et 74 de la Constitution.
L'article 73 qui définit le statut des départements et régions d'outre-mer permet, sur habilitation législative ou réglementaire, d'adapter la législation nationale pour tenir compte des « caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités ».
Ainsi, la loi organique du 21 février 2007 73 ( * ) crée dans son article premier un nouvel article L.O. 3445-1 dans le code général des collectivités territoriales ainsi libellé : « Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences ».
Quant à l'étendue de l'autonomie, en France, les compétences transférées aux collectivités territoriales ne peuvent être que purement administratives, à l'exception peut-être du cas complexe de la Nouvelle-Calédonie 74 ( * ) . En revanche, dans certains pays européens voisins comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, les entités décentralisées peuvent se voir transférer des compétences législatives et acquérir une forme d'indépendance politique.
L'étendue de l'autonomie dépend aussi de la plus ou moins grande « autonomie financière » qui sera laissée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics. C'est la loi organique du 29 juillet 2004 75 ( * ) qui a fixé, en application des dispositions constitutionnelles de l'article 72-2, les règles relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales 76 ( * ) . L'autonomie financière est nécessaire à la libre administration. Mais si l'autonomie financière suppose un certain pouvoir budgétaire, on peut s'interroger 77 ( * ) sur le fait de savoir si une autonomie fiscale est véritablement nécessaire pour les collectivités territoriales.
II. - Le principe de subsidiarité pour quelles structures administratives ?
La notion d'autonomie, pour les collectivités territoriales et pour les établissements publics, pose la question du principe de subsidiarité. Comment ventiler les compétences entre les très nombreuses structures administratives, territoriales ou fonctionnelles, sans tomber dans l'inefficacité, le gaspillage ou à tout le moins dans l'empilement de compétences enchevêtrées qui conduisent à une allocation sous-optimale des deniers publics ?
Pour que l'autonomie de chaque structure administrative existante ait un sens, il faut s'interroger sur une réforme de la structure administrative française dans son ensemble qui, dans sa trop grande complexité actuelle, rend difficile une vraie autonomie pour chacune des trop nombreuses « entités administratives » réclamant leur liberté. Une réforme radicale des structures administratives françaises qui pourrait apparaître comme une solution théorique efficace à l'engourdissement et à l'endettement chronique de l'État ne paraît cependant pas possible concrètement dans le court terme, surtout si l'on souscrit aux analyses de l'école du public choice sur cette question.
A. Le principe de subsidiarité.
Le très ancien principe de subsidiarité 78 ( * ) , repris comme modèle dans l'architecture des pouvoirs de l'Europe, pourrait permettre une bonne articulation des politiques publiques en fonction de leur plus ou moins grande proximité avec le local.
En effet, une définition qui est souvent donnée de ce principe est la suivante : « le principe de subsidiarité signifie que tout échelon supérieur s'interdit de réaliser lui-même ce qu'un échelon inférieur pourrait faire ».
Il faut noter que la subsidiarité n'est pas seulement le principe d'efficacité qui affirme que le bon niveau de compétence ne doit être jamais plus haut que nécessaire mais toujours le plus bas possible. Originellement, ce principe affirme la primauté de l'initiative individuelle sur l'initiative collective et celle des communautés de base sur celle des communautés plus vastes et d'un rang plus élevé ; il en déduit l'attitude que les groupes doivent adopter lorsqu'ils suppléent les défaillances des individus ou des groupes qui les composent : il s'agit de leur apporter les secours nécessaires à leur rétablissement mais non de les détruire ni de les absorber 79 ( * ) .
Ce principe a été amené par Aristote : « la famille est capable de suffire aux besoins de la vie quotidienne, et le village à ceux d'une vie quotidienne élargie » 80 ( * ) , repris par saint Thomas d'Aquin, avec l'idée qu'il faut que le niveau supérieur vienne au secours des initiatives défaillantes des niveaux inférieurs et qui relie ce concept à celui de justice qui serait ce qui oblige à « donner à chacun son bien propre » 81 ( * ) , puis développé par les encycliques sociales de l'Église catholique, notamment, Rerum novarum de Léon XIII 82 ( * ) et Quadragesimo Anno de Pie XI 83 ( * ) .
Pour la doctrine sociale de l'Église, le principe de subsidiarité 84 ( * ) est d'abord « le principe de la fonction supplétive de toute collectivité ».
Le principe de subsidiarité est aujourd'hui surtout connu pour être présent dans le droit communautaire. En effet, le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, dit traité de Maastricht, précise dans son article 3B que : « La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.
« Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
« L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ».
Le principe de libre administration des collectivités territoriales complété par la révision constitutionnelle de 2003 intègre le principe de subsidiarité, notamment dans l'article 72, alinéas 2 et 3 : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »
Le problème avec le principe de subsidiarité dans la grande complexité des structures administratives françaises 85 ( * ) , c'est qu'il devient difficile de savoir quel est l'entité ou l'échelon le plus adapté pour résoudre une difficulté.
Pour améliorer la gouvernance et la gestion locale, c'est-à-dire pour mettre en oeuvre un service public efficace, une réflexion et une réforme importante du fonctionnement de l'État devrait être rapidement engagées.
B. La réforme nécessaire des structures administratives.
Le grand nombre, la complexité, la diversité, l'obscurité, le chevauchement, l'enchevêtrement, l'entrelacs... des collectivités territoriales et structures administratives françaises, conduisent à l'inefficacité, au gaspillage et à l'explosion des coûts financiers nécessaires à la mise en oeuvre des services publics.
La réflexion lancée en 2008 avec le « Comité Balladur » 86 ( * ) qui débouchera sur la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriale 87 ( * ) marque une prise de conscience de la nécessité de réformer l'État et les collectivités territoriales.
Cependant, cette réforme ne va pas assez loin et ne permet pas de résoudre l'inflation permanente du secteur administratif : trop de niveaux ; trop d'élus ; trop d'administrations ; trop de ministères ; trop de subdivisions administratives...
En réalité, la loi du 16 décembre 2010 ne simplifiait pas l'architecture administrative des collectivités territoriales mais mettait en place une nouvelle complexité. Il suffit pour s'en convaincre de lire « l'objet du texte » présenté par le site internet du Sénat : « Le projet de loi vise principalement à réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité, à simplifier et à achever la carte de l'intercommunalité et à créer des métropoles.
« L'article 1 er substitue ainsi aux conseillers régionaux et conseillers généraux une nouvelle catégorie d'élus locaux : les conseillers territoriaux siégeant à la fois dans les départements et les régions. Ils seraient, comme le précise l'article 36, désignés pour la première fois en mars 2014.
« Le projet de loi veut renforcer la structuration des territoires en facilitant les fusions de communes par la substitution d'un nouveau dispositif au mécanisme prévu par la loi «Marcellin» de 1971 (articles 8 à 11) ainsi que les regroupements de départements et de régions (article 12 et 13) et en créant des structures de coopération spécifiquement dédiées aux agglomérations très urbaines, les métropoles (articles 5 et 6) et les pôles métropolitains (article 7).
« Concernant les intercommunalités, l'article 2 prévoit l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, qui seront désignés en même temps que les conseillers municipaux par le biais d'un système de «fléchage». L'article 3 modifie, quant à lui, les règles de fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseils communautaires. Les dispositions de ces deux articles entreraient en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2014. Corrélativement, les articles 16 à 30 visent à achever et à rationaliser la carte de l'intercommunalité d'ici au 31 décembre 2013.
« Le projet de loi vise enfin à fixer des principes permettant l'élaboration d'une future loi visant à clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Cette loi devra mettre fin à l'enchevêtrement des responsabilités locales, auquel répond celui des financements » 88 ( * ) .
Ce texte ne s'attaque pas au véritable problème qui, d'un point de vue de la bonne gouvernance, est celui du trop grand nombre de structures administratives et du trop grand nombre d'élus.
Il suffit de tenter d'établir une liste exhaustive des différentes structures administratives territoriales et nationales en France pour se rendre compte qu'il y a une hypertrophie de ce secteur. Le « mille-feuille administratif et territorial » est un véritable frein à l'efficacité et à la bonne gouvernance. Et même La Cour des comptes 89 ( * ) invite l'État à réformer en profondeur son organisation territoriale pour supprimer les doublons et devenir plus efficace.
On compte aujourd'hui en France un élu ou plus exactement un mandat électoral, car il y a souvent cumul, pour 108 habitants. Le taux de représentation français est quatre fois et demie supérieur à celui des États-Unis d'Amérique !
Malgré la bonne volonté affichée, avec notamment la RGPP (révision générale des politiques publiques) puis la MAP (modernisation de l'action publique) ou encore l'annonce d'un choc de simplification et le vote d'une législation limitant le cumul des mandats, la gestion locale souffre encore de ce canevas de structures administratives imbriquées qui génère des freins et de la complexité dans l'action et dans la gouvernance des collectivités territoriales.
Tableau non exhaustif du mille-feuille administratif et territorial français
|
Intitulé |
Nombre |
|
Présidence |
1 |
|
Ministères |
38 (2013) |
|
Ambassades |
En 2011, le réseau diplomatique et consulaire comprend 162 ambassades, 4 antennes diplomatiques, 98 consulats généraux ou consulats, 130 sections consulaires, 2 antennes consulaires et plus de 500 consulats honoraires. |
|
Assemblée nationale |
1 (577 députés) |
|
Sénat |
1 (348 sénateurs) |
|
Conseil économique, social et environnemental |
1 (233 conseillers) |
|
Régions d'Europe |
8 (78 députés européens français) |
|
Régions françaises |
26 (2 040 élus) |
|
Département français |
101 (4 042 élus) |
|
Intercommunalité (EPCI) : Métropole ; communautés urbaines ; communautés de communes ; communautés d'agglomération |
Au 1 er janvier 2012, notre territoire compte 35 303 communes regroupées au sein de 2 581 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. On dénombre désormais 15 communautés urbaines et une métropole, 202 communautés d'agglomération, 2 358 communautés de communes, 5 syndicats d'agglomération nouvelle (SAN). (environ 38 000 élus - chiffre étrangement difficile à obtenir et à confirmer) 90 ( * ) |
|
Communes Maires |
Maires (36 635) ; conseillers municipaux (519 417) |
|
Préfectures |
101 |
|
Sous-préfectures |
138 |
|
Rectorats |
30 académies en comptant les DOM |
|
Autorités administratives indépendantes |
38 |
III. - Quelle autonomie pour le département de Mayotte ?
Pour illustrer la complexité de la problématique outre-mer, j'évoquerai les changements institutionnels et les spécificités du département de Mayotte.
A. Le cadre général.
L'évolution du statut juridique de Mayotte est un cas d'école pour le droit public Français. Il permet de cerner les difficultés du passage d'un régime de spécialité législative à celui d'un régime d'identité législative. Il est vrai que cette distinction classique considérée par la doctrine comme la Summa Divisio du droit de l'outre-mer a pu être critiquée et considérée comme inopérante. Toutes les collectivités d'outre-mer seraient à mi-chemin entre ces deux concepts avec seulement une dominante de spécialité ou d'identité 91 ( * ) .
L'étude des vicissitudes de Mayotte dans l'obtention d'un statut de département d'outre-mer nous paraît essentielle comme préalable à l'approfondissement des questions de compétences environnementales et à une réflexion sur un développement durable de Mayotte dans le cadre du droit Français. Cette étude permettrait aussi de montrer que la notion d'autonomie pour le département de Mayotte est particulièrement difficile à cerner. « L'autonomie » de Mayotte étant peut-être mieux garantie dans le cadre français et européen que dans une vie solitaire ou dans un rapprochement de l'Union des Comores.
L'adaptation du département de Mayotte, à la complexité et à la rigueur du droit commun, constitue sans doute le défi majeur du processus de départementalisation. En effet, de nombreuses spécificités mahoraises devront être intégrées sans heurts au corpus juridique national.
La révision constitutionnelle de 2003, réorganise les articles 73 et 74 de la Constitution.
À l'intérieur de ce maquis, Mayotte se trouve à la croisée des chemins institutionnels : « Mayotte voyage dans les catégories juridiques ».
Jusqu'au 31 mars 2011, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, elle est aujourd'hui département d'outre-mer régi par l'article 73 de la Constitution.
Au terme de cet article est posé explicitement le principe de l'identité législative pour Mayotte. Des mesures d'adaptation facultatives sont possibles en fonction « des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Cette possible remise en cause de dispositions législatives longtemps incontestables, soient qu'elles prévoient l'exclusion de l'application à Mayotte de dispositions en vigueur dans les autres départements, soit qu'elles instaurent un dispositif spécifique à l'île, conduiront le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État à apprécier le caractère proportionné ou non aux caractéristiques et contraintes actuelles de Mayotte du contenu des lois promulgués.
B. Les faibles marges de manoeuvre de Mayotte.
Mayotte est un petit territoire situé dans l'océan Indien avec de fortes spécificités culturelles économiques, sociales et environnementales : fortes contraintes démographiques, double insularité, éloignement, culture africaine, religion musulmane, plurilinguisme, fragilité du milieu naturel, biodiversité menacée...
Le PIB de Mayotte s'élevait à 3 960 euros par habitant en 2001 et à 6 575 euros en 2009, soit environ 25% du PIB moyen européen.
La question du développement de ce territoire et de sa gouvernance est d'actualité car Mayotte, en devenant département Français, doit rattraper des retards accumulés liés à ces contraintes.
Cette situation particulière de Mayotte limite les possibilités d'économies d'échelle et entraîne des surcoûts, tant pour l'accès aux facteurs de production et aux marchés qu'en termes d'aménagements et d'infrastructures.
Depuis 2001, Mayotte a connu une forte augmentation du niveau de vie de sa population. À la fois grâce à la croissance des revenus mais surtout grâce à la qualité et à la couverture des services publics (protection sociale, éducation, santé).
La stabilité politique et juridique consécutive à la départementalisation offre une réelle sécurité aux investisseurs potentiels. Cependant cette croissance forte de Mayotte, son rattrapage progressif des standards métropolitains, entraînent un renchérissement des coûts des facteurs et le renforcement des contraintes règlementaires. Cela se traduit par des handicaps de compétitivité par rapport aux concurrents de la région. Les prix mahorais sont trop élevés pour être concurrentiels dans la zone régionale de l'océan Indien. De ce point de vue encore, l'économie locale reste dépendante de la commande publique et des transferts de la métropole.
Une réflexion générale et théorique sur le concept de gouvernance et plus particulièrement sur la notion de « bonne gouvernance » est nécessaire pour promouvoir le développement local des départements d'outre-mer.
La notion de gouvernance, complexe et plus utilisée dans le monde de l'entreprise que dans celui des collectivités territoriales fait débat. Les collectivités locales, qu'il s'agisse des départements d'outre-mer ou des communes de ces départements, doivent intégrer cette dimension.
La gouvernance implique le bon fonctionnement de réseaux et l'existence de flux entre ces réseaux. Il ne s'agit plus pour un territoire d'administrer son territoire par le haut sans prendre en considération l'ensemble des acteurs qui concourent, chacun à leur place, au développement local des espaces. Les collectivités territoriales doivent inscrire leurs actions dans leurs environnements géographique, économique, social, institutionnel et culturel. L'aménagement du territoire impulsé par l'État et mis en oeuvre par les collectivités locales est un moyen puissant de développement local s'il est suffisamment réfléchi selon des principes de « bonne gouvernance ».
Mayotte qui vient d'accéder en 2011 au statut tant espéré de cinquième département d'outre-mer est très concernée.
L'équilibre des finances publiques et l'efficacité de la fiscalité de Mayotte devront être des priorités pour le territoire. De même, le contrôle de la gestion publique locale mahoraise est particulièrement important dans la poursuite d'une bonne gouvernance.
Le développement local de ce territoire de la République française, de par ses spécificités économiques, sociales, culturelles et environnementales, devra se faire dans une perspective de développement durable afin de préserver et de valoriser le patrimoine naturel exceptionnel et unique de cette île. Une « bonne gouvernance » sera nécessaire pour atteindre un développement économique local respectueux des nombreuses contraintes culturelles, sociales, géopolitiques et environnementales de Mayotte. L'absence de bonne gouvernance ou l'insuffisance des efforts de bonne gouvernance peuvent à terme se révéler être des contraintes internes qui limiteront l'influence positive en terme de développement économique de l'obtention du statut de département.
C. Les atouts de Mayotte.
Les problématiques sociétales liées au développement durable sont très nombreuses et déterminantes à Mayotte. En effet, la structure, l'organisation et le fonctionnement de la société mahoraise sont spécifiques. L'introduction du droit métropolitain dans cette société insulaire à forte identité africaine et musulmane nécessitera une prise en compte non seulement des défis économiques et sociaux mais aussi des enjeux démographiques et culturels propres à ce territoire.
À propos des défis économiques et sociaux, il convient de rappeler que Mayotte compte parmi les territoires les moins développés de la Nation 92 ( * ) . Les économies ultrapériphériques dont Mayotte fait partie partagent des handicaps communs : insularité, éloignement, faible superficie, relief et climat difficiles et forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur.
Mayotte figure parmi les régions les moins avancées d'Europe 93 ( * ) . Malgré une croissance économique de l'ordre de 10 % annuel ces dernières années, le PIB moyen par habitant s'établit à l'heure actuelle à environ 25 % de la moyenne de l'UE-27. Au niveau régional, ce PIB par tête reste néanmoins huit fois supérieur à celui de l'Union des Comores.
Les administrations publiques sont les principaux contributeurs de cette création de richesses puisque la valeur ajoutée de ce secteur représente près de la moitié du PIB. S'agissant de la balance commerciale, les échanges avec l'extérieur sont structurellement déficitaires : le taux de couverture est inférieur à 2 % depuis 2007. La croissance rapide des importations suit la forte progression de la demande, qu'il s'agisse de la consommation des ménages ou de la commande publique.
Les retards économiques et sociaux de Mayotte pèsent aussi sur la préservation et la valorisation de l'environnement. Notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, les questions du logement et de l'habitat insalubre et celle des transports ou encore de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement.
Pour que le changement de statut constitutionnel de Mayotte se fasse sans heurts, il convient de mettre en oeuvre un développement endogène pour ce territoire. Cela passe dans un premier temps par un règlement de la « crise de la vie chère » qui a connu son paroxysme à Mayotte entre septembre 2011 et janvier 2012 mais qui est toujours présente aujourd'hui ; cela passe aussi par un rattrapage social progressif mais programmé et constant des standards sociaux métropolitains.
Dans un second temps, il conviendra de développer les atouts propres de Mayotte et d'éviter l'impasse, souvent présente dans les DOM, qui consiste en même temps à craindre le marché et à critiquer l'État.
Parmi les atouts de Mayotte, il y a l'environnement. Ce dernier peut constituer le moteur du développement économique futur du territoire. Pour cela, il convient de concilier la croissance économique avec le respect de la nature et de la biodiversité de Mayotte. Dans ce sens, les politiques publiques devront mieux prendre en compte les spécificités de Mayotte et veiller à une meilleure insertion de Mayotte dans son environnement régional.
Quant aux défis démographiques et culturels, ils peuvent là encore, s'ils ne sont pas relevés, constituer des freins au développement durable de Mayotte. Le changement de statut juridique de Mayotte ne permettra pas à lui seul de répondre aux problématiques de la croissance démographique de Mayotte et à celle de l'immigration clandestine très importante en provenance des pays africains de la région, et notamment de l'Union des Comores.
De même, la culture et l'identité très marquées de Mayotte devront faire une place et s'adapter, sans perdre leur âme, aux droits et aux valeurs républicaines qui prévalent dans les départements français d'outre-mer.
Le patrimoine naturel de Mayotte est exceptionnel, qu'il s'agisse de ses ressources terrestres, avec notamment ses forêts, ou de son environnement marin avec son lagon. De même, la diversité biologique est très grande à Mayotte et sa préservation constitue à n'en point douter une richesse pour le futur de l'île.
La bonne gouvernance impose le renforcement et le soutien des secteurs économiques traditionnels et une réflexion et un projet visant à développer de nouvelles activités.
Les activités traditionnelles sont l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'artisanat. Les activités nouvelles à développer sont très nombreuses. On peut citer : l'éco-tourisme ; la recherche et l'exploitation maîtrisée des ressources halieutiques ; l'élevage de perles ; les énergies renouvelables ; la production de biens et de services de qualité destinés à l'exportation dans la zone de l'océan Indien mais aussi un travail sur l'image de Mayotte de manière à rendre l'île plus attractive ; de même, l'ouverture et l'incitation aux IDE (investissements directs étrangers) sont très importantes.
La crise « de la vie chère » qu'a traversé et que vit encore Mayotte n'est pas totalement liée au processus de départementalisation.
Cependant, dans les revendications des populations et des syndicats, il est souvent fait appel à l'arbitrage de l'État ou du conseil général.
En réalité, la crise actuelle doit trouver ses solutions et son dépassement dans une gouvernance du département qui favorise non seulement les activités traditionnelles de Mayotte, mais qui mette aussi en avant une politique publique volontariste de soutien et de facilitation de l'émergence de secteurs nouveaux ouverts sur l'océan Indien et sur le monde.
Conclusion
La gouvernance de la collectivité territoriale de Mayotte et les répercussions économiques et sociales qui y sont liées peuvent constituer des limites internes au développement économique durable du territoire. Si les problématiques économiques et sociales peuvent être résolues en partie par l'investissement et la formation à moyen et à long terme, la question de la gouvernance administrative de Mayotte et de sa performance sera un enjeu majeur à court terme pour le nouveau département.
La bonne gouvernance est en effet une nécessité pour le développement local de Mayotte. C'est pourquoi les finances locales devront être gérées de manière très rigoureuse de façon à permettre à plus ou moins moyen terme l'émergence de marges de manoeuvre budgétaires pour la collectivité. Pour parvenir à un tel résultat, une réflexion globale sur la nature et les enjeux de la gouvernance devra déboucher sur une dynamique économique endogène pour le développement de Mayotte.
Sans une bonne gouvernance du nouveau département, le processus de départementalisation pourrait exacerber les difficultés d'adaptation institutionnelle de Mayotte et réduire encore les capacités financières déjà faibles de la collectivité. Cela serait sans nul doute préjudiciable au développement durable de Mayotte. De plus, cela risquerait de monter la population contre le processus de départementalisation, qui pourrait alors apparaître comme un bouc émissaire idéal. La bonne gouvernance du territoire et le développement économique et social sont donc bien au coeur de la réussite ou de l'échec du changement de statut de Mayotte.
Par ailleurs, parmi les difficultés d'adaptation de Mayotte à prendre en considération de manière approfondie et sérieuse, il y a la réception des coutumes mahoraises dans la dynamique de développement insufflée par la départementalisation. En effet, pour que le passage au nouveau statut ne soit pas rejeté à moyen et à long terme, il faudra, à l'intérieur du cadre légal français, laisser une place aux réseaux de solidarités familiaux et locaux et au cadre villageois. Il faudra aussi intégrer de manière subtile les coutumes et les procédures infra-judiciaires de Mayotte.
Marthe Le Moigne, Maître de conférences en droit public à l'Université de Bretagne occidentale - Autonomie locale et clause générale de compétence
Il est difficile d'aborder l'autonomie locale sans évoquer la clause générale de compétence tant le lien entre les deux semble parfois revêtu de la force des évidences. Toutefois, « l'évidence première n'est pas une vérité fondamentale » 94 ( * ) et l'on peut se demander si ce lien participe ou pas de ces « convictions qui [n'] ont [que] l'apparence d'un savoir » 95 ( * ) . La question se pose avec une particulière acuité au moment où Manuel Valls envisage de faire disparaître la clause générale de compétence des départements et des régions 96 ( * ) rétablie par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 97 ( * ) après l'affirmation de sa suppression par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 98 ( * ) et où l'on peut s'interroger sur les répercussions de la réforme ainsi envisagée sur l'autonomie de ces collectivités.
L'appréhension de ces relations entre l'autonomie et la clause générale de compétence se heurte cependant à des difficultés qui tiennent notamment à la polysémie et à la polymorphie de l'une et de l'autre. La clause générale de compétence découle de la formule en vertu de laquelle « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Issue du premier alinéa de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale 99 ( * ) , cette formule, qui a été étendue aux conseils généraux 100 ( * ) et aux conseils régionaux 101 ( * ) , est désormais codifiée aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales 102 ( * ) , dispositions applicables aux communes 103 ( * ) , départements 104 ( * ) et régions 105 ( * ) situés outre-mer ainsi qu'à la collectivité départementale de Mayotte 106 ( * ) , aux collectivités de Guyane 107 ( * ) , de Martinique 108 ( * ) , de Saint-Pierre-et-Miquelon 109 ( * ) , de Saint-Martin 110 ( * ) et de Saint-Barthélemy 111 ( * ) . Elle n'a pas toujours le même sens dans le discours politique -où elle est parfois comprise comme étant l'aptitude des collectivités territoriales « à tout faire » 112 ( * ) - et dans le discours juridique où elle désigne l'habilitation du « conseil municipal [général ou régional] à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal [départemental ou régional], sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'État ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées au maire [au président du conseil général ou au président du conseil régional] 113 ( * ) ». Cette clause comporte ainsi deux facettes : une facette externe - la définition des compétences de la collectivité territoriale par rapport aux autres personnes - et une facette interne - la répartition des compétences entre les organes de la collectivité. Quant à l'autonomie locale, si l'on tente de dépasser ce que nous apprend l'étymologie - le terme « autonomie » est emprunté du grec autonomia , dérivé de autonomos « qui se régit par ses propres lois », « qui agit de soi-même » 114 ( * ) -, elle est « l'un de ces concepts très fondamentaux que l'on trouve toujours difficile de définir 115 ( * ) ». La Charte européenne de l'autonomie locale 116 ( * ) la définit, toutefois, en son article 3, comme étant « le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ». Tout comme la clause générale de compétence, l'autonomie présente plusieurs facettes - autonomie de gestion, autonomie financière, autonomie institutionnelle, etc. 117 ( * ) Ainsi définies, la clause générale de compétence et l'autonomie locale entretiennent des relations complexes. En effet, ces deux notions sont en interaction dans la mesure où, d'un côté, l'autonomie locale participe des justifications de la clause générale de compétence et, de l'autre côté, la clause générale de compétence constitue un facteur de l'autonomie locale. Toutefois, ces interactions sont limitées. L'autonomie locale n'intervient effectivement que de manière limitée dans l'argumentation utilisée pour montrer le bien-fondé de la clause (I) tandis que cette dernière ne participe que de manière limitée à la concrétisation de l'autonomie locale (II)
I. - L'autonomie locale, justification limitée de la clause générale de compétence
L'autonomie locale participe de l'argumentation utilisée pour montrer le bien-fondé de la clause générale de compétence. Toutefois, elle ne joue à cet égard qu'un rôle limité, qu'il s'agisse de justifier l'apparition de la clause (A) ou son maintien (B).
A. L'autonomie locale, justification limitée de l'apparition de la clause générale de compétence
Les différentes facettes de la clause générale de compétence sont apparues successivement. Si l'autonomie locale est au coeur des préoccupations qui conduisent à justifier l'apparition de la facette interne de la clause générale de compétence (1), elle joue un rôle plus ambivalent dans l'argumentation déployée au moment de l'apparition de la facette externe de cette clause.
1. L'autonomie locale, justification de l'apparition de la facette interne de la clause générale de compétence
Du point de vue interne, la clause générale de compétence permet de définir les attributions de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et elle correspond à l'intention initiale des auteurs du texte. La formule du premier alinéa de l'article 61 de la loi du 5 avril de 1884 permet en effet, dans l'intention de ses auteurs, de répondre à deux problèmes. Le premier concerne la force des délibérations de l'organe délibérant de la collectivité territoriale : constituent-elles en principe des délibérations règlementaires - c'est-à-dire des délibérations exécutoires qui traduisent l'exercice d'un pouvoir de décision 118 ( * ) - ou pas ? L'emploi du verbe « régler » répond à cette question dans un sens favorable. Les délibérations règlementaires deviennent le droit commun. Le second problème intéresse la répartition des compétences entre le conseil municipal, le maire et le préfet en matière d'affaires de la commune 119 ( * ) - sans préjuger de ce que sont ces affaires. La formule de la loi de 1884 fait du conseil municipal l'autorité de droit commun de la commune, « l'autorité principale, normale en quelque sorte, de la commune » 120 ( * ) .
Le souci d'assurer l'autonomie locale et plus précisément l'autonomie communale transparaît dans l'argumentation utilisée par Jozon dans l'exposé des motifs du projet de loi qui a donné naissance à la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale 121 ( * ) , mais aussi par E. de Marcère, rapporteur au nom de la commission chargée d'examiner les propositions de loi municipale 122 ( * ) pour justifier le bien-fondé de l'adoption de la formule en vertu de laquelle « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Il apparaît également dans les différents ouvrages pratiques destinés à l'expliciter 123 ( * ) et les travaux universitaires. R. Maspétiol et P. Laroque estiment ainsi que l'article 61 de la loi municipale pose un « principe de liberté » 124 ( * ) .
Si l'autonomie participe de l'argumentation destinée à montrer le bien-fondé de la facette interne de la clause générale de compétence, elle est également présente mais, de manière plus ambivalente, dans l'argumentation développée pour montrer le bien-fondé de sa facette externe.
2. L'autonomie locale, justification ambivalente de l'apparition de la facette externe de la clause générale de compétence
L'autonomie locale joue un rôle ambivalent dans la consécration de la facette externe de la clause générale de compétence. Cette dernière procède d'une réinterprétation du premier alinéa de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 et de l'article 48 5° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux 125 ( * ) , opérée à la fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle. À cette époque, les circonstances économiques et sociales ainsi que l'évolution des idées conduisent les conseils municipaux à organiser des services publics qui ne correspondent pas aux attributions qui leur sont expressément reconnues par la loi - boulangeries, pharmacies, boucheries ou blanchisseries 126 ( * ) . Certains juristes - universitaires 127 ( * ) et commissaires du gouvernement 128 ( * ) - tentent alors de trouver un fondement légal à ces interventions dont la légitimité n'est guère contestée. La formule de l'article 61 de la loi de 1884 et, dans une moindre mesure, celle de l'article 48 de la loi du 10 août 1871 leur semblent pouvoir remplir cet office. Ainsi, Roland Maspétiol et Pierre Laroque estiment qu'elles reconnaissent aux autorités de la commune et du département des « pouvoirs généraux » car elles autorisent les autorités de la commune et du département « à faire tout ce qui est d'intérêt local, tout ce qui est favorable à la bonne administration et à la prospérité de leurs circonscriptions et n'est pas formellement interdit ou réservé à d'autres autorités » 129 ( * ) . R. Bonnard développe une analyse similaire 130 ( * ) . La consécration de ces pouvoirs généraux est alors présentée par certains auteurs tels que Maurice Hauriou 131 ( * ) et Roger Bonnard 132 ( * ) , comme étant le fruit d'une reconnaissance de l'autonomie dont disposent les collectivités locales. Cette dernière permet ainsi de justifier l'émergence de la facette externe de la clause générale de compétence.
Toutefois, l'autonomie joue à cet égard un rôle ambivalent. Elle participe en effet également de l'argumentation développée pour démontrer l'absence de bien-fondé de la clause. Ainsi, dans leur ouvrage consacré à la tutelle administrative, Roland Maspétiol et Pierre Laroque indiquent qu'« à première vue, la première conception [celle dans laquelle les autorités locales sont « autorisées à faire un certain nombre d'actes énumérés par la loi et aucun autre »], qui est celle des États anglo-saxons, paraît beaucoup moins libérale que la seconde [« accorder des pouvoirs généraux aux autorités locales, c'est-à-dire les autoriser à faire tout ce qui est d'intérêt local »], pratiquée dans la plupart des pays continentaux et notamment en France » mais qu'« en réalité il n'en est rien » et ils concluent en affirmant que « la délimitation de la compétence des personnes morales du droit public est en France un des éléments essentiels de la tutelle administrative 133 ( * ) ». Dans le même sens, Roger Bonnard relève que « le procédé de l'énumération législative offre peut-être plus de garanties pour l'autonomie locale 134 ( * ) ».
Justification limitée de l'émergence de la clause générale de compétence dans sa facette interne et dans sa facette externe, l'autonomie locale participe également, de manière plus ou moins directe, de l'argumentation destinée à montrer le bien-fondé de son maintien.
B. L'autonomie locale, justification limitée du maintien de la clause générale de compétence
L'autonomie locale constitue l'un des arguments mis en avant dans les raisonnements déployés dans les discours juridiques et politiques destinés à montrer le bien-fondé de la clause générale de compétence.
Elle apparaît ainsi dans l'argumentation développée dans nombre de travaux qui justifient le maintien de la clause générale de compétence par l'existence d'une différence de nature entre les collectivités territoriales et les établissements publics, et notamment les établissements publics territoriaux. Jean-Claude Douence considère ainsi par exemple en effet que la clause générale de compétence est inhérente à la nature des collectivités territoriales qui sont des personnes morales de caractère corporatif et qu'elle constitue l'expression de l'« autonomie interne du groupe humain personnifié par le droit 135 ( * ) ».
Le rôle justificatif de l'autonomie locale se manifeste également de manière plus ou moins sous-jacente dans les discours qui s'attachent à démontrer le bien-fondé du maintien de la clause générale de compétence en présentant cette dernière comme étant un moyen de préserver la capacité d'initiative des collectivités territoriales 136 ( * ) , leur droit à l'imagination, ce qui constitue également une des formes de l'autonomie locale.
Toutefois, l'autonomie locale ne joue aujourd'hui qu'un rôle limité dans la justification du maintien ou du rétablissement de la clause générale de compétence. En effet, elle n'intervient parfois que de manière subsidiaire dans les discours car d'autres arguments sont présentés. Tel est le cas par exemple d'assurer la complétude et la souplesse du système de répartition des compétences pour éviter les lacunes, pour permettre d'adapter les collectivités territoriales au changement permanent des techniques et des mentalités qui suscite une évolution continue des besoins collectifs 137 ( * ) , de sécuriser leur action 138 ( * ) et aussi de rendre compte des interventions qui ne relèvent pas explicitement d'un texte, voire ne peuvent être rattachées à aucun texte. Ainsi, par exemple, J.-M. Pontier estime que « l'un des intérêts de la clause générale de compétence est de rendre compte des compétences qui ne figurent pas explicitement dans un texte de loi, [...] d'autant que non seulement on ne peut les présumer illégales, mais qu'il convient, à l'inverse de les présumer légales. D'ailleurs, l'État ne les a pas considérées comme irrégulières, le représentant de l'État n'a pas déféré ces actes devant la juridiction administrative » 139 ( * ) . Plusieurs justifications sont ainsi entremêlées et certaines d'entre elles procèdent plus d'une « conception technocratique de la répartition des compétences », pour reprendre l'expression de F.-P. Benoit 140 ( * ) , que de la mise en avant de l'autonomie locale. Cette dernière n'intervient donc que de manière limitée dans les argumentations déployées pour justifier le maintien de la clause générale de compétence. Tel est d'autant plus le cas qu'elle est également l'un des arguments mis en avant pour contester le bien-fondé de la clause. Elle est en effet présentée dans certains discours comme étant un « instrument trompeur dont la manoeuvre revient toute entière à l'État » 141 ( * ) . Jérôme Chapuisat note, par exemple, que « le régime de la clause générale de compétence fait de l'intérêt local soit, dans un sens restrictif, le prétexte de tous les dessaisissements soit, dans un sens extensif, l'alibi de toutes les charges indues » 142 ( * ) . De sorte que « présentée souvent comme la garantie de libertés indéfinies, elle n'est en réalité que l'instrument d'une implacable mise sous tutelle. Elle n'est certes pas le seul mais elle est celle qui explique le mieux le fossé qui sépare les libertés locales diffuses des libertés publiques reconnues 143 ( * ) ».
Ainsi, l'autonomie locale joue un rôle limité et ambivalent dans les discours relatifs à la clause générale de compétence, utilisée pour en montrer tantôt le bien-fondé tantôt l'absence de bien-fondé. Cette ambivalence n'est sans doute pas dénuée de tout lien avec les limites de la clause générale de compétence qui ne contribue que de manière restreinte à concrétiser l'autonomie locale.
II. - La clause générale de compétence, facteur limité d'autonomie locale
La clause générale de compétence est un facteur d'autonomie locale dans le sens où elle participe des éléments qui concourent à la concrétisation de cette dernière (A) mais elle n'est qu'un des éléments qui permettent d'atteindre ce résultat ce qui lui confère un rôle limité en la matière (B)
A. La clause générale de compétence, facteur d'autonomie locale
La clause générale de compétence a constitué et constitue encore aujourd'hui un facteur d'autonomie locale et ce, à plusieurs titres. En effet, dans sa facette interne, elle s'est d'abord inscrite dans ce que Jean-Bernard Auby appelle « l'autonomie qui se rattache à l'indépendance des organes » 144 ( * ) . Cette autonomie est réalisée « lorsque [les collectivités] disposent d'organes indépendants, libres de se déterminer parce que non-inscrits dans des mécanismes hiérarchiques et émettant des actes qui ne peuvent pas être privés d'effet ou modifiés par une autorité «supérieure» » ». Or, en proclamant que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », le premier alinéa de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 « pose en principe que les conseils municipaux ont un pouvoir de décision propre, et que leurs délibérations sont en conséquence et en règle générale, exécutoires par elles-mêmes et dès qu'elles ont été prises ». La formule du premier alinéa de l'article 61 de la loi de 1884 telle qu'elle a été pensée par ses auteurs a donc contribué à la concrétisation de l'« autonomie qui se rattache à l'indépendance des organes ». Si la situation a évolué, c'est encore le cas dans une certaine mesure aujourd'hui dans le sens où la compétence de principe revient, dans les collectivités qui disposent de la clause générale de compétence, à l'organe issu du suffrage universel direct qui représente le groupement humain personnifié par le droit.
La clause générale de compétence permet aussi la concrétisation d'une autre forme d'autonomie, celle qui « a son siège dans la manière dont le droit définit les activités susceptibles d'être déployées par les collectivités locales » 145 ( * ) . Elle conduit en effet à poser en principe que les organes de la collectivité - en l'occurrence, l'organe délibérant - sont compétents pour identifier les besoins collectifs de la population locale, et les satisfaire - sous quelques réserves -, que ces besoins soient actuels ou futurs, comme en témoigne la décision « Territoire de la Polynésie française » rendue par le Conseil d'État le 18 mai 2005 146 ( * ) . La notion d'intérêt public local, qui a fait l'objet de nombreux débats 147 ( * ) et qui est au coeur de la clause générale de compétence, n'est en effet pas définie par la loi. En principe, le contenu des intérêts publics communs aux membres de la collectivité et le mode de réalisation de ces buts communs 148 ( * ) ne sont donc pas imposés de l'extérieur, comme dans le cas des attributions légales de compétence - qui constituent juridiquement l'exception pour les collectivités dotées de la clause générale de compétence - mais déterminés « de l'intérieur », ce qui correspond à l'autonomie au sens étymologique du terme comme le souligne Jean-Claude Douence 149 ( * ) .
On pourrait ainsi multiplier les angles d'approche de la clause générale de compétence et montrer que dans chacune de ses significations elle contribue à réaliser une ou plusieurs formes d'autonomie locale. Toutefois, si cette clause contribue à l'autonomie locale, elle ne permet de garantir cette dernière que de manière restreinte.
B. La clause générale de compétence, garantie limitée de l'autonomie locale
La clause générale de compétence ne permet de concrétiser l'autonomie locale que de manière limitée et elle peut même, à certains égards, apparaître comme étant un facteur de limitation de cette dernière. Les arguments sont connus. On peut cependant, sans prétendre à l'exhaustivité, rappeler certains d'entre eux.
D'abord, que ce soit sous l'angle interne ou sous l'angle externe, la clause générale de compétence ne confère pas à son titulaire une compétence illimitée 150 ( * ) , une véritable compétence générale pour se saisir de toutes les affaires d'intérêt public local.
Du point de vue interne, l'organe délibérant n'est compétent que sous réserve qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées aux autres organes. Or, le jeu des attributions légales peut limiter considérablement le champ des compétences effectives de l'organe délibérant. Ainsi, à la fin du XIX e siècle, le député A.-L. Amagat soulignait que le nombre des cas dans lesquels l'approbation de l'autorité supérieure est requis en vertu de l'article 68 de la loi du 5 avril 1884 était tel que le principe posé au premier alinéa de l'article 61 de la loi « n'est qu'une illusion qu'il faut dissiper et une équivoque qu'il faut détruire 151 ( * ) ».
Cette limite existe également si l'on envisage la clause générale de compétence dans sa facette externe. Elle ne permet pas aux collectivités de se saisir de toutes les affaires d'intérêt public local et de répondre à tous les besoins directs de la population locale. Elle comporte en effet des limites externes 152 ( * ) qui tiennent notamment au respect de la liberté du commerce et de l'industrie 153 ( * ) , à l'obligation de neutralité qui interdit toute intervention dans un conflit politique 154 ( * ) ou social 155 ( * ) mais aussi les actions qui ne respectent pas les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dans les collectivités où cette loi est applicable 156 ( * ) . Ainsi par exemple, dans une décision du 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de La Réunion contre Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis », le Conseil d'État a considéré qu'une commune ne pouvait pas accorder de subventions à une association qui a des activités cultuelles même si cette association se consacre également à des activités de caractère social et culturel - et qu'elle ne peut donc bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif 157 ( * ) . Le jeu de la clause générale de compétence est également limité en raison de l'interdiction d'empiéter sur les attributions exclusives d'autres personnes publiques. Dans une décision Ville de Cayenne du 13 mars 1985 158 ( * ) , le Conseil d'État a ainsi estimé que le département de Guyane pouvait poursuivre la gestion des installations d'eau dès lors que l'organisation de la distribution de l'eau présentait un intérêt départemental et qu'« aucun texte de nature législative ne confér[ait] l'exclusive compétence aux seules communes ». Ainsi, la clause générale de compétence opère de manière « interstitielle », pour reprendre l'expression employée par la Direction générale des collectivités locales dans l'étude d'impact du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et reprise par Marylise Lebranchu dans les travaux préparatoires à la loi. Elle ne permet donc pas de garantir aux collectivités locales « le droit et la capacité effective [...] de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques », pour reprendre la définition de l'autonomie locale par la Charte européenne.
D'autre part, si la clause générale de compétence permet bien aux organes délibérants des collectivités territoriales de déterminer l'intérêt public local, cette détermination est opérée sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le territoire et sous le contrôle de légalité du juge administratif. Elle conduit donc en définitive, en dépit des limites de ces deux contrôles, à faire dépendre la délimitation des affaires de la collectivité d'organes extérieurs au groupe humain qu'elle personnifie et, de ce point de vue, elle offre moins de garanties d'autonomie que les attributions légales de compétences.
Cette limite de la clause générale de compétence était mise en avant dès le début du XX e siècle. Ainsi, par exemple, Roland Maspétiol et Pierre Laroque indiquaient que, dans le cas de la méthode d'attributions légales de compétences, « si les autorités locales n'ont que des pouvoirs fixés limitativement par la loi, il est toujours possible de faire appel au législateur pour obtenir de nouveaux pouvoirs [...]. Au contraire si la loi se borne à décider, comme le fait en France l'art. 61 de la loi municipale, «le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune», ou comme l'art. 48 ancien de la loi de 1871 [...] «le Conseil général statue sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi», il faudra bien qu'une autorité intervienne pour définir quels sont ces «affaires de la commune» ces «objets d'intérêt départemental» et cette autorité ce sera l'administration. Tandis que la méthode anglo-saxonne aboutit à un régime de tutelle législative, la méthode française aboutit à un régime de tutelle administrative, contrôlé, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, par la juridiction administrative 159 ( * ) ». Dans le même sens, Roger Bonnard relevait que « la clause générale formulée par la loi ne constitue qu'une détermination assez illusoire de la spécialité. Avec une clause générale, la détermination de la spécialité est en réalité l'oeuvre des autorités administratives centrales et des tribunaux intervenant avec pouvoir discrétionnaire. C'est pourquoi on peut considérer que le procédé de l'énumération législative offre peut-être plus de garanties pour l'autonomie locale parce que la détermination de la spécialité est dans ce procédé effectivement faite par le législateur 160 ( * ) ». Certes, les autorités administratives étatiques centrales et locales ne disposent plus aujourd'hui des pouvoirs qu'elles détenaient au début du XX e siècle, il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales sont soumises au contrôle administratif de légalité et que le représentant de l'État dans le territoire - en choisissant de déférer ou pas les actes des collectivités territoriales devant la juridiction administrative - et le juge administratif jouent toujours un rôle dans la délimitation de l'intérêt public local.
Ainsi, la clause générale de compétence ne joue qu'un rôle limité dans la concrétisation de l'autonomie locale. Tel est d'autant plus le cas qu'à l'instar des attributions légales de compétences elle ne permet pas de garantir un véritable pouvoir de décision au bénéfice des collectivités locales. Comme l'ont montré Charles Eisenmann 161 ( * ) et Jacques Caillosse 162 ( * ) , la marge de manoeuvre des collectivités territoriales dans les affaires locales ne peut se déployer que dans les « lieux » que lui assignent ou que lui offrent le législateur et le pouvoir réglementaire national. La réalité de leur pouvoir de décision dans ces affaires dépend de la rédaction de la loi et du règlement national, de l'espace qui leur est laissé et non de la clause générale de compétence qui ne permet donc d'évaluer et de protéger l'autonomie locale que de manière très restreinte.
Pour conclure ce rapide examen des relations entre clause générale de compétence et autonomie locale, on ne peut que constater que s'il existe bien des interactions entre l'une et l'autre, ces interactions sont limitées. La future loi clarifiant l'organisation territoriale de la République pourrait permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de ces liens entre ces deux notions. Si les réformes envisagées entraient en vigueur, nous pourrions constater l'impact de la suppression de la clause générale de compétence sur l'autonomie locale et nous pourrions aussi sans doute savoir si la suppression de la clause générale de compétence par le législateur entraînera la disparition effective de cette réinterprétation a posteriori de la loi de 1884 ou si l'autonomie locale la fera renaître.
Edwin Matutano, Docteur en droit - La légistique pour l'autonomie des collectivités territoriales : une nécessité et un enjeu
Pour certains juristes, parler de légistique est devenu, depuis déjà de nombreuses années, un champ d'études et de réflexions familier 163 ( * ) . Les contributions les plus récentes ne démentent pas l'intérêt suscité par cette matière dont le contenu englobe toutes les branches du droit sans exception et qui constitue un défi aux autorités politiques et aux administrations dépendant de celles-ci, dans la mesure où il permet d'évaluer la portée des marges d'opportunité qui leur sont consenties pour prendre des normes nouvelles, en modifier ou en abroger de précédentes.
C'est que la légistique se donne pour objet de dispenser les savoir-faire essentiels en matière d'élaboration et d'écriture des textes normatifs, mais elle s'intéresse également aux impacts produits par les modifications subies par l'ordonnancement juridique, ce qui amène ses interprètes et experts à examiner la cohérence de l'ordre juridique à un instant donné et les conduit inévitablement à interroger le volume de normes en vigueur, le nombre de textes venus s'insérer dans ce volume, période par période, et à porter ainsi un regard critique sur le contenu du droit au regard des impératifs tenant au respect des principes de clarté de la loi 164 ( * ) et de la sécurité juridique 165 ( * ) et des objectifs de valeur constitutionnelle que sont l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi 166 ( * ) .
Si les principales actions et réflexions portant sur le foisonnement normatif et les efforts qu'il implique dans le domaine de l'écriture des textes ont concerné les normes émises par l'État 167 ( * ) , nous voudrions aborder ici les enjeux que présente la maîtrise de la légistique pour les collectivités territoriales (5 567 609 actes transmis aux préfets par les organes des collectivités territoriales en 2009) 168 ( * ) , en particulier, pour celles qui, outre-mer, sont dotées de compétences étendues sur le plan normatif, a fortiori lorsque ces compétences se substituent à celles exercées jusqu'alors par l'État 169 ( * ) .
Car s'il est question d'autonomie locale, il doit être rappelé le sens littéral du mot « autonomie », dont le dictionnaire Le Littré donne la définition suivante : au premier sens, « droit que les Romains avaient laissé à certaines villes grecques, de se gouverner par leurs propres lois » ; en second lieu, « par extension, indépendance ».
Sans doute, les juristes préfèrent-ils interroger la Charte européenne de l'autonomie locale, traité conclu le 15 octobre 1985 dans le cadre du Conseil de l'Europe et approuvé par la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006, dont l'article 3 dispose : « L'autonomie locale est le droit et la capacité effective pour les collectivités de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. » Cette définition, on le constate, nuance celle du dictionnaire, dans la mesure où elle situe la notion d'autonomie locale « dans le cadre de la loi ». Néanmoins, l'idée principale d'une capacité à agir par des actes propres engageant leur seule responsabilité, reconnue aux collectivités territoriales, est évidemment déterminante.
Nous sommes donc, avec la légistique, au coeur du sujet et des enjeux soulevés par la détention de cette « autonomie », qui n'a de sens que si elle suppose de pouvoir édicter des actes qui s'imposent avec une force obligatoire, sans qu'une tutelle soit exercée à leur égard, ce qui renvoie, s'agissant des collectivités territoriales, à l'exercice de compétences propres par ces dernières 170 ( * ) .
Cette présentation suivra deux axes : par le premier, l'on invitera à s'interroger sur la portée générale de l'art de faire la norme ; par le second, l'on mesurera les enjeux sous-jacents pour les collectivités territoriales ultramarines concernées.
I. - La légistique, art, technique ou mesure d'économie ?
Dans le premier volet de cette étude, se détache la nature duale de la légistique, qu'il convient de faire ressortir successivement : d'une part, il s'agit d'une technique, faite de savoir-faire et, d'autre part, il s'agit d'un moyen du respect général de la légalité.
A. La légistique, assemblage d'usages et de conventions.
C'est le terrain d'élection de la légistique formelle qui est exclusivement concerné ici, même s'il ne se confond pas entièrement avec celle-ci.
Ces usages et ces conventions constituent autant de techniques de rédaction et non de règles à portée obligatoire et c'est là une des difficultés du respect de la légistique.
Il en est de l'écriture des textes normatifs comme du langage ou des écrits de la vie courante : ses malfaçons ne sont pas, en elles-mêmes, susceptibles de porter atteinte à la validité de la norme. Elles peuvent ainsi entraîner des doutes, des interrogations sur leur sens et engendrer ainsi des difficultés d'interprétation.
Ces conséquences éventuelles sont dommageables, évidemment. Mais en droit, elles ne sont pas sanctionnées. Un texte mal rédigé sera dit obscur, il ne sera pas jugé illégal ou inconstitutionnel, en dépit de quelques garde-fous posés par la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'État a ainsi fait de la sécurité juridique un principe général du droit et le Conseil constitutionnel a vu dans la clarté de la loi un principe constitutionnel, tandis qu'il a dégagé un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
Néanmoins, les usages en question, dont la préconisation et la perpétuation se présentent sous forme de bonnes pratiques, relèvent, à l'analyse, du droit « mou » ou « souple 171 ( * ) », dont les mérites sont souvent vantés, mais qui nécessite, lui aussi, une connaissance approfondie.
Maîtriser les usages et les conventions qui tissent et façonnent l'élaboration des textes normatifs revient en tout état de cause à apporter une garantie de cohérence. Cohérence intrinsèque à chaque norme, mais aussi cohérence de l'ordonnancement juridique.
Cette exigence est fondamentale, comme l'est son respect. Assurer la cohérence d'un ensemble de textes, d'un corpus juridique, permet de garantir sa bonne application et, souvent, d'en assurer la validité, car un nombre important d'annulations contentieuses d'actes pour vice de compétence, vice de forme ou vice de procédure pourrait être conséquemment évité.
Aussi convient-il de divulguer les usages, les bonnes pratiques qui fondent une correcte rédaction des textes normatifs. Et de modifier des habitudes, presque un habitus, de travail dans les services administratifs. Le cloisonnement trop fréquent, le manque de partage des connaissances et des savoir-faire professionnels trouvent ici évidemment leurs limites. Cette obligation est d'autant plus impérative que les techniques de légistique sont absentes des programmes universitaires et encore peu abordées par les écoles professionnelles de la fonction publique.
Trop souvent, également, les services se fient à leur propre pratique, par goût des précédents. Ce phénomène coutumier peut produire d'excellents résultats, mais aussi de moins bons. Sans actualisation des connaissances, sans confrontation avec d'autres pratiques et, bien sûr, sans prise en considération des sources utiles existantes, il est difficile, avec la meilleure volonté qui soit, de parvenir à des résultats convaincants.
Autant dire que l'apprentissage et la maîtrise des recommandations et des références valables pour les actes de l'État trouvent leur utilité auprès des collectivités territoriales 172 ( * ) . Il s'agit d'un complément indispensable au respect strict de la légalité auquel nous allons à présent venir.
B. La légistique, instrument du respect de la légalité.
Par-là, l'art de rédiger des textes se confond avec le respect de la légalité. Il s'agit assurément d'un domaine plus familier au juriste. C'est celui occupé par la légistique matérielle et dans une moindre mesure, encore, par la légistique formelle.
Un impératif en résulte : celui de maîtriser le fond du droit dans chaque matière qui fait l'objet de l'attention du pouvoir normatif, quel qu'en soit son détenteur.
Car, pour respecter la légalité, il faut connaître l'environnement juridique au sein duquel vient s'insérer la norme nouvelle. Autrement dit, il ne suffit pas de maîtriser des usages de présentation, d'écriture de la règle de droit, il faut aussi savoir quelles sont ses incidences, une fois celle-ci en vigueur.
Aussi, la légistique matérielle implique-t-elle la bonne connaissance du droit dans un champ donné à l'instant où il est projeté d'adopter une nouvelle norme.
Ainsi, ensemble de bonnes pratiques allié au respect de la légalité et à celui de la hiérarchie des normes, la légistique marie des ordres d'idées et des compétences vastes, mais nécessairement complémentaires. Il convient à présent d'en cerner l'enjeu pour les collectivités ultramarines vouées à l'autonomie.
II. - L'enjeu pour les collectivités territoriales ultramarines
L'on abordera l'enjeu en matière d'organisation des services administratifs de ces collectivités et au premier chef de ceux des ressources humaines, car les collectivités territoriales doivent s'assurer du concours des experts juridiques dont les compétences sont requises pour édicter des normes, avant de s'interroger sur la nécessité, pour les collectivités territoriales, d'assurer la cohérence de l'état du droit en vigueur.
A. Le développement d'une expertise au service des collectivités territoriales
Il est certain que l'organisation des services est pour beaucoup dans la réussite de l'entreprise.
Si celle-ci constitue un défi, elle peut être aidée par la structure de la fonction publique territoriale, par cadres d'emplois, plus apte à cet effet que celle de la fonction publique de l'État.
La légistique renvoie inévitablement à des connaissances juridiques. À cet égard, il est important que l'organisation interne des services administratifs, dans les collectivités territoriales d'une certaine taille, épouse cette réalité.
Bien évidemment, il est nécessaire, à cette fin, pour les collectivités publiques, de pouvoir compter sur des collaborateurs bien formés.
Mais l'on fera observer que cette exigence, soulignée de longue date 173 ( * ) , doit être accompagnée d'une véritable dotation de moyens à disposition de ces agents. Nous entendons par-là qu'il ne suffit pas de recruter des collaborateurs, diplômés en droit et possédant des mastères 2. Ceci est une donnée importante, mais il faut encore que les services dont l'activité est principalement ou exclusivement juridique aient à leur tête un responsable, lequel pour asseoir son autorité dans les meilleures conditions doit être des mieux formés à la matière juridique.
Il va de soi qu'il est hors de question de pratiquer ce qui a toujours cours dans la fonction publique de l'État, en 2014, à savoir affecter des juristes à des postes non juridiques et nommer à des emplois nécessitant une véritable expertise en droit des agents n'ayant jamais fait de droit et n'étant pas diplômés dans cette discipline.
Mais surtout, il est fondamental de circonscrire ce qui doit être matériellement couvert par la notion de droit au sein de l'appareil administratif. En évitant soigneusement l'écueil, relevé dans de nombreuses administrations de l'État, qui, lors de réorganisations internes, a fréquemment conduit à réduire le droit et les affaires juridiques aux seuls services chargés du contentieux.
Le résultat est évidemment en deçà de ce qu'une logique d'efficacité commanderait. Une telle vision est extrêmement réductrice. Les affaires juridiques, dans l'administration, ne se résument pas au suivi de litiges devant les juridictions et à la présence de la défense de la collectivité publique devant celles-ci. Non que les affaires contentieuses soient secondaires, mais la confection de la règle et sa défense auprès des tribunaux sont complémentaires, elles ne sauraient s'exclure.
La matière juridique ne peut être réduite aux procédures contentieuses. Et si, par malheur, les services élaborant des actes sont sis dans un autre pan de l'organigramme que ceux ayant en charge la défense des intérêts de l'administration au contentieux, l'étanchéité a pour effet de découper, de décomposer les savoirs professionnels à propos d'une même règle, d'un même acte.
L'on ne saurait donc trop déconseiller une telle voie. L'élaboration d'actes administratifs met en oeuvre des connaissances juridiques. Si la taille de la collectivité l'autorise, un regroupement de toute la matière juridique s'impose, en n'excluant ni la légistique, ni le contentieux ; si elle ne le permet pas, il convient d'avoir toujours présent à l'esprit que l'élaboration des actes administratifs participe de l'application du droit, au même titre que les affaires contentieuses ou que le conseil.
Certes, il peut paraître difficile dans de nombreux cas de localiser et d'isoler la fonction juridique parmi les actions de l'administration. Fréquemment, la gestion et l'appréciation juridique sont entremêlées et, de ce fait, une partie majeure de l'action administrative pourrait être considérée comme relevant du domaine du droit.
Cependant, simplifier abusivement le droit en l'amputant de toutes les compétences déployées par les légistes apparaît abusif et trompeur. Et il est préférable, alors, de diviser un service en rassemblant les affaires sous des libellés indiquant la teneur de ce qui est traité dans telle ou telle subdivision, et ce, en rassemblant, le cas échéant, gestion, comptabilité et droit. Et dans cette hypothèse, les juristes doivent être aussi bien employés à prendre des décisions, les appliquer, ce qui signifie qu'ils puissent prodiguer des conseils au sujet de leur interprétation et les défendre en cas de contestations contentieuses.
Enfin, nous ajouterons qu'il ne suffit pas non plus de créer un service intitulé « juridique » ou « des affaires juridiques » si le service en question se trouve coiffé par un autre, aux attributions plus vastes, dont le responsable n'est pas juriste.
Cette situation, fréquente, qui peut s'expliquer par le voeu de regrouper les différentes branches des services administratifs en « super-fonctions », variables selon les entités et les circonstances, ne présente pas de gage de réussite, sauf à ce que le responsable du service juridique et ses collaborateurs soient perçus comme de véritables experts dont les actes ne peuvent être contrebalancés par des questions de pure opportunité, soulevées ou défendues par des services ayant en charge d'autres domaines et ne cultivant pas le droit comme métier.
Ainsi, en donnant à la légistique la place qui lui revient, c'est le droit dans son ensemble qui en est rehaussé et, logiquement, le nombre de contentieux doit diminuer à proportion de l'effort consenti en ce sens.
Sur le plan pratique, il est un modus operandi entre l'autorité politique responsable - laquelle, le plus souvent, prend la décision de recourir à une norme - et les services experts, qui rédigent matériellement la norme, qu'il apparaît essentiel de privilégier.
En effet, le plus souvent, lorsqu'une « commande » d'un texte nouveau est prise par un responsable politique auprès de ses services, une étape fondamentale, première, de l'analyse par les services en question est occultée : celle de l'appréciation de la nécessité de la norme que l'on se propose d'adopter.
Or, il va de soi que l'occultation de cette étape participe de l'essor de l'emballement normatif que connaît notre système juridique.
Il importe qu'au sein de collectivités territoriales dotées d'un large pouvoir normatif, il puisse être procédé à un tel examen, sans lequel l'empilement normatif, déjà considérable au plan national, trouverait des relais dans les collectivités territoriales dotées d'un pouvoir étendu à cet égard.
Une telle exigence suppose une bonne coordination entre les auteurs de la norme au sens littéral, qui ont la qualité de décideur politique et les membres des services administratifs qui préparent les actes normatifs, les expertisent, mais n'en décident pas le plus souvent de l'opportunité.
B. La nécessité de disposer d'un corpus normatif cohérent
La taille moindre des collectivités concernées, les facultés pour certaines d'entre elles d'agir de manière concertée, les leçons tirées des échecs et des écueils subis et rencontrés par l'État pourraient inciter les collectivités territoriales à dresser de véritables audits normatifs et à user de leur liberté d'administration pour remanier le volume de normes relevant de leurs compétences et devenir leur propre gardien de la légalité, ce qui constitue un enjeu de taille dans un État décentralisé, surtout si l'on a égard au fait que les préfectures sont de plus en plus démunies de moyens pour assurer le contrôle de légalité 174 ( * ) .
Cette nécessité s'impose avec acuité si l'on considère la plus grande autonomie normative concédée aux collectivités territoriales, et en particulier aux collectivités territoriales ultramarines en vertu, respectivement, des articles 73 alinéa 2 et 3, 74 et 77 de la Constitution 175 ( * ) .
- En effet, en premier lieu, depuis 1998, la Nouvelle-Calédonie est dotée d'un pouvoir normatif important, au travers de la compétence qui lui est reconnue d'adopter des lois du pays, en vertu des articles 99 à 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Actes de valeur législative, ces lois du pays sont soumises, avant leur adoption, au Conseil d'État pour avis et elles peuvent, à l'instar des lois ordinaires, être déférées au Conseil constitutionnel.
- En deuxième lieu, les collectivités ultramarines régies par l'article 74 de la Constitution peuvent, selon les termes de cet article, prendre des actes intervenant dans le domaine de la loi, au titre des compétences qu'elles détiennent. Ces actes font l'objet d'un contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d'État.
Le même article 74 prévoit que l'assemblée délibérante de la collectivité concernée peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité. En outre, une de ces collectivités peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.
C'est donc un important pouvoir normatif qui est reconnu à ces collectivités territoriales (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) que leurs statuts respectifs prévoient et organisent selon des gradients fort différents. La Polynésie française connaît en effet un régime d'autonomie, cependant que les trois collectivités insulaires de l'Atlantique sont régies par un système composé, laissant place à une marge de manoeuvre non négligeable des autorités locales et que dans les îles Wallis et Futuna, en revanche, la centralisation paraît s'exercer encore à plein.
L'on observe conséquemment que les dispositions statutaires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (articles L.O. 6214-3 et L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales s'agissant de Saint-Barthélemy et articles L.O. 6314-3 et L.O. 6351-2 de ce code à propos de Saint-Martin) prévoient expressément la possibilité, pour ces deux collectivités territoriales détachées du département de la Guadeloupe, de prendre des actes administratifs dans le domaine de la loi, les projets d'actes étant obligatoirement soumis au Conseil d'État aux termes des articles L.O. 6243-3 et L.O. 6443-3 du code général des collectivités territoriales, afin de vérifier leur conformité à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux de la France et aux principes généraux du droit.
De façon similaire, les « lois du pays » que la Polynésie française peut édicter, actes de nature administrative en dépit de leur dénomination et de ce qu'ils interviennent dans le domaine de la loi, prévus par l'article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont soumises au contrôle a priori du Conseil d'État, conformément à l'article 177 de ladite loi organique. Le Conseil d'État a, d'ailleurs, transposé aux lois du pays de la Polynésie française la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982) selon laquelle une loi contenant des dispositions réglementaires n'est pas pour autant inconstitutionnelle (CE 1 er février 2006, n° 286584, maire de Papara).
Cette collectivité ultramarine dispose de surcroît, en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, du pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel afin de lui faire constater qu'une loi postérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique est intervenue dans le domaine des compétences de cette collectivité. Cette intéressante disposition permet ensuite à la collectivité de modifier ou abroger la loi en question.
- En troisième et dernier lieu, excepté le département et la région de La Réunion, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution peuvent, en vertu du troisième alinéa de cet article, être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
C'est ainsi que les articles 68 et 69 de la loi n° 2009-493 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ont habilité le conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional en charge de la formation professionnelle et à établir les dispositifs spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Dix délibérations ont ensuite été prises par le conseil régional.
Néanmoins, les demandes formulées par la Martinique en matière de transports intérieurs n'ont pas abouti.
Et plus particulièrement, les cas des collectivités territoriales innomées régies par l'article 73 de la Constitution, que sont à présent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la Guyane et la Martinique, seront intéressants à observer, même si au regard des potentialités offertes, sur le plan normatif par l'article 73 de la Constitution dont elles continueront à relever, leur situation demeurera inchangée.
À l'égard de ces deux collectivités, il y a lieu de relever que les dispositions des articles L. 7151-1 et L. 7151-2 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la Guyane, et des articles L. 7224-8, L. 7224-12 176 ( * ) , L. 7252-1 et L. 7252-2 de ce même code, à propos de la Martinique, sont primordiales.
Et à cet égard, l'on mesure le chemin parcouru depuis le moment où Louis Favoreu écrivait : « en dehors du cas des territoires d'outre-mer, régi par l'article 74 de la Constitution, la loi ne peut, même à titre expérimental, autoriser le pouvoir normatif local à se substituer à elle sans violer la Constitution 177 ( * ) ».
Le passage à un régime normatif caractérisé par la possibilité de prendre des mesures de nature réglementaire, voire de rang législatif, suppose un travail méticuleux et vétilleux à partir de textes consolidés. Il s'agit d'une exigence, contrepartie au régime « sur mesure » 178 ( * ) qui caractérise à présent les collectivités territoriales ultramarines, étant observé que des hypothèses de conflits de lois sont, en ce cas, susceptibles de naître 179 ( * ) .
Cette oeuvre de consolidation est d'autant plus nécessaire que des textes d'origine locale régiront des domaines entiers du droit qui, ailleurs, sur le territoire national, sont soumis au droit commun ou que des textes pris sur une initiative locale modifieront des dispositions originellement édictées par des textes de droit commun adoptés par les pouvoirs publics.
Cela nécessite la tenue rigoureuse de bases de données, dont l'articulation avec celle de « Legifrance » ne doit pas souffrir de lacune. L'accès au droit, sa connaissance en dépendent en effet. Et le travail des rédacteurs de textes en est facilité.
C'est ainsi que l'établissement de la norme doit, dans un tel cas de figure, faire l'objet de toutes les attentions du pouvoir normatif, quel qu'il soit, et, à cet égard, il convient de rappeler que la consolidation des textes normatifs peut être opérée par toute personne intervenant dans le domaine juridique 180 ( * ) et qu'il ne s'agit pas d'un monopole de l'État.
Cette acuité particulière qui leur est requise peut trouver à s'illustrer à travers l'exemple suivant, qui concerne la Polynésie française.
Cette collectivité territoriale est régie, nous l'avons dit, par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de son autonomie.
Selon le 11° de l'article 14 de cette loi organique, l'État est seul compétent pour fixer les règles dans les matières suivantes : « Fonction publique civile et militaire de l'État ; statut des autres agents publics de l'État ». Et à l'appui de cette affirmation, le 5° de l'article 7 de ladite loi organique prévoit que dans les matières ci-après désignées : « Fonction publique civile et militaire de l'État ; statut des autres agents publics de l'État », les dispositions législatives et réglementaires s'appliquent de plein droit sans mention expresse en Polynésie française.
Or, nonobstant cette double affirmation énoncée par le statut de la collectivité territoriale, issu d'une loi organique, les agents non fonctionnaires de l'administration (dénommés « ANFA ») en fonction dans les services de l'État sont régis par le droit du travail, matière qui, en Polynésie française, relève de la compétence de la collectivité territoriale.
C'est ainsi que ces agents contractuels sont soumis à la convention collective du 10 mai 1968 conclue initialement entre le gouverneur représentant de l'État et les organisations syndicales représentatives.
De nos jours et depuis que la détermination des règles du droit du travail est du ressort de la Polynésie française, les avenants à cette convention collective sont conclus entre le président ou le ministre responsable du gouvernement de la Polynésie française et les syndicats (depuis l'avenant n° 6 en date du 10 mars 1992, paru au J.O.P.F. du 19 mars 1992, p. 583).
Des règles de droit du travail d'application locale, émanant des organes de la Polynésie française régissent ces agents de l'État non titulaires et ce, malgré l'affirmation de la loi organique qui paraît englober, au nombre des compétences exclusives de l'État, les règles à eux applicables et en dépit, réciproquement, de ce que l'article L. 1111-2 du code du travail applicable en Polynésie française et issu de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du code du travail ( J.O.P.F. n° 27NS du 4 mai 2011, p. 938) ait également exclu du champ de la compétence du code du travail les « fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public ».
Il est donc permis de s'interroger sur la compétence des autorités de la Polynésie française pour déterminer et faire application des règles du code du travail applicable en Polynésie française à des agents non titulaires de l'État en exercice au sein de cette collectivité territoriale, interrogation à laquelle ni la consultation de « Legifrance », ni celle de son homologue polynésien « Lexpol », ne permettent de répondre.
En conclusion, la légistique, cet art difficile, est impérieux pour les collectivités territoriales ultramarines dès lors qu'elles bénéficient d'une autonomie réelle.
Il sera porté à leur crédit si elles en maîtrisent les arcanes. Liée à l'évolution et aux développements que connaît, sur un plan plus général, notre droit, elle permet de mesurer la capacité d'une société à s'adresser à ses membres, à bâtir un ordonnancement juridique accessible et intelligible et, ainsi, à donner du droit une image à la fois stable et dynamique, permanente et souple, tous qualificatifs souvent difficilement conciliés par les autorités politiques.
Elle apparaît donc bien à leur égard comme un facteur d'exigence porteur d'enjeux.
ATELIER 2 - AUTONOMIE LOCALE : PRINCIPE EUROPÉEN, MISE EN oeUVRE NATIONALE - Sous la présidence de Justin Daniel
Justin Daniel, Professeur de science politique à l'Université des Antilles et de la Guyane - Autonomie locale : principe européen, mise en oeuvre nationale
Le titre de cet atelier m'évoque trois séries d'images. Tout d'abord, la notion d'autonomie locale est à la fois centrale et diffuse. Elle sous-tend l'organisation administrative des États européens et permet de subsumer une grande diversité de situations. En cela, le poids des traditions politico-juridiques est déterminant. En outre, en tant que construction en devenir, l'Europe tente de donner un contenu à la notion d'autonomie au-delà de la diversité des situations en son sein. Enfin, l'idée même d'autonomie pose le problème du jeu des échelles, compte tenu de la fragmentation des pouvoirs et de la pluralité des centres décisionnels. L'autonomie a évolué au fil du temps et ne saurait aujourd'hui définir un pouvoir unifié, désigné par un mode de délégation démocratique et mettant en oeuvre ses actions dans une sphère préalablement circonscrite.
L'atelier va se focaliser sur trois États : l'Espagne, le Portugal et la France, qui gèrent tous trois des territoires insulaires. Deux d'entre eux ont profité de leur transition démocratique pour mettre en place des dispositifs d'autonomie originaux afin de répondre à des revendications territoriales. Annie Fitte-Duval nous présentera la solution espagnole tandis que le professeur Pacheco Amaral évoquera la situation de Madère et des Açores qui sont intégrés à l'État du Portugal, où l'autonomie est bien plus poussée qu'en France. S'agissant justement de la France, force est d'admettre que la notion d'autonomie n'est pas définie de façon précise, en dehors de l'article 74 de la Constitution qui la caractérise davantage qu'il n'en fixe le contenu. Bien sûr, notre Constitution contient par ailleurs divers dispositifs qui tendent à sanctuariser cette notion d'autonomie, si diffuse soit-elle.
En ce qui concerne le lien entre Union européenne et autonomie locale, rappelons l'existence d'une Charte européenne de l'autonomie locale, document de référence d'une très grande souplesse. Cette charte précise néanmoins les principes directeurs et les moyens techniques pour y parvenir. Ces principes sont repris par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) selon une démarche lente et progressive. C'est ce que nous montrera le professeur Danielle Perrot.
Sur le jeu des échelles, rappelons la recomposition de l'action publique sous la double influence de la redéfinition du périmètre des États et de la construction communautaire. L'action publique se réorganise à des échelles territoriales supra et infra nationales. Se pose alors la question de la signification de l'autonomie dans un contexte de pluralisme institutionnel et parfois de concurrence normative, que nous qualifions de gouvernance multi-niveaux, comme nous l'a montré le professeur Vincent Roux. Se pose alors la question de savoir comment s'organise l'action publique au niveau local. Comment s'opère l'articulation entre les différents niveaux d'intervention ? Hervé Rihal tentera de répondre à cette question à partir de l'expérience des départements dans le domaine de l'action sociale.
Au niveau européen, on peut se demander si les développements connus depuis plusieurs décennies n'ont pas une influence sur la conception même de l'autonomie, avec notamment l'inclusion de pouvoirs régionaux à des processus décisionnels complexes qui vient relativiser la conception de l'autonomie telle qu'elle a pu exister outre-mer dans les années 1960. L'autonomie n'oblige-t-elle pas les autorités régionales à opérer à travers des réseaux complexes impliquant les niveaux locaux, étatiques et européens, abjurant en quelque sorte la notion même d'autonomie politique telle qu'elle était revendiquée dans les années 1960 et 1970 dans les départements d'outre-mer ?
Danielle Perrot, Professeur de droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane, Chaire Jean Monnet CRPLC - UMR CNRS 8053 - L'autonomie dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
À propos de l'autonomie des entités infra-étatiques, il eût été approprié de parler du droit de Strasbourg, du Conseil de l'Europe et de sa Chartre de l'autonomie locale 181 ( * ) , en ces lieux, puisque la Haute Assemblée représente les collectivités de la République. Mais le sujet à traiter concerne la Cour de Luxembourg, celle de l'Union européenne 182 ( * ) . Vu le temps imparti, le sujet sera seulement survolé ; on a pourtant écrit des thèses 183 ( * ) , et bien plus, à ce propos.
Dans le vocabulaire de la Cour de justice de l'Union européenne, l'autonomie dont il est question est très souvent celle des États membres, et occasionnellement celle de leurs composantes subétatiques. On pourrait y voir le signe de ce que la CJUE tendrait peut-être à ignorer, sinon à étouffer, cette dernière autonomie.
Cela tient sans doute à la prégnance de l'origine interétatique de toute organisation internationale, et les Communautés puis l'Union européenne n'y échappent pas. Dans le vocabulaire juridique de l'Union européenne, on parle fréquemment de l'« autonomie institutionnelle et procédurale » -- chaque État est libre de son organisation interne --, consacrée par la Cour dès le début des années 1970 184 ( * ) . Mais elle doit se concilier avec le « principe de coopération loyale » 185 ( * ) qui implique que l'État fasse respecter ses obligations par tous ceux sur qui il exerce sa compétence, notamment ceux qui déploient leurs activités dans son champ territorial, par exemple les entités infra-étatiques ou collectivités territoriales. En outre, à propos de personnes de droit public interne, et pour désigner leur non-confusion avec l'État, on peut trouver le mot autonomie, et même indépendance ; ce vocabulaire flou ne facilite pas les choses...
À propos de la jurisprudence de la CJUE, la place des collectivités territoriales a été qualifiée de « chaînon manquant » 186 ( * ) . En effet, elles ne disposent pas d'un accès facile à cette Cour (I) ; et si elles l'ont, le contenu de la jurisprudence ne leur est pas vraiment favorable (II).
I. - L'accès limité des collectivités territoriales au prétoire de la CJUE
Au vu de l'accès limité à la Cour de Luxembourg, il peut être habile, si possible, d'agir en coopération, voire en connivence avec le gouvernement de l'État membre de rattachement, ce qui ne joue pas dans le sens de l'autonomie des collectivités. Peuvent pousser à cette tentation les moyens juridictionnels indirects de mise en cause contentieuse de leurs comportements (A), comme ceux qui permettent de tirer bénéfice du droit de l'Union qu'une de ses institutions aurait méconnu à leur détriment (B) 187 ( * ) .
A. La mise en cause indirecte des comportements critiqués des collectivités devant la CJUE
Concernant les agissements des collectivités territoriales contraires au droit de l'UE, ils peuvent susciter une procédure de manquement contre leur État de rattachement. Les personnes privées qui en pâtissent peuvent aussi s'adresser à un juge interne qui a compétence pour saisir la Cour de l'Union ; l'accès à son prétoire est alors indirect.
1) Une collectivité n'étant pas un État ne peut être poursuivie directement pour manquement à ses obligations
En cas de manquement généré par une collectivité, seul l'État est poursuivi devant la Cour (TFUE, art. 258 & ss.), quitte à ce qu'il renvoie sur la collectivité les conséquences d'un arrêt de manquement.
En pratique, parfois, au stade précontentieux, le point de vue de la Commission européenne n'est pas très contesté au niveau ministériel. Ce fut le cas sur la date d'application d'une directive à un marché relatif au métro de Rennes ; la mobilisation de l'intercommunalité auprès du chef du gouvernement a permis que le recours de la Commission soit rejeté 188 ( * ) .
À l'inverse, l'État peut tirer argument de la menace du contentieux, pour faire pression, comme dans une instruction aux préfets du 11 février 2014, à propos d'une directive de 2002 sur le bruit ; au 14 mars devait avoir été établi un diagnostic quant aux collectivités n'ayant pas adopté les dispositifs de mise en oeuvre et y figurait l'éventuelle substitution étatique aux collectivités 189 ( * ) .
Mais si dans le contentieux du manquement seul l'État peut être formellement poursuivi et la collectivité n'accède pas au prétoire de la CJUE, lorsqu'une personne privée conteste le comportement de la collectivité, l'on admet que, disposant de l'autorité publique, elle puisse en répondre.
2) Une collectivité territoriale étant une personne disposant de l'autorité publique peut être mise en cause par une personne privée
Si un particulier se plaint du comportement d'une collectivité, il peut utiliser les voies de recours que le droit interne met à sa disposition 190 ( * ) ; alors le juge national pourra poser à la CJUE une question préjudicielle en interprétation du droit de l'Union (TFUE, art. 267).
En ce cas, comme dans toute affaire préjudicielle, si la collectivité est partie à l'instance devant le juge du fond 191 ( * ) , elle peut être entendue par la Cour en présentant ses observations, comme tous les États membres, y compris le sien. Peut alors s'opérer une convergence d'argumentation entre la collectivité et son État de rattachement, s'il juge bon de présenter des observations, allant dans le sens d'une interprétation défavorable au particulier.
Mais la collectivité ne peut présenter d'observations, si l'entité publique contestée relève de l'État, comme dans certaines affaires relatives à l'octroi de mer où les redevables avaient attaqué des actes de l'administration des douanes 192 ( * ) .
Les arrêts préjudiciels sont aussi l'occasion pour la CJUE de répondre sur la façon d'indemniser les préjudices subis par des particuliers et générés par des entités publiques internes, dont les collectivités ; alors s'appliquent les règles formulées à propos de la responsabilité des États. Mais, la Cour n'exige pas que seul l'État paie : son droit interne peut prévoir la répercussion en tout ou partie sur la collectivité 193 ( * ) .
Symétriquement au droit de l'Union souvent perçu comme une somme de sujétions, il se peut que certaines de ses normes soient favorables à telle collectivité. Dispose-t-elle alors de moyens de contester des actes méconnaissant des normes supérieures du droit de l'Union ?
B. Les moyens juridictionnels de faire respecter le droit de l'Union favorable aux collectivités par la CJUE
Une collectivité peut être tentée d'invoquer une norme du droit de l'Union qui aurait été méconnue par une institution de l'Union. À cette fin, les traités ont prévu le recours en annulation (TFUE, art. 263) ; pourtant l'accès au prétoire n'est pas aisé et se pose la question des palliatifs.
1) Le recours en annulation des collectivités contre les actes des institutions de l'Union : une possibilité tronquée
Avant d'annuler un acte de droit dérivé, la Cour ne considère pas une collectivité à l'égal d'un État. Des collectivités ont pourtant cherché à se faire reconnaître le même accès à la Cour que les États membres qui ont des facilités telles qu'on les range parmi les « requérants privilégiés ». Même l'invocation de l'intérêt public distinct de celui de l'État n'est pas retenue : c'est la réponse de la Cour au gouvernement des Antilles néerlandaises prétendant que « le royaume des Pays-Bas ne veille pas toujours pleinement à leurs intérêts » 194 ( * ) .
Reléguée parmi les requérants ordinaires, la collectivité doit démontrer la recevabilité de son recours. La condition la plus épineuse est celle du caractère individuel, plutôt difficilement démontrable lorsque l'acte attaqué a une portée générale. Même la mention du nom d'une collectivité dans le traité, comme les Açores, est insuffisante ; cela seul ne prouve pas qu'elle soit touchée individuellement par un règlement contesté, puisqu'il se peut qu'une autre région, par exemple ultrapériphérique, soit affectée par ce dernier 195 ( * ) .
L'intérêt individuel affecté par un acte litigieux relève bien sûr de la sphère publique ; mais l'intérêt général de nature économique ne suffit pas. La clé de la recevabilité d'un recours en annulation contre un acte de portée générale par une collectivité revêt une dimension juridique : il faut démontrer l'atteinte à l'exercice des compétences sur lequel l'État n'a pas d'emprise 196 ( * ) .
Face à ces embûches, il serait tentant de demander au gouvernement de l'État de former un recours, qui endosserait son rôle de requérant privilégié. Ce contournement politique ne renforce pas l'autonomie des collectivités. Au regard du droit processuel de l'Union, y a-t-il des palliatifs ?
2) Des palliatifs ?
Il ne peut être ici question de détailler toutes les nuances techniques des moyens pour que les collectivités se frayent un chemin jusqu'à l'obtention d'une « capacité d'expression juridictionnelle » 197 ( * ) , lorsqu'elles ne peuvent être directement requérantes ; c'est particulièrement le cas à propos de l'intervention qui offre quelques ouvertures.
L'admission de leur capacité d'intervention suppose, bien sûr, d'abord qu'une autre affaire soit en cours et que le requérant y ait formé un recours recevable. Mais les collectivités ne disposent pas du droit inconditionné d'intervenir, analogue à celui des États membres. Ici aussi, en vue du soutien des conclusions d'un justiciable, la seule invocation de la qualité de personne publique est insuffisante pour faire admettre l'intervention ; la collectivité doit démontrer un intérêt « direct et actuel » à la solution du litige ; mais, cette fois, l'intérêt général économique peut être admis pour l'intervention 198 ( * ) . Cependant, si l'affectation de la situation économique et sociale dans le ressort territorial peut être retenue, elle doit être précise et non floue : une commune peut soutenir les conclusions de marins-pêcheurs concentrés dans son ressort, l'Île d'Yeu ; ce n'est pas le cas du département, la Vendée 199 ( * ) . Et si l'intervention de la collectivité est admise, elle peut se faire, ou non, de façon convergente avec celle de l'État, s'il juge bon d'intervenir.
Il reste à signaler pour rappel que la contestation contentieuse d'un acte de l'autorité étatique exécutant fidèlement un acte d'une institution de l'Union peut être portée d'abord devant un juge national, à charge pour lui de poser, s'il y a lieu, la question préjudicielle de la validité de l'acte de droit dérivé qui ne respecterait pas une norme de valeur supérieure 200 ( * ) . En pareil cas, la collectivité requérante devant le juge interne peut présenter des observations à la CJUE qui, cette fois, seraient sans doute contradictoires avec celles de son État membre, sauf s'il a de mauvais gré mis en oeuvre l'acte de droit dérivé qu'il aurait négligé d'attaquer en annulation dans le délai imparti ; ce serait alors une instrumentalisation de la collectivité, ce qui ne renforce pas l'autonomie locale.
Une fois admise à se faire entendre par les juges de Luxembourg, une collectivité peut-elle espérer un arrêt favorable à son autonomie ? Comme la CJUE tend à voir dans l'Union une oeuvre voulue par les État membres, rien n'est moins sûr.
II. - Des solutions jurisprudentielles encore peu propices à l'autonomie des collectivités
Tout d'abord, la Cour a sa propre conception de l'autonomie des entités sub-étatiques, et elle est restrictive (A). On a assisté à des solutions souvent peu favorables à l'autonomie des collectivités ; on peut alors douter des incidences des stipulations nouvelles issues du Traité de Lisbonne (B).
A. Le concept d'autonomie d'une collectivité entendu restrictivement
Comme pour d'autres expressions figurant dans les traités, la CJUE ne se subordonne pas aux énoncés des divers droits internes. Le champ privilégié de la jurisprudence sur l'autonomie est le domaine des « aides d'État » 201 ( * ) ; ce qui amène à s'interroger sur la transposition de sa conception, lorsqu'elle aurait à juger dans une autre matière.
1) La démarche classique de la CJUE : des critères propres potentiellement distincts de ceux retenus en droit interne
La CJUE a confirmé sa démarche générale tendant à se dégager des conceptions juridiques reconnues dans les ordres juridiques internes, à propos de l'autonomie des collectivités : elle refusait d'abord de considérer comme pertinent le degré d'autonomie d'entités régionales 202 ( * ) .
Depuis 2006, dans l'affaire Portugal contre Commission dite « régime fiscal des Açores » 203 ( * ) , elle admet la possibilité d'une prise en compte conditionnée de l'autonomie régionale. Elle accepte de rechercher si des exonérations fiscales décidées par la région doivent être appréhendées à l'échelle de l'État membre - alors une aide serait sélective et potentiellement illégale -, ou au niveau de la région, ce qui conduirait à la solution inverse.
Parmi les conditions de la reconnaissance de l'autonomie régionale suffisante, figurent : l'autonomie consacrée en droit interne ; la non intervention du gouvernement central dans l'élaboration de la décision régionale ; et surtout, l'absence de solidarité financière nationale : la région ne recevrait pas de compensation d'une moindre rentrée fiscale. Eu égard à ce dernier critère, la Cour ne considère pas que la région considérée est suffisamment autonome.
Le Tribunal de l'Union a tenté d'atténuer la portée de cette jurisprudence : à propos de transferts du Royaume-Uni à Gibraltar, ils ne contrediraient son autonomie que s'ils sont précisément liés à la mesure fiscale susceptible d'être qualifiée d'aide 204 ( * ) . Il déclare que ne pas le reconnaître reviendrait à faire de la jurisprudence précitée une « lettre morte ». Mais cet arrêt a été annulé par la Cour pour un autre motif 205 ( * ) .
Cette appréhension timide de l'autonomie, à propos du droit des aides d'État, est-elle transposable dans un autre champ du droit de l'Union ?
2) L'éventuelle reconnaissance de l'autonomie (suffisante) de collectivités au-delà de la question des aides d'État
On peut citer, en matière agricole, le fait qu'un règlement prévoit une mise en oeuvre différenciée selon les régions. Cela laisserait penser que, a priori, les autorités régionales correspondantes voient consacrer leurs compétences en la matière ; ce peut être le cas si le droit interne l'a prévu. Mais rien n'impose un tel schéma : pour la partie du Royaume-Uni dénommée Angleterre, l'autorité compétente est le gouvernement central et la Cour ne le conteste pas 206 ( * ) .
Plus largement d'ailleurs, l'arrêt sur le régime fiscal des Açores a constaté, sans les proscrire, les multiples taux de fiscalité décidés par les différentes collectivités dans un même État, ce qui empêche de déterminer un niveau d'imposition normal ou de référence, pour apprécier s'il y a aide ou non.
Ce point du même arrêt crucial permet d'évoquer un cas strictement français : si une collectivité dite « dotée de l'autonomie », selon la Constitution, Saint-Barthélemy encore région ultrapériphérique de l'Union, au lieu de bénéficier de transferts, reçoit en vertu d'une loi de 2008 un titre de perception au profit d'une autre collectivité, la deuxième (la Guadeloupe), n'est sûrement pas autonome au regard du critère névralgique de l'arrêt « régime fiscal des Açores ». À l'inverse, la première, Saint-Barthélemy, ressent cette « facture de l'autonomie » infondée au point d'obtenir que le tribunal administratif de Basse-Terre sollicite le Conseil d'État qui pose une question prioritaire de constitutionnalité 207 ( * ) . Mais le Conseil constitutionnel ne donne pas satisfaction à la collectivité d'outre-mer 208 ( * ) . Ici, loin de quémander des subsides, elle semble pouvoir s'en passer et est appelée à en fournir 209 ( * ) , ce qui paraît présenter l'exemple, peut-être inédit, où une collectivité satisfait au critère majeur de la CJUE sur l'autonomie d'une région, sans qu'il soit question du droit des aides d'État.
Plus généralement, au-delà de la conception que se fait la Cour de l'autonomie, il n'est pas certain que de nouvelles mentions dans le Traité de Lisbonne soient aptes à infléchir sa ligne jurisprudentielle.
B. La portée incertaine de la reconnaissance accentuée du fait local et régional dans le Traité de Lisbonne
Eu égard à une jurisprudence établie, il est douteux que des changements rédactionnels aient une influence déterminante. À la lettre, le droit primaire de l'Union multiplie les mentions du fait régional et local. Il fournit aussi des garanties procédurales nouvelles en vue de faire respecter le principe de subsidiarité.
1) Le fait local et régional reconnu de façon accrue depuis le Traité de Lisbonne
À la lecture du Traité de Lisbonne, on note un doublement des occurrences des mots « régional/local » et l'on se réjouit de cette reconnaissance 210 ( * ) . Mais subsistent des doutes sur la portée contentieuse d'une de ces mentions, selon laquelle l'identité nationale des États membres comporte aussi désormais « l'autonomie locale et régionale » 211 ( * ) . Il faut avoir conscience que, avant 2009, la reconnaissance antérieure de l'identité nationale des États membres n'a jamais remis en cause le principe cardinal consacré par la Cour en 1964, celui de la primauté du droit communautaire sur celui des États membres 212 ( * ) , quel qu'en soit l'auteur, autorité centrale ou non. La Cour s'appuie aussi sur l'exigence de coopération loyale de ceux-ci 213 ( * ) .
L'examen des arrêts a montré qu'il est judicieux d'invoquer simultanément un autre principe, par exemple le respect de la diversité culturelle, ou de la diversité linguistique ; si cela est retenu, cela peut conforter le respect de l'identité nationale, y compris dans ses dimensions régionale et locale 214 ( * ) .
Il est alors tentant de chercher à combiner le principe d'identité nationale « y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale », avec explicitement le principe de subsidiarité. Le Traité de Lisbonne prévoit des procédures non instituées auparavant, en vue de faire respecter ce principe.
2) Des garanties procédurales nouvelles en vue du respect du principe de subsidiarité
Outre les gouvernements des États qui conservent leur droit de prétendre qu'une décision aurait dû être prise par des autorités internes et non par une institution de l'Union, les parlements nationaux notamment sont promus gardiens de la subsidiarité, selon l'article 5 § 3 du TUE révisé. L'intérêt des nouvelles procédures est que, si elles débouchent positivement dans le sens de la subsidiarité descendante, les autorités internes - éventuellement locales ou régionales - auront plus de place dans l'élaboration des actes juridiques.
À cet effet 215 ( * ) , les chambres parlementaires jouent un rôle d'alerte précoce puisqu'il leur est permis de solliciter l'auteur d'un projet d'acte législatif - souvent la Commission - pour qu'il modifie son texte de façon à laisser plus de marge aux autorités internes ; l'on peut espérer que les chambres représentatives des collectivités y sont attentives. Si la proposition n'est pas modifiée, dans le cas de procédure législative ordinaire, le Conseil ou le Parlement européen peut bloquer la procédure d'adoption.
Si, malgré cela, la procédure législative arrive à son terme, en aval chaque chambre parlementaire peut contester l'acte adopté devant la CJUE 216 ( * ) , au nom du principe de subsidiarité. En outre, le Comité des régions dispose du même recours pour le même motif, si sa consultation est prévue par le TFUE.
Mais la multiplication potentielle des recours n'implique pas une inflexion jurisprudentielle. Car la Cour a développé une position restrictive sur la subsidiarité, que ce soit en vérifiant la motivation des actes déférés 217 ( * ) , ou lors d'examens au fond : elle peut apprécier qu'un objectif à atteindre est mieux réalisé au niveau communautaire, car laisser les autorités nationales agir individuellement ne permettrait pas d'y parvenir de manière suffisante 218 ( * ) . Elle tend ainsi à ne pas annuler ou déclarer invalides des actes soumis à son contrôle et l'on a parlé de « grande retenue » en la matière 219 ( * ) .
La multiplication éventuelle des recours ne doit donc pas être confondue avec une inflexion jurisprudentielle ; il est même possible que la connaissance de la jurisprudence explique une réticence à saisir la Cour qui répugne à juger dans le sens de la subsidiarité descendante et tend à trancher au profit de la subsidiarité ascendante, non pas au profit des États, mais de l'Union.
Au total, la voie vers une meilleure prise en considération de l'autonomie des collectivités s'avère un chemin rocailleux.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
Carlos Pacheco Amaral, Professeur à l'Université des Açores, Chaire Jean Monnet - Autonomie dans l'État unitaire : le cas des Açores et de Madère au Portugal
L'idée d'autonomie est, on le sait, vieille de plusieurs siècles. Elle nous vient des Grecs, des Anciens, pour désigner la condition nouvelle où se trouvaient certaines polis qui n'étaient, ni indépendantes, ni entièrement soumises au pouvoir hégémonique d'autres cités. Elles étaient autonomes dans la mesure où elles possédaient un certain nombre de pouvoirs politiques, mais pas la totalité puisqu'elles se trouvaient, soit soumises au pouvoir d'un hegemon , soit intégrées dans une ligue.
De la Grèce ancienne, l'idée d'autonomie a tracé son chemin dans toute l'Antiquité. On la retrouve dans le cadre de Rome, exactement comme instrument d'agglutination de l'Empire et d'intégration de la pluralité des peuples qui le composaient. C'est pendant l'Empire que l'idée d'autonomie a été introduite pour la première fois au Portugal, dans l'organisation municipale. L'autonomie jouait, alors, un double rôle : d'un côté, elle conduisait à assurer l'intégration des espaces dans l'Empire, de l'autre, elle exprimait la condition de liberté de ces espaces dans la conduite de leurs affaires particulières et la citoyenneté romaine de leurs élites. C'est précisément de cette époque que datent la déjà vieille tradition municipaliste portugaise et les enjeux que le pays continue à connaître au niveau de l'organisation régionale de son territoire continental. Le Portugal n'a pas de tradition régionaliste. Pourtant, le pays connaît une forte tradition municipaliste, c'est-à-dire d'autonomie locale. Cette tradition, héritée de l'occupation romaine, s'est prolongée jusqu'à nos jours, parfois plutôt comme un idéal et un souvenir d'un passé bien aimé que comme une réalité effective. Une tradition qui trouvait sa traduction concrète dans le fait que dans les municipalités et les circonscriptions sociales, au lieu d'être entièrement gouvernées par la capitale, c'étaient les hommes bons de la gouvernance - comme ils étaient connus dans la tradition portugaise - qui étaient responsables de l'exercice autonome du pouvoir politique.
Cette idée d'autonomie est restée dans l'Occident - et dans l'univers musulman - pendant tout le Moyen-Âge. On pourrait même dire que le Moyen-Âge fut la période des autonomies, au pluriel. Sans connaître l'idée de souveraineté, le Moyen-Âge se présente, en effet, comme une vraie mosaïque d'autonomies : soit d'unités territoriales, de royaumes, de provinces, de duchés, d'abbayes et de cités libres, soit d'unités fonctionnelles, de guildes et d'associations les plus diverses, aussi bien de nature religieuse que de nature civile, surtout socioprofessionnelle. Elles se présentaient comme autonomes dans la mesure où, sans nuire à leur respective intégration dans le royaume du Portugal, chacune partageait le pouvoir en s'assumant comme responsable directe de la conduite de ses propres affaires intérieures.
Au Portugal, cette période s'achèvera, très tôt en termes historiques, avec l'émergence d'un État souverain, ce qui pourrait expliquer le rôle et l'expansion immense de ce pays au début de l'époque moderne. Le Portugal, comme d'ailleurs la plupart des pays européens, émergera comme État souverain à travers un processus de centralisation, dans les mains de la Couronne, du pouvoir politique dispersé parmi une pluralité d'unités autonomes.
Néanmoins, dans l'histoire récente, le Portugal a récupéré le vieux concept d'autonomie à trois moments historiques :
- D'abord, à la fin du XIX e siècle, suivant le prolongement final de la centralisation de l'État dans ses archipels atlantiques - y compris les îles et les municipalités elles-mêmes -, et la réunion, pour chacun d'entre eux, dans les mains d'un seul agent de la Couronne, du pouvoir antérieurement dispersé parmi une pluralité d'agents.
- Ensuite, au XX e siècle, à la fin des années soixante et au début des années 1970, quand l'autonomie fut proposée comme mécanisme pour transformer les anciennes colonies africaines en unités autonomes du pays.
- Enfin, en 1975, à la suite de la révolution d'avril 1974, quand le Portugal a remplacé son régime autoritaire par une démocratie qui, d'abord, se voulait socialiste ou, plus précisément, en transition vers le socialisme, mais qui, dès le début, a évolué, et de façon définitive, dans une direction franchement libérale.
L'autonomie émerge comme une demande des archipels atlantiques des Açores et de Madère, suite aux mesures de centralisation adoptées au XVIII e siècle par la Couronne portugaise sous la direction du secrétaire d'État, le marquis de Pombal.
L'archipel de Madère intègre deux îles très proches l'une de l'autre, Madère et Porto Santo - la première d'une superficie de 740,7 km² et la seconde de 42,5 km² -, ainsi que deux petits groupes d'îlots, les Désertes et les Sauvages. Il s'agit d'un archipel, même si l'île de Madère est habitée par 257 745 personnes, Porto Santo seulement par 5 346 personnes, et que les îlots soient pratiquement inhabités.
Les Açores, par contre, sont composées de neuf îles, toutes peuplées et largement dispersées à travers l'Atlantique nord. Elles se prolongent sur 500 milles dans un axe est-ouest, de telle façon que Santa Maria, l'île plus à l'est, émerge de la plateforme continentale africaine, tandis que les îles centrales, São Miguel, Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico et Faial se situent dans la plateforme euro-asiatique, et que les deux îles plus à l'ouest, Flores et Corvo, sont déjà dans la plateforme américaine. Aujourd'hui, les Açores comptent 241 763 habitants : 131 609 résident dans la plus grande des îles, São Miguel, et 425 dans la plus petite, Corvo.
Les deux archipels sont d'origine volcanique et étaient inhabités quand ils ont été découverts et peuplés par le Portugal, à l'aube de l'époque moderne, dans le cadre de l'épopée portugaise des découvertes.
Son propriétaire, le prince Henri le Navigateur, s'est chargé du peuplement des îles. Il les a données, entièrement ou en partie, de façon strictement médiévale, à ses hommes pour les peupler. Ces hommes sont devenus responsables du peuplement, par la capture des colons arrivés surtout du continent portugais, mais aussi par des apports de l'étranger - en particulier de la Flandre, de la Bretagne et du Nord de l'Afrique -, et du gouvernement des îles. Du reste, préférant Lisbonne à la vie dans les îles au milieu de l'Atlantique, ces seigneurs insulaires ont confié rapidement ces tâches à des capitans qui gouvernaient les îles pour eux. Le résultat fut que, dès le début, de la découverte et du peuplement au XV e siècle jusqu'à la réforme centralisatrice de Pombal qui établit une autorité singulière, le Capitan Général, nommée par la couronne dans chacun d'eux, les deux archipels ont été livrés à eux-mêmes. Autrement dit, sauf pour la collecte d'impôts et le recrutement de jeunes pour le service militaire, les îles restaient autonomes, et le pouvoir réel surtout dans les municipalités.
De manière prévisible, la centralisation de la vie politique opérée par la couronne a donné lieu aux premières demandes d'autonomie des élites insulaires.
Pour justifier cette demande d'autonomie, trois arguments furent présentés :
- Premièrement, un argument identitaire. Sous l'influence conjointe du climat, de l'insularité et de l'isolement océanique, malgré leur origine portugaise, chaque archipel, et dans chaque archipel, chaque île, avait développé une identité spécifique, différente de celle du continent. Pas assez différente pour les élever à la catégorie de nation nouvelle qui, alors, devrait aspirer à l'indépendance, mais suffisamment différente pour créer des intérêts propres dont la bonne gestion exigeait l'autonomie.
- Un deuxième argument, de nature idéologique : si le centralisme unitaire se justifiait sur le continent, la condition insulaire, en elle-même, demandait une organisation politique spécifique, c'est-à-dire l'autonomie.
- Finalement, et majoritairement, en raison de l'isolement et de l'abandon séculaire, les populations insulaires des Açores et de Madère ont développé ce qu'on a appelé une « notion ressentie de différence » . Elles étaient différentes, malgré elles, à cause de leur abandon par la couronne portugaise. L'autonomie se justifiait, alors, comme une espèce de discrimination positive. Étant portugaises, les populations des Açores et de Madère devaient être autonomes pour devenir égales aux autres Portugais, restés sur le continent.
C'est dans le cadre de ce kaléidoscope d'arguments que, le 2 mars 1895, le gouvernement portugais a adopté le premier décret d'autonomie, strictement administrative, pour les districts des Açores et de Madère qui en avaient fait la demande.
Au niveau matériel, cette première autonomie était plutôt modeste, et le régime autoritaire de Salazar et de Caetano s'est chargé de la vider entièrement de ses compétences.
L'idée d'autonomie sera reprise en 1971, mais pour les colonies africaines, afin de surmonter les problèmes rencontrés aux Nations unies en matière de droit d'autodétermination des peuples. Le projet s'est traduit sous la forme d'un changement dans la Constitution : les colonies devaient se transformer en provinces autonomes afin de souligner le caractère unitaire et multiracial du Portugal qui se prolongeait de Minho, au nord de son territoire continental européen, jusqu'à Timor dans le Pacifique sud. À cette époque, pourtant, la pression pour l'indépendance était déjà irrésistible, et la révolution de 1974 la concrétiserait dans l'ensemble des espaces coloniaux portugais.
Cette même révolution, dans le cadre de la nécessaire démocratisation de l'État portugais, offrira l'opportunité pour les Açores et Madère - seuls territoires extracontinentaux que le pays a gardés après la révolution -, d'adopter, dans le cadre de la Constitution, un ample régime d'autonomie politique et administrative.
À cette époque, les deux régions - et surtout les Açores - avaient développé des factions séparatistes disposant d'importantes ramifications internationales. Nourris par des ressentiments très forts contre le sous-développement affreux dans lequel se trouvaient les sociétés insulaires, ainsi que par un anticommunisme très marqué - les communistes étant au pouvoir à Lisbonne, le Portugal risquait, selon Henry Kissinger, de devenir « le Cuba de l'Europe » -, les Açores et Madère ne voulaient pas suivre le même chemin. Dans ce contexte, face au danger de l'indépendance des deux archipels, le choix de l'autonomie était une alternative. Et ce choix fut facilité par le fait que les deux principaux partis politiques dans la nouvelle Assemblée de la République élue après la révolution de 1974 et chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour le Portugal - le parti socialiste et le parti social-démocrate - ont confié à des parlementaires, élus sur ces listes par les deux archipels, le soin de définir le nouveau régime d'autonomie desdits archipels.
Ce sont donc deux députés des Açores, Mota Amaral pour les sociaux-démocrates - qui deviendra, par la suite, le premier président du gouvernement de la région - et Jaime Gama pour les socialistes, qui ont été les principaux responsables de la rédaction du nouveau titre VII de la Constitution, dans le cadre d'un ample régime d'autonomie politique, administrative, législative et fiscale pour les Açores et Madère, fixé postérieurement dans les statuts de chacune des régions.
Dans le texte de la constitution, l'article 227 identifie et prévoit les organes propres des régions - un parlement et un gouvernement -, fixe les rapports avec les organes de souveraineté - d'abord à travers un ministre de la République, plus tard déclassé et transformé en représentant de la République - et identifie les compétences des régions, énumérées précisément de la lettre a) à la lettre x) de l'alphabet.
Il serait fastidieux de présenter une description complète des compétences régionales telles qu'elles sont définies dans les statuts. Il suffit de dire qu'elles touchent pratiquement tous les secteurs de la vie contemporaine, soit directement, soit indirectement. En dehors des remarquables exceptions de la sécurité, de la défense nationale et de la justice, il sera difficile de trouver un seul secteur de la vie contemporaine hors de portée des régions, si ce n'est au niveau d'une délibération, au moins à celui de la discussion et de la participation.
Les compétences directes des régions comprennent les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des ressources marines, du commerce, de l'industrie et de l'énergie, du tourisme et des infrastructures, des transports et des communications, de l'environnement et de la planification régionale, de la solidarité et de la sécurité sociale, de la santé, de la famille et des migrations, du travail et de la formation professionnelle, de l'éducation et de la jeunesse, de la culture et des media, de la recherche et de l'innovation technologique, des sports ; de la sécurité publique et de la protection civile, aussi bien que d'autres matières y compris les symboles régionaux, hymnes et drapeau, les congés régionaux, la création d' ombudsmen régionaux, l'adoption de traitements supplémentaires pour la fonction publique régionale, les convocations pour les référendums régionaux, l'initiative citoyenne, aussi bien que les investissements étrangers et l'adoption de stimulants à l'investissement.
Les compétences indirectes des régions autonomes des Açores et de Madère sont encore plus vastes. Les statuts ouvrent le chemin pour la participation des autorités régionales aux organismes de prise de décision nationale s'occupant de matières susceptibles de les intéresser, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau international. Elles incluent le droit des régions de participer à l'élaboration des plans nationaux, à la définition et la mise en oeuvre des politiques fiscale et monétaire, à la définition des politiques au niveau des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et de la plateforme continentale adjacente aux archipels. Elles peuvent également participer à la définition des positions de l'État portugais dans le cadre de l'Union européenne pour des matières les intéressant, à la négociation des traités internationaux et des autres accords touchant leurs intérêts directs et d'administrer les bénéfices découlant de ces traités et accords. Cette participation au processus d'intégration européenne se fait à travers une représentation dans les organismes régionaux respectifs mais aussi dans le cadre des délégations nationales engagées dans les affaires européennes, chaque fois que des matières d'intérêt régional sont en jeu. D'ailleurs, les régions sont représentées dans une pluralité d'organismes nationaux comme le Conseil d'État, le Conseil supérieur de sécurité et défense et la Mission permanente du Portugal près de l'Union européenne.
Avec un tel large et ample spectre de compétences, l'autonomie régionale des Açores et de Madère connaît, pourtant, un triple talon d'Achille.
Tout d'abord, même s'il proclame et adopte des principes fondamentaux comme la subsidiarité et l'autonomie politique, le Portugal reste un État souverain unitaire, ce qui, historiquement, a conduit à une certaine obstruction de l'initiative législative régionale de la part de la Cour constitutionnelle, même s'agissant de matières identifiées par la Constitution et les statuts comme étant de la compétence régionale.
Ensuite, l'intégration politique européenne a profondément bouleversé l'autonomie régionale dans la mesure où la plupart des compétences régionales sont devenues de la responsabilité de l'Union, au niveau de l'agriculture, des pêches, de l'environnement, des transports et de l'enseignement, aussi bien que dans la presque totalité des matières attribuées aux régions. Dans un tel cadre, pour jouer le jeu de l'autonomie, les Açores et Madère se trouvent contraints de se projeter vers Bruxelles et les autres villes accueillant des institutions et organismes européens.
Enfin, la productivité économique réduite des régions et leur capacité, également réduite, de générer des ressources fiscales pour alimenter leurs plans de développement. Cette circonstance force les Açores et Madère à dépendre de la solidarité nationale, portugaise et européenne. Quelques chiffres simples suffisent pour illustrer cette réalité. Les transferts de l'extérieur, du gouvernement de la République et de l'Union européenne, représentaient 27 % du budget des Açores en 1989 et 34 % en 2012. Les chiffres pour Madère sont légèrement inférieurs : 15 % en 1989 et 16 % en 2012. Le PIB des Açores, en 1989, était à 81 % de la moyenne nationale et à 62 % de la moyenne européenne. En 2012, ces chiffres étaient déjà de 94 % de la moyenne nationale et de 71 % de la moyenne européenne. Madère a connu un développement encore plus intéressant. De 85 % du PIB national en 1989, la région est arrivée à 125 % en 2012. Et dans ces mêmes années elle est passée de 66 % à 95 % de la moyenne européenne.
En conclusion, je dirais que l'autonomie des Açores et de Madère est une réalité basée sur un double acte de volonté : celle des populations insulaires et celle des dirigeants nationaux portugais. Alors que cette volonté fut frustrée dans le cas des anciennes colonies africaines dont les peuples réclamaient non pas l'autonomie mais l'indépendance, la viabilité de l'autonomie dans le cas des archipels atlantiques découle du fait qu'elle fut un choix libre et correspondait à la volonté des Açores et de Madère.
Annie Fitte-Duval, Maître de conférences en droit public à l'Université de Pau et des pays de l'Adour - Autonomie régionale et identité politique en Espagne
La notion d'autonomie, largement représentée dans l'espace constitutionnel européen et international, n'a pas partout les mêmes implications. Aussi n'est-il pas inutile de rappeler une définition commune et extensive, celle de l'article 3.1 de la Charte de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe, selon laquelle l'autonomie locale est « le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ». Ainsi l'autonomie peut ne recouvrir qu'une forme de décentralisation poussée. Et le cas de l'Espagne est à cet égard particulièrement édifiant puisque l'article 137 du titre VIII de la Constitution, intitulé « De l'organisation territoriale de l'État » indique que : « L'État, dans son organisation territoriale, se compose de communes, de provinces et des Communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités 220 ( * ) jouissent d'autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs ». La lecture de l'article 137 ne semble pas accorder une signification particulière à l'autonomie des communautés. Mais les communautés autonomes bénéficient, contrairement aux collectivités locales que sont les communes et les provinces, d'une forme d'autonomie « politique » qu'incarne la notion d'autogouvernement, là où les communes et les provinces n'ont qu'une autonomie administrative dans le cadre de la loi, somme toute assez proche de la libre-administration reconnue aux collectivités territoriales françaises. C'est cette autonomie politique qui nous intéresse ici et que le Tribunal constitutionnel affirme dès 1981 en précisant la différence de nature constitutionnelle entre les communautés autonomes et les collectivités locales. C'est encore lui qui énonce les limites de l'autonomie politique dans l'arrêt du 28 juin 2010 sur le statut de la Catalogne.
Le modèle de monarchie parlementaire adopté par l'Espagne après le franquisme recherche l'équilibre entre deux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution, « la souveraineté nationale réside dans le peuple espagnol » et « le droit à l'autonomie des régions et des nationalités », reconnaissant l'unité du peuple et l'unicité de la nation espagnole, d'une part, et la diversité des composantes de cette nation, d'autre part.
L'autonomie régionale espagnole renvoie en effet à une conception diversifiée et asymétrique tant dans sa dimension statutaire que dans la reconnaissance des compétences et des moyens financiers des communautés. L'homogénéité statutaire n'existe pas davantage qu'une stricte répartition des compétences et des moyens.
La Constitution espagnole consacre son titre?VIII à l'organisation territoriale de l'État, et y distingue trois chapitres énonçant respectivement les principes généraux, les règles afférentes à l'autonomie locale (art.?140 à 142) et celles propres aux communautés autonomes (art.?143 et? s.). Reposant sur un principe de différenciation institutionnelle, l'organisation territoriale instituée par la Constitution de 1978 n'induit pas pour autant une forme d'État spécifique puisqu'aussi bien la formule constitutionnelle pourrait s'accommoder d'un État décentralisé ou d'un État fédéral. C'est une construction intermédiaire, un modèle original d'État qualifié d'État autonomique ou d'État des autonomies « à mi-chemin entre État unitaire et État fédéral » qui a été généralisé sur l'ensemble du territoire espagnol. Nous tenterons dans le cadre temporel limité qui nous est imparti d'en dégager quelques traits caractéristiques en présentant, en premier lieu, les particularités de l'État des autonomies (I) avant d'aborder le particularisme des autonomies dans l'État (II).
I. - Particularités de l'État des autonomies
Depuis 1983, l'ensemble du territoire est couvert par les communautés autonomes qui sont au nombre de 17. Si la Constitution prévoit un cadre commun pour ces communautés, elle leur laisse néanmoins une importante marge de manoeuvre qui n'exclut pas le contrôle.
A. Les fondements constitutionnels de l'État des autonomies
Sur le fondement de l'article?143 de la Constitution disposant que les régions « pourront accéder à leur autogouvernement et se constituer en Communautés autonomes ?», les dix-sept entités territoriales décident toutes de se constituer comme telles, réalisant ainsi ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler l'État des autonomies 221 ( * ) . L'utilisation du pluriel tend aussi à souligner la variabilité des situations. Le contenu de l'autonomie n'est pas défini et la Constitution permet d'identifier tout au plus des fonctions nécessaires de l'autonomie, ou plutôt des autonomies, car les pouvoirs varient sensiblement d'une communauté à l'autre.
1. Un processus apparemment souple
Une première remarque s'impose : la faculté de s'ériger en communautés autonomes a été utilisée par toutes les composantes régionales, dans le temps imparti par la Constitution. Si la période d'accès se concentre sur les cinq années qui suivent l'adoption de la Constitution, entre 1979 et 1983, la naissance et le développement des communautés autonomes ne s'effectue ni en même temps, ni de la même façon.
Les modalités d'accès à l'autonomie prévues par le titre VIII de la Constitution de 1978 sont en effet diversifiées et de nature à faciliter cet accès. Quatre procédures sont prévues dans la Constitution pour y parvenir : la procédure dérogatoire utilisée pour les « Communautés historiques » dispensées de formalités d'initiative (art. 143 §1), la procédure normale (art. 143§2) soumise à l'initiative des conseils généraux et à des conditions de majorité, la procédure spéciale dite de « voie rapide » (art. 151 CE) qui permet l'exercice immédiat des compétences mais est soumise en contrepartie à des conditions plus strictes d'initiative et, en dernier lieu, un « parcours institutionnel », procédure exceptionnelle faisant seulement intervenir le Parlement (art. 144 CE).
Le processus autonomique se révèle par ailleurs éminemment flexible à différents égards. En premier lieu, parce que la Constitution n'énumère pas les Communautés autonomes qui composent l'État et ouvre une simple faculté de création, renvoyant pour cela essentiellement à l'initiative des provinces, et se bornant à en dégager les grands axes. L'initiative appartient selon l'article 143.2 aux conseils généraux qui sont les organes délibérants des provinces. Mais les communautés constituées bénéficient d'une réelle autonomie politique.
2. Une véritable autonomie politique
Chaque communauté autonome se présente sur la base de l'article 143 de la Constitution, comme une entité constituée par une province ou un groupe de provinces, dotée de l'autonomie politique et régie par un statut lui accordant des institutions et des compétences particulières. Sa légitimité repose sur la Constitution elle-même qui affirme notamment dans l'article 147-1 que « Les statuts d'autonomie seront la norme institutionnelle fondamentale de chaque Communauté autonome et l'État les reconnaîtra et les protégera comme partie intégrante de son ordre juridique ».
Autonomes politiquement, les communautés bénéficient d'organes propres dont l'article 152 de la Constitution espagnole prévoit l'architecture générale en précisant que « dans les statuts approuvés... l'organisation institutionnelle autonome se fondera sur une assemblée législative élue au suffrage universel, suivant un système de représentation proportionnelle qui assurera, en outre, la représentation des différentes zones du territoire, un Conseil de Gouvernement qui exercera les fonctions exécutives et administratives et un président, élu par l'assemblée parmi ses membres et nommé par le Roi, qui sera chargé de diriger ledit Conseil de Gouvernement ». La Constitution prévoit aussi le principe d'une responsabilité politique du président et des membres du Conseil de Gouvernement devant l'assemblée. Il appartient donc aux communautés d'adopter leurs statuts, de déterminer leurs propres lois électorales, ainsi que de préciser leurs compétences dans les limites fixées par la Constitution.
3. L'affirmation de compétences ouvertes et d'une autonomie financière protégée
La question des compétences demeure très ouverte. Les pouvoirs énoncés par l'article 148 auxquels ont accès les Communautés autonomes sont optionnels, et englobent une liste importante de matières comme l'organisation des institutions du gouvernement autonome, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le logement, la santé, l'hygiène... Les communautés bénéficient de ce fait d'un vivier de compétences, dans lequel elles peuvent puiser à leur guise. Les compétences qu'elles ne choisissent pas demeurent règlementées au niveau national.
L'État bénéficie pour sa part d'une réserve de compétence, prévue à l'article 149 plus traditionnelle dans son contenu puisqu'elle se fonde sur les missions qui lui sont classiquement dévolues dans les systèmes autonomiques, ou qui reviennent à l'État fédéral dans les systèmes fédéraux. Il s'agit principalement de l'exercice de fonctions régaliennes traditionnelles, (« relations internationales », « défense et forces armées », « administration de la justice ») ; de la protection des droits fondamentaux 222 ( * ) , de la mission de garant de la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire et de la transposition harmonieuse du droit communautaire dans le droit interne.
L'autonomie politique des Communautés est indissociable de l'autonomie financière. Le principe de celle-ci est posé par l'article 156 de la Constitution espagnole qui précise que « Les Communautés autonomes jouiront d'une autonomie financière pour le développement et la mise en oeuvre de leurs compétences dans le respect des principes de coordination avec les finances étatiques et de solidarité entre tous les Espagnols ». Les communautés autonomes approuvent leurs propres budgets, sans ingérence de l'État. Ce principe d'autonomie financière implique des ressources suffisantes, pour assurer les compétences reconnues, une liberté de gestion de ces ressources, et la détention d'un pouvoir décisionnel en matière fiscale qui permet aux communautés de créer leurs propres impôts, d'en fixer le régime et d'en assurer le recouvrement. Cette coresponsabilidad fiscal est une dimension concrète de la responsabilité et du pouvoir politique, qui doit cependant se concilier avec le respect de la Constitution espagnole et des lois, et notamment du principe de légalité fiscale issu des articles 31, paragraphe 3, et 133 de la Constitution ainsi que des dispositions de la LOFCA 223 ( * ) qui exclut toute forme de privilège économique ou social sur le territoire espagnol. La loi organique 2/2012 du 27?avril 2012, portant stabilité budgétaire et viabilité financière, en réponse à la crise économique, a renforcé la position du gouvernement de l'Espagne et imposé des contraintes nouvelles sur le plan fiscal et budgétaire aux communautés autonomes et aux municipalités notamment pour le respect des engagements budgétaires exigés par l'Union européenne.
La plasticité du système de répartition des compétences n'exclut cependant pas le contrôle.
B. L'État des autonomies et le contrôle des autonomies
Les décisions des communautés font l'objet de divers contrôles, prévus par la Constitution.
1. La diversité des contrôles
On peut souligner l'existence d'un contrôle de constitutionnalité exercé par le Tribunal constitutionnel sur les actes « ayant forme de loi », d'un contrôle du gouvernement sur les actes pris dans les matières déléguées, d'un contrôle juridictionnel administratif sur les actes réglementaires et d'un contrôle financier exercé par la Cour des comptes. Le délégué du gouvernement placé dans chaque communauté autonome, y exerce les fonctions de représentation de l'État et coordonne les missions étatiques et communautaires mais il n'a pas de pouvoir direct de contrôle sur la communauté autonome (art. 153 et 154 de la Constitution).
La fonction d'arbitre assurée par le Tribunal constitutionnel l'a conduit à préciser par son interprétation constructive les caractéristiques de l'État des autonomies, mais aussi le positionnement des communautés autonomes.
2. L'interprétation constructive du Tribunal constitutionnel
Au sommet du système constitutionnel et garant de l'État de droit, le Tribunal constitutionnel espagnol, en vertu de l'article 161.1 de la Constitution, connaît des conflits de compétence entre l'État espagnol et les Communautés autonomes ou entre ces dernières, et connaît aussi des recours contre les statuts. Il a ainsi dû préciser le contenu des normes qui énoncent la répartition des compétences entre l'État et les Communautés autonomes et qui sont contenues dans la Constitution comme dans les statuts d'autonomie. Le Tribunal constitutionnel intervient aussi selon une procédure complexe, et donc utilisée avec parcimonie, dans les conflits entre communautés autonomes et collectivités locales, par l'intermédiaire du recours en défense de l'autonomie locale 224 ( * ) qui peut être introduit contre toute disposition législative ou à portée législative, émanant de l'État ou d'une communauté autonome et portant atteinte à l'autonomie locale constitutionnellement garantie.
L'arrêt du 28 juin 2010 rendu par le Tribunal constitutionnel espagnol concernant le statut de la Catalogne est à ce titre particulièrement illustratif de la fonction régulatrice exercée par le Tribunal. Saisi d'un recours dirigé contre le statut adopté par la Communauté catalane dans la loi organique du 19 juillet 2006 portant réforme du statut d'autonomie de la Catalogne, le Tribunal clarifie la fonction et le contenu propres des statuts d'autonomie ainsi que leur positionnement par rapport à la Constitution et aux autres normes de l'ordre juridique.
C'est l'occasion pour lui de rappeler notamment que les statuts des communautés autonomes, en tant que normes subordonnées à la Constitution, font aussi partie de l'ordre juridique étatique, d'où la nécessité de leur ratification par le parlement national à la majorité qualifiée.
Toutefois, le contenu de ces statuts rend compte du particularisme des autonomies dans l'État.
II. - Le particularisme des autonomies dans l'État
Même s'il existe un noyau dur commun aux communautés autonomes, les statuts de celles-ci sont marqués par la diversité et se caractérisent par une échelle des particularités qui se manifeste tant à travers les modalités d'accès à l'autonomie que dans les manifestations structurelles de celle-ci. La Constitution reconnaît un droit au particularisme justifié notamment par les traits différentiels qui concourent à l'identité politique, mais ce sont les statuts qui en établissent le contenu.
A. Un particularisme statutaire revendiqué au nom de l'identité propre des communautés
1. Un particularisme différencié et évolutif
Le premier facteur de différenciation est historique : Les trois premières Communautés, le Pays basque, la Catalogne et la Galice 225 ( * ) qualifiées de communautés historiques, ont accédé à l'autonomie par la voie de l'article 143 §1 de la Constitution. Elles ont été suivies par l'Andalousie, la Navarre, Valence et les Canaries qui ont accédé par la voie de l'article 143 §2 (qui prévoit des lois organiques étatiques de transfert et de délégation de compétences). L'ensemble constitue les Communautés dites de premier niveau ou de régime spécial qui ont bénéficié de l'essentiel des compétences, prévues à l'article 149-1 de la Constitution. Les trois communautés historiques ont bénéficié en outre, dès l'origine, de compétences accrues fondées sur les « faits différentiels » qui caractérisent la situation de ces territoires dotés de traits culturels et historiques spécifiques reconnus et mentionnés par la Constitution 226 ( * ) . Les dix autres communautés autonomes, dites de second niveau ou de régime ordinaire, ont accédé à l'autonomie par la voie de l'art. 151 de la Constitution, qui prévoit un accès plus rapide à l'ensemble des compétences, mais plus contraignant en termes de majorité et soumis à l'organisation de referendums.
Au-delà de l'aspect chronologique, les différences statutaires sont notables au sein des communautés historiques. Certaines communautés autonomes se sont pourvues de compétences très larges. La coresponsabilidad fiscal n'est pas partout développée. Les communautés forales disposent d'un régime financier dérogatoire au régime de droit commun 227 ( * ) . C'est le cas non seulement pour les Îles Canaries, en raison de ses spécificités géographiques (bien compréhensibles), mais également pour le Pays Basque et la communauté de Navarre. Les situations financières sont très différentes même si elles ont, dans l'ensemble, évolué négativement avec la crise économique qui contraint le pouvoir central à instaurer, en septembre 2011, une « règle d'or » dans la Constitution espagnole imposant le respect du principe de stabilité budgétaire. La loi organique du 27 avril 2012 a renforcé le contrôle sur les budgets et comptes autonomiques en même temps que le pouvoir de sanction des Communautés.
Mais les différences sont aussi largement nourries des particularismes identitaires.
2. Des particularismes étroitement liés au sentiment identitaire
Si l'identité d'une personne ou d'un groupe est ce qui fait son individualité, ou sa singularité 228 ( * ) , le contenu des statuts des autonomies permet d'approcher la représentation que se font de leur identité les populations concernées.
Un premier constat s'impose à cet égard : il existe une ligne de fracture entre les communautés historiques et les autres. Les régions Basque et Catalane sont à la fois les deux régions les plus riches d'Espagne et celles qui revendiquent une identité régionale historiquement bien établie et non contestée sur le fond, par le pouvoir espagnol. Cette spécificité reconnue fait appel à la notion de « faits différentiels ». Ceux-ci ont une grande importance politique, au point de fonder sur le plan constitutionnel la création d'une communauté autonome, et ils ont incontestablement une incidence sur d'autres compétences autonomiques. Ainsi, la langue catalane a été un des fondements des revendications en faveur de l'autonomie de la Catalogne et a entraîné dans son sillage des compétences en matière éducative et culturelle.
Langues officielles aux côtés du castillan, les langues basques, catalanes et galiciennes ont obtenu un statut particulier au sein de l'Union européenne, où tout demandeur peut s'exprimer dans l'une de ces trois langues grâce à des traducteurs financés par l'État espagnol.
La référence aux « faits différentiels » a aussi nourri le discours différentialiste et les luttes des partis nationalistes implantés dans certaines communautés autonomes pour défendre leur différence par rapport à d'autres communautés. Dans ces communautés, les partis politiques défendent, au-delà des clivages politiques traditionnels, des intérêts supérieurs, ceux de leur région. Avant d'appartenir à une famille politique, les partis représentent la population de leur communauté ce qui crée de grandes divergences entre les régions au sein des mêmes partis politiques. Mais le nationalisme catalan se distingue du nationalisme basque en ce qu'il se présente de manière plus homogène 229 ( * ) et est intégré de manière moins conflictuelle par une grande majorité de la société catalane qui manifeste une volonté de vivre ensemble au sein d'un même territoire, en partageant une culture et une langue communes. Le Pays basque et la Catalogne ne veulent d'ailleurs pas uniquement se voir reconnaître un statut particulier par rapport à l'État espagnol, mais aussi par rapport à l'Union européenne et au Conseil de l'Europe, en s'inscrivant ainsi dans une démarche visant à la construction d'une « Europe des régions ».
D'autres communautés autonomes entendent aussi marquer leur différence : ainsi le statut andalou, même s'il affirme la reconnaissance de l'Andalousie comme « une réalité nationale », semble moins orienté vers la reconnaissance d'une distinction culturelle ou linguistique et met surtout en avant sa dimension citoyenne et sociale, en reconnaissant notamment libertés et droits fondamentaux de créance (droit à l'éducation, droit à une rente de base, droit au logement, droit de libre orientation sexuelle).
La concurrence entre les communautés est en tout cas une réalité qui façonne l'évolution statutaire.
B. Une évolution statutaire sur fond de concurrence
La Constitution prévoit la possibilité, au terme d'une période de cinq ans, de modifier les statuts. Et cette disposition a fondé une émulation qui s'apparente parfois à de la surenchère 230 ( * ) . On observe d'ailleurs que la majorité des recours en inconstitutionnalité déposés contre les statuts d'autonomie réformés l'ont été à l'initiative de communautés autonomes voisines quand bien même ces dernières sont gouvernées par le même parti politique 231 ( * ) .
Cinq ans après l'approbation de leurs statuts, les dix communautés autonomes ont entrepris de les réformer afin d'acquérir de nouvelles compétences et de se mettre ainsi au même niveau que les sept premières 232 ( * ) . Cette démarche a contribué à une homogénéisation provisoire car elle a été compensée par une nouvelle démarche des communautés de premier niveau qui ont relancé le processus statutaire en vue de recréer la distance avec les communautés ordinaires. Les partis politiques sont au coeur de cette course à la différenciation dont les exemples concrets ne manquent pas.
Le préambule de la proposition de réforme statutaire déposée par le Gouvernement autonome basque en 2003 dispose que « Le Peuple basque ou Euskal Herria est un peuple doté d'une identité propre dans l'ensemble des peuples d'Europe, dépositaire d'un patrimoine historique, social et culturel singulier, qui se trouve géographiquement dans sept territoires, actuellement articulés sur trois ensembles juridico-politiques différents, situés dans deux États. Le peuple basque a le droit de décider de son propre avenir... » Le Pays basque se prononce clairement en faveur de l'autodétermination, et d'une « libre association » avec l'Espagne.
L'exemple catalan est également probant. Dans la mesure où la Constitution espagnole différencie la nation espagnole des régions et nationalités qui la composent, le terme de « nationalité » avait été à l'origine introduit dans la Constitution afin de distinguer la Catalogne, le Pays basque et la Galice du reste de l'Espagne. Mais, en 1996, d'autres Communautés autonomes ont introduit ce terme dans leur statut. Aussi la Catalogne a-t-elle voulu franchir une nouvelle étape pour se distinguer de ces nationalités émergentes, jugeant le terme « nationalité » insuffisant pour qualifier sa différence. Elle s'empare dans l'article 1 er du nouveau statut catalan, du terme de nation énonçant que « La Catalogne est une nation constituée en tant que communauté autonome en accord avec la Constitution et le présent statut ».
La démarche initiée par la communauté catalane a été en tout cas partiellement censurée par le Tribunal constitutionnel dont la sentence du 28 juin 2010 a instauré au moins provisoirement quelques limites à l'audace identitaire des communautés autonomes. Si le Tribunal ne conclut à aucune inconstitutionnalité des dispositions relatives à la nation catalane, au peuple catalan, à ses droits historiques et à ses symboles, il retient une conception éclatée de la nation catalane, dont il reconnaît l'existence dans ses dimensions culturelle, historique, linguistique ou sociologique tout en lui niant un sens juridique et constitutionnel, qu'il attache à la seule nation espagnole. Il rappelle le caractère de subordination du statut à la Constitution et censure l'usage préférentiel de la langue catalane dans l'administration ainsi que la création d'un conseil de justice propre à la Catalogne en contradiction avec la compétence de l'État espagnol. L'objectif est visiblement de « couper court à toute prétention d'entendre les expressions nation (dans le préambule), droits historiques et peuple catalan (dans le statut) comme génératrices pour le statut de la Catalogne d'une source de légitimité propre et historique, antérieure et distincte de la Constitution de 1978 » 233 ( * ) .
L'adoption du nouveau statut catalan, somme toute assez modestement censuré par le Tribunal constitutionnel, a suscité d'importantes réactions et des manifestations locales contestant la sentence. Il a surtout donné le signal d'une nouvelle vague de réformes des statuts d'autonomie conduisant à modifier, par exemple, les statuts de l'Andalousie, de Valence, des îles Baléares, d'Aragon et de Castille et Léon. À cet égard, nombre d'observateurs soulignent que l'organisation territoriale de l'État risque de demeurer instable tant que le système constitutionnel n'aura pas instauré une stricte et définitive répartition des compétences entre l'État et les communautés autonomes. Mais ne serait-ce pas alors la fin de l'État des autonomies ?
Hervé Rihal, Professeur de droit public à l'Université d'Angers - Autonomie locale et action sociale
La décentralisation permet de donner à des entités, le département en l'occurrence et notamment le président du conseil général et, à un moindre degré, la commune, des pouvoirs quelquefois insoupçonnés, y compris de juristes qui méconnaissent l'action sociale, pouvoirs qui lui permettront d'avoir prise sur un certain nombre de décisions importantes. Toutefois, cette décentralisation connaît des limites, sans parler des limites financières, ce qui nous prendrait beaucoup trop de temps.
L'aide et l'action sociale ont été largement décentralisées, notamment au travers de la loi de répartition des compétences du 22 juillet 1983 complétée par la loi particulière à l'action sociale du 6 janvier 1986. L'acte II de la décentralisation a également fortement concerné l'action sociale départementale avec la loi du 18 décembre 2003 décentralisant intégralement le revenu minimum d'insertion, celle du 13 août 2004 qui fait du département le chef de file de l'action sociale et gérontologique, celle du 1 er décembre 2008 qui crée le revenu de solidarité active. Enfin, l'acte III de la décentralisation n'abandonne pas pour l'instant le rôle social du département puisque la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 définit son rôle à l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales. Le département est chargé, en tant que chef de file, d'organiser les modalités de l'action commune pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale, au développement social et à la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l'autonomie des personnes et la solidarité des territoires. La commune est chef de file pour l'organisation des services publics de proximité.
Il ne nous appartient pas de définir l'autonomie locale, notion largement explorée au cours de ce colloque. En revanche, l'action sociale se définit selon le code de l'action sociale et des familles, article L. 116-1, comme l'action tendant à « promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ».
L'action sociale repose pour les départements sur quatre branches principales dont le coût total est évalué à environ 37 milliards d'euros : l'aide sociale à l'enfance et la protection maternelle et infantile, l'aide sociale aux personnes âgées, l'aide sociale aux personnes handicapées, l'aide aux personnes en situation précaire grâce au RSA et au fonds de solidarité logement. L'aide sociale représente environ 60 % des budgets départementaux.
Le département se voit octroyer des pouvoirs considérables avec, tout de même, les limites inhérentes au fait que la France demeure un État unitaire et égalitariste dont l'élément central ou déconcentré reste doté d'importantes prérogatives.
I. - Des pouvoirs considérables
Il conviendra à ce stade de distinguer, pour en faire un rapide inventaire, les pouvoirs du président du conseil général et ceux de l'assemblée départementale. Mais la commune, avec son centre communal d'action sociale, qui existe théoriquement dans toutes les communes mais n'a de réalité que dans les communes grandes ou moyennes, revendique aussi une forte autonomie dans le domaine social.
A. Les pouvoirs du président du conseil général
En ce qui concerne le règlement de la situation des enfants ayant fait l'objet d'un signalement aux services de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général dispose d'un véritable pouvoir de « police sociale ». Il doit faire procéder à des investigations. Le département pourra moduler son aide qui peut aller du simple versement d'une allocation temporaire à une intervention éducative à domicile, jusqu'à la décision de placement. Évidemment, la décision de retrait de l'autorité parentale plaçant l'enfant échoit au juge judiciaire, le président du conseil général ne pouvant recueillir des enfants qu'avec le consentement des parents.
Le département doit pour cela s'appuyer sur un réseau de prestataires (foyers de l'enfance, maisons d'enfants à caractère social, assistants familiaux, etc.). Près de 200 000 enfants étant aujourd'hui placés, il s'agit d'un pouvoir très important. Il a également le pouvoir de saisir le parquet et le juge des enfants. Il possède ainsi un pouvoir d'appréciation et de régulation de l'action sociale en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance.
Le président de l'assemblée départementale dispose également d'un pouvoir de police méconnu par le biais du pouvoir d'agrément dans trois domaines. Il s'agit d'abord d'agréer des familles qui souhaitent adopter un enfant (Art. L. 225-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles). Ce pouvoir met le président du conseil général face à des cas difficiles ayant entraîné un contentieux délicat. Le motif unique du refus est le respect de l'intérêt de l'enfant. Il donne lieu à des débats de société d'importance considérable en ce qui concerne notamment les témoins de Jéhovah auxquels l'agrément est systématiquement refusé dans l'intérêt de la santé de l'enfant à cause des refus de transfusions sanguines et les célibataires homosexuels pour lesquels la France a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme le 22 janvier 2008.
Ce pouvoir d'agrément concerne également les assistants familiaux qui gardent à leur domicile les enfants de l'aide sociale, mais aussi les assistants maternels, pourtant majoritairement salariés de droit privé employés par les particuliers (Art. L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles). Le département a donc le pouvoir d'autoriser ou non le travail de salariés de droit privé auprès de particuliers.
Il agrée enfin (Art. L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) les accueillants familiaux qui peuvent recueillir à domicile des personnes âgées ou handicapées sans être pour autant salariés.
Ajoutons que l'autorisation sur appel à projets de création des établissements sociaux et médico-sociaux est du ressort du président du conseil général lorsqu'elle concerne sa compétence. Le contrôle de ces établissements, pouvant aller jusqu'à la fermeture, fait également partie de ses missions. Ces pouvoirs concernant les établissements sociaux sont exercés par le seul président du conseil général mais, lorsqu'il s'agit d'établissements médico-sociaux, ils sont exercés conjointement avec les agences régionales de santé.
En ce qui concerne le cas spécifique des personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 a créé un groupement d'intérêt public départemental obligatoire, la maison départementale des personnes handicapées, dont la commission exécutive est présidée par le président du conseil général qui en assure la tutelle.
Ces importants pouvoirs sont bien souvent délégués - sans doute trop souvent - par le président à ses collaborateurs, élus ou cadres administratifs ou sociaux.
B. Les pouvoirs réservés à l'assemblée départementale
Le premier des pouvoirs qui lui sont réservés est un important pouvoir de planification (Art. L. 312-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles). L'assemblée départementale doit adopter les schémas départementaux, lesquels sont opposables et serviront de base à la création d'établissements. Concrètement, il n'y aura pas d'appels à projets si la création ou la transformation de l'établissement n'est pas prévue par le schéma départemental. Ce pouvoir de planification concerne les établissements pour lesquels le département est compétent afin d'en assurer le contrôle et s'opère en concertation avec les services de l'agence régionale de santé.
C'est aussi cette assemblée qui adopte le règlement départemental d'aide sociale, lequel permet d'accorder des aides supplémentaires par rapport aux aides obligatoires, sans pouvoir remettre celles-ci en cause (Art. L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles). Autrement dit, ce règlement ne peut qu'améliorer les prestations et non aggraver leurs conditions d'obtention. Ce règlement conduira bien évidemment à des inégalités territoriales. Quand on est pauvre, il vaut mieux habiter dans les Hauts-de-Seine que dans le Pas-de-Calais ou la Seine-Saint-Denis ! Il y a des départements qui poursuivent davantage les fraudes au RSA, qui le suspendent et demandent à récupérer les sommes indûment versées, et d'autres qui font l'objet d'une vigilance moindre. Il y a aussi des départements qui mettent en oeuvre la récupération des dépenses d'hébergement des personnes âgées sur les héritiers, d'autres qui préfèrent « fermer les yeux », souvent pour des raisons électoralistes inavouées.
C. L'autonomie du Centre communal d'action sociale
Outil de la commune, le CCAS présente la particularité d'être un établissement public communal dont le conseil d'administration est composé à parité d'élus et de représentants de quatre catégories d'usagers, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles, les personnes en difficulté. C'est le maire qui le préside et fait « pencher la balance » en faveur des élus en cas de divergence.
Plus encore que le département dont la marge financière est aujourd'hui très faible, le CCAS - principalement dans les villes grandes ou moyennes - peut mener une véritable politique d'action sociale envers les populations défavorisées : organisation de sorties familiales, aide aux vacances, aux classes de découverte, à la prise en charge des frais de cantine, d'activités sportives ou culturelles. Il est également gestionnaire d'établissements sociaux voire médico-sociaux que sont les logements-foyers. Il est en première ligne pour le portage des repas à domicile, l'aide alimentaire, ou encore le micro-crédit.
L'imagination est au pouvoir pour inventer des modalités d'aides concernant les populations défavorisées et le CCAS joue un rôle particulier lorsque se produisent des catastrophes. Dans son action, il est bien sûr encadré par le respect de la légalité et notamment de deux principes cardinaux, l'égalité et la liberté du commerce et de l'industrie. Il est en tout cas une expression de l'autonomie locale.
Pourtant, malgré son importance et ses nombreux aspects, force est de constater que cette autonomie rencontre diverses limites.
II. - Une autonomie en réalité très limitée
Suivant l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, « le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ». Ces limites à l'autonomie sont dues à l'application du principe d'égalité mais aussi aux compétences conjointes avec l'ARS et à la « fièvre contentieuse » à laquelle n'échappent pas les usagers de l'action sociale départementale et communale.
A. L'égalité, limite à l'autonomie de l'action sociale des collectivités territoriales
C'est le législateur qui fixe un certain nombre de conditions et de montants pour les prestations sociales qui ressemblent aujourd'hui bien davantage à des prestations de sécurité sociale. Ainsi, il n'est pas possible d'allouer différemment l'allocation personnalisée d'autonomie, le RSA ou la prestation de compensation du handicap d'un département à l'autre. Prenons simplement l'exemple de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles précise qu'elle est accordée « dans les limites des tarifs réglementaires ». Il s'agit de faire application d'une grille évaluant la dépendance. De même, les modalités du plan d'aide et le barème de l'APA sont fixés sur le plan national. Ceci signifie que les différences existant dans l'appréciation des conditions d'octroi de l'aide ne tiennent qu'à des questions d'opportunité et qu'il n'est pas certain qu'il y ait de grandes différences avec l'attribution d'une aide d'État où l'on sait très bien que, d'un département à l'autre, dans le domaine agricole notamment, il existe des différences importantes, alors même que l'aide est accordée par des autorités déconcentrées. Ainsi, les textes sont si précis et détaillés qu'aucune marge n'est en réalité laissée aux départements dans l'octroi des aides.
B. Les compétences conjointes
L'autonomie est également limitée par la persistance de nombreuses compétences conjointes. Ainsi, le président du conseil général reçoit des compétences conjointes avec le directeur général de l'ARS dans le domaine médico-social. On retrouve cette compétence conjointe avec le préfet dans le domaine de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger. Les présidents de conseils généraux doivent donc composer avec les directeurs généraux des ARS. Cette concertation s'imposera au niveau de la planification, de la commission d'appels à projets qui sera coprésidée par ces deux autorités et aboutira à l'autorisation, acte conjoint du département et de l'État qui pose bien des questions juridiques encore non résolues. De même, dans les secteurs médico-social et de l'enfance délinquante ou en danger, le contrôle et la fermeture des établissements sont des pouvoirs de police exercés conjointement, même si le préfet, au nom de l'État, peut toujours « prendre la main » en contrôlant seul l'établissement ou en opérant sa fermeture.
On peut ajouter qu'en matière d'aide sociale à l'enfance, le département n'a bien souvent d'autre choix que d'exécuter les décisions du juge des enfants qui lui confie un enfant ou lui donne l'ordre d'organiser une action éducative en milieu ouvert à son profit.
En réalité, grâce à sa compétence technique et au fait qu'elle revêt le statut d'établissement public de l'État, l'ARS dispose d'un pouvoir plus grand que celui du département.
C. L'action sociale « contaminée » par la « fièvre contentieuse »
La dernière limite tient à ce que l'on peut appeler la « fièvre contentieuse ». C'est ainsi que le juge administratif ordinaire est désormais chargé du contrôle en matière de RSA et de nombreuses décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il a aussi à connaître de redoutables affaires concernant les assistants familiaux et maternels, lorsque, notamment, l'entourage de ceux-ci est accusé d'abus sexuels sur les enfants confiés.
Subsistent également encore aujourd'hui deux types de juridictions très particulières. Il s'agit en premier lieu des tribunaux régionaux et de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en deuxième lieu, des juridictions de l'aide sociale, bien qu'elles aient été quelque peu « dépecées » par deux questions prioritaires de constitutionnalité en 2011 et 2012.
En conclusion, l'on parle de département providence dans le même temps où l'on entend le supprimer, ce qui est assez curieux. En outre, on peut espérer que les binômes de conseillers départementaux qui seront élus en 2015 seront de nature à renforcer le rôle des élus en matière d'action sociale. Ils marqueront en effet - ne serait-ce que par la présence de nombreuses femmes au sein des futurs conseils départementaux - un réinvestissement de l'élu dans l'action sociale, ce qui nous paraît tout à fait souhaitable compte tenu du « relâchement » observé ces dernières années chez les élus dans ce domaine.
L'on imagine en effet fort bien que l'un des membres du binôme soit choisi par les partis politiques pour son expertise en matière sociale. Peut-on alors espérer un renouveau du rôle des élus dans l'action sociale ?
ATELIER 3 - AUTONOMIE LOCALE, QUELS MOYENS POUR L'OUTRE-MER ? - Sous la présidence de Valentin Josse
Valentin Josse, Conseiller général de la Vendée - Autonomie locale, quels moyens pour l'outre-mer ?
Nous avons défini ce matin, non sans difficulté, la notion juridique, administrative et politique de l'autonomie locale dans ses déclinaisons continentales, européennes, insulaires et même départementales.
D'un point de vue pratique, j'observe un double mécanisme de décentralisation et de concentration qui éloigne et restreint les relations entre l'État et les collectivités. La décentralisation s'exécute par de nouvelles compétences, charges et matières sans les transferts de moyens y correspondant. Cela peut atteindre l'équilibre financier des collectivités en question.
Nous avons également débattu de la clause de compétence générale. Du point de vue des moyens, il est à noter que la suppression de la clause générale de compétence conduirait à la fin des financements croisés, essentiels au portage des projets des collectivités.
Nos intervenants vont développer, dans le cadre de cet atelier, la question des intérêts financiers sous ses différents aspects.
Antoine Delblond, Professeur de droit public à l'Université de Nantes - Autonomie dans la propriété des personnes publiques outre-mer
Par finalité, l'autonomie locale vise une administration proche de l'usager et mieux adaptée pour régler des affaires d'intérêt local. Une collectivité territoriale autonome conforte sa légitimité lorsqu'elle s'avère plus efficace que l'État dans l'administration du territoire et des hommes. Tel serait le cas de la gestion locale autonome de la propriété des personnes publiques.
S'il est un domaine où toutes les administrations doivent fortement s'impliquer aujourd'hui, c'est la préservation de l'environnement et de la ressource naturelle. En particulier la protection de l'eau comme source de vie, élément indispensable de notre environnement quotidien, lieu d'activités professionnelles, etc.
À plus forte raison, dans l'environnement insulaire des collectivités d'outre-mer, la gestion de l'eau est une question cruciale, à laquelle les collectivités ne peuvent pas rester indifférentes. L'autonomie locale dans la propriété des personnes publiques pourrait conduire à une gestion rationnelle et avisée de l'eau dans la perspective d'un développement durable.
À cet égard, le droit positif opère de nombreux transferts étatiques, qui donnent à ces collectivités autant de compétences non négligeables en la matière. Reste à mettre en place les moyens d'une véritable politique de développement local.
I. - Administration territoriale autonome de la ressource en eau
Avec la décentralisation, appuyée par le nouveau code de la propriété des personnes publiques, l'administration des eaux domaniales passe progressivement de l'État vers les collectivités territoriales
Dans l'administration de l'eau domaniale, l'État choisit une première forme de décentralisation, par des établissements publics. Les Voies navigables de France administrent le domaine constitué par les voies navigables (8 500 kilomètres). Les agences financières de bassins, créées par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, sont requalifiées ultérieurement en agences de l'eau. Elles réalisent des opérations d'intérêt commun dans les bassins : équilibre des ressources, qualité des eaux, protection contre les inondations.
Ensuite, l'État partage avec les collectivités territoriales la gestion des cours d'eau, domaniaux ou non domaniaux, qui demeurent propriété étatique. Avec l'accord du préfet, ces collectivités interviennent de façon subsidiaire sur le domaine : entretien des cours d'eau, aménagement et exploitation de barrages-réservoirs, exploitation de canaux et digues de protection contre les crues.
La décentralisation fait des collectivités des propriétaires du domaine public fluvial. Elles sont donc amenées à administrer de plus en plus les eaux domaniales. Avec toutefois une adaptation dans les collectivités d'outre-mer.
La loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État autorise les régions intéressées à administrer le réseau fluvial de l'État ainsi que les ports situés sur ces voies. Ce fut le cas des régions Bretagne, Pays de la Loire et Picardie, à des fins essentiellement touristiques.
L'acte II de la décentralisation accentue le transfert du domaine public fluvial de l'État vers les collectivités territoriales ou leurs groupements. C'est le cas avec la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, mais également la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Viennent ensuite le décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'État et des collectivités, et la circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en oeuvre du transfert du domaine public fluvial de l'État vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
Sur ce fondement légal et réglementaire, les collectivités peuvent constituer leur domaine par classement ou par transfert de l'État.
Outre-mer, la législation comporte des adaptations puisque toutes les eaux stagnantes ou courantes appartiennent à l'État, à l'exception des eaux pluviales. De même, par dérogation aux dispositions du code civil, les eaux souterraines lui appartiennent également. Pour administrer cette ressource rare, la loi sur l'eau du 3 janvier 1964 institue des comités de bassins. La décentralisation permet d'aller plus loin. La loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer institue un office de l'eau, établissement public local placé sous la tutelle du conseil général.
II. - Développement territorial autonome de la ressource en eau
Le développement d'une propriété publique territoriale permet d'envisager un projet de développement local autour de la ressource en eau. À cet égard, les collectivités subissent des obligations, pour insérer la gestion de l'eau dans un véritable projet environnemental.
En tant que propriétaire des eaux domaniales, les collectivités territoriales disposent de prérogatives, mais sont également confrontées à de nouvelles contraintes.
En vertu du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les collectivités propriétaires du domaine public fluvial ont la propriété du lit et le droit d'usage des eaux. Elles utilisent des prérogatives diverses. Notamment les autorisations liées aux travaux exécutés sur ce domaine, ainsi que les prises d'eau (L. 2124-8 CGPPP). En contrepartie, elles doivent organiser les services nécessaires pour administrer cette ressource. Elles ont une obligation d'entretien (L. 2124-11 CGPPP), ainsi que la responsabilité des mesures de police sur leur propriété (article L. 2124-6 CGPPP).
Les impératifs environnementaux imposent un véritable projet de développement de la ressource en eau par la propriété des personnes publiques.
La diversité des acteurs et des instruments juridiques nécessitent une planification. C'est le principe évoqué à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Une gestion équilibrée et durable de l'eau doit « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ».
Les collectivités territoriales devront pour cela mettre en place des dispositifs adaptés et des outils opérationnels. Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, elles disposent du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce document est obligatoire.
La ville de Nantes est au centre d'un réseau fluvial important. La Loire, l'Erdre et la Sèvre appartiennent à l'État. Elles contribuent à la « trame bleue », avec d'autres dépendances du domaine fluvial, qui appartient aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Sur les eaux domaniales et non domaniales, la communauté urbaine de Nantes intervient sur tout son territoire, pour l'aménagement des berges comme pour la restauration des cours d'eau. Une structure ad hoc est mise en place : la direction du « Cycle de l'eau ». Des bassins de rétention sont installés en zones urbaines pour stocker le surplus en cas de forte intempérie (exemple : Bottière Chenaie). Ces quelques réalisations traduisent une prise de conscience qui valide les transferts étatiques.
Les collectivités d'outre-mer ont les moyens d'impulser une politique territoriale responsable de l'eau. Avec la loi du 27 juillet 2011, elles peuvent demander des habilitations pour créer les normes nécessaires à une administration locale adaptée. Le régime actuel de domanialité exclusivement étatique est un élément favorable à une telle demande.
Joël Boudine, Maître de conférences en droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane - Autonomie financière des collectivités territoriales outre-mer
Très simplement, l'autonomie financière se résume en la capacité pour les autorités financières locales à déterminer librement leur niveau de ressources et de dépenses. Certains estiment qu'elle va de pair avec l'autonomie de gestion qui correspond aux marges de manoeuvre dont disposent ces mêmes autorités pour définir les modalités d'exercice de leurs compétences 234 ( * ) . En réalité, l'autonomie financière serait une notion davantage attachée au budget, alors que l'autonomie de gestion va plus loin en mesurant la capacité décisionnelle des élus locaux, en termes de trésorerie, de patrimoine, de participation au capital de sociétés, de fixation de taux d'imposition, de tarif des services publics... Cependant, un troisième aspect, fondé essentiellement sur l'élément fiscal, semble aujourd'hui s'affirmer. L'autonomie fiscale est en quelque sorte une composante de l'autonomie financière en ce sens qu'elle marque le pouvoir régalien de lever l'impôt et d'en fixer le produit. Elle n'a certes pas de valeur constitutionnelle, mais elle conditionne largement, voire prioritairement, les questions liées à l'autonomie financière de nos jours.
En effet, lors de la réforme constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 235 ( * ) , le constituant n'a pas cherché à définir la notion, mais à dégager un principe général attribuant à la fiscalité ou, plus précisément, aux ressources propres de chaque catégorie de collectivités, une place déterminante 236 ( * ) par rapport à l'ensemble de leurs ressources.
Ce ratio d'autonomie financière est également étendu aux départements et régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), c'est-à-dire aux collectivités dont les lois et règlements s'appliquent de plein droit mais qui peuvent être adaptés au regard de leurs caractéristiques et contraintes particulières. Néanmoins, il faut reconnaître que si le volet fiscal s'avère indispensable, il ne peut être considéré comme étant suffisant pour appréhender les contours de l'autonomie financière dans ces collectivités quelque peu atypiques 237 ( * ) . Autrement dit, le facteur dépense mérite une considération particulière, dans la mesure où il génère parfois des masses budgétaires assez impressionnantes compte tenu de l'environnement institutionnel, géographique, économique et social de ces collectivités.
En revanche, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna) ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie qui, elle, relève du titre XIII, même si on y retrouve certains particularismes (notamment au niveau économique et social), le système institutionnel commande une interprétation différente de l'autonomie financière, dans la mesure où ces collectivités bénéficient d'un large pouvoir normatif au niveau fiscal. En effet, elles disposent de leur propre législation ou réglementation et par conséquent de leur propre code fiscal. Cependant, il faut observer que l'autonomie fiscale profite essentiellement à la collectivité majeure, les autres, à savoir les provinces et communes, ne bénéficient que d'une compétence limitée en la matière, du fait que leurs ressources dépendent en grande partie des reversements effectués par l'autorité territoriale.
Il résulte de tout ce qui précède une vision binaire de l'autonomie financière outre-mer, de sorte que pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, on insistera à la fois sur le volet fiscal et le volet dépense alors que, pour celles régies par l'article 74 et le titre XIII de la Constitution, l'accent sera mis principalement sur leurs ressources, c'est-à-dire sur la marge de manoeuvre fiscale des autorités locales.
I. - Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Dans ces collectivités, on note la présence d'une fiscalité spécifique qui s'analyse plutôt comme une compensation de la moins-value résultant de la fiscalité de droit commun. Certes, on ne saurait contester son apport budgétaire, mais il est permis de s'interroger sur l'adéquation qui en résulte entre le volume des ressources propres et l'ampleur des dépenses auxquelles sont confrontées ces collectivités. Nous écarterons, naturellement, la collectivité de Mayotte de nos propos, compte tenu de l'absence d'éléments statistiques liée à sa récente transformation en département d'outre-mer 238 ( * ) .
A. Une fiscalité indirecte spécifique qui compense substantiellement les insuffisances de la fiscalité directe locale.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, il est assez frappant de constater que les bases d'impositions relatives à la fiscalité directe locale, à savoir celle de droit commun, demeurent beaucoup plus faibles qu'en France hexagonale, une insuffisance allant du tiers à plus de la moitié selon les impôts locaux pris comme référence. Ainsi, dans le cas des communes et de leurs groupements, les bases en matière de taxe d'habitation pour l'année 2012 se chiffraient à 1 264 €/habitant en France hexagonale contre 636 €/habitant en outre-mer (soit une moins-value de 50 %). La différence est légèrement moins marquée pour la taxe foncière sur les propriétés bâties qui représentait à la même période un montant de 1 178 €/h dans l'hexagone contre 701 €/h en outre-mer (près de 40 % d'écart). Seule la cotisation foncière des entreprises donne un résultat à peu près similaire au montant perçu par habitant en France hexagonale : 398 € contre 312 € 239 ( * ) . Comment expliquer ce phénomène ? Par les allègements d'impôts non compensés, l'évaluation effectuée depuis 1975 et qui ne tient pas compte de l'évolution des logements malgré les successives revalorisations annuelles intervenues après 1980. Sans doute la révision des valeurs locatives des impôts fonciers, amorcée déjà en matière de cotisation foncière des entreprises, devrait corriger certaines tendances.
La faiblesse des bases d'imposition incite parfois les autorités locales à augmenter de façon considérable leurs taux d'imposition, à l'image des communes et surtout des départements de la Guadeloupe et de la Guyane qui sont, depuis quelques années, placés en tête du classement des départements surfiscalisés de France.
À titre d'exemple, le taux moyen d'imposition des communes d'outre-mer pour l'année 2012 en matière de taxe d'habitation était de 27,33 % contre 23,78 % en France Hexagonale et pour le foncier bâti de 26,92 % contre 19,92 % 240 ( * ) . S'agissant des départements, précisons que celui de la Guyane se trouve en première position sur 99 départements pour la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2013, soit 32,92 % devant le Gers (32,86 %), l'Aisne (31,72 %), l'Aude (30,69 %), le Tarn-et-Garonne (28,93 %), le Tarn (28,20 %), l'Orne (27,07 %), la Meuse (25,72 %), la Somme (25,54 %), la Seine-Maritime (25,36 %) et la Guadeloupe (25,27 %) 241 ( * ) . Comme nous le verrons, la faiblesse des bases d'imposition n'est pas la seule à expliquer ce phénomène de hausse, le volet dépense favorise également de tels dérapages. Cependant, ces derniers méritent d'être relativisés si l'on se réfère aux taux d'imposition votés en matière de foncier bâti par les départements de la Martinique et de La Réunion, soit respectivement de 19,49 % et 12,94 % 242 ( * ) .
On écartera nécessairement de nos propos les collectivités régionales du fait que la plupart des impôts directs locaux ont été supprimés lors de la réforme de la taxe professionnelle.
En revanche, s'agissant des impôts spécifiques, les trois catégories de collectivités sont concernées et leur produit paraît compenser parfois assez confortablement la moins-value fiscale observée en droit commun. Parmi ces impôts, on note le reversement par la région aux communes d'une part importante de l'octroi de mer et, exceptionnellement, au département de la Guyane. Mis à part ce dernier cas, généralement les départements ne sont bénéficiaires que de la taxe sur les tabacs et d'une part de la taxe sur les carburants. Enfin, ce sont les régions qui profitent largement de ces impôts en percevant une partie de l'octroi de mer, la taxe sur le carburant, la taxe sur le rhum et la taxe d'embarquement. Tout porte à croire que le conseil régional serait devenu, depuis le transfert de ces impôts en 1984, l'échelon privilégié financièrement et sans doute la collectivité la mieux placée pour assumer pleinement ses responsabilités 243 ( * ) . C'est ainsi que le montant total par habitant des impôts et taxes dépasse largement celui des régions hexagonales, soit 375 €/habitant contre 180 €/h pour l'année 2013 244 ( * ) .
Parmi ces différents impôts, c'est l'octroi de mer qui occupe incontestablement la première place. Ainsi, la part de l'octroi de mer dans l'ensemble des ressources fiscales des communes se situe autour de la moitié, soit 41 % pour la Guadeloupe, 44 % pour la Guyane, 50 % pour la Martinique et 39 % pour La Réunion 245 ( * ) . Pour le département de la Guyane qui est le seul à percevoir une quote-part, le pourcentage est de 12 % et pour les régions la situation est presque similaire à celle des communes, soit 31 % pour la Guadeloupe, 41 % pour la Martinique et 43 % pour la Guyane et La Réunion. On peut donc considérer sans entrer dans des calculs précis que l'insuffisance de la fiscalité directe est compensée pour les communes et assez largement pour les régions. Quant aux départements, la compensation peut être considérée comme étant insuffisante du fait des montants limités qui leurs sont attribués au titre des impôts spécifiques, alors que parallèlement ils doivent faire face à des dépenses sociales incompressibles, voire inflationnistes.
B. Une interprétation de l'autonomie qui ne saurait faire abstraction des dépenses supplémentaires liées aux particularismes locaux
Il convient tout d'abord de préciser que le budget des collectivités territoriales, compte tenu du contexte économique et social des DROM, embrasse des sommes considérables. C'est ainsi que les dépenses départementales d'outre-mer sont, à population équivalente, une fois et demie supérieures à celles des départements de l'hexagone, que les dépenses des régions représentent plus de deux fois celles des autres régions de France.
En clair, les charges exceptionnelles consistent pour ces collectivités, en fonctionnement, à recruter un nombre assez élevé d'agents, à augmenter sans cesse les dépenses d'aide sociale et de formation professionnelle et, en investissement, à faire un effort important en raison des coûts plus élevés qu'en France hexagonale.
S'agissant des communes et groupements de communes, c'est le poste dépenses de personnel qui impressionne par le pourcentage qu'il représente au sein des budgets, soit près de la moitié des dépenses de la section de fonctionnement. Par ailleurs, il constitue l'équivalent d'une fois et demie celui des communes et groupements de l'hexagone : 806 €/h contre 598 €/h 246 ( * ) . Deux raisons majeures peuvent expliquer ce phénomène : une réponse sans doute nécessaire à la situation de l'emploi dans l'outre-mer où parfois les collectivités territoriales sont considérées comme les premiers employeurs et une part de clientélisme politique. Au final, les dépenses de fonctionnement en moyenne sont plus élevées dans ces collectivités, avec un montant de 1 489 €/h contre 1 235 €/h pour celles de l'hexagone 247 ( * ) .
Pour les départements, la situation est sensiblement la même en charge de personnel par habitant, soit 307 € pour l'outre-mer contre 179 € dans l'hexagone selon les budgets primitifs 2013 248 ( * ) , mais plus significative pour les dépenses à caractère social 1 056 €/h contre 541 €/h 249 ( * ) ! Si, en réaction, les dépenses de fonctionnement par habitant sont relativement supérieures à celles de France hexagonale (1 434 € contre 865 €) 250 ( * ) , celles d'investissement restent légèrement inférieures, ce qui montre une certaine difficulté à maintenir un niveau acceptable de leurs interventions, eu égard à l'ampleur du budget de fonctionnement. Rappelons que la section d'investissement des conseils généraux d'outre-mer se situe autour de 15 % contre 25 % en moyenne dans l'hexagone.
Pour les régions, les dépenses réelles par habitant représentent le double de celles de leurs homologues de l'hexagone (961 € contre 427 €). L'écart est encore plus significatif pour les charges de personnel (121 €/h contre 45 €/h) et presque autant pour les dépenses d'enseignement (150 €/h contre 96 €/h) et de formation professionnelle (135 € /h contre 85 €/h) 251 ( * ) . Par rapport aux autres catégories de collectivités territoriales, les régions d'outre-mer sont les seules à maintenir le cap en matière d'investissement, ce qui correspond tout à fait à leur mission : 279 €/h contre 43 €/habitant en France hexagonale 252 ( * ) .
De tous ces éléments, on observe dans les DROM une nette importance en volume des dépenses d'éducation et d'interventions sociales quelle que soit la collectivité de référence, situation qui se justifie par un contexte économique et social fragile nécessitant la prise en charge de certaines catégories vulnérables de la population (les personnes âgées, la petite enfance et les jeunes sans emplois). Du coup, il en ressort une incapacité structurelle, notamment pour les communes et départements, à dégager des excédents significatifs de fonctionnement pour financer leurs projets d'investissements. Cela amène parfois les responsables locaux à présenter des comptes peu sincères afin d'éviter des déséquilibres budgétaires et par voie de conséquence le contrôle des chambres régionales des comptes 253 ( * ) .
II. - Les collectivités régies par l'article 74 et le titre XIII de la Constitution
Les règles de droit commun ne sont applicables à ces collectivités que sur mention expresse du législateur, système dit de la spécialité législative. Elles sont donc dotées d'un statut qui leur est propre et qui leur permet de fixer leurs propres règles fiscales et d'en percevoir le produit. Dans ces conditions, il devient difficile d'appliquer les ratios de France hexagonale tant en ce qui concerne la collectivité majeure principale bénéficiaire que pour les autres collectivités du territoire. On écartera les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) 254 ( * ) qui, certes, bénéficient d'une autonomie fiscale, mais dont les recettes fiscales ne constituent que 2 % du budget.
A. Une large autonomie fiscale de la collectivité territoriale majeure
Que recouvre la notion d'autonomie fiscale pour ces collectivités ? Il s'agit d'un pouvoir de création d'impôt, c'est-à-dire de détermination du champ d'application, de la base d'imposition, du taux ainsi que des modalités de recouvrement et de contrôle. Cela revient à dire que l'État n'a aucune compétence fiscale dans ces territoires, sauf à lever certaines taxes découlant des activités qu'il continue d'exercer (la taxe de sécurité et de police aéroportuaire 255 ( * ) , la contribution de sécurité immobilière 256 ( * ) et en vertu des dispositions de la loi organique de 2007 257 ( * ) , la perception des impôts sur le revenu des personnes physiques et morales domiciliées depuis moins de cinq ans à Saint-Martin (ainsi que la CSG et la CRDS).
Dans ces collectivités, l'État verse également des dotations, mais elles restent insignifiantes en pourcentage par rapport aux produits fiscaux 258 ( * ) . En effet, la fiscalité représente en moyenne 80 % des ressources totales de fonctionnement, ce qui est manifestement plus élevé que les taux hexagonaux prévus pour les communes, départements et régions, soit respectivement de 50 %, 66 % et 54 % en 2011 259 ( * ) .
En Nouvelle-Calédonie, la part de la fiscalité de la collectivité territoriale représentait autour de 90 % du total des recettes de la collectivité en 2011 avec des prélèvements tels que l'impôt sur les revenus des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et les activités métallurgiques ou minières, la taxe de solidarité sur les services, la taxe générale à l'importation, les droits d'enregistrement, la contribution des patentes et la contribution foncière.
À noter que cette collectivité, à compter du 1 er juillet 2014, autorisera la perception d'une nouvelle taxe de type TVA du nom de taxe générale sur les activités et sera la seconde collectivité pourvue de l'autonomie fiscale à instituer une telle fiscalité. En revanche, cette collectivité est la seule à disposer d'un pouvoir législatif en matière fiscale dénommé « lois du pays ». Elles ont une valeur juridique équivalente à celles régies par l'article 34 de la Constitution et font l'objet d'un contrôle de la part du Conseil constitutionnel. Le pouvoir législatif du congrès du territoire est toutefois limité par les normes fiscales de nature constitutionnelles et organiques 260 ( * ) , les normes internationales (traités et conventions ratifiés par la France et applicables en Nouvelle-Calédonie) et le respect des grands principes généraux du droit (principes d'égalité, de non rétroactivité de la norme fiscale notamment).
En Polynésie française, la part des recettes fiscales au sein de l'ensemble des ressources du budget de la collectivité est sensiblement moins importante qu'en Nouvelle-Calédonie, soit près de 80 %. Mais la fiscalité indirecte représente plus de 70 % alors qu'en Nouvelle-Calédonie les produits des impôts directs et impôts indirects s'équilibrent. Parmi les principaux impôts, on note la taxe sur la valeur ajoutée, seule collectivité à l'avoir adoptée au prix d'une longue expérimentation (cinq années), l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe à l'importation, la taxe sur les transactions, les droits d'enregistrement, la contribution des patentes et l'impôt foncier. Observons que l'État contribue au budget de la Polynésie depuis 2011 par le versement d'une dotation globale d'autonomie (90 millions d'euros) 261 ( * ) .
Dans cette collectivité, les délibérations prises dans le domaine législatif sont dénommées « lois du pays » sans avoir toutefois les mêmes caractéristiques que celles de la Nouvelle-Calédonie. En effet, les actes de l'assemblée délibérante intervenant dans le domaine législatif, comme celui de la fiscalité, sont soumis à un contrôle juridictionnel que la Constitution qualifie de « spécifique » et qui est exercé directement devant le Conseil d'État, sous certaines conditions qui distinguent ce contrôle de celui de la légalité de droit commun.
La collectivité de Saint-Martin présente la particularité d'exercer les compétences d'une commune, d'un département et d'une région. Les impôts et taxes constituent près de 70 % du total des ressources budgétaires parmi lesquels on retrouve les taxes foncières, droits de mutation, l'impôt sur le revenu, la taxe générale sur le chiffre d'affaires, la taxe sur les carburants et la contribution sur les patentes. Ici, le droit de l'Union européenne, notamment en matière fiscale et douanière, s'applique dans les mêmes conditions que dans les DROM, compte tenu du fait que ce territoire a opté pour le statut de région ultrapériphérique.
Saint-Barthélemy présente les mêmes caractéristiques que sa voisine dans la mesure où le budget du territoire regroupe celui d'une commune, d'un département et d'une région, mais là s'arrêtent les ressemblances puisque plus de 85 % des recettes budgétaires proviennent des impôts et taxes essentiellement indirects comme les droits de mutation, la taxe de séjour et la taxe sur le carburant. Ils représentent plus de 95 % des recettes fiscales du territoire, soit le plus fort taux enregistré dans les collectivités à autonomie fiscale 262 ( * ) .
La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, moins peuplée que les deux nouvelles des Antilles françaises (6 000 habitants), comprend un budget en ressources composé de 75 % des impôts et taxes avec un relatif équilibre entre impôts directs et impôts indirects. Ces principales recettes sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales, les droits de douane à l'importation, la taxe spéciale à l'importation, la patente et l'impôt foncier. Il s'agit d'une collectivité qui bénéficie d'un statut réduit du fait que c'est l'État qui continue d'exercer certaines compétences 263 ( * ) .
Enfin, le territoire de Wallis-et-Futuna comprend un budget spécial par rapport aux autres dans la mesure où les impôts et taxes constituent seulement 39 % du total des ressources contre 18 % pour les dotations et 40 % pour les produits des services et du domaine 264 ( * ) . Le système fiscal territorial exclut toute forme d'imposition sur les revenus et le capital, ce qui signifie une forte présence des impôts indirects, soit 90 % des recettes fiscales du territoire. Les principaux prélèvements sont les droits de douane, la taxe intérieure sur les alcools et les tabacs, la taxe intérieure sur les hydrocarbures et la patente. Il faut noter que cette collectivité ne bénéficie que d'une compétence d'attribution limitée à certains secteurs de l'activité économique et sociale 265 ( * ) et en l'absence de révision de son statut depuis la réforme constitutionnelle de 2003 266 ( * ) , l'exécutif de la collectivité demeure toujours exercé par le préfet.
Malgré ces éléments réjouissants pour ces collectivités au niveau des recettes, il n'en demeure pas moins que leur situation financière reste fragile selon les observations fournies par les chambres territoriales des comptes. Celles dont la fiscalité repose essentiellement sur les impôts indirects, donc liés à la conjoncture, sont en ligne de mire (la Polynésie et Saint-Martin). Saint-Barthélemy est, semble-t-il, la seule collectivité à échapper à une telle dégradation 267 ( * ) .
B. Des collectivités infra-territoriales dotées d'une compétence fiscale limitée
L'autonomie financière des collectivités infra-territoriales est largement altérée par le fait que c'est le territoire qui reverse le produit des impôts qu'il perçoit, cela relativise la marge de manoeuvre fiscale de ces entités qui repose sur d'autres impôts peu significatifs au plan budgétaire.
C'est ainsi que le budget de la Nouvelle-Calédonie est constitué pour une large part de recettes qui doivent être reversées principalement aux provinces et aux communes, soit un peu plus de 72 % des recettes de fonctionnement distribuées en 2011 268 ( * ) , ce qui permet de relativiser le degré d'autonomie financière de la collectivité centrale. Les communes sont alimentées par deux fonds intercommunaux de péréquation affectés pour l'un en fonctionnement et pour l'autre en investissement 269 ( * ) . Pour les provinces, il est question de dotation de fonctionnement et d'équipement. Au plan fiscal, ces deux catégories de collectivités perçoivent des centimes additionnels sur certains impôts droits et taxes qui représentent à peu près 7 % des recettes fiscales du budget du territoire 270 ( * ) ainsi que certains prélèvements, dont la taxe provinciale sur les communications téléphoniques et la taxe communale sur l'électricité.
En Polynésie française, les communes sont elles aussi alimentées essentiellement par la fiscalité perçue au niveau du territoire grâce à un fonds intercommunal de péréquation et disposent, également, d'une fiscalité additionnelle assise sur des impôts territoriaux. Dans le premier cas, il s'agit d'un prélèvement sur les impôts, droits et taxes du budget général fixé par décret à 17 % depuis 2006 271 ( * ) et d'une contribution de l'État dont le montant est fixé par la loi de finances. Selon la Cour des comptes, ce fonds est en régression depuis quelques années compte tenu du fait qu'il dépend de prélèvements fortement liés à la conjoncture 272 ( * ) . Dans le second cas, il s'agit de centimes additionnels assis sur la contribution des licences, de l'impôt foncier sur les propriétés bâties et de la contribution des patentes, y compris la perception d'une taxe additionnelle sur l'électricité. Pourtant la loi statutaire du 23 février 2004 (article 53) avait prévu la possibilité de transférer des impôts aux communes, mais cela n'a pas été suivi d'effet.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, où il existe deux communes (Saint-Pierre et Miquelon-Langlade), la situation leur est plutôt favorable dans la mesure où elles disposent de leurs propres impôts. En effet, elles bénéficient de prélèvements comme les taxes foncières, le droit au bail, la taxe locale d'équipement pour la première et la taxe de résidence pour la seconde 273 ( * ) . Elles fixent elles-mêmes les taux d'imposition dans les limites fixées par le code local des impôts. Enfin, les communes perçoivent une partie de la taxe sur l'essence, de l'octroi de mer, des droits de navigation ainsi que des centimes additionnels aux produits de la patente et des licences de première et de seconde classe. Compte tenu de ces éléments, on peut considérer qu'elles disposent d'une marge de manoeuvre fiscale et par conséquent d'une autonomie financière plus visible que celle de leurs homologues des autres territoires. Mais, on pourrait tempérer cette observation en faisant remarquer que la notion de fiscalité partagée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française permet, malgré tout, une certaine emprise sur la fiscalité recouvrée par le territoire.
Enfin, à Wallis-et-Futuna, il n'y a que des circonscriptions qui bénéficient d'un budget réduit financé par la dotation de fonctionnement et les subventions d'investissement versées par l'État, alors qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les collectivités infra-territoriales sont inexistantes.
En guise de conclusion, pour la première catégorie de collectivités étudiée, il faut observer que l'article 73 alinéa 3 nouveau de la Constitution permet aux régions et départements (à l'exception de ceux de La Réunion) de fixer les règles applicables sur leur territoire dans un certain nombre de matières relevant du domaine de la loi et du règlement, de même, de procéder à des adaptations de règles prévues par la loi et le règlement dans les matières où s'exercent leurs compétences. Il s'agit de la procédure dite des habilitations qui serait de nature à renforcer les compétences de ces collectivités, c'est-à-dire aggraver leurs dépenses par rapport aux recettes, surtout lorsque l'on sait que le domaine fiscal n'a jusqu'ici obtenu aucune décision favorable en la matière 274 ( * ) . Ce vide pourrait, sans doute, se voir combler avec la transformation de la Guyane et de la Martinique en collectivité unique à l'horizon 2015.
Pour les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, on peut aussi considérer l'autonomie fiscale prétendument annoncée comme étant relative au fait que, dans certains cas, l'administration fiscale continue de relever de l'État 275 ( * ) . La Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité à assurer l'administration de l'impôt, de la création de la norme fiscale jusqu'au recouvrement et au contrôle des prélèvements, l'État n'intervenant que dans le cadre d'accords conventionnels. La Polynésie présente une situation similaire, sauf que les opérations de recouvrement sont assurées par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), c'est-à-dire l'État 276 ( * ) . Parfois, les taux de recouvrement sont assez modestes notamment en Polynésie française 277 ( * ) et à Wallis-et-Futuna 278 ( * ) .
Enfin, comment parler d'autonomie fiscale réelle de certaines collectivités lorsque l'on sait que le système fiscal de Wallis-et-Futuna est assez pauvre en prélèvements 279 ( * ) , que celui de Saint-Barthélemy refuse, pour des raisons tirées de l'histoire, d'instituer des impôts traditionnels comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales 280 ( * ) et que celui de Saint-Martin reste encore insuffisamment alimenté, cela d'autant que les autorités locales ont affiché leur volonté de ne pas créer de distorsion importante avec la partie hollandaise de l'île, plus attractive fiscalement.
Arlette Pujar, Docteur en droit, directrice du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Martinique - Autonomie dans le management des fonctionnaires territoriaux d'outre-mer
Après les interventions d'Antoine Delblond et de Joël Boudine, il me paraît pertinent de compléter leurs analyses par les ressources humaines qui gravitent dans la fonction publique territoriale et sans lesquelles aucune politique publique ne peut être mise en oeuvre.
Le choix que j'ai retenu ici dans le délai qui m'est imparti est de démontrer que les aspects juridiques et/ou politiques de l'autonomie se complètent harmonieusement par les aspects managériaux et/ou sociologiques de l'autonomie.
Le juriste évoque l'autonomie du droit administratif qui est restreint par le contrôle juridictionnel. On peut dès lors penser le droit administratif comme un droit autonome qui va se concrétiser par une séparation des autorités administratives et judiciaires. L'intérêt du concept d'autonomie managériale se manifeste au niveau des organisations administratives et de la mise en oeuvre des politiques publiques et de l'efficacité du management de leurs ressources humaines. C'est la raison pour laquelle le constat de l'absence de délimitation doctrinale interpelle le chercheur. Il s'agit là d'un sujet polysémique qui touche à la fois aux sciences humaines, aux sciences juridiques et aux sciences politiques.
Le concept d'autonomie managériale sera donc présenté en deux temps, par la déclinaison du projet politique au projet d'administration et par la démarche de développement durable et de responsabilité sociétale.
I. - Du projet politique au projet d'administration : le concept d'autonomie appliqué au management
« Les managers publics territoriaux exercent leur métier d'encadrement de façon spécifique notamment par le fait qu'ils sont en interaction constante avec des élus, qu'ils ont à mettre en oeuvre des politiques publiques dans le cadre d'agendas influencés par des élections, qu'ils gèrent des agents sous statut, qu'un dialogue social est souvent présent, qu'ils se réfèrent à des valeurs du service public et des valeurs professionnelles mais aussi à des textes régissant les services publics, que contrairement au secteur privé ils n'ont pas de clients, mais des citoyens-usagers-électeurs-utilisateurs-résidents-habitants-contribuables à multiples facettes et qu'ils sont directement liés à des territoires et à des relations multiples avec l'État et d'autres services publics. 281 ( * ) »
En France, l'inflation du nombre de réunions interministérielles souligne la complexité croissante du processus décisionnel indispensable à l'élaboration du projet politique. Ce constat est valable pour les collectivités territoriales et se traduit par un programme d'actions.
Le mot « management » est une déclinaison du verbe « to manage », réussir, se débrouiller, qui prend sa racine dans le mot latin « manus », main, impliquant un travail manuel, la manipulation. Il fait appel à une grande diversité de disciplines.
« Manager c'est d'abord établir une vision, établir une stratégie, conduire à la réalisation d'objectifs, d'activités, de projets, en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières. » 282 ( * )
Selon Serge Delplace, manager est un mot « valise », c'est-à-dire que chacun, en fonction de son environnement, de sa culture, de l'organisation dans laquelle il est, traduit de manière différente.
A. Les fondamentaux du projet politique
Il appartient aux collectivités territoriales de définir les axes fondateurs du projet politique par la déclinaison devant les commissions sectorielles pour avis consultatifs et prise de décision devant les instances politiques (commission permanente, assemblée plénière, conseil municipal, conseil communautaire...) qui disposent de la force juridique des actes administratifs.
Quatre fondamentaux sont susceptibles d'être retenus :
- l'humain comme première richesse de l'organisation
- des valeurs partagées autour d'un service public de qualité
- l'innovation et la prospective comme moteur de l'administration
- le meilleur service au meilleur coût.
La prise de décision dans le projet politique relève souvent du rapport entre le politique et le cadre dirigeant. En effet, plus le cadre se situe près du pouvoir exécutif, plus il dispose d'une plus ou moins grande opportunité d'autonomie qui se manifeste sur les projets, les propositions, les initiatives, la présentation des rapports, les rapports entre élus/administratifs.
Nous pouvons dire au risque de nous tromper que l'autonomie décisionnelle des cadres se situe au niveau du projet entre le politique et l'opérationnel.
B. La définition du schéma directeur du projet
Pour définir un schéma directeur du projet, il convient avant tout de se mettre d'accord sur les grandes étapes clés, les objectifs, le choix d'une structure possible, les délais réalistes et l'estimation des coûts et des moyens.
Quelle autonomie de l'équipe projet par rapport aux responsables hiérarchiques permanents ? Quelles sont les zones d'autonomie et de responsabilité ? Le cadre dirigeant doit avoir une vision claire de son champ d'autonomie et d'initiative qui peut se décliner dans les principes d'innovation et de créativité impliquant de valoriser l'initiative, la recherche, l'expérimentation et la capitalisation des expériences ce qui nécessite :
- d'avoir une marge de manoeuvre suffisante au plus près de l'usager
- de travailler en équipe pluridisciplinaire pour créer de la compétence collective qui soit supérieure à la somme des compétences individuelles.
Le développement d'une culture du sens commun va de pair avec l'endogamie administrative, c'est-à-dire l'insularité qui crée une proximité très importante entre les élus et les administrations.
C. Le lien entre le projet politique et la mise en oeuvre opérationnelle
Il appartient au DGS 283 ( * ) de traduire le projet politique en mise en oeuvre opérationnelle par les équipes. C'est pourquoi l'action de la direction générale (1) et l'autonomie du cadre (2) seront analysées.
1. L'action de la direction générale
La direction générale des collectivités territoriales dispose, à ce titre, d'une autonomie décisionnelle. Il lui revient, en effet, de définir les stratégies à suivre, en concertation avec les élus et les cadres, de garantir la cohérence d'ensemble, d'identifier les projets qui justifient une organisation transversale et un pilotage spécifique et enfin de faire respecter la hiérarchisation des priorités afin de perturber au minimum l'organisation du travail des cadres et des services.
La définition de l'action de la collectivité peut se résumer par la somme du souhaitable de l'élu et du possible du DGS.
2. Autonomie et pouvoirs du cadre dans la mise en oeuvre opérationnelle
En résumé, le cadre territorial doit posséder une culture du service public et de l'intérêt général. L'administrateur(trice) territorial(e) est souvent généraliste ce qui lui permet d'appréhender de manière globale la gestion d'un territoire en termes de politiques et services publics, de fiscalité, d'organisation et mise en oeuvre des moyens. À la différence des administrateurs de l'État, il(elle) est responsable de l'élaboration et de la réalisation du budget de la collectivité en dépenses comme en recettes et doit veiller aux équilibres à court comme à long terme. Dans le cadre de cette posture, le cadre doit être à l'écoute et à la conjugaison des points de vue de ses collaborateurs. En permanence, il doit assurer l'adaptation des normes aux réalités locales et, en cela, il détient une parcelle d'autonomie conférée par son expérience. Là où le cadre d'État doit faire respecter l'égalité des citoyens et la cohésion nationale. L'autonomie managériale peut se définir par la clarification des compétences et du rôle des élus pour atteindre la cohérence et l'unicité de l'autorité maire/président/adjoint/vice-président/conseiller municipal/conseiller territorial.
De l'autonomie de la prise de décision, on s'interroge sur le discours de promotion des valeurs de service public d'équité, de non-discrimination, de neutralité et d'impartialité.
Pour Pierre-Charles Pupion 284 ( * ) , dans les pays occidentaux, l'autonomie d'action va de pair avec la responsabilisation accrue des dirigeants et la généralisation de la logique d'efficacité et de résultats. Il montre que, de façon croissante, les cadres construisent eux-mêmes leurs marges de manoeuvre et leur autonomie mais que celles-ci trouvent leurs limites dans les ressources qui leur sont allouées. Il explique comment les cadres publics se trouvent en situation de responsabilité directe face aux différentes parties prenantes vis-à-vis desquelles il leur faut faire preuve :
- de pragmatisme, en répondant aux attentes
- de vision, en donnant du sens à leur stratégie
- de pédagogie en permettant aux acteurs de comprendre leur politique.
II. - Mise en oeuvre de l'autonomie managériale des collectivités territoriales dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale
Nous pouvons affirmer que le concept d'autonomie dans le management des collectivités territoriales a suivi l'évolution des organisations modernes. À partir de là, le juriste doit s'attacher à en circonscrire le contenu pour mieux en évaluer les contours en tenant compte de toutes les compétences de l'organisation de travail et des nouveaux sujets d'échanges entre les acteurs.
A. Contenu de l'autorité managériale pour les collectivités territoriales
L'autonomie managériale permet le choix du mode de management approprié au contexte, permettant l'épanouissement des agents territoriaux et la recherche permanente de l'intérêt général et de la satisfaction du plus grand nombre.
Selon l'INSEE, les collectivités territoriales se définissent comme des structures administratives françaises distinctes de l'administration de l'État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d'un territoire précis. Il appartient donc au manager de donner du sens à l'équipe qu'il manage mais à chacun des membres de l'équipe.
Il est primordial pour l'élu et le cadre que leurs relations s'inscrivent dans une volonté de co-production ou de co-construction reposant sur une exigence réciproque et un respect mutuel de valeurs visant à répondre de la meilleure façon possible à la satisfaction de l'intérêt général et des besoins des bénéficiaires du service public.
De nouvelles problématiques portant sur l'éthique, la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) et le développement durable sont apparues et représentent les enjeux majeurs du métier de manager. Le recours à des codes d'éthique, des chartes de valeurs (RESP) 285 ( * ) politique de RSE et de développement durable, labels et certifications « éthiques » sont des instruments de gestion « responsables ».
Laisser une certaine autonomie aux collaborateurs et un degré de responsabilité permet d'être plus efficace dans le travail quotidien. La délégation et l'autonomie sont deux techniques managériales qui ont fait leur preuve.
Selon Christine de Lafare, il convient de développer l'autonomie managériale en renforçant les compétences, en responsabilisant les managers de proximité, préoccupation majeure actuelle des organisations. Au-delà des discours convenus et des bonnes intentions affichées dans les chartes et autres projets d'entreprendre, la réalité est bien là, les managers même les plus frondeurs peinent à prendre des risques, à oser décider, à sortir des sentiers battus, tant il est vrai que systèmes d'information aidant, les managers n'ont jamais eu autant de comptes à rendre, et n'ont jamais bénéficié d'aussi peu de marges de manoeuvre.
Nous pouvons donc dire qu'au sein d'une collectivité, il n'existe pas d'autonomie de décision de l'exécutif et du cadre dirigeant mais une autonomie collective ou collégiale . L'appropriation du temps et du rythme de travail doivent répondre aux besoins d'immédiateté des populations. Le temps administratif n'est pas le temps politique. Il existe une distanciation entre le projet politique et la mise en oeuvre administrative. L'agent administratif est dépossédé de son autonomie temporelle. Il est désormais sujet de contrôle. LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT. Le manque de temps nuit à l'écoute et à la reconnaissance.
La transformation du rôle de manager peut conduire vers deux directions :
- une pathologie de l'encadrement qui conduit à des risques psychosociaux : le nihilisme : le travail perd tout sens ; le clientélisme : on privilégie la paix sociale à tout prix ; l'arrivisme : utilisation de responsabilité pour servir sa carrière ; le compétitivisme : rechercher des prouesses personnelles et la valorisation d'exploits individuels au détriment des réalisations collectives ;
- et une autre direction qui est la « philosophie de la responsabilité » : la responsabilité de l'organisateur : observer, concevoir, décider, mettre en oeuvre, suivre, contrôler et évaluer ; la responsabilité de contribution aux différentes politiques mises en oeuvre ; la responsabilité sur la qualité des relations professionnelles.
B. Le cas particulier de l'autonomie managériale dans un environnement complexe ultramarin
L'évolution institutionnelle outre-mer 286 ( * ) conduira pour ce qui concerne la Martinique et la Guyane à la mise en oeuvre de « cultures professionnelles différentes » qui vont se confronter (fusion administrative). Pour certains, une tendance à vivre « le regard rivé sur le rétroviseur » génère une forte résistance au changement. Cette future collectivité territoriale de Martinique (CTM) est une opportunité pour les cadres territoriaux d'interroger son organisation en tenant compte des expériences des deux collectivités d'origine (conseil général et conseil régional) à savoir le capital de savoir, de patrimoine et la transmission ; le savoir-faire, les relations sociales, les réseaux et le capital des relations entre parties prenantes (élus, agents territoriaux, administrés, citoyens, entreprises...).
Une reconnaissance de l'ensemble des cadres est indispensable et justifiée à la fois par leur place dans l'organigramme, par les nouveaux métiers qu'ils exercent et leurs exigences mais également par la force de proposition qu'ils représentent.
Sans clarification des rôles, des missions et des processus de décision, l'organisation administrative risque de développer des sources de blocage ou des systèmes parallèles, d'empêcher la prise en compte sereine des évolutions managériales et organisationnelles nécessaires.
De plus, le management se trouve confronté à un paradoxe à gérer : « faire plus, innover, initier de nouveaux projets avec des moyens budgétaires constants ou en régression », ce qui pose la question du dispositif de négociation, d'autonomie et de contractualisation des allocations de ressources humaines et financières. Les collectivités territoriales ultramarines sont particulièrement handicapées par l'absence de marges de manoeuvre financière qui ne leur permet pas de procéder à des recrutements de cadres de la haute fonction publique et par des charges liées à l'insularité et à la vulnérabilité de leurs territoires. Dans des environnements complexes et incertains, l'autonomie constitue aujourd'hui à la fois un enjeu et un défi pour les organisations et les managers. Au-delà des décisions organisationnelles et managériales de principe, c'est dans la manière de communiquer, d'échanger, de piloter, de recruter, que l'autonomie peut être cultivée.
Appliquer l'autonomie managériale revient à mettre en pratique les sept principes de la responsabilité sociétale 287 ( * ) : la transparence, le comportement éthique, le respect des intérêts des parties prenantes, internes et externes, le respect de la légalité, le respect des normes internationales de comportement, le respect des droits de l'homme et la responsabilité de « rendre compte ». Le cadre dirigeant doit avoir un comportement transparent et éthique. Il doit contribuer au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société.
Il faut donc oser l'expérimentation sociale et se poser la question de savoir de quels managers nous aurons besoin pour mener à bien le chantier de la collectivité territoriale de Martinique et de Guyane en 2015 ? Dans ce nouveau monde, le management ne s'applique plus sur des ensembles organisationnels mais sur des systèmes socio-humains sans cesse en métamorphose, la métamorphose d'Édouard Glissant.
Dans les faits, le lien social dans une petite collectivité où la proximité est de mise (tout le monde se connaît) permet au cadre dirigeant de détenir un lien de contrôle social et une autonomie de gestion des agents territoriaux. Les fonctionnaires territoriaux en posture de direction doivent repenser les modalités de reconnaissance de l'engagement durable et de la performance individuelle et collective.
- Autonomie et anthropologie
L'anthropologie antillaise 288 ( * ) des postures hiérarchiques met en lumière le modèle de management qui sera retenu au sein des collectivités territoriales ultramarines. La notion de proximité familiale (on est tous plus ou moins parent) a des incidences sur le degré d'autonomie. Le concept de mobilité des cadres est quasiment absent sauf pour ceux qui ont fait le choix de s'installer ailleurs en début de carrière ou en cours de carrière et font le choix ensuite de rester « ailleurs ». L'antillanisation 289 ( * ) des cadres a-t-elle au cours du temps des répercussions sur leur autonomie managériale ?
Les cadres dirigeants doivent être sensibilisés aux objectifs pédagogiques de compréhension du fondement des comportements et des pratiques de la société antillaise ; des dynamiques à l'oeuvre dans tous les aspects de la vie sociale aux Antilles.
Ces questionnements nous renvoient vers le poids de notre histoire, vers les postures hiérarchiques et les niveaux d'encadrement. Difficultés de se projeter à long terme ? Difficultés de prendre la bonne décision ? Sommes-nous prêts à l'autonomie managériale ? La dynamique des milieux, le management des hommes et la fragmentation des besoins permettent de mieux appréhender le degré d'autonomie managériale.
La symbolique du « travail du béké 290 ( * ) » est propre à nos territoires. Deux types de « travail » existent : le travail pour soi (élevage de boeufs, de moutons et cabris, poules et canards et jardin créole...) et le travail pour les autres, qui est assimilé au travail du béké ! Le travail contraint et salarié est le seul reconnu. Les « coups de main 291 ( * ) » renvoient au travail dans la plantation.
La compréhension des systèmes de valeurs qui régissent le fonctionnement différencié des hommes et des femmes favorise une lecture plus incisive de la dynamique des milieux (enjeux, stratégies). La contextualisation de l'arrière-plan culturel et historique représente une introduction à l'anthropologie de la posture hiérarchique. Mieux comprendre le rapport à l'autorité, à la hiérarchie et tout simplement au travail dans le contexte des Antilles pour un management apaisé et une plus grande autonomie décisionnelle. Pour accompagner la mutation profonde qui s'opère dans les organisations publiques, il ne s'agit plus pour les cadres de focaliser leur action sur le respect des normes mais sur les résultats.
Selon Yves Cohen 292 ( * ) , l'autonomie managériale relève de la spécificité du co-pilotage politico-administratif des collectivités territoriales et de la mise en oeuvre d'une politique publique que l'on soit opérateur des actions ou facilitateurs pour ceux qui exercent des métiers dans des fonctions ressources.
L'évolution du concept d'autonomie managériale révèle que la notion d'autorité est aujourd'hui moins liée au savoir, à l'excellence, à la « capacité d'être le meilleur » qu'à la capacité à donner du sens, entraîner, donner envie de convaincre pour vaincre les résistances et de faire s'épanouir des talents.
De façon générale, le degré d'autonomie managériale des cadres dirigeants des collectivités territoriales dépend de la structuration du dispositif de management des équipes mis en place. Les conditions d'exercice du management sont modifiées par les différentes évolutions économiques, techniques, organisationnelles et sociologiques. Du fait de l'incertitude de l'environnement et de la dématérialisation du travail, le cadre dirigeant se doit de manager autrement par les valeurs et par les compétences, combinaison de ces notions. Ce concept d'autonomie managériale mérite une poursuite de l'analyse en tenant compte de tous ces paramètres. Le manager de demain doit compléter sa démarche quotidienne par une approche sociologique des personnes et des relations qu'il entretient avec elles.
Pour Jean-Marc Le Gall 293 ( * ) , cette ambition, centrée sur la prévention, la coopération, l'échange et le compromis, est au coeur de cette recherche indispensable d'une nouvelle écologie du travail humain.
Je ne saurais clore mon propos sans vous inviter, après cette année de centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, à relire la lettre à Maurice Thorez qu'il a rédigée le 24 octobre 1956 dont il me plaît de vous citer un extrait :
« Dans ces conditions, on comprend que nous ne puissions donner à personne délégation pour penser pour nous ; délégation pour chercher pour nous [...]. Qu'aucune doctrine qui ne vaut que repensée par nous, que repensée pour nous [...]. »
André Néron, Administrateur territorial à la retraite, chargé de mission au conseil général pour la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane - L'autonomie confrontée à des contraintes particulières : l'expérience de la Guyane depuis la départementalisation
Succédant à la colonie en 1946, le département de la Guyane, en dépit de la décentralisation mise en oeuvre en 1982, n'a jamais su se défaire de certaines particularités et pratiques coloniales qui s'invitent aujourd'hui dans le processus de mise en oeuvre de la collectivité unique créée par la loi ordinaire du 27 juillet 2011 .
La fusion ainsi envisagée entre le département et la région offre d'intéressantes perspectives de réflexion sur une démarche expérimentale de gouvernance et d'autonomie outre-mer qui ne saurait négliger en effet l'existence d'un contexte souvent atypique d'un point de vue territorial, économique, social, sociologique, culturel, mais aussi historique.
C'est ainsi que le travail actuel d'investigation et d'identification des missions et des moyens de la nouvelle collectivité territoriale de Guyane met en évidence des contraintes particulières qu'il semble difficile de solutionner avant le mois de mars 2015, et qui ont de fortes chances de suivre le courant de la fusion, avec toutes les conséquences liées à leur réalité. Il s'agit principalement :
- de la question de l'indemnisation des autorités coutumières autochtones ;
- de la question de la rémunération des prêtres du clergé catholique ;
- de la situation juridique des biens immobiliers du département de la Guyane hérités de la colonie, et dont la collectivité ne peut disposer à ce jour en pleine propriété.
Pour les autorités coutumières et les prêtres, il y a une problématique financière de nature salariale qu'il nous faut apprécier, mais ne cache-t-elle pas une vraie réalité statutaire à prendre en compte aujourd'hui tant du point de vue de la fonction publique que du fait coutumier ?
En ce qui concerne les biens immobiliers, l'enjeu, dans le contexte actuel de l'évolution institutionnelle, est de garantir à la nouvelle collectivité l'usage effectif de tous ses moyens patrimoniaux.
Pour ces deux catégories de contraintes que nous allons traiter successivement, un éclairage historique s'impose au préalable, afin de mieux comprendre ensuite leur impact juridique ainsi que leurs conséquences financières, matérielles, humaines, politiques ou autres, pour tout projet d'évolution institutionnelle ou statutaire intéressant la Guyane.
Première partie :
L'autonomie à
l'épreuve de contraintes coutumières et cultuelles
L'examen de la masse salariale du budget du département montre que le conseil général assure mensuellement la rémunération de 2 300 agents environ, parmi lesquels figurent à côté des statutaires et des contractuels une cinquantaine de chefs coutumiers, amérindiens et bushinengue, ainsi que 32 prêtres et un évêque. Si ces derniers perçoivent un vrai salaire correspondant à celui d'un rédacteur territorial pour les prêtres, et d'attaché territorial pour l'évêque, les chefs coutumiers bénéficient par contre d'une simple indemnité mensuelle.
Ces éléments prouvent à l'évidence l'existence d'un réel lien administratif entre ces personnes et la collectivité départementale, mais qui se situe manifestement en marge des règles traditionnelles de la fonction publique.
En effet, si l'on s'en tient à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, on constate qu'elle concerne « les personnes nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant ».
Cette définition juridique du fonctionnaire est par ailleurs assortie d'un certain nombre de droits et obligations qui s'imposent également aux agents publics non titulaires ; en particulier, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que la rémunération n'est due qu'après « service fait ».
En quoi consisterait le service fait pour les autorités coutumières et pour les prêtres dans le cadre des missions légales relevant de la collectivité ?
Il se trouve aujourd'hui qu'au titre XI chapitre III de la loi du 27 juillet 2011 relative à la collectivité territoriale de Guyane, il est mentionné en « dépenses obligatoires », « la rémunération des agents de la collectivité ».
Cette seule mention implique-t-elle la charge salariale des membres du clergé catholique et des autorités coutumières ?
A. Le cas des autorités coutumières
Dans un souci de simplification, nous allons volontairement parler des communautés autochtones de Guyane, autant pour identifier les amérindiens que les « noirs marrons », même si l'autochtonie concernerait plus particulièrement les populations amérindiennes.
1. Les amérindiens, premiers habitants de la Guyane
Répartis aujourd'hui sur l'ensemble du territoire en six groupe (ou peuples), la première vague venant du Brésil remonterait au II e siècle de notre ère. Les migrations progressives de sociétés différentes ont eu pour conséquence de rendre difficile la constitution d'un vrai bloc culturel soudé par une langue commune et des pratiques identiques de l'exploitation du milieu.
Dans un ouvrage paru en 1990 Les amérindiens, des peuples pour la Guyane de demain , Pierre et Françoise Grenand, ethnologues, faisaient la remarque suivante :
« Le problème indien demeure, parce que l'administration peu soucieuse d'écouter les avis des spécialistes des questions tribales commet la fatale erreur de confondre les indiens en tant qu'individus, et les nations indiennes en tant qu'entités constituées. Or, c'est bien en tant que nations que les amérindiens de Guyane nous côtoient depuis la conquête, non en tant qu'individus. »
Il semble en effet que la revendication amérindienne porte moins sur la reconnaissance de certains avantages administratifs, que sur celle de leur droit coutumier, et surtout leur existence en tant que peuples au sein du peuple français.
Si aujourd'hui leurs autorités coutumières bénéficient des indemnités versées par le conseil général, ce n'est pas là le résultat de démarches pressantes auprès des pouvoirs publics, mais bien plus la conséquence des pratiques établies dans les rapports entre l'administration et les communautés « noires marrons ».
2. Répartis en quatre groupes, les « noirs marrons » ou « bushinengue », ou encore « noirs réfugiés » sont majoritairement installés sur les berges du fleuve Maroni entre la Guyane et le Surinam
Ils sont les descendants des esclaves importés d'Afrique par les colons, et qui vers le XVIII e siècle ont fui les plantations hollandaises du Surinam et se sont réfugiés en forêt sur la rive française en empruntant aux amérindiens leurs mode de vie et leurs techniques de la chasse et de l'agriculture. L'installation progressive de ces communautés « marrones » a poussé l'administration coloniale vers 1880 à utiliser leur chef suprême « le Gran Man » pour garder la frontière et réguler la circulation sur le fleuve.
Cela s'est fait selon un mode contractuel rémunéré.
Le contrat entre le Gran Man et le gouverneur était verbal et s'articulait en droits et obligations :
Le gouverneur rémunère au nom de la France le Gran Man, qui se charge de favoriser la descente du fleuve et l'établissement des membres de sa communauté à Saint-Laurent du Maroni ; il lui fournit un costume d'apparat.
Les Bonis s'engagent à accueillir le mieux possible les voyageurs sur l'ensemble de la vallée du Maroni. Ils fixent par ailleurs le prix de journée du canotage et autres tâches exécutées.
Pour cette organisation de l'activité des Bonis, le Gran Man reçoit une pension annuelle de 1 200 francs. Les prestations effectuées au profit de tiers sont payées par le commanditaire.
Le mandatement des sommes dues ne recouvre aucun formalisme administratif. L'indemnité au Gran Man est mandatée au nom du commandant supérieur de l'administration pénitentiaire qui, après vérification du service fait, lui remet la somme convenue.
L'intervention d'un acte administratif officiel, liant l'indemnisation à la nomination d'un chef coutumier, va intervenir en 1887.
Cette pratique est entrée dans les faits sans que le conseil général de la Guyane créé en 1878 n'ait pu s'y opposer. Ainsi, les services de l'État, par l'intermédiaire de gendarmes dits « gestionnaires » à l'intérieur du pays, ont continué à reconnaître de nouveaux chefs coutumiers dans les villages et à les indemniser « de mains à mains ». Cela s'est fait d'ailleurs en coïncidence avec la réorganisation administrative du territoire guyanais en 1930 qui a eu pour conséquence de le diviser en deux parties : une zone côtière et une zone protégée dite « territoire de l'Inini ». Il est vraisemblable que c'est durant cette période (vers 1941) que les autorités coutumières amérindiennes ont commencé elles aussi à percevoir les indemnités.
La départementalisation n'a donc fait qu'emprunter la voie de l'intégration de pratiques et de comportements nés sous la colonie et que le préfet, successeur du gouverneur, ne pouvait qu'entériner et mettre en oeuvre.
Par ailleurs, les prérogatives du Gran Man et autres chefs coutumiers sont précisées. Ils se voient octroyer deux types de mission : l'une d'ordre public, l'autre coutumière, comme le rappelle Mme Irma Arnoux dans son ouvrage Les amérindiens dans le département de la Guyane : problèmes juridiques et politiques .
Une fonction administrative de police à l'intérieur du groupe dont ils ont la responsabilité ; des relations constantes avec les gendarmes, c'est à eux qu'ils font appel lorsqu'un membre du groupe commet un délit. C'est à eux qu'il revient de s'occuper de toutes les démarches administratives (pour décès, pièces d'identité...).
Ils deviennent aussi des auxiliaires de justice, chargés de régler les conflits individuels et collectifs dans les villages ou avec les autres groupes ethniques.
Ils sont également garants de la culture ethnique, chargés de préserver l'identité de leurs tribus et d'organiser les cérémonies rituelles et spirituelles.
B. La question du culte catholique
- Le concordat napoléonien de 1801 n'a pas été introduit en Guyane.
- La loi de séparation du 9 décembre 1905 non plus en dépit de son article 43 qui prévoyait les conditions dans lesquelles elle serait applicable à l'Algérie et aux colonies, et qu'un décret du 6 février 1911, avait établi un régime de séparation semblable pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
- Ce refus d'extension résulte du fait que la Guyane est considérée comme terre de mission relevant dès lors d'un statut particulier défini par l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane.
- L'article 2 de la loi du 19 mars 1946 sur la départementalisation disposait que « les lois et décrets actuellement en vigueur en France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront avant le 1 er janvier 1947 l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements ».
- Sur demande de l'évêque de Guyane, le ministre de l'intérieur, interrogé lui-même par le ministre de finances, donne un avis défavorable sur cette extension, le 27 mai 1948.
- Ainsi, le seul texte de référence du régime des cultes en Guyane demeure l'ordonnance royale du 27 août 1828. À la différence de l'Alsace Moselle, il ne s'agit pas d'un régime civil résultant d'un concordat entre le Saint-Siège et la France, mais d'un régime dérogatoire.
- À l'article 36 de cette ordonnance, il est inscrit que « le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable ». Quant à l'article 89, il précise qu'un officier de l'administration de la marine ayant fonction d'ordonnateur est chargé, sous les ordres du gouverneur, d'assurer le « paiement des ministres du culte ».
Du point de vue de la jurisprudence, le débat n'est pas clair.
En effet par un arrêt du 8 novembre 1963 le Conseil d'État confirme l'application en Guyane de l'ordonnance de 1828, puis par un arrêt du 9 octobre 1981 (Béhérec) il assimile le statut des prêtres à celui des fonctionnaires.
C'est à une nuance près ce que l'on trouve dans le précis Dalloz Droit canonique édition 1989 : « les prêtres agréés sont des agents permanents, titulaires rémunérés par le département, mais ils ne sont pourtant pas des fonctionnaires départementaux ».
Saisi pour avis, le représentant de l'État en Guyane se référant à la jurisprudence consultative du Conseil d'État pour ce qui concerne les ministres des cultes reconnus en Alsace Moselle, indique pour sa part : « les ministres du culte catholique en Guyane, seul culte reconnu, n'ont pas été nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative de la fonction publique territoriale ».
C. Comment les situations des autorités coutumières et des prêtres ont-elles été gérées depuis la départementalisation ?
Il ne serait pas exagéré d'apprécier comme une indifférence compatissante la posture de l'État à l'égard des interpellations faites par les exécutifs départementaux ou les parlementaires, vis-à-vis des deux situations évoquées. Rien d'étrange à cela, dans la mesure où les démarches de contestation ne constituaient pas une réelle revendication politique forte, même après que la décentralisation de 1982 a renforcé l'autonomie locale. Il est par ailleurs significatif de constater que les projets d'évolution statutaire initiés par les élus en 2003, puis en 2010 pour une plus grande autonomie encore n'ont pas fait de ces questions des préalables indispensables à résoudre en amont des nouvelles institutions et responsabilités souhaitées.
On peut sans doute noter que dans le souci d'éviter une floraison de demandes d'agrément de chefs coutumiers investis dans de nouveaux villages, le conseil général a défini vers les années 2003-2004 un cadre visant à maintenir un certain quota d'autorités coutumières indemnisées, mais sans que soit posée la question d'un arrêt définitif du versement de ces indemnités, même de façon progressive.
En ce qui concerne les prêtres, il a fallu attendre une délibération récente du 19 décembre 2011 qui, d'une part, a fixé définitivement à 33 les membres du clergé catholique pris en charge et a décidé, d'autre part, que leur rémunération (sauf celle de l'évêque) ne saurait perdurer au-delà de la mise en oeuvre de la collectivité unique.
Deuxième partie :
L'autonomie à
l'épreuve de contraintes matérielles :
la question des
biens de l'ancien domaine colonial
A. Rappel de la situation posée en 1946-1947
Aux termes du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947, les biens de l'ancien domaine colonial ont été répartis à compter du 1 er janvier 1948 entre l'État, les départements et éventuellement les communes.
Dans son article 2, ce texte dispose qu'après inventaire des biens de l'ancien domaine colonial, dressé à la diligence du préfet, ce dernier rédigera un projet de répartition qui, accompagné de l'avis du conseil général, sera transmis au ministre des finances pour la rédaction d'un arrêté avant le 31 décembre 1947.
En définitive un arrêté interministériel du ministre des finances et des affaires économiques du 30 juin 1948 a déterminé, pour chaque nouveau département d'outre-mer, la nouvelle affectation des biens de l'ancien domaine colonial qui ont été répertoriés.
Ce texte traite en fait de l'affectation des biens concernés de l'ancien domaine colonial et non pas de leur propriété.
D'ailleurs, cette question de la propriété ne devait pas poser de problème pour le législateur de 1946, puisque l'objectif était de transformer les colonies en des départements équivalents aux départements métropolitains, autrement dit, le patrimoine de l'ancienne colonie devait ipso jure devenir celui du nouveau département d'outre-mer.
Il faut entendre dès lors que dans le tableau de répartition annexé à l'arrêté de 1948 tous les biens mentionnés dans la rubrique « domaine national » ne sont qu'affectés à l'État à titre d'utilisateur et non de propriétaire .
Cette interprétation a été confirmée par la section des finances du Conseil d'État dans un avis rendu le 12 mars 1948, s'agissant de l'ancien domaine colonial de la Guadeloupe :
« Considérant que le changement de statut dont la loi du 19 mars 1946 a fait bénéficier la Guadeloupe ne saurait avoir pour effet sous réserve des modifications apportées à la consistance du domaine colonial par l'introduction de la législation métropolitaine, de priver la Guadeloupe de la propriété des biens qui constituaient ce domaine ; qu'en conséquence, la Guadeloupe, érigée en département français, est, et demeure, sous la réserve ci-dessus indiquée, propriétaire de ces biens. »
En résumé l'État bénéficie d'un droit de jouissance gratuit pour les besoins de ses services, assorti toutefois d'une obligation de les entretenir en bonus pater familias .
S'il a utilisé et utilise pleinement son droit de jouissance, il n'a pas toujours exécuté son obligation de les entretenir, certains de ces biens étant alors devenus inutilisables.
B. La nécessité impérative de régler la question des biens immobiliers
De façon évidente, elle est la conséquence de l'évolution du contexte juridique et institutionnel depuis la départementalisation.
La décentralisation intervenue en 1982 a confié au département de la Guyane comme aux autres des compétences nouvelles qui ne pouvaient être mise en oeuvre sans une augmentation de moyens matériels et, en l'espèce, de locaux supplémentaires ; le conseil général s'est vu contraint de louer des locaux dans le privé, pour des loyers qui s'élèvent actuellement à 450 000 euros par an.
Le même problème se pose aujourd'hui avec l'évolution vers la collectivité unique de la Guyane puisque la fusion des services départementaux et régionaux risque de provoquer une refonte en profondeur des organigrammes, avec toutes les conséquences en matière d'accueil et d'efficacité des nouvelles structures, sur l'ensemble du territoire.
Enfin, on ne peut négliger l'existence d'un environnement juridique nouveau qui n'a pu que bouleverser celui de 1946 en matière d'autonomie, notamment la Charte européenne sur l'autonomie locale.
C. Quelles modalités pour le règlement de cette situation
Règlement immédiat :
Transférer au département le droit de jouissance des bâtiments actuellement non utilisés par l'État.
Règlement à court terme :
- Prévoir une convention de jouissance entre l'État et le département pour tous les immeubles départementaux bâtis actuellement utilisés par l'État.
- Prévoir par ailleurs des échanges d'immeubles bâtis entre l'État et le département.
Règlement à moyen terme (avant la collectivité territoriale de Guyane)
Modifier le droit posé en 1946-1947 pour le rendre compatible avec les contraintes et le droit actuel.
Conclusion
Au terme de cette présentation, il apparaît que la question du patrimoine immobilier de l'ancien domaine colonial semble être en voie de règlement, même s'il est peu probable qu'elle trouve un exutoire définitif avant la mise en oeuvre de la nouvelle collectivité en mars 2015.
Par contre, s'agissant des autorités coutumières et des prêtres, il est à craindre que ce long « serpent de mer » ne continue à évoluer sans risque au sein des divers systèmes institutionnels qui pourraient être mis en place. En effet, c'est toute la question de la coutume et de son poids juridique qui doivent être pris en compte pour situer la réalité de la question autochtone en Guyane et en tirer les conséquences légales et réglementaires en accord avec l'autonomie locale.
Le débat en l'espèce est de toute évidence politique, et on peut comprendre qu'il ne constitue pas une priorité concertée pour les élus, sans une réelle volonté de l'État de s'y associer.
En ce qui concerne les prêtres, nous pouvons nous interroger en premier lieu sur la possibilité d'exécution de la délibération du conseil général du 19 décembre 2011.
Quelle serait en effet la légalité d'une mesure globale de suppression de leur salaire, alors que leur recrutement fait l'objet d'arrêtés individuels, et qu'ils bénéficient par ailleurs de certains avantages statutaires (congés, retraite, ...) ?
Des risques de contentieux sont à prévoir.
En second lieu, pourquoi l'État refuse-t-il aujourd'hui de supporter la charge de cette dépense alors qu'elle a pour origine des actes juridiques pris par le pouvoir central. Il est clair en effet que ces mesures ont été prises bien avant la décentralisation, et qu'on ne peut par ailleurs évoquer un droit local le justifiant.
Peut-on gommer du jour au lendemain cette réalité guyanaise apparemment bien ancrée dans la société, et à peine contestée par d'autres cultes ?
La solution serait peut-être une véritable institutionnalisation de l'activité du clergé catholique pour participer à des compétences relevant du conseil général (notamment dans le domaine social) et sous réserve de compensations financières de l'État.
ATELIER 4 - AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE OUTRE-MER : DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ - Sous la présidence de Ferdinand Mélin-Soucramanien
Ferdinand
Mélin-Soucramanien, Professeur de droit public à
l'Université de Bordeaux - Autonomie institutionnelle outre-mer :
diversité et complexité
Vous savez que nos outre-mer sont placés dans une perpétuelle instabilité institutionnelle. Ainsi, tandis que Mayotte vient vers la République, la Nouvelle-Calédonie est à un moment crucial de son histoire. Demain, le tribunal de première instance de Nouméa rendra ses premiers jugements sur les radiations de la liste électorale spéciale qui servira à élire le congrès, le 11 mai 2014. Ce même congrès devra décider d'organiser - ou non - un référendum d'autodétermination. Et s'il ne le décide pas, c'est le Gouvernement de la République qui devra l'organiser, même s'il préfèrerait que ce soient les élus eux-mêmes qui décident de leur part d'autonomie dans la République, à côté ou en dehors de celle-ci.
Vous savez aussi que notre droit des outre-mer dessine une sorte d'échelle de souveraineté. Aujourd'hui, La Réunion se trouve en bas de cette échelle. Toutefois, cela pourrait changer à la suite des récentes annonces du Premier ministre sur les conseils départementaux, qui risquent d'engager un chamboule-tout institutionnel. Il y a des prises de position politiques tout à fait intéressantes, y compris venant de la droite locale de La Réunion, traditionnellement attachée au statu quo. La Nouvelle-Calédonie se trouve quant à elle en haut de cette échelle.
Maude Elfort, Maître de conférences en droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane - Autonomie et identités autochtones dans les Guyanes
Évoquer les Guyanes, c'est évoquer un ensemble de trois pays - le Guyana, la Guyane, le Surinam - couvrant 462 086 km² et regroupant une population de 1 665 640 habitants. Au plan politique, le Guyana et le Surinam sont de jeunes États, indépendants de la Grande-Bretagne depuis 1966 pour le premier, et des Pays-Bas depuis 1975 pour le second. La Guyane, pour sa part, est un département français régi par l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958.
C'est évoquer aussi un ensemble écologique inscrit dans le vaste territoire de l'Amazonie, espace qui se caractérise tant par la richesse de ses ressources naturelles que par la variété de ses peuples autochtones 294 ( * ) .
Les relations entre les États et leurs ressortissants autochtones ont longtemps été considérées comme une affaire intérieure relevant exclusivement de la souveraineté de l'État. À partir des années 1957, l'intérêt croissant pour la reconnaissance des droits autochtones, apparu avec le multiculturalisme américain et canadien, va déboucher sur l'internationalisation et la mondialisation des droits des peuples autochtones. Deux textes majeurs sont adoptés par l'Organisation internationale du travail (OIT), les conventions 107 295 ( * ) et 169 296 ( * ) . Ils sont complétés ensuite par des pactes relatifs aux droits économiques et sociaux. En 2007 enfin, l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 297 ( * ) (PA) consacre la reconnaissance internationale de ces peuples. À l'échelle régionale, la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, adoptée en 1997 par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, constitue également un texte référent important, bien qu'elle n'ait toujours pas été adoptée par l'Organisation des États américains.
Si l'on se réfère aux statistiques publiées par Indigenous World et GITPA, les trois Guyanes compteraient plus de 100 000 autochtones : environ 9 000 en Guyane, 41 000 au Guyana et 50 000 au Surinam 298 ( * ) .
Longtemps, l'objectif des États des trois Guyanes a été l'intégration des autochtones dans la société nationale. Cette politique s'est généralement traduite par la dépossession de leurs terres et l'acculturation culturelle.
Aujourd'hui, ces États, à l'exemple de nombreux pays du continent américain, sont confrontés à la question de la reconnaissance de l'identité autochtone sur leur territoire 299 ( * ) . Les solutions apportées sont variées du fait qu'elles reflètent les différences de sensibilité des États des Guyanes.
Néanmoins, ces États partagent une même histoire et surtout ont en commun le texte référent en la matière, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA).
I. - Identités autochtones et ordre juridique interne : des modèles variés
Deux modèles sont à l'oeuvre au sein des États :
- le constitutionnalisme pluraliste qui se caractérise par la reconnaissance du multiculturalisme et la diversité culturelle ;
- le monisme juridique, fondé sur les principes de l'existence d'une source unique du droit - celui de l'État - et de l'égalité des citoyens devant la loi.
A. Le constitutionnalisme pluraliste : l'intégration de l'identité autochtone dans le droit constitutionnel du Guyana
La Constitution de la République coopérative du Guyana adoptée en 1980 ne dit mot sur les autochtones. Cette appréhension juridique au plus haut niveau de l'État se réalise avec la Constitution adoptée en 2001. Son préambule débute, en effet, par ces mots : « Nous peuples du Guyana, célébrons la diversité culturelle et raciale et renforçons notre unité en éliminant toute forme de discrimination ; Valorisons la place spéciale occupée dans notre Nation par les peuples autochtones et reconnaissons leurs droits en tant que citoyens à la terre, à la sécurité et à la promulgation de politiques pour leurs communautés. »
De cette proclamation inaugurale découle une nouvelle institution : la Commission des peuples autochtones (art 19 , C) qui s'accompagne, au niveau national, de la création d'un ministère des affaires amérindiennes.
Il faut ajouter que la loi amérindienne adoptée en février 2006 prévoit la mise en place d'un Conseil national des Toshaos réunissant les chefs des communautés autochtones 300 ( * ) et des conseils de villages chargés de gérer les affaires intérieures 301 ( * ) .
La constitutionnalisation de l'identité autochtone au Guyana constitue une incontestable avancée. En premier lieu, par rapport aux dispositions législatives antérieures, essentiellement celles de la loi amérindienne de 1976 qui ignoraient les droits culturels et linguistiques des amérindiens mais en revanche prévoyaient des pénalités pour possession d'alcool (art. 37). Ensuite, parce qu'elle a consacré la reconnaissance de titres de propriété foncière (déjà mentionnés par la loi de 1976) et contribué à la mise en oeuvre de programmes favorisant l'accès des autochtones aux soins de santé comme à l'enseignement primaire et secondaire.
Force est de constater cependant qu'au Guyana tous les documents officiels, publics ou commerciaux sont rédigés et diffusés en anglais, que l'ensemble des écoles n'utilisent que l'anglais comme langue d'enseignement et que, dans les médias, l'anglais demeure la langue de référence même si, aujourd'hui, elle est de plus en plus concurrencée par l'espagnol.
Ensuite, certaines décisions prises par les conseils de village sont soumises à l'approbation de l'État et si les communautés ont le droit de veto pour les activités minières à petite et moyenne échelle, seul le ministre des mines dispose d'un droit de veto s'agissant d'activités minières à grande échelle mettant en jeu l'intérêt du pays.
Enfin, si la législation vise à mieux protéger les droits fonciers des autochtones, on note aussi l'incompatibilité de ce processus avec d'autres utilisations des terres, notamment par les compagnies privées d'extraction minière ou d'exploitation forestière 302 ( * ) .
B. Le monisme juridique : l'absence de reconnaissance de l'identité autochtone en France et au Surinam
En France et au Surinam il faut constater, en revanche, que les droits positifs n'ont pas enregistré de la même manière l'influence du droit international des droits autochtones.
D'une part, l'égalité est l'un des fondements de la République française , comme le souligne l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse, « le concept juridique de peuple français a valeur constitutionnelle ». Il en résulte que « la mention faite par le législateur du peuple corse, composante du peuple français est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion » 303 ( * ) . Et c'est bien ce qu'applique la France lorsqu'elle s'oppose systématiquement aux clauses des conventions qui tendent à reconnaître aux individus des droits spécifiques à raison de leur appartenance à une minorité. Quelques dispositifs contribuent cependant à favoriser cette autonomie en Guyane : décret du 14 avril 1987 relatif aux zones d'usage et dans lesquelles les autochtones peuvent pratiquer la chasse, la pêche et l'agriculture. Communes exclusivement composées d'amérindiens ou de bushinenge 304 ( * ) ; loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 créant un Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge 305 ( * ) .
D'autre-part, l'égalité et la non-discrimination sont également au coeur du système constitutionnel surinamais ; l'article 8 énonce : « Tous ceux qui sont sur le territoire du Surinam ont un droit égal à la protection des personnes et des biens. Nul ne peut être l'objet de discriminations pour des raisons de naissance, de sexe, de race, de langue, d'origine religieuse, d'éducation, de convictions politiques, de situation économique ou de tout autre situation ». Il en résulte que les droits garantis sont essentiellement des droits individuels. Le droit surinamais ignore en effet la propriété collective. Seule la propriété individuelle est garantie et aucune disposition institutionnelle n'organise la reconnaissance du droit coutumier.
II. - Identités autochtone et ordre juridique interne : les nouveaux défis
A. L'impact, dans les droits positifs internes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
On se souvient que le 13 septembre 2007, après plus de vingt ans de discussions, 143 pays, dont la France, le Guyana et le Surinam, ont voté en faveur de la déclaration. Celle-ci reconnaît dans son préambule le droit de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels. Elle inscrit dans son article 3 le droit à l'auto-détermination des peuples autochtones, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel 306 ( * ) .
Ce droit doit néanmoins être compatible avec le principe de l'intégrité territoriale et l'unité politique des États.
Sans doute, la déclaration marque un progrès notable car, avant elle, les seuls textes portant sur les droits des autochtones se limitaient aux conventions 107 et 109 de l'OIT. Mais il convient de rappeler que ce document, contrairement aux conventions de l'OIT, n'a pas en lui-même d'effet contraignant. Cela étant, on observera que cette absence de portée contraignante n'a pas empêché la Cour interaméricaine des droits de l'homme d'y avoir recours dans l'affaire Peuple Saramaka c./Surinam. En l'espèce, la Cour a considéré que le Surinam, en votant en faveur de la déclaration, avait expressément soutenu son article 32 en vertu duquel « la consultation ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais doit permettre de respecter l'intérêt de ceux qui utilisent la terre ». Suite à cette décision, le Surinam a demandé le soutien du rapporteur spécial des Nations unies en vue de l'aider à mettre en place une nouvelle législation plus respectueuse des droits des peuples autochtones. On peut ajouter que la démarche entreprise par le peuple Saramaka a trouvé un écho auprès des amérindiens puisque l'organisation des peuples Kalina et Ikono a saisi la Cour interaméricaine d'une plainte contre le gouvernement du Surinam.
De son côté, le gouvernement du Guyana s'est engagé à accélérer le processus d'octroi des titres de propriété foncière communautaires et à adapter le cadre juridique national aux normes internationales relatives aux droits humains des PA. L'hypothèse de la ratification de la convention 169 de l'OIT est même envisagée.
Quant à la France , dans son énoncé appuyant la déclaration, elle a tenu à préciser « qu'en vertu du principe d'indivisibilité de la République, des droits collectifs ne peuvent prévaloir sur les droits individuels. Un traitement particulier peut cependant être accordé à des populations sur une base territoriale. Le droit à l'auto-détermination, tout comme les consultations et référendums locaux, évoqués dans les articles 3, 4, 19, 20 et 30 de la déclaration s'exercent conformément aux normes constitutionnelles nationales comme le prévoit l'article 46 de la déclaration. Enfin, l'article 36 concernant le droit des populations autochtones à entretenir des relations internationales se lit dans le cadre des normes constitutionnelles dans ce domaine. » Cette position a été réaffirmée en décembre 2013. À la question posée par le sénateur de la Guyane, M. Jean-Étienne Antoinette, au ministre des Affaires étrangères sur les raisons de l'absence de ratification par la France de la convention 169 de l'OIT, le ministre a rappelé le principe traditionnel de l'indivisibilité du peuple français et le refus de toute discrimination personnelle entre citoyens. Ce qu'il faut noter, ce n'est pas tant la réponse du ministre, au demeurant classique, mais le fait que pour la première fois l'interrogation émane d'un parlementaire guyanais.
En définitive, dans les trois Guyanes, l'impact de la déclaration demeure limitée : elle a certes permis l'organisation annuelle de « journées des peuples autochtones » 307 ( * ) qui contribuent incontestablement à la visibilité croissante des autochtones. Au plan juridique, comme l'ont démontré les affaires Cal c./Bélize 308 ( * ) et peuple Saramaka, elle peut servir de référence et être utilisée comme source de droit par les tribunaux nationaux pour interpréter les droits internes, mais tel n'a pas été le cas jusqu'alors.
En réalité, sa portée reste faible. En France, à la lumière de la position adoptée par le gouvernement en 2013, il est indéniable que celui-ci n'a pas l'intention de mettre en oeuvre la déclaration.
Au Guyana, il suffit de lire les rapports de l'ONU ou ceux d'Amnesty international pour constater que la situation des autochtones n'a guère évolué.
Au Surinam, la pétition des Amérindiens et des Noirs-marrons, en 2011, sur la reconnaissance de leurs droits collectifs sur le sol et le sous-sol s'est heurtée au refus catégorique du chef de l'État, Desi Bouterse 309 ( * ) , au motif que leurs revendications étaient « diamétralement opposées à la Constitution ».
Il faut dire que dans les trois Guyanes la reconnaissance de l'identité autochtone rencontre un certain nombre de contraintes.
B. Les contraintes à la reconnaissance de l'identité religieuse
D'abord, comme le souligne Henri Oberdorff, « le respect des droits de l'homme, surtout dans leur aspect droit de créances, dépend largement du niveau de développement économique et social des pays concernés. L'état de très grande pauvreté rend totalement irréaliste le respect de certains droits » 310 ( * ) . Or, le Guyana est l'un des pays les plus pauvres de la région. Environ 30 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Quant au Surinam, depuis 2004-2005, il est certes sorti de la catégorie des pays à faible revenu, cependant 27,5 % de la population vit encore dans la pauvreté.
Ensuite, la volonté des États de conserver la maîtrise du contrôle de leurs richesses naturelles au nom de leur indépendance économique. On sait que de nouvelles techniques d'exploration minière ont permis de découvrir au Guyana et au Surinam des gisements aurifères de grande envergure 311 ( * ) . Cependant, la plupart des projets d'exploitation se situent sur les territoires autochtones et relèvent du principe du consentement préalable, donné librement et en toute connaissance de cause par les autochtones 312 ( * ) .
Il faut encore ajouter le coût des politiques de reconnaissance des droits autochtones. C'est ainsi que si la création de conseils communautaires au Guyana et en Guyane plaide en faveur de l'identité autochtone, encore convient-il de veiller à ce que ces conseils disposent des moyens leur permettant d'assumer leur mission. Peut-on sérieusement reprocher au Conseil national des Toshaos « qui ne dispose que de fort peu de moyens financiers et logistiques » de peiner à promouvoir la reconnaissance et l'usage des langues amérindiennes ?
Enfin, les gouvernements doivent composer avec une opinion publique défavorable 313 ( * ) .
Par-delà les différences nationales, l'analyse de la situation des autochtones dans les Guyanes révèle l'existence de problématiques communes, de réalités socio-économiques contrastées et de questionnements juridiques identiques. Si les réponses apportées par les États sont variées, un constat s'impose : la prise en compte de l'identité autochtone représente aujourd'hui pour ces pays un défi important.
Olivier Gohin, Professeur de droit public à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur de l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de Paris - Approche comparée des autonomies polynésienne et calédonienne
Il y a, entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, une proximité qui tient à la situation de ces deux ensembles dans le Pacifique Sud et, tout à la fois, un éloignement qui tient à la distance de près de 5 000 kilomètres qui sépare Papeete de Nouméa. En considérant, par exemple, la transformation logique de chacun des deux pôles de l'improbable Université française du Pacifique, créée en 1987 314 ( * ) , en deux raisonnables Universités à part entière, celle de la Polynésie française et celle de la Nouvelle-Calédonie, depuis 1999 315 ( * ) , peut-on soutenir que c'est la distance qui l'a finalement emporté ?
On pourrait également mentionner, en ce sens, la vaste dispersion de la Polynésie française en une centaine d'îles 316 ( * ) , réparties en cinq archipels distincts sur une zone économique exclusive (ZEE) de près de 5 millions de kilomètres carrés 317 ( * ) , face à la forte concentration de la Nouvelle-Calédonie, entre une Grande Terre 318 ( * ) et quelques îles habités à l'Est et au Sud du « Caillou » 319 ( * ) , pour une ZEE de moins de 1 million et demi de kilomètres carrés, mais aussi la différence entre un peuplement d'origine polynésienne, ici, et un peuplement d'origine mélanésienne, là, l'absence de statut personnel dans un cas, l'existence d'un statut coutumier dans l'autre cas, l'importance du tourisme en Polynésie française, en particulier dans les îles de Tahiti, Bora-Bora et Moorea 320 ( * ) face à celle, toute autre, du nickel en Nouvelle-Calédonie qui en est le cinquième producteur mondial 321 ( * ) .
Mais, en même temps, il faut bien souligner l'origine commune de ces deux collectivités publiques 322 ( * ) dans la colonisation française, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France remontant à 1853 alors qu'il faut attendre 1880 pour la formation des Établissements français de l'Océanie 323 ( * ) . Dès lors, c'est aussi ensemble qu'elles sont sorties, en 1946, du droit de la colonisation 324 ( * ) pour devenir alors, l'une et l'autre, deux nouveaux territoires d'outre-mer (TOM) 325 ( * ) , marqués, en particulier, par la loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 : même tardivement, est enfin consacré le suffrage universel dans les Établissements français de l'Océanie (EFO), redénommés Polynésie française à partir de 1957, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1999.
Du reste, c'est de façon commune que la Nouvelle-Calédonie, depuis 1998 326 ( * ) , et la Polynésie française, depuis 2003 327 ( * ) , sont nommément citées dans la Constitution française, ce qui a pour objet et, en tout cas, pour effet de renvoyer vers le pouvoir de révision, et non vers le pouvoir législatif, la décision de leur indépendance, le cas échéant 328 ( * ) . Et, c'est bien avec un faible décalage dans le temps que se fait, le plus souvent, l'évolution statutaire, entre 1976 et 2004, de ces deux collectivités décentralisées, aux compétences de principe, l'une et l'autre, pendant une vingtaine d'années 329 ( * ) : aux statuts calédoniens de 1976 330 ( * ) , 1984 331 ( * ) et 1988 332 ( * ) répondent ainsi et donc correspondent les statuts polynésiens de 1977 333 ( * ) , 1984 334 ( * ) et 1996 335 ( * ) . Le président Gaston Flosse aura souvent marqué, d'ailleurs, son souci de toujours avoir la Nouvelle-Calédonie « dans son rétroviseur » 336 ( * ) , ce qui suppose que toute avancée sur le fond du droit de la décentralisation, dans l'outre-mer calédonien, soit, sinon concomitant, comme en 1984, du moins rattrapé et même dépassé, comme en 1977 ou en 1996, dans l'outre-mer polynésien.
À cet égard, la loi constitutionnelle de 1998 et la loi organique statutaire de 1999, en faveur de Nouméa, marquent une rupture décisive, au détriment de Papeete, depuis la suspension sine die , en janvier 2000, de la procédure de révision constitutionnelle relative à l'ex-futur article 78 nouveau, le président Gaston Flosse acceptant alors d'inscrire l'avenir institutionnel de la Polynésie française dans le cadre d'une nouvelle réforme constitutionnelle portant, notamment, sur l'article 74, celle en cours de préparation, à l'Élysée, à partir du printemps 2000, que la réélection du président Jacques Chirac, deux ans plus tard, allait rendre rapidement possible 337 ( * ) .
Sur fond de décentralisation territoriale, aussi variable soit-elle dans l'ensemble français, considérons, en droit positif, la convergence (I) et la divergence des autonomies, celle de la Polynésie française et, en contre-point, celle de la Nouvelle-Calédonie (II).
I. - La convergence des autonomies
C'est le monisme qui caractérise le droit français depuis 1946 de sorte que ce droit n'est plus régi que par des normes internes, qu'elles soient d'origine interne ou d'origine externe, mais internisées. Rapportée, à titre principal, au statut de la Nouvelle-Calédonie : celui déterminé par la loi organique du 19 mars 1999, et au statut de la Polynésie française : celui déterminé par la loi organique du 27 février 2004, cette construction permet d'identifier deux champs tendant à se superposer dans lesquels s'expriment la convergence de leur autonomie : le champ interne ( A ) et le champ externe ( B ).
A. La convergence dans le champ interne
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont, quoique l'on en dise, deux collectivités territoriales de la République, comme le sont aussi les provinces de la Nouvelle-Calédonie, ce que la loi organique statutaire de 1999 dit, en revanche, expressément 338 ( * ) . Elles sont mentionnées, l'une et l'autre, au titre XII de la Constitution sans que la prescription, d'ailleurs au titre XII, qui prévoit, depuis 2003, que le statut de la Nouvelle-Calédonie est régie par le titre XIII 339 ( * ) , suffise à faire de cette collectivité une collectivité du titre XIII. En tant que collectivité territoriale du titre XII, la Nouvelle-Calédonie, comme ses provinces, est une collectivité à statut particulier, prévue à l'article 72, alinéa 1 er et régie par le titre XIII, sans doute - c'est-à-dire par l'article 77 - mais aussi, et surtout, par bien d'autres dispositions constitutionnelles 340 ( * ) et infra-constitutionnelles 341 ( * ) ; pour sa part, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74, sans doute, mais aussi, et surtout, par bien d'autres dispositions infra-constitutionnelles 342 ( * ) .
Il est vrai que, sur cette base constitutionnelle, l'autonomie de ces deux collectivités décentralisées, fondées sur le principe de spécialité législative 343 ( * ) , est des plus poussées et qu'elle l'est plus encore, depuis la révision de 1998, à Nouméa qu'à Papeete. Et, du reste, le texte ou la jurisprudence peuvent s'en faire l'écho :
- le législateur organique lorsque, à l'article 1 er du statut de 2004, est retenue la notion de « pays », plus précisément de « pays d'outre-mer » 344 ( * ) , préféré, là aussi, à celle de « collectivité territoriale » ;
- le Conseil d'État lorsque, dans sa décision Genell e de 2006, est retenue la notion de « collectivité » 345 ( * ) , préférée à celle de « collectivité territoriale ».
Et, ne voit-on pas aussi des symboles distincts de ceux de la République française, tels qu'un drapeau, en Polynésie française 346 ( * ) comme en Nouvelle-Calédonie 347 ( * ) ?
Or, ces termes spécifiques de « collectivité » ou de « pays » sont inutiles et même nuisibles en tant qu'ils font perdre à la Constitution la cohérence qu'elle mérite de conserver : car, au regard de l'article 24, alinéa 4, de la Constitution selon lequel « le Sénat (...) assure la représentation des collectivités territoriales de la République », comment justifier, en droit, que la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie française, soit représentée dans la haute assemblée ? Du reste, ces symboles, pour être officiels, ne remettent pas en cause, par eux-mêmes, le caractère unitaire de l'État français, tel que déduit de son indivisibilité 348 ( * ) .
Dès lors, comme il se doit, et selon le schéma proposé aux alinéas 3 et 6 de l'article 72 dont le Conseil constitutionnel exige, depuis 1982, la conciliation 349 ( * ) , les collectivités décentralisées, ici comparées, s'administrent librement dans les conditions que la loi, ici constitutionnelle et organique, détermine alors que, dans le même temps, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie 350 ( * ) , exerce sur place, en tant qu'autorité déconcentrée de l'État, le contrôle administratif que la Constitution lui confie, pour veiller, dans chacun de ces deux outre-mers français, aux intérêts nationaux et au respect des lois, compris comme le respect de la hiérarchie normative.
Il est vrai, toutefois, que ces deux mêmes collectivités décentralisées - et elles seulement - sont dotées d'exécutifs formant un gouvernement responsable devant le délibératif, composés de ministres, avec, depuis 2004 , un président de la Polynésie française comme chef de l'exécutif local, alors qu'en revanche, depuis 1999, cet exécutif est voulu comme collégial en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, il a été jugé par le Conseil d'État, en 1992, que la nomination d'un ministre polynésien est un acte administratif 351 ( * ) . Et, la même solution prévaut pour l'élection des membres de l'exécutif calédonien dont le Conseil d'État, en 2001, aura également eu à connaître au contentieux 352 ( * ) .
Il est vrai aussi que, sous le contrôle du représentant de l'État, notamment, les assemblées délibérantes de chacune de ces deux collectivités décentralisées ont la possibilité de prendre - sous la même dénomination de « lois du pays », dans l'un et l'autre cas 353 ( * ) - des délibérations dans les matières, limitativement énumérées, de la loi, sous le contrôle de la tutelle et du juge : ce dispositif vaut pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie 354 ( * ) comme pour l'assemblée de la Polynésie française 355 ( * ) . Or, quoi de nouveau, sur ce point ? Cette compétence d'exception rejoint celle d'autres collectivités territoriales d'outre-mer (CTOM), comme jugé par le Conseil d'État, en 1970, au sujet d'une délibération de la chambre des députés du territoire des Comores 356 ( * ) . Elle n'ajoute rien au droit existant qui retient la même solution, du reste, pour les départements et régions d'outre-mer 357 ( * ) où l'autonomie, pourtant, est bien moins développée : la préférence territoriale, en effet, ne saurait y prévaloir, contrairement à ce qui prévaut tant en Nouvelle-Calédonie 358 ( * ) qu'en Polynésie française 359 ( * ) , même si le champ de l'exception constitutionalisée, en ce sens, n'est pas le même dans ces deux collectivités décentralisées, réserve faite des mesures en faveur de l'emploi de la population locale, calédonienne comme polynésienne.
Il est constant, néanmoins, que, sur une base constitutionnelle dans les deux cas, ces lois du pays, polynésiennes ou calédoniennes, sont d'une nature juridique différente les unes des autres et qu'elles sont soumises à un contrôle juridictionnel différent. Mais, dans l'un et l'autre cas, le contentieux, initié tant par voie d'action que par voie d'exception, se présente bien, en termes de procédure, comme un contentieux administratif, y compris pour les lois du pays calédoniennes 360 ( * ) : ce n'est pas la compétence du juge, en effet, qui détermine la nature de l'acte ou la qualification du contentieux.
B. La convergence dans le champ externe
Comme les collectivités territoriales de droit commun, et pour des raisons, à la fois géographiques et politiques qui ont fini par s'imposer, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont eu à s'insérer dans leur environnement régional, avec cette notable différence, par rapport à la coopération décentralisée, que cet environnement n'est pas fait seulement d'« autorités locales étrangères » 361 ( * ) , mais aussi d'États souverains, souvent de micro-États, comme ceux réunis, à titre principal, dans la Communauté du Pacifique (CPS) ou dans le Forum des îles du Pacifique (FIP) : au bénéfice de leur forte autonomie, les deux collectivités décentralisées sont ainsi membres à part entière de la Communauté, depuis 1947, et membres associés du Forum, depuis 2006 362 ( * ) .
Mais, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont également membres à part entière d'autres organismes régionaux, tels que le Programme régional de l'Environnement (PROE) 363 ( * ) , de l'Organisation du tourisme du Pacifique sud (SPTO) et le Programme de développement des îles du Pacifique (PIDP) et membres associés, entre autres, de la Commission des sciences appliquées de la terre du Pacifique sud (SOPAC), de l'Office international des épizooties (OIE) et de la Commission économique et sociale Asie-Pacifique des Nations Unies (CESAP) 364 ( * ) .
De plus, selon un dispositif initié pour la Nouvelle-Calédonie et basé sur une convention signée, en janvier 2012, entre l'État et la collectivité territoriale, des représentants des collectivités territoriales d'outre-mer peuvent être affectés au sein du réseau diplomatique et consulaire français afin de renforcer l'insertion des collectivités ultramarines étudiées dans leur environnement régional, assurer le suivi des actions de coopération régionale qu'elles engagent et représenter, voire défendre leurs intérêts dans la zone 365 ( * ) . Or, ce dispositif original est susceptible de s'étendre, de la même façon, aux autres collectivités territoriales d'outre-mer, dont la Polynésie française.
Pour autant, il ne s'agit pas, pour ces deux collectivités décentralisées, de créer leur propre réseau diplomatique, compétence qui relève exclusivement de l'État. En particulier, les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, y font obstacle, l'un et l'autre, de la même façon :
- ainsi, l'État et la Nouvelle-Calédonie se voient attribuer compétence pour les « relations extérieures », selon un partage qui recoupe la distinction entre « relations internationales », de la compétence de l'État 366 ( * ) , et « relations régionales », de la compétence de la collectivité territoriale 367 ( * ) ; car, tant que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne sera pas acquise, « les affaires étrangères », au titre des « compétences régaliennes » 368 ( * ) , resteront de la compétence exclusive de l'État ;
- de même, les représentations de la Polynésie française, au titre de ses « relations extérieures » 369 ( * ) , ne sont pas à caractère diplomatique 370 ( * ) , « la politique étrangère » restant de la compétence d'exception de l'État 371 ( * ) .
Le vocabulaire peut varier, la réalité est identique dans le Pacifique Sud : le régional aux deux collectivités décentralisées ; l'international à l'État unitaire.
Mais, dans le champ externe, il faut aussi prendre en compte la dimension européenne du droit français. Elle passe, semblablement, par l'application, depuis 1974, de la Convention européenne des droits de l'homme, en Polynésie française 372 ( * ) comme en Nouvelle-Calédonie 373 ( * ) , et, en revanche, par l'inapplication, depuis 1957, du droit communautaire, devenu, en 2009, droit de l'Union européenne : en effet, en droit positif, l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) du 13 décembre 2007 continue à placer ces deux « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) sous le régime spécial d'association, tel que prévu par ce traité, d'une part, dans sa quatrième partie, aux articles 198 à 204, et, d'autre part, à son article 355, § 2 374 ( * ) .
II. - La divergence des autonomies
Sur la base de fortes dispositions constitutionnelles, la libre administration des collectivités territoriales (art. 72, al. 3) est en correspondance avec leur autonomie, dans le cadre d'une République qui se veut démocratique (art. 1 er , al. 1 er ). Pour autant, le droit constitutionnel connaît les révisions explicites et admet les révisions implicites 375 ( * ) , mais aussi les législations statutaires, organiques ou ordinaires, dans le prolongement de la Constitution révisée, qui ont transformé progressivement le panorama des outre-mers français pour permettre - à ne considérer, ici, que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie - la diversité dans la décentralisation ( A ), mais aussi dans la démocratie ( B ).
A. La diversité dans la décentralisation
Force est de constater que plus la part du droit constitutionnel est forte dans le statut des deux collectivités étudiées, plus leur autonomie est grande, à la lecture des législations organiques qui les régissent, depuis 1992 376 ( * ) , en tant qu'elles sont issues, l'un et l'autre, d'un territoire d'outre-mer, sans davantage appartenir, désormais, à une catégorie constitutionnelle.
Quand la Polynésie française était encore un territoire d'outre-mer (TOM), elle est passée de l'autonomie « interne » : celle de la loi du 6 septembre 1984, à l'autonomie « renforcée » : celle de la loi organique du 12 avril 1996 qui aura permis d'aller aussi loin que possible dans la décentralisation territoriale des outre-mers de spécialité, hors Nouvelle-Calédonie, avant la révision constitutionnelle générale de 2003. Or, le dépassement de cette autonomie renforcée par la réforme du statut calédonien, en 1998-1999, et l'abandon, en cours de route, de la révision de rattrapage du statut polynésien, en 1999-2000, devaient conduire à reprendre le tout, par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, à l'article 74 nouveau de la Constitution, applicable, hors Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales d'outre-mer autres que celles de l'article 73, celles qui sont issues de la départementalisation initiale ou qui l'ont rejointe depuis lors 377 ( * ) .
Dans le cadre du statut propre à chaque collectivité d'outre-mer (COM) de l'article 74 (al. 1 er ), s'ajoutent aux éléments de base (al. 2 à 6 et 12) les éléments dits de « l'autonomie » (al. 7 à 11) : ceux d'une autonomie que l'on pourrait dire « sur-renforcée », comme la Polynésie française - et elle seule - les connaît, réunis dans le second statut d'autonomie qui la régit, depuis la loi organique, plusieurs fois modifiée, du 27 février 2004.
Le jeu subtil des qualificatifs pour marquer la nette amplification, sur vingt ans, de l'autonomie locale, à Papeete, ne doit pas tromper. C'est dans le cadre de la décentralisation territoriale d'un État qui est et qui reste unitaire, que cette autonomie de la Polynésie française aura été progressivement renforcée. Le droit des collectivités territoriales est donc, ici, en présence d'une institution encore et toujours administrative dont les autorités et les actes sont administratifs, y compris les lois du pays polynésiennes, comme cela résulte, de façon implicite, mais nécessaire, de l'alinéa 8 de l'article 74 de la Constitution relatif au « contrôle juridictionnel spécifique » du Conseil d'État 378 ( * ) .
En est-il de même de la Nouvelle-Calédonie, depuis l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, publicisé et constitutionnalisé la même année, et la loi organique statutaire, plusieurs fois modifiée, du 19 mars 1999 ? La réponse qui s'impose - on avoue avoir longuement hésité - est non. Cette autonomie est administrative bien entendu, en tant que les autorités et la plupart des actes sont aussi administratifs. Mais, elle a aussi une finalité et une dimension politiques qui ne doivent pas être méconnues et qui donnent à cette autonomie un caractère politique qu'il faut savoir reconnaître :
- il y a finalité politique de la décentralisation, construite sur l'oxymore d'une « souveraineté partagée », même si l'accord de Nouméa vient rapidement dire, avec prudence, que « le partage des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée » 379 ( * ) . Cette finalité politique repose sur le caractère transitoire des dispositions du titre XIII nouveau, dans l'attente d'une autodétermination locale qui doit être bientôt organisée 380 ( * ) , sauf à envisager, comme en 1998, un nouveau tour de passe-passe pour éviter une et, peut-être, deux consultations sur la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie 381 ( * ) , dénommée « pleine souveraineté » ou « complète émancipation » 382 ( * ) ;
- il y a aussi dimension politique de la décentralisation en tant que les lois du pays polynésiennes ne sont pas des actes administratifs puisqu'elles ont « force de loi » 383 ( * ) , sans être, pour autant, des lois, faute d'être en forme législative 384 ( * ) . Le congrès peut bien être présenté comme un corps politique 385 ( * ) , il n'est pas et ne peut pas être une assemblée parlementaire 386 ( * ) ; le contentieux des lois du pays calédonienne peut bien ressortir à la compétence du Conseil constitutionnel, par voie d'action 387 ( * ) ou par voie de question prioritaire de constitutionnalité 388 ( * ) , cela ne suffit pas à faire des lois du pays des lois à part entière ; telle juridiction administrative territoriale a pu dire qu'une loi du pays calédonienne était bien une loi 389 ( * ) , c'est là une décision d'espèce qui se heurte à des faits têtus : les lois du pays sont des règlements non administratifs qui relèvent du contentieux constitutionnel, en application d'un dispositif exprès, à cet effet, consacré par le pouvoir de révision, en 1998, du moins par voie d'action 390 ( * ) .
Il est donc possible d'évoquer, à Nouméa, une décentralisation, pas seulement administrative, mais politique qui ne suffit pas à constater un fédéralisme asymétrique, mais qui fait de la France un État autonomique dans cette seule hypothèse de la Nouvelle-Calédonie, nettement différenciée, sur ce point, de la Polynésie française. Pour autant, le moindre des paradoxes est que cette décentralisation politique ne s'accompagne pas de la démocratie politique.
B. La diversité dans la démocratie
L'autonomie locale est une liberté publique au coeur de la démocratie politique. Qui ne comprend ce que la diversité peut avoir de choquant quand elle se rapporte, en France, à une même démocratie politique, basée indistinctement, d'abord et surtout, sur le caractère universel du suffrage, tel qu'il aura fini par s'imposer tardivement, en 1944-1945 391 ( * ) ? La diversité de la démocratie oppose, en effet :
- d'une part, le suffrage universel en Polynésie française, celle qui prévaut à toutes les élections ou consultations organisées dans la collectivité, sans exclure, le cas échéant, le référendum local ou la consultation d'autodétermination de l'article 53, alinéa 3 de la Constitution ;
- d'autre part, le suffrage restreint en Nouvelle-Calédonie, propre à satisfaire une revendication des indépendantistes, principalement kanaks, appuyée sur la violence armée ou sur la menace du retour à la violence armée 392 ( * ) et dissimulée derrière le paravent de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie.
Sans doute, une telle restriction du suffrage ne vaut pas pour les élections ou consultations nationales, comme les présidentielles ou les législatives ou les référendums qui impliquent tous les nationaux français ; elle ne vaut pas davantage pour les élections municipales ou européennes où l'exclusion de non-nationaux français heurterait de front le droit de l'Union européenne 393 ( * ) . Elle vaut, en revanche, pour les élections provinciales et donc du congrès 394 ( * ) et aux référendums d'autodétermination de l'article 77, dans l'idée d'essence politique, c'est-à-dire dans l'idéologie que ces élections ou consultations qui ne concernent pas les non-nationaux français, ne sauraient inclure tous les nationaux français sur le territoire calédonien.
Ainsi, une durée de domiciliation de dix ans était déjà requise, par le statut de 1988, pour pouvoir se prononcer sur l'autodétermination en 1998, le caractère référendaire de la loi ayant alors permis, de façon peu glorieuse, d'échapper à une décision certaine d'inconstitutionnalité. Et, une fois cette consultation escamotée, à l'échéance acquise, en 1998, contre la volonté exprimée du peuple français, la même restriction du suffrage sera reprise, dix ans plus tard, mais par le biais d'une révision constitutionnelle rendue nécessaire par le choix de la voie parlementaire fait :
- d'abord, pour consulter, en 1998, les populations calédoniennes sur l'accord de Nouméa au suffrage restreint (art. 76) ;
- puis, pour élaborer une loi organique statutaire qui prévoit ce suffrage restreint à deux occasions :
. d'une part, le suffrage restreint aux élections provinciales et donc du congrès, à partir de mai 1999, conformément à cet accord 395 ( * ) et à la Constitution révisée, en 1998, et, d'ailleurs, re-révisée, sur ce point, en 2007 (art. 77) 396 ( * ) , et donc, pour la prochaine fois en date, en mai 2014 : le nombre des exclus du suffrage universel qui était déjà de 19 200 en 2009, dont 17 650 dans la province Sud, soit 18 % des électeurs, va mathématiquement augmenter encore, à cette échéance électorale. Or, sur le fondement prétendu d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation 397 ( * ) qui s'oppose tout de même à la rétroactivité de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 et donc à la remise en cause, jusqu'à cette date, du tableau annexe glissant 398 ( * ) , que peut-on entendre, depuis quelques semaines, à Nouméa, malgré le vague démenti du Premier ministre 399 ( * ) et la sage prudence des commissions administratives spéciales ? La demande, à cor et à cri, de l'un des principaux dirigeants indépendantistes, Roch Wamytan, signataire de l'accord de Nouméa et président du congrès, en faveur de la radiation de la liste électorale spéciale de plus de 5 600 non kanaks 400 ( * ) et l'inscription sur cette liste de près de 1 700 kanaks : voilà où l'on en est, de façon préoccupante et même dangereuse, un mois avant les provinciales du 11 mai 2004, alors que les tribunaux de première instance vont statuer et que la Cour de cassation, en définitive, va avoir à dire, à nouveau, un droit si étrange 401 ( * ) ;
. d'autre part, le suffrage autrement restreint au référendum d'autodétermination 402 ( * ) , à organiser, une fois au moins, à partir de mai 2014, à une échéance indéterminée, mais certaine la première fois, en tout cas à droit constitutionnel constant, tel que défini par ce même accord 403 ( * ) et par la Constitution révisée, en 1998 404 ( * ) .
En conclusion , on dira, pour paraphraser Shakespeare, qu'il y a quelque chose de pourri dans le statut de la Nouvelle-Calédonie dès lors que la décentralisation politique ne s'accompagne pas de la démocratie politique. On ne saurait être et demeurer, dans l'ensemble français, à n'importe quel prix. Et le prix du suffrage universel, le premier des droits de l'homme, est un prix bien trop élevé à payer pour pouvoir rester français quand on est opposé à l'indépendance. Expliquer la restriction du corps électoral par le fait que l'accord de Nouméa mettrait fin à la colonisation, ce qui est une lubie, et donc au peuplement, ce qui est une menace, augure fort mal des conditions de la sortie d'un faux accord qui n'est pas un facteur de paix civile, mais de division sociale, sur fond de communautarisme, sinon d'ethnicisme 405 ( * ) , et d'exclusion. On dira même qu'à de telles conditions, l'indépendance de la Kanaky est préférable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans ce qui, sur place, n'est plus la République.
A contrario, la sortie du provisoire, le plus tôt possible, par un référendum nécessaire et probable de rejet de l'indépendance - un seul suffira - devrait impliquer une révision constitutionnelle de nature à remettre en cause les révisions de 1998 et de 2007 afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de retrouver le suffrage universel, à titre principal 406 ( * ) et en toute hypothèse 407 ( * ) . Qu'alors, dans une décentralisation redevenue administrative, pas simplement administrative dans cet outre-mer non départementalisé 408 ( * ) , mais administrative quand même dans une collectivité territoriale, la Nouvelle-Calédonie conserve son statut particulier ou qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'article 74, peu importe : en droit positif, c'est l'autonomie de la Polynésie française qui, pour les républicains, est l'exemple à suivre ; c'est l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie qui, pour les démocrates, est l'anomalie à dénoncer.
Véronique Bertile, Maître de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux - Statut, institutions et ressources humaines : le cas de La Réunion
Le droit applicable à l'outre-mer a évolué vers plus d'autonomie, notion centrale aujourd'hui. En reprenant tout ce qui a été dit depuis ce matin, cette autonomie, quel que soit le qualificatif qu'on lui attribue - administrative, financière - et sans entrer dans les querelles notionnelles, s'entend comme une plus grande marge de manoeuvre laissée aux collectivités territoriales, dans une optique de développement économique et social.
Les réformes qui ont concerné l'outre-mer sont néanmoins marquées par une grande oubliée, une grande absente : la fonction publique. Et dans une réflexion qui porte sur l'autonomie locale, je ne fais pas allusion à la fonction publique d'État - bien que certaines problématiques se posent - mais plus précisément bien sûr à la fonction publique territoriale. Cette précision apportée, il faut immédiatement en apporter une autre : ce que j'entends par « fonction publique territoriale ». Le parti a été pris d'embrasser la définition la plus large possible afin d'y inclure, quel que soit leur statut (droit public, droit privé), tous les agents employés par les collectivités territoriales. En somme, les ressources humaines des collectivités territoriales, pour reprendre l'expression retenue et proposée par les organisateurs de ce colloque.
Cet « oubli » de la fonction publique territoriale dans les réformes qui ont touché l'outre-mer ne peut que susciter la perplexité quand on sait l'importance de la fonction publique territoriale dans les économies ultramarines. Les données sont connues et ont été évoquées plusieurs fois aujourd'hui : les sociétés d'outre-mer sont caractérisées par un taux de chômage élevé et le secteur privé y étant peu développé, la pression se fait plus forte sur l'emploi public. Dans un tel contexte, la fonction publique territoriale est, dans les outre-mer, un sujet d'une grande importance économique et sociale, pour trois séries de raisons au moins :
- par les emplois nombreux ;
- par les revenus distribués ;
- par les services rendus à la population.
Cette fonction publique territoriale se caractérise par la précarité des emplois 409 ( * ) outre-mer de façon encore plus prégnante qu'ailleurs. Du rapport Ripert au rapport Laffineur 410 ( * ) , de nombreuses mesures ont été proposées mais n'ont pas trouvé d'écho.
Cette importance de la fonction publique territoriale outre-mer révèle la complexité des enjeux et atteste que son absence des réformes n'est pas anodine. Ce silence est aujourd'hui assourdissant : la situation outre-mer est préoccupante, urgente et la politique de l'autruche n'est plus possible. À l'heure de l'autonomie, on ne peut plus faire l'économie d'une réflexion approfondie devant aboutir à une réforme du système en place. Le goulot d'étranglement que constitue l'emploi public local outre-mer obère toute marge de manoeuvre des collectivités locales.
Bien que partageant des traits communs, les fonctions publiques territoriales outre-mer présentent chacune des problématiques qui leur sont propres et qui tiennent à la singularité de leur situation. Immanquablement néanmoins, La Réunion est citée en exemple - ou plutôt devrais-je dire en contre-exemple. Région de France au taux de chômage le plus élevé - où il avoisine les 30 % -, La Réunion a une fonction publique territoriale qui se caractérise aujourd'hui encore par une proportion importante d'agents non titulaires, alors que ce n'est plus le cas des autres DOM qui tendent à s'aligner sur les chiffres nationaux.
La Réunion étant l'outre-mer qui tient le plus à rapprocher son statut du droit commun, faut-il faire un parallèle entre la situation de la fonction publique territoriale à La Réunion et le statut de l'île ? Dans une optique de développement économique et social, le statut tel qu'il est appliqué à La Réunion permet-il une gestion des ressources humaines efficace ?
Au gré des réformes accordant toujours plus d'autonomie aux outre-mer, La Réunion s'est astreinte à rester le plus possible dans le droit commun, en refusant dans un premier temps la procédure du congrès, puis la possibilité de dérogation législative et en n'usant que très peu des possibilités d'adaptation offertes par l'article 73 de la Constitution dont elle relève. Pour l'anecdote, je rappellerai qu'un député de l'île avait même demandé à sortir La Réunion de l'article 73, l'article 72 lui paraissait alors suffisant. On peut légitimement se demander dans quelle mesure cette position, cette crispation statutaire n'est pas contre-productive pour le développement économique et social de l'île.
En effet, on ne peut que constater que le statut de l'île, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, ne permet pas une gestion des ressources humaines efficace. La fonction publique territoriale réunionnaise est pléthorique et chère (I) ; elle doit être réformée pour permettre aux collectivités locales une gestion maîtrisée des ressources humaines (II). Et pour cela, nul besoin de changer de statut puisque l'article 73 le permet.
I. - Une fonction publique territoriale pléthorique et chère
La fonction publique territoriale réunionnaise se caractérise par un sur-effectif (A) qui reflète un contexte économique et social dégradé.
A. Pléthorique
Effectif de la fonction publique territoriale outre-mer (tous statuts confondus)
|
Collectivités |
Nombre d'agents |
Taux d'administration |
|
La Réunion |
35 000 |
4,26 % |
|
Martinique |
17 300 |
4,39 % |
|
Guadeloupe |
15 100 |
3,74 % |
|
Polynésie française |
12 619 (7 956 FPT, 4 663 FPC) |
4,7 % |
|
Nouvelle-Calédonie |
9 261 |
3,77 % |
|
Guyane |
8 000 |
3,49 % |
|
Mayotte |
7 912 |
3,72 % |
|
Saint-Martin |
864 |
2,34 % |
|
Saint-Barthélemy |
190 |
2,12 % |
|
Total |
97 046 |
|
|
National |
1 921 200 |
2,8 % |
La fonction publique territoriale dans son ensemble compte 1,9 millions d'agents, tous statuts confondus. Outre-mer, elle compte 97 000 agents, soit 5 % de la fonction publique territoriale globale. Dans les DOM (Mayotte inclus), elle compte 83 000 agents. À La Réunion, l'outre-mer le plus peuplé, la fonction publique territoriale emploie 35 000 agents.
Le taux d'administration, qui se définit comme le rapport entre les effectifs employés par les collectivités territoriales et la population totale, est de 2,8 % au niveau national, alors qu'il est de 3,8 % outre-mer. Cela fait 1 agent pour 34 habitants au niveau national, 1 agent pour 24 habitants dans les DOM, ratio que l'on retrouve à La Réunion. Ce n'est donc pas sur le nombre d'agents que La Réunion se distingue des autres DOM.
La fonction publique territoriale réunionnaise pèse en pourcentage du total des emplois : la proportion entre la fonction publique territoriale et la population active est supérieure à celle de la métropole et à celle des autres DOM (Mayotte exclue) : 7,9 % en métropole, 13 % en Guadeloupe, 14,3 % en Martinique, 15,9 % en Guyane et 17,7 % à La Réunion.
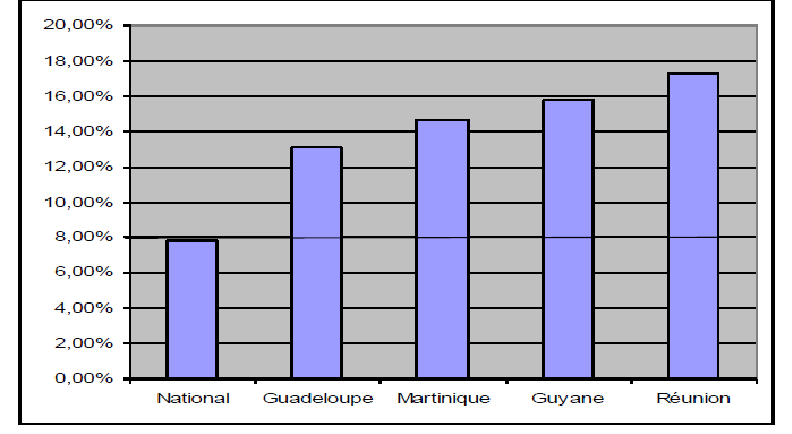
Pour le dire autrement, un travailleur sur cinq à La Réunion est un agent d'une collectivité territoriale. Il faut toutefois relativiser la comparaison entre l'outre-mer et la métropole dans la mesure où le secteur privé est peu développé outre-mer.
La structure institutionnelle de la fonction publique territoriale repose sur la catégorie juridique de l'employeur et renvoie à la répartition par type de collectivités. La fonction publique territoriale se caractérise par un grand nombre d'employeurs publics locaux : la région, le département, les communes mais aussi les établissements publics.
La Réunion
|
Communes |
63 % |
|
Département |
15 % |
|
Région |
4 % |
|
Autres |
18 % |
Autres : établissements publics départementaux (1 %), SDIS (3 %), CCAS et caisses des écoles (8 %), EPCI (6 %).
Les collectivités territoriales à La Réunion sont les principaux pourvoyeurs d'emplois sur leurs territoires : elles ont un rôle social ( « buvard social » ). La pression s'est faite particulièrement forte sur les maires, qui ont embauché de nombreux agents contractuels (1) et qui recourent massivement aux emplois aidés (2).
1. Une proportion élevée d'agents non titulaires
La proportion d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale outre-mer est supérieure à la moyenne nationale (32,5 % contre 20 %). Mais nulle part outre-mer cette proportion n'est supérieure à celle des agents titulaires, à l'exception de La Réunion.
En Guadeloupe : seulement 10 % de non titulaires parmi les agents territoriaux (89% titulaires), ce qui place la Guadeloupe bien en-deçà de la moyenne nationale. Ce faible poids est dû à une forte vague de titularisations qui a eu lieu suite aux mouvements sociaux des années 1998-1999. Auparavant les agents non titulaires représentaient 45 % des effectifs.
À Mayotte : 20 % de non titulaires (51 % titulaires, 30 % d'emplois aidés), ce qui place Mayotte dans la moyenne nationale.
En Guyane : 26 % non titulaires (72 % titulaires).
En Martinique : 36 % de non titulaires (62 % titulaires).
À La Réunion : 58 % non titulaires (42 % titulaires). La plus grande part des personnels non titulaires sont des « journaliers », « intégrés » ou « reclassés », catégories spécifiques à La Réunion.
Les « journaliers » sont des agents d'exécution recrutés de façon informelle et rémunérés sur la base du travail quotidien effectué.
2. Le recours aux emplois aidés
La Réunion se distingue aussi par le nombre important d'emplois aidés. Au niveau national, les emplois aidés représentent 3,3 % des effectifs de la fonction publique territoriale. 78 % d'entre eux travaillent dans une commune ou un établissement communal. Plus la taille de la commune diminue, plus la part des emplois aidés est importante : ils représentent 14 % des effectifs dans les communes de moins de 1 000 habitants contre seulement 1 % dans celles de plus de 100 000. C'est donc bien d'abord dans les petites communes que l'on retrouve un recours important aux emplois aidés. Or, l'outre-mer compte bon nombre de « petites » communes.
Selon l'étude du CNFPT 411 ( * ) , on constate une sur-représentation des emplois aidés dans les collectivités et établissements publics territoriaux de La Réunion, du Nord-Pas-de-Calais, de la Guyane et de la Martinique. La présence du Nord-Pas-de-Calais atteste qu'il ne s'agit pas uniquement d'une spécificité ultra-marine. Selon les derniers chiffres, la proportion d'emplois aidés serait de 2,6 % en Guadeloupe, 5,8 % en Martinique, 11 % en Guyane et 18,6 % à La Réunion. Elle atteint 30 % à Mayotte.
Ce recours aux emplois aidés a une importance telle outre-mer qu'il a été conforté par le législateur, comme l'atteste l'exemple des contrats « emplois-jeunes ». Alors que le dispositif a été supprimé en métropole, il a été prolongé pour les contrats conclus avec des collectivités territoriales ou des établissements publics des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une période de 36 mois maximum au-delà de la durée fixée initialement, par une circulaire du ministère de l'outre-mer validée par la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer 412 ( * ) .
B. Chère
Pléthorique, la fonction publique territoriale à La Réunion est également chère. Les compléments de majoration prévus initialement pour la fonction publique d'État 413 ( * ) ont été étendus à la fonction publique territoriale. Ils sont plus élevés à La Réunion que dans les trois autres DOM. Alors que la rémunération des fonctionnaires est majorée de 40 % en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, elle l'est de 53 % à La Réunion.
Cette « prime de vie chère » est composée de trois éléments :
- une majoration de traitement de 25 %, instituée par la loi du 3 avril 1950 ;
- un complément temporaire à la majoration de traitement de 5 %, institué par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des agents, porté à 15 % par le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 414 ( * ) ;
- un indice de correction, applicable uniquement à La Réunion, institué par le décret du 11 janvier 1949, modifié par le décret du 22 juin 1971. Cet indice de correction était destiné à compenser l'écart de parité entre le franc français et le franc CFA, qui avait cours localement. Depuis le retrait du franc CFA et l'introduction du franc métropolitain, intervenue le 1 er janvier 1975, le taux de l'indice de correction a été ramené à 1,138.
Par effet de conséquence, sur-rémunération et effectif pléthorique entraînent un niveau de dépenses de personnel très élevé. Les budgets locaux présentent une structure déséquilibrée, avec des charges de personnel supérieures à la moyenne nationale.
- 8 % pour les départements en métropole
- 24 % en Guadeloupe et à La Réunion
- 29 % en Martinique
- 43 % en Guyane
À La Réunion, les dépenses de personnel représentent :
- 58,7 % des dépenses de fonctionnement des communes de plus de 10 000 habitants ;
- 64,4 % pour les communes de moins de 10 000 habitants.
À titre de comparaison, en métropole, les charges de personnel représentent :
- 48,44 % pour les communes de plus de 10 000 habitants ;
- 38,05 % des frais de fonctionnement des communes de moins de 10 000 habitants.
Dépenses de personnel des collectivités locales/habitant (en euros)
|
France |
DOM |
|
|
Régions |
9 |
39 |
|
Départements |
97 |
183 |
|
Communes |
452 |
625 |
Ainsi, là où en France les régions dépensent 9 euros par habitant, les régions d'outre-mer en dépensent 39 par habitant.
Ces dépenses sont à l'origine de la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment en Guadeloupe où, sous la pression des syndicats, on a titularisé massivement. C'est bien le poids de la dépense qui handicape les collectivités situées outre-mer et non pas la faiblesse des recettes fiscales. Grâce à l'octroi de mer, les communes d'outre-mer disposent de ressources fiscales abondantes : celles-ci s'élèvent, fiscalités directe et indirecte confondues, à :
- 535 € par habitant et par an dans l'hexagone,
- 741 € en Guadeloupe,
- 827 € à La Réunion,
- 832 € en Guyane,
- 833 € en Martinique.
Il en résulte une faiblesse de l'investissement des collectivités territoriales. Et cette faiblesse de l'investissement local fragilise les économies d'outre-mer où l'investissement privé est déjà moins important qu'en métropole.
Avec une fonction publique territoriale pléthorique et chère, les collectivités territoriales à La Réunion n'ont que très peu de marge de manoeuvre pour un développement économique et social. Les possibilités d'adaptation offertes par l'article 73 de la Constitution n'ont pas été utilisées en matière de fonction publique : elles peuvent - et elles doivent - l'être, pour que les collectivités territoriales puissent avoir une gestion des ressources humaines maîtrisée.
II. - Vers une gestion des ressources humaines maîtrisée
La fonction publique territoriale engendre pour les collectivités locales des dépenses qui grèvent fortement leurs budgets et, partant, leur marge de manoeuvre. Pour parvenir à des dépenses moins lourdes, il faut donc, au regard de ce qui a été dit précédemment, réduire le nombre d'agents et leur coût. Il faut donc non seulement revoir les sur-rémunérations mais restreindre l'accès à la fonction publique territoriale.
A. Revoir les sur-rémunérations
Prévus à l'origine (1950) pour assurer le développement économique et social des départements d'outre-mer en attirant dans ces territoires des agents qualifiés, on peut s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de la pérennité de ces avantages : le contexte dans lequel ils ont été accordés n'existe plus et, ironie de l'histoire, c'est précisément le développement économique et social qui les a justifiés qui commande aujourd'hui qu'on les remette en cause.
Les sur-rémunérations créent des inégalités de traitement non pas entre fonctionnaires en poste en métropole et fonctionnaires en poste outre-mer - cette différence de traitement là est autorisée par la loi - mais entre les agents titulaires et les agents non titulaires d'une même collectivité. En effet, les agents non titulaires n'en bénéficient pas et il en résulte que dans les départements d'outre-mer un agent titulaire gagne un salaire moyen 1,6 fois plus élevé qu'un agent non titulaire. De même, ces « primes de vie chère » creusent l'écart entre les salaires du public et ceux du privé, faisant peser sur ces derniers des contraintes dissuasives.
Les sur-rémunérations pèsent de façon complexe dans les économies ultramarines. Différents rapports ont relevé tantôt leurs effets bénéfiques, tantôt leurs effets négatifs. Leur remise en cause doit nécessairement se faire dans une réforme globale et concerner non seulement la fonction publique territoriale mais également nécessairement les deux autres fonctions publiques - d'État et hospitalière -. Qu'il s'agisse du principe même de leur suppression ou moins radicalement de leur diminution jusqu'à ce qu'elles atteignent le différentiel de prix avec la métropole (proposition Laffineur), la réforme des sur-rémunérations doit s'accompagner de l'engagement corrélatif que les sommes ainsi dégagées soient réinjectées dans l'économie locale au soutien notamment de la création d'emplois dans le secteur privé.
Soulagés du surcoût du personnel, les budgets locaux pourront retrouver une respiration salutaire leur permettant de maîtriser leurs ressources humaines.
B. Restreindre l'accès à la fonction publique territoriale
Si elle a longtemps été un tabou, la remise en cause des sur-rémunérations est, depuis le rapport Laffineur, notamment davantage acceptée. La seconde mesure de maîtrise de gestion des ressources humaines fait en revanche beaucoup moins consensus et ne manquera pas de faire se lever les boucliers.
Il faut connaître la situation réelle de la société réunionnaise pour comprendre et analyser ses données économiques, à commencer par l'inquiétant taux de chômage. Contrairement à ce qu'une première déduction par trop simpliste pourrait laisser penser, ce chômage ne s'explique pas par la présumée nonchalance des Réunionnais qui ne seraient que des assistés sociaux. L'économie de La Réunion connaît un fort taux de croissance et le marché du travail est très dynamique. Le chômage est dû à la pression démographique, l'économie réunionnaise n'arrivant pas à absorber le flux de nouveaux entrants sur le marché du travail. Là encore qu'on ne se livre pas à la conclusion hâtive d'un taux de natalité qui exploserait, le taux de fécondité à La Réunion certes plus élevé qu'en métropole n'étant pas sensiblement plus haut et n'étant pas le plus élevé d'outre-mer. Les nouveaux entrants sur le marché du travail ne sont pas seulement les jeunes Réunionnais mais aussi, cela se sait moins car cela ne se dit pas, les métropolitains - jeunes et moins jeunes - qui viennent s'installer à La Réunion. Ainsi, depuis 2001, La Réunion a accueilli plus de 25 000 jeunes de 26 à 34 ans. Parallèlement, les opportunités d'un « retour au pays natal » des jeunes Réunionnais incités à la mobilité par les pouvoirs publics sont de plus en plus compromises et, à chaque rentrée scolaire, l'arrivée de métropole de milliers de professeurs alors que des jeunes sur place ont le concours est devenue le marronnier de la presse locale et la raison d'une contestation sociale qui ne cesse de croître. Ce phénomène ne se retrouve pas, ou de façon beaucoup moins sensible, dans les autres outre-mer.
Au regard de l'étroitesse du marché et de l'enclavement du territoire, la question de la restriction de l'accès à l'emploi, qu'il soit public ou privé, se pose nécessairement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la problématique telle que soulevée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française se retrouve à La Réunion. Cette restriction se pose davantage en termes de recrutement local qu'en termes de préférence régionale. En effet, recrutement local ne signifie pas préférence régionale.
La préférence régionale, considérée comme contraire au principe d'égalité, n'a été juridiquement acceptée que dans le cadre très particulier de la Nouvelle-Calédonie. Conformément à l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 415 ( * ) , la Constitution 416 ( * ) reconnaît la citoyenneté néo-calédonienne et crée, au profit des citoyens néo-calédoniens, un droit préférentiel d'accès aux emplois locaux qui vaut aussi bien pour le secteur privé que pour la fonction publique territoriale 417 ( * ) .
Un tel accès préférentiel aux emplois publics locaux n'a pas été consacré en Polynésie française. La loi organique du 27 février 2004 a néanmoins prévu que « à égalité de mérites » 418 ( * ) , la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières. Une telle discrimination positive est toutefois strictement contrôlée : dans un arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'État a annulé une loi du pays prévoyant que le recrutement des fonctionnaires de la Polynésie française par concours externe s'effectue par voie de deux concours dans les cadres d'emplois des catégories A (à l'exception de ceux qui relèvent des filières de la santé et de la recherche), B, C et D, dont l'un est ouvert aux seuls résidents à hauteur de 95 % des postes à pourvoir 419 ( * ) .
La Réunion peut s'inspirer de ce mécanisme polynésien. Et son statut tant de DROM que de RUP le lui permet. Principe d'égalité et statut de l'article 73 ont tous deux valeurs constitutionnelles et doivent être conciliés. Ils peuvent l'être, sans que la République soit menacée de désintégration.
Les deux mesures proposées de réforme de la fonction publique territoriale peuvent par ailleurs être liées : la remise en cause de la sur-rémunération rendra peut-être la fonction publique territoriale réunionnaise moins attractive aux yeux des métropolitains.
Le statut de La Réunion n'est en rien un obstacle à une réforme de la fonction publique territoriale en vue d'une meilleure gestion des ressources humaines par les collectivités territoriales. Le cadre juridique le permet ; tout est maintenant question de volonté politique.
Bertrand Beauviche, Président de section à la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, Chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon - L'autonomie fiscale sous le regard du juge financier
Les juridictions financières, dans le cadre de leurs travaux et à travers le prisme de la bonne gestion des deniers publics, s'intéressent aux dynamiques institutionnelles. Le rapport thématique particulier sur la conduite par l'État de la décentralisation de 2009 420 ( * ) s'inscrit dans ce type de travaux, plus récemment le rapport thématique particulier sur l'autonomie fiscale en outre-mer 421 ( * ) , relève également de cette catégorie.
Ces travaux visent à mieux appréhender les particularités des dynamiques institutionnelles des collectivités territoriales dans leur dimension financière et budgétaire.
En effet, la dynamique institutionnelle des collectivités d'outre-mer (COM) 422 ( * ) et de la Nouvelle Calédonie (NC) est complexe, chaque collectivité à sa spécificité ce qui rend une approche transversale et les comparaisons assez difficiles entre elles.
La compétence fiscale est emblématique du caractère spécifique du statut de ces collectivités. Il s'agit d'une caractéristique commune aux COM et à la Nouvelle-Calédonie. Cette spécificité dont l'origine réside dans le régime financier propre aux colonies françaises (consacré par la loi du 13 avril 1900, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1900) prospère depuis 1946 dans le cadre juridique constitutionnel des territoires puis collectivités d'outre-mer, contenu aux articles 74 de chacune des constitutions en vigueur et spécifiquement dans le chapitre XIII de celle de 1958, depuis 1998 pour la Nouvelle Calédonie.
Selon ces dispositions, la compétence en matière fiscale et de droit de douane relève ainsi des intérêts propres de ces collectivités.
C'est sans nul doute l'une des compétences les plus structurantes de la vie financière budgétaire économique et sociale de ces territoires.
Tous ces éléments ont donc conduit le juge financier à s'intéresser à cette compétence, et ce, tant dans son exercice que dans son institutionnalisation, (récente dans certains territoires), dans le cadre du rapport public thématique ci-dessus évoqué, fruit d'une collaboration de l'ensemble des chambres territoriales des comptes et de la Cour des comptes, dont la première et la quatrième chambres, respectivement en charge de la politique fiscale et de Wallis-et-Futuna.
Il s'agit du premier travail transversal à l'échelle de l'ensemble des juridictions financières sur ce sujet. Toutefois, certaines chambres territoriales avaient déjà précédemment traité, en tout ou partie, cette thématique dans le cadre leur travaux d'examen de la gestion 423 ( * ) . Le juge financier a eu également à traiter de cette compétence, plus exceptionnellement, dans le cadre de contrôles budgétaires 424 ( * ) .
Dans une première partie nous exposerons les grandes lignes dégagées par ce rapport concernant l'autonomie fiscale. Dans une seconde partie nous reviendrons sur certains points évoqués dans le rapport ou concernant d'autres travaux des juridictions financières relatifs à la compétence fiscale pour essayer d'en souligner les liens avec la thématique de notre atelier autonomie institutionnelle outre-mer : diversité et complexité.
A. Les grandes lignes du rapport
Le rapport s'articule autour du constat que la fiscalité des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie est atypique à l'image de son contexte et qu'il s'agit d'une fiscalité insuffisamment adaptée aux besoins des territoires. Le rapport dresse ensuite les voies d'une fiscalité plus performante.
L'autonomie fiscale, une compétence atypique.
Au sein de la République française, ces territoires ont la particularité de pouvoir créer l'impôt et de conduire la politique fiscale de leur choix. Cette compétence leur est reconnue par la Constitution.
Malgré leur singularité, ces collectivités présentent les caractéristiques suivantes :
Leurs économies sont relativement fragiles, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie qui exploite le nickel ou de Saint-Barthélemy grâce au tourisme de luxe.
Leurs taux de prélèvements obligatoires atteignent un niveau significatif, sauf pour des raisons particulières à Wallis-et-Futuna et à Saint-Martin ; ils ne sont inférieurs que de 10 à 15 points aux taux constatés en métropole (45 % en 2012) ; pour autant, ces territoires n'assurent ni les dépenses régaliennes, ni la prise en charge de la totalité des dépenses publiques transférées (exemple : rémunération des personnels de l'éducation).
Leurs systèmes fiscaux se caractérisent par une fiscalité indirecte plus importante, héritée de leur histoire propre et une imposition des patrimoines relativement plus faible qu'en métropole.
La Cour et les chambres territoriales des comptes font les constats suivants :
1. L'exercice de l'autonomie fiscale se heurte à de nombreuses difficultés de gestion liées à la complexité de la matière fiscale et au format trop restreint des administrations qui s'y consacrent ;
2. Toutes ces collectivités, à l'exception de Saint-Barthélemy, sont confrontées à la difficulté de déterminer le bon niveau des prélèvements obligatoires, pour répondre au mieux à la double nécessité de contribuer à leur développement économique et d'équilibrer les budgets ;
3. La conciliation des objectifs de politique fiscale s'avère délicate, au point parfois d'affecter le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt, en raison notamment des multiples exonérations et niches fiscales. Dans certains territoires, le rendement fiscal en est amoindri, allant parfois jusqu'à compromettre les équilibres budgétaires des collectivités.
Face à ces constats, la Cour et les chambres territoriales recommandent que chaque collectivité ultramarine s'attache, pour ce qui la concerne, le cas échéant avec le concours de l'État, à :
- améliorer la connaissance des assiettes taxables de toute nature (revenu, consommation, patrimoine) ;
- ajuster aux besoins les moyens consacrés à l'administration de l'impôt, notamment ceux dédiés à la production de la norme, du contrôle fiscal ainsi que du recouvrement ;
- procéder à une revue des exonérations fiscales, afin de mieux en apprécier l'efficacité et de simplifier le droit applicable.
En outre, dans le respect des prérogatives fiscales de ces collectivités ultramarines, la Cour et les chambres territoriales suggèrent d'accompagner les nécessaires adaptations des systèmes fiscaux d'un effort de maîtrise des dépenses publiques.
La diversité et la spécificité des contextes, des territoires et des économies interdisent toute approche uniforme et globalisante.
Les mesures fiscales recommandées peuvent ainsi aller de simples aménagements, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, à une réforme plus profonde, à l'instar de celle engagée en Nouvelle-Calédonie ou qui vient d'être amorcée en Polynésie française ; la réforme du système fiscal de Wallis-et-Futuna doit, par ailleurs, s'inscrire dans le cadre plus large de la modernisation de son statut, devenu nécessaire depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
B. L'autonomie fiscale dans le cadre d'une dynamique d'autonomie institutionnelle
Au-delà des constats et analyses précédemment évoqués, le rapport évoque plusieurs points spécifiques au transfert et à l'exercice de la compétence fiscale qui en révèlent toute la complexité.
Ce rapport évoque tout d'abord les difficultés inhérentes au transfert de cette compétence.
Deux catégories de collectivités sont distinguées :
- Tout d'abord les collectivités où l'institution de cette compétence fiscale est très ancienne et remonte au XIX e siècle. II en est ainsi pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna 425 ( * ) . Dans ces collectivités, le transfert de la compétence s'est réalisé dans un contexte de charges transférées relativement limitées.
Dans ces collectivités, la reconnaissance de cette compétence s'est accompagnée, comme l'ensemble des collectivités territoriales, de modalités de soutiens financiers et matériels de l'État fréquemment adaptées à leur scaractéristiques statutaires ou contextes particuliers.
Ainsi au fil du temps ont été instituées diverses dotations spécifiques (dotation d'autonomie en Polynésie, dotation de construction des collèges en Nouvelle-Calédonie...) et pour l'équipement, un soutien financier de l'État contractualisé dans le cadre de contrats de développement.
Leur structure budgétaire s'est ainsi construite sur une longue période.
- La deuxième catégorie concerne les collectivités où cette compétence a été récemment transférée qui concerne Saint-Barthélemy et Saint Martin.
À la différence de leurs consoeurs, l'accès à la compétence fiscale pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin s'est effectué dans une approche financière plus globale et selon les principes de transfert des compétences inspirés du droit commun de la décentralisation. En effet, les transferts de charges et de recettes correspondant aux nouvelles compétences exercées se sont réalisés selon les principes consacrés constitutionnellement en 2003 à l'article 72-2 et en particulier l'alinéa selon lequel « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi . »
En 2011, il résultait de l'application de ces dispositions pour les deux collectivités caribéennes un montant des charges transférées inférieur à celui du montant des recettes transférées et ce quand bien même les recettes fiscales ont été estimées au regard de la fiscalité perçue antérieurement. Le différentiel entre les recettes et les dépenses s'est ainsi soldé, pour chacune des collectivités concernées par la détermination d'une dotation de compensation de transfert de charges, négative et pérenne qu'il leur incombe désormais de verser annuellement à l'État.
Ces modalités donnent lieu à diverses contestations que les juridictions constitutionnelle et administratives s'emploient à trancher. Le Conseil constitutionnel s'est notamment récemment prononcé 426 ( * ) dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la collectivité de Saint-Barthélemy, portant sur le 3° du paragraphe II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Le juge financier souligne ainsi la particularité de la compétence fiscale dans ces collectivités et recommande que son projet de transfert donne lieu à des études de faisabilité ou d'impact préalables. Le rapport évoque également les particularités qui s'attachent à la structure des finances publiques propres à certains territoires
À ce propos, et cela n'est pas neutre dans une vie financière et budgétaire, le rapport évoque les particularités qui s'attachent aux transferts de compétences importantes sans que leurs contreparties financières soient réalisées et qui, pour l'essentiel, sont mises en oeuvre sous la forme de mises à disposition gratuites de services ou de personnels, notamment en matière d'enseignement secondaire.
Les volumes budgétaires concernés sont particulièrement conséquents et pourraient, au-delà de leur compensation financière, avoir dans le temps un impact sur la compétence fiscale qui aujourd'hui pourvoit à alimenter plus de 70 % des recettes des budgets de ces collectivités.
Au titre des complexités ou difficultés identifiées, ce rapport évoque également la question de l'impact des dynamiques institutionnelles infra territoriales au sein de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le développement des communes de Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit désormais dans un cadre juridique fortement inspiré du modèle métropolitain. Cette évolution qui concerne, avec quelques particularités, également les provinces de Nouvelle-Calédonie et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, doit s'accompagner des moyens financiers correspondants.
Ces derniers, dont l'essentiel est aujourd'hui issu du prélèvement fiscal territorial, ne répondent plus totalement aux exigences de financement liées aux compétences désormais exercées. Les collectivités infra-territoriales de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon évoluent dans un système de financement ne laissant au secteur local que des ressources fiscales limitées, sur lesquelles elles ne disposent que d'une capacité d'initiative encadrée.
Les modes d'allocation de ressources centralisées qui ont été associés aux statuts laissent à ce jour peu de place au déploiement d'une fiscalité locale et devraient peut-être évoluer selon des principes plus conformes aux principes de la décentralisation.
Enfin, ce rapport dresse le contexte financier dans lequel s'inscrit cette compétence et le fait que sa modernisation s'inscrit aussi dans la nécessité d'agir sur d'autres déterminants des finances publiques et en particulier les dépenses rappelant en cela les limites de cette compétence.
Pour conclure et en résonance avec ce dernier point, il doit être rappelé que le juge financier peut être appelé à exercer cette compétence dans le cadre du contrôle budgétaire (pour rééquilibrer un budget par exemple). Cela ne s'est toutefois, jusqu'à présent, jamais réalisé.
Certains avis budgétaires ont seulement préconisé l'augmentation de certains produits fiscaux laissant aux collectivités le soin d'y procéder. Il en est ainsi par exemple de l'avis n° 2011.0082 de la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin qui considère, au titre des mesures de redressement, « qu'en conséquence les recettes fiscales de la collectivité doivent être augmentées ; que notamment le relèvement du taux de la TGCA de deux points permettrait sur une année pleine des produits supplémentaires de l'ordre de 6 M€ permettant de résorber le déficit ; ».
Il apparaît en effet que les déséquilibres budgétaires et financiers de Saint-Martin en 2011 et 2012, s'ils ont donné lieu à des avis budgétaires préconisant diverses mesures de redressement, ont été accompagnés d'une convention de restructuration financière entre l'État et la collectivité.
Cette convention a mobilisé, notamment, une avance exceptionnelle de l'État en contrepartie d'engagement d'adoption de diverses mesures d'économie ou fiscales, suivant en cela les recommandations du juge financier.
Il demeure cependant que l'alternative d'une intervention plus contraignante du juge financier en matière fiscale pour rétablir un équilibre altéré, dans le cadre d'un avis budgétaire, constitue le droit commun.
CONCLUSION
Jean-Luc Albert, Professeur de droit public à l'Université d'Auvergne
Le choix du terme « kaléidoscope » par les organisateurs de ce colloque amène par lui-même à nombre d'interrogations introductives.
Pourquoi ce terme ?
Les dictionnaires définissent celui-ci comme étant « un instrument cylindrique dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre colorié qui en se réfléchissant sur un jeu de miroirs angulaires disposés tout au long du cylindre, y produisent d'infinies combinaisons d'images aux multiples couleurs » ; mais il peut s'agir aussi d'une « succession rapide et changeante d'impressions, de sensations » ( Robert, Langue française ).
Est-ce exactement à l'un de ces deux sens que pensaient les organisateurs du colloque ?
Le choix des mots et donc des titres est important.
Le concept d'autonomie est largement utilisé tant s'agissant de la capacité humaine à se mouvoir, à décider notamment pour soi-même, que dans la matière administrative, institutionnelle, et il n'était pas inutile de s'interroger d'abord sur les fondements de l'autonomie, puis les sens qui lui sont donnés et ses dimensions fonctionnelles sous le couvert de la libre administration.
En somme, ce sont les multiples couleurs du concept, jusque et y compris dans ses dimensions ultramarines, que les organisateurs ont choisi d'explorer et ce dans un schéma qui reste fondé sur une mécanique unitaire et centralisée dans la décision institutionnelle et administrative avec l'absence d'une capacité d'auto-organisation administrative et institutionnelle.
De multiples couleurs ?
Soit !
Mais alors n'aurait-on pu avoir recours, si l'on se réfère à un bien, une représentation, une image, à l'adjectif « polychrome », « qui est de plusieurs couleurs » conduisant alors au nom de polychromie « état de ce qui a plusieurs couleurs » ; mais alors si les organisateurs du colloque ont choisi des présentations successives d'images autour de la construction de l'autonomie locale à la fois dans ses fondements et sa mise en oeuvre notamment en outre-mer et donc de nous montrer une sorte de boule à multiples facettes, n'aurait-on pu aussi du fait de cette succession d'images avoir recours à un autre terme, celui de « kinescope », le kinescope étant dans sa définition la plus ancienne « un appareil permettant de voir des photographies avec reconstitution du mouvement » ( Larousse ).
Certes, mais s'il existe un mouvement, est-il réellement identifiable et a-t-il une direction précise, voulue, ou bien s'agit-il d'un mouvement multidirectionnel ? Et quels sont les objectifs d'un tel processus ?
Ce faisant, c'est à l'image de la toupie colorée que ces quelques réflexions m'ont conduit avec cette image d'une toupie qui comporte sept couleurs mais qui, lorsqu'elle tourne très vite, donne le sentiment, pour celui qui regarde le mouvement accéléré, d'une fusion des couleurs en la couleur « blanche », laquelle est en fait l'addition de toutes les couleurs ; mais alors, a contrario, cela nous amène aussi à appréhender ce questionnement sous l'angle de l'arc-en-ciel qui est une fragmentation dans le ciel de la lumière « blanche » en ces sept couleurs.
De fait, les nombreuses études qui ont structuré le colloque de ce jour mènent-elles à une polychromie de l'autonomie locale ou à une unicité non avouée ?
Ou bien s'agit-il de voir celle-ci sous le prisme de l'oeil de la mouche structuré en de multiples facettes ?
De nombreuses études ont déjà été consacrées à l'autonomie locale y compris dans ses dimensions ultramarines, et même sur le plan financier.
Rappelons cependant ici ce point de départ historique et particulier de l'analyse qu'est, s'agissant de la France, le décret des 8 et 10 mars 1790 qui autorise les colonies à faire connaître leur voeu sur la constitution, la législation et l'administration qui leur conviennent.
Le propos introductif de ce texte est clair : « l'Assemblée nationale... déclare que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a cependant jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières », l'article 1 er de ce décret précisant que « chaque colonie est autorisée à faire connaître son voeu sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitants, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leur intérêts respectifs » 427 ( * ) .
La question ne porte donc pas d'abord sur l'identification d'un modèle standard de l'autonomie y compris pour les outre-mer mais de savoir si des principes généraux communs, des règles communes 428 ( * ) , similaires peuvent sous-tendre cette autonomie dans sa diversité et ce en connaissant les limites qui sont destinées à maintenir une sorte de lien commun, de pacte commun, fondateurs d'une forme d'identité principielle.
De fait, le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 portant modification du sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies, de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion avait conféré au conseil général un large champ d'autonomie décisionnelle et notamment la faculté de voter « les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie » ; cependant, ils ne sont rendus exécutoires que par décret de l'Empereur et se doivent selon les commentateurs de l'époque de respecter les traités de commerce conclus par la France ; pour autant, il est alors aussi précisé que les « colonies recouvrent le droit de faire les tarifs de douanes, dans les mêmes conditions que, pour la métropole, le Corps législatif a le droit de faire des tarifs. Mais la question constitutionnelle du droit du souverain est réservée dans l'un et l'autre cas et ne saurait en aucune façon être engagée » 429 ( * ) .
Or, si dans certains domaines l'outre-mer français a pu connaître dans le passé une autonomie décisionnelle plus grande qu'actuellement, et si se font jour depuis un certain nombre d'années différentes réflexions en outre-mer sur des autonomies différenciées 430 ( * ) , les administrés concernés doivent pouvoir disposer de garanties similaires sans que la différenciation ne remette en cause des schèmes et valeurs communs qui fondent la société française, sauf à ne plus vouloir adhérer au pacte commun, au socle commun, et il vaut mieux alors se séparer.
En ce sens, le Conseil constitutionnel a posé quelques garde-fous essentiels qui fondent un socle commun que l'autonomie « locale » ne saurait « écorner ».
Ainsi a-t-il rappelé au travers des considérants 25 et 26 de sa décision du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 431 ( * ) , que :
« 25. ... ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques et par suite l'ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ;
« 26. ... et que le législateur ne pouvait dès lors limiter la compétence de l'État aux seules garanties fondamentales des libertés publiques ... » ; le Conseil constitutionnel devant déclarer contraire à la Constitution le mot «fondamentales». »
Qui ne saurait, en outre, oublier la décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dont les considérants 5 et 6 ont rappelé que :
« 5. ... ainsi que le proclame l'article 1 er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;
et que : « 6. ... ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance » 432 ( * ) .
Faut-il enfin rappeler la célèbre jurisprudence Préfet de l'Allier contre commune de Bellenaves, ma commune, aux termes de laquelle et selon l'analyse de la CAA de Lyon, il n'appartient pas à un conseil municipal de limiter la portée d'un traité sur le territoire de sa commune même si celui-ci est susceptible d'emporter des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, une telle prérogative ne relevant que des compétences de l'État, ou en vertu de traités internationaux en vigueur, de l'Union européenne 433 ( * ) .
Cette dimension identitaire a encore été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe 434 ( * ) , Conseil qui soulignait alors que l'article I-5 du traité, énonçait que l'Union « respecte l'identité nationale des États membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » et que la Charte des droits fondamentaux de l'Union, « conformément au paragraphe 4 de l'article II-112 du traité, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres », « ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions », sont dès lors respectés les articles 1 er à 3 de la Constitution qui s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance.
Ainsi, très progressivement s'est dessiné une sorte de bloc identitaire, constituant les piliers, les fondations d'une appartenance collective que l'autonomie locale ne saurait remettre en cause, autonomie souvent revendiquée dans le contentieux constitutionnel et qui a finalement conduit à peu de censures 435 ( * ) .
C'est d'ailleurs dans cette optique que la révision constitutionnelle de mars 2003 réformant en particulier l'article 72 de la Constitution et introduisant notamment une faculté pour les collectivités territoriales de pouvoir, sur une habilitation législative, déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences 436 ( * ) , faculté il faut le reconnaître peu sollicitée depuis dix ans, s'accompagnait d'interdits précis s'agissant des conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou l'exercice d'un droit constitutionnellement garanti.
Il est vrai que le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique relative à cette expérimentation devait admettre que le pouvoir constituant puisse introduire dans la Constitution des dispositions nouvelles dérogeant à des règles ou principes de valeur constitutionnelle et, en l'espèce notamment, au principe d'égalité ; mais là encore le Conseil émettait des réserves tenant aux articles 7, 16 et 89 de la Constitution 437 ( * ) , reprenant en cela l'approche qui avait été la sienne dans sa décision de 1999 relative à la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie 438 ( * ) .
De fait, les apports foncièrement novateurs de la révision de 2003 n'ont guère été mis en pratique, quid de la subsidiarité, du pouvoir réglementaire local, de ce droit à l'expérimentation normative... ?
Des autonomies ultramarines différenciées, certes pourquoi pas.
Le colloque a fait apparaître les fondements juridiques d'une telle faculté, ses dimensions fonctionnelles, et la diversité des itinéraires.
Mais, au-delà du questionnement sur l'exercice de compétences de proximité, sur l'affirmation d'identités propres à des populations au sein d'autres populations et sur l'affirmation de dimensions identitaires culturelles, quelle est la portée de ces différenciations et quel en est le sens ?
À cet égard, la loi organique du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 439 ( * ) n'a pas fait que montrer le développement de fortes différenciations juridiques et de compétences particulières comme celle relative à la création d'autorités administratives indépendantes ; elle a aussi, à l'inverse, contribué à intégrer dans ce territoire, et pourquoi ne le mettrai-je pas en avant, « avec des adaptations » certes, des règles analogues à celles régissant les collectivités locales « standards » comme sur le plan des règles budgétaires, l'organisation financière et comptable, le contrôle des juridictions financières, le statut de l'ordonnateur... amenant la Nouvelle-Calédonie à une dimension fonctionnelle très similaire à celle des autres collectivités territoriales 440 ( * ) .
Dès lors, les deux questions essentielles ne sont pas « comment » et « par quels moyens », mais pourquoi l'autonomie et pour quoi faire ?
Sur ce point, on pourrait ébaucher une réponse qui n'est pas forcément avouée ni toujours plaisante.
Il n'est pas interdit de penser que les outre-mer français, loin d'être pluriels et polychromes, évoluent vers des statuts juridiques très similaires voire identiques et de fait sur un modèle monochrome.
Sans le dire vraiment, sans peut-être toujours l'avouer et peut-être en estimant que les statuts divers actuels qui ont été présentés à l'occasion de ce colloque ne sont que des statuts transitionnels, et sans oser proposer le passage à un modèle fédéral, solution qui n'a jamais été retenue y compris lors des discussions tournant autour de l'écriture de la Constitution de la V e République, c'est sans doute - et cette affirmation va être inévitablement combattue - vers une sorte de « modèle » calédonien que se tournent nombre de responsables des collectivités ultramarines, à tout le moins si l'on s'en tient à certaines suggestions, remarques, voire comportements collectifs.
Contrôle du marché du travail local, adaptation territoriale des concours de la fonction publique nationale, capacité à maîtriser un certain commerce extérieur avec une dimension douanière spécifique 441 ( * ) , soustraction à certaines exigences de l'Union européenne, règlementation économique locale accentuée, fiscalité spécifique font partie de ces « revendications » (et au-delà des considérations identitaires symboliques) qui doivent amener à asseoir une autonomie locale renforcée qui ne reposera pas seulement sur l'exercice local d'un ensemble de compétences mais aussi et sans doute surtout sur une capacité à élaborer la norme, traductrice d'une politique définie localement, en somme à disposer de la compétence de la compétence, conduisant ainsi à quelque peu égratigner des attributs souverains.
LE PROGRAMME DE LA RENCONTRE



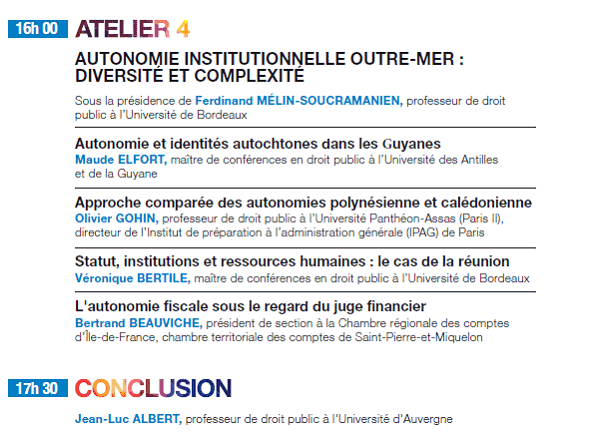
* 1 « La décentralisation a une valeur démocratique puisqu'elle se ramène à faire gérer le maximum d'affaires par les intéressés eux-mêmes ou par leurs représentants ». G. Vedel, Droit administratif, Paris, PUF, 1961, p. 460.
* 2 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 9 ème édition, 1919, p. 175.
* 3 B. Thomas, Les vies d'Alexandre Jacob, Fayard, Paris, 1998, p. 137 et 138. Alexandre Jacob est réputé notamment pour avoir établi un réseau appelé « Les Travailleurs de la nuit » capable d'opérer dans plusieurs localités simultanément, et d'organiser toutes les suites des cambriolages (fuite, revente des objets volés, protection des bandits, etc.).
* 4 R. Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'État, Paris, CNRS Éditions, 1985, 1530 p.
* 5 F. Fournier, Recherche sur la décentralisation dans l'oeuvre de Maurice Hauriou, LGDJ, 2005, 656 p.
* 6 Loi constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation décentralisée, JORF, 29 mars 2003, p. 5568.
* 7 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JORF, 17 août 2004, p. 14545.
* 8 http://www.senat.fr/ct/ct04-03/ct04-030.html#toc0.
* 9 H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l'État, Paris et Bruxelles, LGDJ et Bruylant, 1997, p. 355.
* 10 Statut d'autonomie et titre XIII.
* 11 Le président de la République a affirmé que « les régions se verront confier un pouvoir réglementaire local d'adaptation », ce qu'avait déjà annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors de l'adoption du Pacte d'avenir pour la Bretagne, en décembre à Rennes. Il s'agit de « donner encore plus de libertés aux élus pour travailler », selon lui.
* 12 V. G. Bigot, L'administration française, politique, droit, société, 1789-1870, Lexis-Nexis, 400 p.
* 13 N. Foulquier, Maurice Hauriou, constitutionnaliste, jus politicum, n° 2, 2009, p. 8.
* 14 Cons. Constit., décision n° 79-104 du 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie ; Cons. Constit. Décision n° 82-137 du 25 février 1982, Décentralisation).
* 15 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2 ème édition, 1929, p. 625.
* 16 C. Bacoyannis, principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, Economica, PUAM, 1993.
* 17 J. Barthélémy, Les tendances de la législation sur l'organisation administrative depuis un quart de siècle, RDP, 1909, pp. 150-151.
* 18 V. M. Bourjol, Jurisclasseur Collectivités locales, Constitution, n° 46.
* 19 V. note L. Favoreu, La problématique constitutionnelle des projets de réforme des collectivités territoriales, RFDA, 1990, p. 400 ; M. Bourjol et S. Bodart, Droit et libertés des collectivités territoriales, Masson, 1984, pp. 34-35.
* 20 C. Bacoyannis, op. cit. p. 100.
* 21 Le Conseil constitutionnel a veillé au respect de ces prérogatives de l'État (décision n° 82-137 DC du 25 février 1982).
* 22 Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 et n° 87-241 du 19 janvier 1988.
* 23 Décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 et n° 98-407 DC du 15 janvier 1998 ; décision n° 95-358 DC du 26 janvier 1995.
* 24 Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
* 25 Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.
* 26 Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 ; Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 ; Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998.
* 27 A. Roux & L. Favoreu, op. cit. p. 6.
* 28 E. Gaziaux, L'autonomie en morale : au croisement de la philosophie et de la théologie, Presse universitaire de Louvain, 1998, p. 360.
* 29 V. Ch. Roig, Théorie et réalité de la décentralisation, Revue française de science politique, 16 ème année, n° 3, 1966, p. 447.
* 30 O. Guichard, Vivre ensemble, Rapport de la Commission de développement des responsabilités locales, Paris, La documentation française, 1976, t. 1, « Rapport », 432 p.
* 31 G. Protiere, La puissance territoriale : contribution à l'étude du droit constitutionnel local, Thèse, 30 juin 2006, Lyon II, 544 p.
* 32 B. Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France (1815), in M. Gauchet, De la liberté chez les modernes : écrits politiques, Paris, Hachette, Pluriel, 1980, p. 263.
* 33 G. Bacot, L'apport de Tocqueville aux idées décentralisatrices, in L. Guellec, Tocqueville et l'esprit de la démocratie, Presses de Sciences Po, 2005, p. 208.
* 34 M. Hauriou, op. cit. p. 171.
* 35 Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, JORF n° 175 du 30 juillet 2004, p. 13561.
* 36 M-J Redor (dir.), L'ordre public : Ordre public ou ordres publics. Ordre public et droits fondamentaux, Actes du colloque de Caen des jeudi 11 et vendredi 12 mai 2000, Bruylant, 2001, 415 p., et principalement les articles de Étienne Picard, « Introduction générale : la fonction de l'ordre public dans l'ordre juridique », pp. 17 à 61 et Jean-Manuel Larralde, « La constitutionnalisation de l'ordre public », pp. 213 et s.
* 37 À titre d'exemple, l'article 73 de la Constitution.
* 38 L'article 2 de ladite Charte, intitulé Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale, dispose que : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution ».
* 39 À ce propos, Alain Delcamp la définit comme « un élan plus qu'un carcan », in La Décentralisation française vue d'Europe. La France et la Charte européenne de l'autonomie locale, colloque organisé sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat, et du Conseil d'Europe, Paris, Palais du Luxembourg, 26 juin 2001, Sénat, p. 20.
* 40 JM Auby, Jean-Marie Auby, in J. Moreau et G. d'Arcy, La libre Administration des collectivités locales. Réflexion sur la décentralisation, Economica, Presse universitaire d'Aix-Marseille, 1984, p. 93.
* 41 L. Ngomo Tsimi, L'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées : l'exemple du Cameroun , Thèse, septembre 2010, Université Paris-Est, p. 7.
* 42 M. Joyau, De l'autonomie des collectivités territoriales françaises. Essai sur la liberté du pouvoir normatif local , (Préface de Jean-Yves Vincent), Bibliothèque de Droit Public, tome 198, p. 1.
* 43 Ch. Eisenmann, Centralisation et Décentralisation. Esquisse d'une théorie générale, Paris, LGDJ, 1948.
* 44 J. Thalineau, Essai sur la centralisation et la décentralisation : réflexions à partir de la théorie de Charles Einsenman, Thèse, 21 février 1994, p. 11 et p. 34 et s.
* 45 Ch. Einsenmann, Centralisation - décentralisation, Dalloz, 1948, p. 8.
* 46 M. Bourjol, Libre administration et statut de la fonction publique locale, Actes du colloque d'Angers, Cahiers du C.F.P.C., n° 13, octobre 1983, p. V.
* 47 M. Troper, Système juridique et État, Archives de philosophie du droit, tome 31, Sirey, 1986, p. 41.
* 48 B. Faure, Le pouvoir réglementaire des collectivités locales, Thèse dactylographiée, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1992, p. 7.
* 49 M. Waline, Droit administratif, 8 ème édition, Sirey, 1958, p. 266.
* 50 Loi organique n° 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, J.O.R.F., 2 août 2003, p. 13217.
* 51 L. Dauphin, Collectivités territoriales et expérimentation, Thèse, Université de Limoges, 4 décembre 2008, p. 191.
* 52 V. Jacqueline Montain-Domenach, La reconnaissance d'un pouvoir normatif régional : entre utopie et principe de réalité, Pouvoirs locaux, n°86/2010, p. 54 et s.
* 53 Commissariat Général du Plan, Regards prospectifs sur l'État stratège, La documentation française, 2004, 208 p.
* 54 P. Mauroy, Refonder l'action publique locale, Rapport au Premier ministre, La Documentation française, 2000, p. 20.
* 55 Premier Ministre, La stratégie d'organisation à cinq ans de l'administration territoriale de l'État, juin 2013, p. 22.
* 56 V. Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique, 25 ans de la réforme de la gestion publique dans les pays de l'OCDE : convergence et systémique, mai 2006, p. 11.
* 57 Sénat, Rapport d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République, 8 octobre 2013, p. 38.
* 58 Cité par G. Koubi, À mi-chemin entre État centralisé et État régionalisé... "Bribes" - (re)lecture d'un rapport de février 2006..., Droit des collectivités territoriales, 19 janvier 2009.
* 59 Pasquier, R. ; Simoulin, V. ; Weisbein, J., 2007, La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories , LGDJ ; Voir aussi, Daniel, J., 2012, « La gouvernance territoriale aux Antilles et en Guyane : indétermination d'une notion, transformation de l'action publique », in, Elfort, M. ; Roux, V., 2012, La gouvernance territoriale dans les régions et départements français d'Amérique , PUAM, p. 13.
* 60 Delblond, A., 2012, « Autonomie locale et gouvernance territoriale outre-mer », in, Elfort, M. ; Roux, V., 2012, La gouvernance territoriale dans les régions et départements français d'Amérique , PUAM, p. 151.
* 61 Moreau-Desfarges, Ph., 2010, La gouvernance , PUF.
* 62 Krugman, P., 1998, L'économie auto organisatrice , Collection Balises, De Boeck Université.
* 63 Résolution n° 2 sur la gouvernance territoriale : renforcement des capacités d'intervention par une meilleure coordination, adoptée à la 14 e session de la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire (CEMAT) des États membres du Conseil de l'Europe, à Lisbonne (Portugal), le 27 octobre 2006.
* 64 L'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et pacifique (ACP) a été signé le 23 juin 2000 dans la capitale du Bénin.
* 65 Il a par exemple été beaucoup question de « l'autonomie des universités » au moment du vote de la loi LRU, sans que n'ait été véritablement défini ce concept d'autonomie.
* 66 Le Lidec, P., 2007, « Le jeu du compromis : l'État et les collectivités territoriales dans la décentralisation en France », Revue française d'administration publique 1/2007 (n° 121-122), p. 111-130.
* 67 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
* 68 Dictionnaire, Petit Larousse.
* 69 Dictionnaire, Petit Robert.
* 70 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
* 71 Le principe est posé par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution : « dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». De même, l'article 34 de la Constitution précise que « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Enfin, le principe de libre administration a reçu une pleine valeur juridique avec la décision du Conseil constitutionnel n° 79-104 DC du 23 mai 1979 relative à la Nouvelle-Calédonie.
* 72 Delblond, A., 2012, « Autonomie locale et gouvernance territoriale outre-mer », in, Elfort, M. ; Roux, V., 2012, La gouvernance territoriale dans les régions et départements français d'Amérique , PUAM, p. 151.
* 73 Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
* 74 Clinchamps, N., 2012, « Le Conseil constitutionnel face à l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n° 35 (Dossier : la Constitution et l'outre-mer) - avril 2012.
* 75 Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
* 76 Stirn, B., 2011, Les sources constitutionnelles du droit administratif, introduction au droit public , LGDJ, p. 166.
* 77 Philip, L., 2002, « L'autonomie financière des collectivités territoriales », Cahiers du Conseil constitutionnel n°12 (Dossier : le droit constitutionnel des collectivités territoriales) - mai 2002 ; Philip, L., 2000, « Le pouvoir fiscal local bénéficie-t-il d'une protection constitutionnelle ? », Pouvoirs locaux , n° 46, sept. 2000.
* 78 Million-Delsol, Ch., 1993, Le principe de subsidiarité , PUF, QSJ.
* 79 Chevrier, S. ; Pellissier-Tanon, A., 1999, « La subsidiarité, une forme d'autonomie alternative à la décentralisation ? », Communication au 10° congrès de l'AGRH, « La GRH, contrôle ou autonomie ? », septembre 1999, Actes du 10° congrès de l'AGRH, tome 1, pp. 325-334.
* 80 Aristote, Politique , I, 2, 1252b et s., Vrin.
* 81 Saint Thomas d'Aquin, Somme de théologie, IIa-IIae, q. 58, a. 1. 39, CERF.
* 82 Rerum Novarum , 15 mai 1891.
* 83 Quadragesimo Anno , 15 mai 1931.
* 84 La racine du mot subsidiarité est le latin subsidiarius : subsidiarius, a, um ( subsidium ), qui forme la réserve / subsidiarii, orum , m, troupes de réserve ; subsidior, ari ( subsidium ), int, former la réserve ; subsidium, ii , n ( subsido ), 1. ligne de réserve (dans l'ordre de bataille) / réserve, troupes de réserve / 2. [d'où] soutien, renfort, secours, integros subsidio adducere : amener des troupes fraîches comme renfort / 3. [fig.] aide, appui, soutien, assistance / moyen de remédier, ressources, arme, subsidia ad omnes casus comparare : se ménager des moyens de parer à toute éventualité, des ressources pour toute éventualité / 4. lieu de refuge, asile. (Félix Gaffiot, Dictionnaire abrégé Latin-Français illustré , Paris : Hachette, 1963, p. 619).
* 85 On a pu parler de « mille-feuille administratif », ou de « mille-feuille territorial ».
* 86 Balladur, E., 2009, Comité pour la réforme des collectivités locales - « Il est temps de décider » - Rapport au Président de la République, La documentation française.
* 87 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Rapport n° 169 (2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 décembre 2009, « Projet de loi de réforme des collectivités territoriales ».
* 88 Rapport n° 169 (2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 décembre 2009, « Projet de loi de réforme des collectivités territoriales ».
* 89 Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2013, La documentation française.
* 90 Source ADCF, Assemblée des Communautés de France ; www.adcf.org.
* 91 Jos, E., 2011, « l'article 73 de la constitution et la diversité des statuts », Colloque, Les collectivités françaises situées outre-mer à l'épreuve des évolutions statutaires et de la réforme territoriale, Mercredi 9 février 2011, Palais du Luxembourg, organisé par le CRPLC (Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe).
* 92 Goujon, M. ; Hermet, F., 2011, « L'indice de développement humain : une évaluation pour Mayotte », WP CEMOI n°10.
* 93 CEROM, 2010, « Mutations et évolutions de l'économie mahoraise à la veille de la départementalisation », n° 1, novembre ; IEDOM, 2010, Mayotte : Rapport Annuel .
* 94 Bachelard (G.), La psychanalyse du feu . Paris, Les Éditions Gallimard, 1992, 192 p, p.11.
* 95 Ibid.
* 96 Montecler (M.-C. de), « Clause générale de compétence, acte III », A.J.D.A. , 2014, p. 884 ; Pontier (J-M.), « Fluctuat et mergimus », A.J.D.A., 2014, p. 305 ; Poupeau (D.), « Manuel Valls veut réduire de moitié le nombre de régions et supprimer les conseils départementaux », A.J.D.A. , 2014, p. 765.
* 97 Article 1 er de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, J.O.R.F. , n°0023, 28 janvier 2014, p. 1562. Sur ce point, voir notamment : Brisson (J-F.), « Clarification des compétences et coordination des acteurs », A.J.D.A. , 2014, p. 605 ; Pontier (J.-M.), « Le vrai faux retour de la clause de compétence générale », J.C.P. édition Administrations et Collectivités territoriales , n° 8, 24 février 2014, 2047.
* 98 Article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ( J.O.R.F. , n°0292, 17 décembre 2010, p. 22146). Cette disposition ne devait entrer en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2015. Sur ce point, voir, notamment : Faure (B.), « La nouvelle compétence générale des départements et des régions », R.F.D.A., 2011, p. 240 ; Guilloud (L.), « Établissement public de coopération intercommunale et collectivité territoriale : une distinction en voie d'extinction ? », in Aubelle (V.) et Monjal (P-Y.), La France Intercommunale : Regards sur la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, Paris, L'Harmattan, 2013, pp. 167 et s. ; Janicot (L.), « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale menacée ? », R.F.D.A., 2011 p. 227 ; Pontier (J-M.), « Requiem pour une clause générale de compétence ? », J.C.P. édition Administrations et Collectivités territoriales , 2011, no 2015 ; « Mort ou survie de la clause générale de compétence ? », B.J.C.L., 2011, p. 11.
* 99 Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, J.O. du 6 avril 1884, p. 1557 ; D. 1884, IV, pp. 25 et s. Ces dispositions étaient applicables à la Guyane, la Martinique et La Réunion en application de l'article 165 de la loi.
* 100 Par l'article 23 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ( J.O.R.F. , 3 mars 1983, p. 730.).
* 101 La formule figurait à l'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 Portant création et organisation des régions ( J.O.R.F. , 9 juillet 1972, p. 7176).
* 102 Elle figure également sous une forme légèrement différente à l'alinéa 1 de l'article L. 1111-2 du C.G.C.T. - issu de l'article 1 er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ( J.O.R.F. , 9 janvier 1983, p. 215) - qui dispose : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. »
* 103 L'article L. 2121-29 du C.G.C.T. est applicable aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion (Article L. 2561-1 du C.G.C.T.), de Mayotte (Article L. 2564-1 du C.G.C.T.), de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article L. 2571 du C.G.C.T.) et de Polynésie française (Article L. 2573-5 du C.G.C.T.). Une disposition similaire figure à l'article L. 112-25 alinéa 1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en vertu duquel « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
* 104 L'article L. 3211-1 du C.G.C.T. est applicable aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion (Article L.3441-1 du C.G.C.T.).
* 105 L'article L. 4221-1 du C.G.C.T. est applicable aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion (Article L. 4431-1 du C.G.C.T.).
* 106 Article L.O. 3511-1 du C.G.C.T.
* 107 Article L. 7111-1 du C.G.C.T.
* 108 Article L. 7211-1 du C.G.C.T.
* 109 Article L.O. 6414-1 du C.G.C.T.
* 110 Article L.O. 6314-1 du C.G.C.T.
* 111 Article L.O. 6214-1 du C.G.C.T.
* 112 Caillosse (J.), « La «complexité» pour que rien ne change ? », Pouvoirs locaux , n° 68, 2006, p. 38. Pour un exemple récent, lors des travaux préparatoires à l'adoption de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : « En effet, je ne suis pas persuadé que l'on améliore la lisibilité en rétablissant la clause de compétence générale, puis en désignant un chef de file. Qu'est-ce qui prévaudra : la clause de compétence générale, qui permet de tout faire, de s'occuper de tout, ou le chef de file, qui se concentre sur une action précise ? », M. Louis Nègre, Sénat, J.O.R.F. , 1 er juin 2013, n° 64 S (C.R.), Session ordinaire de 2012-2013, compte rendu intégral, séance du vendredi 31 mai 2013, p. 5135.
* 113 C.E., 29 juin 2001, commune de Mons-en-Baroeul, req. n°193716.
* 114 Voir les définitions données par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales du nom « autonomie » et de l'adjectif « autonome ». [http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/autonomie], [http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/Autonome], (10 avril 2014).
* 115 Auby (J-B.), « La libre administration des collectivités locales : un principe à repenser », in Quel avenir pour l'autonomie des collectivités locales, Entretiens de la Caisse des dépôts sur le développement local , Paris, Ed. de l'Aube / SECPB, C.N.R.S, G.R.A.L.E, 1999, 423 p., p.87. Cadoux (C.), « Le concept d'autonomie en France (Théorie et pratique) », R.S.A.M.O., décembre 1989, p. 208
* 116 Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985. La Charte européenne de l'autonomie locale a été approuvée par la loi n°2006-823 du 10 juillet 2006 autorisant l'approbation de la charte européenne de l'autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ( J.O.R.F. , 10 juillet 2006, p. 10335) et publiée par le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 portant publication de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ( J.O.R.F. , 5 mai 2007, p. 7932). Elle est entrée en vigueur le 1 er mai 2007.
* 117 Voir les différentes facettes de l'autonomie locale telles qu'elles résultent de la Charte de l'autonomie locale. Cf. aussi : Auby (J.-B.), loc. cit.
* 118 On distingue à cette époque cinq catégories de délibérations des conseils municipaux : les délibérations règlementaires ou décisions, les délibérations sous condition d'autorisation, Les avis et les réclamations. Sur ce point, cf., par exemple, Marcère (E. de), Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner les propositions de loi municipale, Séance du 19 décembre 1882, J.O. documents parlementaires (Chambre, Annexe n° 1547), janvier 1883, pp. 2657 et s., p. 2661.
* 119 Sur les relations ambivalentes entre la revendication d'autonomie locale et l'expression « affaires locales », voir, notamment : Burdeau (F.), « Affaires locales et décentralisation : l'évolution d'un couple de la fin de l'Ancien Régime à la Restauration », in Le pouvoir : mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, L.G.D.J., 1977, 1190 p., pp. 765-788.
* 120 Moreau (F.), Le règlement administratif : étude théorique et pratique de droit public français, Paris, A. Fontemoing, 1902, p. 470. Il reconnaît un statut comparable au conseil général sur le fondement de l'article 48 5° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux (D., 1871, IV., p. 102) : « Le Conseil général doit être considéré comme l'autorité principale, normale, dans le département. La loi du 10 août 1871 est moins nette que la loi du 5 avril 1884. Néanmoins elle appelle le Conseil général à délibérer « généralement sur tous les objets d'intérêt départemental », et « il est saisi soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres » (art. 48 in fine). Cette règle, moins solennelle en la forme que celle donnée pour le Conseil municipal par la loi du 5 avril 1884 (art. 61) est au fond équivalente ; elle investit le Conseil général d'un pouvoir général, embrassant toutes les affaires départementales » . Id ., p. 457.
* 121 « Jusqu'ici les communes, ou plutôt les conseils municipaux, organes des communes, n'ont eu à proprement parler qu'un pouvoir consultatif, puisque l'autorité préfectorale reste toujours maîtresse d'arrêter les effets de leurs délibérations. Il est vrai que, tandis que certaines de ces délibérations doivent être approuvées expressément, d'autres, celles qui ont pour objet les mesures d'administration pure ou de peu d'importance, deviennent exécutoires par cela seul que le préfet ne les a pas annulées dans un certain délai (loi du 18 juillet 1837, art. 18). Dans la pratique, il est très rare, presque exceptionnel aujourd'hui, que le préfet s'oppose à l'exécution de ces dernières délibérations. Mais cette pratique favorable ne constitue pas un droit pour les communes. Elle entraîne dans tous les cas des retards et des complications aussi gênantes qu'inutiles. La loi que nous vous proposons donne satisfaction aux réclamations depuis longtemps élevées contre ce système. Elle pose en principe que les conseils municipaux ont un pouvoir de décision propre, et que leurs délibérations sont en conséquence, et en règle générale, exécutoires par elles-mêmes et dès qu'elles ont été prises. [...] On parle de la nécessité de l'intervention de l'autorité supérieure, en vue d'empêcher un conseil municipal, organe de la majorité des électeurs, d'opprimer la minorité, ou de sacrifier trop légèrement à l'intérêt général ou même à un intérêt de parti, les intérêts privés. Mais si l'on admet cette ingérence de l'autorité supérieure en vue de protéger les intérêts particuliers, c'en est fait de l'autonomie communale, et on retombe forcément dans le système actuel. » Jozon cité in Morgand (L.), La loi municipale : commentaire de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation et les attributions des conseils municipaux, tome 1, Organisation, Paris, Librairie administrative de Berger-Levrault et Cie, 1884, p. 325.
* 122 « Dans la loi du 18 juillet 1837, les délibérations ayant en elles-mêmes force exécutoire, forment la très minime exception. [...] En définitive, le conseil n'avait guère qu'un droit d'initiative, la décision appartenait au préfet. La loi du 24 juillet 1867 avait élargi le cercle de leur action ; mais encore, elle imposait aux délibérations, pour qu'elles fussent exécutoires, l'accord entre le maire et le conseil, et, en l'absence de cet accord, l'approbation préfectorale devenait nécessaire. C'était mettre le droit de la commune à la merci des maires, et, à cette époque, les maires étaient nommés par le pouvoir central et pouvaient être pris en dehors du conseil. Une loi libérale ne peut maintenir les communes dans cet état de dépendance : la loi actuelle contient sur ce point des modifications capitales à la législation existante. Premièrement le droit absolu de délibérer sur les affaires communales devient la règle, et il n'est fait d'énumération des objets dont les conseils peuvent avoir à s'occuper que pour les exceptions, c'est-à-dire pour les cas où l'autorisation préfectorale est exigée. En dehors de ces cas, restreints au strict nécessaire, la compétence et le droit de décision du conseil sont entiers. La loi nouvelle enlève également le droit de veto que la loi de 1867 avait conférée au maire, lequel redevient ce qu'il doit être : l'exécuteur des décisions du conseil municipal et non leur juge ». Marcère (E. de), Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner les propositions de loi municipale, séance du 19 décembre 1882, J.O. documents parlementaires (Chambre, Annexe n° 1547), janvier 1883, pp. 2657 et s., p. 2661.
* 123 Voir, par exemple : Morgand (L.), loc. cit.
* 124 Maspetiol (R.) et Laroque (P.), La tutelle administrative , Paris, Sirey, 1930, p. 199.
* 125 Ce dernier disposait que : « Le conseil général délibère : [...] 5° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres ».
* 126 Berthelemy (H.), Traité élémentaire de droit administratif , Paris, Rousseau, 1933, p. 231. Pour un aperçu plus exhaustif des services créés, cf. notamment Rouault (M-C.), L'intérêt communal , Lille, Presses universitaires de Lille, 1991, pp. 336 et s.
* 127 Hauriou (M.), « Note sous C.E., 1 er février 1901, Descroix et autres boulangers, S., 1901, III., p. 41. », in Notes d'arrêts sur décisions du Conseil d'État et du tribunal des conflits publiées au recueil Sirey de 1892 à 1928 par Maurice Hauriou réunies et classées par André Hauriou, tome 1, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2000, p. 159.
* 128 Rivet, « Conclusions sur C.E. 11 juin 1926, Raynaud c/ Ville de Châtellerault », D.P. , 1927, III., pp. 43 et s.
* 129 Maspetiol (R.), Laroque (P.), op. cit. , p. 72.
* 130 Bonnard (R.), Précis de droit administratif , Paris, Sirey, 1935, pp. 277 et s.
* 131 Hauriou (M.), loc. cit.
* 132 Bonnard (R.), loc. cit.
* 133 Maspetiol (R.), Laroque (P.), loc. cit.
* 134 Bonnard (R.), loc. cit.
* 135 Douence (J-C.), « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », R.D.P. , 1972, p. 753, p. 771 ; Douence (J-C.), « Réflexions sur la vocation générale des collectivités locales à agir dans l'intérêt public local », in Quel avenir pour l'autonomie des collectivités locales, Entretiens de la Caisse des dépôts sur le développement local , Paris, Ed. de l'Aube / SECPB, C.N.R.S, G.R.A.L.E, 1999, 423 p., p. 317.
* 136 Sur la clause générale de compétence comme capacité d'initiative, cf. : Guichard (O.) / Commission de développement des responsabilités locales, Vivre ensemble, Rapport de la Commission de développement des responsabilités locales , Paris, La documentation française, 1976, p. 183. Cf. aussi : Auby (J-B.), « Innovation, légalité et management public », Politiques et management publics , 1993, n° 4, pp. 147-157 ; Caillosse (J.), « Repenser les responsabilités locales. Du débat sur la « clarification des compétences » et la « Clause générale de compétence » à celui d'un changement de modèle territorial », Les Cahiers de l'institut de la Décentralisation , n° 8, II, 2006 ; Douence (J-C.), « La clause générale de compétence aujourd'hui », Pouvoirs locaux , n°68, I/2006, pp. 47-52. ; Faure (B.), Le pouvoir réglementaire des collectivités locales , Paris, L.G.D.J, 1998, pp. 69-70 ; Pontier (J-M.), « Semper Manet. Sur une clause générale de compétence », R.D.P. , 1984, p. 1443, p.1471 ; Pontier (J-M.), « Nouvelles observations sur la clause générale de compétence », in La profondeur du droit local. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Douence , Paris, Dalloz, 2006, 501 p., p. 365, p. 394.
* 137 Douence (J.-C.), « La clause générale de compétence aujourd'hui », loc. cit.
* 138 Ainsi, par exemple, lors des débats qui ont présidé à l'adoption de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : « Supprimer la clause générale de compétences impliquerait de faire la liste de toutes les compétences existantes. Or on en oubliera toujours ! ». M. Bruno Sido, Sénat, J.O.R.F. , 3 octobre 2013, n°101 S (C.R.), Session ordinaire de 2013-2014, Compte rendu intégral, Séance du mercredi 2 octobre 2013.
* 139 Pontier (J.-M.), « Nouvelles observations sur la clause générale de compétence », loc. cit.
* 140 Benoit (F.-P.), « L'évolution des affaires locales. De la décentralisation des autorités à la décentralisation des compétences », in La profondeur du droit local. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Douence , Paris, Dalloz, 2006, 501 p., pp. 23-44.
* 141 Caillosse (J.), « Repenser les responsabilités locales. Du débat sur la « clarification des compétences » et la « Clause générale de compétence » à celui d'un changement de modèle territorial », loc. cit.
* 142 Chapuisat (L.-J.), « Les affaires communales », A.J.D.A. , 1976, pp. 470-478, p. 473.
* 143 Chapuisat (J.), « Libertés locales et libertés publiques », A.J.D.A. , 1982, pp. 349-356, p. 352.
* 144 Auby (J.-B.), loc. cit.
* 145 Ibid.
* 146 « Considérant que la bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local ; qu'en jugeant que l'intérêt public ne pouvait s'apprécier au regard des besoins futurs du développement touristique et que seule l'insuffisance de l'initiative privée était susceptible de justifier les délibérations litigieuses, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; » C.E., 18 mai 2005, Territoire de la Polynésie française, req. n°254199.
* 147 Pour une présentation synthétique de ces débats, voir, notamment, Rouault (M.-C.), « Compétences des collectivités territoriales et intérêt public local », JurisClasseur Collectivités territoriales , Fascicule 652.
* 148 Douence (J.-C.), « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », loc. cit.
* 149 Douence (J.-C.), « La clause générale de compétence aujourd'hui », loc. cit.
* 150 Laubadère (A. de), « Vicissitudes actuelles d'une distinction classique : établissement public et collectivité territoriale, A propos des groupements de collectivités territoriales », in Mélanges offerts à Paul Couzinet , Université des Sciences sociales de Toulouse, 1974, pp. 411-560, pp. 411-413 ; Pontier (J.-M.), « Semper Manet. Sur une clause générale de compétence », loc. cit. ; Douence (J.-C.), « la région : collectivité à vocation générale ou spécialisée ? », R.F.D.A. , 1986, pp. 539-554, p. 552 ; Douence (J.-C.), loc. cit.
* 151 Amagat (A.-L.), Séance du 30 juin 1883, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires du 1 er juillet 1883, pp. 1522-1523.
* 152 Pour une analyse plus exhaustive de la jurisprudence en la matière, cf. notamment : Douence (J.-C.), « La notion de service public local », Encyclopédie Dalloz. Collectivités locales ; Douence (J.-C.), « La création et la suppression des services publics locaux », Encyclopédie Dalloz. Collectivités locales. Voir aussi Schwartz (R.), « Conclusions sur C.E., Section, 26 juillet 1995, Commune de Villeneuve-d'Ascq », A.J.D.A. , 1995, pp. 834 -837.
* 153 Rivet, « Conclusions sur C.E. 11 juin 1926, Raynaud c/ Ville de Châtellerault », précitées .
* 154 Sur ce point, voir, par exemple, C.E., 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine, Commune de Saint-Ouen et Commune de Romainville, req. n° 93331, 93847, 93885.
* 155 Sur ce point, voir la jurisprudence en matière d'aide des collectivités territoriales aux grévistes ou aux familles de grévistes et, notamment : C.E., 20 novembre 1985, Commune d'Aigues-Mortes, Rec., p. 330.et C.E., 11 octobre 1989, Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rec. , p. 184.
* 156 Ce qui n'est pas le cas de la Polynésie française. Dans la décision Ministre de l'Outre-mer contre Gouvernement de Polynésie française , le Conseil d'État a estimé que l'octroi dans l'intérêt général de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes n'était pas interdit C.E., 16 mars 2005, Ministre de l'Outre-mer c/ Gouvernement de Polynésie française , req. n o 265560, Rec., p. 108.
* 157 C.E., Section, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de La Réunion c/ Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis », req. n o 94455, Rec., p. 803.
* 158 C.E., 13 mars 1985, Ville de Cayenne, req. n os 19321 et 19322, Rec., p. 76.
* 159 Maspetiol (R.), Laroque (P.), loc. cit.
* 160 Bonnard (R.), loc. cit. F.Moreau développe une analyse comparable : « Cette théorie légale suppose que certaines questions sont, pour ainsi dire, de nature départementale ; décision fort importante, puisque « tout acte et toute délibération d'un Conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet » (art. 33). Le catalogue de ces affaires n'est donné par aucun texte. L'appréciation sur ce point est faite par le chef de l'État : « la nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique » (Ibid.). En outre, le juge auquel l'application du règlement est demandée doit l'écarter comme illégal et nul. Le recours au Conseil d'État n'est pas possible, la nullité proclamée par la loi n'a pas à être prononcée. » Moreau (F.), loc. cit. , p. 457.
* 161 Eisenmann (C.), Centralisation et décentralisation. Esquisse d'une théorie générale , Paris, L.G.D.J., 1948, 330 p.
* 162 Caillosse (J.), « Ce que les juristes appellent « décentralisation ». Notes sur l'évolution du droit français de la décentralisation à la lumière des travaux de Charles Eisenmann », in La profondeur du droit local. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Douence , Paris, Dalloz, 2006, p. 71.
* 163 Conseil d'État, De la sécurité juridique, Rapport public 1991, La Documentation française, études et documents n° 43, 1992 ; Conseil d'État, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public 2006, La Documentation française, études et documents n° 57, 2006 ; Bergeal (C.), Savoir rédiger un texte normatif, Berger-Levrault, 2012, 7 ème éd. ; Drago (R.), (ss dir.), La confection de la loi : Cahiers des sciences morales et politiques, PUF, 2005 ; Fournier (J.), Le travail gouvernemental, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et Dalloz, 1987 ; Lasserre (B.), Pour une meilleure qualité de la réglementation, La Documentation française, Paris, 2004, 47 p. ; Latournerie (D.), La qualité de la règle de droit : l'influence des circuits administratifs de son élaboration, Rev.adm., 1981, p.581-595 ; Mandelkern (D.), La qualité de la réglementation, La Documentation française, bibliothèque des rapports publics, Paris, 2002 ; Maynial (P.), Le droit du côté de la vie, Réflexions sur la fonction de l'État, Rapport au Premier ministre, La Documentation française, coll. des rapports officiels, Paris, 1997 ; PY (R.), Le Secrétariat général du gouvernement, La Documentation française, Notes et études documentaires, n° 4779, Paris, 1985 ; Remy (D.), Légistique, l'art de faire les lois, Romillat, coll. Pratique du droit, 1994.
* 164 CC n° 98-401 DC du 10 juin 1998 ; CC n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004.
* 165 CE Ass., 24 mars 2006, société KPMG et autres.
* 166 CC n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 ; Jennequin (A.), L'intelligibilité de la norme dans les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, RFDA, 2009, p. 913.
* 167 Cf. circulaire n° 5281/SG du 29 février 2008 relative à l'application des lois (J.O. du 7 mars 2008) ; circulaire du 13 septembre 2010 relative au moratoire sur l'adoption de nouvelles normes concernant les collectivités territoriales-implications sur la procédure d'élaboration des textes réglementaires ; circulaire n° 5512/SG du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales (J.O. 18 février 2011) ; circulaire du 27 mars 2013 relative à la codification ; circulaire du 2 avril 2013 relative à l'interprétation facilitatrice des normes ; circulaire du 2 juillet 2013 relative à la simplification des textes du secteur de la construction et de l'aménagement ; circulaire du 17 juillet 2013 relative à la simplification administrative ; circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation ; pour des exemples d'études sur des textes ou des techniques de rédaction : Richard (J.), Droit souple : pour une doctrine de recours et d'emploi, Recueil Dalloz, 2013, p. 2512 ; Peres (C.), L'article 6-1 du code civil, heurs et malheurs du titre préliminaire, Recueil Dalloz, 2013, p. 1370 ; Jean-Pierre (D.), Le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires : un peu de moralisation, beaucoup de précipitation, La Semaine juridique-Administrations et collectivités territoriales, n° 31, 29 juillet 2013, act.665 ; Billet (P.), Le droit de l'environnement et la modernisation de l'économie, Environnement, n° 10, octobre 2008, alerte 59.
* 168 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux, DGCL, 2010.
* 169 Reste donc hors de ce propos l'action portant sur les normes applicables aux collectivités territoriales, qui s'est traduite par l'adoption de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
* 170 Janicot (L.), Réflexions sur la notion de compétences propres appliquée aux collectivités territoriales en droit français, AJDA, 2004, p. 1574.
* 171 À propos du rapport du Conseil d'État pour 2013 qui lui est consacré : Pauliat (H.), La consécration du droit souple : insuffisance des règles normatives, renforcement de la qualité du droit ?, La Semaine juridique-Administrations et collectivités territoriales, n° 48, 25 novembre 2013, act. 912 ; pour une approche générale de la notion : Thiebierge (C.), Le droit souple, réflexion sur les textures du droit, RTDC,2003,p.599.
* 172 Ainsi de l'emploi du présent de l'indicatif valant impératif : Le Gars (J.), De la manière de délier l'administration de sa compétence liée, AJDA, 2010, p.406 ou du présent de ce mode, à l'exclusion du futur : Vestur (H.), Grenelle I : une loi « hors norme »..., Environnement n° 2, février 2010, étude 4.
* 173 Rep. QE n° 11970, Sénat, J.O. Sénat, 5 octobre 1995.
* 174 Prendre acte de la décentralisation : pour une rénovation indispensable des contrôles de l'État sur les collectivités territoriales, rapport d'information n° 300, (2011-2012), par M. Jacques Mézard, sénateur, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 25 janvier 2012.
* 175 La Nouvelle-Calédonie étant une collectivité territoriale, bien qu'un titre distinct, le titre XIII, lui soit consacré par la Constitution : CC 3 juillet 2009, n° 2009-587 DC, considérant 4.
* 176 Cet article est intéressant en ce qu'il désigne le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale comme disposant, à titre exclusif, de l'administration : il fait écho à l'article L. 4422-25 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales qui fait du président du conseil exécutif de cette collectivité territoriale le « chef des services » de celle-ci, à l'article 63 alinéa 2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui place l'administration de cette collectivité territoriale à disposition de son gouvernement, à l'article 134 alinéa 4 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui dispose que le président du gouvernement dirige l'administration de cette dernière, à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales au bénéfice du maire, à l'article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales s'agissant du président du conseil général, de l'article L. 4231-33 dudit code, s'agissant du président du conseil régional, aux articles L.O. 6252-3, L.O. 6352-3 et L.O.6462-5 dudit code au profit du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que, toutes choses égales par ailleurs, à l'article 2 alinéa 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton qui désigne l'administrateur supérieur du premier de ces territoires comme dirigeant ses services et de l'article 8 alinéa 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer qui contient une disposition analogue en faveur de leur administrateur supérieur ; il est à relever qu'aucune disposition correspondante n'est prévue en faveur de quelque organe de la Guyane .
* 177 Favoreu (L.), La loi, le règlement et les collectivités territoriales , AJDA, 2002, p.561.
* 178 Verpeaux (M.), L'Outre-mer français depuis 1982 , La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 44, 5 novembre 2012, 2349.
* 179 Sana-Chaille de Nere (S.), Les conflits de normes internes issus du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence normative en droit civil , Réflexions sur l'élaboration d'une règle de conflit, Journal du droit international (Clunet) n° 1, janvier 2014, doctr. 2.
* 180 Moysan (H.), La consolidation des codes, lois, décrets : positions doctrinales d'éditeurs ou devoir de l'État ? , La Semaine juridique-édition générale, n° 50, 13 décembre 2006, I 196.
* 181 Voir Gérard Marcou et Jean-François Akandji-Kombe, La Charte européenne de l'autonomie locale et l'impact du droit communautaire sur les collectivités locales des États membres, Rapport pour le Comité européen sur la démocratie locale et régionale et pour le congrès des pouvoirs locaux et régionaux , Comité européen sur la démocratie locale et régionales (CDLR), Conseil de l'Europe, 14 sept. 2011.
* 182 Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (1 er déc. 2009), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est dénommée Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans les lignes qui suivent, la nouvelle appellation sera utilisée, quoique la jurisprudence citée soit le plus souvent celle de la CJCE. Par ailleurs, le Tribunal de première instance (TPI) se trouve à présent dénommé Tribunal (de l'Union européenne) ou Trib. UE. Voir TUE révisé par le Traité de Lisbonne, art. 19.
* 183 À titre d'exemple, voir Mathilde Boulet, Les collectivités territoriales françaises dans le processus d'intégration européenne , Paris, L'Harmattan, 2012 ; Laurent Malo, Autonomie locale et Union européenne , Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l'Union européenne, Thèses, 2010 ; Aurélie Noureau, L'Union européenne et les collectivités locales , Thèse doctorat en droit, Université de La Rochelle, 2 avr. 2011, http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/09/66/PDF/TheseNoureau.pdf ; ou encore Dorothée PAYET, L 'entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence de l'Union européenne - La Cour de justice de l'Union européenne face à la dimension régionale et locale des États membre s, Thèse doctorat droit public, Université de La Réunion, 13 mars 2013 (non encore publiée).
* 184 CJCE, 15 déc. 1971, International Fruit Company, aff. 51/71 à 54/71, Rec . p. 1107.
* 185 CJCE, 21 sept. 1983, Deutsche Milchkontor, aff. 205 à 215/82, Rec . p. 2633.
* 186 Georges Vandersanden, « La place des régions dans le contentieux communautaire : le chaînon manquant », in Mélanges en l'honneur du Professeur Jean-Victor Louis, Université de Bruxelles, 2003, pp. 545-577.
* 187 Les exemples donnés ici seront ici très sélectifs, par rapport à l'ampleur du contentieux pertinent.
* 188 CJCE, 5 oct. 2000, Commission c/ République française, aff. C-337/98, Rec. p. I-8377. Voir Amine Amar, « L'intervention des collectivités régionales et locales dans les procédures de manquement devant la Cour de justice européenne : une concrétisation de l'exigence de proximité », in Le droit de l'Union européenne en principes -- Liber Amicorum en l'honneur de Jean Raux , pp. 583-597.
*
189
Voir :
- Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la
gestion du bruit dans l'environnement (
JOUE
L 189 du 18 juill. 2002,
p. 12) ;
- Mise en demeure de la Commission
européenne -- Infraction n° 2013/2006 -- C(2013)3039 final,
Bruxelles, 30 mai 3013
[http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mise_en_demeure_de_la_Commission_Europeenne_du_30_mai_2013.pdf];
- Instruction
du Gouvernement du 11 février 2014, relative aux collectivités en
situation de non-conformité concernant la mise en oeuvre de la directive
2002/49/CE, NOR : DEVP1401911J,
Bulletin officiel MEDDE
-
METL
, n° 2014/3, 25 févr. 2014, p. 71.
* 190 Voir par ex. CJCE, 18 juin 1985, P. Steinhauser c/ Ville de Biarritz, aff. 197/84, Rec . p. 1819 ; la Cour y précise que l'obligation de respect du droit de l'UE pèse sur les « collectivités décentralisées ».
* 191 Par ex. CJCE, 19 févr. 1998, Paul Chevassus-Marche c/ Conseil régional de La Réunion, aff. C-212/96, Rec . p. I-743.
* 192 CJCE, 16 juill. 1992, Administration des Douanes c/ Legros e. a., aff. C-163/90, Rec . p. I-4625 ; 9 août 1994, René Lancry SA e. a. c/ Direction générale des douanes e a, aff. C- 363/93, 407/93, 408/93, 409/93, 410/93, 411/93, Rec . p. I-3957 ; également, CJCE, 30 avr. 1998, Sodiprem SARL e. a. et Roger Albert SA c/ Direction générale des douanes, aff. C-37 et 38/96, Rec . p. I-4253.
* 193 CJCE, 1 er juin 1999, Klaus Konle, aff. C-302/97, Rec. p. I-3099 ; 4 juil. 2000, Salomone Haim, aff. C-424/97, Rec. , p. I-5123.
* 194 CJCE, 22 nov. 2001, Nederlandse Antillen c/ Conseil de l'Union européenne, aff. C-452/98, Rec. , p. I-8973.
* 195 Voir, après TPI, ord., 7 juill. 2004, Região autónoma dos Açores c/ Conseil de l'Union européenne, aff. T-37/04 R, Rec. p. II-2153 ; TPI, arrêt, 1 er juill. 2008, Região autónoma dos Açores c/ Conseil de l'Union européenne, aff. T-37/04, Rec. p. II-103*, Pub. somm. ; CJCE, ord. 26 nov. 2009, Região autónoma dos Açores c/ Conseil de l'Union européenne, aff. C-444/08 P, Rec. p. I-200*, Pub.somm.
* 196 TPI, 30 avr. 1998, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-214/95, Rec. p. II-717 ; 15 déc. 1999, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH c/ Commission des Communautés européennes, aff. jointes T-132/96 et T-143/96, Rec. p. II-3663 ; ord., 7 juill. 2004, Região autónoma dos Açores c/ Conseil de l'Union européenne, aff. T-37/04 R, Rec. p. II-2153.
* 197 Formulation de Dorothée Payet, L'entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence de l'Union européenne... , Thèse précitée.
* 198 CJCE, ord. 6 mars 2003, Ramondin et Ramondin Capsula c/ Commission, aff. C-186/02 P, Rec . p. I-91*, Pub. sommaire.
* 199 TPI, ord. 3 juin 1999, Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) e. a. c/ Conseil de l'Union européenne, aff. T-138/98, Rec . p. II-1797.
* 200 Sur l'interprétation de l'ex-article 177 TCEE, devenu art. 234 TCE, puis art. 267 TFUE, voir CJCE, 22 oct. 1987, Foto Frost, aff. 314/85, Rec . p. 4199.
* 201 Voir TFUE, art. 107 (antérieurement TCEE, art. 92 et TCE, art. 87) & ss.
* 202 CJCE, 14 oct. 1987, Allemagne c/ Commission, aff. 248/84, Rec . p. 4013 (à propos d'un régime d'aides instauré par le Land Nordrhein-Westfalen).
* 203 CJCE (grande chambre), 6 sept. 2006, Portugal c/ Commission, aff. C-88/03, Rec . p. I-7115 ; en outre : pour la Région Biscaye, CJCE, 11 sept. 2008, Union General de Trabajadores de la Rioja (UGT - Rioja) e.a., aff. C-428/06 à C-434/06, Rec . p. I-6747.
* 204 TPI, 18 déc. 2008, Gouvernement de Gibraltar c/ Commission, aff. T-211/04 et T-215/04, Rec . p. I - 3745.
* 205 CJUE (grande chambre), 15 nov. 2011, Commission européenne et Royaume d'Espagne c/ Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aff. C-106/09 P et C-107/09 P, Rec . p. I-11113 ; selon la CJUE, l'aide est discriminatoire car elle aboutit à exonérer des sociétés off shore .
* 206 CJCE (grande chambre), 16 juill. 2009 , Mark Horvath c/ Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, aff. C-428/07, Rec . p. I-6355.
* 207 Conseil d'État, 27 janvier 2014, n° 373237, ECLI :FR :CESSR :2014 :373237.20140127.
* 208 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, JORF , 30 mars 2014, texte 61 sur 80.
* 209 NB : Saint-Martin également COM, mais toujours RUP, ne se voit pas appliquer la même disposition législative que celle soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel et ne se trouve pas dans une situation financière telle qu'elle serait sollicitée de verser des montants au profit d'une autre région.
* 210 Voir par exemple, Pierre-Yves Monjal, « Collectivités territoriales françaises et droit de l'Union européenne : quelques remarques sur la portée de la reconnaissance du niveau local par les textes européens », Revue du Droit de l'Union européenne , 3/2011, pp. 347-359.
* 211 TUE révisé, art. 4 § 2.
* 212 CJCE, 15 juill. 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64, Rec . p. 1141.
* 213 CJCE, 4 mars 2004, Allemagne c/ Commission, aff. C-344/01, Rec . p. I-2081.
*
214
Sébastien Platon, « Le
respect de l'identité nationale des États membres : frein ou
recomposition de la gouvernance ? »,
in
Colloque
« L'Union européenne et ses États membres après
le Traité de Lisbonne -- quelle place et quel rôle dévolus
aux États, pour quelle Union ? », Sénat, 25 nov.
2011,
Revue de l'Union européenne
, n° 556, mars 2012,
pp. 150 et ss. ; par exemple, l'auteur souligne que quand la violation du
principe de non-discrimination n'est pas retenue, cela rend inopérante
l'invocation du non-respect de l'identité nationale : Trib. UE, 13
sept. 2010, République italienne c/ Commission, aff. T-166/07 et
T-285/07,
Rec
. p. II-193*, Pub. sommaire.
NB, sur pourvoi, la CJUE
a annulé cet arrêt, au motif de la discrimination en raison de la
langue, interdite par le statut des fonctionnaires de l'Union ; elle ne se
prononce pas sur le respect de l'identité nationale : CJUE (grande
chambre), 27 nov. 2012, République italienne c/ Commission
européenne, aff. C-566/10 P, non encore publié.
* 215 Protocole n° 2, joint au Traité de Lisbonne.
* 216 Voir, en France, Constitution, art. 88-6.
* 217 CJCE, 13 mars 1997, Allemagne c/ Conseil et Parlement européen, Rec . p. I-2405.
* 218 CJCE, 9 déc. 2001, Pays-Bas c/ Commission, aff. C-377/98, Rec. p. I-7009.
* 219 Jean-Victor LOUIS, Quelques remarques sur l'avenir du contrôle du principe de subsidiarité, in Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Promenades au sein du droit européen , Bruylant, 2008, pp. 283-305.
* 220 C'est nous qui soulignons.
* 221 Pierre Bon, « Espagne : L'État des autonomies », in Christian Bidégaray (dir.,) L'État autonomique : forme nouvelle ou transitoire en Europe ? , Économica, coll. droit public positif, Paris, 1994, p. 119.
* 222 Dans la Constitution espagnole, art. 149 §1, l'État est notamment chargé de « faire respecter l'égalité de tous les Espagnols face à leurs droits et devoirs constitutionnels. »
* 223 Cette loi financière adoptée en 1980 est venue combler certains silences de la Constitution.
* 224 LOTC : art. 75 bis à 75 quinquies.
* 225 Ces régions sont en effet considérées comme nationalités historiques dans la mesure où, pendant la Seconde République, elles ont approuvé par référendum un projet d'autonomie, conformément à la seconde Disposition Transitoire de la Constitution.
* 226 Cf. par exemple, Luis E. Delgado del Rincón : Les réformes statutaires dans l'état des autonomies
Numéro 73. Revue Confluences Méditerranée. 2010.
* 227 Ces dérogations reposent sur les foros qui confèrent aux communautés (entités forales) qui en bénéficient, des prérogatives fiscales très importantes, l'État se bornant à percevoir une partie des recettes transmises par celles-ci au titre des principales impositions.
* 228 Dictionnaire Larousse.
* 229 Certains observateurs notent cependant une radicalisation récente de la revendication catalane.
* 230 Cf. Hubert Alcaraz et Olivier Lecucq : L'État des autonomies après l'arrêt du Tribunal constitutionnel espagnol sur le nouveau Statut de la Catalogne-Commentaire de l'arrêt 31/2010 du 28 juin 2010, RFDA 2011 p. 403.
* 231 Castille-La Manche et Aragon contre Valence, ou Valence contre la Catalogne et l'Andalousie.
* 232 Il faut ici souligner que le premier statut d'autonomie des Canaries, établi en 1982 prévoyait des compétences plus étendues que celles de la plupart des autres statuts adoptés au même moment, plaçant concrètement ce territoire au même niveau que les Communautés historiques de Catalogne, du Pays basque et de Galice ainsi que l'archipel des Baléares, dont les statuts avaient été adoptés plus tôt.
* 233 Pierre Subra de Bieusses : La sentence du Tribunal constitutionnel espagnol sur le statut de la Catalogne (à propos de la décision du 28 juin 2010), Revue de la science politique en France et à l'Étranger, 01 juillet 2011 n° 4, p. 935. Cf. aussi Santiago Muñoz Machado : « Le mythe du Statut-Constitution » - Informe Comunidad Autónomo, Barcelone 2005.
* 234 Avis n° 325 présenté par M. Michel Mercier au nom de la commission des finances sur le projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Sénat, session ordinaire 2003-2004, p. 5.
* 235 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, J.O n° 75 du 29 mars 2003, p. 5568.
* 236 Selon l'article 72-2 alinéa 3 de la Constitution : « les recettes fiscales et autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ».
* 237 Cela se caractérise par la situation monodépartementale des régions, une superficie communale plus étendue en moyenne que celle de la France hexagonale (une population communale également plus importante), la spécificité de certaines ressources fiscales, un flux d'immigration clandestine élevé (surtout en Guyane et à Mayotte), un taux de chômage impressionnant (près de 30 % à La Réunion).
* 238 Loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 et loi ordinaire n° 2010-1487 du 7 novembre 2010 relatives au département de Mayotte, J.O n° 0284 du 8 décembre 2010, p. 21458 et 21459. La fiscalité de droit commun des départements et régions d'outre-mer ne sera applicable aux départements et communes de Mayotte qu'à compter du 1 er janvier 2014.
* 239 Guide statistique de la fiscalité directe locale 2011/2012, collectivités-locales.gouv.fr, annexe 1, p. 56, 58 et 62.
* 240 Guide statistique de la fiscalité directe locale 2011/2012, collectivités-locales.gouv.fr, annexe 1, p. 64 et 66.
* 241 Fiscalité locale-départements : collectivités-locales.gouv.fr.
* 242 À noter que depuis la réforme de la taxe professionnelle, les taux départementaux intègrent les anciens taux régionaux : soit 13,50 % pour le département et 3,88 % pour la région de Martinique avant la réforme.
* 243 Les moyens financiers nouveaux mis à la disposition de la région sont en réalité ceux qui, antérieurement, relevaient du budget de l'assemblée départementale ; on aboutit alors à un quintuplement des moyens financiers régionaux en 1984. En contrepartie, cela entraîna pour le département la perte de plusieurs millions de francs résultant de ce transfert fiscal, alors même qu'il ne disposait pas à l'époque d'un potentiel fiscal équivalant à celui de ses homologues de l'hexagone.
* 244 Chiffres inscrits aux budgets primitifs 2013. Les finances des collectivités locales en 2013 : état des lieux, rapport de l'observatoire des finances locales, 9 juillet 2013, p. 70
* 245 Chiffres de 2011, rapport précité de l'observatoire des finances locales, p. 68.
* 246 Rapport précité de l'observatoire des finances locales (chiffres de l'année 2010), p. 69.
* 247 Rapport précité de l'observatoire des finances locales, p. 69.
* 248 Les chiffres mentionnés ne tiennent pas compte de Mayotte et de Paris. Rapport de l'observatoire des finances locales, p. 70.
* 249 À noter que ces chiffres n'intègrent pas la ville de Paris. La situation est encore plus critique en Guyane où le département doit faire face à des charges de personnel justifiées par la nécessité de pallier la carence du secteur privé en matière de santé dans des zones les plus reculées et souvent les plus défavorisées.
* 250 Chiffres tirés des budgets primitifs 2013 hors Paris et hors gestion de la dette active. Finances locales-départements, collectivités-locales.gouv.fr.
* 251 Rapport de l'observatoire des finances locales, p. 70.
* 252 Il s'agit des dépenses d'équipement brut. Rapport de l'observatoire des finances locales, p. 70.
* 253 Certaines collectivités minorent les restes à réaliser en dépenses et/ou majorent les restes à réaliser en recettes. Les obligations de rattachement à l'exercice des charges et produits sont ignorées, les comptes de gestion sont établis à partir de données dont la sincérité et la fiabilité sont sujettes à caution... La situation financière des communes des départements d'outre-mer, rapport thématique de la Cour de comptes, juillet 2011, p. 30.
* 254 Il s'agit d'un territoire de cinq districts qui connaît une présence humaine de nature logistique, scientifique ou militaire.
* 255 En Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 256 À Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 257 Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, J.O n° 45 du 22 février 2007, p. 3218.
* 258 Selon les collectivités : dotation globale de fonctionnement (communes, intercommunalité, départements, provinces), dotation élu local, dotation spéciale instituteurs, dotations amendes de police, dotations d'équipement des territoires ruraux, dotation globale d'équipement des départements, dotation des bibliothèques communales, dotation générale de décentralisation, dotation globale de développement économique...
* 259 Rapport public thématique de la cour des comptes sur l'autonomie fiscale en outre-mer, novembre 2013, p. 31.
* 260 Ces normes concernent l'élaboration des textes fiscaux et surtout le caractère législatif de l'impôt (ici, c'est la même institution qui intervient à la fois en matière de lois du pays et de délibération de nature réglementaire, à savoir le congrès).
* 261 Rapport de l'Observatoire des finances locales, p. 90.
* 262 Il n'existe pratiquement pas d'impôts directs dans cette collectivité.
* 263 La gestion des établissements publics locaux d'enseignement, la voirie nationale, la lutte contre les maladies vectorielles, la police de la circulation, la gestion des bibliothèques et le financement de moyens des services d'incendie et de secours.
* 264 Rapport de l'observatoire des finances locales, annexe 3 les collectivités locales d'outre-mer, p. 71.
* 265 Transport intérieur, urbanisme, agriculture, tourisme, pêche, sport, sécurité sociale.
* 266 Statut qui n'a pratiquement pas évolué depuis 1961.
* 267 Pour l'heure, car sa santé économique reposant essentiellement sur le tourisme, il y a lieu d'être circonspect pour l'avenir, sachant qu'il s'agit d'un secteur particulièrement fragile.
* 268 Rapport de l'observatoire des finances locales, p. 90.
* 269 En 2011, sur 1,5 Mds € de recettes de fonctionnement, 72,6 % ont fait l'objet de reversements. Rapport de l'observatoire des finances locales, annexe 3 les collectivités locales d'outre-mer, p. 71.
* 270 Il s'agit de prélèvements qui s'ajoutent aux droits de licences, patentes, contributions foncières, droits d'enregistrement...
* 271 Article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, J.O n° 52 du 2 mars 2004, p. 4183.
* 272 En ce sens qu'elle repose essentiellement sur la fiscalité indirecte. Rapport de la Cour des comptes, p. 67.
* 273 Les deux perçoivent en outre la taxe de traitement des ordures ménagères.
* 274 Sauf à mentionner une demande de la région Guyane qui avait pour objet de permettre à cette collectivité de fixer elle-même le taux de la taxe minière perçue à son profit (article 1599 quinquies B du code général des impôts). En réalité, les habilitations ont concernés des domaines divers comme la formation professionnelle, l'environnement énergétique, l'habitat, le transport...
* 275 Dans les petites collectivités à l'image de Saint-Barthélemy (article 6214-4 de la loi organique précitée du 21 février 2007), Saint-Martin (article 6314-4 de la loi organique précitée). À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'État qui assure la mission de la gestion de l'impôt et à Wallis-et-Futuna, les moyens sont plus ou moins partagés avec une participation de la Nouvelle-Calédonie en matière de recouvrement.
* 276 Plus précisément, le recouvrement est opéré par le payeur de la Polynésie (agent DGFIP) et deux receveurs particuliers : le receveur des impôts et celui des hypothèques, eux-mêmes agents de la Polynésie en tant que comptables secondaires.
* 277 Soit 5,8 % pour la patente. Rapport précité de la cour des comptes 2013, p. 82.
* 278 Rappelons que dans cette dernière collectivité, le système fiscal ne comprend aucune sanction pénale.
* 279 Son taux de prélèvements obligatoires est de l'ordre de 16 %.
* 280 À Saint-Barthélemy, le livre des procédures fiscales qui devaient accompagner le code des impôts depuis 2007 se fait attendre.
* 281 Définition proposée par le groupe national Management du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
* 282 Serge Delplace, Docteur ingénieur traitement de l'information, in colloque international réseau Redford, juin 2009 sur la responsabilité sociétale, une opportunité pour de nouvelles pratiques de management et de gouvernance.
* 283 Directeur général des services.
* 284 In Autonomie et responsabilité des cadres publics, une mutation managériale, coordonné par Pierre-Charles Pupion, collection cadre service public.
* 285 Réseau des Écoles de service public.
* 286 Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
* 287 Danielle Laport, directrice de l'Aract Martinique, docteur en sociologie et ingénieur social in la responsabilité sociétale, colloque international réseau Redford, juin 2009. Guide méthodologique responsabilité sociétale conçu par l'ARACT Martinique en direction des collectivités territoriales (http://martinique.aract.fr/portal/pls/portal/docs/1/2216361/PDF.
* 288 Accompagnement de la sociologie et de l'anthropologie de la représentation du monde de tous les jours aux Antilles.
* 289 Recrutement de cadres locaux sur des postes d'encadrement.
* 290 Les békés sont les descendants des colonisateurs.
* 291 Manifestation de solidarité entre voisins.
* 292 In « Le besoin de chefs au début du XX e siècle », Yves Cohen, Directeur d'études au CRH, École des hautes études en sciences sociales.
* 293 Conseil en stratégies sociales, professeur associé au Celta (Sorbonne).
* 294 Selon l'ONU, les autochtones représenteraient, à l'échelle mondiale, près de 800 millions de personnes. Il faut préciser qu'en dépit de multiples tentatives l'ONU n'a finalement retenu aucune définition officielle de la notion d'autochtone ; pour autant, l'importante étude de José R. Martinez Cobo permet d'identifier les éléments clés de la différenciation : les peuples autochtones constituent des groupes humains auto-identifiés, caractérisés par des systèmes sociopolitiques, des langues, des cultures, des valeurs et des croyances particulières, une relation privilégiée avec les terres et les ressources naturelles de leur territoire et, fréquemment, par l'existence d'une continuité historique avec les sociétés précoloniales.
* 295 Concernant la protection et l'intégration des populations indigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, adoptée en juin 1957.
* 296 Concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, adoptée le 27 juin 1989 et entrée en vigueur le 5 septembre 1991.
* 297 Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones approuvée le 13 septembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations-Unies (UN Doc A/61/L67, UN Doc A61 /L.67/Add, 12 et 13 septembre 2007).
* 298 Conformément à la conception extensive adoptée, en 2005, par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (aff Moiawana c. le Surinam, Séries C, n° 124, CIDH 15 juin 2005), cette notion regroupe non seulement les amérindiens mais également les noirs-marrons, descendants des esclaves africains.
* 299 Les revendications de droits au nom de l'autochtonie sont surtout présentes en Guyane française, elles concernent essentiellement les droits sur la terre et les ressources, la langue, l'éducation, la culture.
* 300 Aux termes de l'article 41 de la loi, le Conseil doit « promouvoir la reconnaissance et l'usage des langues amérindiennes, donner des avis au ministre concernant la protection de la nature et du patrimoine amérindien, y compris l'identification et la désignation des monuments amérindiens ».
* 301 La question de savoir où se situe la frontière entre les affaires intérieures relevant de la compétence des conseils communautaires et celles qui relèvent de la compétence de l'État concerné est importante car elle conditionne le contenu et la portée de l'autonomie de ces entités. Celle-ci dépend également des ressources et des moyens alloués à ces structures. Il est clair que la réponse à ces questions entretient des liens étroits avec le droit de propriété des terres et le contrôle des ressources naturelles.
* 302 Sur l'ensemble de ces points, voir Rapport National (A/HRC/WG.6/8/GUY/1), de l'ONU (A/HRC/WG.6/8/GUY/2).
* 303 Décision 91-290 DC , GDCC, n° 35.
* 304 Commune d'Awala-Yalimapo par exemple.
* 305 Codifiée aux art. L. 71-121-1 à L. 71-121-7, CGCT.
* 306 Il est admis aujourd'hui que l'autodétermination présente deux aspects : un aspect externe qui signifie qu'un peuple a le droit de décider de son statut international, par exemple revendiquer la sécession ou l'accès à l'indépendance. Mais l'auto-détermination présente également un aspect interne qui au sens de la Déclaration de 2007 signifie « le droit d'un peuple de choisir son propre régime politique, d'influer sur l'ordre politique de la région dans laquelle il vit et de sauvegarder son identité culturelle, ethnique, historique ou territoriale ». Cf. Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, 19 juillet 1993, § 17, p.19, 21, 23 .
* 307 Depuis décembre 2011 en Guyane française.
* 308 Aurelio Cal et communauté Maya de Santa Cruz c.Belize ; et Manuel Coy et Communauté Maya de Conejo c . Belize, affaires regroupées n°171§172, Cour suprême du Bélize (18 octobre 2007). Voir Clive Baldwin et Cynthia Morel, « Recourir à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans des actions en justice », in Peuples autochtones dans le Monde (Dir I. Bellier), Collections horizons autochtones, L'Harmattan, 2013.
* 309 Conférence sur les droits fonciers, 21/22 octobre 2011. Semaine guyanaise, novembre 2011, p.8.
* 310 H. Oberdorff, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Lextenso éditions, LGDJ, 2011.
* 311 Omai au Guyana, Rosebel au Surinam et en 2011, ce sont plus de 500 tonnes d'or qui ont été découvertes au Surinam.
* 312 Article 19 de la Déclaration de 2007.
* 313 Les revendications foncières des amérindiens et des Noirs-Marrons ne passant pas très bien auprès d'une large majorité de la population urbaine.
* 314 Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique.
* 315 Décret n° 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'Université de la Polynésie française et de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
* 316 118 îles dont 67 habitées.
* 317 Près de la moitié de la ZEE française.
* 318 C'est, de loin, la plus grande île de l'archipel, avec 16 346 km 2 (à peu près comme le Limousin : 16 942 km 2 ), soit 86 % de la superficie totale de la Nouvelle-Calédonie qui correspond, quant à elle, à 65 % de la superficie des outre-mers français, Guyane et TAAF déduits.
* 319 Les îles Loyauté, à l'Est : principalement, Ouvéa, Lifou et Maré et l'île des Pins, au Sud.
* 320 Ces trois îles de l'archipel de la Société concentrent 90 % du tourisme en Polynésie française qui représente de l'ordre de 13 % du PIB marchand, avec, ces trois dernières années (2011-13), un nombre de touristes en hébergement payant de 145 000 environ.
* 321 Le nickel représente 90 % des exportations du territoire en valeur. La Nouvelle-Calédonie représente entre 20 et 40 % des réserves mondiales de ce minerai et 9 % de la production mondiale.
* 322 En ce sens, TC, 22 janv. 921, Société commerciale de l'Ouest africain, Rec . 91 ; D. 1921.43.12., concl. Matter ; S. 1924.3.34, concl. Matter ; GAJA , 19 è éd., Paris, Dalloz, 2013, n° 36, p. 223 et s. Selon les professeurs Louis Rolland et Pierre Lampué, « toutes les dépendances coloniales sont constituées en centre d'intérêts distincts, en collectivités publiques douées de capacité juridique », in Précis de législation coloniale, 3è éd., Paris, Dalloz, 1940, p. 46.
* 323 La colonisation de la Polynésie française commence par les Marquises, en 1842, année du protectorat français sur les îles du Vent, les îles Tuamotu et deux îles des Australes : Tubuai et Raivavae. C'est en 1880 que ce protectorat est transformé en une nouvelle colonie, les EFO, qui intègrent alors les Marquises. Les îles Gambier sont annexées par la France, en 1891. L'archipel des îles-Sous-le-Vent, resté indépendant en 1842 - comme confirmé par l'accord franco-anglais dit « convention de Jarnac », entre 1847 et 1887 - est soumis, à son tour, au protectorat français en 1888, puis annexé par la France, en 1897. Quant aux îles Australes encore indépendantes, elles sont aussi annexées par la France, entre 1887 et 1901 : Rapa en 1887 ; Rurutu en 1900 ; Rimatara en 1901. Ainsi, c'est en dix ans seulement que les EFO de 1880 s'étendent à toute la Polynésie française, entre 1891 et 1901.
* 324 Préambule de la Constitution de 1946, al. 18 ; à ce sujet, Olivier Gohin, « Alinéa 18 » in Gérard Conac, Xavier Prétot et Gérard Teboul (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946 , Paris, Dalloz, 2001, p. 401-435. Cette thèse est combattue par les indépendantistes (Roch Wamytan ou Oscar Temaru, par ex.) qui sont parvenus à faire réinscrire la Nouvelle-Calédonie, en 1986, et la Polynésie française, en 2013, sur la liste des pays à décoloniser, la France étant alors en situation de puissance administrante.
* 325 Const. du 27 oct. 1946, art. 60, 74 et 85, principalement.
* 326 Const., accord de Nouméa du 5 mai 1998, publicisé et constitutionnalisé, et loi const. du 20 juil. 1998 : titre XIII nv, art. 76 et 77 nvx ; adde , art. 72-3, al. 3, issu de la loi const. du 28 mars 2003.
* 327 Const., art. 72-3, al. 2, issu de la loi const. du 28 mars 2003 préc.
* 328 En ce sens, Stéphane Diémert, « La Constitution, l'autodétermination des populations d'outre-mer et l'appartenance à la République : nouvelles perspectives », in Mélanges Louis Favoreu : Renouveau du droit constitutionnel , Paris, Dalloz, 2007, p. 637-659. De même, le principe d'irréversibilité de l'accord de Nouméa ne tient qu'à droit constitutionnel constant : ainsi, la révision de 2003 a pour objet et pour effet, à l'article 72-3, al. 1 er , d'invalider, en droit, la notion de « peuple kanak ».
* 329 Cette compétence de principe remonte, pour la Polynésie française, à la loi statutaire du 12 juil. 1977. Elle est fondée, en droit positif, sur l'art. 13 de la loi org. du 27 févr. 2004. En Nouvelle-Calédonie qui a eu la compétence de principe avec la loi statutaire du 28 déc. 1976, ce sont les provinces qui, depuis leur création, ont cette compétence de principe (loi org. du 19 mars 1999, art. 20), l'État et la Nouvelle-Calédonie ayant, l'un et l'autre, des compétences d'exception ( ibid. , art. 22 et 23), sans que le transfert progressif de compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie change cette donnée juridique.
* 330 Loi du 28 déc. 1976.
* 331 Loi n° 84-821 du 6 sep. 1984.
* 332 Loi du 9 nov. 1988. Cette loi référendaire vient après le statut Pisani (loi du 23 août 1985) et les statuts Pons I (loi du 17 juil. 1986) et Pons II (loi du 22 janv. 1988), suspendu par la loi du 12 juil. 1988.
* 333 Loi du 12 juil. 1977.
* 334 Loi n° 84-820 du 6 sept. 1984, modif. loi du 12 juil. 1990.
* 335 Loi org. du 12 avr. 1996.
* 336 Comme en témoignait le sénateur Guy Allouche (PS, Nord), à l'occasion de la discussion générale du projet de loi constitutionnelle (n° 425, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, « Les autorités polynésiennes ont regardé l'avenir de la Polynésie française tout en ayant la Nouvelle-Calédonie dans le rétroviseur. La situation néo-calédonienne a fourni à notre collègue Gaston Flosse un argument de poids pour avancer encore plus vite et plus loin dans la voie de l'autonomie politique », Sénat, séance du 12 oct. 1999.
* 337 À ce sujet, Olivier Gohin, « La prise en compte de la Polynésie française dans la révision constitutionnelle de mars 2003 », Revue juridique polynésienne : L'autonomie en Polynésie française - The concept of autonomy in French Polynesia , n° hors-série, 2004, vol. 4, p. 43-63.
* 338 Loi org. du 19 mars 1999, art. 3.
* 339 Const., art. 72-3, al. 3 préc., issu de la loi const. du 28 mars 2003.
* 340 Accord de Nouméa préc., mais aussi, l'art. 72, al. 4 sur l'expérimentation locale : en ce sens, la décision CC, 30 juil. 2003, Expérimentation par les collectivités territorial es, déc. 03-478 DC, Rec . 406 qui ne retranche pas la Nouvelle-Calédonie du champ d'application de la loi org. n° 2003-704 du 1 er août 2003.
* 341 À titre principal, la loi org. statutaire de 1999 préc.
* 342 À titre principal, la loi org. statutaire de 2004 préc.
* 343 On rappelle ici que, dans les outre-mers de spécialité, le droit métropolitain n'est pas, en principe, directement applicable, sauf à ce qu'en tout ou en partie , il soit rendu expressément applicable, même s'il peut l'être autrement au bénéfice d'adaptations, alors encadrées et susceptibles de contrôle juridictionnel.
* 344 « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution » : loi org. statutaire de 2004, art. 1 er , al. 2) ; égal., art. 2. Cette expression de « pays d'outre-mer » est reprise du projet préc. d'art. 78 de la Constitution qui n'a pas abouti.
* 345 CE Sect., 13 déc. 2006, JCP A 2007, 2004, concl. Verclytte et p. 43-46, note Gohin ; RFDA 2007. 18, concl. Verclytte, AJDA 2007. 363, chr. Lenica et Boucher ; D. 2007. 1175, note Verpeaux.
* 346 Loi org. du 27 févr. 2004, art. 1 er , al. 5 : « la Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes ». Le drapeau polynésien a été adopté par la délibération n o 84-1030 AT de l'assemblée territoriale, dans sa séance du 23 nov. 1984.
* 347 Accord de Nouméa préc., préambule, pt 5, § 4 ainsi que doc. d'orientation, pt. 1.5 ; loi org. du 19 mars 1999, art. 5, al. 1 er . On notera que, le 13 juillet 2010, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, hors délibération conforme à la loi organique, a émis le « voeu que soient arborés, ensemble, en Nouvelle-Calédonie, le drapeau dont la description est annexée et le drapeau national », le drapeau retenu étant celui des indépendantistes kanaks du FLNKS, adopté en 1984 ; à ce sujet, le dossier sur « la question des drapeaux en Nouvelle-Calédonie », in Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie , 16, 2010/2. Le 17 juillet 2010, le Premier ministre François Fillon, en déplacement officiel dans l'archipel, hisse, pour la première fois, le drapeau dit « Kanaky », à côté du drapeau français, sur le siège du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
* 348 En ce sens, Olivier Gohin et Jean-Gabriel Sorbara, Institutions administratives , coll. Manuels, 6 è éd., Paris, LGDJ, 2012, n° 151-160, p. 82-86.
* 349 CC, 25 févr. 1982, Décentralisation , déc. 82-137 DC, cons. 4, Rec . 38 ; GDCC , 17 è éd., Paris, Dalloz, 2013, n° 9 et les réf. ; voir, plus précisément, CC, 15 mars 1999, Statut de la Nouvelle-Calédonie , déc. 99-410 DC, cons. 24 (sol. impl.), Rec . 51 et CC, 12 févr. 2004, Second statut d'autonomie de la Polynésie française , déc. 04-490 DC, cons. 109 à 111, Rec. 41.
* 350 Familièrement dénommé « haussaire ».
* 351 CE, 15 janv. 1992, Président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, Rec. 20.
* 352 CE, 1 er octobre 2001, Roch Wamytan et autres , req. 232274.
* 353 Olivier Gohin, « Les lois du pays : contribution au désordre normatif français », RDP 2006/1, p. 85-112.
* 354 Pour s'en tenir à la loi org. statutaire de 1999, art. 99 (matières de la loi), 101 (compétence du congrès) ainsi que 103 et 104 (contrôle du haussaire).
* 355 Pour s'en tenir à la loi org. statutaire de 2004, art. 13 et 140 (matières de la loi), 142 (compétence de l'assemblée) ainsi que 143 et 176-I (contrôle du haussaire).
* 356 CE Ass., 27 décembre 1970, Saïd Ali Tourqui, Rec . 138 ; AJDA 1970.320, chr. Denoix de Saint Marc et Labetoulle.
* 357 Const., art. 73, al. 2 et 6 dans les matières de la compétence de ces collectivités territoriales ; Const., art. 73, al. 3 à 6, dans les matières de la compétence de l'État, sous réserve des matières intransférables (al. 4) et de l'exclusion de La Réunion de ce dispositif (al. 5).
* 358 Accord de Nouméa préc., préambule, pt 4, § 4 et pt 5, § 8 ainsi que doc. d'orientation, pt. 2, § 2 et pt. 3.1.1., § 2 et s. ; Const., art. 77, al 4 : « règles relatives à l'emploi » ; loi org. du 15 mars 1999, art. 24.
* 359 Const., art. 74, al. 10 : « mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier » ; loi org. du 27 févr. 2004, art. 18 et 19.
* 360 En ce sens, Olivier Gohin, « L'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie », AJDA 1999. 500.
* 361 CGCT, art. L. 1115-1, al. 1 er .
* 362 On notera que la Nouvelle-Calédonie, appuyée par les autorités françaises, demande à obtenir le statut de membre à part entière du Forum. Son statut qui est de large autonomie, sans être celui de l'indépendance ou de la libre association à la France, constitue, néanmoins, pour certains États membres, un obstacle à son éligibilité à ce titre. Wallis-et-Futuna est également membre de la Communauté qui a son siège à Nouméa, de même que la France, membre fondateur. De plus, Wallis-et-Futuna est observateur du Forum dont la France est partenaire, en tant qu'invitée au dialogue post-forum.
* 363 De même que Wallis-et-Futuna et la France.
* 364 On ne tient pas compte, bien entendu, du Groupe Fer de Lance Mélanésien (GFLM) qui associe le FLNKS, et non la Nouvelle-Calédonie, à des États mélanésiens de la région océanienne : Papouasie Nouvelle Guinée, Salomon, Fidji, Vanuatu et qui a tenu son 19 e sommet, à Nouméa, du 19 au 21 juin 2013.
* 365 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé, en avril 2012, le premier « délégué » pour la Nouvelle-Calédonie, en poste à l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande. Quatre autres postes devraient également être ouverts : en Australie et au Vanuatu, d'abord ; en Papouasie Nouvelle-Guinée et à Fidji, ensuite.
* 366 Accord de Nouméa, doc. d'orientation, pt. 3.2.1, § 1 et 5 ; égal., loi org. du 19 mars 1999 , art. 21-II-1° , art. 28 à 30 et 34.
* 367 Ibid ., § 2 à 4 ; égal., loi org. du 19 mars 1999 , art. 31 à 33.
* 368 Ibid ., pt. 3.3.
* 369 Loi org. du 27 févr. 2004, art. 15. L'expression de « relations extérieures » est en provenance du premier statut d'autonomie (loi org. du 12 avr. 1996, art. 6-1°), telle que reprise aux al. 2 et 7 du projet abandonné d'art. 78 de la Constitution.
* 370 CC, 12 févr. 2004, préc., cons. 27 : « Considérant que l'article 15 de la loi organique permet à la Polynésie française de " disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique " ; que, toutefois, cette faculté, qui n'appartenait pas jusqu'à présent à la Polynésie française, ne saurait, sans empiéter sur une matière de la compétence exclusive de l'État, conférer à ces représentations un caractère diplomatique ; que, sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution ».
* 371 Const., art. 74, al. 3 et loi org. du 27 févr. 2004, art. 14-3°. Cela inclut les « arrangements administratifs » qui sont des accords internationaux de mise en oeuvre déconcentrée de la politique étrangère de l'État français avec tout État ou territoire du Pacifique et donc une modalité de l'association de la Polynésie française à une compétence de l'État (ibid., art. 16 ; adde , Olivier Gohin et Marc Joyau, « L'évolution institutionnelle de la Polynésie française », AJDA 2004. 1245).
* 372 CEDH, 27 avr. 1995, Mme Piermont c/ France , RFDA 1997. 999, note Lévinet.
* 373 CEDH, 11 janv. 2005, M. Py c/ France , AJDA 2005. 551, chr. Flauss.
* 374 À ce sujet, Olivier Gohin, « L'organisation des outre-mers européens et l'articulation entre traité instituant la Communauté européenne et Constitutions des États membres », in Laurent Tesoka et Jacques Ziller (dir.), Union européenne et outremers unis dans leur diversité, Aix, PUAM, 2008, p. 87-119. On notera que l'accord de Nouméa précise que la Nouvelle-Calédonie « sera associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM » (doc. d'orientation, pt. 3.23.1., § 5) ; égal. voir loi org. du 19 mars 1999, art. 30 et 31, 89 et 180-6° et loi org. du 27 févr. 2004, art. 31-3°, 41 et 135.
* 375 CC, 2 sept. 1992, Maastricht II, déc. 92-312 DC, cons.19 ; Rec . 76.
* 376 Art. 74 modif. loi const. 25 juin 1992.
* 377 Tel est le cas de Mayotte, depuis le 31 mars 2011.
* 378 Par ex. CE, 16 oct. 2013, Société Électricité de Tahiti , AJDA 2014, n° 10, 17 mars 2014, p. 568-574, note Gohin.
* 379 Accord de Nouméa, préambule, pt. 5, § 9.
* 380 La consultation sera organisée au cours de la prochaine mandature (mai 2014 - mai 2019), à une date déterminée par le congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. À défaut de fixation de cette date avant la fin 2017, la consultation sera organisée à une date fixée par l'État, dans la dernière année du mandat (accord de Nouméa, doc. d'orientation, pt. 5, § 1 et 2). Les six derniers mois du mandat (déc. 2018-mai 2019) étant neutralisés (loi org. du 19 mars 1999, art. 217, al. 1 er ), ce serait alors entre mai et décembre 2018.
* 381 En cas de rejet de l'indépendance lors de la première consultation, l'accord de Nouméa va jusqu'à envisager la possibilité d'une seconde consultation, demandée par le tiers des membres du congrès, dans la deuxième année suivant la première (doc. d'orientation, pt. 5, § 3). Cette seconde consultation aurait lieu dans les dix-huit mois suivant la demande, sans pouvoir être organisée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès ( ibid .). Et, en cas de réponse à nouveau négative au suffrage restreint, une troisième consultation pourrait être organisée, sur la même question, aux mêmes conditions. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser que la demande de seconde ou de troisième consultation rendrait cette ou ces nouvelle(s) consultation(s) obligatoire(s) (CC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie , déc. 99-410 DC, cons. 50 à 53, Rec. 51).
* 382 Accord de Nouméa, préambule, pt. 4, § 6 et pt. 5, dernier § ; doc. d'orientation, pt. 5, § 3, 6 et 7.
* 383 Loi org. du 19 mars 1999, art. 107, al. 1 er .
* 384 À ce sujet, Olivier Gohin, « Pouvoir législatif et collectivités locales », in Mélanges Jacques Moreau , Paris, Economica, 2003, p. 177-193.
* 385 CEDH, 11 janv. 2005, M. Py c/ France , préc.
* 386 La Constitution définit le Parlement comme composé de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. 24, al. 2). Dès lors, est juridiquement fausse l'affirmation, lue sur le site du Conseil constitutionnel, selon laquelle une loi du pays calédonienne est un « texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif » (Découvrir la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) - première des « 12 questions pour commencer : qu'entend-on par `disposition législative' » ?
* 387 Loi org. du 19 mars 1999, art. 104 et 105.
* 388 Ibid ., art. 107, al. 2.
* 389 TA Nouvelle-Calédonie, 2 mars 2000, M. Bensimon, req. n° 9900452 ; CAA Paris, 20 décembre 2002 , M. Cortot, req. n° 02PA00451.
* 390 Comme il n'y a pas de base constitutionnelle à la connaissance par le Conseil constitutionnel des lois du pays par voie d'exception, retenue par la loi du 10 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a cru devoir en trouver une dans l'article 61-1 de la Constitution, en tant qu'il prévoit que la QPC est applicable aux « dispositions législatives » (CC, 3 déc. 2009, Application de l'article 61-1 de la Constitution , déc. 09-595 DC, cons. 33 et 34, Rec . 206). Mais, une disposition qui a force de loi n'a pas nécessairement la nature de la loi. Dès lors, si la QPC est recevable contre toute disposition législative, c'est au sens d'une disposition qui a force de loi, principalement une loi ordinaire ou organique, mais pas systématiquement : par ex., contre une loi du pays calédonienne ou contre une ordonnance de l'art. 92 ou encore contre une ordonnance ratifiée de l'art. 38.
* 391 Suffrage universel étendu aux femmes (ord. du 21 avr. 1944) et aux militaires d'active (ord. du 17 août 1945).
* 392 Accord de Nouméa, préambule, art. 4, § 3, art. 5, § 6 et avant-dernier § ; doc. d'orientation, pt 2. ; loi const. du 20 juil. 1998, art. 77, al. 4 ; loi org. du 19 mars 1999, art. 4. Sur le modèle de la citoyenneté de l'Union européenne qui permet de faire voter des non nationaux en France, il s'agit de donner l'illusion de ne pas rompre le lien entre citoyenneté et droit de vote qui remonte à la Révolution française pour éviter que des nationaux votent en France. L'art. 4 de la loi org. statutaire est très explicite à cet égard « Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188 ».
* 393 C'est aussi la raison pour laquelle la calédonisation des communes, avec application du suffrage restreint, prévue par l'art. 27 de la loi org. du 19 mars 1999, n'est toujours pas mise en oeuvre.
* 394 Le congrès est formé de la réunion de membres des trois assemblées de province (loi org. du 19 mars 1999, art. 62, al. 1 er ) : 32 élus de la province Sud sur 40, 15 élus de la province Nord sur 22 et 7 élus de la province des Îles Loyauté sur 14.
* 395 Accord de Nouméa, doc. d'orientation, pt. 2.2.1., § 4 et 5.
* 396 Const., art. 77, al. 4 et 7. L'al. 4 résulte de la loi const. du 20 juil. 1998 et l'al. 7 de la loi const. n° 2007-237 du 23 févr. 2007. La loi org. du 19 mars 1999 prévoit les règles relatives au régime électoral à ses art. 188 et 189, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel en faveur d'un électorat dit « glissant » : « Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 188 et 189 que doivent notamment participer à l'élection des assemblées de province et du congrès les personnes qui figurent au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 et sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998 » (CC, 15 mars 1999, Loi organique sur la Nouvelle-Calédonie, déc. 99-410 DC, cons. 33 ; Rec . 51) ; cette interprétation en faveur de l'électorat glissant est, d'ailleurs, celle de deux signataires anti-indépendantistes de l'accord de Nouméa : le député Pierre Frogier (JO Débats, Ass. nat., 11 juin 1999, p. 5 778) et le sénateur Simon Loueckhote (JO Débats, Sénat, 13 oct. 1999, p. 5067). À ce sujet, Olivier Gohin, « La Constitution française contre les droits de l'homme : le précédent de la restriction du suffrage en Nouvelle-Calédonie » , in Mélanges Pierre Pactet , Paris, Dalloz, 2003, p. 187-210.
Sous la pression des indépendantistes kanaks, sinon par leur chantage sur le retour à la violence armée, et, en tout cas, après l'arrêt Py c/France précité de la Cour de Strasbourg, en date du 11 janv. 2005, justifiant la restriction du suffrage, en Nouvelle-Calédonie, par des « nécessités locales », par application paradoxale de la clause dite « coloniale » de la Convention (art. 56, § 3), le pouvoir de révision est intervenu, à nouveau, pour inverser cette interprétation et imposer l'électorat dit « gelé » : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent (...) les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 » : la consultation du 8 novembre 1998 « et comprenant les personnes non admises à y participer », de sorte que ceux qui participent à ces élections sont a contrario ceux qui ont dix ans de domicile continu, en Nouvelle-Calédonie, au 8 novembre 1998, quelle que soit la date de leur établissement dans la collectivité ; à ce sujet, Olivier Gohin « La Nouvelle-Calédonie à l'épreuve d'un suffrage toujours plus restreint » , JCP A, 2006. 1107, p. 1695-1696 et « Quand la République marche sur la tête - Le gel de l'électorat restreint en Nouvelle-Calédonie », AJDA. 2007, p. 800-807.
* 397 C. cass., 16 nov. 2011 , Mme Jollivel , pourvoi n° 11-61129 ; égal., 5 mars 2012, Oesterlin , pourvoi n° 12-60526.
* 398 C. cass., 12 décembre 2013, Mme Y., pourvoi 13-60217.
* 399 Réponse du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à la question orale au Gouvernement posée à l'Assemblée nationale, le 25 févr. 2014, par Mme Sonia Lagarde (UDI, Nouvelle-Calédonie).
* 400 C'est au tiers électeur qu'il appartient de rapporter la preuve que l'électeur dont il demande la radiation de la liste électorale spéciale ne remplit aucune des conditions prévues par la législation électorale en vigueur (C. cass., 10 avril 2010, Mme X , pourvoi 1060248 et 60249), notamment celle d'avoir été inscrit au tableau annexe du 8 novembre 1998. Or, ce tableau n'existe pas, faute d'avoir été établi par l'administration en temps utile et cette preuve est donc impossible à rapporter à l'encontre des électeurs dont la radiation est demandée. Depuis lors, les commissions administratives spéciales, composées de magistrats judiciaires qui les président et de représentants de l'État, ont fait comme si toutes les personnes, présentes sur le territoire avant novembre 1998, y étaient inscrites. En conséquence, elles ont passé ces personnes, après dix ans de présence (électorat glissant), mais jusqu'en février 2007 au plus tard (électorat gelé), du tableau annexe de 1998 à la liste spéciale de l'année en cours. Ainsi, les tiers électeurs ne sont pas en mesure de rapporter la preuve que des électeurs dont il est constant qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste générale des électeurs, à la date du 8 novembre 1998, n'étaient pas inscrits non plus au tableau annexe, alors que cette dernière inscription est la condition essentielle à prendre légalement en compte, au titre de l'électorat glissant, jusqu'en 2007. Au demeurant, il n'est pas davantage possible aux tiers électeurs de rapporter la preuve du défaut d'établissement en Nouvelle-Calédonie, pendant dix ans au moins, entre novembre 1988 et février 2007, des électeurs qui n'ont pas pu voter en novembre 1998, faute de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie à cette date, et inscrits sur la liste spéciale après cette date.
* 401 Les TPI, compétents en premier et dernier ressort, statuent sur recours des décisions prises par les commissions administratives spéciales qui, de façon inouïe, auront fonctionné sous le regard d'une mission des Nations-Unies. Les TPI de Nouméa et de Koné ont pris, le 11 avril, lendemain du colloque, des décisions divergentes : décisions de rejet des radiations dans le premier cas ; solution inverse dans le second cas.
* 402 Accord de Nouméa, doc. d'orientation, pt. 2.2.1, § 1 à 3 ; Const., art. 77, al. 5, issu de la loi const. du 20 juil. 1998. ; loi org. du 19 mars 1999, art. 218 et 219 ; à ce sujet, Olivier Gohin, « Le droit de vote en Nouvelle-Calédonie » in Jean-Yves Faberon et Guy Agniel (dir.), La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, Coll. Les Études, Paris, La Documentation française, 2000, p. 387-397. C'est pour ne pas confronter consultation d'autodétermination au suffrage restreint et référendum local au suffrage universel que le Conseil constitutionnel exclut le référendum local de l'art. 72-1, al. 2, en Nouvelle-Calédonie (CC, 30 juil. 2003, Référendum local, déc. 03- 482 DC, cons., Rec. 414, cons. 4 et 5, le jour même où il n'y interdit pas et donc il permet l'expérimentation locale (CC, 30 juil. 2003, déc. 03-478 DC, préc). Cette nouvelle mésaventure du positivisme juridique (en ce sens, Anne-Marie Le Pourhiet, « Nouvelle-Calédonie : la nouvelle mésaventure du positivisme juridique », RDP 1999, p. 1005-1035) conduit, décidément, le juge constitutionnel à de sérieuses contorsions.
* 403 L'accord de Nouméa envisage pas moins de trois consultations successives sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie : au cours du quatrième mandat (mai 2014-mai 2019), une consultation électorale sera organisée, à une date déterminée par le congrès, au cours de ce mandat, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ; à défaut de fixation de cette date avant mai 2018, la consultation sera organisée, à une date fixée par l'État, dans la dernière année du mandat. Si la réponse des électeurs est négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée selon la même procédure et dans les mêmes délais. Si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée.
* 404 En application de ce dispositif de la Constitution, la loi org. du 19 mars 1999 définit « les conditions et les délais » dans lesquels les populations calédoniennes auront à se prononcer sur l'indépendance. Elle précise que la première consultation ne peut intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat, c'est-à-dire entre décembre 2018 et mai 2019, période ainsi neutralisée. Les deux consultations suivantes sont facultatives. Mais, à la demande du tiers des membres du congrès, elles deviennent obligatoires (en ce sens, CC, 15 mars 1999 préc., cons. 50 à 53). Alors que l'accord de Nouméa dit que la deuxième consultation doit, en ce cas, être organisée au cours de la deuxième année suivant la première consultation (doc. d'orientation, pt. 5, § 4), la loi organique, pour sa part, précise que cette nouvelle consultation a lieu, sur demande écrite déposée à partir du sixième mois suivant le premier scrutin, mais pas dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès, et ce dans les dix-huit mois suivant cette demande, mais pas dans la période neutralisée (art. 217, al. 2 et 3) : cela ne permet pas de donner une date certaine. Du reste, le principal rédacteur de ces textes reconnaît que « la loi organique ne fixe pas de délai au terme duquel ce pouvoir » (de provoquer une nouvelle consultation, confiée à une minorité indépendantiste) « deviendrait caduc » (François Garde, Les institutions de la Nouvelle-Calédonie, coll. Mondes océaniens, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 92). Quoique contraire à l'accord de Nouméa sur ce point, ce dispositif n'a, pourtant, pas été censuré par le Conseil constitutionnel, en 1999. Le cas échéant, la troisième consultation suit le même régime que la deuxième et aggrave donc l'incertitude qui pèse sur le processus de sortie du régime transitoire, fixé à la Nouvelle-Calédonie, depuis 1998.
* 405 En ce sens, Jean-Yves Faberon, « L'évolution du droit de vote en Nouvelle-Calédonie », RJP 2001, p. 91-103.
* 406 On pourrait concevoir de revenir aussi sur certains transferts de compétences portant atteinte à l'État régalien ou aux libertés publiques ou à l'égalité en droits entre Français : par ex., la calédonisation préc. des communes n'aurait plus aucune raison d'être dès lors que le suffrage restreint aurait disparu.
* 407 On rappelle cette affirmation du secrétaire d'État à l'Outre-mer, Jean-Jacques Queyranne : « Bien évidemment, cette notion de corps électoral restreint ne vaut que pour la durée de l'accord » (JO Débats Sénat, 13 oct. 1999, p. 5 068).
* 408 On se réfère ici à ce motif de la décision du Conseil constitutionnel du 8 août 1985 : « considérant que le congrès dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire (...) » (CC, 8 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie , déc. 85-196 DC, cons. 16, Rec . 63).
* 409 « La précarité dans la fonction publique territoriale », Rapport du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale, 16 mars 2011.
* 410 Jean Ripert, L'égalité sociale et le développement économique dans les DOM, 1989 ; Eliane Mossé, Quel développement économique pour les départements d'outre-mer ?, février 1999 ; Bertrand Fragonard, Les départements d'outre-mer : un pacte pour l'emploi, juillet 1999 ; Michel Mercier, Pour une République territoriale : l'unité dans la diversité, 1999-2000 ; Lambert Jérôme, Rapport sur le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, 4 mai 2000 ; Marc Laffineur, Rapport d'information sur la fonction publique d'État et la fonction publique locale outre-mer, 25 septembre 2003 : Jean-Pierre Brard, Rapport d'information relatif à l'amélioration de la transparence des règles applicables aux pensions de retraite et aux rémunérations outre-mer, 13 mars 2007.
* 411 Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, « Les contrats aidés dans les collectivités territoriales au 31/12/2008 », Synthèse n° 27, décembre 2009.
* 412 Loi n° 2003-660.
* 413 Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, JORF du 6 avril 1950, p. 3707 et loi du 30 juin 1950 pour les TOM.
* 414 Décrets n°49-55 et n° 71-485.
* 415 JORF du 27 mai 1998, p. 8039.
* 416 Article 77, issu de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF du 21 juillet 1998, p. 11143.
* 417 Article 3.1.1. de l'Accord de Nouméa.
* 418 Article 18, alinéa 2.
* 419 CE 25 novembre 2009 Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 328 776.
* 420 http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-conduite-par-l-Etat-de-la-decentralisation
* 421 http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
* 422 Polynésie française, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.
*
423
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Collectivite-de-la-Polynesie-francaise-Finances-et-fiscalite
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Region-Nouvelle-Caledonie-Nouvelle-Caledonie-Nouvelle-Caledonie
* 424 Avis n° 2011.00802, sur le budget primitif 2011 de la collectivité d'Outre-mer (COM) de Saint-Martin.
* 425 La compétence fiscale étendue distincte du droit commun, si elle s'est trouvée éteinte de 1946 à 2007 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy lors de leur appartenance au département de la Guadeloupe n'a pas été fortement impactée à Saint-Pierre-et-Miquelon lors de l'intermède statutaire du département de 1975 à 1985.
* 426 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014386QPCccc_386qpc.pdf
* 427 Lois annotées ou Décrets, ordonnances, avis du Conseil d'État, etc., 1 ère série 1789-1830, p.15.
* 428 Voir Élise Untermaier, Les règles générales en droit public français, LGDJ, Bibliothèque Droit public, Tome 268, 2011.
* 429 M. Chamblain, Recueil général des lois et des arrêts, Sirey, 1866, Paris, 3, p.48-49.
* 430 Voir Karine Galy, « Pluralisme institutionnel et répartition des compétences locales : améliorer la cohérence et renforcer le partenariat », p.183 et s., in Aménagement du territoire et développement durable. Les collectivités françaises de l'espace Amazonie-Caraïbe en quête d'un projet territorial, (Marie-Joseph Aglaé (Dir.), Cujas, 2009.
* 431 Cons. const., Décision n°96-377DC, JORF, 13 avril 1996, p.5724, Rec., p.46.
* 432 Cons. const., Décision n° 99-412DC, JORF, 18 juin 1999, p.8964.
* 433 CAA Lyon, 13 décembre 2007, req. n°06LY00379, Préfet de l'Allier contre commune de Bellenaves, inédit.
* 434 Cons. const., Décision n°2004-505DC, JORF, 24 novembre 2004, p.19885, Rec., p. 173.
* 435 En ce sens, la récente décision du Conseil constitutionnel 2014-386 QPC du 28 mars 2014, collectivité de Saint-Barthélemy, JORF, 30 mars 2014, p. 6203.
* 436 Loi organique 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, JORF, 2 août 2003, p.13217.
* 437 Cons. const., Décision n°2003-478 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, JORF, 2 août 2003, p.13302.
* 438 Cons. const. Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF, 21 mars 1999, p. 4238, Rec., p.63.
* 439 Loi organique 2013-1027 du 15 novembre 2013, JORF, 16 novembre 2013, p.18616 et s.
* 440 Cons. const., Décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, JORF, 16 novembre 2013, p. 18634.
* 441 Cf. Jean-Luc Albert, Douane et droit douanier, PUF, 2013.







