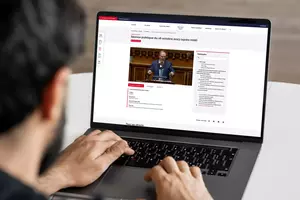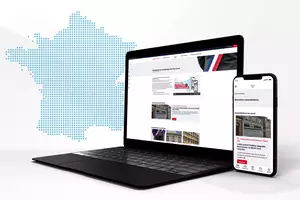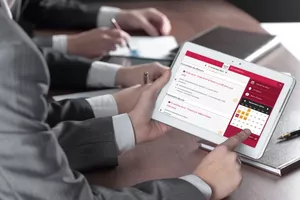B. UNE PERTINENCE LIMITÉE DES INTERVENTIONS AU REGARD DES BESOINS DU SECTEUR
1. Une conception des dispositifs parfois peu stratégique
La Cour des comptes met en avant les lacunes de la conception des plans, faute d'une gouvernance adaptée. Ainsi, elle souligne « l'imprécision » de la définition des montants mobilisés dans le cadre des plans, ce qui découle d'un manque de réflexion préalable : « la stratégie des investissements dans les industries culturelles et créatives des PIA 1 et 3 est ainsi peu écrite. Il n'existe pas de stratégie cadre ni d'exposé des objectifs qu'il serait légitime de poursuivre, hormis, en filigrane, la nécessité de soutenir la transformation numérique de ces industries ».
En conséquence, faute d'une conception suffisamment stratégique en amont, le soutien apportés par les divers plans s'est parfois avéré inadapté. Ainsi, s'agissant du plan de relance, le soutien massif apporté aux industries culturelles a pu entrer en conflit avec les évolutions structurelles de certaines filières, voire avec certaines politiques historiques du ministère de la Culture.
Un cas spécifique qui interroge : les
aides à la presse
dans le cadre du plan de relance
Le secteur de la presse a bénéficié de 58 millions d'euros de crédits du plan de relance, s'ajoutant à 5 millions d'euros votés en loi de finances rectificative pour 20202(*). À noter que les crédits non consommés dans le cadre du plan de relance ont été utilisés en 2023 pour financer les aides à la presse dans le contexte inflationniste.
Ces aides s'ajoutent aux aides à la presse de droit commun. La Cour des comptes relève que les crédits distribués aux entreprises de presse dans le cadre du plan de relance s'avèrent très concentrées, à la fois géographiquement et par bénéficiaires. Ce constat s'explique d'autant plus facilement que la Cour indique qu'aucun « critère relatif à la concentration des médias ni à la répartition géographique des bénéficiaires du Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) ne figure dans les critères d'éligibilité ou d'évaluation prévus » par décret.
Si cette aide ponctuelle a pu être indispensable pour certains titres de presse, elle ne saurait éluder les difficultés de long terme du secteur, nécessitant une réforme d'ampleur. Dans la mesure où la crise du secteur de la presse écrite est bien antérieure à la crise sanitaire, les mesures contracycliques dans le cadre du plan de relance peuvent s'apparenter à un emplâtre sur une jambe de bois. Le chiffre d'affaires global du secteur a reculé de 6 % entre 2019 et 2022, et cette tendance est amenée à durer.
L'aide à la presse doit aujourd'hui être conçue comme une aide à l'investissement et non plus comme un soutien à des titres fragiles, n'ayant pas pu ou su procéder à une révision de leurs modèles ou comme un appui à des messageries (France Messagerie en premier lieu) qui ne peuvent rien face à la diminution inexorable du lectorat « papier ».
Source : commission des finances
Les rapporteurs spéciaux ne peuvent sur ce point que reprendre les constats de la Cour des comptes, qui relève que « l'occasion semble avoir été manquée d'aborder les enjeux pourtant identifiés de transformation véritablement nécessaires pour l'avenir (presse, livre, musique), mais trop complexes pour que les dispositifs adéquats puissent être élaborés en quelques semaines », le plan de relance ayant été mis en place dans l'urgence.
Si le plan de relance a bénéficié à l'ensemble des industries culturelles, la Cour des comptes relève également que les plans d'investissement ont été massivement orientés vers quelques filières : « le cinéma, l'audiovisuel, l'image animée ou le numérique sont clairement privilégiés » car celles-ci étaient davantage « proactives ». L'exemple le plus frappant est l'appel à projet « La grande fabrique de l'image », géré par la Caisse des dépôts et dont l'angle phare est l'aménagement ou la modernisation d'une dizaine de grands studios de tournage, se voulant compétitifs avec les plus grands studios internationaux (153 000 m² de plateaux de tournage et 187 000 m² de décors extérieurs permanents devant être construits d'après le ministère). La conception du programme se basait pour compléter l'analyse du ministère notamment sur une étude des besoins confiée par le CNC au cabinet McKinsey. Si ce programme représente selon la Cour des comptes un « “passage à l'échelle" significatif », les rapporteurs spéciaux s'interrogent cependant sur le dimensionnement du projet au regard du volume actuel des tournages sur le territoire français. En outre, la Cour note que « bien que le CNC ait indiqué dans sa réponse à la Cour que l'appel à projets ne s'adressait pas à des projets reposant à plus de 30 % sur une subvention de France 2030, 27 projets [sur 68] ne respectent pas cette condition », ce qui doit interroger sur la viabilité à terme de certains d'entre eux.
En outre, les 350 millions d'euros de France 2030 s'ajoutent aux crédits et réductions d'impôt devant accroître la relocalisation des tournages en France, alors que le montant record de 591 millions d'euros de dépenses éligibles a été atteint en 2022. Ce sont 346 millions d'euros de dépenses supplémentaires par rapport au niveau de 2019, soit une progression de 141 %. Le montant total de la dépense fiscale a été chiffré à 472 millions d'euros en 2023, soit un niveau à peu près équivalent à celui constaté en 2022. Les montants prévisionnels pour 2024 dénotent une nette progression (+ 55 millions d'euros) atteignant des niveaux inédits. En conséquence, il est légitime de s'interroger sur le caractère massif des financements apportés dans le cadre de la Grande fabrique de l'image, s'ajoutant aux divers soutiens publics au cinéma, comme l'a indiqué à plusieurs reprise la commission des finances3(*).
Enfin, les rapporteurs spéciaux s'interrogent sur les moyens considérables déployés dans le cadre de l'appel à projet Culture immersive et métavers à hauteur de 150 millions d'euros géré par Bpifrance, s'ajoutant aux 50 millions d'euros destinés à financer les technologies du métavers hors champ de la culture. Dans le contexte de tensions sur les finances publiques, il n'est pas certain que consacrer 200 millions d'euros au métavers fasse partie des investissements prioritaires, y compris dans le seul domaine culturel.
2. Les investissements de la Caisse des dépôts et de Bpifrance : une prise de risque élevée pour des investissements dont la pertinence reste à démontrer
Une part importante de la gestion des PIA et certains dispositifs de France 2030 ont été confiés aux deux opérateurs généralistes que sont la Caisse des dépôts et Bpifrance. La Cour des comptes a une vision très critique de certains appels à manifestation d'intérêt gérés par ces opérateurs.
Ainsi, l'appel à manifestation d'intérêt « Culture, patrimoine, numérique » géré par la Caisse des dépôts depuis 2017 dans le cadre du PIA 1 avait pour but de financer des projets innovants mêlant culture et numérique. Il concentre nombre des limites soulevées par la Cour. L'appel est doté de 140 millions d'euros jusqu'à fin 2024. Au printemps 2023, cinq des quatorze sociétés lauréates étaient placées en procédure collective, soit un taux de sinistralité de 35 %, largement supérieur à la moyenne. Cette proportion de défaillance découle d'un défaut d'évaluation du risque par la Caisse des dépôts : « le suivi étroit de ces souscriptions en capital a fait défaut, ainsi que l'évaluation de [la] performance réelle » des entreprises, qui, souffrent « d'une absence de modèle économique viable ». En outre, selon la Cour, les projets financés n'ont parfois qu'un lien distant, pour ne pas dire inexistant dans certains cas, avec le secteur culturel.
Le fonds ICC/Tech and Touch, géré par Bpifrance mais dont les parts sont souscrites par la Caisse des dépôts, pour un montant total de 125 millions d'euros, fait l'objet d'une analyse détaillée par la Cour des comptes. Ce fonds a procédé par des prises de participation dans 13 entreprises, par la souscription à un fonds de fonds et par des placements en organismes de placements collectifs (OPC). S'agissant du fonds de fonds, qui représente un engagement de 10 millions d'euros, il semble n'avoir aucun lien avec les industries culturelles4(*).
S'agissant des entreprises, pour la plupart des start-up, concernées par la prise de participation, leur examen révèle d'autres difficultés : le fonds ICC/Tech and Touch a investi dans une start-up dont la maison mère est domiciliée dans le Delaware ; une autre propose des jetons non fongibles (NFT) dans le secteur de la mode, activité hautement spéculative et sans lien direct avec le secteur culturel ; une troisième est une société de podcasts connaissant des problèmes de droits d'auteurs et dont la valeur s'est considérablement dégradée après la prise de participation de Bpifrance (d'après la Cour, d'une valeur d'1,6 million d'euros lors de leur souscription, les actions détenues par Bpifrance ne représentaient ainsi plus que 179 000 euros lors de la revente de la start-up en juillet 2022).
D'autre part, l'effet levier sur les industries culturelles semble extrêmement faible, rapportés aux 14 millions d'euros d'ores et déjà décaissés dans le cadre de prise de participation dans des start-up : Bpifrance évoque une progression de seulement 115 emplois dans la totalité des 13 entreprises bénéficiaires entre 2021 et 2023, ce que les rapporteurs spéciaux considèrent comme particulièrement alarmant.
Si la Cour met donc en avant un « bilan très mitigé » de ces opérations, les rapporteurs spéciaux considèrent quant à eux qu'une telle gestion, s'agissant d'argent public, n'est pas tolérable de la part d'opérateurs expérimentés.
* 2 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 3 Itinéraire d'un art gâté : le financement public du cinéma, Roger KAROUTCHI, rapport n° 610 au nom de la commission des finances, mai 2023.
* 4 L'inventaire des prises de participation du fonds de fonds dressé par la Cour est à cet égard éloquent : ameublement, vins, jouets, confection « durable » de vêtements, foie gras de synthèse, alimentation premium pour chats et chiens, fabrication robotisée de pizzas, produits cosmétiques, service de réparation électroménager à domicile...