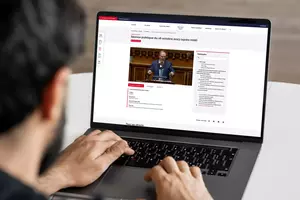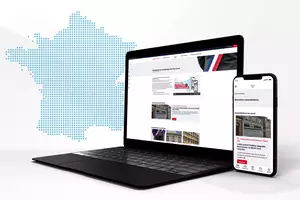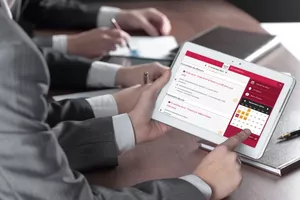IV. APRÈS LA DIRECTIVE CSRD, UNE PAUSE S'IMPOSE
Le processus normatif de l'Union européenne ne s'arrête pas à la directive CSRD.
A. RÉVISION DE LA DIRECTIVE SFDR : ALIGNER LE FINANCIER ET LE NON-FINANCIER
La directive CSRD conduit à réviser la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) afin d'aligner les réglementations non financières et financières et de définir des exigences minimales fondamentales pour faire franchir à la finance durable une nouvelle étape.
Le souci d'allégement doit également concerner les informations à fournir par les institutions financières, car cette complexité risque de dissuader les investisseurs de réaffecter leur épargne vers une économie plus durable au lieu de les aider à déterminer des préférences claires en matière de durabilité.
B. DIRECTIVE « DEVOIR DE VIGILANCE » : PRENDRE LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Inspirée par la loi française du 27 mars 2017, la proposition de directive relative au devoir de vigilance raisonnable en matière de développement durable des entreprises, dite directive CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence), doit articuler le plan de vigilance que les entreprises concernées doivent adopter et le rapport de durabilité.
Elle traite des risques de violations des droits humains et environnementaux tout au long de la chaîne de valeur. La proposition de directive prévoit qu'une entreprise peut désormais être tenue juridiquement responsable si l'un de ses fournisseurs habituels ne respecte pas les normes du droit du travail ou si ses activités portent atteinte à l'environnement. Les sociétés qui ne respecteraient pas les règles pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 5 % de leur chiffre d'affaires mondial.
La résolution européenne du Sénat du 1er août 2022 a regretté que la lutte contre le changement climatique ne figure plus dans l'annexe de la proposition de directive et ne relève donc pas du périmètre du devoir de vigilance, « alors que certaines activités ont incontestablement des effets négatifs en matière climatique ». Elle a souhaité qu'un « lien plus précis soit établi entre le devoir de vigilance et la lutte contre le changement climatique ». Elle demande par ailleurs que les obligations des PME en matière de durabilité soient proportionnées à leurs ressources et prioritairement centrées sur les incidences négatives réelles de leurs activités.
Par ailleurs, la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a adopté, le 28 juin 2023, un avis politique, au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
La directive est toujours en cours de négociation, et le secteur financier a été inclus, par le Parlement européen, de son champ contrairement à la proposition du Conseil européen, même si leurs obligations sont allégées.
La coordination avec la directive CSRD doit être maximale afin de ne pas surajouter de complexité, d'autant plus que le régime de responsabilité est source de contentieux compte tenu de l'articulation des responsabilités entre la société mère et ses filiales, évoqué dans un rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris.
Pour la rapporteure Marion Canalès, ce projet de directive s'inscrit toutefois dans le prolongement logique de la directive CSRD. La future directive devra veiller à ce que les entreprises, y compris les entreprises de services financiers, exercent le devoir de vigilance en matière d'environnement, de gouvernance et de droits humains sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, y compris en dehors de l'Europe. La « pause » normative devrait donc s'appliquer après l'adoption de cette directive, corollaire de la directive CSRD en matière de reporting.
La délégation recommande...
... d'aligner la définition du risque
climatique
si ce dernier est intégré au champ du devoir de
vigilance
La consultation des représentants des entreprises devra être approfondie d'autant que l'adoption de la proposition de directive a été retardée à l'initiative de l'Allemagne et, qu'en France, sa complexité a suscité des inquiétudes qui se sont exprimées après l'adoption du rapport par la délégation aux Entreprises.
Le MEDEF, dans un communiqué du 8 février 2024 a exprimé de « vives préoccupations » et demandé à « poursuivre les discussions », car la proposition de directive « ne prend pas en compte l'environnement souvent complexe dans lequel les entreprises opèrent. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n'est aujourd'hui réellement en mesure de contrôler l'entièreté de sa chaîne de valeur ou d'activités. Les impacts opérationnels et financiers de ce texte sur nos entreprises sont difficilement mesurables et de ce fait, n'ont pas été sérieusement évalués par une étude d'impact ». Il considère que l'approche répressive adoptée par le texte expose les entreprises européennes à des risques de sanctions éliminatoires, « entravant sérieusement la compétitivité européenne ». Dans un contexte international où les tensions sont de plus en plus exacerbées, « l'Europe se distingue encore une fois en produisant des normes sans envisager les conséquences concrètes pour ses entreprises ».
La CPME a considéré, dans un communiqué du 13 février 2024, que « la volonté de supprimer les impacts négatifs que certaines activités peuvent générer sur les droits de l'homme, les droits sociaux, l'environnement et le changement climatique est parfaitement compréhensible. En revanche, les modalités pour y parvenir ne sont pas, en l'état, acceptables ». Elle juge que les dispositions incluses dans cette proposition de directive, qui compte près de 500 pages, « imposeraient une très lourde charge administrative aux PME, à rebours de tous les grands discours actuels sur la simplification ». Comme pour la directive CSRD, les PME, même si elles ne sont pas directement visées, seraient mécaniquement affectées du fait de leur appartenance à une chaîne de valeur et contraintes d'effectuer un reporting à la demande de leurs partenaires commerciaux, sous peine d'être évincées des marchés. La CMPE demande donc « d'introduire des simplifications et des mesures d'accompagnement en faveur des PME. Il serait totalement incohérent de plaider en faveur de mesures de simplification en France et d'agir à Bruxelles pour complexifier davantage encore la vie des entreprises ».