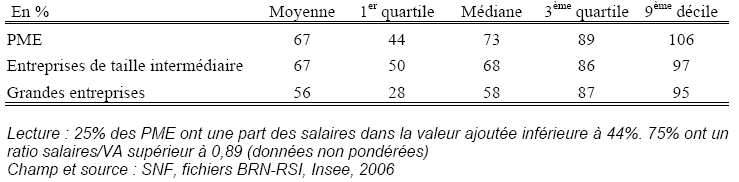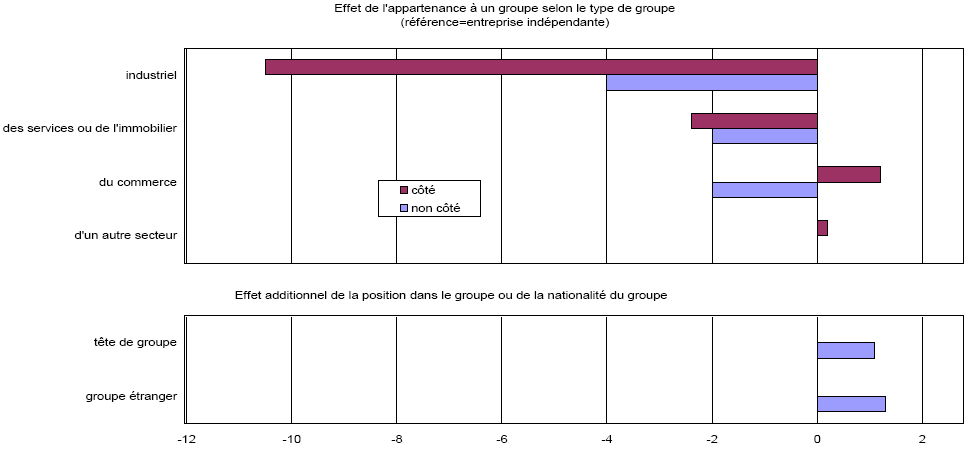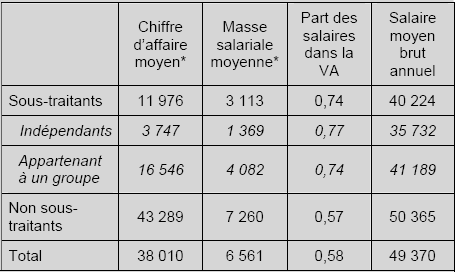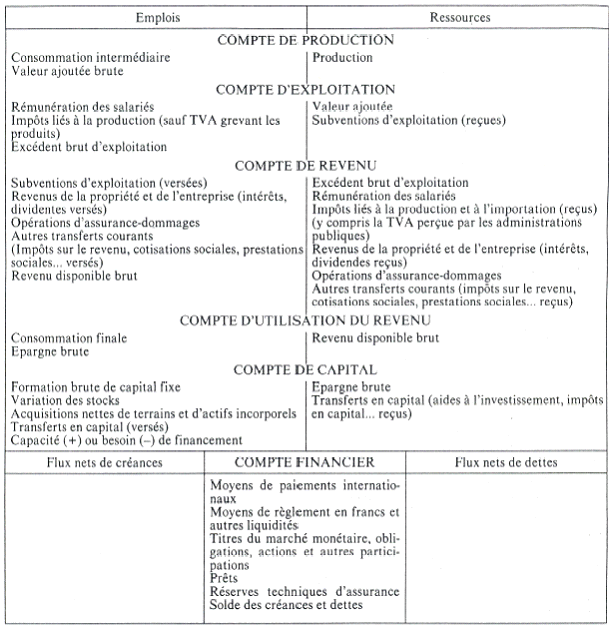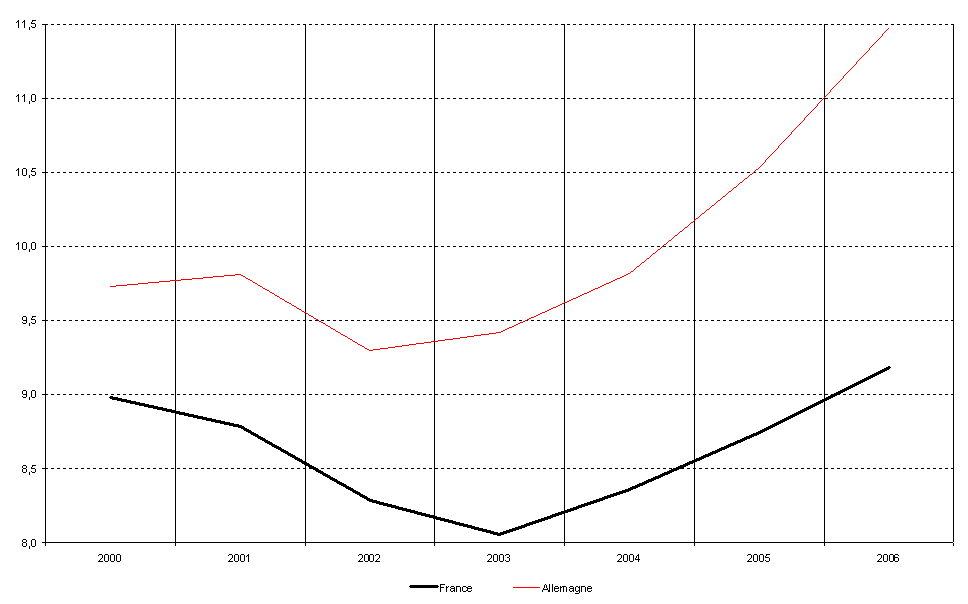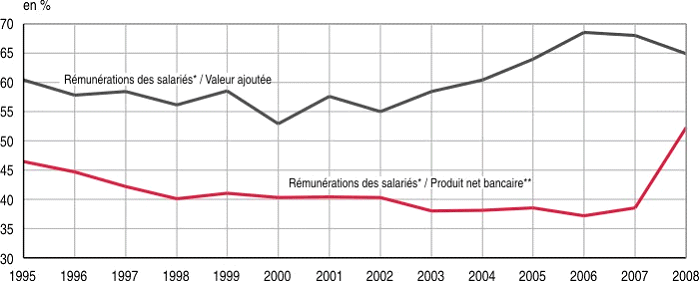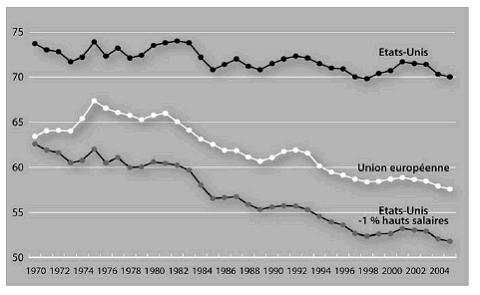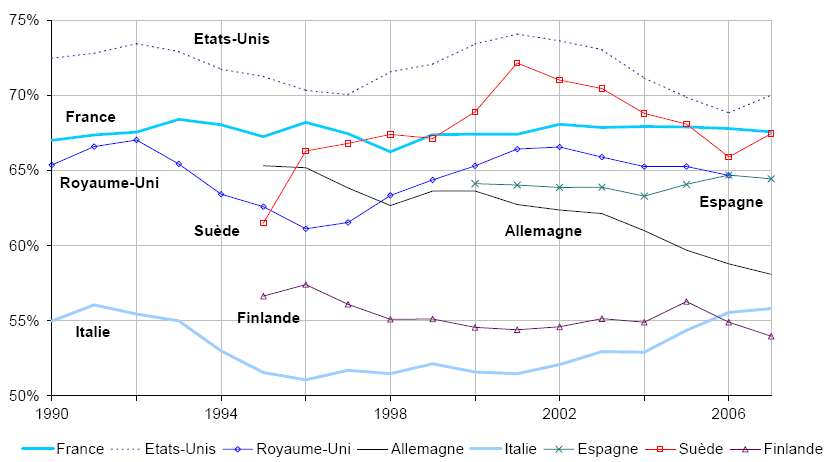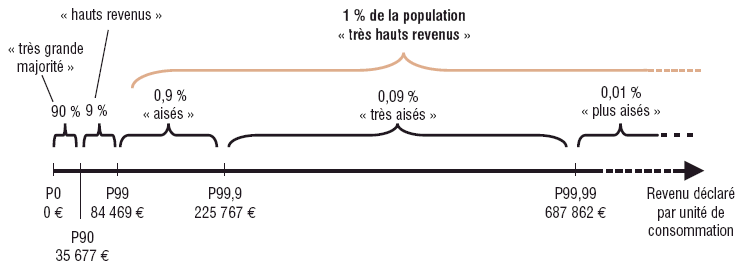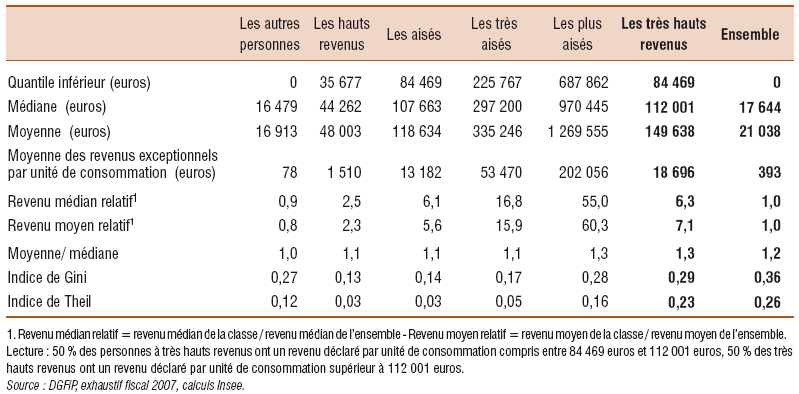Rapport d'information n° 227 (2010-2011) de M. Joël BOURDIN et Mme Patricia SCHILLINGER , fait au nom de la Délégation à la prospective, déposé le 18 janvier 2011
Disponible au format PDF (4,8 Moctets)
-
SYNTHÈSE GÉNÉRALE DU
RAPPORT
-
INTRODUCTION - PRODUCTIVITÉ :
NOUVELLES APPROCHES, NOUVELLES TENSIONS
-
PREMIÈRE PARTIE : MALAISE DANS
L'ENTREPRISE
-
I. PEU DE SALAIRES, DE PLUS EN PLUS
D'HÉTÉROGÉNÉITÉ SALARIALE
-
A. LE POUVOIR D'ACHAT DES REVENUS SALARIAUX
PROGRESSE PEU
-
B. DES TRAJECTOIRES SALARIALES
DIFFÉRENCIÉES ET DES INÉGALITÉS SALARIALES QUI
AUGMENTENT
-
1. Des pratiques salariales qui
s'individualisent
-
2. Une augmentation des inégalités
salariales
-
a) Une réalité peu apparente dans
certains indicateurs
-
b) Mais une différenciation salariale qui
s'accentue
-
(1) En fonction de l'employeur
-
(2) Entre les hauts salaires et le reste du
salariat
-
(3) Selon la qualité de la position dans
l'emploi
-
(4) Les risques accrus d'une augmentation du
salariat pauvre
-
a) Une réalité peu apparente dans
certains indicateurs
-
1. Des pratiques salariales qui
s'individualisent
-
A. LE POUVOIR D'ACHAT DES REVENUS SALARIAUX
PROGRESSE PEU
-
II. UNE EXPLICATION CONSENSUELLE MAIS À
PROLONGER : LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE ET DES GAINS DE
PRODUCTIVITÉ
-
III. UNE EXPLICATION PLUS
CONTROVERSÉE : LA DÉFORMATION DU PARTAGE DE LA VALEUR
AJOUTÉE AUX DÉPENS DES SALAIRES
-
A. VALEUR AJOUTÉE ET GLOBALISATION
-
B. VALEUR AJOUTÉE ET FINANCIARISATION DE
L'ÉCONOMIE
-
1. Une question technique aux conséquences
pratiques importantes : la consommation de services financiers par les
entreprises non financières
-
2. Une position de principe controversée de
la comptabilité nationale sur le concept de richesses
-
3. Des choix de méthode qui brouillent la
vision de la répartition des richesses
-
4. Les questions posées par
l'appréciation de la rentabilité du capital : comment
appréhender le rendement des actifs ?
-
1. Une question technique aux conséquences
pratiques importantes : la consommation de services financiers par les
entreprises non financières
-
C. COMMENT MESURER LES SALAIRES ?
-
1. Le salaire et ses évolutions : un
changement de nature ?
-
2. Comment traiter l'intéressement et la
participation ?
-
3. Les questions posées par
l'économie souterraine
-
4. Les conditions de financement de la protection
sociale
-
5. De quelques problèmes comptables
résultant de règles d'enregistrement des opérations en
comptabilité nationale
-
1. Le salaire et ses évolutions : un
changement de nature ?
-
A. VALEUR AJOUTÉE ET GLOBALISATION
-
I. PEU DE SALAIRES, DE PLUS EN PLUS
D'HÉTÉROGÉNÉITÉ SALARIALE
-
CHAPITRE II - TENSIONS SUR LES CONDITIONS DE
TRAVAIL
-
I. MANAGEMENT, ORGANISATION ET RYTHME DU TRAVAIL
ORIENTÉS PAR L'EXIGENCE D'UNE RENTABILITÉ ACCRUE
-
II. UN INCONFORT AU TRAVAIL EN PARTIE
CONTRE-PRODUCTIF
-
A. UNE PRÉCARISATION DIFFUSE DANS LE CADRE
D'UN ÉQUILIBRE AUTONOMIE/SÉCURITÉ
DÉGRADÉ
-
1. Une qualité du travail compromise par
l'accumulation de contraintes objectives
-
a) Une « charge mentale »
parfois excessive, cause de stress
-
b) Des contraintes physiques qui évoluent
plutôt qu'elles ne s'amoindrissent
-
c) L'acclimatation souvent peu concertée
des nouvelles formes d'organisation
-
d) Une gestion managériale des nouvelles
contraintes parfois peu prévenante
-
e) L'impasse d'un certain « autisme
managérial » en cas de recherche exagérée de
rentabilité
-
a) Une « charge mentale »
parfois excessive, cause de stress
-
2. Une vulnérabilité sensiblement
accrue
-
a) La fin des carrières prévisibles,
sans contreparties en termes d'employabilité
-
b) La hantise du chômage dans un
marché du travail dual, où les mobilités sont
essentiellement subies
-
c) Une plus forte adhésion aux tâches
exigeant un management attentif
-
d) Une « atomisation » du
personnel fragilisante
-
(1) Un délitement des collectifs de travail
objectivement préjudiciable
-
(2) Des situations de « souffrance au
travail » plus vivement ressenties
-
e) Une prévention et une sanction encore
insuffisantes des risques psychosociaux encourus dans l'entreprise
-
(1) Un droit émergent
-
(2) Des institutions efficacement
mobilisées ?
-
a) La fin des carrières prévisibles,
sans contreparties en termes d'employabilité
-
1. Une qualité du travail compromise par
l'accumulation de contraintes objectives
-
B. UNE PRODUCTIVITÉ EN DEÇÀ
DES ATTENTES
-
C. UN DIAGNOSTIC À
DIFFÉRENCIER
-
1. Selon le type d'organisation ? Une
explication en partie tautologique
-
2. Selon le secteur ? Une incidence moindre
qu'attendu
-
3. Selon l'appartenance
socio-professionnelle ? Un déséquilibre d'ampleur
comparable
-
4. Le noyau de l'entreprise préservé
moyennant une entropie croissante à la périphérie
-
5. Des conditions de travail sensibles à la
taille des établissements
-
1. Selon le type d'organisation ? Une
explication en partie tautologique
-
A. UNE PRÉCARISATION DIFFUSE DANS LE CADRE
D'UN ÉQUILIBRE AUTONOMIE/SÉCURITÉ
DÉGRADÉ
-
I. MANAGEMENT, ORGANISATION ET RYTHME DU TRAVAIL
ORIENTÉS PAR L'EXIGENCE D'UNE RENTABILITÉ ACCRUE
-
CHAPITRE III - LA GOUVERNANCE : UN
DÉSÉQUILIBRE DES POUVOIRS
-
I. L'ENTREPRISE ET SES PARTIES PRENANTES :
VARIATIONS THÉORIQUES ET HISTORIQUES
-
II. LA PLACE DES SALARIÉS DANS
L'ENTREPRISE : UNE REPRÉSENTATION COLLECTIVE N'ASSURANT QU'UNE
PARTICIPATION RÉSIDUELLE À LA GESTION
-
III. LES SALARIÉS, OUBLIÉS DE LA
GOUVERNANCE AU NOM DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
-
I. L'ENTREPRISE ET SES PARTIES PRENANTES :
VARIATIONS THÉORIQUES ET HISTORIQUES
-
CHAPITRE IV - UN SYSTÈME DE DROIT SOCIAL
DU TRAVAIL DANS UNE TRANSITION INACHEVÉE
-
I. HISTORIQUE - LES NORMES DU DROIT SOCIAL DU
TRAVAIL, UNE STRUCTURATION PAR LE MIEUX-DISANT SOCIAL...
-
A. LA CONSÉCRATION D'UNE APPROCHE
POSITIVISTE DU DROIT
-
B. UN ÉDIFICE STRATIFIÉ
-
C. DES PRINCIPES QUI S'APPLIQUENT AU PACTE SOCIAL
MAIS DANS UNE PERSPECTIVE DE MIEUX-DISANT SOCIAL
-
A. LA CONSÉCRATION D'UNE APPROCHE
POSITIVISTE DU DROIT
-
II. ... MAIS, UN ORDONNANCEMENT QUI S'EST
TROUVÉ REMIS EN CAUSE
-
A. DES CHANGEMENTS DONT TÉMOIGNE
L'ÉVOLUTION RÉCENTE DU PAYSAGE CONVENTIONNEL
FRANÇAIS
-
B. L'IMPORTANCE GRANDISSANTE DONNÉE AU
DROIT CONVENTIONNEL ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE
-
1. Une volonté d'implication croissante,
voulue par le législateur, des partenaires sociaux dans
l'élaboration du droit du travail
-
2. Une facilitation des possibilités de
déroger à la hiérarchie des normes au profit, notamment,
des entreprises
-
3. Un ensemble de normes désormais moins
hiérarchisées et davantage articulées
-
1. Une volonté d'implication croissante,
voulue par le législateur, des partenaires sociaux dans
l'élaboration du droit du travail
-
C. LA DIVERSIFICATION PEU CONTRÔLÉE
DES SOURCES DE PRODUCTION DE RÈGLES JURIDIQUES : L'EXEMPLE DE LA
« SOFT LAW »
-
A. DES CHANGEMENTS DONT TÉMOIGNE
L'ÉVOLUTION RÉCENTE DU PAYSAGE CONVENTIONNEL
FRANÇAIS
-
I. HISTORIQUE - LES NORMES DU DROIT SOCIAL DU
TRAVAIL, UNE STRUCTURATION PAR LE MIEUX-DISANT SOCIAL...
-
DEUXIÈME PARTIE : LE SCÉNARIO
DU PIRE
-
I. LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR
AJOUTÉE À UN POINT HISTORIQUEMENT BAS
-
A. UNE FORTE BAISSE DE LA PART DES SALAIRES DANS
LA VALEUR AJOUTÉE
-
B. QUELQUES FAITS STYLISÉS
COMPLÉMENTAIRES
-
C. LA RÉPARTITION DE LA VALEUR
AJOUTÉE AU CONFLUENT D'INFLUENCES DIVERSES QUI, À L'AVENIR,
RISQUENT DE PROLONGER LA BAISSE DE LA PART SALARIALE DANS LA VALEUR
AJOUTÉE
-
D. LES PERSPECTIVES D'UN VIEILLISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
-
A. UNE FORTE BAISSE DE LA PART DES SALAIRES DANS
LA VALEUR AJOUTÉE
-
II. LA RÉPARTITION DE LA VALEUR
AJOUTÉE TOUJOURS PLUS UN OBSTACLE À LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ?
-
A. MICROÉCONOMIE ET MACROÉCONOMIE,
DEUX APPROCHES THÉORIQUES DIFFÉRENTES POUR UNE MÊME
CONCLUSION : LE PROFIT OPTIMUM N'EST LE PROFIT MAXIMUM QUE SOUS CERTAINES
CONDITIONS
-
B. ACTUALITÉ ET PROSPECTIVE : QUELS
PEUVENT ÊTRE AUJOURD'HUI LES PROLONGEMENTS PRATIQUES DE CE CONSENSUS DANS
UNE ÈRE DE GLOBALISATION ?
-
C. DANS LES FAITS, LA RESTAURATION DU TAUX DE
MARGE DES ENTREPRISES NE S'EST PAS ACCOMPAGNÉE D'UNE RELANCE DE
L'INVESTISSEMENT
-
A. MICROÉCONOMIE ET MACROÉCONOMIE,
DEUX APPROCHES THÉORIQUES DIFFÉRENTES POUR UNE MÊME
CONCLUSION : LE PROFIT OPTIMUM N'EST LE PROFIT MAXIMUM QUE SOUS CERTAINES
CONDITIONS
-
III. LES REVENUS DU CAPITAL, DES
INÉGALITÉS QUI FONT BOULE DE NEIGE : VERS UNE
SOCIÉTÉ ÉCLATÉE ?
-
I. LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR
AJOUTÉE À UN POINT HISTORIQUEMENT BAS
-
CHAPITRE II : UN MANAGEMENT DE MOINS EN
MOINS RESPECTUEUX DU TRAVAIL
-
CHAPITRE III : DES ENTREPRISES MAL
GOUVERNÉES DANS UN MONDE INGOUVERNABLE ?
-
CHAPITRE IV : UN DROIT DE TRAVAIL EN VOIE
D'EFFRITEMENT
-
TROISIÈME PARTIE : QUELS FACTEURS
D'ÉMANCIPATION ?
-
I. UN IMPÉRATIF DE LUCIDITÉ
-
II. RESTAURER UN ESPACE DE PILOTAGE DU
SYSTÈME ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
-
III. LE PARTAGE GLOBAL DE LA VALEUR
AJOUTÉE, UNE GRANDE DIVERSITÉ DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DONT
L'ACTION PUBLIQUE DOIT TENIR COMPTE
-
IV. RENFORCER LE RÔLE DES MÉCANISMES
DE REDISTRIBUTION : UN INSTRUMENT IMPOSSIBLE DANS UN CONTEXTE DE
CONCURRENCE FISCALE EN EUROPE ?
-
V. ADAPTER LE RÉGIME DU SMIC ?
-
A. LE SMIC, UN FACTEUR DE RIGIDITÉ POUR
L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ?
-
1. Le SMIC limiterait le volume des emplois et
contribuerait au chômage notamment à celui des
non-qualifiés
-
2. L'assouplissement du SMIC permettrait en outre
de retrouver un système plus harmonieux des salaires
-
3. Dans ces conditions une réforme du SMIC
peut apparaître équitable d'autant que le SMIC est aujourd'hui
« subventionné »
-
1. Le SMIC limiterait le volume des emplois et
contribuerait au chômage notamment à celui des
non-qualifiés
-
B. DES ARGUMENTS À CONSIDÉRER
SOIGNEUSEMENT MAIS DONT L'ISSUE NE PARAÎT PAS DEVOIR ÊTRE UNE
RÉFORME RADICALE DU SMIC
-
A. LE SMIC, UN FACTEUR DE RIGIDITÉ POUR
L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ?
-
I. UN IMPÉRATIF DE LUCIDITÉ
-
CHAPITRE II : TROUVER UN NOUVEL
ÉQUILIBRE ENTRE AUTONOMIE ET SÉCURITÉ POUR LES
SALARIÉS
-
I. UNE INFLEXION SOCIALE DU MANAGEMENT ET DE
L'ORGANISATION DU TRAVAIL ?
-
II. UN OBJECTIF D'EMPLOYABILITÉ
RÉELLEMENT POURSUIVI ?
-
A. LE CONSTAT PRÉALABLE D'UNE FORMATION
CONTINUE N'OPTIMISANT PAS L'EMPLOYABILITÉ DES FRANÇAIS
-
B. UNE
« FLEXISÉCURITÉ » PERMETTANT UNE
SOCIALISATION EFFICACE DES RISQUES PROFESSIONNELS ?
-
C. DES ENTREPRISES ENGAGEANT UNE GESTION DES
COMPÉTENCES RESPONSABLE ?
-
A. LE CONSTAT PRÉALABLE D'UNE FORMATION
CONTINUE N'OPTIMISANT PAS L'EMPLOYABILITÉ DES FRANÇAIS
-
I. UNE INFLEXION SOCIALE DU MANAGEMENT ET DE
L'ORGANISATION DU TRAVAIL ?
-
CHAPITRE III : RÉÉQUILIBRER LE
GOUVERNEMENT DES ENTREPRISES
-
CHAPITRE IV : RETOUR VERS UN DROIT SOCIAL
MAÎTRISÉ
-
I. LES PRÉALABLES À UNE MEILLEURE
LÉGISLATION
-
II. QUELLES PRIORITÉS ?
-
III. DES CONDITIONS HÉROÏQUES
-
I. LES PRÉALABLES À UNE MEILLEURE
LÉGISLATION
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
ANNEXES
N° 227
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2011 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation sénatoriale à la prospective (1) sur la prospective du pacte social dans l' entreprise ,
Par M. Joël BOURDIN et Mme Patricia SCHILLINGER,
Sénateurs.
|
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; MM. Bernard Angels, Yvon Collin, Mme Évelyne Didier, MM. Joseph Kergueris, Jean-François Le Grand, Gérard Miquel, vice - présidents ; M. Philippe Darniche, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Fabienne Keller, M. Daniel Raoul, Mme Patricia Schillinger, M. Jean-Pierre Sueur, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Pierre André, Denis Badré, Gérard Bailly, Mmes Nicole Bonnefoy, Bernadette Bourzai, MM. Jean-Pierre Caffet, Gérard César, Alain Chatillon, Jean-Pierre Chevènement, Marc Daunis, Daniel Dubois, Jean-Luc Fichet, Mmes Marie-Thérèse Hermange, Élisabeth Lamure, MM. Jean-Pierre Leleux, Philippe Leroy, Jean-Jacques Lozach, Michel Magras, Jean-François Mayet, Philippe Paul, Mme Odette Terrade, M. André Villiers . |
SYNTHÈSE GÉNÉRALE DU RAPPORT
|
A la demande de M. Gérard Larcher, président du Sénat, la délégation sénatoriale à la prospective s'est penchée sur l'avenir du pacte social dans l'entreprise. M. Joël Bourdin (UMP, Eure) et Mme Patricia Schillinger (Soc, Haut-Rhin) , respectivement président et membre de la délégation, présentent ici les conclusions de leur rapport. |
Sans une amélioration significative du pacte social dans l'entreprise, dans le sens d'une meilleure reconnaissance des salariés et d'une revalorisation du travail, l'économie et la société pourraient s'exposer à de sérieux revers.
I. LE DIAGNOSTIC : MALAISE DANS L'ENTREPRISE
Ces trente dernières années, dans un contexte de concurrence et de mobilité des capitaux croissantes, une recherche de productivité de plus en plus orientée vers le court terme a progressivement modifié toutes les facettes du pacte social dans l'entreprise. Avec des nuances selon la configuration productive et la situation, dominante ou non, de l'entreprise dans la chaîne de production, on observe :
- des gains ralentis et des inégalités salariales croissantes, mais des revenus du capital en forte augmentation ; le ralentissement des gains de productivité est en cause mais également la répartition des richesses ;
le constat d'une stabilité du partage de la valeur ajoutée et, partant, d'une répartition équilibrée des revenus devrait être nuancé ; le débat ouvert par le Président de la République sur le partage de la valeur ajoutée doit se poursuivre ;
- de fortes tensions sur les conditions de travail, traduction de l'affaiblissement d'un modèle fordiste basé sur la carrière et la sécurité de l'emploi de salariés soumis à un fort contrôle hiérarchique ; à ce stade, ni les progrès de l' « employabilité » désormais visée par les politiques publiques, ni l'autonomie promue par un discours managérial souvent illusoire, ne débouchent sur un équilibre satisfaisant du point de vue des salariés ;
- des relations sociales dégradées et une gouvernance déséquilibrée, avec une translation du pouvoir vers des investisseurs financiers au sein d'entreprises plus grandes qu'il y a trente ans, mais composées d'établissements plus petits où les salariés sont éloignés des lieux de décision ; la capacité de négociation de salariés « oubliés » de la gouvernance au nom de l'efficacité économique, est en outre obérée par un taux de syndicalisation passé de 30 % à environ 8 % des salariés depuis l'après-guerre ;
- un ordre juridique du travail dans une transition inachevée : le droit social du travail porte la marque de l'affirmation de l'objectif de maximisation de la productivité mais aussi des difficultés rencontrées dans la transition d'un modèle à l'autre et dans la prise en compte de la dimension internationale de problèmes sociaux du travail.
II. LE SCÉNARIO DE L'INACTION : LA PROBABILITÉ DU PIRE
Pour les prochaines décennies, la poursuite des tendances lourdes conduirait à une impasse dangereuse :
• Les conflits de répartition
continueraient à se résoudre au détriment des
rémunérations salariales
. Le travail
« paierait » d'autant moins que le vieillissement
démographique s'accompagnerait d'un prélèvement accru sur
les salaires. Les différents déterminants de la
répartition de la valeur ajoutée (niveau du chômage,
diversification des opportunités d'investissement du capital,
financiarisation de l'économie, mondialisation du marché du
travail, désinflation compétitive au coeur de l'Europe,
nécessités du désendettement, etc.) pèseraient sur
les salaires, les propriétaires du capital défendant plus
efficacement leur part d'un revenu national qui augmenterait de plus en plus
lentement. L'épargne pèserait sur la demande sans s'investir dans
des projets productifs.
La croissance potentielle baisserait, notamment sous l'effet du choc démographique. L'épargne de précaution pèserait sur la consommation sans s'investir pour autant sur le territoire économique national faute de perspectives de croissance. Elle serait allouée à des placements patrimoniaux, d'où la multiplication de bulles d'actifs, ou aux pays émergents à forte croissance.
Les besoins sociaux résultant du vieillissement démographique et des effets des restructurations économiques augmenteraient dans des proportions telles que les faibles marges de manoeuvre des budgets nationaux y seraient consacrées. L'Etat n'investirait plus et les effets attendus des biens publics (éducation, environnement, innovation...) sur la croissance ne seraient pas au rendez-vous ce qui accentuerait les contraintes pesant sur le pacte social dans l'entreprise.
• Il n'y aurait pas d'autre choix que de
flexibiliser davantage salaires et emplois et
le management
exercerait des tensions renforcées sur le travail
. Les
entreprises se rabattraient sur le levier de l'organisation du travail pour
soutenir tant bien que mal une productivité
« plombée » par un déficit cumulé
d'innovation. Avec un niveau de qualification stagnant et un dialogue social
toujours médiocre, les organisations « à flux
tendus » s'approfondiraient ainsi que la segmentation du
marché du travail avec un recours accru à des contrats courts
pouvant aller jusqu'à la disparition du contrat de travail dans la
mouvance de l'idée que chacun doit devenir un « entrepreneur
de lui-même ».
Le reflux attendu du chômage se heurterait au socle structurel d'une population restée trop longtemps éloignée de l'emploi et de la formation. Cela fragiliserait le régime d'assurance chômage confronté à la contrainte globale du désendettement public. La rigueur compromettrait aussi l'acclimatation de toute politique visant à améliorer vraiment l'employabilité, onéreuse en termes de formation et de logement.
Finalement, avec les contraintes multipliées d'organisations toujours plus finement calibrées en effectifs, les salariés endureraient une dégradation radicale du compromis sécurité/autonomie entraînant une prolifération de troubles psychosociaux, une désincitation au travail, un recours accru au travail clandestin et l'amplification d'une émigration économique.
• Dans ce cadre, le scénario tendanciel
verrait s'accroître le questionnement sur la légitimité
d'une
gouvernance dans l'entreprise qui apparaîtrait de plus en
plus comme l'expression d'un rapport de forces susceptible de nuire à
terme aux objectifs de productivité et de compétitivité
de l'entreprise et de l'économie nationale.
Le transfert de pouvoir à l'investisseur financier « dilué » se poursuivrait dans le cadre d'une mondialisation non coopérative secouée par des crises ponctuelles. La distance physique aux lieux de décisions et la poursuite d'objectifs principalement financiers mineraient le pacte social. Le dialogue social national demeurerait bipolaire et se révèlerait de plus en plus inadapté à la résolution de problèmes de dimension mondiale. Le gouvernement des entreprises ne trouverait plus de contrepoids que dans une opinion publique influençable et, peut-être, versatile.
• Enfin,
l'effritement du droit social
du travail s'amplifierait
. La dérégulation
refléterait les politiques d'Etats témoignant de
stratégies individuelles de « cavalier seul », le
moins-disant social devenant le point de référence d'un droit
international du travail qui peinerait à émerger. Les nouvelles
normativités, à commencer par la « soft
law », se développeraient de façon anarchique, sans
nulle certification et ne seraient l'expression que d'un marketing
généralisé dont les grandes lignes seraient
décidées, à leur profit, par les grandes entreprises
monopolistiques.
III. LES FACTEURS D'ÉMANCIPATION PAR RAPPORT AU SCÉNARIO DU PIRE
Le rapport s'est attaché à identifier les marges d'émancipation par rapport au scénario quasi-tendanciel, qui est le scénario du pire. Une revalorisation du travail - pécuniaire, qualitative, normative et symbolique - dans le pacte social passe par la réinscription des stratégies d'entreprises dans le temps long, ainsi qu'une évaluation multicritères de leurs performances qui ne se décrète pas aisément.
Dans un contexte où les Etats sont de moins en moins capables de piloter la sphère économique et sociale, les marges sont étroites et la reconquête d'un espace de liberté suppose de prendre acte de ce que le bon niveau d'action ne peut plus être réduit au niveau national . Les obstacles majeurs à surmonter sont celui des excès de concurrence entre espaces économiques, le court-termisme d'un capital mis à même de se réallouer à tout moment ainsi que de faibles perspectives de croissance attribuables à des politiques économiques non coordonnées . Un nouvel équilibre macroéconomique conciliant incitations au travail, dynamisme de la demande et renforcement de la qualité de l'offre s'impose.
Symétriquement la complexification des structures et l'accélération des changements requièrent des méthodes d'action plus décentralisées , passant par le recours à une information mieux partagée et à des instruments de négociation adaptées.
• Tout en respectant les mécanismes de
marché dans toute la mesure où ils sont compatibles avec une
amélioration de la croissance potentielle
, l'Etat s'attacherait
à conduire toutes les politiques nécessaires à la
production des biens publics
- improduits par le
marché - nécessaires à l'optimisation de la
croissance potentielle. Des politiques macroéconomiques et structurelles
orientées vers la croissance s'imposeraient. L'objectif de
promouvoir un modèle de travail digne et
rémunérateur
et de corriger
les
inégalités excessives dans la distribution des revenus
primaires
serait reconnu comme prioritaire.
• Les salariés recouvreraient une
véritable
autonomie
dans le travail. Une
orientation plus sociale et humaine du management et de l'organisation
du travail
tendrait à juguler une certaine forme de
mal-être au travail sur la base d'
une implication
systématique des salariés
- et non un simulacre de
consultation -
dans toute « conduite du
changement »
, de formations à la gestion insistant
sur la considération et le soutien des collaborateurs, et d'
un
intéressement du « top management » à la
« performance sociale » et non plus seulement
financière
.
Cette dernière démarche serait favorisée par une responsabilisation financière ou fiscale des entreprises pour leurs externalités sociales négatives , notamment en termes de chômage ou de maladie. Un procédé de labellisation pourrait informer les clients de la conformité des conditions de production à certains standards sociaux, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Les consommateurs pourraient mieux pondérer le rapport qualité-prix des biens et services par la réputation sociale y compris locale des entreprises.
La sécurisation des salariés constituerait l'autre volet d'une restauration de la qualité de l'emploi et du travail : les salariés seraient placés en situation d' assumer financièrement et professionnellement les mobilités requises dans une économie ouverte, adaptable et compétitive.
A côté de l'assurance chômage et d'un accès au logement facilité, l' employabilité des personnes deviendrait l'axe majeur d'une « flexisécurité » de pointe, d'ores et déjà qualifiée, au Danemark, de « mobication », soit un condensé de mobilité et d'éducation. Dans ce cadre, les pouvoirs publics parviendraient -non sans mal- à rendre « pilotable » le système de formation français. En synergie, les entreprises seraient conduites à une gestion plus responsable des emplois et des formations de leurs salariés en pratiquant une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
• S'agissant du gouvernement des
entreprises
et du dialogue social, un premier type d'inflexion
pourrait être recherché dans la poursuite de la
consolidation du rôle des partenaires sociaux
impulsée par la loi du 20 août 2008,
via
une réforme favorisant leur financement ou l'apparition
d'un syndicalisme de services plus proche des préoccupations
concrètes des salariés, sans omettre la question du dialogue
social dans les petites et moyennes entreprises ni celle de la
représentativité des organismes patronaux.
Par ailleurs, une gouvernance plus partenariale s'instaurerait. Elle comprendrait une réflexion sur la codétermination, et une protection renforcée de l'actionnariat de long terme. Des modes alternatifs de gouvernance s'inspirant de ceux des entreprises familiales ou coopératives redeviendraient attractifs, la question se posant toutefois de leur compatibilité avec les exigences de la compétition économique.
La codétermination , appliquée en Allemagne dans les entreprises de plus de 500 salariés, est fragile dans la mesure où elle doit être mise en oeuvre sans nuire à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité du territoire. Une telle participation pourrait néanmoins avoir un intérêt pour faire émerger un consensus qui ne sera de toute façon possible que si le contexte du dialogue social est par ailleurs apaisé. A noter que le succès de cette idée repose, là aussi, sur une modification du mode d'évaluation de la performance des entreprises.
•
En cohérence,
le droit social du travail
se dirigerait vers une
architecture rénovée
où, sans vouloir
définir à lui seul l'intérêt général,
l'Etat ne renoncerait pas à intervenir. La négociation sociale se
développerait de façon plus équilibrée à la
faveur d'un respect généralisé du dialogue social mais
aussi d'un renforcement des légitimités syndicales, notamment par
la mise à niveau de l'expertise, tandis qu'émergeraient les
conditions d'édiction de normes internationales disciplinant le
« dumping social ». Par ailleurs, les nouvelles
normativités sociales feraient l'objet de certification et le
« consumérisme social » gagnerait en
maturité.
INTRODUCTION - PRODUCTIVITÉ : NOUVELLES APPROCHES, NOUVELLES TENSIONS
Après les « Trente glorieuses », à partir des années 70, le système économique s'est décloisonné et a été dérégulé.
De nouveaux acteurs ont émergé dans un contexte d'intégration dans une économie-monde où, malgré de persistantes singularités (dans le niveau et le rythme de développement notamment), les convergences s'imposent de plus en plus au prix d'un constant processus de restructurations qui touche le travail et les salariés.
Les vecteurs de ce processus d'intégration sont multiples, mais la mobilité du capital en représente l'un des plus puissants, en dépit des risques qui subsistent, notamment sur le front des monnaies.
Plus globalement, l'expansion de la sphère financière dans les économies contemporaines représente une tendance forte qui fait accéder cette sphère au rang des « structures » autonomes, ce qui est, au moins partiellement, contradictoire avec sa fonction traditionnelle plus limitée de contribution au financement de l'activité économique.
En bref, le système économique est de plus en plus englobant et l'influence du facteur rare, le capital, s'y est renforcée, notamment grâce à sa mobilité qui permet d'élargir les choix d'allocation de l'épargne .
La globalisation n'est pas un phénomène seulement géographique. Elle est, sans doute beaucoup plus fondamentalement, la réduction de la quasi-totalité des acteurs économiques au rôle « d'agents » d'un mécanisme économique qui ne trouve plus guère d'instances le surplombant. C'est en ce sens qu'elle engendre une crise de l'Etat et, plus largement, de toutes les supervisions et de toutes les régulations.
La question se pose de savoir si le système économique mondialisé peut se passer de tels acteurs alors même que les tensions exercées par la combinaison des dynamiques économiques et des intérêts financiers se renforcent.
Il n'est pas contestable que les crises économiques et financières se sont multipliées à partir des années 90 et leur cadence s'est accélérée autant que leur ampleur s'est élargie.
C'est, dans ces conditions, à bon droit que la capacité de prévenir les crises peut être mise en doute. Jusqu'à présent, y compris dans l'actuelle crise globale, la plus aiguë de toutes, la capacité de réparation a subsisté. Mais les réparations entreprises paraissent de moins en moins complètes - laissant derrière elles des coûts peu réversibles - et de plus en plus coûteuses.
Au demeurant, après le rôle d'assureur en dernier ressort joué par les Etats au cours des derniers événements, au prix d'une dégradation sans précédent de leurs finances publiques qui demandera des années d'ajustement, il faut s'interroger sur leur capacité à renouveler, du moins à moyen terme, une expérience si déstabilisante mais aussi sur la permanence du rôle émollient assigné à eux dans les économies où l'endettement privé n'a pas assuré le bouclage économique 1 ( * ) .
Les excès de la dette sont probablement derrière nous pour un temps assez long. La croissance économique devrait en être affectée si rien ne change, d'autant qu'une période transitoire impose une sorte de purge et ses inévitables à-coups dans un monde où l'incoordination reste la règle.
Mais évoquer les excès de la dette ne suffit pas. Tout excès de dette correspond nécessairement à un excès d'épargne 2 ( * ) .
Cette symétrie renvoie globalement au constat des déséquilibres internationaux ou régionaux.
Sans doute, une partie de ces déséquilibres peut-elle être attribuée à des dynamiques de rattrapage économique qui concernent la sphère réelle. Que les pays émergents réclament de l'épargne pour financer leur développement n'a rien que d'ordinaire. Il serait sans doute plus satisfaisant que cette épargne vienne des pays développés ou, plus précisément, que l'épargne qui en est issue ne s'ajoute pas à une épargne domestique déjà abondante.
Il est plus désolant que des pays développés paraissent ne plus savoir à quoi peut leur servir leur développement. Les voir oublier les principes d'une répartition équitable de leurs richesses quand, pourtant, ils s'inscrivent pleinement dans une logique d'augmentation de celles-ci (comme l'accent mis sur la performance et la productivité en témoigne symboliquement) et observer à quel point ils paraissent manquer de foi dans l'avenir (comment expliquer autrement la panne d'investissement qu'ils semblent subir ?) est troublant.
La situation de l'Europe est à cet égard particulièrement inquiétante. Les « demi-succès » de la Stratégie de Lisbonne sont un symbole éloquent d'une forme de renoncement à croire en soi. En outre, l'hypothèse d'une Europe du déclin démographique qui viendrait déprimer cette confiance n'est pas la moindre des hypothèses à considérer. Elle a sa logique : la mutation d'une Europe de la croissance en une Europe de l'épargne et de la rente. Cependant, l'Europe du rattrapage économique d'après la Seconde Guerre mondiale (fut-elle vraiment autre chose ?) n'a pas les atouts d'un rentier équitable, faute d'être arrivée au stade de l'Europe du leadership. Elle ne peut garantir à chacun que son patrimoine sera suffisant pour qu'il soit un rentier heureux. En outre, ceux qui pourraient estimer pouvoir en être auraient tort d'imaginer que leurs actifs ne seront pas contestés par les populations qui les rentabilisent, c'est-à-dire par les populations du monde émergent et par ceux qui, dans les pays développés, subissent jusqu'à présent les restructurations économiques.
L'Europe de la rente, privée ou des fonds souverains, n'est pas un choix viable à long terme et, à court terme, il expose les populations de l'Europe à la frustration et à la stagnation .
Le pacte social qui se dessine dans les entreprises de France et d'Europe porte la marque de ces non-choix.
La globalisation, dans toutes ses dimensions, semble le modeler de plus en plus. Or, les évolutions du pacte social qui se joue dans les entreprises paraissent ne pas tenir leurs promesses :
- le management par la performance ne s'accompagne pas d'une accélération de la productivité ;
- la restauration des profits (voire l'accroissement de leur part dans les richesses produites) ne « dynamise » pas l'investissement productif ;
- l'autonomie accordée aux salariés semble se traduire par une soumission toujours plus forte aux contraintes des flux tendus et ne pas aboutir à une participation accrue, d'ailleurs inégalement souhaitée, aux instances de gouvernement des entreprises ;
- l'adaptation du droit paraît rimer moins avec un renforcement de son efficacité qu'à un effacement de son rôle protecteur déjà mis à mal par l'extension de zones de non- (ou de peu de) droit ;
- le surgissement d'un droit de la globalisation et de la financiarisation peine à advenir...
Dans ces conditions, alors qu'il est de plus en plus dessiné pour satisfaire les exigences d'un modèle économique en crise, le pacte social dans l'entreprise se retrouve lui-même en crise et se fait vecteur de cette crise.
Ainsi, rouage d'une mécanique très englobante, le pacte social dans l'entreprise ne trouve pas plus que d'autres de ces rouages (plutôt moins d'ailleurs si l'on songe à l'importance relative des efforts entrepris pour refonder la « finance » comparativement à l'absence de l'ordre du jour des questions relatives à l'équilibre des relations sociales et économiques dans l'entreprise) d'autorité surplombante, apte à le gouverner.
Il est urgent de renverser ces logiques et de réaffirmer qu'un pacte social du travail - source de toute richesse - fondé sur une plus grande reconnaissance de sa valeur est non seulement conciliable avec l'objectif d'améliorer les performances économiques mais encore une condition essentielle du succès de cette entreprise.
PREMIÈRE PARTIE : MALAISE DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE I - DES GAINS SALARIAUX RALENTIS ET DES
INÉGALITÉS SALARIALES QUI S'AMPLIFIENT
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Le pouvoir d'achat des salaires individuels augmente de moins en moins. Il n'avait fallu qu'une quinzaine d'années entre 1959 et 1974 pour doubler le pouvoir d'achat du salaire par tête. Trente ans plus tard, celui-ci n'a gagné qu'environ 50 % tandis que le salaire net par tête n'a que très faiblement progressé en monnaie constante. Son niveau en 2007 ne représente que 1,2 fois celui de 1983. En outre, les trajectoires salariales se sont diversifiées ce qui a accru les inégalités de salaires. L'individualisation croissante des rémunérations (notamment via l'intéressement et la participation) a joué mais les composantes décisives de ces inégalités ont été le développement des emplois atypiques et la persistance du chômage ainsi que l'effet des restructurations du tissu d'entreprises et l'envolée des plus hautes rémunérations salariales. Il existe un consensus pour lier la faiblesse de la progression des salaires avec le ralentissement des gains de productivité. La productivité n'augmente plus que très peu, notamment sous l'effet d'un ralentissement de la productivité globale des facteurs. Ce constat, insuffisant en soi, invite à approfondir les motifs du ralentissement de la productivité. En effet celui-ci représente une forme de remise en cause pour une organisation économique de plus en plus productiviste. Schématiquement, il en existe deux interprétations polaires et contradictoires. La première l'attribue aux rigidités et fait la part belle aux rigidités du pacte social et à ses effets sur la création de richesses par les entreprises. Elle débouche sur des propositions de flexibilisation, recourant à des « modèles » étrangers, où la préconisation de décentraliser le pacte social en restaurant l'entreprise comme lieu à privilégier de sa définition s'impose avec vigueur. La seconde interprétation de l'« échec productiviste » contredit tous les termes de la première, l'échec en question étant attribué à la crise du capitalisme financier, qui, pour être globale, trouve un point de fixation dans la crise de l'entreprise. Les modifications du pacte social dans l'entreprise qui ont tendu à plus de dérégulation sont marquées par un « désinvestissement » de la composante proprement entrepreneuriale (le capital humain, l'investissement, la recherche et l'innovation) de ce pacte. |
|
Tout approfondissement de ce processus ne ferait qu'aggraver la crise, notamment en découplant toujours plus, jusqu'aux points de rupture, la production de ses conditions d'expansion, c'est-à-dire en accentuant le déséquilibre entre la dynamique de l'offre et celle de la demande 3 ( * ) . Parmi les manifestations de ce découplage, il convient de faire une place particulière au partage de la valeur ajoutée. La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée est un facteur controversé de l'atonie salariale. Elle est avérée pour les années 80 mais vue comme un retour à la « normale ». Au-delà, des constats d'une stabilité de la répartition de la valeur ajoutée ont été posés mais ils peinent à convaincre, diverses interrogations, sur les concepts de richesse produite et sur les méthodes de mesure, venant conforter l'intuition que les changements de paramètres d'équilibre des relations sociales ont été propices à la rémunération du capital plus qu'à celle du travail. Quoi qu'il en soit, même dans un diagnostic de stabilité de la répartition de la valeur ajoutée, en raison de la dynamique des « très hauts salaires », la part des rémunérations du travail de la quasi-totalité des salariés a diminué. |
I. PEU DE SALAIRES, DE PLUS EN PLUS D'HÉTÉROGÉNÉITÉ SALARIALE
Le ralentissement du pouvoir d'achat des salaires - accentué au niveau du salaire net en raison de la hausse des prélèvements sociaux - est une tendance lourde de l'économie française. En outre, les gains salariaux évoluent différemment si bien que sur fond de chômage 4 ( * ) (et d'inégalités face à ce risque), les disparités salariales s'accroissent quand on les saisit avec des données concrètes.
A. LE POUVOIR D'ACHAT DES REVENUS SALARIAUX PROGRESSE PEU
Les gains de pouvoir d'achat des salaires sont faibles et ils ont considérablement ralenti.
VALEUR AJOUTÉE, PRODUCTIVITÉ APPARENTE DU
TRAVAIL ET SALAIRES PAR TÊTE
INDICES D'ÉVOLUTION EN EUROS
CONSTANTS, BASE 100 EN 1959
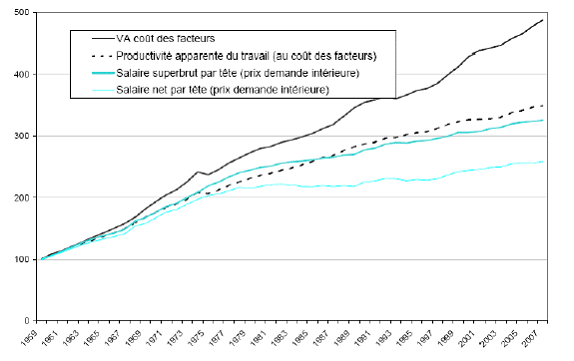
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », par M. Jean-Philippe COTIS. INSEE.
Il n'avait fallu qu'une quinzaine d'années entre 1959 et 1974 pour doubler le pouvoir d'achat du salaire superbrut par tête (salaire + toutes cotisations sociales). Trente ans plus tard, celui-ci n'a gagné qu'environ 50 % tandis que le salaire net par tête n'a que très faiblement progressé en monnaie constante. Son niveau en 2007 ne représente que 1,2 fois celui de 1983.
Sans doute, en raison de créations nettes d'emplois, la masse salariale a-t-elle un peu plus progressé. Mais, le ralentissement des rémunérations unitaires trouve son pendant dans celui du pouvoir d'achat de la masse des salaires.
MASSE SALARIALE, ET SALAIRE SUPERBRUT PAR
TÊTE
TAUX DE CROISSANCE EN EUROS CONSTANTS
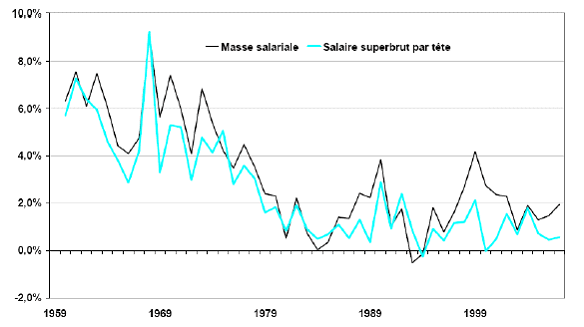
Note : au prix de la demande intérieure finale.
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », par M. Jean-Philippe COTIS. INSEE.
En tendance, salaire par tête et masse salariale évoluent généralement de façon étroitement parallèle 5 ( * ) si bien que l'impact des différentes dynamiques salariales sur l'emploi ne ressort pas avec évidence.
En particulier, l'épisode (long) de modération salariale débuté à la fin des années 70 ne s'est traduit par un enrichissement de la croissance en emplois qu'au cours des quelques phases de forte expansion de la production, à la toute fin des années 80 et au tournant des années 90.
En première analyse, les performances d'emploi de l'économie française paraissent moins directement corrélées avec la modération salariale qu'avec ses performances en termes de croissance 6 ( * ) .
De la courbe figurée dans le graphique ci-dessus, on peut également tirer l'observation que les périodes de fortes créations d'emploi sont aussi des périodes où le pouvoir d'achat du salaire par tête est plus dynamique. Toutefois, le lien entre créations d'emplois et augmentation du pouvoir d'achat n'apparaît pas entièrement déterministe. Autrement dit, les fluctuations du taux de chômage n'ont pas d'effets univoques sur les gains de pouvoir d'achat par tête ce qui suggère que le taux de chômage structurel (le taux de chômage en dessous duquel il existe des tensions inflationnistes résultant notamment des augmentations salariales) n'a pas une valeur unique. Au demeurant, on relève, empiriquement, que les rythmes d'augmentation des salaires par tête constatés depuis plus de trente ans n'ont, pris globalement, jamais provoqué de tensions inflationnistes telles que la croissance du volume de la production en paraisse devoir être plafonnée.
Même si les comparaisons internationales doivent être prises avec beaucoup de précaution (les structures économiques et les prix peuvent tant différer qu'elles n'aient qu'une signification médiocre), la France se classe plutôt mal dans le classement des salaires en Europe.
Comme le montre le tableau ci-dessous, elle est dans les derniers rangs des pays fondateurs de l'Europe.
SALAIRES ANNUELS BRUTS MOYENS
DANS QUELQUES PAYS DE
L'UNION EUROPÉENNE
|
2007 |
|
|
Allemagne |
40 200 |
|
Autriche |
37 716 |
|
Belgique |
38 659 |
|
Bulgarie |
2 626 |
|
Danemark |
53 165 |
|
Finlande |
36 114 |
|
France |
32 413 |
|
Hongrie |
8 952 |
|
Lettonie |
6 690 |
|
Luxembourg |
45 284 |
|
Portugal |
15 345 |
|
Roumanie |
4 828 |
|
Royaume-Uni |
46 051 |
|
Slovaquie |
8 400 |
|
Suède |
36 871 |
Champ : salariés à temps plein des entreprises industrielles ou de services de 10 salariés ou plus.
Source : Eurostat
B. DES TRAJECTOIRES SALARIALES DIFFÉRENCIÉES ET DES INÉGALITÉS SALARIALES QUI AUGMENTENT
L'analyse des évolutions de salaires est généralement conduite à travers des indicateurs de moyennes qui par construction agrègent des réalités distinctes. Si ceux-ci ne sont pas inutiles, ils ne disent rien sur les situations concrètes des salariés qui ressortent comme de plus en plus dispersées.
Ainsi, alors que les indicateurs sur les salariés moyens invitent à conclure à une convergence du salariat, quand on va au-delà des informations révélées par ces moyennes pour examiner les différentes situations salariales à un niveau plus fin, la période récente confirme le sentiment que le régime salarial, loin d'être homogène, est de plus en plus éclaté.
L'analyse des situations de rémunération salariale concrètes aboutit au constat d'une grande diversité des situations individuelles .
Il existe des inégalités de salaires qui, au-delà des apparences données par certains indicateurs incomplètement fidèles à la réalité, s'élargissent. En haut de l'échelle très peu de salariés perçoivent des rémunérations qui leur permettent de devenir des « super-riches » 7 ( * ) ; en bas, un salariat pauvre se constitue. Dans l'entre-deux, la dynamique salariale est perçue comme d'autant plus faible que les salariés ne considèrent pas toujours (à tort ou à raison) que la part grandissante de leurs rémunérations destinée à couvrir les dépenses sociales n'est en fait qu'une forme différée des salaires.
1. Des pratiques salariales qui s'individualisent
a) Les salaires sont peu négociés
Le nombre des entreprises où il existe une négociation collective des salaires est plutôt faible. En 2007, seules 16 % des entreprises de 10 salariés et plus ont été dans ce cas. Ce nombre est particulièrement bas dans les petites entreprises et dans certains secteurs (construction, services aux particuliers, commerce).
PROPORTION D'ENTREPRISES AYANT OUVERT DES
NÉGOCIATIONS
OU DISCUSSIONS SUR LES SALAIRES EN 2007 (EN %
D'ENTREPRISES)
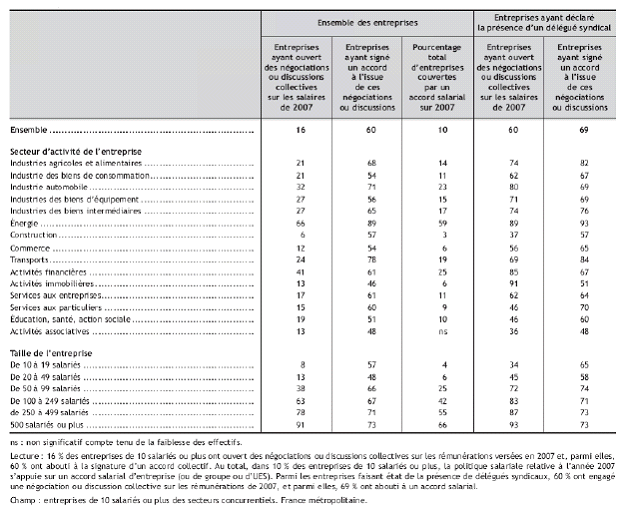
Source : enquête « Pratiques salariales ». DARES. 2007.
Il témoigne d' un écart important entre les obligations légales et les pratiques de négociation .
Légalement, toutes les entreprises disposant d'une section syndicale (et où au moins un délégué syndical a été désigné) doivent chaque année ouvrir des négociations collectives portant notamment sur les salaires. Parmi les entreprises de 10 salariés ou plus déclarant qu'un ou plusieurs délégués syndicaux étaient présents en leur sein, seules 60 % ont engagé des négociations ou discussions sur les rémunérations de 2007. Cette performance est très supérieure à celle des entreprises où il n'existe pas de délégués syndicaux mais elle témoigne d'une application moyenne de la loi.
Par ailleurs, la négociation n'aboutit pas toujours .
En 2007, le taux d'aboutissement a été de 60 % (de 69 % dans les entreprises où il y a une ou des délégations syndicales) si bien que le pourcentage d'entreprises couvertes par un accord salarial collectif d'entreprise est de 10 % du total des entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels .
Ces piètres résultats doivent être nuancés .
En premier lieu, ces entreprises couvrent 45 % des salariés du champ envisagé (6 millions de salariés au total) et même 62 % quand on envisage les entreprises où des négociations collectives ont été ouvertes.
Ainsi, près de la moitié des salariés des secteurs concurrentiels ont été concernés par des évolutions salariales négociées au plus près des unités de base de la création de valeur.
En second lieu, l'une des raisons de l'absence de négociation collective au niveau de l'entreprise est attribuée à l'existence d'autres niveaux de négociation (la branche) ou de fixation des salaires (le SMIC) 8 ( * ) .
Enfin, les pratiques salariales ne sont pas figées du fait de la seule absence de négociation collective .
Ainsi, en 2007, si seules 10 % des entreprises ont vu se conclure un accord salarial, 86 % des entreprises de 10 salariés ou plus ont accordé des augmentations de salaires , proportion qui grandit avec la taille des entreprises.
RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE TYPE
D'AUGMENTATIONS
ACCORDÉES EN 2007 (EN %
D'ENTREPRISES)
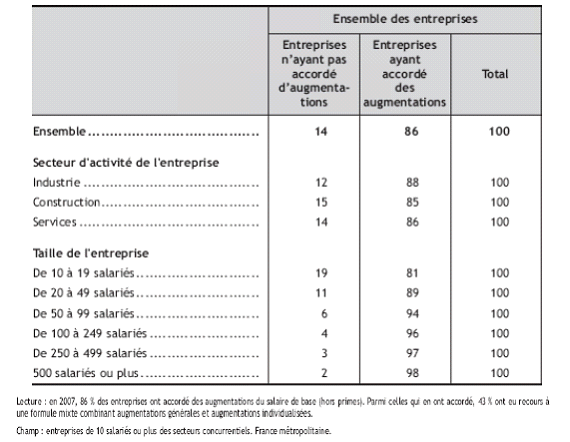
Source : enquête « Pratiques salariales ». DARES. 2007.
b) Les augmentations de salaires sont de plus en plus individualisées
La situation salariale des salariés est de plus en plus dépendante de mécanismes d'individualisation .
Les pratiques des entreprises en matière de rémunération de leurs salariés ressortent comme très diverses. Les augmentations peuvent être générales et/ou individualisées portées sur l'octroi de primes liées ou non à la performance (y compris sous forme de primes liées à l'intéressement, à la participation ou à l'épargne salariale) et autres éléments de rémunération qui complètent le salaire de base (complémentaire santé, épargne retraite, tickets restaurants...). Les entreprises utilisent de plus en plus des formes de rémunération complémentaires au salaire qui s'ajoutent à ce dernier et se substituent parfois aux augmentations du salaire de base.
RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE TYPE
D'AUGMENTATIONS
ACCORDÉES EN 2007 (EN %
D'ENTREPRISES)
|
Uniquement
|
Uniquement
|
Augmentations mixtes |
Total |
|
|
Ensemble |
37 |
20 |
43 |
100 |
|
Secteur d'activité de l'entreprise |
||||
|
Industrie |
30 |
19 |
51 |
100 |
|
Construction |
40 |
15 |
45 |
100 |
|
Services |
39 |
22 |
39 |
100 |
|
Taille de l'entreprise |
||||
|
De 10 à 19 salariés |
45 |
21 |
34 |
100 |
|
De 20 à 49 salariés |
34 |
22 |
44 |
100 |
|
De 50 à 99 salariés |
25 |
18 |
57 |
100 |
|
De 100 à 249 salariés |
20 |
16 |
64 |
100 |
|
De 250 à 499 salariés |
16 |
17 |
67 |
100 |
|
500 salariés ou plus |
9 |
14 |
77 |
100 |

Source : enquête « Pratiques salariales ». DARES. 2007.
Sans doute, faut-il observer que la plupart des entreprises cumulent augmentations générales et augmentations individuelles . Mais, les entreprises qui ne procèdent qu'à des augmentations générales sont très minoritaires (37 % pour l'ensemble) et, ce, d'autant plus qu'elles sont de grande dimension (9 % des grandes entreprises).
La règle est de plus en plus le cumul d'augmentations générales et d'augmentations individualisées . Là aussi c'est à mesure que les entreprises grandissent que cette coutume salariale se systématise.
L'analyse des critères pris en compte pour procéder à des augmentations générales des salaires confirme l'importance de l'existence de critères de fixation des salaires extérieurs à l'entreprise.
Il faut, à ce propos, distinguer selon la situation hiérarchique des salariés comme le révèlent les enquêtes, qui sont à la source 9 ( * ) de l'appréciation des pratiques salariales.
LES CRITÈRES D'AUGMENTATIONS
GÉNÉRALES DU SALAIRE DE BASE EN 2007
(EN %
D'ENTREPRISES)
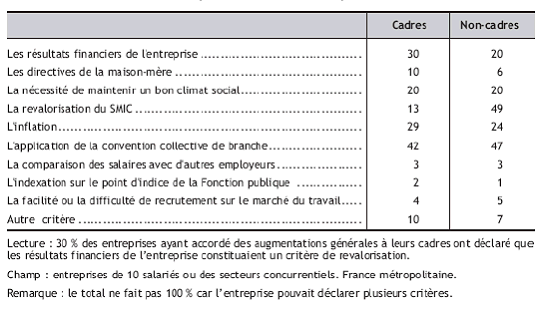
Source : enquête « Pratiques salariales ». DARES. 2007.
Pour les non-cadres , 49 % des entreprises déclarent que la revalorisation du SMIC a constitué un critère. Il n'est pas précisé si ce fut un critère impliquant un choix ou la simple application des décisions de relèvement de SMIC. On peut toutefois induire de la différence entre cadres et non cadres que le second motif est sans doute assez fort.
Par ailleurs, le rôle joué par les conventions de branche est important , que ce soit pour les cadres ou les non-cadres.
Il est plus surprenant d'observer que, sans être négligeable, la considération des résultats financiers des entreprises n'est mentionnée que par un pourcentage minoritaire d'entre elles pour expliquer les augmentations générales des salaires.
Cette réponse des entreprises pourrait être analysée comme contrastant avec l'idée assez répandue que le capitalisme financier exerce des effets déterminants sur les politiques salariales. Mais, outre que les données ici utilisées ne sont que des données d'enquête, il faut rappeler qu'elles ne couvrent que les augmentations générales de salaires, augmentations dont l'ampleur n'est pas précisée.
Or, il existe une tendance à l'individualisation des salaires et l'analyse des critères d'augmentations individuelles des salaires semble montrer que la performance est largement prise en compte à ce stade .
LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS
INDIVIDUELLES EN 2007
(EN % D'ENTREPRISES)
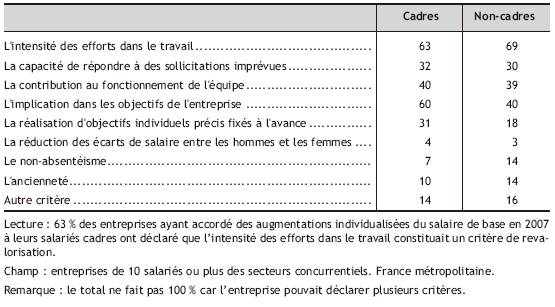
Source : enquête « Pratiques salariales ». DARES. 2007.
Ces critères confirment la place du choix de l'entreprise dans les augmentations individuelles des salaires et l'importance qu'y prennent les éléments relatifs à l'intensité des efforts et, plus généralement, à la productivité de chaque salarié . Il reste à évaluer l'affectivité de ces critères et la pertinence des évaluations dont ils procèdent.
La structure des rémunérations salariales révèle que les éléments variables du salaire représentent environ 15 % des rémunérations. Il existe ainsi une marge non négligeable de flexibilisation des salaires.
Mais, en même temps, cette décomposition de la masse salariale apparaît structurelle si bien que, d'un point de vue macroéconomique, on peut hésiter à voir dans les éléments variables une source effective de modulation.
On ne sait à quoi attribuer ce qui ressort comme une apparente rigidité. Conduit-elle à nuancer l'authenticité des revendications pour plus de flexibilité ou ces éléments de salaires doivent-ils être vus comme plus automatiques que ne l'indiquent les enquêtes ?
En tout cas, l'inertie de la structure salariale n'équivaut pas à une inertie générale des salaires non plus qu'à un défaut de variabilisation microéconomique des situations salariales.
En 2006, le salaire de base représentait 86,3 % de la masse salariale brute des entreprises du secteur marchand non agricole 10 ( * ) , le reste provenant soit des heures supplémentaires et complémentaires (1,3 %), soit des primes et compléments (12,4 %).
DÉCOMPOSITION DE LA MASSE SALARIALE
SELON
LES BRANCHES PROFESSIONNELLES REGROUPÉES EN 2006
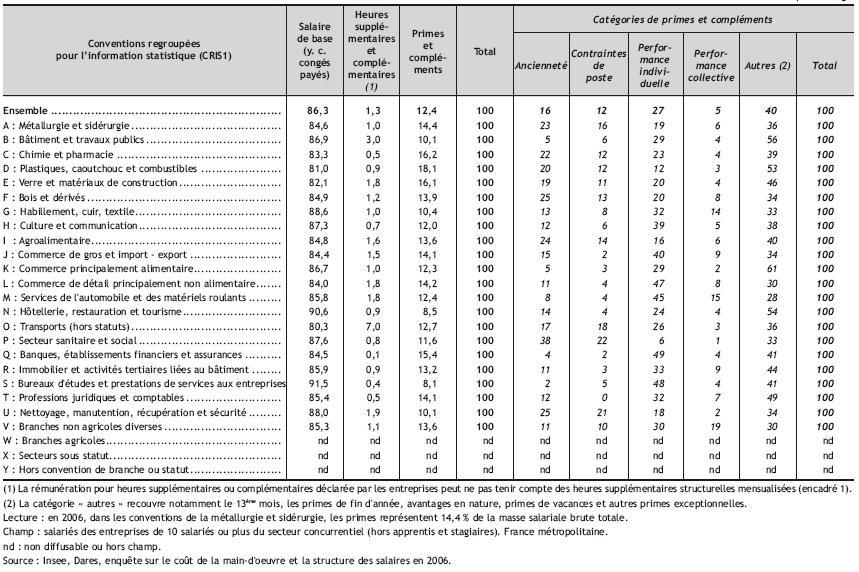
Source : INSEE, DARES, enquête sur le coût de la main-d'oeuvre et la structure des salaires en 2006.
LES GAINS BRUTS MENSUELS MOYENS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 10 SALARIÉS OU PLUS ET LEUR DÉCOMPOSITION SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 1998
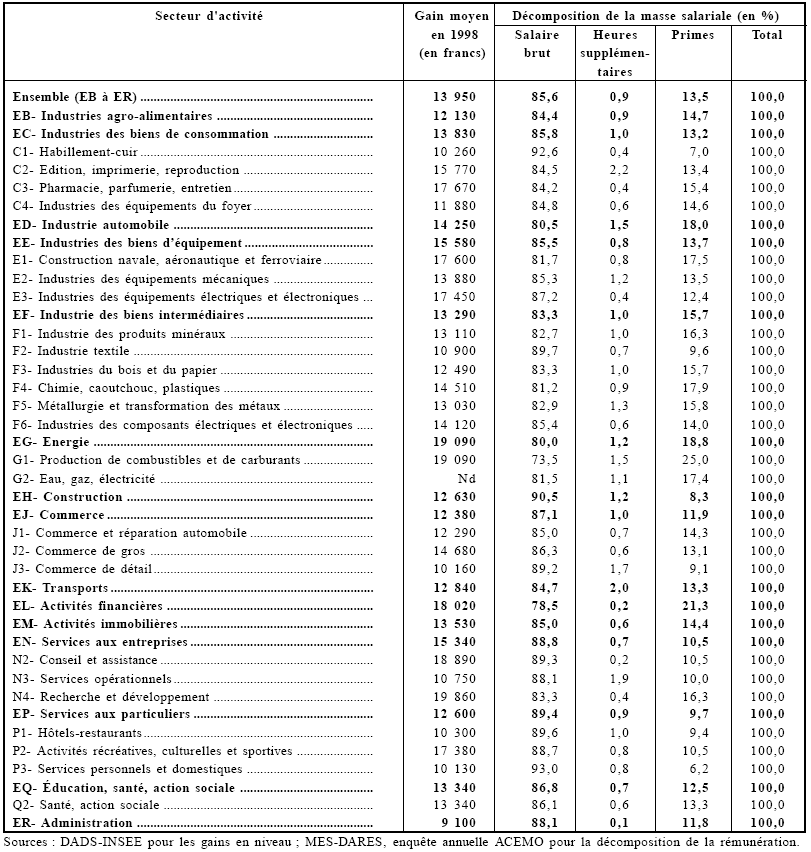
Source : Premières synthèses. Janvier 2000. N° 01.1
Par ailleurs, le poids du salaire de base est très variable selon les branches ; il en va de même pour les éléments rémunératoires variables.
Pour ce qui concerne ces derniers, le niveau des compléments liés aux heures supplémentaires ressort comme particulièrement élevé dans les Transports et le Bâtiment. Dans ces secteurs, les heures supplémentaires jouent un rôle important dans la flexibilité salariale que le cycle (et la saisonnalité) paraît imposer.
En ce qui concerne les primes et compléments , la différenciation par branche est également assez forte. Leurs poids est plus élevé dans l'industrie que dans les services, excepté dans les activités financières et immobilières. Il est sans doute également influencé par la taille des entreprises, la démographie des entreprises de chaque branche expliquant ainsi une partie de la variabilité des primes et compléments. Il est à noter que parmi ceux-ci, la situation individuelle tend à occuper une place centrale (qu'il s'agisse d'ancienneté, de performance, ou d'autres considérations personnelles englobées dans la sous-catégorie « autres »).
De l'inertie apparente de la structure des rémunérations, on ne saurait déduire que le salaire est macroéconomiquement rigide . On verra qu'au contraire les évolutions salariales ressortent comme très corrélées, quoique de façon asymétrique, avec des variables macroéconomiques lourdes, qui conditionnent de plus en plus les dynamiques des salaires.
L'inertie de la structure des rémunérations semble plutôt témoigner d'un défaut de flexibilité des salaires à la hausse qu'à la baisse, tant la modération salariale paraît marquer structurellement l'histoire récente des salaires en France.
La relative constance de la répartition entre salaires de base et primes traduirait ainsi plutôt le fait que les éléments variables de la rémunération évoluent de concert avec le salaire de base si bien qu'ils ne jouent pas réellement leur rôle d'adaptation des salaires aux cycles, en particulier dans la phase haussière de ceux-ci.
Par ailleurs, cette tendance ne paraît pas jouer de la même manière pour tous les salariés. Quelques branches, en particulier celles des services financiers, témoignent d'évolution des primes et compléments atteignant une certaine ampleur.
La répartition de ces éléments de salaires y semble très fortement individualisée ce qui s'explique sans doute par leur concentration sur certains métiers de la banque.
De façon générale, l'individualisation des salaires est de plus en plus forte dans un panorama où les données macrosociales sur les rémunérations ne la révèlent pas toujours immédiatement 11 ( * ) .
c) L'arbitrage salaires-intéressement et participation pèse sur le salariat traditionnel et crée des inégalités
Il reste également à compléter ce panorama par la prise en compte des revenus non salariaux 12 ( * ) accordés aux salariés : la participation financière dont ils bénéficient .
Les dispositifs de participation financière sont obligatoires ou facultatifs. La participation est obligatoire pour les seules entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les autres cas, les dispositifs de participation financière sont facultatifs mais ils bénéficient de dispositions incitatives, notamment du point de vue des prélèvements obligatoires.
|
PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES SALARIÉS La participation financière des salariés recouvre l'ensemble des dispositifs ci-dessous. La participation des salariés aux résultats de l'entreprise , obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés, permet de faire participer chaque salarié aux résultats de son entreprise, en redistribuant une partie des bénéfices réalisés selon des modalités prévues par accord collectif. Cependant, les sommes versées ne sont pas immédiatement disponibles : elles sont bloquées pendant 5 ans en vue de financer des investissements productifs. En contrepartie, l'entreprise et les salariés bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux. L 'intéressement des salariés à l'entreprise permet à toute entreprise qui le souhaite , dès lors qu'elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, d'instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de se constituer avec l'aide de celle-ci un portefeuille de valeurs mobilières. Le Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) , créé par la loi du 19 février 2001, permet à plusieurs entreprises, quelles qu'elles soient, de créer un dispositif d'épargne commun à l'ensemble de leurs salariés. Cela permet notamment aux petites entreprises de s'ouvrir à la participation financière , car la mise en place de ce système n'est plus faite entreprise par entreprise ; en outre, le coût pour une entreprise de mettre en place le PEI est bien inférieur au coût nécessaire à la mise en place du PEE ; Le Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) , créé par la loi du 21 août 2003, est un système d'épargne retraite en entreprise ; la sortie se fait en rente viagère et éventuellement en capital. Il bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux supplémentaires par rapport au PEE : ainsi le plafond d'abondement est doublé (4600 € par an et par salarié contre 2300 € pour le PEE). Il peut également être mis en place entre plusieurs entreprises, sur le modèle du PEI : on parlera alors de PERCO-I. Pour mémoire, le Plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), qui disparaîtra totalement en août 2006, était un plan d'épargne à long terme (10 ans au moins), avec le même plafond d'abondement que le PERCO. Ce plan existait aussi sous forme commune à plusieurs entreprises, sur le modèle du PEI. Source : Rapport annuel du Conseil supérieur de la participation pour 2004-2005 |
Les dispositifs de participation financière, qui ajoutent à la flexibilité des revenus distribués par les entreprises à leurs salariés, ont connu un essor incontestable.
Alors qu'en 1999, 63,1 % des salariés n'avaient bénéficié d'aucun des dispositifs en vigueur, cette proportion a baissé à 51,7 % en 2007 et à cette date 57 % des salariés du secteur marchand non agricole avaient un accès à un dispositif au moins 13 ( * ) .
Les sommes distribuées ont également beaucoup augmenté passant de 7 à 17,4 milliards d'euros entre ces deux années, soit une progression nettement plus rapide que celle des revenus salariaux.
Ainsi, selon les données de la DARES, alors que les sommes distribuées représentaient 4 % de la masse salariale des entreprises concernées 14 ( * ) en 1999 15 ( * ) , elles en représentaient 7,7 % en 2007.
LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION, D'INTÉRESSEMENT ET D'ÉPARGNE SALARIALE DANS LES ENTREPRISES DE 10 SALARIÉS OU PLUS, EN 2005, 2006 ET 2007
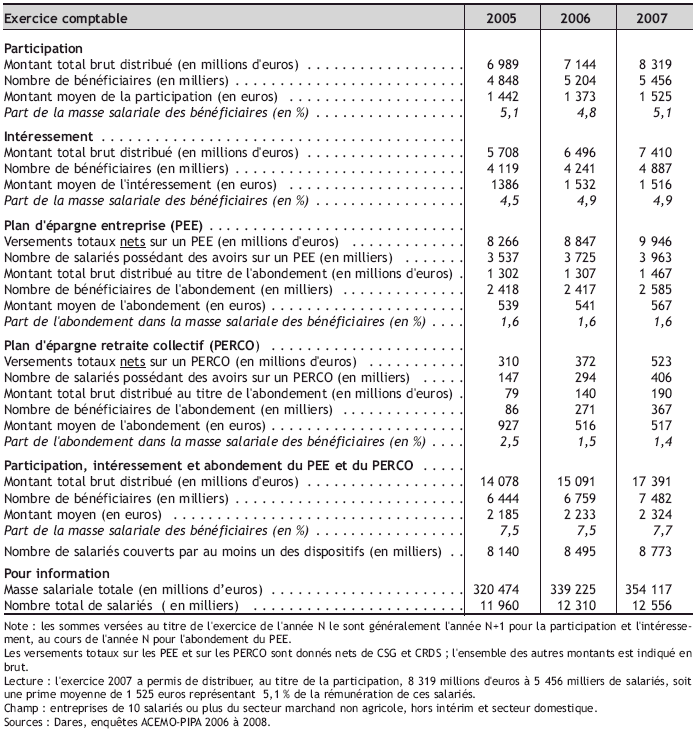
Source : Premières synthèses. Juillet 2009. N° 31.2
Malgré leur diffusion élargie, les dispositifs en question apparaissent très inégalement mobilisés.
Ils sont concentrés dans les grandes entreprises , seuls 14 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés étant couverts. De ce fait, l'accès à ces dispositifs est très variable selon les secteurs d'activité (singularisés par la démographie de leurs entreprises en fonction de leur taille).
PART DES SALARIÉS AYANT ACCÈS À UN
DISPOSITIF DE PARTICIPATION, D'INTÉRESSEMENT ET D'ÉPARGNE
SALARIALE EN 2007,
SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
(EN %)
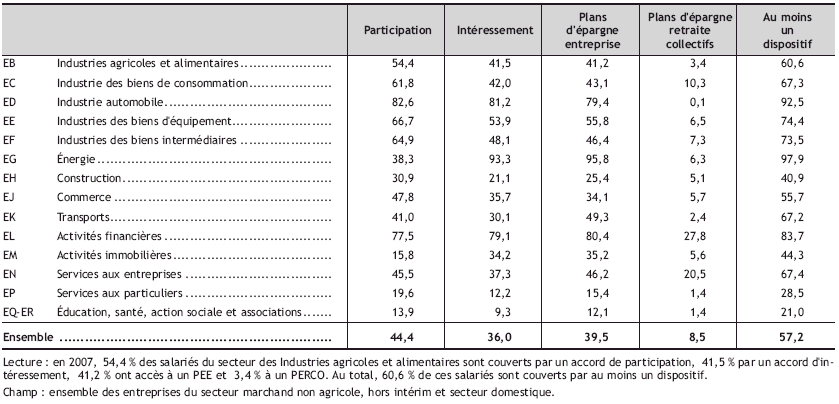
Source : Premières synthèses. Juillet 2009. N° 31.2
On observe que la hiérarchie des secteurs établie selon le critère d'accès à la participation financière recouvre à peu près celle fondée sur la part des éléments variables de rémunération.
La concentration des dispositifs de participation financière se vérifie également au regard du niveau du salaire . Ils bénéficient essentiellement aux salariés du haut de la distribution.
IMPORTANCE DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION,
D'INTÉRESSEMENT
ET D'ÉPARGNE SALARIALE EN 2007, SELON LA
TAILLE DE L'ENTREPRISE
ET LE SALAIRE ANNUEL MOYEN DANS L'ENTREPRISE
(EN %)
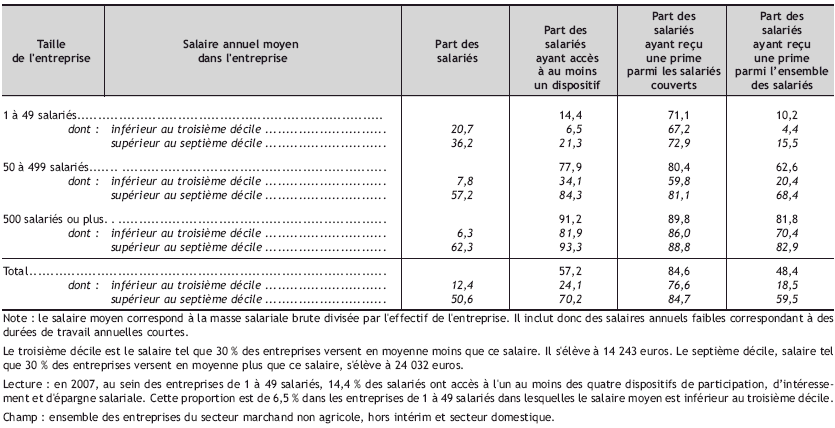
Source : Premières synthèses. Juillet 2009. N° 31.2
Qu'il s'agisse de l'accès potentiel ou du bénéfice effectif des régimes de participation, les salariés des bas déciles (de salaires) en profitent beaucoup moins que ceux du haut de l'échelle salariale.
Le régime fiscalo-social avantageux de ces dispositifs apparaît ainsi, à première vue, comme régressif (à rebours des exonérations de cotisations sociales sur les « bas salaires ») et leur caractère collectif doit être fortement nuancé.
2. Une augmentation des inégalités salariales
Conformément au sentiment général, les inégalités salariales ont augmenté au cours de la dernière décennie même si le phénomène d'accroissement des inégalités n'est pas particulièrement perceptible quand on suit la distribution des salaires nets des personnes employées à temps complet.
a) Une réalité peu apparente dans certains indicateurs
Le rapport entre le salaire moyen des 10 % les mieux payés et celui des 10 % les moins rémunérés tend même à baisser (de 4,2 en 1965 et 3,3 en 1982 à 3 en 2006). On peut toutefois noter que le fort repli intervenu entre 1965 et 1982 s'est atténué au-delà.
De même, l'avantage salarial de ceux qui sont juste autour du salaire médian par rapport aux salariés du bas de l'échelle a diminué (le rapport est passé de 2 en 1965 et 1,7 en 1982 à 1,5 en 2006).
DISTRIBUTION DU SALAIRE NET DES TEMPS COMPLETS DU
SECTEUR PRIVÉ
DE 1950 À 2006
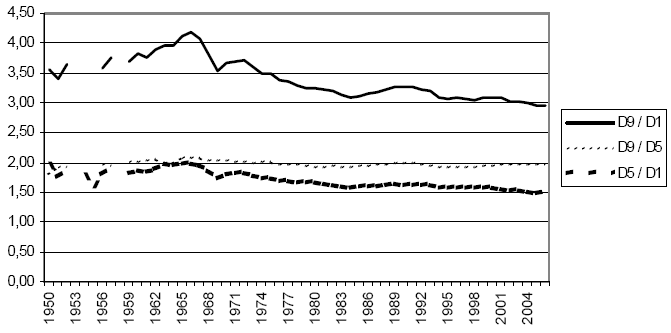
Source : INSEE
Pour la période la plus récente (1996 à 2006), si on relève un moindre aplatissement de la hiérarchie des salaires, on observe toutefois que les salaires moyens ont continué à être rattrapés par les salaires du bas de la hiérarchie (ceux des deux premiers déciles surtout) tandis que les salaires du haut de la distribution (8 ème et 9 ème déciles), bien qu'en progression plus faible que ceux des deux premiers déciles, ont été plus dynamiques que les salaires moyens .
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS DES NEUF PREMIERS DÉCILES DE SALAIRES
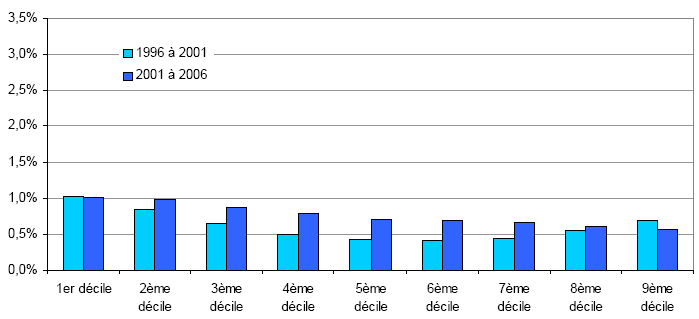
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Si on excepte le salaire moyen du premier décile qui évolue de la même manière dans le temps, on peut remarquer que lors de la première sous-période, qui a correspondu à une croissance économique générale deux fois plus forte que la seconde (+ 3 % l'an avec + 1,5 % entre 2001 et 2006), les inégalités ont moins diminué que dans la période de plus faible croissance.
Si l'idée, généralement répandue, que s'est produite une augmentation des inégalités n'est donc pas particulièrement étayée par les données relatives aux salaires des personnes employées à temps plein , une vue plus détaillée (et plus réaliste) révèle déjà à ce niveau que cette idée générale n'est pas dénuée de fondements empiriques .
b) Mais une différenciation salariale qui s'accentue
(1) En fonction de l'employeur
Tout d'abord, la position occupée dans le salariat conduit à des situations très disparates .
C'est vrai en ce qui concerne les secteurs . Par exemple, si le salaire moyen par tête est structurellement plus élevé dans les banques que dans les sociétés non financières, cet écart a augmenté sur la période récente : il était supérieur de + 35 % à celui versé par les sociétés non financières en 1995, il l'est de + 50 % en 2006.
Mais, d'autres facteurs structurels comptent, comme l' appartenance à des entreprises différentes par la taille ou la position dans la chaîne de production .
|
LES FACTEURS STRUCTURELS DE
DIFFÉRENCIATION
La part des salaires dans la valeur ajoutée diffère beaucoup en fonction de la taille des entreprises, du secteur et de la position de l'entreprise dans la chaîne de production. En ce qui concerne les secteurs , la part des salaires dans la valeur ajoutée varie dans une proportion du simple à plus du double. PART DE LA RÉMUNÉRATION DANS LA VALEUR AJOUTÉE SELON LE SECTEUR
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009. Dans l'industrie qui concentre le tiers de la masse salariale des entreprises non financières, la part des salaires atteint 62 % soit moins que la moyenne. Dans les activités de services, son poids relatif est supérieur (autour des trois-quarts de la valeur ajoutée). L'importance relative du capital dans les fonctions de production respectives des secteurs joue un rôle important dans ces différences dans la mesure où, dans l'industrie, il faut rémunérer davantage d'actifs productifs. L'importance relative de la part des salaires dans la valeur ajoutée n'implique pas pour autant que les salaires soient plus élevés dans les secteurs où cette part l'est elle-même . Cette même observation vaut aussi s'agissant des différentes catégories d'entreprises par la taille où il existe aussi une grande variabilité du « poids relatif des salaires ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DISTRIBUTION DE LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009. Dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire, les salaires pèsent 67 % de la valeur ajoutée contre 56 % dans les grandes entreprises. Mais, dans celles-ci (entreprises de plus de 5 000 salariés ou d'un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros), les salaires sont plus élevés en lien avec une productivité par tête plus forte. D'autres caractéristiques des entreprises s'accompagnent de différenciation quant au poids des salaires dans la valeur ajoutée. L'âge des entreprises entraîne une décroissance de la part salariale dans la mesure où les bénéfices n'apparaissent qu'après quelques années. De même, l'appartenance à un groupe implique, dans l'industrie, un poids des salaires réduit surtout quand l'entreprise est cotée par rapport à la situation des entreprises indépendantes (- 10 points). Mais ce constat est moins net dans les autres secteurs d'activité.
RAPPORT SALAIRE/VA : EFFETS DE L'APPARTENANCE
À UN GROUPE
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009. De même, les entreprises « têtes de groupe » ou relevant d'un groupe étranger ont une part des salaires plus élevée. La position dans la chaîne de production et la situation concurrentielle jouent également un grand rôle. En particulier, le fait d'être sous-traitant 16 ( * ) emporte une part des salaires dans la valeur ajoutée élevée. Dans ces entreprises, les salaires se montent à 75 % de la VA soit 17 points de plus que pour des entreprises identiques dans leurs autres caractéristiques 17 ( * ) . Dans ces entreprises, les marges sont comprimées de sorte que les salaires étant donnés par le jeu des équilibres sur le marché du travail, l'excédent brut d'exploitation y est plus faible.
EXPOSITION CONCURRENTIELLE ET
SOUS-TRAITANCE :
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009. Cependant, là aussi, il n'existe pas de corrélation positive entre l'importance relative de la part de la valeur ajoutée revenant aux salaires et le niveau du salaire moyen. |
Quelques constats s'imposent :
Les petites et moyennes entreprises paraissent consacrer aux salaires une part de leur valeur ajoutée nettement supérieure à ce qu'elle est dans les grandes entreprises ;
Mais, la part relativement élevée des salaires dans la valeur ajoutée n'empêche pas les PME, notamment les sous-traitantes, de connaître une situation salariale moins favorable puisque le salaire (superbrut) y est inférieur de 20 % par rapport aux entreprises comparables non sous-traitantes ;
La part relativement élevée des salaires dans la valeur ajoutée des PME pourrait s'expliquer par le fait qu'à salaires donnés, les PME dégagent moins de valeur ajoutée que les grandes entreprises, notamment parce que leur chiffre d'affaires est contraint par des pressions sur les prix qu'elles pratiquent émanant des grandes entreprises dont elles sont les sous-traitantes ;
La faiblesse relative de la part des salaires dans la valeur ajoutée des grandes entreprises ne s'accompagne pas d'une situation salariale défavorable, mais paraît résulter des caractéristiques des secteurs dans lesquels elles interviennent et d'un pouvoir de marché leur permettant de dégager des marges de profit importantes. Autrement dit, au niveau microéconomique, on vérifie souvent que l'importance des profits ne rime pas avec une situation salariale comparativement défavorable 18 ( * ) .
(2) Entre les hauts salaires et le reste du salariat
Enfin, une différenciation des destinées salariales est intervenue entre les salaires les mieux payés et le reste du salariat .
La considération de la dynamique des salaires des 1 % des salariés les mieux rémunérés montre que ceux-ci ont bénéficié d'une croissance de leurs salaires particulièrement élevée entre 1996 et 2001, le millième des salariés du haut de la distribution étant plus particulièrement favorisé.
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS DES QUANTILES DE
SALAIRES,
AU SEIN DU DERNIER DÉCILE
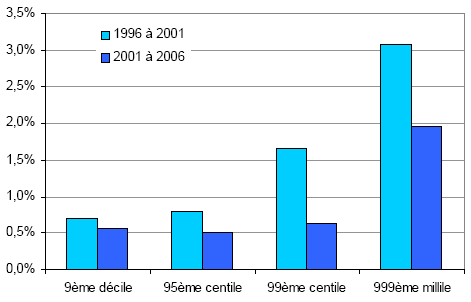
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Au total, quand le centième des salaires du haut de l'échelle recevait 5,5 % de la masse salariale en 1998, c'est près de 6,6 % qui leur étaient attribués en 2006 (1,1 point de gain de masse salariale).
PART DES SALAIRES SUPÉRIEURS AU
99
ÈME
CENTILE
DANS LA MASSE SALARIALE TOTALE
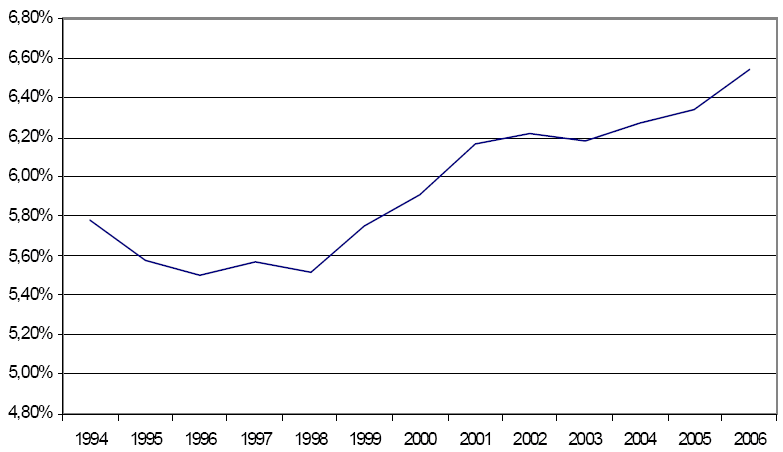
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Si la situation des très hauts salaires a ainsi nettement décroché par le haut, d'autres phénomènes contribuent à engendrer la perception d'inégalités croissantes.
(3) Selon la qualité de la position dans l'emploi
Si on délaisse le champ des salariés à temps plein qui, conventionnellement, sert le plus souvent dans les études portant sur les salaires, pour tenir compte des salaires perçus par l'ensemble des salariés en tenant compte de leur durée réelle d'emploi 19 ( * ) , on observe que le revenu salarial 20 ( * ) a progressé beaucoup moins que le salaire moyen par tête à temps complet.
MÉDIANES DU SALAIRE ANNUEL NET D'UN TEMPS COMPLET ET DU REVENU SALARIAL, EN EUROS CONSTANTS
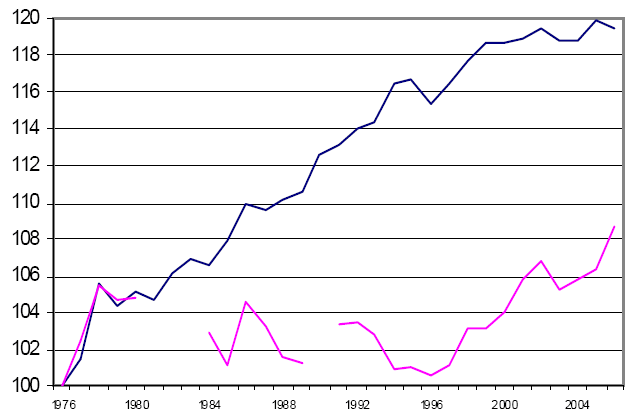

Source : Insee, DADS séries longues et DADS exploitation au 1/25. Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Le revenu salarial, à l'inverse du salaire moyen, a stagné entre 1976 et 1996. Il n'a vraiment augmenté qu'à la fin des années 90 (période de forte croissance économique et de « normalisation » de la situation d'emploi des salariés). Mais, au total quand le salaire moyen par tête médian est à 120 en 2006 (base 100 en 1976) le revenu salarial médian n'est qu'à 109.
En dehors même de toute législation impliquant une baisse de la durée du travail (sinon celle sur le temps partiel) un processus de diminution des jours de travail rémunérés s'est déroulé sous l'effet de l'augmentation de la place des formes d'emplois dites atypiques et de le persistance du chômage.
NOMBRE MOYEN DE JOURS ANNUELLEMENT
RÉMUNÉRÉS
DES SALARIÉS DU SECTEUR
PRIVÉ
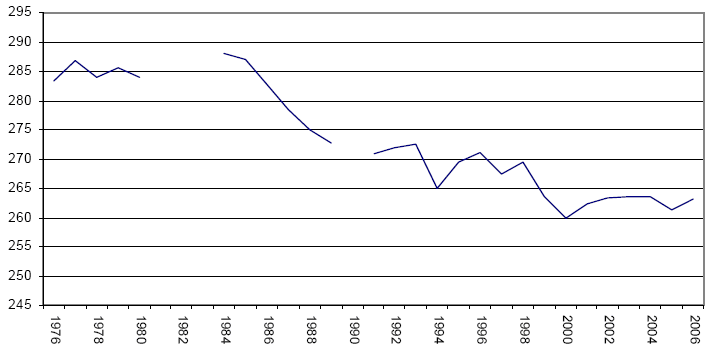
Source : Insee
Le nombre moyen de jours rémunérés qui était de 285 en 1976 est tombé à 260 en 2000 soit un recul de près de 9 % en lien avec la progression des formules de sous-emploi dont celle des emplois dits « atypiques ».
Ces emplois sont passés de 5,5 à 12 % du total.
PART DES FORMES ATYPIQUES D'EMPLOI DANS L'EMPLOI TOTAL
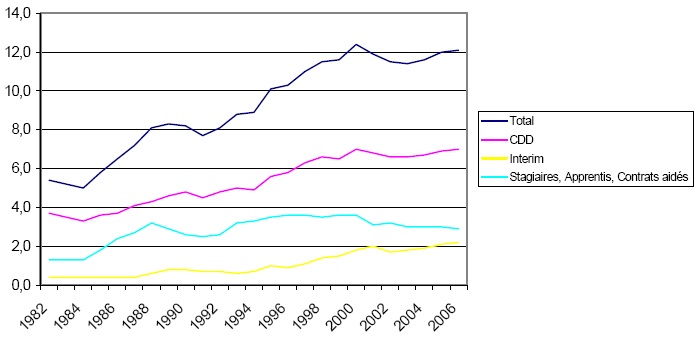
Source : Insee
Outre les effets de ce processus sur la position de négociation des salariés dans les discussions de tout niveau conduisant à la fixation des salaires, la propagation des formes d'emplois pouvant comporter des durées d'emploi réduites, à quoi il faut ajouter les effets du temps partiel et du chômage, pèse sur les salaires réellement perçus par les personnes en emploi.
Finalement, derrière les situations moyennes se dissimule une segmentation du marché du travail avec des situations très contrastées .
De ce point de vue, même si les inégalités de revenu salarial n'ont, pas plus que les inégalités de salaire moyen , progressé, elles sont d'un niveau qui reste très élevé.
DISTRIBUTION DU REVENU SALARIAL NET DU SECTEUR PRIVÉ
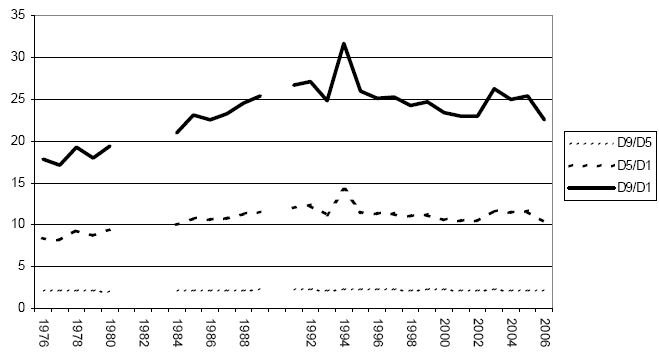
Source : Insee, DADS, exploitation au 1/25 ème
L'écart entre un cadre à temps plein et un non-qualifié à temps partiel ou un stagiaire est dans une proportion de l'ordre de 25 à 1.
Ce phénomène peut être considéré comme durable. En dix ans, entre 1996 et 2006, 38,6 % de ceux qui relevaient des 20 % disposant du revenu salarial le plus faible en début de période sont dans la même situation à son terme.
Par ailleurs, s'il existe une assez forte dispersion des trajectoires salariales avec, en 2005 par exemple, pour un quart des salariés perdant plus de 540 €, la moitié qui ont enregistré un gain de plus de 400 €, il semble exister quelques pesanteurs structurelles qui condamnent à la pauvreté salariale certaines catégories de la population.
Ainsi, ce sont plutôt les femmes, les employés et les ouvriers qui subissent des évolutions salariales négatives.
De même, si on a observé que le partage global de la valeur ajoutée varie selon les caractéristiques des entreprises, il faut ajouter que celles-ci influencent également les variations de la situation salariale des employés , qui peut être d'ailleurs souvent « plus avantageuse » dans les entreprises où le partage de la valeur ajoutée ressort comme apparemment peu favorable aux salariés.
(4) Les risques accrus d'une augmentation du salariat pauvre
Il existe une montée de la pauvreté dans le salariat .
A ce sujet, il faut au préalable relever que la pauvreté est principalement liée à l'exclusion du marché du travail. Dans l'ensemble des pauvres (en 1997), 53 % sont sans emploi.
NOMBRE DE MÉNAGES ET DE PERSONNES
PAUVRES
SELON L'OCCUPATION DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE EN
1997
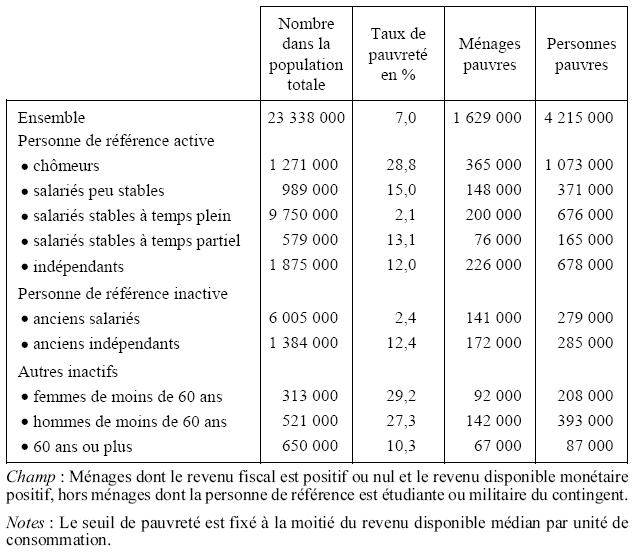
Source : Enquête « Revenus fiscaux » 1997, INSEE-DGI. Inégalités économiques.
Le taux de pauvreté est nettement plus élevé dans les populations à l'écart du travail tandis qu'il est particulièrement bas chez les salariés stables à temps plein. Cette situation ne fait que confirmer l'hétérogénéité de la population française qui comporte une première césure nette entre les chômeurs et ceux qui exercent une activité mais qui, au sein même du salariat, est caractérisée par une diversité des situations où les salariés stables à temps plein (eux-mêmes très différenciés) occupent la meilleure position.
Le niveau assez élevé du taux de pauvreté des indépendants ayant été souligné, on doit aussi remarquer que pour les salariés stables, le taux de pauvreté atteint malgré tout 2 % (contre 7 % pour la population en moyenne en 1997), ce qui montre que l'emploi à temps plein n'immunise pas contre la pauvreté.
Il faut insister sur le fait que les modalités atypiques d'emploi s'accompagnent d'un taux de pauvreté relativement élevé que ce soit pour les « salariés peu stables » ou les « temps partiels ». Leur taux de pauvreté est inférieur à celui des chômeurs mais il est remarquablement élevé.
En outre, le taux de pauvreté des ménages salariés 21 ( * ) , pour être relativement bas, a augmenté au cours du temps, passant de 4 % en 1970 à 6,6 % en 1997.
Ce processus correspond à une augmentation du taux de pauvreté dans le salariat qui est passé de 9,5 % à 13,6 % entre 1970 et 1997 (+ 4,1 points) .
TAUX DE PAUVRETÉ DES MÉNAGES DE 1970
À 1997
SELON L'OCCUPATION DE LA PERSONNE DE
RÉFÉRENCE
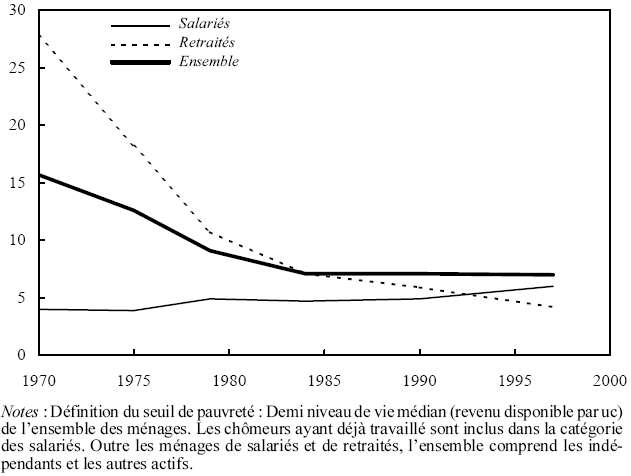
Source : Enquête « Revenus fiscaux » 1997, INSEE-DGI. Inégalités économiques.
On peut souligner que la montée de la pauvreté dans le salariat, qui contraste, en particulier, avec la situation des ménages retraités dont le taux de pauvreté a considérablement reculé, a été particulièrement forte après 1984, soit au cours de la période de réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée .
PROPORTION DE MÉNAGES À BAS
REVENU
AVANT ET APRÈS PRISE EN COMPTE DES PRESTATIONS
(EN %)
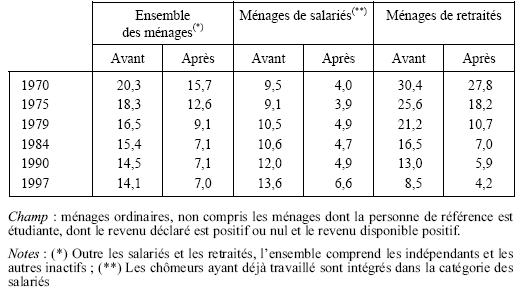
Source : INSEE-DGI, Enquête « Revenus fiscaux » 1970, 1975, 1979, 1984, 1990 et 1997
Dans cette période, il ne semble pas que l'augmentation du taux de pauvreté chez les salariés ait résulté d'une concentration accrue de la masse salariale au profit des salariés les mieux rémunérés .
PART DES 10 % DES SALARIÉS LES MIEUX PAYÉS DANS LA MASSE SALARIALE TOTALE EN FRANCE DE 1919 À 1938, EN 1947 ET DE 1950 À 1998
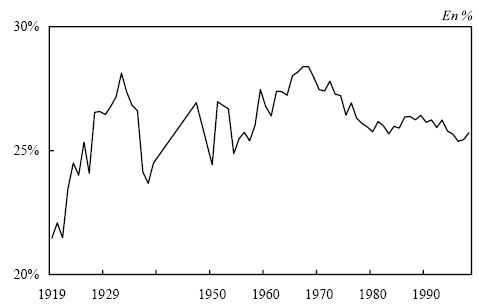
Source : Piketty, 2001, colonnes P90-100 des tableaux D7 et D16, annexe D
Si quelques salariés ont perçu des rémunérations qui leur ont permis d'entrer dans la catégorie des super-riches, les 10 % les mieux payés ont absorbé une part constante (environ le quart) de la masse salariale totale dans les années 80 et 90. Autrement dit, les gains des quelques très riches ont été compensés dans la strate des riches par une certaine modération des gains des autres salariés du décile de salaires le plus élevé.
Par ailleurs, le salaire minimum a augmenté ce qui a permis de rapprocher la situation du bas de la distribution des salaires de celle de l'échelon supérieur.
C'est donc la dégradation des conditions d'emploi (en termes de stabilité et de durée) qui explique la montée de la pauvreté chez les salariés ce que confirment les données détaillées par type d'emploi mentionnées plus haut .
Au demeurant, historiquement, la concentration des salaires a eu tendance à baisser puis à se stabiliser en France où, finalement, la hiérarchie des salaires n'est pas souvent remise en cause (au contraire de la dynamique salariale).
PART DES 5 % DES SALARIÉS LES MIEUX PAYÉS DANS LA MASSE SALARIALE TOTALE EN FRANCE DE 1919 À 1938, EN 1947 ET DE 1950 À 1998
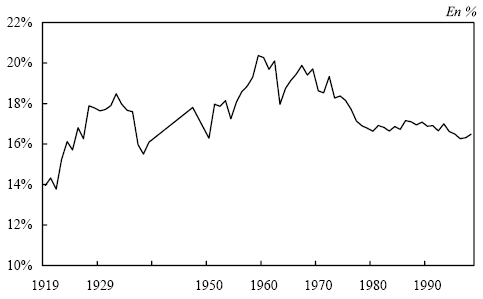
Source : Piketty, 2001, colonnes P90-100 des tableaux D7 et D16, annexe D
PART DES 1 % DES SALARIÉS LES MIEUX PAYÉS DANS LA MASSE SALARIALE TOTALE EN FRANCE DE 1919 À 1938, EN 1947 ET DE 1950 À 1998
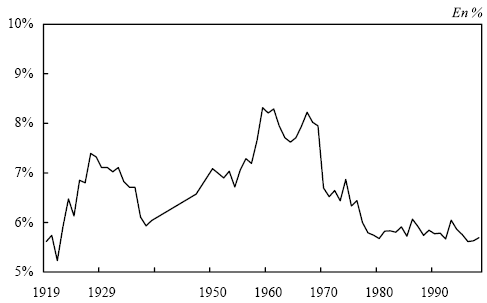
Source : Piketty, 2001, colonnes P90-100 des tableaux D7 et D16, annexe D
Evidemment, les évolutions plus récentes ainsi que les observations suscitées par les nouvelles pratiques salariales concernant le « haut management » ou, au contraire, les salariés les plus précaires (temps partiels subis, stagiaires, employés par intermittence) devraient conduire à remettre en cause ces tendances et le consensus sur la hiérarchie des salaires.
Ainsi, on peut constater qu'au-delà du panorama plutôt neutre donné par certaines données, il existe d'indéniables fondements empiriques à la perception d'un maintien voire d'un accroissement des inégalités salariales 22 ( * ) .
L'impression d'un partage primaire inégal des revenus versés à raison de la participation à la création de valeur ajoutée ne peut qu'être renforcée quand on prend en considération les revenus non salariaux (les revenus du capital) pour apprécier la situation globale des individus parties prenantes à la création de valeur ajoutée par les entreprises (v. plus loin) 23 ( * ) .
Au total, la concentration des revenus auprès du centième de la population la plus riche, après avoir beaucoup régressé entre 1930 et 1975, a entamé au-delà un processus de reconstitution dans la plupart des pays développés.
PART DES REVENUS AVANT IMPÔTS PERÇUS PAR LES 1 % LES PLUS RICHES
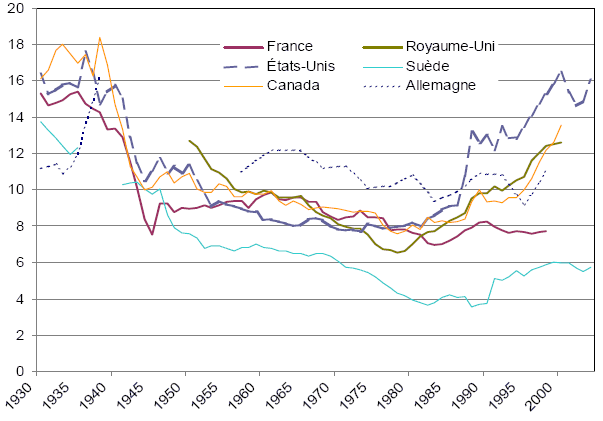
Source : Insee (OCDE, 2008, d'après Leigh, 2007)
Pour l'heure toutefois, tout comme la Suède, la France paraît échapper assez largement à ce mouvement qui est très accusé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
II. UNE EXPLICATION CONSENSUELLE MAIS À PROLONGER : LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE ET DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
La croissance économique conditionne celle des revenus. La croissance résulte de la combinaison d'une augmentation du volume des facteurs de production (travail et capital) et des évolutions de leur productivité.
Le supplément de revenu peut donc être divisé entre un surplus lié à la quantité des facteurs de production et un surplus de productivité attribuable aux progrès d'efficacité des facteurs.
Seul celui-ci peut permettre d'augmenter la rémunération unitaire des facteurs de production 24 ( * ) . Or, si la croissance économique a ralenti, le surplus de productivité a, lui, subi un ralentissement encore plus net en étant divisé par un facteur proche de 6 entre 1950-1974 (+ 3,3 % l'an) et 1990-2008 (+0,6 % l'an). Ce ralentissement ne laisse de poser des questions dans un contexte où, pourtant, la hausse de la productivité paraît être devenue une priorité absolue.
Si, en soi, l'essoufflement de la croissance est un déterminant important du pacte social, le ralentissement de la productivité redouble ses effets contraignants. Mais, on ne peut se contenter d'identifier ces deux phénomènes. Il est essentiel d'en proposer une étiologie pertinente.
A cet égard, il existe deux interprétations polaires et contradictoires.
La première attribue le ralentissement de la productivité aux rigidités et fait la part belle aux rigidités du pacte social et à ses effets sur la création de richesses par les entreprises.
Elle débouche sur des propositions de flexibilisation, recourant à des « modèles » étrangers, où la préconisation de décentraliser le pacte social en restaurant l'entreprise comme lieu privilégié de sa définition s'impose avec vigueur.
La seconde interprétation de l'« échec productiviste » contredit tous les termes de la première, l'échec en question étant attribué à la crise du capitalisme financier, qui, pour être globale, trouve un point de fixation dans la crise de l'entreprise.
Les modifications du pacte social dans l'entreprise qui ont tendu à plus de dérégulation sont marquées par un « désinvestissement » de la composante proprement entrepreneuriale (le capital humain, l'investissement, la recherche et l'innovation) de ce pacte.
On aurait probablement tort de vouloir opter pour l'une plutôt que pour l'autre de ces interprétations. L'impératif de pertinence conduit à reconnaître et à admettre le champ de validité de chacune d'elles.
A. UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE QUI A RALENTI
Le ralentissement de la croissance économique est, sur le long terme, un des faits principaux qui colore les équilibres économiques et sociaux en France .
La croissance économique est passée de 5,4 % l'an entre 1950 et 1974 à 2,4 % entre 1975 et 1989 et 1,9 % entre 2000 et 2008. Le rythme de croissance annuel a perdu les 2/3 de son dynamisme de la période initiale.
Comptablement, ces pertes proviennent pour une part de la décélération du rythme d'accumulation des facteurs de production : l'augmentation du stock de capital a suivi un rythme deux fois moins fort et, pour le travail, l'inflexion de la quantité mobilisée, un peu moindre, dans son ampleur, a été proche 25 ( * ) . Mais, c'est surtout l'essoufflement des gains d'efficacité des facteurs de production (la productivité globale des facteurs - PGF -) qui a pesé sur le rythme de croissance (v. infra ).
Ce dernier processus a mécaniquement, conjointement avec celui de la décélération de la croissance de la population active, limité les effets de la réduction du rythme de croissance sur le chômage. Il n'empêche que l'accumulation du travail salarié n'a pas été suffisante pour éviter une hausse du sous-emploi 26 ( * ) .
L'augmentation du sous-emploi (qui englobe le chômage mais aussi toutes les formes d'emplois à durée atypique 27 ( * ) , que celle-ci soit voulue ou subie) est la principale conséquence 28 ( * ) de la décélération de la croissance. En effet, à elle seule, la croissance économique, si elle tend à augmenter le revenu national 29 ( * ) , n'augmente pas le revenu par tête, la trajectoire de celui-ci étant dépendante de la réalisation de gains de productivité des facteurs de production .
Mais, le rythme de la croissance conditionne celui des créations d'emplois qui, rapporté à l'évolution de la population active, détermine la variation du chômage.
Or, celle-ci est une composante importante, du moins en théorie, de l'économie du pacte social général et de la partie de celui-ci qui prend racine dans l'entreprise.
Même si, pratiquement, la mesure de cet effet est incertaine, la capacité des salariés de négocier avec les employeurs ressort amoindrie d'une situation marquée par un chômage persistant, voire croissant.
De même, la nécessité d'assurer les agents économiques contre le risque de chômage, qui devient structurel quand les conditions de la croissance préviennent une dynamique économique suffisamment forte pour absorber la population active, implique des prélèvements sur le revenu. Or, ces prélèvements, qui deviennent alors eux-mêmes structurels, instaurent un décrochage permanent entre la contribution des facteurs à la production et les revenus qu'ils en retirent.
A cet égard, on touche les limites du raisonnement selon lequel les dépenses consacrées au traitement du sous-emploi sont utiles à la croissance économique. Il n'apparaît fondé que dans l'hypothèse où le chômage est une transition d'un emploi appelé à disparaître pour des raisons économiques qui le condamnent vers un autre emploi plus productif (le supplément de production servant d'assiette au financement de ces dépenses). On peut aller jusqu'à concéder que cette dernière condition peut ne pas être remplie si les dépenses engagées permettent d'éviter les coûts économiques résultant de la dégradation de la situation sociale provoquée par le chômage. Mais, les dépenses de traitement du chômage n'ont que cette dernière justification (ce qui n'est évidemment pas rien d'autant que des motifs humanitaires puissants s'y ajoutent), quand elles portent sur les chômeurs devenus tels du fait de l'insuffisance structurelle de croissance.
En toute hypothèse, l'écart entre la contribution à la production et le revenu retiré de celle-ci pèse sur les salaires nets (ou les profits nets) quand il doit augmenter pour couvrir un chômage grandissant et peut engendrer un sentiment de frustration qui n'est pas entièrement propice à une expérience réconciliée avec le travail.
Autrement dit, l'insuffisance de la croissance par ses effets potentiels sur le chômage atteint les conditions mêmes de l'exercice du salariat .
Dans les faits, comme ces effets sont asymétriques et touchent plus particulièrement les salariés sans grand capital, qu'il soit financier ou « humain » comme on dit aujourd'hui (capacités professionnelles concurrentielles, capital social et relationnel...), que ce soit par le chômage ou par l'affaiblissement de la condition salariale, ce sont les moins « dotés » qui sont touchés.
Le ralentissement de la croissance exerce donc des effets asymétriques sur les individus et, dans une mesure qui reste à préciser, peut également être vu comme procédant de contraintes aux impacts différenciés selon la position occupée sur le marché du travail (v. infra ).
B. LE RÉTRÉCISSEMENT DU SURPLUS DE PRODUCTIVITÉ
La contrainte d'accélération de la productivité, qu'il s'agisse de gagner en compétitivité ou de maximiser le revenu, paraît sous-tendre de nombreuses évolutions ayant concerné les pratiques sociales dans l'entreprise, que ces évolutions concernent les pratiques de l'entreprise elles-mêmes ou leur cadre légal.
Pourtant, plus on « parle performance » plus la performance s'érode.
Ainsi, le surplus de productivité, dont l'évolution conditionne la possibilité de gains de pouvoir d'achat par tête, a vu sa croissance annuelle, qui avait déjà perdu 2 points à partir de 1975 par rapport à la période 1950-1974, enregistrer une perte supplémentaire de 0,7 point par an à partir de 1990.
Les facteurs de production nouveaux ont de moins en moins permis de gagner en efficacité.
Si la croissance économique a moins ralenti, c'est en raison d'une certaine résistance de l'accumulation des facteurs de production, mais la baisse de la productivité unitaire des facteurs n'a pas été compensée par cette accumulation.
Ces données sont confirmées par diverses études qui montrent une baisse continue de la productivité du travail jusqu'à des points atteints dans des périodes économiques particulièrement troublées de notre histoire.
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ EN FRANCE DANS LE SECTEUR MARCHAND
|
1890-1913 |
1913-1950 |
1950-1973 |
1973-1980 |
1980-1990 |
1990-1995 |
1995-2002 |
|
|
Productivité par emploi |
1,48 |
0,98 |
4,89 |
2,04 |
2,69 |
1,55 |
0,88 |
|
Productivité horaire |
1,91 |
1,65 |
5,28 |
3,07 |
3,29 |
1,75 |
1,77 |
Source : Bulletin de la Banque de France, n°139 - Juillet 2005
La croissance de la productivité du travail (qu'il s'agisse de la productivité horaire ou de la productivité par emploi structurellement moins dynamique du fait de la baisse de la durée du travail) a ralenti de plus en plus, de sorte que les gains de productivité suivent un rythme proche de celui observé entre 1913 et 1950, période marquée par deux guerres mondiales et la grande crise économique des années 30 30 ( * ) .
Il est intéressant de décomposer les différentes contributions possibles à la productivité pour approcher où se situent les problèmes qui en expliquent le ralentissement.
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DE LA
PRODUCTIVITÉ EN FRANCE
DANS LE SECTEUR MARCHAND
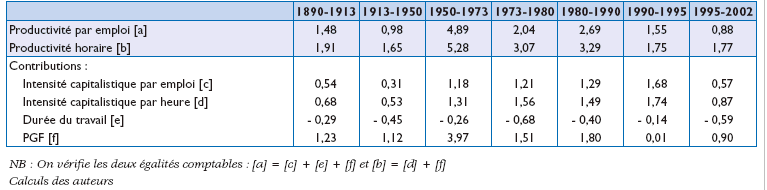
On observe que la réduction de la durée du travail a joué un rôle structurel négatif sur la productivité par emploi , témoignant, dit-on, d'un « arbitrage » pour davantage de temps libre. On décrit souvent cet « arbitrage » comme un choix privilégiant la qualité de vie plutôt que la quantité des richesses monétaires .
Dans la réalité, la netteté de ce choix n'apparait pas aussi clairement. Ses deux termes sont discutables. Du côté du temps libéré, on peut relever, par exemple, qu'une partie de la baisse de la durée du travail est plus subie que souhaitée. Quant à la responsabilité de la baisse de la durée du travail dans le ralentissement de la croissance économique, elle n'est pas entièrement précisée.
Il est comptablement indéniable que la réduction du temps de travail freine théoriquement l'activité. Mais celle-ci peut être si peu dynamique, pour d'autres raisons, que la réduction du temps de travail puisse apparaître comme une conséquence plutôt que comme une cause d'une croissance molle. La récente période où le recours au travail à temps partiel a servi de variable d'ajustement alternative à la mise au chômage soit en France, soit en Allemagne montre que, pour apprécier plus complètement le rôle de la baisse du temps de travail, il faut en mesurer les effets sur le rythme d'accumulation de ce facteur de production.
Autrement dit, à « l'arbitrage » mentionné plus haut, il faut en ajouter un autre qui, plus effectif sans doute, concerne le choix entre durée du travail et chômage .
L'enseignement le plus net est plutôt dans la responsabilité de l'évolution de la productivité globale des facteurs dans l'affaiblissement de la croissance . Celle-ci représente une mesure de tous les gains d'efficacité économique qui ne sont pas directement attribuables à des variations quantitatives.
Excepté entre 1990 et 1995 où l'intensité capitalistique (c'est-à-dire du rapport quantitatif du capital au travail), dont on peut estimer qu'elle favorise la productivité du travail, a connu une forte augmentation, ce sont des facteurs non directement quantifiables (la PGF) qui paraissent déterminer le plus l'ampleur des gains de productivité.
Autrement dit, dans la période des très forts gains de productivité du travail, si l'accumulation du capital a compté, les progrès généraux d'efficacité du travail ont été encore plus déterminants. De même, c'est le freinage de la productivité globale des facteurs qui explique comptablement l'affaiblissement des gains de productivité.
C. UN DIAGNOSTIC À PROLONGER
Sur les constats d'un ralentissement de la croissance et des gains de productivité, il y a consensus, mais s'en tenir là serait insuffisant. Certes, les causes de ces évolutions sont encore en partie incertaines (ce qui conduit à recommander une amplification des travaux portant sur la croissance), mais on peut en envisager quelques unes et, plus particulièrement, se poser la question des interactions entre les équilibres atteints sur les marchés des facteurs de production et le rythme de la croissance .
1. Facteurs d'offre ou affaire d'équilibre ?
Il faut d'abord envisager, outre les relations entre le rythme de la croissance et l'accumulation du travail et les salaires, l'impact de la répartition des fruits de la croissance sur le dynamisme économique .
Sur le premier point , il existe au moins deux approches différentes et contradictoires.
Une lecture classique voit dans les rigidités salariales un frein structurel à l'accumulation du travail et une explication au chômage persistant. Le prix du travail serait trop élevé ce qui découragerait l'emploi, notamment pour les emplois à productivité faible. En outre, le chômage structurel atteindrait un haut niveau en France en raison des tensions salariales qui se déclencheraient dès qu'on y atteint le seuil des 9 % de chômeurs. Enfin, des rigidités institutionnelles élèveraient le coût du travail perçu par des employeurs exposés aux difficultés d'ajuster la main-d'oeuvre à une activité économique de plus en plus volatile. En bref, le chômage serait « classique » et celui-ci freinerait structurellement la croissance économique. Cette vision débouche sur des propositions de flexibilisation du marché du travail (déréglementation des salaires et de l'emploi) mais elle est également cohérente avec la proposition d'augmenter le capital humain pour disposer d'une main-d'oeuvre plus qualifiée capable de performances productives plus élevées, seules susceptibles de justifier un plus haut niveau de salaires.
Les lectures moins orthodoxes comprennent d'abord l'idée que ce n'est pas fondamentalement l'insuffisance de l'accumulation du travail qui explique le ralentissement de la croissance mais celui-ci qui est responsable du sous-emploi. Le coût du travail n'est pas l'obstacle premier. C'est l'insuffisance de la production qui, éventuellement, le rend tel. Cette sous-production s'explique elle-même par une demande conjoncturellement ou structurellement insuffisante.
En outre, d'un point de vue plus microéconomique, des analyses ont approfondi l'idée qu'il faut enrichir la conception du salaire pour ne plus voir en lui un simple élément quantitatif soumis à une contrainte exogène de productivité mais aussi un déterminant plus qualitatif qui, en soi, représente une incitation efficace à élever la productivité du travail.
Dans ces approches, l'abaissement du coût du travail exerce des effets contraires à ceux attendus dans les analyses classiques :
- elle accentue le désajustement entre offre et demande en déprimant celle-ci ;
- elle réduit la productivité en ôtant au salaire sa force d'incitation ;
- plus largement, le déclassement du travail qui est associé à la réification des salariés le dévalorise radicalement et, en alimentant un sentiment de précarité, anéantit la valeur des engagements réciproques entre les salariés et l'entreprise, qui représente une condition de la prospérité de l'entreprise mais aussi de relations sociales apaisées.
La popularité de ces deux lectures opposées des liens entre croissance et travail ne peut être considérée comme le tout indépassable de la question pour plusieurs raisons :
- en premier lieu, la croissance économique est tributaire d'autres variables que le travail ; et la productivité du travail est elle-même dépendante d'autres facteurs, irréductibles aux seuls paramètres de l'emploi. Ainsi, le rythme de l'investissement ou les gains de productivité résultant de l'innovation importent (et importeront de plus en plus v. infra ) sans qu'ils soient exclusivement explicables par les équilibres du marché domestique du travail ;
- en second lieu, il est possible (v. Malinvaud) que les freins à l'accumulation du travail soient non-exclusifs les uns des autres, autrement dit que les deux approches exposées plus haut puissent, chacune, rendre compte d'une partie des problèmes d'accumulation et de performances du travail. Il s'agirait alors non de privilégier un type d'action plutôt que l'autre mais de les concilier ce qui, pour être beaucoup plus difficile, serait aussi une condition essentielle de l'efficacité des politiques publiques.
Les difficultés rencontrées sur cette voie sont considérables. Elles tiennent à ce qu'elle conduit à affronter une série de dilemmes, parmi lesquels ceux-ci :
- un premier entre restauration de l'employabilité par une baisse des rémunérations salariales et maintien de l'incitation au travail ;
- un deuxième entre différenciation salariale et objectif de limiter les inégalités ;
- un troisième entre distribution inégalitaire des salaires et dynamique de la demande, de l'offre, et donc de la croissance ;
- un quatrième entre logiques de production et logiques de redistribution et d'intervention publique pour soutenir la croissance...
Outre les éléments techniques du diagnostic, deux attitudes différentes apparaissent fondamentales dans la résolution de ces dilemmes suivant le degré de confiance accordé respectivement aux mécanismes de marché et à l'intervention publique .
Dans cette réflexion globale, un dernier élément majeur doit être mentionné : le degré de confiance dans la capacité à passer d'une approche analytique à l'action pratique , dans un contexte où les relations économiques et sociales semblent ordonnées par des forces qui échappent de plus en plus à toute autorité venant les surplomber.
De ces points de vue, il apparaît particulièrement légitime dans le contexte de crise globale actuelle de se pencher sur les questions soulevées par la répartition des fruits de la croissance et de ses impacts notamment sur le rythme et l'horizon de celle-ci.
On peut envisager l'hypothèse que la répartition du revenu national ait instauré un équilibre conduisant à une production trop souvent en-deçà des capacités de production 31 ( * ) et que ce mauvais équilibre n'ait pas été suffisamment corrigé par des politiques économiques restées structurellement trop restrictives bien que comprenant des déséquilibres plus ou moins consentis.
Toutes ces questions appellent des approfondissements (dont certains sont envisagés dans la suite de ce rapport).
Des réponses qui pourraient leur être apportées dépend en partie l'avenir de la croissance française dont on peut craindre que les processus d'accumulation ne pourront la soutenir sensiblement dans un contexte de faible accroissement de la population active et de concurrence des espaces dans l'attraction des capitaux .
2. Croissance potentielle et répartition du revenu national
Dans un rapport consacré à la prospective du pacte social dans l'entreprise, on ne peut ignorer que les perspectives de croissance potentielle ne sont pas particulièrement favorables pour la France 32 ( * ) .
A l'avenir, le rythme de la croissance devrait ralentir du fait d'un essoufflement de la progression de la population active (même avec des hypothèses plutôt favorables : tendance de la population active soutenue par l'immigration ; hausse des taux d'emploi par âge), dans le contexte d'une stabilisation des gains de productivité.
Sur ce point, plusieurs variables doivent être considérées.
Du côté de l'efficacité des facteurs productifs :
le capital accumulé pourrait être devenu de moins en moins source de gains d'efficacité ;
les innovations managériales sont elles-mêmes peut-être en cause ou, plus largement, l'implication des salariés dans l'entreprise, ce que semblent suggérer plusieurs analyses dont rend compte le présent rapport ;
la créativité et l'innovation pourraient être moins fortes que dans la période de rattrapage de l'Après-guerre dont on peut dire que ces processus furent favorisés par un courant d'imitation de modèles disponibles (notamment aux Etats-Unis) ;
la restructuration de l'économie française pourrait avoir épuisé ses effets favorables à une accélération de la productivité globale des facteurs et exercer désormais des effets de freinage dans un contexte de montée de la part des services dans la production totale...
Il faut souligner que les prévisions de croissance potentielle ne sont pas sans admettre une certaine marge d'incertitude. Sous cet angle, les perspectives démographiques sont moins incertaines que celles portant sur la productivité.
Il existe une forme d'inertie des variables démographiques. Par ailleurs, ce n'est pas sur ce point que les prévisions de croissance potentielle semblent affectées d'un biais restrictif (v. ci-dessus).
La variable-clef sera le rythme des gains de productivité . En effet, seul le retour à une croissance soutenue de la productivité globale des facteurs pourra à l'avenir faire le lit de la croissance en France et atténuer à terme les conflits de répartition qu'un faible essor de l'activité risque de rendre particulièrement aigus.
Or, il parait raisonnable de considérer que les gains de productivité ne sont pas indépendants de la répartition du revenu national.
Les gains de productivité ont longtemps été vus comme essentiellement exogènes provenant de l'intervention de changements, ou providentiels ou indépendants de l'équilibre du régime de croissance économique, associés à des innovations de produits ou de processus productifs autonomes.
Cependant, des approches contemporaines laissent entrevoir qu'il est possible de diversifier l'analyse des innovations en endogénéisant leur survenance. Dans ces approches, la relation innovation croissance est complétée par une relation croissance innovation, ce qui ouvre la voie à des enchaînements vertueux. La croissance économique n'est plus seulement dépendante de changements venus d'ailleurs (des laboratoires ou des « génies du conseil aux entreprises » 33 ( * ) par exemple), elle crée ses propres conditions. L'augmentation des revenus résultant de la croissance de la production permet en particulier de hausser le niveau du capital, quantitativement et qualitativement, qu'il soit matériel (l'investissement au sens de la comptabilité nationale) ou immatériel (le capital humain, l'économie de la connaissance...).
Par exemple, de récents travaux ( voir Cahn et Saint-Guilhem de la Banque de France ) ont montré que la productivité globale des facteurs pouvait être mise en relation avec des composantes facilement identifiables du régime de croissance : le taux d'utilisation des capacités de production, le progrès technologique incorporé au capital qui dépend du rythme de l'investissement, le rythme d'accumulation du facteur travail...
Ces études suggèrent qu'il est possible d'agir sur la productivité globale des facteurs en respectant deux principes :
- tendre toujours vers une dynamique soutenue de l'investissement ;
- augmenter le rythme des innovations productives.
Ces deux principes supposent à leur tour que le régime de croissance (tant son rythme que son équilibre) respecte quelques conditions.
Le rythme de la croissance doit être assez élevé pour que l'incitation à investir soit forte et que le produit dégagé permette de financer la hausse du niveau du capital.
L' équilibre du régime de croissance doit être tel que cette première condition soit remplie de façon durable.
Autrement dit, la demande doit être suffisante et compatible avec l'émergence de conditions favorables au financement du capital.
Mais il faut encore, ces conditions étant créées, que le financement disponible soit effectivement consacré à hausser le niveau du capital.
Appliquée à la France, cela suppose que la croissance effective ne soit pas inférieure à la croissance potentielle si bien que des politiques macroéconomiques adaptées doivent intervenir pour rejoindre la croissance potentielle mais aussi que la France puisse financer, et finance effectivement, les efforts nécessaires à l'innovation ce qui renvoie à la question de l'affectation des ressources financières mobilisables à cet effet.
Or, l'ensemble de ces conditions ne sont pas indépendantes du partage de la valeur ajoutée. Comme on l'indique dans la deuxième partie du présent rapport, certaines configurations du partage de la valeur ajoutée sont plus propices que d'autres à l'atteinte d'un objectif de hausse de la croissance potentielle dans des conditions soutenables.
III. UNE EXPLICATION PLUS CONTROVERSÉE : LA DÉFORMATION DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AUX DÉPENS DES SALAIRES
Aux effets du ralentissement de la croissance et des gains de productivité sur la progression des salaires sont susceptibles de s'ajouter ceux résultant d'une déformation du partage de la valeur ajoutée.
De celui-ci dépendent, en effet, à croissance donnée, la dynamique des salaires et des profits.
Le partage de la valeur ajoutée est ainsi particulièrement riche d'enseignements sur les équilibres du pacte social.
|
QU'EST CE QUE LA VALEUR AJOUTÉE ? Les indicateurs de partage de la valeur ajouté sont construits à partir des informations réunies selon les conventions de la comptabilité nationale. Celle-ci décrit les opérations économiques (des différents secteurs et de l'économie nationale) à travers une série de comptes en distinguant les comptes d'opérations courantes des comptes d'accumulation et de patrimoine. Les premiers sont assimilables aux comptes d'exploitation et financiers de comptabilité privée ; les seconds ressemblent à des comptes de bilan. Les comptes de production et d'exploitation décrivent la production des agents économiques à travers le concept de valeur ajoutée (production nette des consommations intermédiaires nécessitées par la production) ainsi que la répartition des revenus afférents qui se décomposent en des salaires (revenus du travail) et en des profits (dénommés excédent brut d'exploitation - EBE - revenus de capital). Toutefois, le concept de revenu courant est élargi quand on descend la séquence des comptes d'opérations courantes . On mesure, à ce stade, les flux de revenus nets des agents en tenant compte en particulier des revenus nets des créances nettes. Cette correction est analogue à celle qui consiste, en comptabilité privée, à ajouter aux résultats opérationnels les résultats financiers. On relève, et si cette convention doit être discutée (v. infra ), que le concept de valeur ajoutée et sa répartition ne tiennent pas compte de ces revenus financiers courants (non plus d'ailleurs que des plus ou moins values qui, quant à elles, ne sont décrites que dans les comptes de patrimoine). |
|
COMPTE DES FLUX DES SECTEURS INSTITUTIONNELS
La valeur ajoutée représente le solde du compte de production . Elle résulte de la différence entre la production et les consommations intermédiaires utilisées pour la réaliser. La valeur ajoutée est la ressource principale (à côté des subventions) du compte d'exploitation . C'est à ce stade des comptes des secteurs que le partage de la valeur ajoutée est déterminé entre, d'un côté, ce qui revient aux salariés et, de l'autre, ce qui - avec l'excédent brut d'exploitation - est considéré comme le revenu de l'entreprise (et de ceux qui la possèdent). Les emplois du compte d'exploitation sont essentiellement les salaires (cotisations sociales comprises) versés par les entreprises et le solde du compte d'exploitation, qui est l'excédent brut d'exploitation (EBE). A ce niveau, la réflexion sur le partage de la valeur ajoutée est exclusivement conduite à partir des données de l'exploitation de l'entreprise . En simplifiant, on peut dire que ces niveaux des comptes nationaux correspondent à la séquence suivante d'une comptabilité privée sommaire :
En deçà, les comptes de revenu et de capital décrivent l' utilisation de l' excédent brut d'exploitation : - le compte de revenu qui, en plus de l'EBE enregistre en ressources, les recettes liées aux créances de l'entreprise (intérêts et dividendes perçus, indemnités d'assurances...) aboutit en solde au revenu disponible brut (ou épargne brute) une fois déduits les intérêts et dividendes versés mais aussi les impôts sur le revenu (principalement l'impôt sur les sociétés) ; - le solde du compte précédent (le revenu disponible brut ou épargne brute) est une ressource du compte suivant, le compte de capital , dont les emplois sont la formation brute de capital fixe (l'investissement) et les acquisitions nettes d'actifs (hors actifs financiers). Le solde de ce compte est, selon que les ressources dépassent ou non les emplois, une capacité ou un besoin de financement . |
Les indicateurs de partage de la valeur ajoutée synthétisent les résultats des procédures d'attribution primaire des revenus à ceux qui contribuent à leur création.
Les conditions du partage de la valeur ajoutée informent donc sur la façon dont jouent les mécanismes de fixation des revenus des facteurs productifs et sur la répartition des revenus primaires à laquelle ils aboutissent.
Mais, les questions posées par le partage de la valeur ajoutée ne sont pas seulement des questions relatives à la répartition des revenus entre les différentes parties prenantes à leur création.
D'une part, elles s'élargissent vers des questions connexes , celles qui viennent nécessairement quand on évoque le prix d'un facteur de production, qu'il s'agisse du travail ou du capital. Tout particulièrement, le prix du facteur considéré est-il adapté ou est-il trop élevé si bien que le facteur est sous-employé ? Cette question traditionnellement posée pour le facteur travail quand on recherche les causes d'un chômage persistant doit l'être aussi pour le capital : par exemple, son prix n'est-il pas si élevé qu'il décourage l'investissement ?
D'autre part, la répartition n'est pas indépendante de la production et donc de la croissance . Celle-ci influence sans doute celle-là mais la répartition elle-même conditionne la croissance économique.
En bref, il existe un débat sur les modalités effectives de la répartition des revenus mais aussi sur celles qui favorisent la croissance la plus forte et la plus équilibrée .
De ce point de vue, la période en cours est particulièrement fertile en discussions puisqu'on a pu estimer qu'au fondement de la crise globale se trouvait une répartition des richesses insoutenable car trop inégalitaire.
On retrouve là une dimension constante des problèmes posés par les arrangements sociaux dans l'entreprise, qui font le pacte social à ce niveau, avec leur influence par un contexte où les aspects économiques comptent beaucoup mais aussi leur influence sur ce contexte.
Deux rapports importants 34 ( * ) ont été récemment consacrés au partage de la valeur ajoutée. Ils concluent à la stabilité du partage global de la valeur ajoutée depuis la fin des années 80 .
Or, ce constat de stabilité de la part des salariés dans la valeur ajoutée est, non seulement, peu en cohérence avec les perceptions communes, mais encore plutôt contraire à l'intuition inspirée par différentes données connues par ailleurs.
Le contexte ne semble pas réunir les conditions d'une stabilité du partage de la valeur ajoutée. En effet, il est marqué par autant de caractéristiques qui laissent présager un affaiblissement du salariat avec :
- dans les années 80 , un net recul de la part des salaires dans la valeur ajoutée et, au-delà, une montée de l'intensité capitalistique (rapport du capital au travail) ;
- la persistance du chômage qui pèse sur les conditions de ce partage ;
- l'augmentation des situations de monopole ou d'oligopoles dans lesquelles, en théorie, les prix sont supérieurs aux coûts normaux de production d'une marge qui est constituée d'une rente;
- l'assouplissement des contrats de travail qui pèse sur les salaires en flexibilisant le volume d'emploi mais aussi la rémunération ;
- la mondialisation avec, en théorie, une homogénéisation du rendement du capital 35 ( * ) et, à travers l'émergence d'un marché du travail de plus en plus mondialisé, plus largement, une homogénéisation des coûts des facteurs de production peu favorable aux salaires ;
- la hausse de la part des femmes dans le salariat alors que celles-ci sont moins bien rémunérées que les hommes...
Sans doute, face à ces éléments, en existe-t-il d'autres pouvant jouer dans le sens inverse d'une hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Mais ils paraissent d'un poids réduit. Ainsi en va-t-il :
- des effets de recomposition de l'offre qui comporte une part grandissante des services, secteur où le poids des salaires est comparativement plus élevé en général ;
- de la réduction du temps de travail , même si elle a été compensée par des réductions de cotisations sociales et par de la modération salariale ;
- de la rigidification des coûts salariaux , résultat de la hausse des salaires différés (des cotisations sociales), mais toujours susceptible d'être compensée par une baisse concomitante des salaires directs ;
- de l'adoption d'un régime salarial favorable en haut et en bas de la hiérarchie des salaires (avec, en haut, les « salaires-profits » des managers et, en bas, le SMIC).
A ces données de contexte, il faut ajouter la considération des résultats de plusieurs études qui montrent que la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ne s'est pas arrêtée au seuil des années 90 .
Appliquées à des champs différents (G10, G7, Union européenne à 15), quatre organisations internationales (Banque des règlements internationaux, FMI, Commission européenne et OCDE) ont publié des études qui indiquent, qu'excepté parfois entre 1995 et 2000, la part salariale dans la valeur ajoutée a continûment diminué.
PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
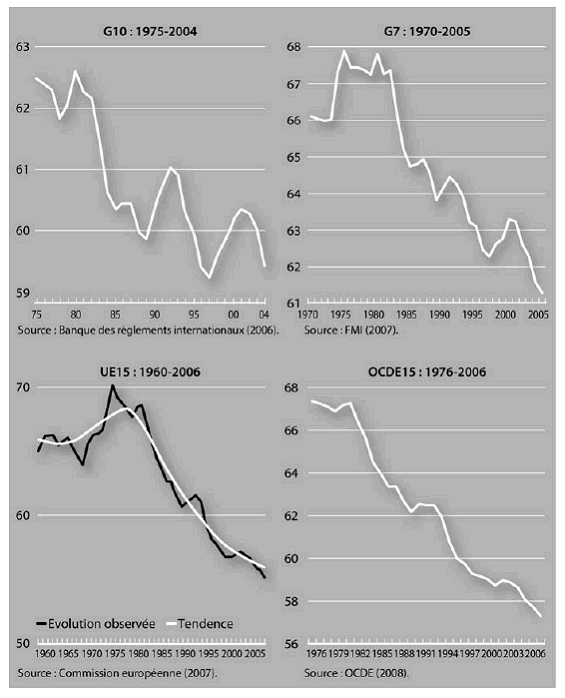
Source : La revue de l'IRES n° 64 - 2010/1
Par ailleurs, pour la France, des études conduites sur la base de données de comptabilité privée concernant les seules entreprises du SBF 250 montrent que la répartition de leur valeur ajoutée s'est considérablement déformée au détriment des salaires et au bénéfice des rémunérations du capital.
DÉCOMPOSITION DU TAUX DE RENDEMENT
ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES DU SBF 250 DE 1992
À 2007
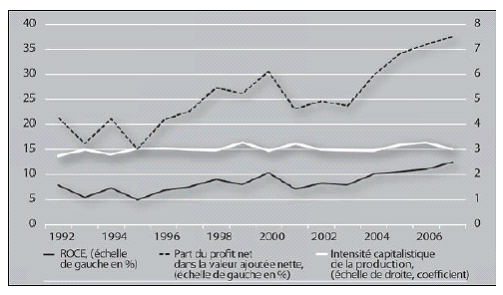
Source : Thomson Financial, Sociétés non financières du SBF 250, hors Vivendi et France Telecom
Ces résultats n'infirment pas nécessairement ceux de la comptabilité nationale pour des raisons qui tiennent à des différences de champ, territorial notamment et de population des entreprises.
Mais, à supposer que soit validé le constat d'une stabilité du partage de la valeur ajoutée en France, ils montrent que ce constat n'empêche pas ipso facto certaines entreprises d'améliorer substantiellement leur taux de marge 36 ( * ) .
Quoi qu'il en soit, le diagnostic de stabilité du partage de la valeur ajoutée nous paraît poser une série de problèmes liés aux principes et méthodes suivis .
Ces problèmes sont très divers mais on peut ici indiquer que leur source principale vient de la discordance entre les concepts de la comptabilité nationale qui servent à suivre le partage de la valeur ajoutée et la réalité d'une économie où la globalisation internationale et les phénomènes financiers ont pris la place qu'on connaît .
Des nombreuses questions posées par les indicateurs de suivi du partage de la valeur ajoutée, on aborde ici trois principales :
- partage de la valeur ajoutée et globalisation des marchés de biens et services ;
- partage de la valeur ajoutée et financiarisation de l'économie ;
- quels calculs pour quels salaires ?
En l'état, faute de disposer de l'ensemble des données nécessaires, les problèmes identifiés ne permettent pas de poser un diagnostic inverse de celui admis dans les rapports sus-cités.
Mais, ils jettent un doute sur leur pertinence et conduisent au minimum à conclure à l'incertitude quant aux évolutions de la répartition de la valeur ajoutée depuis les années 90. Plus encore, comme les problèmes identifiés vont presque tous dans le sens d'une sous-estimation de la part des profits dans la valeur ajoutée, ils obligent non seulement à remettre en cause le consensus de stabilité du partage de la valeur ajoutée, mais encore à donner crédit à l'hypothèse d'une poursuite de la réduction de la part salariale dans la valeur ajoutée au cours de cette période .
A. VALEUR AJOUTÉE ET GLOBALISATION
La valeur ajoutée est un concept territorial qui permet de mesurer la production réalisée sur le sol national , celle-ci étant définie comme le résultat d'une activité socialement organisée destinée à créer des biens et services .
Or, tous ces termes, qui posent des problèmes de mesure, sont discutables d'un point de vue conceptuel et par leurs effets sur la façon dont les richesses sont appréhendées.
Dans une économie mondialisée où le poids des firmes multinationales s'est beaucoup accru (v. le graphique ci-dessous qui indique la part du chiffre d'affaires des grands groupes cotés réalisé à l'étranger), la mesure de la création de richesses par les entreprises à travers le suivi de leur seule production nationale peut paraître manquer de significativité .
PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ
À L'ÉTRANGER
PAR LES GRANDS GROUPES COTÉS
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS DE 1990 À 2006
(EN %)
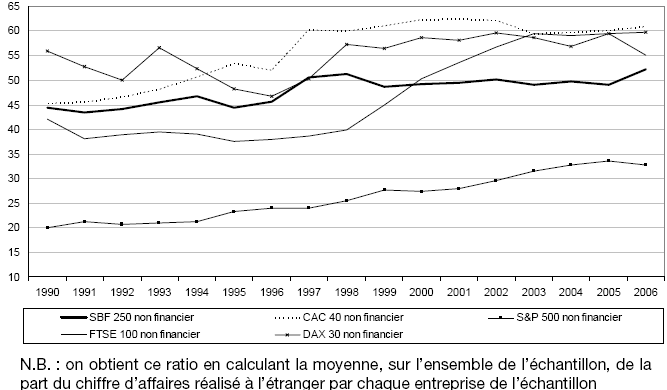
Source : CAS. Horizons stratégiques n° 7. Janvier-Mars 2008. La rentabilité des entreprises en France selon leur taille et leur potentialité de croissance, par Bertille Delaveau et Roland du Tertre.
1. La question des prix de transfert
D'une part, les entreprises peuvent de plus en plus localiser la valeur qu'elles créent où elles le souhaitent au moyen de flux qui leur permettent d'arbitrer la localisation de leur valeur ajoutée sans que celle-ci corresponde à des fondamentaux. Autrement dit, il peut y avoir un hiatus entre le lieu de création de la valeur ajoutée et le territoire où cette valeur est constatée.
Une partie grandissante des productions nationales est destinée à l'exportation. Dans l'autre sens, la production incorpore de plus en plus de biens et services importés sous forme de consommations intermédiaires.
Sans atteindre le niveau allemand, la part des consommations intermédiaires importées dans la production réalisée en France, qui ont doublé entre 1995 et 2006 (passant de 150 à 300 milliards d'euros) est désormais de 9,2 % (contre 7,2 % en 1995) et représente plus de 15 % du PIB.
PART DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
IMPORTÉES DANS LA PRODUCTION
EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE ENTRE 2000 ET
2006 (EN VALEUR)
|
|
Sources : TES symétriques - Insee. Eurostat
La sensibilité de la valeur ajoutée au commerce extérieur est donc reliée, au stade de la production, aux exportations et, au stade des consommations intermédiaires, à la valeur des consommations intermédiaires importées.
Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, si la valeur des exportations diminue, la valeur ajoutée se contracte. De même 37 ( * ) , si la valeur des consommations intermédiaires augmente, la valeur ajoutée baisse, ces deux phénomènes pouvant le cas échéant se cumuler.
Que le PIB (et la croissance) soit dépendant des performances du commerce extérieur, c'est un constat macroéconomique bien établi, mais c'est ici au niveau microéconomique qu'on se situe.
La question est de savoir si l'appauvrissement économique d'une Nation quand son commerce extérieur se détériore a son pendant à due proportion au niveau des firmes.
Il est d'autant plus légitime de poser cette question que l'importance prise par le commerce entre entreprises appartenant à un même groupe dans le commerce international est désormais très grande.
De fait, le commerce extérieur français est largement un commerce intragroupe.
Dans le secteur manufacturier, les multinationales contribuent à 75 % des échanges internationaux des entreprises françaises et, pour ces entreprises, le commerce intragroupe est majoritaire : il s'élevait à 70 % des échanges des filiales de groupes industriels situées en France .
Or, plusieurs études montrent que les multinationales peuvent modifier les termes de leurs transactions internes à seule fin de localiser où elles le souhaitent leur valeur ajoutée (que ce soit pour des motifs fiscaux ou pour d'autres raisons).
En particulier, une étude de l'INSEE 38 ( * ) semble montrer l'existence d'une sensibilité des balances commerciales intragroupes à des écarts institutionnels (fiscalité, réglementation) qui laisse penser que des phénomènes de délocalisation de la valeur ajoutée ne provenant pas de délocalisations de l'activité, peuvent intervenir sans que la valeur ajoutée au sens de la comptabilité d'entreprise ne soit modifiée.
Avec la pratique des « prix de transfert », la valeur ajoutée est bien créée sur le territoire national, et c'est ainsi à bon droit que le travail et le capital qui y contribuent sont recensés comme des facteurs de production mis en oeuvre sur le territoire en question. Mais, un phénomène d'attrition de la valeur ajoutée résultant d'un artifice vient réduire le produit de ces facteurs de production.
Il serait très utile, à tous égards, de mesurer soigneusement l'ampleur de ce phénomène. Mais, à défaut d'en avoir une mesure précise, on peut indiquer que le taux d'ouverture de l'économie française, qui a beaucoup augmenté au cours des trente dernières années, fait que l'assiette théorique de ce phénomène est a priori importante 39 ( * ) .
*
* *
Compte tenu des incertitudes entourant la pratique des prix de transfert 40 ( * ) , on peut considérer qu'il est en réalité impossible de poser un diagnostic sûr quant à l'évolution du partage de la valeur ajoutée.
La seule quasi-certitude est qu'une partie de la valeur ajoutée est délocalisée via cette technique avec pour effet d'augmenter facialement la part des salaires dans la valeur ajoutée et de diminuer artificiellement les profits réellement dégagés par l'activité économique des firmes concernées qui viennent rémunérer le capital engagé en France.
2. Les effets perturbateurs des emplois voués à la production de valeur à l'étranger
Indépendamment des problèmes de mesure du partage de la valeur ajoutée résultant du processus ici décrit, il faut souligner que du fait de leur internationalisation les firmes ont sans doute dans leurs emplois de plus en plus de salariés dont l'activité est vouée à participer à la création de valeur par des entreprises étrangères du groupe dont ils relèvent.
Si ces services ne sont pas facturés aux entreprises qui en bénéficient, ce phénomène aboutit à faire entrer les salaires de ces employés dans la part salariale d'une valeur ajoutée à laquelle ils ne contribuent pas puisqu'en réalité leurs rémunérations sont la contrepartie d'une valeur ajoutée à l'étranger sans que la valeur ajoutée effectivement créée par ces salariés soit enregistrée dans le pays (ici la France) où ils sont rémunérés.
L'ampleur de ce phénomène n'est pas connue mais il paraît assez vraisemblable qu'il ait pu perturber la relation entre salaires et valeur ajoutée telle qu'elle est suivie dans les études disponibles à travers les indicateurs usuels, c'est-à-dire dans le cadre purement territorial de la comptabilité nationale.
B. VALEUR AJOUTÉE ET FINANCIARISATION DE L'ÉCONOMIE
La financiarisation de l'économie, qui se déploie dans un cadre qui va se mondialisant, a des effets sur la création et le partage des richesses qui sont presque totalement occultés par le suivi de la répartition de la valeur ajoutée effectué selon les méthodes de la comptabilité nationale.
Mais, avant de développer ce point, il convient d'exposer les difficultés posées par le traitement de la production des services financiers et de leur utilisation par les autres secteurs de l'économie.
1. Une question technique aux conséquences pratiques importantes : la consommation de services financiers par les entreprises non financières
La question de la valorisation des services rendus par les intermédiaires financiers est une vieille question de la comptabilité nationale. Symétriquement, se pose la question du traitement des productions de ce secteur quand elles sont utilisées par les autres secteurs économiques.
L'évaluation de la production des intermédiaires financiers est problématique en ce sens que seule une partie de leurs activités donne lieu à facturation.
Leurs autres sources de revenu ne sont pas facturées puisqu'elles consistent en des produits financiers divers.
Les comptables nationaux se sont attachés à résoudre ce problème pour les seules opérations d'intermédiation bancaire (à l'exclusion donc de l'intermédiation financière pour compte propre).
Ils calculent des « services d'intermédiation financière indirectement mesurables » (les SIFIM).
Les SIFIM sont appréciés à partir des marges réalisées par les institutions financières sur leurs opérations d'intermédiation bancaire . On considère ainsi implicitement que ces marges représentent la rémunération de ces services et qu'elles sont une composante de la valeur ajoutée des sociétés financières.
On distingue deux types de marges : celles réalisées sur les crédits qu'octroient les institutions financières et celles obtenues sur les dépôts bancaires qu'elles collectent.
Les marges sur crédits des établissements financiers sont liées à l'octroi de crédits à un taux d'intérêt supérieur à celui auquel ils se refinancent, tandis qu'il y a marge sur dépôts s'ils rémunèrent les dépôts au dessous du taux auquel ils peuvent placer ces liquidités sans risque.
Au total, les SIFIM sont égaux à ces marges.
Il faut souligner que les SIFIM sont appréciés à partir des marges sur intérêts et non de l'ensemble des intérêts reçus par les établissements (voir ci-dessous)
Longtemps, la comptabilisation de la valeur ajoutée des établissements financiers a été résolue par l'imputation à une branche fictive de la production des services financiers attribuée aux sociétés financières. Cette solution revenait à déduire de la valeur ajoutée nationale une consommation intermédiaire de services financiers correspondant à la valeur ajoutée du secteur financier.
Mais, une réforme comptable est intervenue qui consiste, d'une part, à considérer qu'une partie des services financiers n'est pas consommée mais est rattachable à un investissement, d'autre part, à imputer à chaque secteur l'utilisation des services financiers qui lui est propre.
Pour les entreprises non financières, cette réforme conduit à diminuer leur valeur ajoutée puisqu'on ajoute à leurs consommations intermédiaires une nouvelle consommation intermédiaire : celle correspondant aux services financiers utilisés par elles.
Le tableau ci-dessous récapitule l'équilibre ressources-emplois des SIFIM en 2000.
ÉQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS DES SIFIM EN 2000 (en millions d'euros)
|
Production |
34 240 |
|
Importations |
5 079 |
|
Total ressources |
39 319 |
|
Consommations intermédiaires |
24 078 |
|
dont : Entreprises non financières 1 |
17 255 |
|
Ménages 2 |
3 556 |
|
Administrations 3 |
3 267 |
|
Consommation finale |
12 868 |
|
Exportations |
2 373 |
|
Total emplois |
39 319 |
1
Sociétés et entreprises
individuelles
2
Ménages (hors El) : accédants
à la propriété
3
Administrations publiques
et Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLsm)
Source : Comptes nationaux base 2000, Insee
On remarque que, par rapport à l'ancienne méthode de comptabilisation, la valeur ajoutée des entreprises non financières se trouve amputée de 17,2 milliards d'euros.
Ainsi, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises non financières ressort comme mécaniquement plus élevée que lorsque les SIFIM n'étaient pas imputés en consommations intermédiaires à ce niveau .
Normalement, ce ressaut est neutralisé quand on procède à des comparaisons, que ce soit dans le temps (les données sont alors rétropolées) ou entre pays (si la méthode est d'application générale). Il n'en reste pas moins que les relations entre entreprises non financières et établissements financiers peuvent changer dans le temps et varier selon les pays et, de même, les marges d'intermédiation bancaire ne sont pas nécessairement stables :
- la structure de financement des entreprises peut varier selon qu'elles recourent plus ou moins à l'intermédiation des banques ;
- les écarts de taux peuvent évoluer dans le temps.
On a indiqué plus haut que seules les marges d'intermédiation bancaire étaient prises en compte dans les SIFIM et déduites à ce titre comme consommations intermédiaires de la valeur ajoutée des entreprises non financières. Les autres charges financières sont déduites de l'EBE des entreprises et considérées ainsi comme une affectation de leur profit.
Il ne serait pas illogique de suivre la même méthode pour les SIFIM plutôt que de les déduire de la valeur ajoutée des firmes.
Cette dernière convention aboutit à traiter différemment des réalités financières semblables, à savoir les écarts de taux supportés par les entreprises. Il peut en résulter des biais de comparaison de leur valeur ajoutée (dans le temps ou entre pays) sans autres causes qu'organisationnelles.
On peut considérer qu'il n'est pas satisfaisant de faire varier la part des salaires dans la valeur ajoutée des sociétés non financières en fonction du niveau plus ou moins élevé de consommations intermédiaires qui s'apparentent à des charges calculées (et non observées).
*
* *
Mais, les problèmes posés par la financiarisation de l'économie vont au-delà de cette question.
Un hiatus entre les richesses au sens de la comptabilité nationale (la valeur ajoutée) et les richesses au sens commun existe et va en s'élargissant à mesure que les opérations financières se développent. Il résulte de plusieurs choix, de principe et de méthode, de la comptabilité nationale.
2. Une position de principe controversée de la comptabilité nationale sur le concept de richesses
Sur le plan des principes, la notion de production qui est le socle de la valeur ajoutée repose sur une conception particulière des richesses (due à l'économiste John Hicks) qui veut que le revenu recouvre le maximum que l'on peut consommer au cours d'une période, en espérant être aussi riche à la fin qu'au début .
Cette conception conduit à exclure du champ des ressources associées à la production (et donc comptées comme valeur ajoutée) toutes les ressources supposées non reproductibles avec les seuls moyens dont dispose le producteur, mais aussi toutes les richesses qui ne peuvent être considérées comme créées en contrepartie de la production d'un bien ou d'un service .
Cette convention apparemment anodine a eu longtemps pour effet d'écarter de la production des oeuvres aussi essentielles dans l'économie contemporaine que les logiciels. Elle continue à expliquer que la recherche ne soit pas encore pleinement valorisée (même si elle devrait être mieux prise en compte à l'avenir) comme un élément de la production des entreprises 41 ( * ) .
Surtout, elle conduit à exclure de la mesure des richesses par la valeur ajoutée une partie considérable des phénomènes d'enrichissement financier .
Autrement dit, comme elles ne sont pas la contrepartie de la production d'un bien, les richesses provenant de la valorisation des actifs mis en oeuvre pour produire se trouvent exclues du champ des richesses mesurées par la valeur ajoutée.
3. Des choix de méthode qui brouillent la vision de la répartition des richesses
Cette position de principe se décline dans des choix de méthode .
La comptabilité nationale est ordonnancée selon une séquence de comptes qui conduit à distinguer, d'un côté, les comptes courants , qui s'ouvrent par la production et, une fois déduites les consommations intermédiaires, par la valeur ajoutée , et se soldent par l'épargne, et, d'un autre côté, les comptes d'accumulation qui débouchent in fine sur les comptes de patrimoine. Ceux-ci mesurent l'enrichissement net des agents à travers la notion de valeur nette du patrimoine.
Or, dans les comptes d'accumulation, certaines opérations interviennent indépendamment de la détermination des résultats des comptes courants que sont la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et l'épargne si bien qu'il n'existe pas de correspondance stricte entre les soldes des comptes courants et les variations de richesses décrites par les comptes de patrimoine .
Plusieurs catégories d'opérations financières ne sont pas considérées comme entrant dans la valeur ajoutée. C'est le cas pour les gains en capital (les plus-values) mais aussi pour les revenus financiers courants (intérêts et dividendes). Toutefois, à la différence des plus-values, ceux-ci sont ajoutés à l'EBE pour déterminer l'épargne des entreprises.
Le présent rapport n'est pas le lieu d'une discussion approfondie de cette option qui fait l'objet d'un débat de principe particulièrement vif d'autant que les choix de la comptabilité nationale contrastent en tous points avec ceux qui inspirent les normes comptables privées internationales.
Mais, on ne peut que souligner ici la discordance qui semble exister entre la conception de la création de richesses promue par la comptabilité nationale et celle que s'en font les agents économiques et qui influence leurs perceptions (et leurs comportements économiques concrets) .
On pourrait, sans inconvénient majeur selon nous, intégrer les revenus financiers perçus par les entreprises au niveau de la valeur ajoutée . Ce choix qui permettrait de consolider les résultats opérationnels et les produits financiers courants en amont des comptes, permettrait sans doute de mieux appréhender les situations financières concrètes des entreprises , telles qu'elles sont perçues, et telles qu'elles influencent les pratiques salariales. Il traduirait mieux la création de valeur par l'ensemble des salariés. Il aboutirait au constat d'une part des salaires dans la valeur ajoutée plus basse et dont la pente serait sans doute descendante .
Avec la méthode actuellement suivie, des problèmes de coïncidence entre valeur ajoutée et salaires versés par les entreprises peuvent se poser dont témoignent d'ailleurs les rapports précités .
|
UN EXEMPLE DES PROBLÈMES COMPTABLES
D'APPRÉCIATION
Dans les rapports consacrés au partage de la valeur ajoutée, le choix du champ - un secteur institutionnel donné ou l'ensemble de l'économie nationale - se pose classiquement. Il apparaît notamment que les singularités des entreprises financières et d'assurances, du point de vue comptable perturbent la significativité des indicateurs de partage de la valeur ajoutée dans ce champ. C'est pourquoi on raisonne habituellement sur les seules entreprises non financières. En effet, une partie de plus en plus importante des ressources des établissements financiers, sur lesquelles elles se fondent (parfois très directement comme dans le cas des bonus) pour définir leurs rémunérations n'entre pas dans le champ de la valeur ajoutée puisqu'elles viennent d'opérations d'arbitrage financier ou de la perception de revenus financiers courants. On considère que de ce fait le lien entre les salaires versés par ces établissements (qui tiennent compte de ces gains en capital) et leur valeur ajoutée (d'où ces gains sont exclus) est trop distendu pour que le ratio salaires/valeur ajoutée soit pleinement significatif dans le secteur financier. Cette distorsion peut être illustrée par le graphique ci-dessous. On y observe que rapportés à la valeur ajoutée (qui n'inclut pas les gains financiers susmentionnés) les salaires sont fortement croissants. En revanche, la part salariale dans le produit net bancaire est (hors l'année 2008 pour des raisons évidentes) plutôt à la baisse.
ÉVOLUTION DE LA PART DES SALAIRES DANS LE
SECTEUR FINANCIER
Sources : TES symétriques - Insee. Eurostat |
Mais, cette limite qui s'applique aux entreprises financières ne s'applique-t-elle vraiment qu'à elles de sorte que le partage de la valeur ajoutée des entreprises non financières serait indemne de cet effet ?
Outre les effets que pourraient avoir les flux de revenus financiers courants des entreprises non financières sur leurs politiques salariales 42 ( * ) , l'importance des variations de valeur des bilans des entreprises non financières invite à répondre négativement à cette interrogation et à imaginer que ces variations ont un impact sur les rémunérations salariales versées par ces entreprises.
Dans ces conditions, le jugement porté sur la rentabilité du capital varie beaucoup selon que l'indicateur choisi tient compte ou non de la valorisation des actifs .
4. Les questions posées par l'appréciation de la rentabilité du capital : comment appréhender le rendement des actifs ?
a) Le choix épineux d'un indicateur de rentabilité du capital
Le rapport de M. Jean-Philippe Cotis reconnaît incidemment les problèmes de méthode rencontrés dans le choix d'un indicateur de rendement du capital.
Son rapport fait mention du graphique suivant 43 ( * ) :
REVENUS DISTRIBUÉS BRUTS VERSÉS PAR LES
SNF,
INCLUANT OU NON LES PLUS-VALUES,
EN PROPORTION DES ACTIONS ET DES
AUTRES PARTICIPATIONS À LEUR PASSIF
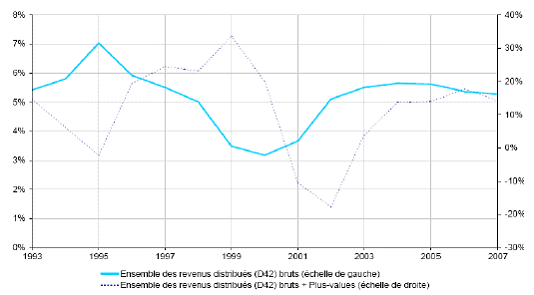
Source : Insee - Comptabilité nationale en base 2000
On y observe que le rendement du capital appréhendé à partir des revenus courants rapportés aux fonds propres a oscillé entre 3,1 et 7 % ce qui, déjà, n'est pas une variation négligeable.
Mais on peut remarquer surtout que la prise en compte des plus-values augmente beaucoup la volatilité du rendement du capital et débouche sur un rendement structurellement plus élevé . Au point bas, le rendement peut être négatif ; au point haut, il peut atteindre 30 %.
Encore doit-on observer que ce constat est quelque peu minoré par des choix de méthode. La rentabilité financière du capital est difficile à mesurer et les termes de la mesure proposée dans le rapport illustrent cette difficulté puisque le dénominateur du ratio (les fonds propres) varie en fonction du numérateur. Ainsi, mécaniquement, les effets d'une hausse de la profitabilité des entreprises sur l'indicateur de rendement du capital financier se trouvent atténués par la convention qui consiste à recourir aux valeurs du marché pour apprécier les actifs et les passifs .
Cette convention n'est pas arbitraire : à la
valorisation des actifs
- qu'il faut, par définition, prendre
en considération pour apprécier les plus-values -
correspondent des valorisations de passifs en fonds propres. Et, dans
l'hypothèse où la totalité du passif serait
constitué de fonds propres, toute plus-value sur actifs serait
neutralisée par une revalorisation du passif. Il n'y aurait alors qu'une
source de décalage possible avec une éventuelle dissociation
entre les marchés de cotation des actifs et des passifs (par exemple, si
la valorisation des actifs était pour tout ou partie
réalisée sur des marchés différents de ceux
où les passifs sont valorisés). Bien entendu, cette situation se
rencontre souvent mais à cette source de variation du rendement du
capital ainsi calculé, il faut ajouter celle associée au fait que
la totalité des passifs ne sont pas valorisés sur les
marchés financiers. Tel est le cas en particulier des actifs bancaires
(les dettes contractées auprès des intermédiaires
financiers) qui sont pris à leur valeur historique (et ne sont pas
intégrés aux fonds propres qui forment le dénominateur de
l'indicateur figuré dans le graphique ci-dessus). Ainsi, moins les
actifs sont couverts par des fonds propres plus les valorisations de
marché qui influent sur la valeur du numérateur du ratio peuvent
entraîner des variations de la valeur de ce ratio.
Ainsi, l'appréciation de la rentabilité des fonds propres à partir de ce ratio, qui est sensible à la structure de bilan des entreprises 44 ( * ) , n'offre pas tous les enseignements souhaitables quant à la rentabilité du capital .
En outre, même si la valorisation des fonds propres à la valeur du marché n'est pas arbitraire, cette propriété n'empêche pas de considérer qu'une valorisation à la valeur historique offre un point de vue également légitime sur la rentabilité du capital .
La méthode de valorisation au cours du marché décrit le prix auquel peuvent être vendus les actifs à un instant donné en fonction des transactions marginales intervenues sur les marchés financiers. Sauf afflux de ventes, qui à demande constante, sont susceptibles de faire baisser la valeur des actifs, elle aboutit à une vision assez significative de la valeur du patrimoine actif des détenteurs du capital. En revanche, s'agissant des passifs, si cette méthode permet d'évaluer ce qu'il faut débourser à « l'instant t » pour investir dans une entreprise, elle ne restitue pas l'historique de la constitution des passifs qui finalement importe seul quand on veut apprécier les phénomènes de rendement réel attachés à la détention d'un capital. Une méthode de valorisation aux coûts historiques est de ce point de vue préférable.
Autrement dit, cet indicateur ne permet pas, du fait de sa construction, de mesurer avec une précision certaine la rémunération réelle du capital et son évolution.
Cette remarque invite à la recherche d'indicateurs de rendement du capital plus adaptés.
A cet égard, il ne fait pas de doute que la rentabilité du capital mesurée à partir des données de la comptabilité nationale ne décrit pas correctement les phénomènes de rémunération des fonds propres .
Les ratios usuels de la comptabilité nationale indiquent que la rentabilité du capital est installée sur une pente descendante. A en juger par les indicateurs traditionnels qui rapportent, l'un, le revenu net à la valeur nette des capitaux engagés (le rendement des fonds propres plus connu sous le nom anglo-saxon de « return on equity - (ROE) », l'autre, le revenu net d'exploitation au capital net (le rendement du capital employé soit, en anglais, le « return on capital employed - (ROCE) », une diminution du rendement du capital toucherait la France (dans des conditions assez proches de celles observées aux Etats-Unis).
RATIOS USUELS DE RENTABILITÉ DU CAPITAL
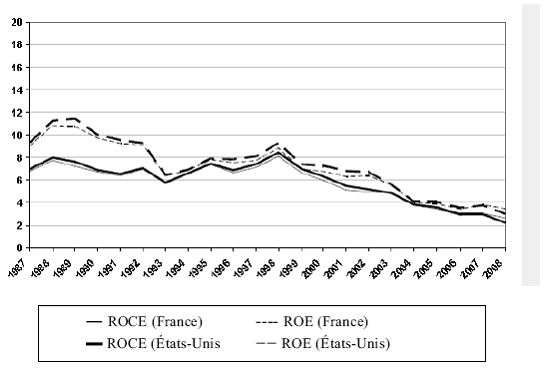
Source : « Asset price changes and the macroeconomic measurement of corporate profitability », par Gilbert Cette, Dominique Durant et Jean-Pierre Villetelle. Novembre 2009
Or, ces résultats ne sont pas totalement conformes à l'intuition et posent notamment un problème de compréhension de l'expansion des opérations financières et de la valeur des sociétés.
En réalité, la construction des indicateurs traditionnels de la comptabilité nationale destinés à suivre la rentabilité du capital n'est pas exempte de biais qui peuvent donner de celle-ci une image trompeuse, l'appréciation usuelle du rendement du capital à partir des données de la comptabilité nationale étant dépendante de conventions qui, sans être injustifiables, ne sont pas les seules possibles et aboutissent à des résultats problématiques par divers aspects.
Le choix principalement concerné par cette observation est celui qui consiste à traiter de façon hétérogène les gains en capital des deux termes des ratios de rentabilité 45 ( * ) .
Les deux dénominateurs de ces ratios sont évalués en tenant compte des gains (ou des pertes en capital). Autrement dit, ils sont estimés à leur valeur de marché . De leur côté, les numérateurs sont pris sans tenir compte des plus ou des moins-values 46 ( * ) , réalisées ou non, sur les éléments d'actifs des entreprises.
Cette convention n'est pas arbitraire mais elle procède d'une conception de revenu des firmes qui peut être jugée comme exagérément restrictive.
Quant à l'absence de prise en compte des gains (ou pertes) en capital pour évaluer le profit de l'entreprise, si elle est conforme à une tradition de la comptabilité nationale selon laquelle ces sources de richesse (ou d'appauvrissement) ne sont pas des revenus comme les autres, du fait, en particulier, de leur non-reproductibilité (ainsi qu'on l'a souligné, cette conception remonte aux pères fondateurs de la comptabilité nationale), elle peut, aujourd'hui que les opérations financières se sont considérablement développées, sembler « datée ».
Elle pose, en outre, des problèmes techniques puisqu'elle peut introduire un biais dans le traitement d'un même revenu selon qu'il est, ou non, versé. Même si, théoriquement, les dividendes non versés sont enregistrés comme des revenus 47 ( * ) (dans le ratio de ROE, pas dans celui du ROCE), la détermination du montant de tels revenus ne va pas de soi.
Enfin, rapportée à la règle de valorisation retenue pour apprécier le dénominateur des ratios de rentabilité, cette convention aboutit à un paradoxe : de son fait, la rentabilité du capital peut baisser sous l'effet d'une amélioration des perspectives de rentabilité des actifs de l'entreprise . En effet, celle-ci peut provoquer une revalorisation immédiate du capital (mais pas des actifs qui la justifient), avec pour conséquence une réduction de la rentabilité apparente de la firme.
En bref, la comptabilité nationale propose des données qui ne permettent pas d'apprécier correctement la rentabilité du capital et, partant, l'impact des conditions économiques du partage de la valeur ajoutée .
Il est donc utile, et légitime, de recourir à des instruments proposant un élargissement du concept de revenu du capital en complément des indicateurs habituels. On peut notamment proposer d'ajouter aux revenus du numérateur des ratios de rentabilité du capital les gains en capital nets ajustés selon la nature des capitaux figurant au dénominateur .
Ces indicateurs ajustés se rapprochent des développements en cours dans les principes de comptabilité privée, l'IASB (International Accounting Standards Board) préconisant une conception élargie du profit, nuancée par quelques réserves visant à ne retenir des plus values que celles susceptibles d'une certaine récurrence.
Ces ratios ajustés donnent une image sensiblement différente du revenu et de l'évolution de la rentabilité du capital tant en France qu'aux Etats-Unis.
RATIOS ÉLARGIS DE RENTABILITÉ DU CAPITAL
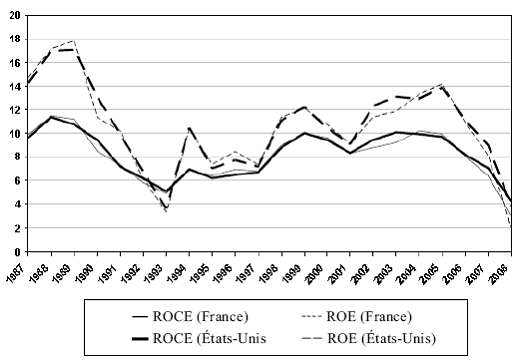
Source : « Asset price changes and the macroeconomic measurement of corporate profitability », par Gilbert Cette, Dominique Durant et Jean-Pierre Villetelle. Novembre 2009
b) Des incidences pratiques considérables
Trois constats peuvent être faits :
• en premier lieu,
les ratios de
rentabilité du capital élargis situent celle-ci nettement
au-dessus des ratios usuels
. Selon les années, la
rentabilité du capital y apparaît supérieure de 4 à
6 points (soit du tiers au double) par rapport à la
rentabilité mesurée par la comptabilité
nationale ;
• en deuxième lieu, la valeur des ratios
élargis ressort comme plus volatile, notamment parce qu'elle est
sensible aux phénomènes de variations des prix d'actifs ;
• troisième constat,
l'utilisation
d'une mesure du rendement du capital intégrant les plus-values sur
actifs modifie le profil des courbes
. Hormis pour la toute fin de
période marquée par les débuts de la crise
immobilière et financière, la tendance dévoilée par
le ratio élargi est haussière et contraste avec la baisse de la
rentabilité du capital retracée par les ratios usuels.
*
* *
Autrement dit, même en tenant pour acquise la stabilité du partage de la valeur ajoutée en France depuis 1990, on relève que celle-ci n'a pas empêché une augmentation tendancielle de la rentabilité du capital qu'on peut attribuer à la valorisation des actifs des firmes 48 ( * ) .
Il faut envisager que les entreprises et les salariés ont de la richesse qu'ils créent une conception différente de celle des comptables nationaux.
En toute hypothèse, l'internationalisation et la financiarisation des firmes rendent particulièrement complexe l'analyse des conditions du partage de la valeur ajoutée et des effets de ce partage sur la valeur proprement territoriale des firmes.
C. COMMENT MESURER LES SALAIRES ?
Outre les problèmes de détermination des richesses à prendre en compte pour mesurer la part des salaires dans l'économie, il faut mentionner les difficultés que suscite la détermination des salaires eux-mêmes . Elles sont nombreuses et on se bornera à évoquer trois d'entre elles.
On laissera donc de côté les autres difficultés et notamment le traditionnel problème de suivi des salaires perçus par les entrepreneurs individuels dont le nombre s'est réduit au cours du temps et celles, déjà signalées, qu'il y a dans une économie globalisée à circonscrire les salaires versés sur un territoire donné de sorte qu'ils correspondent bien à un travail fourni pour développer la production strictement nationale.
Mais, auparavant, une observation fondamentale s'impose.
1. Le salaire et ses évolutions : un changement de nature ?
On a pu relever qu'un processus de différenciation des rémunérations salariales était en cours au terme duquel le travail est de moins en moins rétribué pour compenser la valeur de l'engagement des salariés dans l'entreprise en tant que tel , mais se trouve de plus en plus dépendant de la contrepartie marchande de cet engagement .
Le développement des composantes variables de la rémunération (qu'elles soient incluses dans les salaires au sens juridique - comme les primes et compléments - ou non - comme la participation -) concrétise cette tendance.
Le lien entre la répartition du revenu et la performance des entreprises sur leurs marchés mais aussi avec leur situation financière - qui peut être plus ou moins autonome de leurs positions de marché en fonction des comportements financiers des entreprises - est de plus en plus serré. Il tend à renouveler fondamentalement la nature du salaire.
A la limite, le salaire entendu comme la contrepartie de la mobilisation de son temps et de sa force par le salarié pourrait disparaître. On peut voir, à cet égard, dans les perspectives d'extension du nombre des « auto-entrepreneurs » une illustration de ce processus, nouveau « signal faible » (comme disent les prospectivistes) d'un avenir où le salariat aurait disparu au profit de l'agglomération d'auto-entrepreneurs définitivement dégagés de la relation stable avec l'entreprise que consacre le salariat.
Après tout, cette perspective ne serait pas sans rapport avec les phénomènes de restructurations d'entreprises au terme desquels certaines portions de l'entreprise intégrée sont séparées d'elle pour lui permettre d'accroître sa productivité, et, ce, en économisant des coûts rendus allégés par l'externalisation.
Quoi qu'il en soit, les salaires d'aujourd'hui ne peuvent plus être considérés comme ceux d'hier et la part salariale dans la valeur ajoutée comporte une proportion de plus en plus élevée des rémunérations qui s'apparentent à un prélèvement sur l'excédent brut d'exploitation c'est-à-dire dépendant de celui-ci ou de certaines de ses composantes .
Dans ces conditions, le constat d'une stabilité de la part salariale dans la valeur ajoutée est parfaitement compatible avec celui d'une réduction de la part des « salaires traditionnels » dans la valeur ajoutée.
Par ailleurs, compte tenu des inégalités salariales grandissantes, on doit observer que même dans l'hypothèse d'une stabilité globale de la répartition de la valeur ajoutée, des pans entiers du salariat ont connu une réduction de leurs « droits de tirage » sur la valeur ajoutée.
La question de l'équité de cette tendance et de ses effets sur la dynamique économique n'est pas une fausse question et le débat ouvert sur ce point par le Président de la République doit se poursuivre .
|
LE CAS PARTICULIER DES TRÈS HAUTS SALAIRES Parmi les salariés pour lesquels il existe une tendance à relier leurs rémunérations aux performances des firmes, qu'elles soient opérationnelles ou financières, figurent les salariés du sommet de la hiérarchie. Ils perçoivent les rémunérations les plus élevées et ces rémunérations se particularisent aussi comme celles ayant connu un rythme d'augmentation particulièrement soutenu. Les spécificités de la position salariale de ces salariés conduisent à s'interroger sur la notion même de certains éléments de leur rémunération . S'agit-il encore de salaires ou doit-on évoquer des prélèvements sur les résultats des entreprises ? Les « stock-options » sont exclues du champ des salaires défini par la comptabilité nationale mais cette exclusion suffit-elle à circonscrire le champ des salaires ? Cette question a un aspect un peu conventionnel mais elle traduit l'existence du problème de fond abordé ci-dessus quant à la nature du salaire et elle est légitime compte tenu de la singularité des dynamiques salariales de la population en cause. Au demeurant, celle-ci est si forte que, selon qu'on inclut ses rémunérations dans la masse salariale ou non, le profil d'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée varie parfois du tout au tout. Ainsi, pour les Etats-Unis, une exclusion du 1 % des salariés percevant les plus hauts salaires conduit à passer du constat d'une relative stabilité de la part des salaires dans la valeur ajoutée à celui d'une baisse prononcée de cette part. LA PART SALARIALE AUX ÉTATS-UNIS (1970-2005)
Source : La revue de l'IRES n° 64 - 2010/1 |
2. Comment traiter l'intéressement et la participation ?
Dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, le traitement de l'intéressement et de la participation pose un problème .
Si les « stock options » ne sont pas comptabilisés dans les rémunérations salariales 49 ( * ) , en revanche , l'intéressement et la participation des salariés sont inclus dans les salaires et traitements bruts et contribuent ainsi à déterminer la répartition de la valeur ajoutée en abondant la part présumée « revenir » aux salaires .
Or, l'inclusion des versements au titre de l'intéressement et de la participation dans les éléments pris pour apprécier le montant relatif des salaires et des profits pose un problème de méthode qui est aussi un problème de principe .
On relèvera qu'en comptabilité d'entreprise, la participation des salariés est enregistrée dans le compte de répartition du revenu comme une répartition de l'excédent d'exploitation. Par ailleurs, si la comptabilité nationale réintègre ces sommes aux salaires, elle ne suit pas cette règle s'agissant des jetons de présence versés aux salariés membres des organes sociaux. Ils sont prélevés sur l'EBE.
Ces deux conventions différentes peuvent s'appuyer sur des justifications propres.
D'un côté , il paraît peu contestable que, ces mécanismes produisant des avantages financiers au profit des salariés qui en bénéficient, ils puissent être assimilés à une mécanique d'affectation de la valeur ajoutée aux salariés. En outre, on estime parfois qu'il existe une forme de substituabilité entre salaires et participation. Celle-ci ne serait en fait qu'une forme plus flexible de rémunération salariale 50 ( * ) . Ainsi, le choix de rattacher la participation et l'intéressement à la masse des rémunérations salariales n'est pas dénué de tout fondement.
D'un autre côté , les primes de participation et d'intéressement n'ont généralement pas les caractéristiques d'un salaire : elles sont variables et non fixes ; elles ne sont pas disponibles sans conditions. Surtout, elles ne sont pas directement la contrepartie du travail salarié mais dépendent d'un statut de salarié qu'elles font évoluer dans le sens d'un détenteur du capital ou d'une créance sur les entreprises dont la valeur dépend des primes et de leur rendement financier, c'est-à-dire, en première approximation, du profit des entreprises.
Dans le cadre de l'intéressement et de la participation, tout se passe comme si ses bénéficiaires étaient, non pas des salariés mais bien des propriétaires du capital des entreprises, c'est-à-dire des actionnaires . A ces deux titres, c'est bien une part des profits qui leur est versée.
En complément, on remarquera que, du moins sur un plan comptable 51 ( * ) , les versements de participation et d'intéressement sont d'autant plus importants que les progrès de productivité profitent moins aux salaires et davantage au profit.
Comme le relève le Centre d'analyse stratégique, dans la lignée des suggestions de Weitzman selon lequel « le partage des profits assuré dans le cadre de l'intéressement et de la participation serait avant tout un outil de flexibilité salariale » , « les analyses du lien entre partage collectif des bénéfices et évolution des salaires réalisées sur la France semblent indiquer que ces dispositifs s'accompagnent de hausses du salaire de base moins rapides que dans les entreprises qui n'en proposent pas, favorisant ainsi la modération salariale » . Ainsi, « l'introduction d'une part variable dans les rémunérations, à partir du profit net de l'entreprise, pourrait se traduire davantage par un changement de structure de la rémunération des salariés et entre salariés (i.e. hausse du variable au détriment du fixe et répartition différente de cette part variable) que par une hausse de la part globale de la valeur ajoutée qui leur revient ».
De tout ceci, il résulte que la convention de la Comptabilité nationale de classer les versements au titre de l'intéressement et de la participation comme des éléments de rémunération du travail peut apparaître discutable .
Les fonds collectés au titre de ces deux régimes sont gérés dans le cadre de mécanismes dits « d'épargne salariale » comprenant, outre des comptes bloqués, des « Plans d'épargne Entreprise » (PEE), le Plan partenarial d'épargne salariale volontaire, aujourd'hui remplacé par le PERCO (plan d'épargne retraite collectif),...
En 1991 , le montant des versements constitués dans le cadre de l'intéressement et de la participation s'élevait à 3,3 milliards d'euros, soit 0,5 % de la valeur ajoutée des sociétés non financières et des sociétés financières . En 2006 , ces versements atteignaient : 7,1 milliards d'euros pour la participation ; 6,4 milliards d'euros pour l'intéressement et 1,3 milliard d'euros pour l'abondement supplémentaire des PEE, soit, au total, 14,9 milliards d'euros et 1,5 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises financières et non financières.
A partir de ces données, on peut estimer que l'inclusion de l'intéressement et de la participation dans la part salariale de la valeur ajoutée revient à masquer une baisse supplémentaire de 1 point de la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Cependant il faut garder à l'esprit que, du fait de la substituabilité entre l'intéressement-participation et les salaires directs, ce raisonnement ne peut être accueilli sans nuances. Sans l'essor de l'intéressement et de la participation, il est probable que les composantes plus traditionnelles de la rémunération du travail auraient connu des dynamiques différentes.
S'il est donc délicat de décider quel traitement comptable de l'intéressement et de la participation est le plus adapté, il n'est pas douteux que l'intéressement et la participation représentent une modalité de flexibilisation de la masse salariale et, plus encore, de modération salariale. Dans ces conditions, il est sans doute artificiel d'assimiler ces deux mécanismes à des salaires ordinaires. Cette assimilation revient en effet à neutraliser une partie des effets de la modération salariale sur la part de la valeur ajoutée revenant au travail .
3. Les questions posées par l'économie souterraine
L'évaluation précise du niveau du PIB est devenue lourde d'enjeux concrets à partir du moment où celle-ci a été utilisé dans le système de financement du budget européen.
Il est alors devenu plus nécessaire que jamais de corriger les données recensées pour prendre en compte l'économie parallèle.
Les redressements effectués pour tenir compte de l'économie souterraine ont pour effet d'augmenter le PIB mais aussi l'excédent brut d'exploitation puisque la totalité du supplément de valeur ajoutée dû à la prise en considération de l'économie souterraine est comptée comme tel.
Cette solution radicale conduit sans doute à exagérer la part des profits dans la valeur ajoutée 52 ( * ) puisqu'aussi bien une partie de l'économie souterraine doit être consacrée aux salaires 53 ( * ) .
Mais, cet effet est de second ordre par rapport aux effets d'une non-correction ou d'une correction insuffisante des phénomènes d'économie souterraine qui, de leur côté, entrainent une sous-estimation de l'excédent brut d'exploitation.
En effet, il est raisonnable de penser que plus un pays connaît une extension de l'économie souterraine plus le partage de la valeur ajoutée déductible des données de la comptabilité nationale (non corrigées pour tenir compte de ce phénomène) exagère la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Les corrections apportées par la comptabilité nationale tendent à remédier à cet effet optique. Mais, on ne sait dans quelle mesure elles sont suffisantes pour donner une image fidèle de la réalité. L'ampleur de la correction n'est pas connaissable aisément ni a fortiori sa représentativité par rapport au phénomène réel (par nature, mal connu).
Plus les corrections s'éloignent du phénomène concret, plus se trouve minoré l'excédent brut d'exploitation des agents par rapport à ce qu'il est dans les faits.
*
* *
On peut avancer l'hypothèse que l'ampleur de l'économie souterraine varie dans le temps et selon les pays ainsi que le taux de correction apportée au PIB si bien que les niveaux de valeur ajoutée identifiés par la comptabilité nationale et la répartition de celle-ci entre salaires et profits ne doivent être considérés que comme des approximations plus ou moins fidèles. Il en va de même des évolutions qui sont retracées en ces domaines .
4. Les conditions de financement de la protection sociale
La part des salaires dans la valeur ajoutée est appréhendée à partir d'une notion extensive des salaires qui comprennent les cotisations sociales dues par les employeurs et les salariés 54 ( * ) .
On peut se demander si cette convention n'aboutit pas à créer un écart entre la perception que peuvent retirer les salariés de leur situation salariale et celle que mesure l'indicateur de répartition de la valeur ajoutée.
a) Une part salariale qui comporte de moins en moins de salaires directs ce qui renforce probablement la perception d'une érosion du pouvoir d'achat
A ce sujet, il faut insister, d'abord et avant tout, sur la nature de salaires différés des cotisations sociales. En ce qui concerne les salariés, les cotisations sont souvent jugées équivalentes à des salaires dont la perception est différée dans le temps, par exemple, pour les pensions, reportée à l'âge de prise de la retraite. En outre, en ce qui concerne les employeurs, il est évident qu'elles représentent un élément du coût du travail.
D'un autre côté, une partie des prélèvements sociaux pris en compte pour mesurer la part des salaires dans la valeur ajoutée peut ne pas déboucher sur des gratifications profitant réellement aux salariés.
A part les accidents individuels (le fait de n'être jamais malade ou de décéder avant le bénéfice d'une retraite), cette situation peut se produire dès lors que les prélèvements supportés par les salariés financent des prestations versées finalement à des non salariés, situation qui n'est pas exclue, même dans le système éclaté de sécurité sociale qui a cours en France.
Ainsi, le traitement des cotisations sociales comme salaires différés n'est pratiquement justifié que sous la condition qu'elles soient réellement restituées aux salariés qui les supportent. Or si, dans le cadre de systèmes sociaux strictement bismarckiens (soit des systèmes où les prestations sont conditionnées aux cotisations), une telle correspondance est assurée tel n'est pas le cas dans les systèmes sociaux marqués par une conception plus solidariste.
Il ne serait pas anormal de considérer que les cotisations sociales (et autres prélèvements de même nature) destinées à financer des droits sociaux non contributifs soient ôtées du numérateur du rapport des salaires dans la valeur rajoutée. Il est possible que cette correction n'ait pas d'effets considérables au niveau de l'ensemble de l'économie mais peut-être n'en irait-il pas de même, si ses effets devaient être appréhendés secteur par secteur.
Par ailleurs, l'agrégation des salaires directs et des salaires différés peut être vue comme un mélange de « créances » aux valeurs différentes : les salaires directs sont acquis alors que la valeur des salaires différés n'est que conditionnelle à certains événements personnels mais aussi et surtout aux équilibres financiers des régimes sociaux qui peuvent être remis en cause.
Ces remarques peuvent être étendues, dans une certaine mesure, aux salaires directs puisque ceux-ci incluent implicitement des prélèvements dont la destination n'est pas nécessairement « fléchée » vers les salariés eux-mêmes 55 ( * ) .
Même s'il ne doit pas être mal interprété, un constat s'impose : la part des salaires dans la valeur ajoutée comporte de moins en moins de salaires directs dans les pays où la protection sociale est collective .
Au total, on peut donc dire, dans ces conditions, que la présentation des indicateurs usuels de partage de la valeur ajoutée comme étant censés ne restituer que le seul partage primaire du revenu (car excluant la prise en compte des processus de redistribution secondaire passant par les prélèvements obligatoires sur les revenus primaires et leur affectation) n'est pas tout à fait exacte.
Une partie de la composante salariale correspond à des prélèvements (obligatoires ou volontaires parfois) sur les salaires qui ne peuvent être assimilés à des revenus salariaux que sous certaines conditions qui, en pratique, ne sont pas nécessairement remplies.
Si le choix d'inclure les cotisations sociales liées au salaire dans la part de la valeur ajoutée revenant aux salariés n'est donc pas dénué de justifications, il n'en pose pas moins un problème puisque ces cotisations ne sont par définition pas perçues par les salariés.
Ainsi, une fraction de la part de la valeur ajoutée revenant aux salariés n'est pas perçue par eux .
Or, cette fraction est de plus en plus importante à mesure que la part des cotisations sociales dans la masse salariale augmente.
Le graphique ci-dessous rend compte de cette augmentation en distinguant les cotisations des salariés et des employeurs.
COTISATIONS SOCIALES, Y COMPRIS CSG ET
CRDS,
EXPRIMÉES EN % DES SALAIRES SUPERBRUTS
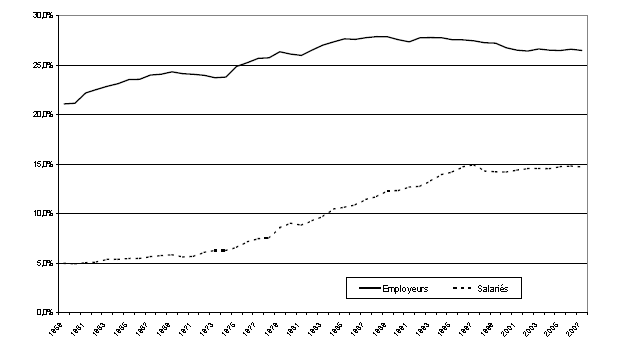
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », par M. Jean-Philippe COTIS. INSEE.
En 1959 les cotisations sociales représentaient 27 % des salaires superbruts 56 ( * ) . Cette proportion était passée à 30 % en 1975. Au milieu des années 90, elle était de 42 %.
En bref, une part de plus en plus importante de la valeur ajoutée imputée aux salaires est constituée d'éléments que les salariés ne perçoivent pas .
Le graphique ci-après figure les effets de l'augmentation des prélèvements obligatoires sur le travail sur la perception d'un écart entre les revenus d'activité perçus et la croissance économique.
VALEUR AJOUTÉE, PRODUCTIVITÉ APPARENTE DU
TRAVAIL ET SALAIRES PAR TÊTE
INDICES D'ÉVOLUATION EN EUROS
CONSTANTS, BASE 100 EN 1959
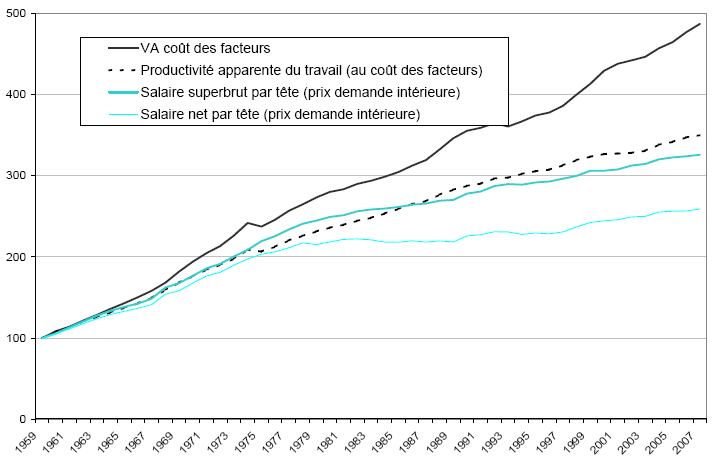
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », par M. Jean-Philippe COTIS. INSEE.
Depuis 1959, la valeur ajoutée a été multipliée par cinq. Le salaire superbrut par tête 57 ( * ) , après avoir augmenté parallèlement à la productivité apparente du travail, a connu une croissance plus rapide entre 1974 et le début des années 80. Puis, le différentiel s'est inversé, la productivité - pourtant en ralentissement - augmentant davantage que le salaire superbrut depuis .
Le décrochage est encore plus franc s'agissant du salaire net par tête en raison de la part grandissante des prélèvements sociaux. Ceux-ci ont augmenté plus vite que le salaire direct qui n'est supérieur en 2007 par rapport à 1959 que de 2,7 fois, soit à peu près deux fois moins que la valeur ajoutée.
b) Mais, une perception sans doute erronée, du moins en partie
Deux observations s'imposent toutefois .
•
Le différentiel de croissance entre
le salaire par tête et la valeur ajoutée est principalement le
résultat d'un ralentissement de la productivité individuelle du
travail.
Celle-ci a été compensée par une augmentation de la quantité de travail mobilisée pour produire mais sans que le chômage de masse ne recule durablement 58 ( * ) .
•
Les pays dans lesquels la protection
sociale est moins collective font souvent apparaître un salaire net plus
élevé et plus dynamique
(pas toujours car les
règles de la comptabilité nationale prévoient le recours
à des cotisations imputées pour mesurer le poids de certains
régimes sociaux privés). Mais, étant donné
l'homogénéité des préférences des individus
dans les pays de développements économiques comparables, ce
résultat doit être considéré comme assez largement
optique. En fait, si le salaire direct est alors plus élevé et/ou
plus dynamique, les utilisations du salaire consacrées à obtenir
des protections contre les risques, collectivement couverts dans les autres
pays, égalisent les situations réelles, aux mécanismes de
solidarité près mais aussi, en sens inverse, aux coûts des
protections près.
Sur ce dernier point, il est vraisemblable que le coût des assurances sociales est assez différencié selon les pays. Dans le domaine de la santé, la très grande diversité du niveau des dépenses qui y sont consacrées ne peut pas être expliquée par les seuls écarts dans les volumes consommés mais aussi par des différences de prix. De même, il est probable que les services collectifs d'éducation sont rendus à des coûts moins élevés que lorsque celle-ci est privatisée.
Dans l'hypothèse, assez réaliste, où cette situation se vérifierait, on peut en déduire que les entreprises reçoivent une subvention implicite qui leur permet de rémunérer moins leurs salariés dans les pays où l'ensemble protection sociale-santé est assurée collectivement .
D'un point de vue macroéconomique , une telle situation peut s'accompagner de processus qui viennent en neutraliser les effets au niveau du partage global de la valeur ajoutée :
- dans les pays où les protections sociales et les biens collectifs sont relativement développés, le taux de marge supplémentaire des entreprises non financières peut être compensé par le niveau relativement faible du taux de marge des administrations publiques et par un moindre développement des assurances ;
- inversement, il est logique de s'attendre à ce que du fait des taux de marge des producteurs privés de prestations privatisées, les entreprises des pays où la collectivisation est moindre soient conduites à réduire leur taux de marge puisqu'elles doivent payer des salaires plus élevés toutes choses égales par ailleurs.
Ainsi, si, globalement, le partage de la valeur ajoutée peut être indifférent aux conditions institutionnelles qui prévalent, ce n'est nécessairement pas le cas quand on se concentre sur un secteur de l'économie .
Dans ces conditions, les comparaisons dans le temps et entre pays, dont on a déjà indiqué quelques limites, peuvent être vues comme fragilisées par la diversité des structures économiques .
Par ailleurs, on doit relever que ces différences structurelles conduisent à constater que, même à niveaux de salaire comparables, il n'existe pas de concordance stricte entre le niveau relatif des salaires versés par les entreprises et le niveau de vie des salariés qui peuvent accéder à des quantités de biens très variables en fonction des prix pratiqués dans l'économie.
5. De quelques problèmes comptables résultant de règles d'enregistrement des opérations en comptabilité nationale
Enfin, il est possible que la valeur des indicateurs du partage de la valeur ajoutée soit influencée par les conditions de la répartition secondaire des revenus par d'autres biais, plus comptables.
L'organisation de la protection sociale est diversifiée et ne passe pas toujours par l'intervention d'administrations publiques. Théoriquement, tous les avantages sociaux consentis aux salariés sont enregistrés en charges imputés au travail à travers le calcul de cotisations qu'elles soient effectives ou imputées.
Mais, les conditions de calcul de ces deux catégories de cotisations sont différentes. Dans le cas des cotisations effectives, le calcul est assez simple. Ces cotisations sont enregistrées dès que l'obligation en est constatée et dans les termes légaux ou conventionnels en vigueur. Une remarque doit être faite à ce propos. La règle d'enregistrement en droits constatés conduit à écarter les effets des variations des taux de recouvrement . Dans les faits, ceux-ci sont sans doute généralement plutôt stables. Mais, à l'occasion des fluctuations économiques, notamment dans des crises aigües comme celle qui est en cours, on peut devoir constater de fortes évolutions des taux de recouvrement que ne permettent pas de retracer la règle d'enregistrement comptable appliquée.
En pratique, en cas de forte chute du taux de recouvrement des cotisations sociales, l'évaluation de la répartition de la valeur ajoutée « sur-pondère » sans doute la part salariale et minimise la résistance du taux de marge des entreprises.
S'agissant des cotisations imputées, elles résultent d'un calcul particulièrement complexe puisque les comptables nationaux sont censés les évaluer non seulement à la valeur des prestations servies au moment de l'évaluation mais encore en projetant les besoins financiers qu'implique dans le futur la dynamique des prestations.
On n'a pas pu estimer dans quelle mesure cette règle est appliquée. Mais puisque les cotisations effectives et les cotisations imputées obéissent à des conventions de calcul différentes, cette différence devrait se traduire théoriquement, par un niveau de la part des salaires dans la valeur ajoutée plus élevé dans les pays où les systèmes sociaux sont gérés par des régimes sans constitution de réserves 59 ( * ) .
Pour autant, comme pour tous les éléments comptabilisés sur la base de calcul :
- il est possible que les calculs ne soient pas exacts ;
- et, surtout, l'on ne peut négliger qu'il existe un écart entre le calcul et les flux effectifs.
Ainsi, une part de ce qui est compté en salaires peut ne pas avoir d'équivalents concrets.
*
* *
La plupart des observations qu'inspire la méthode de suivi du partage de la valeur ajoutée dans les termes de la comptabilité nationale vont dans le sens d'une surestimation de la part des salaires dans la valeur ajoutée et d'une sous-estimation de celle revenant au capital par les indicateurs usuels .
C'est en ayant présentes à l'esprit ces réserves qu'il convient d'examiner les évolutions du partage de la valeur ajoutée telles qu'identifiées par la comptabilité nationale, d'autant que les principales limites des indicateurs utilisés trouvent leur origine dans les difficultés de la comptabilité nationale à suivre les richesses créées dans le contexte d'une économie globalisée et financiarisée, deux phénomènes qui n'ont cessé d'accroître leur prégnance depuis 1975.
CHAPITRE II - TENSIONS SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce faisant, l' équilibre antérieur consistant, du point de vue des salariés, en une certaine sécurité matérielle (protection des emplois, prévisibilité des rémunérations), moyennant une liberté réduite dans le travail (surveillance importante, peu d'initiative et carrières prévisibles), s'est dégradé .
Ces derniers contribuent à la formation d'une « couche de flexibilité » le plus souvent subie qui, conjuguée au chômage, rend inquiétantes les transitions professionnelles qu'exige pourtant l'adaptation permanente d'un appareil de production compétitif. Dans la période récente, en dépit de certaines évolutions du système de formation continue et de l'acclimatation théorique d'une « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » (GPEC) dans les grandes entreprises, l'« employabilité » prétendument recherchée est loin d'être garantie et de combler, en termes de sécurité, le vide creusé par le délitement de la carrière...
On assiste en effet, par delà une responsabilisation individuelle effective, basée sur les résultats, à une prolifération de contraintes de méthode, d'organisation ou administratives qui, jointes à des contraintes physiques qui évoluent plutôt qu'elles ne s'amoindrissent (troubles musculo-squelettiques), sont aussi de nature à engendrer un stress accru.
|
Une véritable « crise managériale » se serait faite jour, dont les suicides retentissants au sein de l'entreprise France Telecom ont à la fois constitué le révélateur et le symptôme le plus alarmant. Parmi les multiples exemples d'un constat réitéré par de nombreux observateurs, on peut lire ainsi, dans Le Monde 60 ( * ) : « il semble désormais établi que de nombreuses organisations sont devenues sources de stress et de souffrance , non seulement pour les opérationnels peu qualifiés mais aussi pour les ingénieurs et autres profils techniques, ainsi que pour le management intermédiaire ».
Le cas est-il aussi général ? Comment en serait-on arrivé là, et quel chemin pourrait désormais emprunter le management ?
Rappelons brièvement de quoi il s'agit.
Les « psychologues du travail » s'entendent à peu près sur le fait que la rémunération, utile pour fidéliser les salariés, ne permet pas de garantir l'implication du personnel, qui repose sur des ressorts différents. La menace de perdre son emploi, ou toute autre forme de contrainte, ne suffisent pas davantage à susciter un engagement authentique du personnel. Les salariés ont besoin d'être convaincus de la justification profonde , à la fois économique et morale , du travail qui leur est demandé.
Le « management » va répondre à ces objectifs d' implication du personnel , en mettant, dans un premier temps, l'accent sur la mobilisation des cadres. Une entreprise qui ne comblerait pas les aspirations des personnels chargés d'optimiser la production des « exécutants » se trouverait évidemment fragilisée. Aujourd'hui, la recherche d'un engagement maximal tend à s'étendre uniformément à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le management général se situe au confluent de la gestion des ressources humaines et de la stratégie d'entreprise. Bien que s'appuyant sur de nombreux exemples, on soulignera qu'il constitue une discipline normative , au sens où il opère un certain nombre de prescriptions destinées à optimiser le facteur humain dans l'entreprise. Si leur transcription dans les faits n'est pas garantie, la littérature correspondante n'en acclimate pas moins un ensemble de règles et de justifications de ces règles .
Or, toute règle , même tacite et non écrite, doit être acceptée pour produire tous ses effets sans être rejetée, dévoyée ou désagréablement subie. La justification des règles managériales et des contraintes qu'elles impliquent dans le quotidien des salariés, résident dans les avantages matériels ou moraux qu'elles procurent, susceptibles d'engendrer en retour une adhésion fructueuse à ces règles, gage de leur pleine efficacité.
Une lecture attentive de la littérature managériale et l'application qui peut en être faite dans l'entreprise offrent ainsi un angle d'exploration privilégié du pacte social dans l'entreprise, qui repose pour partie sur des usages consistant en un faisceau de droits et d'obligations dont la nécessité est largement intériorisée, et non exclusivement sur l'énoncé magistral de règles théoriques.
Au sein de l'entreprise, le « compromis fordiste », maintenu par la « technostructure » jusque dans les années quatre-vingt, a depuis été remis en cause, notamment par l'avènement de la « corporate governance » actionnariale , portant son lot de modifications concernant l'organisation du travail et les méthodes de management.
L'équilibre antérieur , qui consistait, du point de vue des salariés, en l'assurance d'une certaine sécurité matérielle moyennant une surveillance importante ainsi qu'une liberté d'initiative et de carrière relativement réduite , a été bouleversé .
S'acheminerait-on vers un nouvel équilibre , dont l'évolution des conditions et de l'organisation du travail seraient les principaux paramètres, qui ne se trouverait pas aussi favorable aux salariés -du moins à certains- que le précédent ?
I. MANAGEMENT, ORGANISATION ET RYTHME DU TRAVAIL ORIENTÉS PAR L'EXIGENCE D'UNE RENTABILITÉ ACCRUE
Il convient de porter un diagnostic sur le « malaise social » dans le monde du travail, qui attire en France l'attention de nombreux observateurs. Celui-ci conduit à déceler, derrière un discours managérial fédérateur, économiquement argumenté, des évolutions globales parfois peu lisibles. Certaines portent d'indéniables améliorations , mais aussi des mutations préjudiciables au bien-être des salariés , même si leurs effets sont contrastés (et opacifiés) en raison de la diversité des configurations rencontrées d'une entreprise à l'autre, et dont les statistiques disponibles (qui portent souvent sur des situations moyennes) rendent insuffisamment compte.
A. UN MANAGEMENT EN PHASE AVEC LA « CORPORATE GOVERNANCE » ACTIONNARIALE
Dans les entreprises d'une certaine taille, un nouveau modèle managérial s'est diffusé depuis les années quatre-vingt dix, dont les principales caractéristiques apparaissent globalement stabilisées depuis les années 2000.
Il se trouve en rupture avec le modèle qui prévalait alors, qui découlait du pouvoir de la « technostructure ».
|
L'AVÈNEMENT DE LA « TECHNOSTRUCTURE » Des années trente jusqu'à la fin des années soixante, un certain type d'entreprise incarne la modernité : celui de la grande industrie développant une production de masse , dont la croissance repose sur des économies d'échelle, la standardisation et l'organisation rationnelle du travail. Son succès ne repose plus sur un entrepreneur historique, possesseur du capital et sorte de « figure du père », qui prévalait dans les représentations antérieures, dans la mouvance de la révolution industrielle, mais sur des cadres dont la légitimité apparaît flagrante à la lumière des travaux d'un Henri Fayol 61 ( * ) , considéré comme un des fondateurs du management. L'entreprise s'appuie désormais sur ses directeurs ou gestionnaires -formant la « technostructure » mise en évidence par Galbraith - aux vastes pouvoirs 62 ( * ) sur un marché dont les techniques de « marketing » garantissent par ailleurs l'expansion. Dans cette entreprise, dont le gigantisme est la marque du succès, l'ossature est constituée par une hiérarchie pyramidale . Les salariés y bénéficient d'une planification rationnelle des carrières et aussi, pour les plus avancées d'entre elles, d'une prise en charge de certains aspects de la vie quotidienne , qu'il s'agisse de la formation, du logement ou même des vacances. Ce mouvement est accompagné 63 ( * ) par un droit du travail de plus en plus protecteur , quoique sans gain de pouvoir dans l'entreprise 64 ( * ) ou d'autonomie dans le travail. La psychologie du travail, avec la diffusion de la théorie des besoins (encadré suivant), soulignait par ailleurs l'importance de la sécurité pour que les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes. |
Cette orientation présentait une cohérence économique dans une situation de plein emploi où la fidélisation des salariés constituait un enjeu important pour les entreprises, tandis que de forts gains de productivité réalisés sur des marchés en expansion permettaient une progression des salaires conforme au modèle fordiste 65 ( * ) .
Dans un contexte désormais marqué par une concurrence internationale accrue et la diffusion d'une « corporate governance » actionnariale , le nouveau modèle tend à instaurer, sous la responsabilité des cadres de l'entreprise, une logique de projet de nature à impliquer l'ensemble du personnel, qui se superpose à la logique d'objectifs , qui tend alors à concerner jusqu'au personnel exécutant.
|
DE LA TECHNOSTRUCTURE À LA « CORPORATE GOVERNANCE » ACTIONNARIALE Jusqu'aux années quatre-vingt, la gestion des entreprises a d'abord été le fait de la « technostructure », constituée de « professionnels » engagés pour administrer les entreprises. Dans le mode de régulation fordiste, le contrôle effectif de l'entreprise n'est pas le fait des actionnaires, mais celui des dirigeants salariés. Cette situation s'est inversée au cours des années quatre-vingt-dix, ainsi que l'observe notamment Jean Gadrey qui, dans « Nouvelle Economie, nouveau mythe ? » 66 ( * ) , décrit le déplacement du pouvoir dans l'entreprise de la technostructure à celui des actionnaires. Au cours des années quatre-vingt-dix, la dérèglementation des marchés financiers favorise la montée en puissance des fonds de placements (fonds de retraite, fonds de performance et fonds mutuels). Cherchant à infléchir le partage de la valeur ajoutée en faveur des profits, ils acquièrent une telle influence sur les entreprises que la « corporate governance » donne désormais la primauté aux « shareholder » : il s'agit d'une gouvernance d'entreprise axée sur la satisfaction des besoins des actionnaires, donc sur le rendement des actions. |
Ce faisant, l'entreprise s'allège d'échelons hiérarchiques devenus inutiles et de ses fonctions support, volontiers externalisée, le recours au concept de « réseau » permettant alors d'expliquer plus complètement son fonctionnement. L'adoption de ce modèle managérial, parfois dénommé « modèle néo-managérial », est quelquefois dénommée « reengineering ».
1. Du cadre hiérarchique au « manager animateur »
Afin de redonner du lustre aux fonctions d'encadrement, de nouveaux modes de gestion sont acclimatés dès les années soixante-dix. Ils consistent essentiellement à rendre aux cadres l'autonomie qu'ils avaient perdue avec la croissance des structures et la multiplication des échelons hiérarchiques.
Selon les promoteurs de la gestion par objectifs, lorsque les projets ou les métiers se complexifient, il devient plus difficile de définir la manière de conduire l'activité et moins risqué de s'entendre sur des objectifs, en laissant aux cadres le soin de s'organiser pour parvenir à les remplir.
Ce processus est analogue à celui qui aboutit à la déconcentration de fonctions complexes peu maitrisables par le « centre ».
La direction par objectifs se trouvera au coeur de cette revalorisation fonctionnelle du métier de cadre . Jugé désormais sur la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, son avancement ne devrait plus, idéalement, être lié à son ancienneté, son obéissance, voire son diplôme ou ses relations.
|
PETER DRUCKER ET LA DPO (DIRECTION PAR OBJECTIFS) Peter Drucker est considéré comme le fondateur du management par objectifs. Son ouvrage fondamental, publié en 1954 , a pour titre « The Practice of Management » (« La pratique de la direction des entreprises »). Les idées qui y sont développées paraissent aujourd'hui relativement banales, alors qu'elles étaient profondément novatrices il y a un demi-siècle, ce qui atteste a posteriori du succès considérable de ce livre et surtout de l'ampleur des transformations historiques du management. Elles provoquèrent chez les employeurs américains des réactions telles que Drucker fut près de considérer qu'il n'avait pas d'avenir dans le management. Mais les Japonais leur réservèrent un accueil enthousiaste et puisèrent dans cet ouvrage nombre d'enseignements. Celui qui allait devenir « le pape du management » affirmait que les seuls facteurs qui font progresser une entreprise sont les hommes , leur capacité d'innovation et la façon dont ils organisent leurs relations de travail . Ce qui suppose de ne pas exiger des ouvriers qu'ils laissent leur intelligence au vestiaire lorsqu'ils entrent à l'usine, alors que c'était la position officielle, et défendue avec âpreté, des patrons et des leaders syndicaux américains des années cinquante. Dans sa discipline majeure, le management des organisations, les apports de Peter Drucker sont importants et durables. La DPO (Direction par objectifs) , qui l'a rendu célèbre, est encore appliquée dans la plupart des entreprises. De même, les organisations réellement décentralisées, qu'il a toujours défendues, restent l'idéal de nombreux « managers ». D'après un article de Marc Mousli paru dans le n° 258 d'Alternatives économiques (mai 2007) |
Pour autant, le fonctionnement hiérarchique n'est pas remis en cause, et l'usage ne s'instaure pas davantage de licencier des cadres qui, par exemple, seraient jugés inefficaces ou inutiles : le besoin de sécurité apparaît encore primordial.
Les rémunérations demeurent progressives dans le cadre d'une carrière au cours de laquelle leurs niveaux, déterminés sans considération de la productivité marginale de la personne, apparaîtrait souvent, selon les critères actuels, insuffisant en début de carrière et excessif en fin de carrière 67 ( * ) .
Au tournant des années quatre-vingt-dix , la hiérarchie dans l'entreprise fait l'objet d'une remise en cause plus globale que dans les années soixante, ne concernant plus seulement le management des cadres de l'entreprise mais s'étendant à l'ensemble de ses collaborateurs.
La hiérarchie se rapporte, dans une acception sociologique, à une logique de « domination » qui fait de moins en moins sens avec l'élévation générale du niveau d'éducation et la nécessaire implication professionnelle des salariés que requiert une logique de projet généralisée .
Dès lors, la vie de l'entreprise peut s'envisager comme la déclinaison d'une succession de projet (comme tendrait à se décliner, par ailleurs, la vie privée) dont les cadres sont chargés de la supervision.
En requérant, autant que possible selon les ressources internes et externes à l'entreprises, non pas des hommes stabilisés dans des structures, mais des « talents » sélectionnés, mobilisés et motivés pour chaque mission , cette logique favorise une qualité maximale au moindre coût , d'autant plus que les fonctions d'autorité formelle peuvent être, par ailleurs, délaissées ( infra ).
Mobile, créatif, généraliste et attentif aux hommes, le cadre, désormais « manager » (appellation réservée les trois décennies précédentes aux seuls cadres dirigeants), s'oppose alors aux cadres du passé, perçus comme hiérarchique, statutaires, conventionnels, cloisonnés et à la froide rationalité gestionnaire. La désignation de « cadre », en tant qu'elle se rattache à une vision arriérée l'entreprise, peu compatible avec une responsabilisation spontanée des employés, est alors délaissée.
Dans une logique de spécialisation, la rupture entre la figure du gestionnaire (le manager) et de l'expert (l'ingénieur) est par ailleurs consommée. A coté du manager, émerge en outre la profession de « coach », qui consiste à accompagner chacun dans le développement de son « potentiel ».
2. Un personnel émancipé et mobile, la consécration du « client roi »
Avec la crise économique de la seconde partie des années soixante-dix, le chômage bouleverse les rapports de force, tandis que la capacité des entreprises à répondre aux attentes financières des salariés s'amoindrit. L' amélioration des conditions de travail et l'« enrichissement des tâches » deviennent des objectifs portés par de nombreuses entreprises.
Le passage du fordisme au toyotisme dans l'industrie, au cours des années quatre-vingt, a accompagné ce mouvement (voir encadré infra ), tandis que le taylorisme originel, comme toute forme d'organisation reposant sur une planification , apparaît désormais comme une figure d'organisation dépassée .
Bientôt, la motivation du personnel devient inhérente au système de gouvernance, ce qui permet de lui faire confiance (mais conduit, en termes sociologique, à un « auto-contrôle » renforcé), ce qui est source d'économies importantes grâce à une augmentation de la productivité, les fonctions d'autorité formelle pouvant être délaissées .
Le passage d'un projet à un autre permet de revendiquer un processus d'accroissement de la liberté et de l' employabilité des membres de l'équipe. D'aucuns considèrent, en effet, que l'entreprise répond au besoin de sécurité -terme ayant d'ailleurs acquis une connotation moins positive, pour se rapporter à une conception statique et donc dépassée de l'entreprise- lorsque, à défaut de garantir l'emploi, elle accroît l'employabilité de ses collaborateurs. Dans cette optique, l' entreprise entend renforcer les capacités et l'adaptabilité de ses salariés en leur fournissant des expériences professionnelles variées et présentant une certaine difficulté.
La mobilité , vertu nécessaire, devient paradoxalement un gage de sécurité , puisqu'elle conditionne largement l'employabilité de la personne dans un « monde en réseau » ( infra ). Luc Boltanski et Eve Chiapello dans « Le nouvel esprit du capitalisme » 68 ( * ) notent ainsi que « c'est précisément parce que le projet est une forme transitoire qu'il est ajusté à un monde en réseau : la succession des projets en multipliant les connexions et en faisant proliférer les liens, a pour effet d'étendre les réseaux ».
Ce schéma entre en parfaite résonance avec le modèle économique libéral , qui promeut la disparition des barrières à l'embauche et au licenciement, afin de favoriser in fine l'activité économique et l'emploi.
Par ailleurs, la mise en avant généralisée de la satisfaction du client aboutit à transférer une partie du contrôle hiérarchique, renforçant l'« auto-contrôle » susmentionné.
Certains estimeront que cette attention -largement ostentatoire- portée au client, sur laquelle la publicité s'emploie à communiquer, parfois à renfort d'« enquêtes de satisfaction », a atteint un certain point de non-retour - et de réalité - depuis le développement de l'Internet où divers forums et lieux d'expression (hébergés ou non par le site du vendeur) permettent à la clientèle de diffuser des retours d'expérience ou des réclamations forgeant une « e-réputation » ayant un impact appréciable, reconnu et parfois géré par les entreprises, sur les intentions d'achat.
Quoi qu'il en soit, cette attention portée au client contribue à détourner l'attention d'un objectif central de l'entreprise, potentiellement source de conflictualité, tout en participant à sa réalisation : engendrer le meilleur revenu pour ses propriétaires ou actionnaires 69 ( * ) .
*
Au total, par les gains de productivité qu'elle veut susciter, la présente démarche managériale et d'« émancipation » du personnel s'avère cohérente avec l'exacerbation de la concurrence économique en lien avec la mondialisation et la primauté donnée aux actionnaires, en lieu et place de la « technostructure », dans le cadre d'une « corporate governance » en phase avec la « révolution néolibérale » 70 ( * ) .
Cette logique s'étend aux rémunérations , qui résultent de la productivité des salariés, des rapports entre l'offre et la demande sur le marché du travail ou du niveau du SMIC, et non plus d'une carrière prévisible en fonction du poste et du diplôme.
3. La métaphore du réseau
Dans « Le nouvel esprit du capitalisme » ( op. cit ), Luc Boltanski et Eve Chiapello ont mis en avant le concept transverse de « réseau » pour caractériser cette nouvelle organisation, qu'elle concerne les hommes ou les entreprises.
Des équipes réduites et pluridisciplinaires, orientées vers la plus grande satisfaction du client, se forment à l'occasion des projets successifs . Les « managers » sont les chefs de projets, coordinateurs experts dans l'art d'apparier les compétences et les hommes dans un but commun. Dès lors, la mobilisation des relations personnelles et les aptitudes relationnelles font l'objet d'une forte valorisation : le « savoir être » est autant valorisé que le savoir ou le « savoir faire ».
L'entreprise est désormais « allégée » , non seulement de quelques échelons hiérarchiques devenus inutiles, mais encore de fonctions extérieures au « coeur de métier » et considérées comme annexes. Autour d'elle, gravitent ainsi un réseau de fournisseurs, sous-traitants, entreprises alliées (joint ventures) et personnel intérimaire , sollicités en tant que de besoin au rythme de projets successifs.
Cette évolution est à la fois précipitée par la mondialisation , car elle permet à l'entreprise de se concentrer sur son avantage compétitif , en conservant les fonctions qui lui assurent une situation stratégique dans le réseau, et permise par la diffusion des NTIC qui diminuent les coûts de transaction. En particulier, l'introduction d'outils tels que l'ERP ( infra ) facilite ce type de pilotage , en imposant des standards aux filiales, avec lesquelles les échanges sont facilités (et en permettant réciproquement à certaines entreprises de proposer leurs services ou leurs productions à d'autres entreprises dans des conditions d'efficacité et de disponibilité optimales).
4. Chacun « entrepreneur de lui-même » ?
La logique de projet, de mobilité et d'employabilité, en rupture avec celle développée dans la théorie des besoins d'Abraham Maslow 71 ( * ) qui, auparavant, faisait autorité, doit être rapprochée d'une certaine littérature dévolue au « développement personnel » .
« L'entreprise de soi », ouvrage de Bob Aubrey 72 ( * ) - qui avait auparavant mené une réflexion fournie sur l'employabilité- ayant rencontré un large succès dans le milieu du coaching et du management, en fournit une illustration topique.
|
« L'ENTREPRISE DE SOI » L'entreprise de soi se fonde sur l'idée que l'individu « augmente sans cesse sa capacité à se connaître, à s'éduquer, à s'adapter aux contextes sociaux et à développer des stratégies de vie. En un mot : qu'il peut réellement être l'entrepreneur de sa vie ». Dans cette perspective, à la question « que vais-je faire ? » se substitue une autre, « comment vais-je atteindre mes objectifs ? » (qu'ils soient liés à la vie personnelle ou à l'activité professionnelle). Quelle que soit la conception de l'individu, on en revient finalement toujours au même constat : chacun de nous n'a d'autre choix que devenir son propre maître... Extrait d'un article de Gilles Marchand, revue « Sciences Humaines », hors-série n° 40 - mars/avril/mai 2003 |
L'« entreprise de soi », ou « Me Inc. », est en passe de devenir un objectif énoncé tel quel par de nombreux « coach », qui conseillent volontiers de « se gérer comme une entreprise ». Dans cette veine, s'inscrit la « marque personnelle », ou « personal branding », concept mobilisé depuis les années deux mille afin d'aider à construire et promouvoir son image dans une logique de marketing, aussi bien pour les consultants que pour les employés, afin d'optimiser sa propre trajectoire professionnelle. Ce type de démarche implique notamment de recourir à l'Internet et aux sites sociaux.
On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre ce mouvement d'idée et l'acclimatation du statut d'« autoentrepreneur », qui n'est d'ailleurs pas sans similitudes avec certaines innovations juridiques ayant eu lieu dans d'autres pays industrialisés.
Plus généralement, ce type de représentation se trouve en phase avec le mouvement d'externalisation et de réticulation observé auprès des entreprises, dont l'aboutissement ultime et théorique serait la disparition du squelette de l'entreprise, à laquelle succèderaient des entités mouvantes et informes apparaissant, évoluant et disparaissant à la faveur de projets économiques successifs, réunissant provisoirement des hommes dont l'engagement n'implique pas de lien de subordination, au bénéfice de la plus grande liberté contractuelle.
|
ÉMERGENCE, RÉTICULATION ET DISSOLUTION DE L'ENTREPRISE :
UNE GRILLE D'ANALYSE MICROÉCONOMIQUE AVEC LES
CONCEPTS
Ronald Coase , dans un article intitulé « The Nature of the Firm » (1937), s'est interrogé sur l'existence même de l'entreprise, dont la théorie économique néoclassique ne rend pas compte. En l'absence d'organisation préétablie, toute production implique un recours au marché engendrant divers coûts : coûts de recherche et d'information, de négociation (contrats) et de décision, enfin coût de surveillance (prestataires) et d'exécution. Lorsque ces coûts, liés à la coordination marchande, dépassent ceux liés à la coordination hiérarchique, le recours à l'« entreprise » s'avère rationnel. Dans les années soixante-dix, Oliver Williamson , formalise l'approche de Ronald Coase dans la théorie dite des « coûts de transaction ». Les agents économiques recourent au marché ou recherchent des arrangements institutionnels alternatifs afin de minimiser les coûts de production majorés des coûts de transaction . Entre le marché et l'entreprise, il identifie de nombreuses formes « hybrides » permettant cette optimisation, telles que la sous-traitance, la concession ou le réseau 73 ( * ) . En adoptant cette grille d'analyse, force est de constater que, dans la période récente, les coûts de transaction ont fortement diminué avec le développement d'Internet et des réseaux de communication . Don Tapscott et Anthony Williams, dans Wikinomics 74 ( * ) , en sont ainsi arrivés à prédire la disparition des hiérarchies d'entreprises et l'avènement de la « collaboration de masse » comme nouvelle forme d'organisation économique. Les entreprises tendant à rétrécir leur champ d'activité jusqu'à ce que les coûts de réalisation en interne ne dépassent plus les coûts de réalisation à l'extérieur, ils prévoient, à terme, la diffusion d'un mode de production collaboratif 75 ( * ) où des individus s'organisent temporairement sur une base égalitaire et mutualisent leurs efforts en vue d'un objectif commun. |
B. UN TRAVAIL INTENSIFIÉ
De la mesure de la productivité du travail aux enquêtes auprès des salariés sur l'organisation de leur travail et ses conditions, les thermomètres disponibles indiquent une intensification du travail concomitante à la diffusion de nouvelles méthodes de production et de management .
1. L'ancrage du productivisme toyotiste
a) Du Japon à l'Europe en passant par les Etats-Unis : l'incubation du toyotisme
Dans les années quatre-vingt, l'implantation aux Etats-Unis d'usines Toyota appliquant l'ohnisme (voir encadré infra ) a constitué auprès des salariés américains concernés une acculturation 76 ( * ) dont la réussite à surpris de nombreux observateurs. En effet, les performances de ces usines étaient similaires à celles implantées au Japon, la qualité des produits obtenus s'avérant, en conséquence, sans commune mesure avec celle des grands constructeurs généralistes nationaux.
|
LA DIVISION DU TRAVAIL, D'ADAM SMITH AU TOYOTISME La division du travail , théorisée par Adam Smith en 1776 et illustrée par le célèbre exemple de la manufacture d'épingles, s'est généralisée avec la révolution industrielle. Adam Smith y voyait un moyen d'enrichissement, la production croissant si les ouvriers sont spécialisés dans une seule opération. Le taylorisme A la suite d'Adam Smith, Frederick Winslow Taylor énonça au début du 20 ème siècle les principes d'une organisation scientifique du travail (OST) destinée à améliorer la productivité . Cette organisation opère non seulement une séparation entre les différentes tâches d'exécution ( division horizontale du travail), qui aboutit au travail à la chaîne (travail posté), mais encore une séparation entre la conception et l'exécution de la production ( division verticale ). L'ouvrier devient alors plus productif. Une critique fondamentale du système réside dans le constat que le travail devient plus aliénant et déresponsabilisant . Or, si le taylorisme s'est depuis transformé, il a toujours cours, non seulement sur certaines chaînes de production, mais encore dans les services, que l'on songe, par exemple, aux « call centers » ou aux fast-food. Le fordisme Henri Ford, s'inspirant largement des travaux de Taylor, généralise dans ses usines le travail à la chaîne qui impose les cadences et repose sur une parcellisation des activités ; parallèlement, la standardisation est poussée à l'extrême (un modèle unique : la Ford T de couleur noire), permettant la production en grande série ; en contrepartie, les ouvriers reçoivent un salaire supérieur aux moyennes observées dans l'industrie à l'époque (le « five dollars a day »). Cette hausse des rémunérations engendre de nouveaux débouchés pour la production . Le fordisme correspondra ainsi à une période de capitalisme social et l'on parle volontiers de « compromis fordiste » , reposant sur un partage de la valeur ajoutée avantageux pour les salariés , jusqu'aux années soixante-dix. De fait, dès la fin des années soixante, les salaires ont progressé plus vite que la productivité , favorisant l'accélération de l'inflation. Or, dans le contexte d'une concurrence accrue, notamment sur le plan international, les salaires pèsent sur les coûts de production et la compétitivité sans garantir, pour autant, de débouchés pour les productions nationales. La nécessité de rétablir les marges s'est bientôt faite sentir dans les pays industrialisés les plus avancés, pesant davantage sur l'évolution de la rémunération du travail, au point de remettre en cause de compromis fordiste. Le toyotisme Le toyotisme constitue un prolongement du taylorisme. Il s'agit d'une OST inventée par l'ingénieur Ohno -on parle indifféremment de toyotisme ou d' ohnisme- mise en place par Toyota autour des années cinquante, proposant de garder les mêmes objectifs de productivité que le taylorisme avec un renversement de perspective, l'« aval » -c'est-à-dire la demande - ayant désormais, seul, vocation à enclencher le processus de production , en lieu et place de l'« amont ». En conséquence, aucune fabrication ne peut commencer tant que le client ne l'a pas demandée. Largement diffusé au cours des années quatre-vingt, ce modèle apparaît adapté à un contexte d'internationalisation des échanges où la compétitivité-prix devient cruciale . Le toyotisme permet de répondre à la demande avec une flexibilité maximale, en produisant « juste à temps » avec le moins de stocks possible grâce à un personnel beaucoup plus polyvalent . Il met alors un terme à une certaine dévalorisation du travail liée à la généralisation des procédés tayloristes, qui se traduisait par un turn-over et un absentéisme important, des conflits ou des malfaçons, augmentant in fine les coûts. Le toyotisme se caractérise par l'observation du « principe des cinq zéros » :
A ces principes, s'ajoute celui de l'« autonomation de la production » (contraction des termes « autonomie » et « automatisation ») qui réside dans la capacité d'une machine à s'arrêter dès qu'elle rencontre un problème. La tâche de surveillance des machines se réduit et les ouvriers peuvent donc travailler sur plusieurs d'entre elles, ce qui améliore la productivité. Les ouvriers sont amenés à travailler en groupes semi-autonomes , organisant eux-mêmes leur production. Seul un objectif quantitatif est fixé par la hiérarchie, ce qui revient à abandonner partiellement le principe de division verticale du travail. De cet ensemble, il résulte que l'organisation est tournée sur les besoins de plus en plus différenciés des consommateurs . L' ouvrier , polyvalent et responsabilisé en termes de qualité , est davantage impliqué . La promotion continue et certaines formes de participation aux bénéfices établissent, par ailleurs, un lien de filiation entre fordisme et toyotisme. Si l'on prétend parfois que l'exigence de qualifications, de polyvalence, de responsabilisation propres au toyotisme ont amélioré le sort des ouvriers dans l'industrie par rapport à l'organisation taylorienne, d'aucuns critiquent la « surcharge mentale » (voir infra ) susceptible d'en découler. |
Ce succès a entrainé une diffusion accélérée des méthodes toyotistes , si bien qu'au début des années quatre-vingt-dix , environ les deux tiers de l' industrie américaine avaient connu un processus de réorganisation s'apparentant au toyotisme.
Les principes du « juste à temps » et du travail en équipes autonomes se sont diffusés à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein des entreprises du secteur tertiaire , aux Etats-Unis d'abord, puis, une décennie plus tard, en Europe , où la flexibilité du travail a apporté une contribution particulière à la diffusion du modèle, améliorant de façon substantielle le « juste à temps ».
Le potentiel de l'informatique pour les innovations organisationnelles a débouché sur une diffusion concomitante des TIC -créatrices d'un vaste marché- et de la « lean production » (mot à mot « production allégée », mais on parle généralement de « production au plus juste »), qui constitue un toyotisme « naturalisé » et approfondi aux Etats-Unis.
De fait, les TIC facilitent la diffusion de normes de production et de qualité dans la perspective d'une « qualité totale », ainsi que la certification de sous-traitants qui permet « de structurer la production et de réduire l'incertitude sur les fournisseurs jusqu'au consommateur final » 77 ( * ) .
Les TIC autorisent encore une forte réactivité face aux attentes du consommateur, suscitant un « sur-mesure de masse » (« mass-customisation ») ainsi qu'un renouvellement accéléré de l'offre (cf. l'exemple de la marque de vêtements Zara).
Enfin, il semble réciproquement que, sans réorganisation du travail « au plus juste », le recours aux TIC tende à peser sur la productivité, plutôt qu'à l'améliorer 78 ( * ) .
b) L'acclimatation incertaine des formes d'« organisation apprenante »
Dans les pays scandinaves , l'organisation de la production a suivi un modèle, dit modèle sociotechnique suédois (encore qualifié d'Uddevalisme, du nom de l'usine Volvo où elle a été initiée), légèrement différent de celui de la « lean production », fondé sur le principe d'équipes véritablement autonomes qui s'auto-organisent pour réaliser les objectifs établis avec la hiérarchie. Les entreprises s'inspirant de cette forme d'organisation sont aujourd'hui qualifiées d'« entreprises apprenantes ».
D'après la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, en 2005, « les indicateurs relatifs au contenu et à la nature du travail fournissent une vue d'ensemble positive », la plupart des travailleurs européens étant chargés d'évaluer eux-mêmes la qualité de leur travail (73 %) et de régler eux-mêmes les problèmes imprévus (81 %), tandis que, pour une majorité d'Européens, le travail implique de nouveaux apprentissages (70 %). Seuls 43 % des travailleurs européens estiment que leur travail implique des tâches monotones.
Mais, outre les problèmes classiques que posent les enquêtes d'opinion en termes de fiabilité des résultats, « si l'on se penche sur l'évolution de ces indicateurs [de 1995 à 2005] , le bilan n'est pas si positif : on observe une réduction lente, mais nette de la part des emplois impliquant une auto-évaluation de la qualité, le règlement des problèmes imprévus et de nouveaux apprentissage s (dans les trois cas, la réduction est de près de 5 %) ».
Corrélativement, les niveaux d'autonomie des salariés semblent avoir diminué de 1995 à 2005 :
PROPORTION DES SALARIÉS DÉCLARANT POUVOIR
CHOISIR OU MODIFIER
LES MODALITÉS DE LEUR TRAVAIL
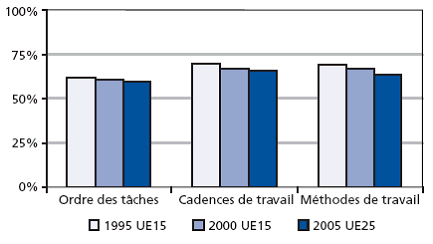
Source : quatrième enquête européenne sur les conditions de travail de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
En conséquence, les principes de l'« organisation apprenante » ne semblent pas se généraliser au détriment de la production « au plus juste » dans la période récente.
|
QUELLES MÉTHODES DE PRODUCTION AUJOURD'HUI ? M. Edward Lorenz a dessiné les contours des configurations dominantes d'organisation du travail à partir de la troisième enquête européenne 79 ( * ) sur les conditions de travail. A partir de quinze variables 80 ( * ) reposant sur les déclarations des salariés des établissements d'au moins dix personnes du secteur marchand, il aboutit à une classification des principales formes d'organisation du travail en Europe en quatre classes distinctes. Elles se rattachent, par leurs caractéristiques respectives, à des modèles types couramment mentionnés dans la littérature : les organisations « apprenantes », les organisations « au plus juste », les organisations tayloriennes et les organisations de « structure simple ». Les deux premiers correspondent à des formes « modernes » d'organisation du travail, les deux derniers aux formes « anciennes ». Les organisations du travail « apprenantes » Les salariés y disposent d'une forte autonomie dans le travail, autocontrôlent la qualité de leur travail et rencontrent fréquemment des situations d'apprentissage et de résolution de problèmes imprévus. Ils sont relativement nombreux à travailler en équipe. Ils exercent le plus souvent des tâches complexes, non monotones et non répétitives et subissent peu de contraintes de rythme. Cette classe s'apparente au modèle sociotechnique suédois , fondé sur le principe d'équipes autonomes qui s'auto-organisent pour réaliser les objectifs établis avec la hiérarchie. Les organisations du travail « au plus juste » Cette catégorie présente une forte diffusion du travail en équipe, de la rotation des tâches et de la gestion de la qualité (autocontrôle de la qualité et respect de normes de qualité précises). Elle correspond typiquement au modèle de la « production au plus juste » (« lean production »), en filiation directe du toyotisme ( supra ) , qui combine travail en groupe, polyvalence, qualité totale et flux tendus (Womack et al., 1990). Simultanément, les salariés se voient imposer des contraintes de rythme particulièrement lourdes et exécutent des tâches souvent répétitives et monotones. Si, comme dans les organisations apprenantes, ils sont souvent confrontés à des situations d'apprentissage et de résolution de problèmes imprévus, ils bénéficient en revanche de bien moindres marges d'autonomie dans leur travail. Cette autonomie modérée s'exerce sous de fortes contraintes de rythme et de normes de qualité. Il s'agit donc d'une « autonomie contrôlée » que les employeurs suscitent pour concilier contrôle managérial et mobilisation de l'initiative et de la créativité des salariés. Les organisations du travail tayloriennes Cette catégorie s'oppose dans une large mesure à celle des organisations apprenantes. Comme dans les organisations au plus juste, les individus sont soumis à d'importantes contraintes de rythme, effectuent des tâches répétitives et monotones et sont astreints à des normes de qualité précises. Mais, contrairement à la classe précédente, leur travail présente une faible autonomie, un faible contenu cognitif et l'autocontrôle de la qualité y est peu répandu. Cette classe relève du modèle taylorien d'organisation du travail, dans ses formes classiques, mais aussi dans ses formes assouplies en « taylorisme flexible » (Boyer, Durand, 1993), comme le suggère la fréquence relative des pratiques de rotation des tâches. Les organisations du travail de structure simple Elles tendent à s'opposer aux organisations au plus juste. Le travail en équipe, la rotation des tâches et la gestion de la qualité y sont peu diffusés. Le travail y est peu contraint dans ses rythmes et peu répétitif, mais relativement monotone et à faible contenu cognitif. La catégorie des organisations de « structure simple » (Mintzberg, 1982) a été définie par une faible formalisation des procédures et un mode de contrôle par supervision directe. Source : d'après Centre d'études de l'emploi, Connaissance de l'emploi n°13, mars 2005, « Les nouvelles formes d'organisation du travail en Europe » |
Dans une approche comparative, la France demeurerait cependant l'un des pays, après ceux de l'Europe du nord, où les organisations apprenantes constituent le quotidien d'une proportion relativement importante de salariés .
PARTITION DES ORGANISATIONS DANS QUELQUES PAYS D'EUROPE
(en % des salariés concernés)
|
Organisation « apprenante » |
Organisation « au plus juste » |
Organisation taylorienne |
Organisation simple |
|
|
France |
47 % |
25 % |
18 % |
11 % |
|
Allemagne |
43 % |
20 % |
18 % |
19 % |
|
Royaume-Uni |
30 % |
33 % |
17 % |
20 % |
|
Espagne |
21 % |
25 % |
26 % |
28 % |
|
Italie |
38 % |
24 % |
21 % |
16 % |
|
Danemark |
54 % |
28 % |
8 % |
10 % |
|
Suède |
67 % |
15 % |
7 % |
11 % |
|
UE à 27 |
38 % |
26 % |
19 % |
17 % |
Champ : salariés d'établissements d'au moins 10 personnes dans les secteurs d'activités économiques à dominante marchande et non agricoles ou domestiques.
Source : Learning organisations - the importance of work organisation for innovation, par Nathalie Greenan et Edward Lorenz, 2010.
Si ces chiffres apportent une information utile pour les comparaisons internationales, ils ont une moindre valeur intrinsèque. Ils reposent en effet sur des statistiques faisant l'impasse sur les structures de moins de 10 salariés ou agricoles, qui correspondent potentiellement à des types d'organisation généralement moins « avancés » que ceux des entreprises plus importantes.
En France, plus de 20 % des salariés travaillent pour des entreprises de moins de 10 salariés, où l'on peut raisonnablement présumer que les « organisations simples » sont, par exemple, plus répandues que les « organisations apprenantes ».
Ainsi, on ne saurait conclure du tableau ci-dessus que près de la moitié des français et plus du tiers des salariés européens travailleraient dans des « organisations apprenantes ».
2. Le constat d'un travail plus intensif et plus flexible
L'hypothèse d'un accroissement des difficultés rencontrées par les salariés dans l'entreprise n'est pas contredite par l'évolution de l'intensité du travail qu'ils ressentent, en constante augmentation sur la période 1991-2005.
ÉVOLUTION DE L'INTENSITÉ DU
TRAVAIL
81
(
*
)
UNION EUROPÉENNE À 15,
1991-2005 (%)
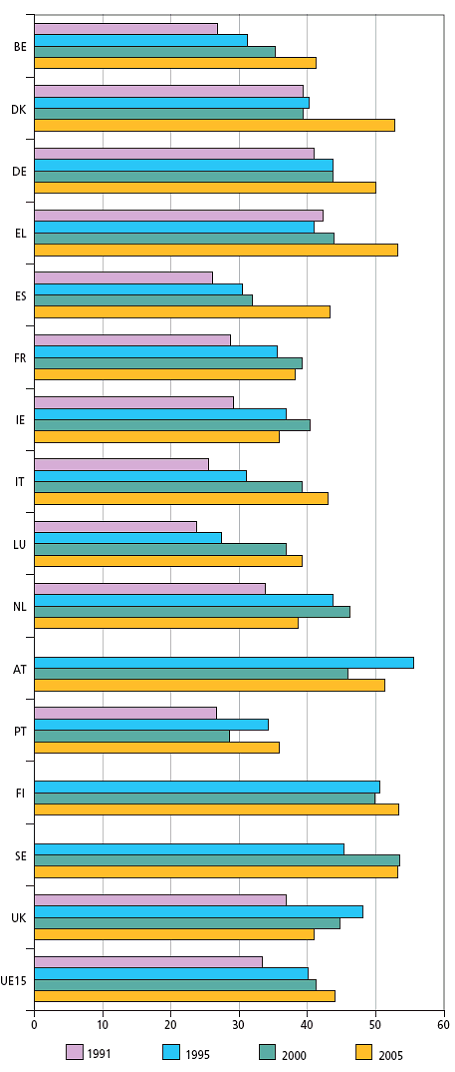
Abréviations : DE : Allemagne ; AT :
Autriche ; BE : Belgique ; DK : Danemark ;
ES : Espagne ; FI : Finlande ; FR : France ;
EL : Grèce ; IE : Irlande ;
IT : Italie ; LU :
Luxembourg ;
NL : Pays-Bas ; PT : Portugal ; UK Royaume-Uni ; SE
Suède.
Source : quatrième enquête européenne sur les conditions de travail de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
De 1991 à 2005, l'intensité semble progresser dans une mesure équivalente - l'indicateur augmente d'un peu plus de 10 points - en France comme dans l'Europe à 15 .
Parallèlement, la flexibilité des horaires , quoiqu'encore largement minoritaire, gagne du terrain , la proportion de salariés ayant des horaires fixes étant passée de 70 % à 67 % ces dix dernières années.
PROPORTION DE SALARIÉS AYANT DES HORAIRES FIXES
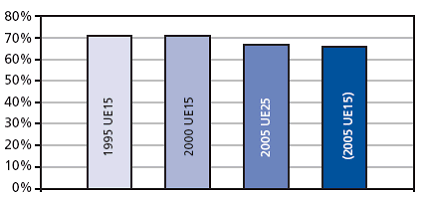
Source : quatrième enquête européenne sur les conditions de travail de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Encore, les indications sur la flexibilité sont-elles fondamentalement ambigües ; ainsi l'IRES 82 ( * ) parle-t-il d'« une flexibilité plus souvent conçue en France comme une réponse aux besoins de l'entreprise (...), alors que dans d'autres pays, elle aménage davantage les contraintes de travail dans un sens favorable à la vie familiale ». Les conditions de la mise en place des « 35 heures » en France ( infra ) peuvent expliquer cette perception.
3. Une productivité du travail notablement élevée en France
Au tournant des années deux-mille, la France a beaucoup réduit son temps de travail à la faveur des « 35 heures ». Elles se sont accompagnées d'une flexibilité accrue ainsi que d'une certaine intensification du travail, dont il était d'ailleurs prévu qu'elles contribuent, en partie, au financement de la réduction du temps de travail grâce aux gains de productivité suscités.
DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE D'UN EMPLOI SALARIÉ À TEMPS PLEIN EN FRANCE
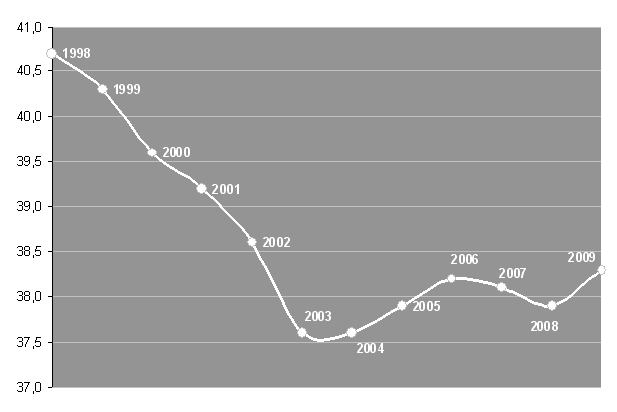
Sources : Eurostat, Service des études économiques du Sénat
Par la suite, du fait d'assouplissements successifs, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour un emploi à temps plein s'est légèrement allongée. Cela peut contribuer à expliquer, sur le graphe « ÉVOLUTION DE L'INTENSITÉ DU TRAVAIL » ( supra ), le décalage français avec la tendance européenne 83 ( * ) .
D'une façon générale, la productivité horaire du travail est particulièrement forte en France . Son évolution comparée avec celle de ses principaux partenaires sur la période récente montre que ce particularisme s'accentuerait, le différentiel de productivité vis-à-vis de la moyenne des pays de l'Union européenne à 15 s'étant plutôt creusé sur la période 1997-2007 :
PRODUCTIVITÉ DE LA MAIN D'oeUVRE PAR HEURE DE TRAVAIL
Différentiel vis-à-vis de l'UE à 15 (base 100 sur la période 1997-2007)
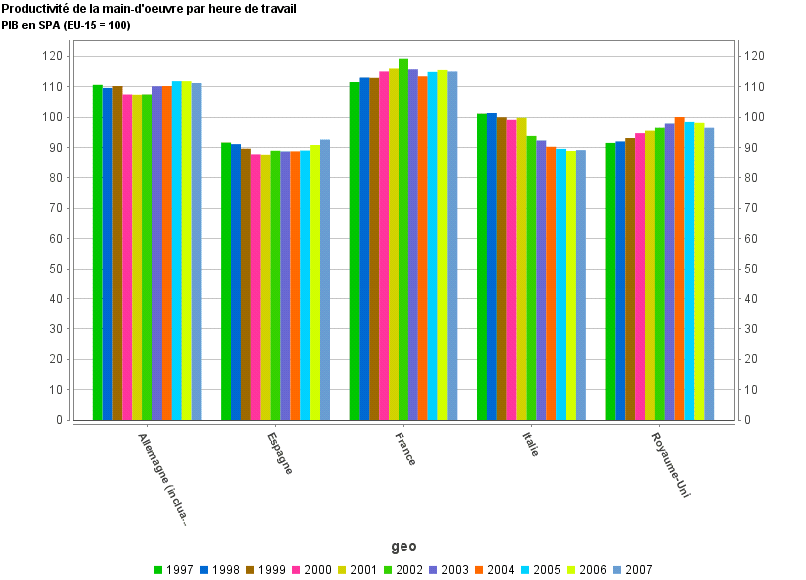
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
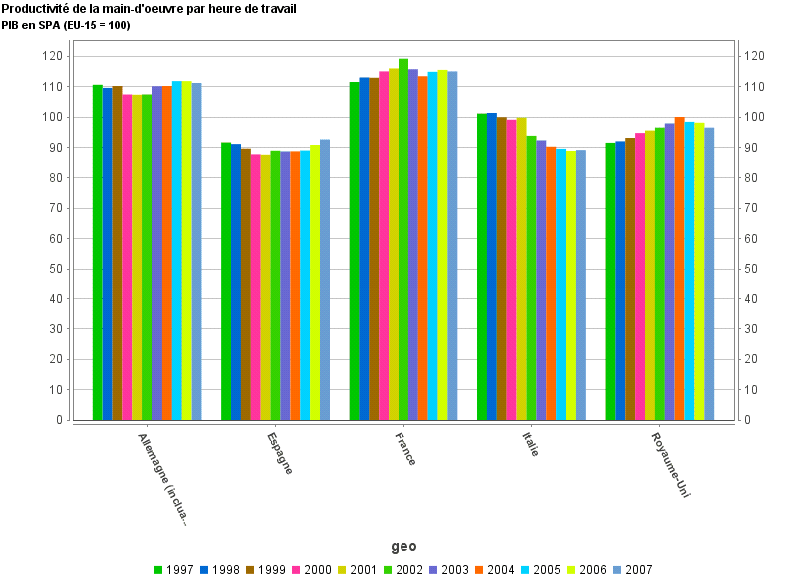
Sources : Données Eurostat
Il est bien possible que cette situation, qui se retrouve aussi au niveau de la productivité par tête (malgré une durée du travail plus faible) ne résulte pas seulement de l'efficacité personnelle des salariés français. Des effets de composition sont souvent cités, comme le fait que la France compte relativement peu d'emplois non qualifiés (et peu productifs), ou encore la sélection des salariés aux âges les plus productifs.
Ces nuances n'empêchent pas que les salariés employés en France réalisent des productions par homme et par tête sans beaucoup d'équivalent dans le monde.
*
En dépit des évolutions qui ont été retracées, l' insatisfaction au travail des européens ne serait ni prépondérante, ni même franchement évolutive d'après l'enquête précitée. Du moins en 2005, « les travailleurs européens affichent des niveaux de satisfaction élevés à l'égard de leurs conditions de travail. Ces niveaux sont similaires à ceux des travailleurs de la plupart des autres économies industrielles avancées ». En 1995, comme en 2000 ou en 2005, plus de 80 % des travailleurs de l'UE à 15 se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » à l'égard de leurs conditions de travail 84 ( * ) .
La France apparaît, selon cette grille, dans une situation médiane au sein de l'UE à 27 :
SATISFACTION AU TRAVAIL, PAR PAYS
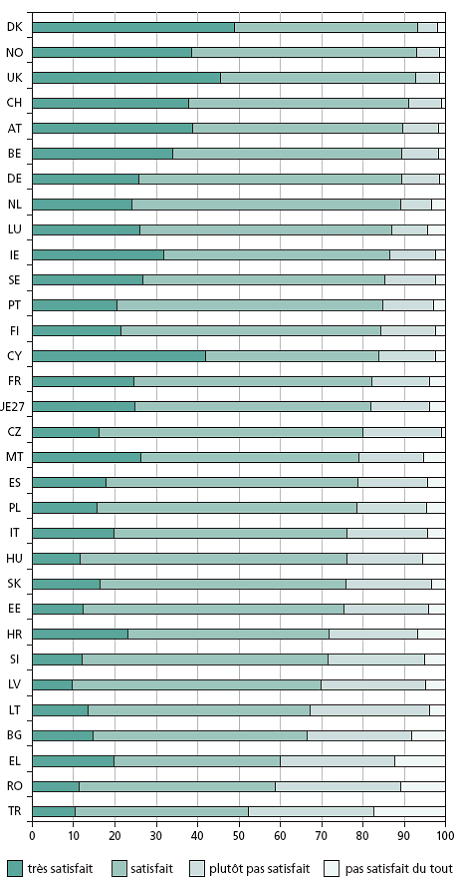
Abréviations : DE : Allemagne ; AT : Autriche ; BE : Belgique ; BG : Bulgarie ; CY : Chypre ; DK : Danemark ; ES : Espagne ; EE : Estonie ; FI : Finlande ; FR : France ; EL : Grèce ; HU : Hongrie ; IE : Irlande ; IT : Italie ; LV : Lettonie ; LT : Lituanie ; LU : Luxembourg ; MT : Malte ; NL : Pays-Bas ; PL : Pologne ; PT : Portugal ; CZ : République tchèque ; RO : Roumanie ; UK : Royaume-Uni ; SK : Slovaquie ; SI : Slovénie ; SE : Suède ; HR : Croatie ; NO : Norvège ; CH : Suisse ; TR : Turquie.
Source : quatrième enquête européenne sur les conditions de travail de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Cependant, sur la base des résultats de l'enquête « International Social Survey Program » (ISSP) de 2005, ainsi que de l'« European Quality of Life Survey », il ressortirait que la France se positionne comme un des pays où la prévalence du stress au travail est la plus forte 85 ( * ) .
D'après un sondage 86 ( * ) réalisé pour le réseau ANACT 87 ( * ) , le stress touche quotidiennement 4 salariés sur 10 et, parmi ces salariés, 60 % l'attribuent à leur vie professionnelle.
II. UN INCONFORT AU TRAVAIL EN PARTIE CONTRE-PRODUCTIF
Il convient d'apporter des éléments d'explication au « malaise social » dans le monde du travail en France, reflet d'une somme de malaises et de stress individuels.
Le rapport estime que la promesse d'un travail de plus grande qualité, portée par la quasi-totalité des discours managériaux et justifiant une implication professionnelle accrue, n'est pas tenue, tandis qu'il procure une bien moindre sécurité que par le passé.
Cette configuration, qui engendre inconfort et stress chez les salariés, est néfaste pour la productivité. Bien entendu, la diversité des configurations rencontrées d'une entreprise à l'autre ne permet de formuler qu'un diagnostic général, susceptible de nuances et d'exceptions.
Quoi qu'il en soit, les explications d'un nouveau « mal-être », en cohérence avec l'évolution de l'organisation du travail et du management, ne manquent pas.
A. UNE PRÉCARISATION DIFFUSE DANS LE CADRE D'UN ÉQUILIBRE AUTONOMIE/SÉCURITÉ DÉGRADÉ
Si la progression d'un « mal-être » au travail n'est pas générale, et si la médiatisation actuelle de la souffrance au travail participe, comme toute médiatisation, d'un certain effet d'emballement, il serait cependant peu responsable de nier la réalité de ces phénomènes, étayés par un faisceau de statistiques diversifiées et pour lesquels les facteurs explicatifs abondent.
Les salariés ont vécu, ces quarante dernières années, une certaine « émancipation » reposant sur un discours managérial promouvant une responsabilisation croissante, avec une organisation beaucoup moins pyramidale et hiérarchique que par le passé, en phase avec la diffusion d'une culture de résultat à tous les échelons de l'entreprise et un relèvement général du niveau éducatif et des compétences .
En contrepartie, la pérennité de l'emploi occupé ne fait plus l'objet d'un « engagement moral » de l'entreprise - le paternalisme n'a plus cours et la main d'oeuvre est devenue souvent abondante -, la stabilité n'étant d'ailleurs plus considérée comme un avantage en termes d'employabilité, tandis que les rémunérations sont dorénavant ajustées à la productivité , plutôt qu'à l'ancienneté.
Le salarié doit , d'une façon générale assumer la « responsabilité » de sa carrière , au sein puis à l'extérieur de l'entreprise.
Les inconvénients de la responsabilisation des salariés excèdent-ils aujourd'hui ses avantages ? Plus précisément, de leur point de vue, les abandons en termes de sécurité valent-ils les gains (et lesquels ?) obtenus en matière de liberté ?
En premier lieu, se pose la question , centrale, de la liberté dans le travail , qui suppose, d'une part, qu'il puisse être effectué avec une autonomie suffisante et, d'autre part, que celui-ci mobilise et valorise le talent de celui qui l'effectue. C'est, selon une désignation usuelle en la matière, la qualité du travail qui est ici en cause. Est-elle aussi bien orientée que le laisserait supposer la théorie managériale ?
En second lieu, se pose la question des abandons en termes de sécurité . Ces derniers n'apparaissent-ils pas singulièrement excessifs, quand bien même les promesses en termes d'émancipation auraient été tenues ?
1. Une qualité du travail compromise par l'accumulation de contraintes objectives
Les nouvelle méthodes de production et de management peuvent poser problème au regard de la santé physique et psychologique des employés, parfois confrontés à un cumul de contraintes d'une ampleur inédite.
Dans l'attente d'un véritable suivi statistique des risques psychosociaux au travail en France 88 ( * ) , on citera l'enquête Sumer 89 ( * ) de 2003, qui concluait qu'entre 1994 et 2003, « l'exposition des salariés à la plupart des risques et pénibilités du travail a eu tendance à s'accroître . Cette tendance recouvre toutefois des évolutions divergentes, certaines expositions augmentant, d'autres diminuant parfois de manière sensible. Ainsi, les longues journées de travail sont devenues plus rares et le travail répétitif est moins répandu. Mais les contraintes organisationnelles se sont globalement accrues , les pénibilités physiques également ».
Du travail mythifié au travailleur mystifié, telle est peut être l'enchaînement désagréable auquel conduit le discours managérial dominant...
a) Une « charge mentale » parfois excessive, cause de stress
Les nouvelles méthodes de production engendrent souvent une « charge mentale » accrue, liée à la superposition des contraintes, qui favorise à son tour une plus forte propension au stress 90 ( * ) .
Aux exigences de productivité et de flexibilité , légitimées par la « dictature du consommateur » (et rendues, le cas échéant, plus directement sensibles par des éléments de rémunération variable), s'ajoute un faisceau de contraintes nouvelles.
Depuis la fin des années 90, la poursuite de la diffusion des NTIC et la mise en pratique de nouveaux concepts de management (ERP, certification, ...) entrainent une standardisation importante qui, d'une certaine façon, se trouve en rupture avec l'octroi -et l'exigence- d'autonomie croissante qui prévaut pour le personnel .
|
LES PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉE (PGI), OU ERP 91 ( * ) Pour gagner en efficacité à tous les niveaux de fonctionnement, les entreprises cherchent à intégrer les différentes fonctionnalités des logiciels qu'elles utilisent. Les progiciels de gestion intégrés (PGI) satisfont ces besoins. Ils organisent les échanges d'informations à travers une base de données partagée répondant à des codifications standardisées de l'information. À partir de celle-ci, il devient notamment possible d'automatiser des processus. Par exemple, l'informatisation des achats, selon ces normes, permet au service comptable de déclencher automatiquement un paiement ou encore une mise en production, de mettre à jour automatiquement le stock des matières premières, voire de passer une commande pour renouveler ce stock. Le caractère très structurant des PGI pour l'organisation et leur coût très élevé en font un outil adopté prioritairement par les grandes entreprises ou celles qui appartiennent à des groupes : 56 % des entreprises de plus de 250 salariés utilisent un PGI. Mais parmi ces dernières, beaucoup n'exploitent que partiellement ces progiciels. En effet, l'objectif d'intégration impliquerait de remplacer les autres logiciels spécialisés ; or une forte majorité des entreprises équipées d'un PGI (70 %) utilise parallèlement d'autres applications informatiques achetées sur le marché ou développées en interne. Les petites et moyennes entreprises (10 à 249 salariés) sont peu nombreuses à avoir adopté un PGI. En revanche, elles utilisent massivement des progiciels spécialisés ou des applications « maison » (8 sur 10), pouvant recouvrir des fonctionnalités extrêmement variées et répondre à leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, 93 % des entreprises ont mis en place au moins un type d'application informatique (PGI ou autre) ne serait-ce que dans un seul service. Les entreprises les moins équipées sont les petites structures des secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration, du commerce de détail ou de la construction. Ces entreprises se contentent des logiciels bureautiques standards le plus souvent livrés avec les ordinateurs. Entre les entreprises, l' échanges de données informatisées (EDI) est une technique remplaçant les échanges de documents (commandes, factures, bons de livraison, etc.) et le paiement par des échanges entre ordinateurs, connectés par liaisons spécialisées ou un réseau (privatif) à valeur ajoutée (RVA). Les données sont structurées selon des normes techniques de référence (ex : Edifact, Etebac). Chaque document est ainsi acheminé d'un ordinateur émetteur vers un ordinateur récepteur qui interprète et intègre le document à son progiciel de gestion intégré , à la différence d'une réception par fax qui nécessiterait une nouvelle saisie par un opérateur. Source principale : INSEE (2006), site « logistique Conseil » |
Il est, ainsi, fréquent que les salariés connaissent un cumul de contraintes, concernant aussi bien la productivité, qu'imposées par des normes de qualité et diverses modalités de standardisation , chaque fonction ayant son propre type de standardisation.
A ces difficultés, peuvent s'ajouter celles engendrées par une organisation matricielle de la production, fréquente dans les grandes entreprises qui doivent adapter leur organisation hiérarchique à la conduite de projets successifs, et dont il peut découler pour les salariés des instructions difficilement conciliables.
|
L'ORGANISATION MATRICIELLE Le fonctionnement par projets nécessite la mise en place d'une organisation spécifique non permanente qui va se superposer à la structure de l'entreprise. L'organisation matricielle est une structure croisée : les directions métiers et le directeur de projet sont co-responsables de la performance du projet. Le directeur de projet désigne, planifie, organise, contrôle son équipe projet. Il a une autorité hiérarchique sur les intervenants du projet. Il peut ainsi donner des priorités dans la réalisation des différentes tâches. Il est responsable de l'utilisation des ressources sur son projet mais les intervenants dépendent hiérarchiquement de leurs directions métier. Ces intervenants consacrent une partie de leur temps de travail au projet et doivent également assumer une partie de leurs tâches quotidiennes. Ce type d'organisation est régulièrement mis en place dans les entreprises qui travaillent en parallèle sur plusieurs projets de même nature représentant un enjeu fondamental. Elle se rencontre, par exemple, dans les industries pharmaceutiques. Source : OlsenConseil, adresse : http://www.journalolsen.org/ . |
Outre la gestion difficile d'une situation de stress durable , le salarié peine à développer son professionnalisme dans un contexte de contraintes croissantes dont certaines peuvent, au surplus, s'avérer ainsi contradictoires.
Ici se trouve une cause avérée de souffrance au travail .
La charge mentale peut se trouver encore aggravée lorsque le mode de fonctionnement de l'entreprise requiert une mobilité et une disponibilité physique, notamment en cas d' horaires flexibles , peu compatibles avec les exigences de la vie privée, notamment familiale . Les contraintes et les inquiétudes relevant de l'organisation domestique sont alors renforcées, et peuvent venir s'ajouter aux précédentes.
Si le télétravail tend à isoler le salarié du collectif de travail ( infra ), son développement peut, dans une mesure assez significative, contribuer à pallier certains des inconvénients qui précèdent, mais il semble cantonné non seulement en termes d'activités (certains emplois de cadres et d'ingénieurs, fonctions administratives support...), mais encore, dans une certaine mesure, en termes d'organisation du travail, ses caractéristiques le prédisposant aux organisations apprenantes (le Centre d'analyse stratégique 92 ( * ) observe ainsi que « le télétravail est d'autant plus aisé à mettre en oeuvre que la structure de l'organisation est légère, peu hiérarchisée, réactive et que les processus internes font appel aux TIC »).
b) Des contraintes physiques qui évoluent plutôt qu'elles ne s'amoindrissent
La tertiarisation de l'économie et les progrès continus de la robotique peuvent laisser supposer que les contraintes physiques subies dans le travail seraient en voie de régression.
Pourtant, dans « Les désordres du travail » 93 ( * ) , Philippe Askénazy estime que le problème de l'accroissement de la charge physique supportée au travail serait encore plus alarmant que pour la charge mentale. Avec des postures pénibles, des poids à porter, de longs déplacements à pied etc., les nouvelles méthodes de production , en favorisant la polyvalence , sont en effet de nature à accroitre la charge physique , leurs exigences en la matière se cumulant ou s'ajoutant à des contraintes mentales.
De fait, une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles intitulée « Accidents et conditions de travail » 94 ( * ) établit que, non seulement l'intensité du rythme de travail, mais aussi son imprévisibilité, accroissent le risque d'accident. En revanche, contrairement à certaines théories managériales, disposer de marges de manoeuvre pour organiser son travail ne constitue pas un facteur apparaissant comme nettement protecteur. Par ailleurs, le soutien du collectif de travail -qui tend à s'estomper dans les nouvelles formes d'organisation- et de la hiérarchie protège du risque d'accident.
Prenant, pour sa part, l'exemple, dans les années quatre-vingt-dix aux Etats-Unis, de la multiplication des accidents constatée chez les chefs de rayons, conduits à assumer des tâches de manutention pour rentabiliser le temps gagné grâce aux TIC sur leurs travaux habituels, Philippe Askénazy note que « l'optimisation passe par l'utilisation de l'ensemble de la disponibilité et des capacités des salariés, qu'elles soient cognitives ou physiques ».
Au total, les accidents du travail et maladies professionnelles d'ordre physique, qui sont corrélés à la charge physique supportée au travail, ont augmenté ces dernières années, notamment 95 ( * ) sous la forme de troubles musculo-squelettiques (TMS) classés en maladies professionnelles, principalement liés à l'usage des terminaux informatiques, en forte augmentation en Europe -même si la tendance recouvre aussi une meilleure reconnaissance de la maladie. Bien entendu, le stress développé par ailleurs peut aussi contribuer au développement de symptômes physiques, tels que des maladies cardiovasculaires ou, précisément, des TMS.
DE PLUS EN PLUS D'ARRÊTS DE TRAVAIL POUR MALADIE PROFESSIONNELLE
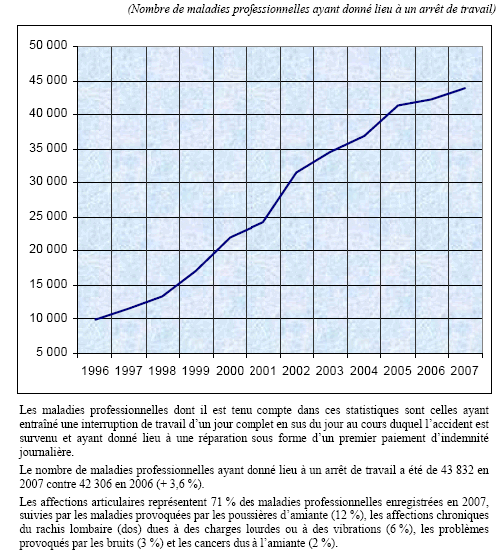
Sources : Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Repères statistiques sur les dimensions économique, sociale et environnementale de la société française (Conseil économique, social et environnemental, 2009)
La quatrième enquête européenne sur les conditions de travail montre qu'en 2005, près de la moitié des travailleurs (46 %) utilisent un ordinateur pendant au moins un quart de leur temps de travail. Plus généralement, 35% des travailleurs questionnés indiquent que leur travail nuit à leur santé.
|
LA QUALITÉ DU TRAVAIL COMPARÉE AU SEIN DE
L'EUROPE DES QUINZE :
Nathalie Greenan, Ekaterina Kalugina et Emmanuelle Walkowiak, du Centre d'études de l'emploi, ont réalisé une évaluation de l'évolution de la qualité du travail entre 1995 et 2005 sur la base des études européennes sur les conditions de travail menées en 1995, 2000 et 2005. Leur travail 96 ( * ) se fonde ainsi sur des données harmonisées, qui leur permettent d'approcher quatre dimensions de la qualité du travail jugées essentielles : les conditions physiques de travail , qui rejoignent la question de la santé et de la sécurité au travail, l' intensité du travail, qui se subdivise en deux dimensions - l'intensité des contraintes techniques et l'intensité des contraintes de marché - et, enfin, la complexité du travail . Elles partent du postulat que la qualité du travail s'améliore avec celle des conditions physiques de sa réalisation ainsi qu'avec sa complexité, tandis qu'elle se détériore à mesure que les contraintes techniques ou de marché se font plus intenses. Le risque maximal de souffrance au travail se manifeste donc lorsque les conditions physiques sont mauvaises, l'intensité haute et la complexité basse, ce qui est notamment le cas de la Grèce et, dans une moindre mesure, de la Finlande et du Portugal. D'après cette étude originale, la situation de la France serait globalement stable de 1995 à 2005, tandis que celle de l'Europe des quinze se dégraderait dans son ensemble , avec une baisse de la qualité, une hausse de l'intensité et une baisse de la complexité ressentie (malgré Lisbonne...), ce dernier mouvement n'étant pas, d'ailleurs, aisément explicable 97 ( * ) . Il semble que l'Allemagne et l'Italie soient particulièrement concernées par cette tendance globale, néfaste pour les salariés. |
c) L'acclimatation souvent peu concertée des nouvelles formes d'organisation
L'impact des nouvelles formes d'organisation de la production sur la pénibilité n'est pas univoque : la plupart des novations liées aux nouvelles organisations apparaissent comme ambivalentes sur le plan de la satisfaction et de la souffrance au travail et c'est plutôt le contexte particulier de chaque entreprise qui est de nature à faire pencher la balance d'un coté ou de l'autre.
La diversité des impacts sur les conditions de travail est à l'image de celle des modalités des organisations modernes, qui peuvent se rattacher à la catégorie « vertueuse » des entreprises apprenantes ou à celle, habituellement présentée comme plus dangereuse pour les salariés, de la « production au plus juste », sachant que cette schématisation constitue un outil utile mais nécessairement imparfait pour appréhender une réalité qui est plutôt, malgré une certaine polarisation, celle d'un continuum d'entreprises entre ces deux formes.
Il semble en particulier que les conditions d'acclimatation des nouvelles organisations - les modalités de la « conduite du changement », selon une terminologie d'usage en la matière - soient un moment particulièrement sensible de la vie d'une entreprise quant à la façon dont les salariés vont « vivre » leurs nouvelles conditions de travail .
Certes, selon les termes de l'article L. 2323-27 du code du travail, « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l' organisation du travail , de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ». A cet effet, « il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur » dans les domaines susmentionnés et « formule des propositions » 98 ( * ) .
Bien que cette obligation se trouve en outre banalisée, dans le champ européen, par une directive européenne 99 ( * ) garantissant notamment « l'information et la consultation [des représentants des travailleurs] sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail », de nombreux observateurs déplorent, en France, un manque de général de concertation .
Henri Rouilleaut, membre du Centre d'analyse stratégique, auditionné dans le cadre du présent rapport, estime en particulier que l'instauration autoritaire de nouvelles organisations - à laquelle aucune prescription juridique ne fait aujourd'hui véritablement obstacle - est néfaste : « on ne réussit pas à réformer durablement quand le sens des missions se brouille, les moyens pour les atteindre font défaut, les repères manquent... La conduite du changement « top down » est génératrice de frustrations et, suivant le cas, de mouvements sociaux, d'attitudes de retrait des salariés nuisibles à la performance, de montée de risques psychosociaux ... ».
d) Une gestion managériale des nouvelles contraintes parfois peu prévenante
Les diverses formes d'inconfort ou de souffrance au travail sont loin de se retrouver à l'identique dans des organisations comparables. Il vient que, par delà l'accumulation objective des contraintes, la qualité du management peut être en cause.
Philippe Askenazy, dans l'ouvrage précité, souligne que « d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, l'impact des pratiques innovantes sur le conditions de travail est positif ou bien négatif. On aboutit même à une forme de conclusion tautologique : la situation de salariés se détériore dans les entreprises où de bonnes conditions de travail ne sont pas un réel objectif, et elle s'améliore si l'employeur intègre ces conditions . En revanche, il est systématiquement démontré que la dégradation (ou l'amélioration) des conditions de travail est toujours un phénomène collectif de l'établissement ou de l'entreprise ».
Pour sa part, Pascal Ughetto affirme, au terme d'une enquête qualitative 100 ( * ) , qu'« il n'est plus possible de parler des conditions de travail en niant toute la prégnance du fait gestionnaire dans l'entreprise, de si grande importance pour apprécier les conditions de travail. Celui-ci est d'un effet considérable : « bien managé », le travail peut exiger beaucoup mais être source de plaisir ; « mal managé », il devient une épreuve... indépendamment des conditions de travail au sens le plus strict ».
En particulier, les explications données aux salariés pour chacune des nouvelles contraintes qui leur sont imposées et l' accompagnement proposé pour les aider à surmonter les difficultés qui en résultent, apparaissent fondamentales pour que les salariés trouvent ces contraintes « légitimes ».
Aux termes d'un « pacte social » post-tayloriste, fondé sur la pleine responsabilité de « collaborateurs » devant mobiliser le meilleur de leur intelligence et de leur créativité au service de projets communs, il est évidemment nécessaire d'expliquer parfaitement toute les contraintes qui s'imposent au salarié pour les rendre acceptables.
C'est une question d'équilibre : on ne peut à la fois traiter les salariés comme des adultes responsables pour la réalisation de leurs objectifs ou de leurs projets, et comme des incapables majeurs pour les conditions de cette réalisation .
e) L'impasse d'un certain « autisme managérial » en cas de recherche exagérée de rentabilité
Il arrive que, dans une gouvernance actionnariale conduite à son paroxysme, le management par objectif soit totalement préempté par des actionnaires dont l' appétence à court terme est telle que leurs exigences sont formulées sans attention raisonnable portée à l'impact sur la qualité des emplois des objectifs ainsi fixés .
La mondialisation de l'économie et la concurrence par les prix sont bien évidemment de nature à engendrer ou aggraver ce type de comportement actionnarial.
Dans ces occurrences, l'entreprise doit présenter une rentabilité maximale, quel qu'en soit le prix humain. Cette recherche d'un « ROE » (return on equity 101 ( * ) ) maximal constitue une démarche généralement orientée sur le court terme, parfois préjudiciable à la capacité de développement ultérieur de l'entreprise. Et ce qui est vrai des sacrifices qu'elle peut imposer à l'investissement le peut être aussi s'agissant du capital humain.
|
DU MANAGEMENT PAR OBJECTIF À L'« AUTISME MANAGÉRIAL » Une confiance excessive des dirigeants dans les systèmes de management par objectifs, combinée à une incompréhension - ou, pis, à un désintérêt -pour l'activité et les différents métiers de l'entreprise peuvent s'avérer dangereuses pour une organisation et ses membres. A l'extrême, les dirigeants peuvent en venir à considérer que l'organisation, ses métiers et ses individus sont totalement adaptables et redéployables. Dans une telle situation, l'entreprise perd son épaisseur stratégique. La direction n'est plus un organe où se négocient les objectifs de la firme , en articulant les demandes externes (des actionnaires, des clients) et ses ressources internes. Le rôle du top management se résume simplement à traduire et répercuter les objectifs des actionnaires sur les échelons inférieurs de l'organisation , sans s'interroger sur la capacité de l'organisation à atteindre, supporter, voire enrichir ces objectifs. A trop s'éloigner de l'activité, de ce que les individus sont capables de faire, le top management se désolidarise progressivement de l'entreprise. En réaction, les salariés s'interrogent et se demandent si les dirigeants jouent pour ou contre l'intérêt de l'entreprise , détruisant la confiance nécessaire à tout projet collectif. L'entreprise, entendue comme projet et potentiel collectif, est mise à mal. Mais les effets les plus néfastes sont à craindre lorsque se développe une forme d'« autisme managérial », où le top management fixe des objectifs présentés comme non négociables , et ne souhaite plus prêter d'attention aux difficultés vécues par les acteurs qui réalisent l'activité. Au-delà du stress et de la violence que ces mécanismes génèrent pour les individus , le top management peut rapidement se retrouver pris à son propre piège. En effet, à partir du moment où tout écart par rapport aux objectifs devient synonyme d'incompétence , plus aucune information sur les dysfonctionnements ne filtre jusqu'aux organes dirigeants. Les opérationnels - middle managers, techniciens, acteurs projets -- deviennent plus animés par la peur de la sanction et le culte de l'indicateur que par le travail bien fait. Ils doivent de plus en plus jongler et prendre des risques pour réaliser leurs objectifs tout en menant à bien leur activité. Dans de telles situations, la direction risque de perdre le contrôle de l'entreprise. C'est lorsqu'une crise grave éclate qu'elle prend conscience -trop tardivement - que les objectifs n'étaient pas tenables et que des dérives graves sont devenues routinières . De nombreuses crises industrielles récentes s'inscrivent dans un tel système, où l'usage inconsidéré du management par objectifs éloigne les dirigeants de l'activité, et rend invisibles des crises couvant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans l'organisation. Le management par objectifs n'est pas, en soi, un mécanisme malsain. Mais ce n'est ni le seul, ni le meilleur levier de pilotage d'une organisation. Mobilisé de manière dogmatique, et combiné à une inattention pour l'activité et les opérationnels, il peut aboutir à une perte de contrôle sur l'entreprise qui peut avoir des répercussions catastrophiques sur la dynamique d'une organisation . Extrait d'un article d'Aurélien Acquier, Le Monde du 18 décembre 2009 |
La mise sous tension se communique alors vers les filiales et les sous-traitants ou, plus largement, les entreprises en contrat dans une quelconque situation de dépendance économique. Ce type de situation est parfois engendré par l'existence d'un monopsone (une entreprise acheteuse pour de nombreuses entreprises vendeuses) ou d'un oligopsone (quelques acheteurs pour un nombre important de fournisseurs). La pression exercée à la baisse, par les centrales d'achat des chaînes de grande distribution, sur les tarifs de leurs « petits » fournisseurs 102 ( * ) , dont le caractère excessif est souvent relevé, est topique de ces situations de concurrence imparfaite.
Quelles qu'en soient les modalités, ces « transferts » de pression à la réalisation de gains de productivité seraient d'autant plus fréquents qu'ils permettent - au moins dans un premier temps - de préserver la qualité de vie et le niveau de rémunération des salariés de l'entreprise donneuse d'ordre tout en parvenant à remplir ses objectifs de rentabilité.
Il est à noter que le risque de maximisation exagérée des objectifs augmente notablement dans le cadre d'opérations de LBO (leverage buyout) 103 ( * ) ou lorsque le capital d'une entreprise s'ouvre largement à des fonds spéculatifs ou à des fonds de pension.
Afin d'éviter l'écueil d'une intensification insupportable du travail, à laquelle une pure logique de gouvernance actionnariale peut conduire, il conviendrait (à la faveur - ou malgré ? - la crise actuelle) de modérer cette logique pour promouvoir le facteur social dans les déterminants stratégique de l'entreprise .
Auditionné par votre Délégation à la prospective, Francis Mer s'est déclaré « effaré par le cas de France Telecom, où les personnes se sont vues appliquer aveuglément certaines méthodes ». Selon lui , « le management doit être un état d'esprit positif, que porte volontiers le « manager de terrain », hélas trop souvent évincé au profit du « manager d'entreprise », en proie aux exigences de la financiarisation . Il convient aujourd'hui de créer un environnement pédagogique conduisant le « top management » à changer de paradigme ».
Lorsque les actionnaires seraient eux-mêmes convaincus de la pertinence financière à long terme d'une telle démarche, les modalités concrètes de la valorisation du facteur social interne à l'entreprise resteraient à inventer. L'introduction de mécanismes conduisant à indexer une partie de la rémunération variable de management supérieur non plus exclusivement sur des résultats financiers, mais aussi sur des indicateurs « sociaux », constituerait une piste 104 ( * ) particulièrement novatrice.
Naturellement, les auteurs du rapport réalisent pleinement, en matière de gouvernance d'entreprise, la « révolution copernicienne » que supposeraient de telles évolutions, sans mésestimer, en particulier, la difficulté à identifier et renseigner les indicateurs pertinents.
L' enjeu n'est pourtant rien moins que celui d'une certaine réconciliation entre les salariés et le management .
2. Une vulnérabilité sensiblement accrue
Indifférence du management aux difficultés rencontrées, incertitudes autour de la carrière et de l'emploi, délitement des collectifs de travail... : alors qu'il est soumis à un faisceau de contraintes de plus en plus dense, le salarié paraît démuni.
a) La fin des carrières prévisibles, sans contreparties en termes d'employabilité
La prise en compte de plus en plus exclusive du mérite, de la performance et des aptitudes réelles afin de pourvoir aux différents postes dans l'entreprise et, parallèlement, la tendance croissante des salariés à prendre en main leurs carrières - attitude que leur suggère aussi bien la remise en cause effective des carrières linéaires ( supra ), l'obsolescence plus rapide des productions et des postes ainsi qu'un certain discours managérial au sein et hors de l'entreprise 105 ( * ) -, débouche sur une imprévisibilité croissante des trajectoires professionnelles, au sein puis hors de l'entreprise.
Il est un fait que le taux de rotation du personnel 106 ( * ) - ou « turn over » - tend à augmenter .
TAUX DE ROTATION DE PERSONNEL DEPUIS 1996
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 10 SALARIÉS ET PLUS
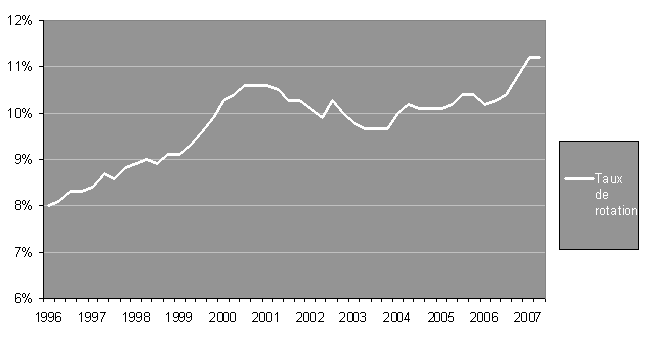
Source : Service des études économiques du Sénat, données DARES
Ce phénomène concernerait au premier plan les « outsiders » ( infra ), notamment les intérimaires et les personnes en contrats à durée déterminée, ces derniers représentant 9,4 % des salariés 107 ( * ) . L'examen des causes de sortie de l'entreprise, dont les fins de CDD représentent 63 % (contre 8 % pour les licenciements), ne contredit pas ce diagnostic :
SORTIES SELON LES PRINCIPAUX MOTIFS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 10 SALARIÉS OU PLUS (2007)
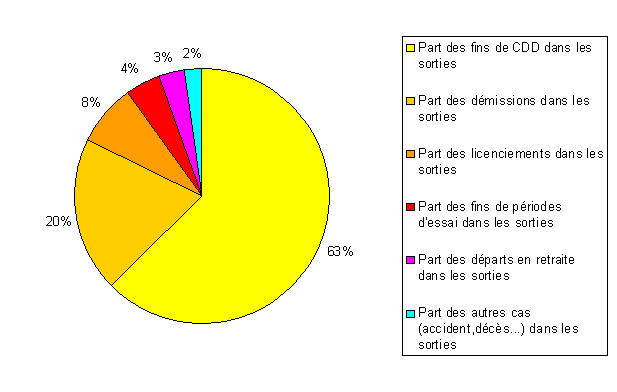
Source : Service des études économiques du Sénat, données DARES
Contrepartie d'une liberté théorique qui permettrait d'être, avec bonheur, le continuel inventeur de sa vie professionnelle, cette incertitude peut déboucher sur une inquiétude réelle (même si, sous un autre angle, qui pourrait être celui des promoteurs de cette liberté, « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou » 108 ( * ) ).
Les termes du débat ne sont probablement pas les mêmes selon les profils et le niveau d'études. Il semble, en effet, a priori plus facile à un salarié diplômé et « adaptable », habitué aux travaux de conception, de parvenir, précisément, à « concevoir » sa carrière, qu'à un travailleur cantonné dans des tâches d'exécution peu variées, ne disposant pas des mêmes réseaux d'information, et probablement moins enclin à réfléchir à ses « aspirations » dans le travail, dès lors que ce dernier, parfois vécu comme une fatalité, ne valoriserait pas particulièrement celui qui l'exécute.
Ainsi, les remises en cause professionnelles pourraient apparaître comme plus fréquemment décidées chez les cadres, et davantage subies chez les moins diplômés.
Quoi qu'il en soit, la remise en cause des carrières linéaires emporte pour tous - par delà l' aléa majeur du chômage - une imprévisibilité géographique et financière d'autant plus fragilisante que les salariés se trouvent « installés » dans la vie - ou le souhaitent . Par ailleurs, le raccourcissement des perspectives dans le cadre de la suppression de la carrière au sens d'une trajectoire globalement prévisible au sein d'une entreprise fait écho au problème plus général de crise de l'avenir de la mobilité sociale ascendante.
Malgré l'acclimatation des quelques éléments de « flexisécurité », de la GPEC 109 ( * ) ainsi que de nouveaux droits à formation visant à préserver ou améliorer l' employabilité des personnes et leur capacité à assumer les diverses situations de mobilité ( infra ), l'ensemble formé par les dispositifs existants ne parvient en aucun cas à remplacer la « carrière » dans son rôle assurantiel , ainsi que d'ascension sociale.
Concernant la formation, la Cour des comptes 110 ( * ) constate ainsi que « les bénéficiaires de formation professionnelle sont pris en charge par des interlocuteurs différents en fonction de leur situation : l'Etat pour l'enseignement professionnel, les régions et les entreprises pour l'apprentissage, les entreprises et les branches professionnelles pendant les périodes d'activité salariée, la région et les organismes du service public de l'emploi en cas de recherche d'emploi. Cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle s'oppose à un suivi individualisé des besoins de formation tout au long de la vie . De plus, les inconvénients engendrés par ce fonctionnement se concentrent sur ceux qui , peu formés ou mal qualifiés, connaissent la plus grande instabilité sur le marché du travail et sont le plus souvent exposés au risque de chômage. Il apparaît donc que, par son organisation même, le système de formation professionnelle tend à accuser les inégalités entre les mieux formés, qui bénéficient en général d'un accès aisé et régulier aux formations se révèle plus irrégulier et difficile ».
L' employabilité des salariés constitue aujourd'hui la principale piste de sécurisation des salariés qui soit compatible avec les mutations, toujours plus rapide, de l'appareil de production ( infra ).
b) La hantise du chômage dans un marché du travail dual, où les mobilités sont essentiellement subies
Comme le soutient Eric Maurin dans « La peur du déclassement » 111 ( * ) , le pacte social français peut être décrit en termes d'accès et de garantie en matière de statuts.
Le « statut », bien que perçu comme contraire à l'idéal républicain 112 ( * ) , jouit en France d'un prestige et d'une diffusion qui, de facto, excède largement le champ des professions règlementées. Depuis la second guerre mondiale jusqu'aux années 70, s'est déployée une société de salariés « à statut », plus ou moins protégés de l'« arbitraire » patronal. La montée en puissance du salaire minimum donne, selon l'auteur, une illustration de ce mouvement.
Paradoxalement, la crise de 1974 puis les « trous d'airs » de la croissance que nous avons connus depuis se sont souvent traduits par une nouvelle rigidification des statuts, que l'on songe, par exemple, à l'autorisation administrative de licenciement en 1974, ou à l'encadrement des contrats à durée déterminée (CDD) en 1982.
En 2009, comme dans les années quatre-vingt ou quatre-vingt-dix lorsqu'il s'est manifesté, le recul de l'emploi se traduit par les mêmes effets sur les mêmes catégories de personnes :
- les « insiders » 113 ( * ) , c'est- à dire les personnes travaillant en CDI et les fonctionnaires, sont globalement épargnés , tandis qu'ils défendent avec conviction un statut chèrement acquis contre toute velléité d'y atteindre ;
- les « outsiders » payent la crise au prix fort : les personnes en CDD sont les premières licenciées , les nouveaux venus sur le marché du travail, c'est dire les jeunes , sont relégués, tandis que les chômeurs voient leurs perspectives de retour à l'emploi s'éloigner encore.
Depuis la fin des années quatre-vingt dix, s'observe en Europe une segmentation accrue des marchés du travail entre « insiders et « outsiders » , avec des emplois précaires concentrés sur les jeunes et les femmes peu qualifiés, qui sont les moins armés dans la concurrence pour l'accès aux emplois stables et sur lesquels se concentrent les conséquences de la flexibilité.
En France, la part des contrats temporaires (contrats à durée déterminée, intérim, stages et contrats aidés, apprentissage) est passée de 9,6 % en 1990 à 15,3 % en 2007 , l'essentiel de la hausse ayant eu lieu au cours des années quatre-vingt-dix. Désormais, la « couche de flexibilité » 114 ( * ) composée des CDD et de l'intérim serait largement mobilisée pour s'ajuster aux cycles économiques : l'élasticité de la croissance du nombre de chômeurs aux variations du PIB a fortement augmenté, étant passée de -1,4 durant la période 1990-1993 à -7,5 actuellement 115 ( * ) . En termes de flux, la grande majorité des embauches s'effectue aujourd'hui sur la base de contrats courts : en 2007 , la part des CDI dans les embauches a pu être estimée par la DARES à 28 % 116 ( * ) .
Le Conseil d'orientation pour l'emploi 117 ( * ) observe que les contrats courts ne permettent pas toujours d'accéder facilement à un emploi stable : seuls trois salariés sur dix en CDD ou en intérim une année donnée accèdent à un CDI l'année suivante et si, toutes choses égales par ailleurs, les personnes en contrat court accèdent plus facilement à l'emploi stable que les chômeurs, on remarque, pour les débutants, que les contrats temporaires ont moins souvent débouché sur un CDI à la fin des années 1990 qu'au début des années 1980.
Il semble donc que certains salariés se trouvent durablement enfermés dans le chômage ou les emplois courts , même si ces derniers répondent aussi à d'autres objectifs que celui d'une flexibilité accrue 118 ( * ) , dont il semble, d'ailleurs, que la recherche puisse s'accommoder du recours à des CDI 119 ( * ) .
En définitive, les mobilités résultant du recours à des contrats temporaires , qui permettent de fluidifier le marché du travail, apparaissent comme en partie subies par des salariés qui, par ailleurs, se caractérisent par un plus faible accès à la formation 120 ( * ) , ce qui entraîne une déperdition de leur capital humain ( infra ).
Selon certaines approches, la France ferait figure d'exception pour ce qui est de l'intensité de la protection résultant du contrat de travail , avec un degré de protection de la « législation protectrice de l'emploi » (LPE), non seulement relativement élevé , mais encore en augmentation sur les dernières décennies (1985-2003) 121 ( * ) .
Or, la France serait un des pays où le sentiment d'insécurité de l'emploi est le plus marqué . Fabien Postel-Vinay et Anne Saint-Martin observent plus généralement que « (....) la protection de l'emploi, telle qu'elle est conçue dans les pays d'Europe (...), ne serait pas une bonne protection contre le sentiment d'insécurité de l'emploi, rôle protecteur que semblerait bien jouer, en revanche, l'assurance-chômage 122 ( * ) ».
Comment expliquer le paradoxe d'une LPE s'avérant, dans une certaine mesure, contre-productive ? D'après les mêmes auteurs, « Il est théoriquement et empiriquement bien établi qu'une LPE plus stricte tend à allonger la durée moyenne du chômage en même temps qu'à allonger la durée moyenne en emploi. Du point de vue des salariés et du risque de perte d'emploi auquel ils font face, c'est donc un instrument à double tranchant : d'un côté, la LPE « joue son rôle » en diminuant le risque individuel de perte d'emploi, mais de l'autre, elle augmente le coût lié à la perte d'un emploi en diminuant les chances de retour à l'emploi. Une interprétation possible des résultats (...) est que ce second effet domine le premier ».
Quoi qu'il en soit, c'est d'abord le niveau très élevé du chômage en France qui crée une peur de la précarisation, la LPE pouvant avoir, dans ce contexte de fond, un impact effectivement ambivalent.
c) Une plus forte adhésion aux tâches exigeant un management attentif
• Autant la motivation de la personne, en
mobilisant ses capacités et son intelligence, constitue un aspect
positif des nouvelles méthodes de management, autant peut être
perçu négativement l'engagement de toute la personne, non
seulement dans ses dimensions physique et intellectuelle, mais aussi
psychologique, lorsqu'il s'avère nécessaire de faire sien
l'objectif ou le projet sans distanciation raisonnable.
Dans le cadre d'un nouveau projet, l'enthousiasme et une implication maximale apparaissent souvent comme la norme et la condition de la réussite collective. On demande d'apporter sa créativité, lorsqu'on ne fait pas appel, sous l'influence de « gourous » du management, à l'émotivité de la personne. Sous l'impulsion du manager ou du chef de projet, dont il est attendu une importante capacité d'entraînement, une adhésion plus ou moins forte finit par se manifester, d'autant plus qu'il se révèle psychologiquement avantageux de souscrire aussi intimement que possible aux objectifs au regard des contraintes réelles que leur réalisation implique.
Le reproche de manipulation ou d'exploitation, parfois formulé en de pareilles circonstances, pourrait être réfuté au motif qu'il n'y a pas d'intentionnalité évidente qui prendrait le masque de l'autonomie et de la responsabilité offertes.
Il n'empêche qu'au nom du respect des temps sociaux, sinon d'une certaine conception de la dignité humaine, certaines personnes se sentent en décalage avec un mode de fonctionnement exigeant une adhésion jugée trop intime et envahissante au « projet » et supposant même parfois la mobilisation, alors ressentie difficilement, d'un tissu de relations mêlant intérêts professionnels et affinités.
Quoiqu'il en soit, il semble que les Français attachent une importance particulière au travail . Ainsi que le rappelle Dominique Méda 123 ( * ) , « Au Danemark et en Grande Bretagne, les personne interrogées ne sont que 40 % à dire que leur travail est important. Elles sont 50 % dans un groupe de pays constituant une sorte de ventre central, avec l'Allemagne et la Grèce. Enfin, dans une série de pays dont fait partie la France, les taux sont extrêmement élevés ».
Au vu des enquêtes disponibles, les explications pouvant être avancées résident notamment, outre la peur de perdre son emploi, dans « l'intérêt intrinsèque accordé au travail » : « Les Français seraient (...) attachés à la dimension expressive du travail et auraient des attentes extrêmement fortes en matière de réalisation de soi et d'expression de soi dans le travail ».
Cet attachement est peut être l'expression de l'insatisfaction ressentie au travail.
• Il arrive que, pour des raisons quelconques
(dont les difficultés précédemment énoncées
peuvent être à l'origine),
un salarié ne donne pas
satisfaction
. Un tel fait, souvent étayé par des
« indicateurs de performance » individuels, ne manquera pas
d'être rapidement révélé à
l'intéressé, tant l'organisation du travail en flux tendus ne
supporterait pas le maintien de « maillons faibles ».
Alors, en raison d'une plus forte adhésion à sa tâche, une remise en cause de la qualité ou de l'efficacité du travail , fût-elle parfaitement légitime, tend à devenir plus fragilisante . Cette observation vaut aussi collectivement : si un projet réussi crée un fort sentiment de satisfaction, son échec est symétriquement de nature à engendrer une frustration importante. Aussi, le management doit-il redoubler de précautions pour marquer une quelconque déception ou désapprobation, et donner le cas échéant au salarié, par exemple au moyen de formations ou de conseils, les moyens de s'améliorer .
Plus généralement encore, l'implication du personnel rend difficilement supportable une simple absence de reconnaissance des objectifs tenus, du projet réalisé ou, tout simplement, du travail bien fait ou seulement fait.
Ainsi, en toute hypothèse, un management inattentif aux hommes présente une capacité de nuisance redoublée lorsqu'il est requis, par ailleurs, une forte adhésion à sa tâche, adhésion à laquelle les Français seraient, semble-t-il, prédisposés.
d) Une « atomisation » du personnel fragilisante
Sans revenir sur les multiples causes de la désyndicalisation en France, le salarié qui se trouve en difficulté connaît une nouvelle solitude résultant d'une parcellisation des collectifs de travail au sein de l'entreprise.
(1) Un délitement des collectifs de travail objectivement préjudiciable
Dans les nouvelles formes d'organisation , le travail au sein d'équipes successives, la polyvalence et un plus fort turn-over favorisent un certain délitement des « collectifs de travail » , surtout lorsqu'ils s'accompagnent d'un mouvement de filialisation et d'externalisation concernant des fonctions auparavant exercées par l'entreprise.
Par contraste, il apparaît d'ailleurs que, d'une certaine façon, le taylorisme « faisait » le collectif de travail ...
Les conditions de travail et de rémunération apparaissent aujourd'hui comme généralement moins favorables dans la nébuleuse des PME sous-traitantes que dans les entreprises donneuses d'ordre, les premières recourant d'ailleurs moins fréquemment au contrat à durée indéterminée.
Les personnels concernés, peu syndiqués et portés à une attitude plus résignée, apparaissent moins à même d'exercer une pression utile pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
Par ailleurs, les objectifs de performance, souvent libellés collectivement au sein d'« équipes », peuvent aboutir, d'une part, à une « concurrence » entre salariés d'une même entreprise et, d'autre part, à une surveillance accrue entres salariés d'une même « équipe ».
Enfin, on notera que l' instauration des « 35 heures » a débouché, dans de nombreuses entreprises, sur la remise en cause ou la réduction de nombreux « temps interstitiels » (pauses café etc.) afin de permettre l'acclimatation de la RTT sans perte de compétitivité. Or, il s'agit de temps privilégiés pour tisser du « lien social » et consolider ainsi le « collectif de travail ».
De même, les modifications organisationnelles , parfois fréquentes, en recomposant les équipes, fragilisent les collectifs de travail, surtout lorsqu'elles s'assortissent d'un changement d'établissement, dans un contexte marqué par une augmentation de leur nombre au sein de l'entreprise ( infra ) corrélé à une diminution de leurs effectifs. Le développement du télétravail participe, par ailleurs, de ce mouvement.
(2) Des situations de « souffrance au travail » plus vivement ressenties
Rien n'indique qu'au sein de l'entreprise fordiste, qui prévalait encore dans les années soixante-dix, les risques de souffrance au travail furent objectivement moins importants qu'aujourd'hui .
En effet, dans le contexte d'un travail parcellisé et fortement hiérarchisé, les ouvriers, en particulier, avaient un encadrement rapproché, potentiellement « caporaliste » et parfois coupable de harcèlement, pour l'exécution de tâches répétitives parfois accablantes.
Pourtant , ainsi que le souligne Danièle Linhart 124 ( * ) , la souffrance au travail n'était pas un sujet « de société », du fait d'une certaine prise en charge par le collectif de travail , qu'il s'agisse d'entraide ou de veille organisationnelle, dans le sens d'une rotation du personnel sur les postes les plus pénibles.
Par ailleurs, l'engagement politique et syndical permettait aux travailleurs de s'identifier à une classe sociale selon un référentiel partagé. D'une part, cet engagement pouvait servir d'exutoire à certaines formes de souffrance , susceptibles d'être vécues comme collectives plutôt qu'individuelles (cf. l'attente de la « fin du capitalisme » par la CGT). D'autre part, les perspectives d'améliorations, dans le contexte d'une progression continue des droits des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, n'étaient pas invraisemblables.
Aujourd'hui, les salariés en situation de souffrance au travail ne trouvent pas de sens collectif à leur histoire , et ont davantage le sentiment d'être victime d'une injustice personnelle ou de ne pas être à la hauteur de la tâche qui leur est impartie. Par ailleurs, l'amélioration constante des droits ainsi que des conditions matérielles et financières de salariés ne semble plus constituer une tendance de fond irrépressible.
e) Une prévention et une sanction encore insuffisantes des risques psychosociaux125 ( * ) encourus dans l'entreprise
(1) Un droit émergent
Le stress et le harcèlement ont récemment fait l'objet d'accords nationaux qui prennent acte, d'une certaine façon, de l'existence de risques associés aux nouvelles formes de management et d'organisation du travail. Mais ces accords, qui transposent des accords-cadre signés par les partenaires sociaux européens, demeurent largement « déclaratifs » et donc sans effets directs si employeurs et syndicats ne s'en saisissent pas.
• Stress au travail
L'accord cadre européen sur le stress au travail de 2004 a été transposé en France par l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail.
|
L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 2 JUILLET 2008
« L'identification d'un problème de stress au travail doit passer par une analyse de facteurs tels que : - l'organisation et les processus de travail (aménagement du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques d'horaires, degré d'autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis, une mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc.) ; - les conditions et l'environnement de travail (exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l'efficacité, à la chaleur, à des substances dangereuses, etc.) ; - la communication (incertitude quant à ce qui est attendu au travail, concernant les orientations et les objectifs de l'entreprise, une communication difficile entre les acteurs, etc.) ; - et les facteurs subjectifs (pressions émotionnelles et sociales, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d'un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.). L'existence des facteurs énumérés peut constituer des signes révélant un problème de stress au travail. Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l'éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l'employeur. Les institutions représentatives du personnel, et à défaut les travailleurs, sont associées à la mise en oeuvre de ces mesures ». |
Etendu par un arrêté du 6 mai 2009 et donc applicable à l'ensemble des employeurs, mais sans force contraignante, l'accord relatif au stress au travail n'avait été que rarement décliné au niveau des branches et des entreprises lorsqu'en octobre 2009, le ministère du travail décida d'enjoindre 126 ( * ) les entreprises de plus de 1 000 salariés d'engager, avant février 2010, des négociations en vue d'aboutir à un accord ou à un plan d'action sur le stress au travail.
Il n'a pas été prévu davantage de sanction 127 ( * ) , mais une liste distinguant les entreprises étant parvenues à un accord, celles ayant engagé des négociations et celles n'ayant rien fait, a été publiées le 18 février 2010. Cette méthode anglo-saxonne du « name and shame » 128 ( * ) , introduisant un élément de « soft law » 129 ( * ) , a fait l'objet de quelques controverses, aussi bien quant à l'exactitude des listes qu'à la pertinence de la méthode, si bien que, seule, a été maintenue et actualisée la « liste verte » des entreprise ayant signé un accord.
Il est à noter qu'un accord d'entreprise sur le stress au travail a été signé à France Télécom en mai 2010. Insistant sur les facteurs de stress pouvant être liés à l'organisation du travail, aux méthodes de management, à l'environnement de travail, aux conditions de travail, au contenu du travail et à ses exigences, cet accord prévoit la création d'un Comité national de prévention du stress, où siègeront syndicats, direction et conseillers en prévention chargés de faire des propositions à la direction pour un « plan d'actions pluriannuel ».
• Harcèlement et violence au
travail
L'accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, qui constitue la transposition de l'accord cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail de 2007, vient compléter la démarche initiée par l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail. Ses dispositions abordent les aspects organisationnels, les conditions et l'environnement de travail.
|
L'ACCORD DU 26 MARS 2010 SUR LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE AU TRAVAIL Le document rappelle l'obligation de l'employeur de protéger les salariés contre le harcèlement. S'il ne reconnait pas de lien de causalité direct 130 ( * ) entre l'organisation du travail ou le mode de management et les situations de harcèlement et de violence , il admet que « l'environnement de travail peut avoir une influence sur l'exposition des personnes » à ces situations. En revanche, l'accord explique que les phénomènes de stress découlant « de facteurs tenant à l' organisation du travail , l'environnement de travail ou une mauvaise communication dans l'entreprise, peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier ». Selon l'accord, « les mesures visant à améliorer l'organisation, les processus, les conditions et l'environnement de travail et à donner à tous les acteurs de l'entreprise des possibilités d'échanger à propos de leur travail participent à la prévention des situations de harcèlement et de violence au travail. En cas de réorganisation, restructuration ou changement de périmètre de l'entreprise, celle-ci veillera à penser, dans ce nouveau contexte, un environnement de travail équilibré ». Concrètement, « l'employeur, en concertation avec les salariés ou leurs représentants, procèdera à l'examen des situations de harcèlement et de violence au travail lorsque de telles situations sont constatées, y compris au regard de l'ensemble des éléments de l'environnement de travail : comportements individuels, modes de management, relations avec la clientèle, mode de fonctionnement de l'entreprise,... ». |
Bien que l'accord, signé à l'unanimité des syndicats, ait été étendu par un arrêté publié le 31 juillet 2010, son impact semble dépendre essentiellement de la bonne volonté des entreprises , auxquelles il offre un cadre d'analyse et l'amorce d'une méthode. En termes de potentiel d'amélioration des situations critique et surtout de responsabilité effective de l'employeur, l'avancée pourrait demeurer ténue.
Heureusement, depuis 1992, le harcèlement sexuel puis, depuis 2002, le harcèlement moral , sont directement prohibés par le code du travail 131 ( * ) . Les mesures individuelles (affectation, formation, sanction, licenciement...) trouvant leur origine dans un comportement de harcèlement moral sont annulables, la responsabilité, tant du salarié harceleur que de l'employeur 132 ( * ) , peut être engagée, et des sanctions pénales sont encourues.
La jurisprudence civile estime que le harcèlement peut être constitué en l'absence d'intention malveillante 133 ( * ) et que la proscription du harcèlement moral permet même de condamner une méthode managériale faisant peser un risque psychosocial sur un salarié 134 ( * ) : « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Sur la base de cette jurisprudence, le rapport de Mme Sylvie Catala, inspectrice du travail, sur France Telecom, constate que cette entreprise recourt à des « méthodes de gestion caractérisant le harcèlement moral » .
|
UN INSPECTEUR DU TRAVAIL RELÈVE QUE FRANCE
TELECOM PRATIQUE
Dans un rapport de plus de 80 pages transmis au procureur de la République le 4 février 2010, l'inspection du travail accuse la société de « méthodes de gestion caractérisant le harcèlement moral » . Rappelant les réorganisations intervenues depuis la privatisation de l'opérateur historique, l'inspectrice du travail Sylvie Catala s'attarde sur le plan ACT - le volet ressources humaines du plan NexT mis en oeuvre par le PDG Didier Lombard peu après son arrivée en 2005 - et ses 22.000 suppressions d'emploi. Elle observe que « lorsqu'une entreprise supprime 22.000 emplois et fait changer de métier 10.000 personnes, elle s'inscrit normalement dans le cadre réglementaire prévu à cet effet, à savoir la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences. Or ni l'un ni l'autre de ces dispositifs n'ont été mis en oeuvre » au sein de France Télécom. Caractère pathogène de la politique Elle note ensuite que « de 2006 à 2009, des événements se sont produits au sein des établissements de France Télécom répartis sur tout le territoire national, démontrant le caractère pathogène de la politique de réorganisation et de management mise en oeuvre par FT . » S'appuyant sur une citation du DRH Olivier Barberot lors d'une convention (« le déclic se fait sur un projet, sur l'envie d'une vie nouvelle, sur une frustration que l'on ressent chez France Télécom »), l'inspectrice conclut : « c'est donc sur le sentiment de frustration des travailleurs de FT que la direction compte s'appuyer pour qu'ils se réorientent dans le cadre des espaces de développement ou qu'ils quittent la société. » Au bord de la route « Soulignons que dès la phase de mise en route du plan ACT, la direction de France Télécom savait que certains salariés resteraient « au bord de la route » », écrit l'inspectrice entre guillemets, reprenant une déclaration de Louis-Pierre Wenes, l'ex-patron de la France. « La direction a été alertée à maintes reprises non seulement par les CSCHT, les médecins du travail de l'entreprise mais aussi dans certains cas par l'inspection du travail et les Centres régionaux d'Assurance maladie », déplore le rapport. Or les réponses apportées par le groupe à ces alertes, comme les cellules d'écoute, n'ont « pas permis une démarche de prévention » et les autres mesures pour l'essentiel n'ont « pas été déclinées dans les établissements . » Harcèlement moral Dans la rubrique « Qualification juridique » de son rapport, l'inspectrice relève que « les réorganisations, restructurations et les méthodes de management mises en oeuvre au sein de France Télécom sont de nature à provoquer des troubles de la santé mentale », ce qui constitue une infraction aux dispositions du code pénal, ajoutant que « dans les cas les plus graves, l'organisation du travail conduit au suicide ou y contribue ». Au regard du droit du travail, l'inspectrice met en cause l'entreprise pour harcèlement moral : « il ressort des différents cas étudiés et du rapport Technologia que l'employeur a mis en oeuvre des méthodes de gestion du personnel qui ont eu pour effet de fragiliser psychologiquement les salariés et de porter atteinte à leur santé physique et mentale ». (...) Source : La tribune du 10 avril 2010 |
Malgré ces avancées, la réflexion théorique sur la nature du travail et son organisation ne semble pas suffisamment aboutie pour parvenir à une qualification juridique stabilisée des diverses situations envisageables . Dès lors, il semble encore difficile de parvenir à un équilibre entre protection des salariés et sécurité juridique des employeurs, ces derniers devant garder la liberté fondamentale de faire évoluer leurs méthodes sans risquer de se voir condamnés de manière aléatoire sur la base de critères ambigus.
• Défaut de
sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », ces mesures comprenant des actions de prévention, d'information et de formation, ainsi que « la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».
Sur ce fondement de ce concept, qui semble fécond 135 ( * ) , la jurisprudence estime que l'employeur a une « obligation de sécurité de résultat » 136 ( * ) , dont le défaut peut résulter de l'organisation collective de l'entreprise 137 ( * ) . Le rapport précité de l'Inspection du travail relève, pour sa part, que les mesures pour protéger la santé mentale des travailleurs n'ont pas été prises et que « la prévention des risque d'atteinte à la santé (...) n'a pas été planifiée en prenant en compte l'organisation du travail ».
(2) Des institutions efficacement mobilisées ?
Pour une meilleure prise en compte des « risques psycho-sociaux », des institutions représentatives du personnel, particulièrement le CHSCT 138 ( * ) , la médecine du travail, voire l'inspection du travail, peuvent avoir un rôle clé.
Le CHSCT , qui se réunit normalement chaque trimestre, doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de santé, en particulier avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, et avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
|
ARTICLE L. 4612-8 DU CODE DU TRAVAIL « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ». |
D'une façon générale, il analyse les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le CHSCT peut proposer des actions d'information et de prévention.
Les médecins du travail pratiquent une médecine exclusivement préventive dont l'objet est d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Ainsi, ils agissent en vue d'améliorer globalement les conditions de travail.
La mission des inspecteurs du travail consiste, pour ce qui les concerne, à contrôler l'application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects (santé et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel, durée du travail, contrat de travail, travail illégal...). Les inspecteurs du travail recueillent de nombreuses plaintes liées à des cas de harcèlement.
Le deuxième plan Santé au travail 2010-2014 vise à développer une politique de prévention active contre l'ensemble des risques professionnels y compris les risques psycho-sociaux et musculo-squelettiques. Si les objectifs et les axes d'intervention paraissent à la hauteur des enjeux 139 ( * ) , certaines difficultés persistantes, qui tiendraient notamment aux moyens de l'inspection du travail et à l'indépendance du CHSCT ou de la médecine du travail, n'iraient pas dans le sens d'une prévention optimale des risques psycho-sociaux. Nous renvoyons ici à la lecture du rapport précité de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat.
B. UNE PRODUCTIVITÉ EN DEÇÀ DES ATTENTES
A titre de mise en perspective, on rappelle ici la sous-optimalité des performances économiques résultant à long terme ( via une moindre importance accordée à l'investissement en capital humain ou physique) de fortes exigences actionnariales de rentabilité, qui entretiennent souvent un rapport de connexité avec l'acclimatation des nouvelles organisations du travail.
En effet, ces dernières sont généralement adoptées dans la perspective d'améliorer la productivité. Mais, à moyen terme, ces gains directs peuvent, de même, s'avérer en partie hypothétiques lorsque les salariés sont stressés par trop de sollicitations psychologiques et physiques, en arrivant parfois à se poser la question du sens de leur engagement professionnels. Ces personnels ne sauraient donc contribuer, à hauteur des espérances, à la performance de l'entreprise.
1. Coûts objectifs de l'inconfort et sous-optimalité de la performance des entreprises
Les organisations du travail et les modes de management nocifs peuvent contribuer au développement de maladies et à la survenance d'accidents du travail qui débouchent sur des coûts importants pour les entreprises et la société.
L'émergence du stress , qui est fortement lié aux nouvelles modalités de l'organisation productive , a pu donner lieu à des chiffrages qui, pour être marqués par d'importantes marges d'incertitude, montrent que le phénomène est rien moins qu'anodin pour les comptes publics ainsi que ceux des entreprises. Nous reprenons ici les observations de la récente mission d'information sur le mal-être au travail du Sénat.
|
LE COÛT EXORBITANT DU STRESS POUR L'ÉCONOMIE Le stress semble avoir un coût élevé pour l'économie. L'INRS a, en partenariat avec Arts et Métiers Paris Tech, mené une étude sur le coût du stress professionnel en France. La première évaluation, réalisée en 2002, sur la base de données datant de 2000, faisait état d'un coût compris entre 830 millions et 1,6 milliard d'euros. Une actualisation de cette évaluation a été entreprise en 2009 à partir des chiffres datant de 2007. L'estimation du coût a considérablement augmenté puisque celui-ci serait compris entre 1,9 milliard et 3 milliards d'euros. Comme l'a indiqué Valérie Langevin, psychologue du travail à l'INRS lors de son audition 140 ( * ) , ces chiffres, qui intègrent à la fois les coûts directs (dépenses de soins) et les coûts indirects (liés à l'absentéisme, aux cessations d'activité et aux décès prématurés), constituent une évaluation a minima. Les coûts réels du stress sont vraisemblablement nettement supérieurs et ce, pour deux raisons : - les chercheurs n'ont pris en compte qu'un seul facteur de stress, le « job strain » ou « situation de travail tendue » définie par la combinaison d'une forte pression subie et d'une absence d'autonomie dans la réalisation du travail. Or, le « job strain » représente moins d'un tiers des situations de travail fortement stressantes ; - parmi les pathologies liées au stress, les auteurs n'ont retenu que celles qui font l'objet de nombreuses études : les maladies cardio-vasculaires, la dépression et certains troubles musculo-squelettiques (TMS). D'autres maladies sont donc exclues du champ de l'étude. Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 7 juillet 2010 |
Sans déboucher sur un quelconque « chiffrage », le rapport « Lachmann » 141 ( * ) , intitulé « Bien-être et efficacité au travail » 142 ( * ) , estime que, d'une façon générale, plus de « bien-être » au travail débouche sur une amélioration de la performance globale des entreprises : « Parce que social, santé, organisation et management sont indissociables, nous n'avons pas souhaité entrer dans le sujet sous l'angle du seul traitement de la souffrance : pour nous, l'amélioration de la santé psychologique au travail ne doit pas se limiter à la gestion du stress professionnel. Le vrai enjeu est le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale ressource de l'entreprise ».
Ainsi, la prévention des risques psychosociaux n'est qu'un élément d'un enjeu plus large, celui de la « valorisation du bien-être » des salariés dans l'entreprise.
Les propositions de ce rapport pour améliorer le « bien être et l'efficacité au travail » se rattachent d'ailleurs à un certain nombre de problèmes se recoupant assez largement avec ceux qui ont été identifiés dans les pages qui précèdent.
|
LISTE DES PROPOSITIONS DU RAPPORT « LACHMANN » 1. L'implication de la direction générale et de son conseil d'administration est indispensable. L'évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain, et donc la santé des salariés. 2. La santé des salariés est d'abord l'affaire des managers, elle ne s'externalise pas. Les managers de proximité sont les premiers acteurs de santé. 3. Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail. Restaurer des espaces de discussion et d'autonomie dans le travail. 4. Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé. Le dialogue social, dans l'entreprise et en dehors, est une priorité. 5. La mesure induit les comportements. Mesurer les conditions de santé et sécurité au travail est une condition du développement du bien-être en entreprise. 6. Préparer et former les managers au rôle de manager. Affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis des équipes et des hommes. 7. Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d'individus. Valoriser la performance collective pour rendre les organisations de travail plus motivantes et plus efficientes. 8. Anticiper et prendre en compte l'impact humain des changements. Tout projet de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l'impact et la faisabilité humaine du changement. 9. La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l'entreprise. L'entreprise a un impact humain sur son environnement, en particulier sur ses fournisseurs. 10. Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes. Accompagner les salariés en difficulté. Source : rapport intitulé « Bien-être et efficacité au travail - 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail », février 2010. |
2. Un climat de défiance contre-productif pour l'entreprise
Les nouvelles formes d'organisation du travail , lorsqu'elles s'assortissent d'un management dévoyé, sont susceptibles de conduire, en termes de qualité du travail, à une situation fort dégradée au regard de l'idéal plus ou moins libérateur d'accomplissement et de dépassement de soi dans le travail véhiculé par le discours managérial dominant.
Cependant, les abandons en termes de sécurité , au regard de la situation qui prévalait dans la régulation fordiste, apparaissent conséquents, voire disproportionnés.
Le déséquilibre qui en résulte est, en certaines circonstances, flagrant . La crise économique actuelle est de nature à l' aggraver encore, en crispant les détenteurs du capital de l'entreprise sur le « return on equity » tout en accroissant la peur du chômage des « insiders ».
Dès lors, il suffit de peu pour que l' insatisfaction des salariés ne se dégrade en défiance générale vis-à-vis de l'entreprise .
Un management autoritaire et une gestion humaine et salariale inattentive aux efforts des salariés, est constitutive d'un manque de considération , voire de confiance envers le personnel qui suscite, en retour, une certaine forme de défiance envers l'entreprise .
Par ailleurs, le spectacle réitéré, d'une part, de licenciements massifs associés à des délocalisations opérées en dépit de la réalisation de bénéfices et du versement de certaines rémunérations très élevées aux dirigeants et, d'autre part, de suicides de salariés mettant en cause certaines pratiques managériales, donnent aux Français la vision, sans doute caricaturale, de grandes entreprises dont le comportement est aussi peu édifiant qu'elles peuvent être exigeantes envers leur personnel .
Certes, une telle représentation , qui devient familière à la faveur de la médiatisation de mouvements de personnels successifs liés à la fermeture d'unités de production sur le territoire national ou de gestions humaines susceptibles de pousser certains salariés au désespoir, ne saurait correspondre, en réalité, à une pratique courante.
Mais il semble que, par l' indignation suscitée auprès de très nombreux Français, ce type de représentation, volontiers véhiculé par les médias, parvient à diffuser et entretenir , d'une façon générale, une véritable défiance de la part des salariés vis-à-vis de l'entreprise, alors même qu'elle ne résulterait pas objectivement de l'expérience vécue (à laquelle elle peut cependant donner une coloration particulière, entretenant cette défiance).
Quoi qu'il en soit, un sondage réalisé en octobre 2009 de la SOFRES intitulé « salarié et sortie de crise » conclut ainsi que « La rupture du lien entreprise-salarié semble consommée », cette rupture pouvant d'ailleurs être analysée comme s'inscrivant dans le cadre plus général d'une « société de défiance » 143 ( * ) ...
Puis, dans le contexte d'une crise confirmée, qui devrait susciter un resserrement de toutes les parties prenantes autour d'un objectif de survie économique, un sondage IFOP-Le Monde-Michael Page, publié mardi 8 juin 2010, sur la prise en compte du capital humain dans la gestion des grandes entreprises françaises, conclut au contraire à une défiance accrue des salariés vis-à-vis de leur management .
Certes, la « valeur travail » ne semble pas compromise, avec des salariés toujours très « investis » dans des entreprises dont ils partagent globalement les valeurs. Mais une majorité des salariés interrogés estiment ne pas comprendre ou adhérer à la stratégie de l'entreprise (51 %) et ont le sentiment de ne pas être écoutés (55 %).
Or, d'une façon générale, la défiance est contre-productive . Elle favorise des comportements exclusivement orientés par la préservation des avantages individuels, au mépris de l'intérêt collectif. La perte d'esprit d'initiative, le scepticisme quant au bien-fondé des instructions données par la hiérarchie et une moindre adhésion à la culture de l'entreprise sont autant de comportements de nature à compromettre sa compétitivité. Structurellement, elle constitue un frein à l'acclimatation d'organisations apprenantes.
C. UN DIAGNOSTIC À DIFFÉRENCIER
Le propos qui précède, inspiré par la lecture de statistiques globales et l'élucidation de logiques socio-économiques qui s'appliquent typiquement aux grandes entreprises capitalistes, en prise avec la mondialisation, mérite assurément d'être nuancé et décliné selon le type et le contexte particulier aux différentes entreprises.
Dans cette perspective, certains facteurs susceptibles d'alimenter le « déséquilibre » constaté en défaveur des salariés méritent a priori d'être isolés : le type d'organisation du travail, le secteur concerné, l'architecture et le positionnement de l'entreprise dans son environnement productif, la taille des établissements, enfin la catégorie socioprofessionnelle.
1. Selon le type d'organisation ? Une explication en partie tautologique
La distinction établie entre les différents types d'organisation (« apprenantes », « au plus juste », taylorienne et de structure simple 144 ( * ) ) permet de figurer une sorte d'« échelle des risques » de l'inconfort au travail, l'organisation « au plus juste », de par sa diffusion, étant potentiellement la plus nocive pour les salariés, qui se trouvent placés en situation d'« autonomie contrôlée » avec, d'une part, des objectifs de performance et de qualité très ambitieux et, d'autre part, un faisceau de contraintes et de contrôles particulièrement pesant, les rémunérations étant, par ailleurs, tirées par le bas en raison d'une forte exposition à la concurrence.
Le potentiel d'inconfort au travail des organisations tayloriennes, davantage lié aux contraintes physiques, n'est pas moins élevé, mais il ne constitue pas à proprement parler un effet des nouvelles formes d'organisation du travail.
|
PERSISTANCE ET AFFRES DU TAYLORISME « Souvent considéré comme dépassé, le taylorisme n'a pourtant pas complètement disparu du monde industriel, si l'on en croit les témoignages recueillis lors des auditions. La psychologue Marie Pezé 145 ( * ) , en charge de la consultation « Souffrance et travail » au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, a évoqué le cas de ces ouvrières d'usine qui vissent vingt-sept bouchons à la minute. « Pour tenir cette cadence infernale, les ouvrières doivent renoncer à toute activité mentale et se concentrer sur la seule répétition de leur geste de travail. Leur rage et leur frustration sont entièrement tournées vers l'accélération du geste. Lorsque la tension devient trop forte, les ouvrières font des crises de nerfs dans l'atelier, s'allongent sur les brancards prévus à cet effet, prennent des anxiolytiques et retournent au travail une fois la crise passée ». Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 7 juillet 2010 |
L'impact des organisations de « structure simple » peut être considéré comme neutre a priori, les qualités humaines de l'employeur faisant alors la différence dans un environnement globalement peu qualifié. Quant aux organisations apprenantes, si elles procurent une authentique liberté dans le travail, elles paraissent ne pouvoir fonctionner, à l'inverse, que dans un environnement relativement qualifié.
Cette grille de lecture, utile à la compréhension du sujet, s'avère au demeurant peu opérationnelle dès lors qu'on ne connaît pas l'organisation interne d'une entreprise, ou qu'on ignore sa cause. En outre, elle peut apparaître tautologique : si je définis la production « au plus juste » comme une épure organisationnelle présentant toutes les caractéristiques d'une structure potentiellement nocive pour les salariés (cf. l'encadré supra concernant les quatre types d'organisation), dois-je vraiment m'étonner qu'il en soit ainsi ?
Mais ce n'est pas la seule approche envisageable. D'autres critères permettent d'étalonner le jugement global formulé sur l'évolution des conditions de travail, et de présumer utilement de l'organisation et de l'intensité du travail.
2. Selon le secteur ? Une incidence moindre qu'attendu
Vos rapporteurs ne peuvent que rejoindre les conclusions de la mission d'information 146 ( * ) sur le mal-être au travail et la commission des affaires sociales du Sénat, selon lesquelles « le phénomène du mal-être est général .
« Il est répandu tant dans le secteur public que dans le secteur privé et touche les salariés de l' industrie comme des services . Il concerne les jeunes , qui rencontrent souvent des difficultés d'insertion professionnelle, comme les seniors , dont la capacité de résistance peut être émoussée.
« La situation des agriculteurs est l'une des mieux étudiée au travers de l'enquête Eva (Vieillissement en agriculture), menée par la mutualité sociale agricole (MSA) auprès des salariés agricoles. Elle a établi un lien entre l'insuffisance ressentie de la reconnaissance du travail accompli, la consommation de psychotropes et la fréquence des consultations médicales.
« Le mal-être ne concerne pas seulement les salariés mais également les chefs d'entreprise , qui peuvent eux-aussi être soumis à un stress intense ou épuisés par le travail ».
Si l'industrie se prête plus spontanément que les services à des organisations du travail en flux tendu, l' application des principes toyotistes au secteur tertiaire a effectivement tendu à se généraliser depuis les années quatre-vingt-dix ( supra ).
Il en résulte aujourd'hui, suivant une terminologie adoptée par certains observateurs, un nouveau « taylorisme des services », dont les centres d'appel fournissent une illustration emblématique. La standardisation y passe généralement par l'obligation faite aux salariés de suivre un script pendant leurs conversations avec les clients, leur expression se trouvant dépersonnalisée et « mécanisée », parfois jusqu'à l'absurde 147 ( * ) .
3. Selon l'appartenance socio-professionnelle ? Un déséquilibre d'ampleur comparable
Il semble qu'employés et cadres soient potentiellement tout aussi vulnérables, le curseur étant simplement placé différemment sur l'échelle de l'autonomie et des contraintes organisationnelles et de performance.
Toutes les catégories de personnels peuvent souffrir des conséquences de la « lean production », avec un rapport « contraintes de résultat et organisationnelles / autonomie » également défavorable, numérateur et dénominateur tendant à se trouver simultanément majorés pour les cadres.
Cependant, ces derniers sont plus particulièrement amenés à souffrir du stress résultant de la superposition des contraintes professionnelles, qui tendent en outre, pour ces derniers, à engendrer une certaine confusion des temps sociaux. En revanche, seuls les ouvriers et les employés du tertiaire peuvent être amenés à composer avec une organisation taylorienne
4. Le noyau de l'entreprise préservé moyennant une entropie croissante à la périphérie
Au terme d'un calcul économique rigoureux , dont la pratique est de plus en plus systématique, l'entreprise a tendance à externaliser les fonctions étrangères à son « coeur de métier » , pour lequel elle bénéficie des meilleurs avantages comparatifs.
Fournisseurs et sous-traitants, filiales et entreprises alliées sont ainsi sollicités en tant que de besoin au rythme de la production et des projets successifs. Or, nous savons que les conditions de travail sont globalement moins favorables dans les entreprises dépendantes que dans les entreprises donneuses d'ordre, les premières se signalant d'ailleurs par un recours moins fréquent au contrat à durée indéterminée.
Un véritable « déplacement » de la pression au résultat peut alors se faire du centre vers la périphérie de l'entreprise, ses dirigeants pouvant juger plus expédient de demander des efforts supplémentaires à une entité juridique distincte (l'entreprise sous-traitante ou fournisseur) soumise à une concurrence accrue par la mondialisation, qu'à ses propres salariés, souvent plus syndiqués et moins résignés à des concessions concernant leurs conditions de travail.
5. Des conditions de travail sensibles à la taille des établissements
Si, à mesure qu'elle augmente, la taille de l'entreprise semble jouer a priori en faveur des salariés (rémunérations supérieures en moyenne, accords collectifs parfois plus favorables, meilleure surveillance de l'application du droit du travail, instances représentatives du personnel), c'est aussi à partir d'une certaine « taille critique » qu'il devient intéressant d'introduire les nouvelles formes, potentiellement néfastes, d'organisation du travail et de management, car elles nécessitent des investissements importants. On rappelle ici le coût très élevé des progiciels de gestion intégrés ( supra ).
Mais, par delà la taille de l'entreprise, la taille de l'établissement a une incidence notable sur la qualité du « collectif de travail » ( supra ). Au sein d'une entreprise, plus l'établissement au sein duquel on travaille est petit, plus les risques d'isolement et de dégradation des collectif de travail sont grands .
Or, selon l'INSEE, les salariés français travaillent dans des entreprises de plus en plus grandes, mais sur des lieux de travail de plus en plus petits .
Cette tendance paradoxale, amorcée depuis les années soixante-dix, s'observe dans tous les secteurs de l'économie française. Ainsi, en 2006, 33 % des salariés français du privé 148 ( * ) étaient employés dans une entreprise de plus de 1 000 salariés, contre 27 % en 1985. Mais 38 % des actifs salariés appartiennent à un établissement de moins de 20 salariés en 2006, contre 34 % en 1985. Pour sa part, le Conseil économique, social et environnemental 149 ( * ) relève qu'en trente ans 150 ( * ) , la part des salariés travaillant dans des établissements de moins de 50 salariés est devenue majoritaire , passant de 43 % à 53 %.
Cette situation résulte d'une concentration des unités décisionnelles doublée d'un morcellement de la production . Cette tendance se retrouve dans tous les secteurs de l'économie française, et particulièrement dans les services aux entreprises, l'industrie et le commerce de détail.
Elle est de nature à accroître les tensions entre, d'une part, les impératifs de productivité, formulés à partir du centre de décision de l'entreprise et, d'autre part, des difficultés grandissantes pour faire respecter collectivement un seuil d'exigence raisonnable.
* *
*
De nombreux salariés seraient fondés à considérer que leurs conditions de travail, de réalisation personnelle et de rémunération ne sont pas à la hauteur de leur investissement professionnel et des risques accrus qu'ils encourent désormais dans l'entreprise et sur le marché du travail.
La question se pose, à leur endroit, d'un rééquilibrage des termes du « contrat tacite » qui lierait ainsi le personnel (abandonnant un volant de liberté) à son entreprise (apportant sécurité et rémunération). Mais peut-il seulement y avoir, dans l'entreprise ou ailleurs, un contrat sans confiance ?
CHAPITRE III - LA GOUVERNANCE : UN DÉSÉQUILIBRE DES POUVOIRS
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Il n'existe pas un modèle unique de pacte social dans l'entreprise, comme en témoigne l'évolution du concept d'entreprise au cours des deux derniers siècles et la persistance de multiples avatars de cette notion. On observe néanmoins quelques grandes tendances : - au cours du vingtième siècle, en conséquence de la nécessité d'accumuler du capital en vue de l'industrialisation, le pouvoir est passé progressivement de l'entrepreneur familial au manager technocrate, puis aux actionnaires et investisseurs financiers : il en a résulté une progressive dépersonnalisation des relations dans l'entreprise ; - la tertiarisation n'a pas freiné ce processus, au contraire : les salariés travaillent aujourd'hui en moyenne dans des entreprises plus grandes qu'il y a trente ans, mais au sein d'établissements plus petits ce qui accroît le sentiment de distance par rapport aux lieux de décision ; - l'émergence d'entreprises fonctionnant en réseaux (réticulation), sur fond d'externalisation à des fins productives, a aussi modifié les relations entre parties prenantes, les relations interentreprises devenant un facteur déterminant de réalisation du pacte social. La gouvernance des entreprises s'est-elle adaptée à ces évolutions ? - La participation des salariés à la gestion des entreprises s'est développée, en France, grâce à des mécanismes de représentation, d'information et de consultation, plutôt que par l'association aux instances décisionnelles. Parallèlement, le taux de syndicalisation est passé d'environ 30 % à environ 8 % des salariés depuis l'après-guerre. Or, alors que le thème de la réhabilitation de l'entreprise, comme lieu de poursuite de finalités partagées se développait, les excès du capitalisme financier ont au contraire mis l'accent sur les divergences d'intérêts des parties prenantes, divergences qui peinent à s'exprimer et à se résoudre de façon pragmatique, dans la négociation. - Les salariés ont en effet été « oubliés » de la gouvernance , au nom de l'efficacité économique. Tandis que la cogestion apparaît comme un « serpent de mer » du débat politique, la suprématie actionnariale s'est instaurée. Cette suprématie est pourtant contestée tant du point de vue de sa pertinence juridique que de celui de son efficacité économique. Dans ce contexte, les ouvertures réalisées en direction des salariés s'inscrivent davantage dans le sens d'une reconnaissance de la place de l'actionnariat salarié que dans celui d'une prise en compte des intérêts du facteur de production que constitue le travail. |
I. L'ENTREPRISE ET SES PARTIES PRENANTES : VARIATIONS THÉORIQUES ET HISTORIQUES
« Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d'air dans un courant régulier d'entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif. Lorsque dans un pays le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, il risque de s'accomplir dans des conditions défectueuses. »
J.M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie
L'entreprise n'est pas un concept juridique précisément défini, mais plutôt une construction doctrinale en devenir . Comme la notion de pacte social, celle d'entreprise est à la croisée de plusieurs disciplines : les relations entre ces notions sont d'autant plus difficilement appréhendables que le contenu de chacun des concepts est susceptible d'interprétations diverses. S'il est admis qu'une forme de contrat social légitime la souveraineté de l'État et partant, l'ordre juridique étatique, ce schéma n'est pas directement transposable au monde de l'entreprise, qui ne fonctionne ni avec les mêmes objectifs ni selon les mêmes modalités que la société politique. Néanmoins, on peut supposer que le fonctionnement et l'organisation de chaque entreprise repose bien sur un « pacte social » dont l'équité et l'efficacité peuvent être discutées.
L'entreprise a connu de multiples avatars historiques , depuis l'abolition des corporations par la loi Le Chapelier en 1791, jusqu'à l'avènement de la grande multinationale cotée sur les marchés financiers. Ce concept désigne toujours aujourd'hui des réalités multiples : entreprise familiale ou financiarisée, locale ou mondiale, agricole, industrielle ou de services, sans que l'une des facettes de ces alternatives soit forcément exclusive des autres, ce qui complique l'analyse.
Avant d'envisager l'avenir de l'entreprise, et des entreprises, se pencher sur leur passé permet de mesurer le chemin parcouru depuis l'avènement concomitant de la démocratie et du capitalisme. Ce chemin peut être caractérisé de deux manières :
- d'une part, le concept d'entreprise a progressivement émergé comme lieu de définition d'un pacte social régulé par la puissance étatique ;
- d'autre part, l'évolution des entreprises réelles, en conséquence de mutations économiques structurelles, a modifié la relation des parties prenantes à l'entreprise .
A. UN CONCEPT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE CONSTRUCTION RÉCENTE
Le concept d'entreprise, considéré comme ayant longtemps été un « point aveugle » de la théorie, ou encore une « boîte noire », « insaisissable et incontournable » 151 ( * ) , a pourtant progressivement émergé au vingtième siècle, tant dans les disciplines économiques que juridiques.
1. Entreprise et marché
Le concept d'entreprise fut tout d'abord ignoré de l'analyse économique néoclassique, dans laquelle les ressources sont allouées par le marché. Dans ce schéma, les entreprises, lieu de combinaison des facteurs de production, sont un élément transparent du système économique .
La première tentative d'identification de l'apport économique de l'entreprise est celle de l'économiste né au Royaume-Uni Ronald Coase 152 ( * ) . Coase conteste le présupposé d'un système économique coordonné par les prix, fonctionnant comme un « organisme » plutôt que comme une « organisation », ce qui ne correspond pas d'après lui au « monde réel ». Citant son collègue DH Robertson, il évoque l'existence d' « ilots de pouvoir conscient dans un océan de coopération inconsciente ». A l'extérieur de la firme, la production dépend des mouvements de prix, la coordination étant assurée par le marché. A l'intérieur de la firme en revanche, on trouve, en lieu et place de la structure de marché, une structure dans laquelle c'est l'entrepreneur qui coordonne l'activité, alloue les ressources et contrôle la production.
L'entrepreneur joue dans l'entreprise le rôle que les prix jouent sur les marchés, car ce rôle de coordination permet une réduction des coûts . La régulation par les prix engendre en effet de forts coûts de collecte d'information, que l'existence de l'entreprise permet de diminuer . Celle-ci réduit par ailleurs le nombre de contrats nécessaires pour combiner les différents facteurs de production, et permet d'inscrire l'activité de l'entreprise dans la durée . L'entrepreneur optimise ses coûts en arbitrant en permanence entre internalisation et externalisation des tâches, en sorte d'égaliser les coûts de ces deux types de fonctionnement, étant entendu que la fiscalité peut introduire des incitations supplémentaires en faveur de tel ou tel type d'organisation.
L'entreprise, selon cette analyse, est par conséquent le « système de relations qui apparaît lorsque l'allocation des ressources dépend de l'entrepreneur ».
Au sein de ce système de relations, le contrat de travail est un maillon essentiel. Ce contrat se distingue d'une relation de marché par l'existence du lien de subordination , qui est l'expression du pouvoir de direction de l'entrepreneur.
L'émergence du concept d'entreprise dans la théorie économique s'est accompagnée de constructions doctrinales visant à acclimater ce concept en droit.
2. Entreprise et droit
L'entreprise repose sur de multiples supports juridiques , mais n'a longtemps pas été en soi un concept de droit.
Elle trouve la légitimité dans les principes constitutionnels de droit de propriété et de liberté d'entreprendre , énoncés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, complétés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
|
LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'entreprendre a fluctué au cours des vingt dernières années. Ces tâtonnements ne portent pas sur le fondement de cette liberté (art. 4 de la Déclaration de 1789), mais sur son degré de protection, ainsi que sur l'intensité du contrôle de sa limitation par le Conseil. Pour résumer cette évolution, on peut dire qu'à partir d'une formulation initiale protectrice (1982), le Conseil a eu tendance à minorer progressivement la protection de la liberté d'entreprendre. Ce n'est que depuis 1997 que s'opère une évolution inverse, débouchant sur le considérant très ferme figurant dans la décision de janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Désormais, la liberté d'entreprendre n'occupe plus de rang subalterne au sein des libertés et le Conseil vérifie que la conciliation opérée par le législateur entre cette liberté et d'autres exigences constitutionnelles ou des motifs d'intérêt général antagonistes n'est pas excessivement ou inutilement déséquilibrée. Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 "(...)Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre (...) " Source : services du Conseil constitutionnel (2001) |
Par la suite, la loi a progressivement instauré un cadre commun de relations sociales, enraciné dans les circonstances historiques nationales, dont la fonction première fut d'instaurer des protections pour remédier à l'inégalité économique entre employeurs et salariés . L'après-guerre fut propice au développement de l'État providence, comme en témoignent en France les principes du préambule de la Constitution de 1946, relatifs à la liberté syndicale, au droit de grève et à la participation des travailleurs à la gestion des entreprises. L'économie de marché est ainsi fondée sur des États de droit, instaurant des règles indispensables au bon fonctionnement du système économique.
|
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 (EXTRAITS) - Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. - Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. - Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. - Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. |
Le pacte social vécu dans l'entreprise est fondé par conséquent sur un lien de subordination, conséquence du pouvoir de direction qui s'exerce dans l'entreprise, compensé par l'existence de diverses protections légales. Il se fonde aussi sur l'affectio societatis qui doit animer les propriétaires de son capital.
Dans ce cadre, l'entreprise est d'abord une addition de contrats , encadrés par des dispositions légales d'ordre public. Ces contrats sont notamment les suivants :
- le contrat de société : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » 153 ( * ) ;
- le contrat de travail , qui existe dès l'instant où une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur) ;
- les contrats permettant à l'entreprise de détenir des actifs, de s'endetter, de choisir des sous-traitants, de définir ses relations avec ses distributeurs, ses clients, etc.
Chaque partie-prenante participe ainsi à la vie de l'entreprise moyennant l'existence de contrats qui fixent les contreparties de ce concours et sont en constante évolution.
La doctrine a toutefois complété cette approche purement contractuelle de l'entreprise par une dimension institutionnelle. Dans cette perspective, l'entreprise est analysée comme une organisation c'est-à-dire comme une communauté dotée de règles de fonctionnement. Cette perspective aboutit inéluctablement à poser la question de la démocratisation de l'entreprise.
L'analyse institutionnelle, complétée par l'examen des multiples retombées des actions des entreprises, bien au-delà de la sphère de leurs cocontractants, peut aboutir à considérer l'entreprise comme un ordre juridique propre, émanant de l'exercice d'un pouvoir privé, parallèlement et parfois en concurrence avec les États :
« Les problèmes posés par la globalisation de l'économie ne peuvent être traités que s'ils sont abordés dans le cadre d'une théorie juridique qui reconnaisse l'existence, à un niveau différent de celui des États, d'ordres juridiques déterritorialisés ayant une rationalité propre, qui n'entrent pas dans le cadre confortable d'une vision de la société régulée de manière souveraine par les États » 154 ( * ) .
La concurrence entre pouvoirs publics et privés a de multiples conséquences sur le long terme. Elle modifie les modes de fonctionnement respectifs des États et des entreprises, induisant de nouvelles formes de droit moins autoritaires et plus partenariales , comme l'avait souligné un colloque de votre Délégation à la planification en date du 23 janvier 2007 155 ( * ) .
Le concept d'entreprise a ainsi progressivement émergé, d'abord comme communauté, puis comme institution, voire comme ordre juridique.
Cette évolution vers l'institutionnalisation de l'entreprise est aujourd'hui contrebalancée par l'insertion de celle-ci au sein de réseaux, conçus comme une voie d'optimisation entre institutions et contrats. Ces réseaux instaurent de nouvelles formes de hiérarchies plus souples et plus informelles, sur des fondements contractuels plutôt qu'institutionnels. Cette tendance a permis d'introduire davantage de flexibilité dans l'organisation des entreprises. De fait, elle diminue l'effectivité des branches du droit fondées sur l'entreprise comme institution , notamment le droit du travail. Ce processus de réticulation affecte d'ailleurs non seulement les relations des entreprises entre elles, mais aussi leur organisation interne, comme en témoignent l'évolution récente du management.
L'entreprise cherche ainsi sa voie entre deux impératifs pour partie contradictoires :
- la stabilité qu'elle a pour objet d'introduire dans les relations économiques : Ronald Coase la considérait comme un mode de « planification » permettant de faire l'économie d'un certain nombre de coûts résultant du recours au marché ;
- et la flexibilité que les fluctuations inhérentes à l'économie de marché rendent nécessaire.
Cette évolution du concept d'entreprise n'est pas séparable de l' histoire qui a contribué à sa formation. Par ailleurs, elle ne doit pas conduire à négliger la diversité des entreprises , qui demeure importante, au-delà des idéaux-types utiles à la réflexion.
B. DES RÉALITÉS DE PLUS EN PLUS CONTRASTÉES
L'entreprise a connu, et continue de connaître, de multiples avatars.
1. Du capitalisme familial à l'actionnariat de masse
Dans le modèle de l'entreprise familiale , le patron agit dans l'intérêt de la famille et, dans une version un peu apologétique, des employés, considérés comme membres d'une famille élargie .
Dans ce système, le dirigeant fondateur connaît quatre limites à son pouvoir 156 ( * ) :
- il doit assurer la pérennité d'une entreprise , dont le nom se confond généralement avec celui de la famille : au-delà de son destin personnel, le dirigeant suit une stratégie de long terme visant la survie de l'entreprise et du groupe familial ;
- il doit afficher des valeurs morales manifestant son exemplarité tant à sa famille qu'à son environnement social local ;
- il a le devoir d'organiser une succession viable , ce qui le place là encore dans la longue durée ;
- il doit maintenir l'indépendance de son entreprise, c'est-à-dire gérer la croissance de celle-ci tout en contrôlant son actionnariat.
Or le modèle familial s'est justement heurté à la nécessité d'accumuler toujours davantage de capitaux pour accompagner la révolution industrielle. L'industrialisation a modifié les conditions de réalisation du pacte social.
Les sociétés du dix-neuvième siècle étaient très majoritairement des sociétés de personnes, dans lesquelles le patrimoine de l'entreprise se confondait avec celui de son propriétaire. L'entrepreneur répondait des dettes de l'entreprise, au besoin par ses biens personnels. L'entreprise et son fondateur étaient alors indissolublement liés. La forme de la société en commandite par actions, réformée en France par une loi de 1856, a permis de répondre aux besoins croissants de capitaux, avant la libéralisation de la société anonyme par la loi du 24 juillet 1867, qui supprima l'autorisation préalable à leur création et permit l'essor de cette forme juridique jusque là très minoritaire en France.
Ce modèle, marqué par son origine familiale, est celui de l'actionnaire apporteur de fonds mais reconnaissant la légitimité et le pouvoir de l'entrepreneur.
Ce modèle fut bouleversé par l'élargissement de l'actionnariat , en réponse à l'accroissement de la taille des entreprises , dont les effets apparurent progressivement, la figure de l'entrepreneur étant remplacée par celle du manager technocrate , dont la légitimité est fondée sur le savoir, tandis que les actionnaires sont considérés comme des rentiers, passifs car non légitimes à « gouverner » l'entreprise .
Cette évolution est décrite dans l'ouvrage classique d'Adolf Berle et Gardiner Means, The modern corporation and private property (1932) : constatant l'accroissement de la taille des entreprises américaines depuis la fin du dix-neuvième siècle, et le fractionnement de leur capital, les auteurs en déduisent une modification de la nature des entreprises capitalistes. D'après Berle et Means, la séparation de la propriété de l'entreprise et de sa direction fait qu'il n'y a plus confusion nécessaire des intérêts de l'entreprise et de ses dirigeants. La dilution de l'actionnariat entraîne sa passivité et empêche la formation de contre-pouvoirs efficaces à la poursuite des intérêts privés des managers.
A la suite de la crise des années 1970, c'est le pouvoir des managers qui a été remis en cause , parallèlement à la massification de l'actionnariat. Les actionnaires et investisseurs financiers ont progressivement revendiqué un retour sur investissement prédéterminé et un pouvoir de contrôle sur la stratégie (cf chapitre consacré à la gouvernance).
Au-delà de cette succession d'idéaux-types, la multiplicité des figures de l'entreprise a perduré. Cette diversité ne saurait être négligée. Elle n'exclut toutefois pas une évolution générale, vers une dépersonnalisation des rapports à l'entreprise.
2. Une modification du rapport à l'entreprise
En conséquence de l'accroissement de la taille des entreprises, on observe une concentration de plus en plus importante des emplois dans les plus grandes , ce qui ne signifie pas pour autant que les salariés travaillent au sein d'unités de taille accrue.
La tertiarisation a au contraire favorisé l'émergence de groupes fonctionnant en réseaux , ce qui implique une modification du rapport des parties prenantes, notamment des salariés, à l'entreprise.
a) La diversité des entreprises
La France compte environ 3 millions d'entreprises , dont environ 1,2 million ont au moins un salarié . 1,8 millions d'entreprises n'ont pas de salariés.
990 000 entreprises ont entre 1et 9 salariés.
487 entreprises ont plus de 2 000 salariés.
|
LA NOTION D'ENTREPRISE D'APRÈS LA NOMENCLATURE
DE L'INSEE
D'après le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, pris en application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), et conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 696/93 du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté, l'entreprise se définit comme : « la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes ». Les entreprises sont réparties en quatre catégories, en fonction de leur taille, de leur chiffre d'affaires annuel et de leur total de bilan. Ces catégories sont les suivantes : - les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ; - les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ; - les entreprises de taille intermédiaire (ETI) occupent moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros ; - les grandes entreprises (GE) sont celles qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes. La notion d'entreprise doit être distinguée de deux autres concepts : l'unité légale et le groupe d'entreprises. - l'unité légale désigne la société au sens juridique du terme ; - le groupe d'entreprises est le rassemblement des entreprises tenues par des liens juridico-financiers. Le dénombrement des entreprises concerne les unités inscrites au REE (Répertoire des entreprises et des établissements - SIRENE) qui exercent une activité économique réelle. Il englobe des entreprises telles que les définit EUROSTAT, mais aussi des organismes dont le fonctionnement n'est pas financé par une activité marchande. Selon la définition retenue par l'Office statistique des Communautés européennes, EUROSTAT, une entreprise est « une unité organisationnelle de production de biens et services marchands jouissant d'une autonomie de décision » . Trois points fondamentaux caractérisent l'entreprise : - Une entreprise exerce une activité économique réelle ; - Une entreprise produit des biens et/ou des services marchands ; - Une entreprise dispose de l'autonomie de décision. |
ENTREPRISES SELON L'ACTIVITÉ ET LA FORME JURIDIQUE (au 1 er janvier 2008)
|
Taille en nombre de salariés |
Total |
dont entreprises de 10 à 249 salariés |
|||||||
|
0 |
1 à 9 |
10 à 49 |
50 à 199 |
200 à 499 |
500 à 1999 |
2 000
|
|||
|
Industries agricoles et alimentaires |
20 880 |
35 620 |
6 238 |
1 053 |
265 |
120 |
16 |
64 192 |
7 376 |
|
Industries hors IAA |
86 841 |
62 696 |
26 776 |
6 129 |
1 402 |
627 |
121 |
184 592 |
33 370 |
|
Construction |
198 103 |
171 215 |
27 609 |
2 172 |
259 |
139 |
18 |
399 515 |
29 874 |
|
Commerce |
378 151 |
248 730 |
38 495 |
5 452 |
829 |
317 |
83 |
672 057 |
44 225 |
|
Transports |
51 044 |
26 687 |
9 677 |
2 033 |
398 |
126 |
32 |
89 997 |
11 840 |
|
Activités financières |
31 742 |
17 689 |
2 072 |
560 |
179 |
192 |
63 |
52 497 |
2 690 |
|
Activités immobilières |
147 842 |
39 788 |
3 475 |
499 |
121 |
38 |
2 |
191 765 |
4 024 |
|
Services aux entreprises |
352 203 |
151 929 |
28 081 |
4 364 |
894 |
414 |
116 |
538 001 |
32 723 |
|
Autres services |
545 899 |
235 057 |
25 858 |
3 697 |
419 |
111 |
36 |
811 077 |
29 698 |
|
Total |
1 812 705 |
989 411 |
168 281 |
25 959 |
4 766 |
2 084 |
487 |
3 003 693 |
195 820 |
ENTREPRISES SELON LE NOMBRE DE SALARIÉS ET L'ACTIVITÉ (au 1 er janvier 2008)
|
Personnes physiques |
Personnes morales |
Total |
||||
|
Secteur d'activité |
dont commerçants |
Total |
dont
|
dont SA |
Total |
|
|
Industries agricoles et alimentaires |
2 115 |
34 813 |
22 815 |
1 479 |
29 379 |
64 192 |
|
Industrie (hors IAA) |
3 614 |
60 727 |
90 176 |
10 910 |
123 865 |
184 592 |
|
Construction |
1 359 |
203 155 |
180 599 |
3 397 |
196 360 |
399 515 |
|
Commerce |
191 554 |
289 612 |
321 571 |
14 668 |
382 445 |
672 057 |
|
Transports |
14 114 |
44 178 |
36 845 |
2 303 |
45 819 |
89 997 |
|
Activités financières |
7 766 |
21 703 |
14 758 |
3 244 |
30 794 |
52 497 |
|
Activités immobilières |
20 873 |
59 389 |
85 410 |
5 946 |
132 376 |
191 765 |
|
Services aux entreprises |
18 566 |
188 978 |
247 387 |
17 337 |
349 023 |
538 001 |
|
Autres services |
99 135 |
557 008 |
205 542 |
5 307 |
254 069 |
811 077 |
|
Total |
359 096 |
1 459 563 |
1 205 103 |
64 591 |
1 544 130 |
3 003 693 |
Source : INSEE
b) La modification du rapport à l'entreprise
Les salariés du secteur privé travaillent aujourd'hui dans des entreprises plus grandes qu'il y a trente ans. Cette évolution s'est faite au détriment des entreprises de taille moyenne, alors que les petites entreprises concentrent toujours autant de salariés.
Cet accroissement de la concentration de l'emploi s'est accompagné d'une diminution moyenne de la taille des lieux de travail (établissements).
Les principaux déterminants de cette situation sont à rechercher dans la modification de la nature des emplois :
- d'une part, l'emploi a fortement diminué dans les grands sites industriels ;
- d'autre part, il a progressé dans le secteur des services, au sein de petits établissements 157 ( * ) appartenant souvent à de grandes entreprises.
RÉPARTITION DE L'EMPLOI EN FONCTION DE LA TAILLE
DES ÉTABLISSEMENTS
ET DES ENTREPRISES
|
en % |
|||||
|
Nombre de salariés |
Établissement |
Entreprise |
|||
|
1985 |
2006 |
1985 |
2006 |
Effectifs en 2006
|
|
|
1-9 |
24 |
26 |
22 |
21 |
3 300 |
|
10-19 |
10 |
12 |
9 |
9 |
1 450 |
|
20-49 |
18 |
18 |
15 |
13 |
2 000 |
|
50-250 |
25 |
26 |
18 |
15 |
2 350 |
|
250-1 000 |
15 |
14 |
10 |
8 |
1 250 |
|
1 000-5 000 |
6 |
4 |
10 |
12 |
1 900 |
|
5 000 et + |
2 |
1 |
17 |
21 |
3 300 |
|
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 550 |
|
Lecture : en 2006, 21 % des salariés du secteur privé travaillaient dans une entreprise de moins de 10 salariés, ce qui représente environ 3,3 millions de salariés. |
|||||
|
Champ : salariés des entreprises privés hors agriculture et ex-GEN (encadré) de France métropolitaine. |
|||||
|
Source : UNEDIC, traitement Insee |
|||||
Les salariés travaillent aujourd'hui, en moyenne, dans des lieux de production plus petits, mais dépendant de structures plus grandes (société ou groupe). La taille moyenne des établissements tertiaires est en effet, en moyenne, plus petite que celle des établissements industriels.
Ces évolutions ont conduit progressivement à une modification du rapport des parties prenantes, notamment les salariés, à l'entreprise. L'éloignement des sièges sociaux , combiné au contrôle accru d'un actionnariat anonyme , précédemment évoqué, a créé un fossé entre l'entreprise et ses salariés, contribuant à la crise du pacte social .
L'entreprise peine de plus en plus à fournir repères et identité à ses salariés. Le trio actionnaires-dirigeants-salariés semble davantage marqué par les conflits d'intérêts qui le traversent, que par la communauté qui devrait l'animer.
Les repères traditionnels ne permettent pas de répondre au défi ainsi posé, dans la mesure où la référence aux classes sociales ne répond que très imparfaitement à la question de la définition des parties prenantes : par exemple, l'actionnariat s'est dilué au point de concerner, non seulement les dirigeants et les salariés d'une entreprise, mais plus largement l'ensemble des ménages.
Le trio actionnaires-dirigeants-salariés n'est, au demeurant, pas un cadre d'analyse exhaustif , en conséquence de multiples évolutions, notamment l'émergence de problématiques mondiales, telles que l'environnement, auxquelles les États ne peuvent apporter, seuls, de réponse satisfaisante. Il existe à l'évidence des niveaux de responsabilité multiples, dont la désignation, problème par problème, est lourde d'enjeux.
Par ailleurs, ces constats militent pour une réflexion renouvelée sur la gouvernance des entreprises.
Le préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », a été mis en oeuvre, en France, en développant les mécanismes de représentation collective, d'information et de consultation des salariés dans l'entreprise , plutôt que par association de ceux-ci aux instances de gouvernement de l'entreprise.
S'agissant de la gouvernance, la doctrine a oscillé depuis un siècle entre :
- une vision « contractuelle » , qui fait prévaloir l'hétérogénéité des intérêts des acteurs de l'entreprise ;
- et une vision « institutionnelle », considérant l'entreprise comme une entité autonome, poursuivant des finalités partagées par l'ensemble des parties prenantes.
La première approche , insistant sur l'antagonisme des intérêts entre apporteurs de capital et de travail, fut longtemps et demeure pour une large part celle des organisations professionnelles tant patronales que syndicales .
La seconde approche , dont les racines sont à rechercher dans le courant personnaliste chrétien, est plutôt de nature doctrinale et politique. Elle préconise en quelque sorte une « troisième voie » associant l'ensemble des acteurs dans un projet commun , sans remise en cause de la propriété privée 158 ( * ) .
Les auditions effectuées par vos rapporteurs ont témoigné de la persistance de cette ligne de partage.
Pour l'avenir, il est tentant de penser que la chute des régimes communistes d'une part, et la mise en évidence des excès du capitalisme financier d'autre part, pourraient conduire à privilégier un retour de balancier vers une conception plus solidaire de l'entreprise , impliquant une certaine « démocratisation » de son fonctionnement. Cette démocratisation n'entrerait pas nécessairement en contradiction avec les objectifs de productivité et de compétitivité de l'entreprise.
II. LA PLACE DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE : UNE REPRÉSENTATION COLLECTIVE N'ASSURANT QU'UNE PARTICIPATION RÉSIDUELLE À LA GESTION
Depuis 1936, les dispositifs législatifs visant à renforcer la négociation collective et à accroître l'information et la consultation des salariés ont été multipliés.
Cette multiplication n'est-elle pas toutefois le symptôme de leurs faiblesses intrinsèques ?
La réforme du droit syndical et du droit des élections professionnelles pourrait, à l'avenir, renforcer la légitimité du dialogue social dans l'entreprise, et accroître l'utilité des mécanismes de représentation collective.
Il convient de rappeler ici les principaux mécanismes de représentation collective des travailleurs mis en place depuis 1936 et régulièrement réajustés pour tenir compte des mutations économiques et sociales. Ce droit résulte de la combinaison historique de dispositions relevant tantôt de la conception électorale, tantôt de la conception syndicale de la représentation, qui convergent aujourd'hui.
A. LE PAYSAGE SYNDICAL : ADHÉSIONS ET IMPLANTATIONS
|
FONDEMENTS DU DROIT SYNDICAL Constituant un délit pénal entre 1791 (décret d'Allarde, loi le Chapelier) et 1864 (abolition du délit de coalition), les syndicats professionnels furent légalisés par la loi du 21 mars 1884 (loi Waldeck-Rousseau), correspondant à un « retour à la vie juridique du fait collectif 159 ( * ) ». Le préambule de la constitution de 1946 fit de cette liberté un droit constitutionnel. : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Les accords de Grenelle (1968) reconnurent la représentation syndicale dans l'entreprise et furent suivis de la proclamation d'un droit à la négociation collective (1971), rendue obligatoire dans les branches et dans les entreprises par les lois Auroux (1982). Aujourd'hui, l'article L. 2131-1 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». |
1. Le déclin de la syndicalisation
Depuis l'après-guerre, le paysage syndical français s'est progressivement diversifié sous l'influence de plusieurs courants idéologiques. Il en résulte un nombre élevé d'organisations syndicales , en contraste avec la situation des autres pays européens, généralement dominés par un petit nombre d'organisations syndicales.
L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU PAYSAGE SYNDICAL
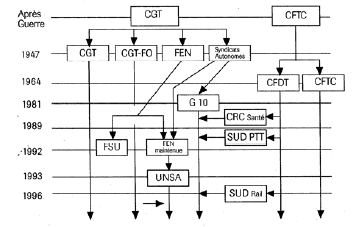
Source : Hadas-Lebel (2006)
Au cours de la même période, le taux de syndicalisation est passé d'environ 30 % à environ 8 % des salariés et 5 % dans le secteur privé.
ÉVOLUTION DU TAUX DE SYNDICALISATION EN FRANCE DEPUIS L'APRÈS-GUERRE
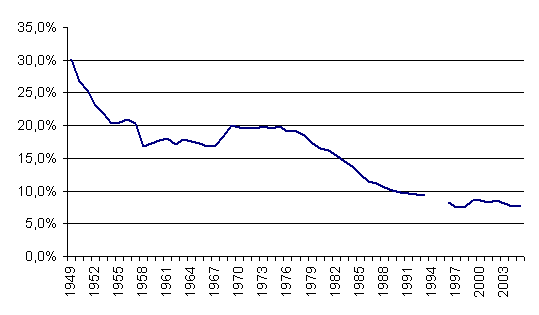
Par comparaison, le taux de syndicalisation moyen en Europe (UE à 25) est estimé à 25 %. La France a le taux de syndicalisation le plus faible de tous les pays de l'Union européenne à 25. Ces divergences sont en partie le reflet de modèles distincts de représentation des salariés, puisque dans certains pays l'adhésion est obligatoire pour obtenir le bénéfice de certaines contreparties. En Suède, par exemple, où le taux de syndicalisation est de 71 %, les syndicats négocient des avantages pour leurs seuls adhérents ; en Belgique, où 53 % des salariés sont syndiqués, le versement des allocations chômage est conditionné à une adhésion syndicale préalable.
TAUX DE SYNDICALISATION (2007)
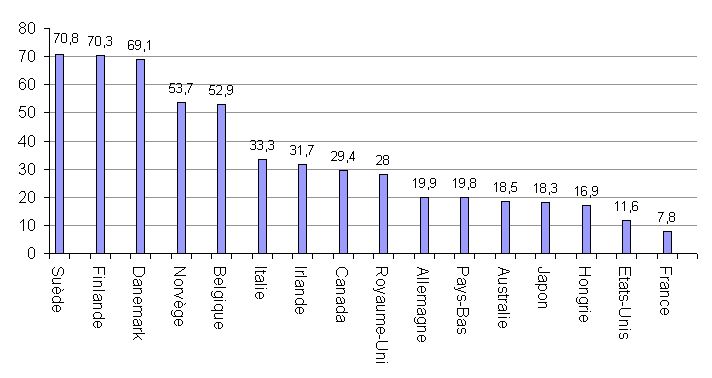
Source : OCDE
Le déclin du syndicalisme n'est pas propre à la France, mais commun à l'ensemble des pays de l'OCDE. En Allemagne, par exemple, il a chuté de 27 % à 20 % entre 1997 et 2007.
Ce déclin est lié à celui de la société industrielle : la tertiarisation, l'individualisation des relations de travail et la diversification des emplois, ainsi que l'augmentation du chômage ont été des facteurs de ce déclin.
Parmi les principaux déterminants de l'adhésion syndicale et de la présence syndicale sur le lieu de travail , on distingue en effet 160 ( * ) :
- la nature publique ou privée de l'employeur (la syndicalisation est supérieure dans les collectivités publiques) ;
- la taille de l'établissement (la syndicalisation plus forte dans les grands établissements que dans les petits) ;
- le secteur d'activité (la présence syndicale est forte dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des transports, de l'éducation...);
- le niveau de qualification (les cadres et professions intellectuelles sont plus syndiqués que les ouvriers et employés) ;
- le niveau de revenu (les mieux rémunérés sont plus syndiqués);
- le sexe (les hommes adhèrent plus souvent à un syndicat que les femmes) ;
- l' âge (plus l'âge augmente plus le taux de syndicalisation est élevé);
- le statut de l'emploi (les formes flexibles d'emploi représentent un obstacle à la syndicalisation).
Ainsi par exemple :
- S'agissant des variations en fonction du statut de l'emploi, le taux de syndicalisation est de :
• 16,7 % pour les titulaires de la
fonction publique
• 6,5 % pour les salariés sous CDI
à temps complet
• 5,8 % pour les salariés sous CDI
à temps partiel
• 3 % pour les travailleurs sous CDD
• 0,9 % pour les intérimaires.
- En distinguant en fonction de la taille de l'établissement, le taux de syndicalisation est de :
• 4,1 % dans les établissements
d'au plus 5 salariés
• 11,4 % dans les établissements de
100 salariés et plus.
2. La progression de l'implantation syndicale
Le constat du déclin syndical doit néanmoins être nuancé par un examen de l'implantation syndicale, qui a, pour sa part, progressé . Ainsi, en 2005 :
- 56 % des salariés déclarent qu'un ou plusieurs syndicats sont présents dans leur entreprise ou leur administration, contre 50,3 % en 1996 ;
- 41 % des salariés des entreprises et des administrations déclarent être couverts par un syndicat sur leur lieu de travail, contre 37,5 % en 1996.
Par ailleurs, 90 % des salariés en France sont couverts par une convention collective , ce qui signifie que de nombreux salariés profitent des avantages du syndicalisme sans en payer le prix, le modèle français de représentation des salariés incitant à des comportements de « passagers clandestins ».
LA SYNDICALISATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ (PÉRIODE 2001-2005)
|
% de salariés syndiqués |
% de salariés avec syndicat sur le lieu de travail |
|
|
Industrie |
6,1 |
53,4 |
|
BTP |
2,2 |
17,5 |
|
Commerce |
2,8 |
20,4 |
|
Transports, télécommunications |
5,6 |
44,4 |
|
Banque, assurance |
8,9 |
47,4 |
|
Services aux entreprises |
4,2 |
24,5 |
|
Éducation, santé, action sociale (secteur privé) |
7,0 |
37,9 |
|
Hôtels, cafés, restaurants, services aux particuliers |
4,6 |
11,8 |
Source : INSEE, DARES
Si la France a le plus faible taux de syndicalisation observé dans l'UE, le pourcentage de salariés pour lesquels un syndicat est présent dans l'entreprise (ou l'administration) y est en revanche supérieur à la moyenne européenne.
Les disparités de taux de syndicalisation en Europe, largement dépendantes des contextes historiques et juridiques nationaux, doivent donc être interprétés avec prudence.
Le faible taux de syndicalisation français résulte pour partie du fait que la France n'a pas opté pour un syndicalisme de services , comme celui des pays scandinaves et de Belgique, par exemple. Ainsi, en France, les syndicats négocient pour l'ensemble des salariés et non pour leurs seuls adhérents. Les règles de représentativité instaurées dans l'après guerre (1950), limitant le pluralisme syndical, et permettant la signature d'accords par des syndicats minoritaires, n'ont pas favorisé la recherche par les syndicats de nouveaux adhérents. Ceux-ci ont privilégié un développement par l'implantation dans le plus grand nombre d'entreprises, plutôt que par l'adhésion du plus grand nombre de salariés.
Aux facteurs économiques et sociaux du déclin syndical il faut donc ajouter les déterminants institutionnels, dont le rôle est probablement essentiel.
B. LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL FACE AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
1. Panorama des institutions représentatives du personnel (IRP)
Les institutions représentatives du personnel (IRP) ont connu des adaptations constantes depuis leur instauration en 1936 puis 1946. Elles sont encore l'objet, en 2010, de négociations en vue d'une réforme.
La loi prévoit l'élection de deux institutions représentatives du personnel (IRP) :
- les délégués du personnel (DP) , élus dans les établissements de plus de 10 salariés ;
- les comités d'entreprise (CE) , élus dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Depuis 1993, dans les entreprises de moins de 200 salariés, ces deux institutions peuvent être fusionnées en une délégation unique du personnel .
Par ailleurs, la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), chargé de veiller à la santé et à la sécurité des salariés sur leur lieu de travail, est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. Il est composé du chef d'établissement et d'une délégation de représentants du personnel désignés par les membres du CE et les délégués du personnel.
En réponse aux mutations induites par l'internationalisation des entreprises et leurs restructurations, l'existence des CE a été complétée par la mise en place de comités de groupe , par la loi du 28 octobre 1982, qui ont pour fonction d'assurer la représentation des salariés au niveau où les orientations majeures sont décidées. Ils ne sont pas nécessaires dans les entreprises qui ont mis en place un comité d'entreprise européen , en application de la directive 94/4/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs .
Quant à la représentation du personnel dans les petites entreprises, la loi prévoit depuis 1982 la possibilité d'élire des « délégués de site » dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus (article L. 2312-5 du code du travail) mais cette disposition s'est révélée ineffective.
CE et DP sont élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel de liste à deux tours, les syndicats ayant un monopole de présentation des candidats au premier tour.
2. Les attributions économiques des Comités d'entreprise (CE)
D'après l'article L. 2323-1 du code du travail, dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, « le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. ». En conséquence, « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. » (article L. 2323-6 du même code) .
Pour exercer leurs missions, les représentants du personnel au CE bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de 20 heures et d'une formation économique de cinq jours. Ils peuvent recourir à des experts (notamment experts-comptables).
Le CE dispose, par ailleurs, d'un droit d'alerte auprès de l'employeur ou du conseil d'administration lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
LES ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES DU CE
|
Information obligatoire |
Consultation obligatoire |
|
- Situation économique, juridique et financière de l'entreprise : rapports d'ensemble, documents comptables, communications et copies auxquelles ont droit les actionnaires, évolution générale des commandes et de la situation financière, documents relatifs aux opérations de concentration, d'OPA, d'OPE... - Rémunérations et participation ; - Temps de travail et congés : heures supplémentaires, bilan annuel du travail à temps partiel... ; - Emploi : méthodes de production, méthodes de recrutement, analyse de la situation de l'emploi, contrats d'apprentissage, emploi de travailleurs handicapés, contrats aidés, CDD, travail temporaire, GPEC... - Droits collectifs : modifications apportées aux conventions et accords collectifs, droit d'expression des salariés... ; - Bilan annuel en matière de santé et sécurité. |
- sur les mesures économiques affectant le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel - sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise (fusion, cession, modification des structures de production, acquisition ou cession de filiales, prise de participation dans une société...) - sur des questions relatives à l'emploi (mise en place d'un plan d'égalité professionnelle, conclusion de certains CDD et temporaires, introduction du télétravail, projets de conclusion de conventions relatives à l'aide à l'emploi...) - sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés - sur la modification du temps de travail, des congés, la mise en place de mesures de chômage partiel, l'organisation et le fonctionnement de la médecine du travail - sur la mise en place et les modifications du règlement intérieur - sur les accords de participation, d'intéressement, PERCO, PEE qui n'auraient pas été conclus par le CE - sur les licenciements économiques et les licenciements de salarié protégés - sur diverses mesures relatives à la formation professionnelle, la politique de recherche et développement... |
|
Rapport unique : Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur remet pour avis au CE, une fois par an, un rapport unique qui se substitue à certaines informations et documents à caractère économique, social et financier soumis au comité pour information ou pour avis. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, la remise d'un rapport unique est également possible à condition qu'un accord collectif le prévoie. |
|
Source : Les institutions représentatives du personnel, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (La Documentation française, 2009)
En contrepartie de la connaissance des problèmes généraux de l'entreprise que permettent les dispositions en vigueur, les membres du comité et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
C. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
La négociation collective demeure l'un des principaux moyens pour les salariés de faire entendre leur voix. Elle prend une part croissante comme source de droit. Dans l'entreprise, elle est le monopole des délégués syndicaux, lorsqu'ils existent.
1. Négociation de branche et d'entreprise
La convention de branche , qui couvre plus de 90 % des salariés français par le système de l'extension, jouait traditionnellement un rôle de régulation économique en permettant de limiter les distorsions de concurrence. Ce niveau, particulièrement adapté pour les PME , est devenu aujourd'hui secondaire. Les « lois Auroux » (1982) ont initié la montée en puissance de la négociation d'entreprise, en introduisant le mécanisme de l'accord dérogatoire dans le cas de la négociation du contingent annuel d'heures supplémentaires. La faculté de conclure des accords dérogatoires a ensuite été étendue à d'autres éléments de la négociation. Afin de combler les lacunes des règles de représentativité syndicale, un droit d'opposition a été mis en place, au profit des syndicats non signataires de l'accord ayant obtenu 50 % des voix des inscrits aux élections professionnelles.
Puis la loi du 4 mai 2004 161 ( * ) a autorisé les accords d'entreprises à déroger aux normes de la convention de branche sauf lorsque celle-ci l'interdit expressément 162 ( * ) . Depuis 2004, dans le silence de la convention de branche, un accord d'entreprise peut donc comporter des dispositions moins favorables. Cette faculté est toutefois exclue dans certains domaines : salaires minima, classifications, garanties collectives et mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
La loi du 20 août 2008 163 ( * ) confirme cette évolution. Elle rend l'accord de branche subsidiaire s'agissant des questions relatives au temps de travail.
Les lois de 2004 et 2008 ont parallèlement généralisé et simplifié le droit d'opposition , qui n'est plus limité aux seuls accords dérogeant in pejus , et qui peut être exercé par des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés (et non des inscrits) au premier tour des dernières élections professionnelles 164 ( * ) .
A court terme, la faculté ouverte par la loi de 2004 n'a toutefois pas été mise en oeuvre :
« La complexité ressentie comme excessive du nouveau cadre légal, l'inadéquation du dispositif au regard des pratiques et des enjeux de la négociation collective dans les entreprises, l'existence d'une incertitude juridique forte autour de la notion de dérogation, et le verrouillage du dispositif par les acteurs des branches conventionnelles, sont autant de raisons identifiées expliquant le non-usage de la faculté de déroger. » 165 ( * ) .
A long terme, la tendance à la décentralisation de la négociation au niveau des entreprises et des établissements a probablement vocation à s'amplifier au cours des années à venir . Il n'est pas certain que la négociation de branche puisse résister longtemps à cette évolution, même s'il semble, pour l'heure, que la loi ait produit l'effet inverse de celui qui était recherché :
« On constate (pour l'instant) un renforcement du pouvoir des branches professionnelles sur le statut des salariés de la branche. En stipulant de multiples clauses de « verrouillage », les branches affirment (et révèlent en même temps) leur hégémonie sur les matières qu'elles traitent, et ne laissent finalement aux accords et conventions ayant un champ moins large qu'un rôle complémentaire et non un rôle de substitution » 166 ( * ) .
L'évolution vers une plus grande autonomie des acteurs pourrait priver toutefois la négociation collective d'une de ses fonctions, à savoir la régulation sectorielle de la concurrence. Notre collègue député Jean-Frédéric Poisson a d'ailleurs souligné l'intérêt de la négociation de branche , dans son rapport sur la négociation collective et les branches professionnelles 167 ( * ) : entre l'accord national interprofessionnel et l'accord d'entreprise, qui ont tous deux pris une place croissante au cours des années récentes, l'accord de branche a le mérite de prendre en compte la diversité des organisations productives et des modèles de relations professionnelles, tout en ne laissant pas les entreprises isolées face aux enjeux qui leur sont communs. Ce rôle ne peut toutefois être joué utilement qu'à condition que les branches soient construites pour être efficaces , et non, par exemple, inutilement dispersées.
LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
|
Au niveau de la branche |
Au niveau de l'entreprise |
|
|
Tous les ans |
- sur les salaires, l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche |
Négociation annuelle obligatoire dans toutes les entreprises où existent une ou plusieurs sections syndicales représentatives avec nomination de délégués syndicaux - salaires effectifs - durée effective et organisation du temps de travail - évolution de l'emploi et du travail précaire - objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre - création d'un régime de prévoyance maladie, dès lors que les salariés ne sont pas couverts par un tel accord - épargne salariale s'il n'existe aucun autre accord - accès et maintien dans l'emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle (300 salariés et plus) - éventuellement, la formation et la réduction du temps de travail |
|
Tous les
|
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois des seniors et sur la prise en compte de la pénibilité du travail - sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés - sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation. |
|
|
Tous les
|
- sur les classifications professionnelles - sur l'institution d'un ou plusieurs plan d'épargne interentreprises (PEI) ou plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière |
|
2. Négociation nationale et institutionnalisation du dialogue social
La loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social tend à systématiser le dialogue social, en initiant une espèce de « décentralisation » sociale.
Elle dispose que toute réforme dans les domaines des relations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle doit être précédée d'une concertation avec les organisations patronales et syndicales, les partenaires sociaux pouvant alors faire connaître au Gouvernement leur intention d'ouvrir une négociation sur le thème considéré.
En réalité, comme l'a montré l'étude de M. Dominique-Jean Chertier 168 ( * ) , les partenaires sociaux étaient déjà, avant 2007, largement consultés en amont de la loi, par le biais d'instances consultatives diverses ou en conséquence des interactions entre loi et négociation collective, par exemple la reprise par la loi du contenu d'un accord national interprofessionnel qui est devenue, au fil des années, une pratique courante. La réforme a visé à donner un caractère systématique à la concertation pour l'ensemble des réformes du droit social, selon des modalités harmonisées. Cette réforme s'inspire de la notion d' « agenda partagé » , avancée par le rapport Chertier, qui préconisait l'inscription de l'action des pouvoirs publics dans un cadre clair, connu à l'avance et prévoyant un partage des tâches et des calendriers entre Gouvernement, Parlement, partenaires sociaux et acteurs de la société civile.
Selon les termes du président de la République, il s'est agi de « placer les partenaires sociaux au coeur de l'élaboration des normes et des réformes sociales » 169 ( * ) .
La loi de modernisation du dialogue social n'a toutefois pas retenu la proposition du rapport Chertier tendant à insérer dans la Constitution un renvoi vers une loi organique dédiée à la procédure d'élaboration des textes sociaux. Le rapport Chertier proposait qu'en cas d'échec des négociations, le Gouvernement puisse reprendre l'initiative. En cas d'accord en revanche, le Gouvernement et le Parlement n'auraient eu qu'une alternative : approuver l'accord en totalité ou le rejeter, sans aucune possibilité d'amendement.
Accroître le rôle des partenaires sociaux dans l'élaboration des normes rendait nécessaire de consolider leur légitimité, ce qu'a fait la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (cf. chapitre III de la troisième partie).
*
Quoi qu'associés à la marche de l'entreprise au moyen de mécanismes de représentation et de négociation, les salariés peuvent toutefois être considérés comme « oubliés » de la gouvernance.
III. LES SALARIÉS, OUBLIÉS DE LA GOUVERNANCE AU NOM DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Le modèle de gouvernance par les actionnaires ( shareholders ), qui est le plus communément accepté aujourd'hui, s'oppose au modèle de gouvernance par les parties prenantes ( stakeholders ) qui tend à associer aux orientations de l'entreprise l'ensemble des acteurs concernés, notamment les salariés. La question ici posée est indirectement celle de savoir à qui appartient l'entreprise.
En France, le modèle standard de gouvernance actionnariale est tempéré, mais de façon résiduelle, par des dispositifs d'association des salariés à la gouvernance . Ces dispositifs, qui ont fait l'objet de réflexions théoriques nombreuses depuis un demi-siècle, ont été introduits en pratique dans le sillage des nationalisations.
A. UNE GOUVERNANCE DOMINÉE PAR LES ACTIONNAIRES
Le gouvernement actionnarial peut se fonder sur l'idée d'un droit de propriété des apporteurs de capitaux sur l'entreprise : cette idée, issue du capitalisme individuel et familial , a été transposée dans le contexte d'un financement sur les marchés financiers, s'accompagnant d'une massification de l'actionnariat.
Loin d'être remis en cause par ces évolutions, ce présupposé a été, au contraire, conforté par les réformes intervenues depuis les années 1990 .
1. La suprématie actionnariale contestée par la doctrine
La suprématie actionnariale est juridiquement contestable ; en outre, son efficacité économique est également remise en cause.
a) Une suprématie juridiquement contestable
Le modèle de gouvernance actionnariale repose sur l'idée contestable selon laquelle l'actionnaire serait propriétaire de l'entreprise . Or « les actionnaires ne sont propriétaires que des actions émises par les sociétés commerciales qui servent de support juridique aux entreprises, pas de l'entreprise en soi » 170 ( * ) .
« Il ne fait pas de doute que les actionnaires ne sont pas les propriétaires des actifs de la société. Ils n'ont aucun droit direct sur ceux-ci. Seule la société, personne morale, peut en user, en percevoir les fruits et en disposer, conformément aux décisions prises par les dirigeants sociaux » 171 ( * ) .
Si l'on admet que les actionnaires ne sont pas propriétaires mais créanciers de l'entreprise, il reste à examiner si cette créance est d'une nature particulière, ou si elle est similaire à d'autres créances. Dans cette optique, la logique du gouvernement actionnarial repose sur l'idée selon laquelle les actionnaires seraient les créanciers résiduels de la société, leur rémunération n'intervenant qu'après celle de tous les autres créanciers (prêteurs, salariés etc.). Ils ne sont rémunérés que si l'entreprise est profitable, après l'ensemble des autres parties prenantes et seraient donc les principaux preneurs de risques. En outre, leur intérêt et celui de l'entreprise convergeraient dans la recherche du profit maximal 172 ( * ) , et le gouvernement actionnarial serait donc le plus efficace d'un point de vue économique.
Ce raisonnement peut toutefois être inversé, en fonction des circonstances historiques, économiques et sociales : lorsque les actionnaires sont puissants et que l'entreprise est gouvernée principalement en fonction de leurs exigences de profitabilité, ne deviennent-ils pas de facto les créanciers principaux, c'est-à-dire les premiers en mesure de réaliser leurs actifs, les autres créanciers de l'entreprise, notamment les salariés, devenant résiduels ?
Les salariés sont en effet peu mobiles, leur information est disparate et leurs revenus faiblement diversifiés, en sorte qu'ils assument aussi une partie importante du risque. Ce risque est d'autant plus élevé que le chômage est massif et la mobilité réduite en raison des coûts de transport et de logement. On peut même dire que c'est le risque le plus considérable tant les capacités respectives du capital et du travail de se prémunir contre une diminution de leur rendement sont inégales.
b) Une suprématie dont l'efficacité économique est contestée
La convergence des intérêts financiers des actionnaires avec ceux de l'entreprise est discutable, en raison d'horizons temporels susceptibles d'être différents .
Le souci de liquidité des actionnaires peut conduire à une attitude court-termiste défavorable à l'investissement. Cette attitude devient celle des dirigeants, grâce à la mise en place d'incitations également court-termistes consistant en des modes de rémunération alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
A l'inverse, des travaux montrent que des actionnaires possédant des blocs de contrôle importants, tels que les actionnaires familiaux, considèrent le rendement de leur actif à plus long terme 173 ( * ) .
Les salariés pourraient, eux aussi, avoir des intérêts qui convergent avec l'intérêt de long terme de l'entreprise, s'ils ne privilégient pas leurs revenus à court terme, mais plutôt la pérennité de leur emploi, grâce à des stratégies en faveur de l'investissement et des gains de parts de marché. L'Allemagne est souvent citée en exemple de ce compromis.
Plus généralement, le lien entre gouvernance et performance économique de l'entreprise est discutable . Certes, on trouve des études établissant une corrélation entre la place de l'actionnaire dans le gouvernement d'entreprise et la performance financière et boursière de celle-ci 174 ( * ) . Toutefois évaluer la performance de l'entreprise sur le fondement de ses performances boursières constitue en soi une mise en application du modèle actionnarial. Dans une perspective plus large, il faudrait prendre en compte, pour juger la performance, les intérêts sur le long terme d'un plus grand nombre de parties prenantes, et construire un indicateur prenant en compte notamment les questions d'emploi, de parts de marché, de relations avec les clients et fournisseurs, d'impact environnemental et local.
2. La suprématie actionnariale consacrée par la pratique
Bien qu'elle soit fondée sur des présupposés discutables, la suprématie actionnariale a été consacrée par la pratique, qui a tendu à promouvoir des formes de « démocratie actionnariale » en améliorant les droits d'information et la transparence à l'égard des actionnaires, notamment minoritaires, dans les sociétés cotées, à l'image de la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis (2002), qui a rendu les dirigeants pénalement responsables des comptes publiés.
En France, plusieurs travaux ont préconisé d'améliorer l'information des actionnaires et de renforcer l'indépendance des administrateurs. Il s'agit notamment des rapports Viénot I (1995) et II (1999) et du rapport Bouton (2002). La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) et la loi n°2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière (LSF) ont traduit ces évolutions sur le plan législatif, en introduisant de nouvelles obligations de transparence pour les dirigeants et de nouveaux droits pour les actionnaires .
Cette évolution en faveur des actionnaires s'est par exemple traduite par l'éviction des dirigeants d'Eurotunnel par l'assemblée générale de cette entreprise le 7 avril 2004, sur la base des dispositions de la loi NRE, qui avait autorisé les représentants de 5 % du capital seulement d'une entreprise à convoquer une assemblée générale. Cet événement a aussi montré que le gouvernement des entreprises n'était pas à l'abri d'une certaine dérive démagogique .
Les préconisations des principaux rapports de référence précités sur le sujet, ainsi que de recommandations de janvier 2007 et d'octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées, ont été reprises dans le cadre du code AFEP 175 ( * ) -MEDEF relatif au gouvernement d'entreprise des sociétés cotées , dont la première édition date d'octobre 2003. Ce code peut être désigné par les sociétés cotées comme étant leur code de référence en application de la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (DDAC). A défaut d'appliquer ce code, elles doivent fournir des explications, en application du principe anglo-saxon « comply or explain ».
Au plan international, Les Principes de gouvernement de l'entreprise de l'OCDE (2004) relèvent que « le gouvernement d'entreprise est l'un des principaux facteurs d'amélioration de l'efficience et de la croissance économiques et de renforcement de la confiance des investisseurs ». Ce gouvernement est défini comme faisant « référence aux relations entre la direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et d'autres parties prenantes » . Les salariés sont reconnus au nombre de ces parties prenantes, l'OCDE préconisant de « permettre le développement des mécanismes de participation des salariés qui sont de nature à améliorer les performances » et l'amélioration de la transparence et de la diffusion de l'information. Si l'OCDE reconnaît les salariés comme parties prenantes, ce qui constitue une avancée par rapport à la conception strictement « shareholder » de la gouvernance d'entreprise, elle ne préconise toutefois pas leur participation avec voix délibérative aux conseils .
Dans ce contexte favorable à la gouvernance actionnariale, la place des salariés tend à être reconnue mais de façon résiduelle, et davantage dans le sens d'un développement de l'actionnariat salarié que dans le sens d'une prise en compte des intérêts du facteur de production que constitue le travail.
B. LE « SERPENT DE MER » DE LA COGESTION À LA FRANÇAISE
La question de la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise se pose en effet différemment selon que l'on envisage la place des salariés actionnaires, c'est-à-dire apporteurs de capitaux, ou celle des salariés apporteurs de leur seule force de travail. Dans la problématique de la cogestion, c'est bien de la participation des travailleurs à la gouvernance de l'entreprise qu'il s'agit.
1. Un débat ancien
Le programme du Conseil national de la Résistance prévoyait le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie.
L'instauration des CE en 1946 s'est accompagnée de dispositions prévoyant la participation de 2 ou 4 de ses membres avec voix consultative au conseil d'administration (ou conseil de surveillance).
Dans les années 1960, le général de Gaulle a renouvelé la problématique de l'association du capital et du travail dans le cadre de la relance de la participation , qui n'était pas seulement financière dans son esprit 176 ( * ) .
Inspirés par les principes gaullistes, deux rapports ont, à cette époque, préconisé une meilleure association des salariés aux instances décisionnelles de l'entreprise.
L'ouvrage de François Bloch-Lainé , « Pour une réforme de l'entreprise » (1963), qui évoque déjà le « gouvernement de l'entreprise », propose une gestion collégiale et la réalisation d'une démocratie industrielle en instaurant, dans les grandes entreprises, une « commission de surveillance » composée de représentants du capital et du personnel, chargée de contrôler un « collège de directeurs ».
Le rapport de Pierre Sudreau , « La réforme de l'entreprise » (1975), réalisé à la demande du président de la République Valéry Giscard d'Estaing, préconisait notamment d'accorder aux représentants des salariés un tiers des postes dans les conseils d'administration des entreprises dotés des seuls droits d'information et de contrôle.
Ces propositions n'ont toutefois pas trouvé de débouché concret avant la mise en oeuvre des nationalisations.
A la même époque, l'Allemagne a mis en place le système de la codétermination , consistant en une représentation paritaire, depuis 1976 dans les entreprises de plus de 2.000 salariés, ou minoritaire des salariés dans le conseil de surveillance de l'entreprise.
LA CODÉTERMINATION À L'ALLEMANDE
|
Type d'entreprise |
Nombre de représentants des travailleurs au Conseil de surveillance (CS) |
|
500 à 2.000 salariés |
1/3 du CS |
|
> 2.000 salariés |
½ du CS
|
|
Secteurs métallurgie/charbon
|
½ du CS
|
Le système allemand est aujourd'hui remis en question en particulier sur les points suivants : l'évaluation controversée de ses effets économiques et sociaux, le maintien de la parité dans les conseils de surveillance des grandes entreprises, l'interaction entre conseils d'entreprise et d'établissement, la possibilité d'introduire une option permettant à chaque entreprise de négocier individuellement la forme concrète de la codétermination. Il est généralement admis que l'objectif de la loi sur la codétermination de 1976 n'était pas d'augmenter la compétitivité des entreprises, mais de donner aux salariés une possibilité de participation démocratique aux décisions de l'entreprise les concernant. La codétermination est donc fondée sur une perception de l'entreprise comme une instance sociale dans laquelle propriétaires, direction d'entreprise et salariés collaborent en vue de la réalisation d'objectifs communs 177 ( * ) . Cette vision est remise en cause par le patronat allemand, au nom de l'efficacité économique. Les principales confédérations de patrons allemands 178 ( * ) proposent ainsi de laisser davantage de liberté aux entreprises dans la détermination des formules de codétermination : parité ou représentation minoritaire (1/3), transfert de la cogestion vers un système consultatif... ou, à défaut, application d'une législation contraignante ne retenant pas la cogestion paritaire, dont les patrons allemands soulignent le caractère unique au monde, comme pierre angulaire 179 ( * ) .
Les experts de la commission précitée présidée par Kurt Biedenkopf ont toutefois estimé que la codétermination ne constituait pas un frein à la compétitivité allemande. Au contraire :
« C'est précisément dans une époque de tensions économiques que la codétermination au niveau de l'établissement comme la codétermination des salariés au conseil de surveillance ont rempli leur mission de servir d'outil efficace de médiation entre les intérêts différents des employeurs et des salariés. L'approche coopérative de la codétermination n'a pas seulement des effets positifs sur la motivation et le sens de responsabilité des salariés, mais en contribuant à la paix sociale elle a aussi d'importants effets politiques sur la société. Les entreprises peuvent et devraient utiliser la productivité de la coopération dans la compétition . » 180 ( * )
2. Les dispositifs mis en place
Provoquant l'hostilité tant des organismes patronaux que syndicaux, la participation des salariés aux instances de décision des entreprises a connu un commencement d'application en France, par strates successives.
a) La représentation du CE dans les instances décisionnelles
Depuis la création des CE en 1946, la loi prévoit la présence, avec voix consultative, d'une délégation de représentants du CE aux séances du conseil d'administration (CA) ou de surveillance (CS) des sociétés.
La loi n o 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a permis, en outre, aux CE d'être représentés dans les assemblées générales d'actionnaires .
|
LA REPRÉSENTATION DU CE AU CA, AU CS ET À L'AG Représentation du CE au CA/CS des entreprises Le CE est représenté au CA ou au CS de l'entreprise par deux de ses membres , appartenant respectivement au premier collège (ouvriers, employés) et au second (agents de maîtrise, cadres). Lorsqu'un collège distinct a été institué pour les cadres, le nombre de représentants au CA ou au CS est porté à quatre, dont deux cadres. Ce nombre passe à un seul représentant dans les sociétés où le conseil comprend des administrateurs élus par les salariés et choisis parmi les salariés (dispositif peu pratiqué, cf ci-après). Les représentants ainsi désignés sont soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article L. 225-37 du code de commerce pour toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration pour les informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président du conseil d'administration. La notion de confidentialité trouve ses limites dans la mesure où la diffusion serait de nature à compromettre « la survie de l'entreprise ». Les représentants du CE n'ont qu'un rôle consultatif . Ils peuvent soumettre au conseil des voeux, sur lesquels le conseil doit donner un avis motivé. Ils ont droit pour cela aux mêmes communications que les autres membres du conseil à l'occasion des réunions. Représentation à l'AG La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) permet aux comités d'entreprises de disposer d'une représentation aux assemblées générales d'actionnaires . Elle ouvre aussi le droit au comité d'entreprise de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires « en cas d'urgence ». Le comité s'est également vu reconnaître le droit de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. Les représentants du CE à l'AG des actionnaires ne disposent pas du droit de vote. Ils doivent être entendus, s'ils le souhaitent, lors de toute délibération requérant l'unanimité des associés. |
b) La représentation facultative aux conseils avec voix délibérative
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public généralise la présence d'administrateurs salariés dans les CA ou CS des entreprises contrôlées majoritairement par la puissance publique . Dans les entreprises publiques de 200 à 1.000 salariés, deux sièges sont attribués aux représentants élus des salariés tandis que dans celles de plus de 1.000 salariés, un tiers des sièges leur est réservé. Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance.
Dans le sillage des privatisations, l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 a introduit une représentation facultative des salariés, avec voix délibérative, au sein du CA ou du CS des sociétés commerciales . Cette forme de cogestion doit être inscrite aux statuts de l'entreprise par une assemblée générale extraordinaire. Le nombre d'administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre d'administrateurs peut être porté à cinq. Cette dérogation ne s'applique pas aux membres du conseil de surveillance.
Ce dispositif demeure peu usité : si les salariés non actionnaires sont représentés dans quelques entreprises privatisées, seuls sont représentés les salariés actionnaires dans les autres sociétés faisant l'expérience de la représentation des salariés.
c) La représentation des salariés actionnaires
La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, a institué un dispositif concernant la représentation des salariés actionnaires lorsque ceux-ci possèdent au moins 5 % du capital de la société.
Facultatif lors de sa création, ce système a été rendu obligatoire, lorsque les salariés actionnaires possèdent plus de 3 % du capital, par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
On estime en 2008 à environ 2,5 à 3 millions le nombre de salariés détenteurs d'actions de leur entreprise .
En 2009, 153 entreprises du SBF 250 181 ( * ) ont un actionnariat salarié . 36 seulement ont au moins 3 % de leur capital détenu par les salariés.
ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES COTÉES DU SBF 250
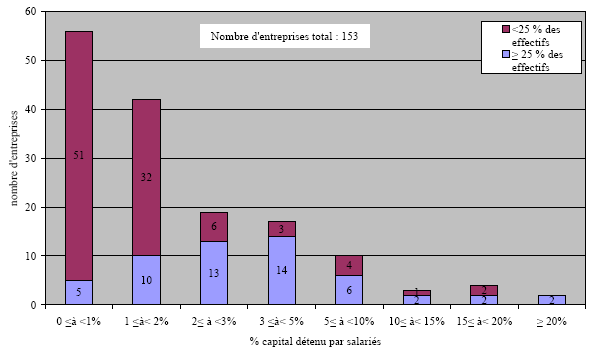
Note de lecture : 56 entreprises ont moins de 1 % de leur capital aux mains des salariés. Dans 51 d'entre elles, l'actionnariat salarié représente moins de 25 % de l'effectif total. Par ailleurs, dans 2 entreprises dont plus de 25 % de l'effectif salarié est actionnaire, plus de 20 % du capital est ainsi détenu.
Source : Benhamou (2010)
En conclusion, le choix de la coopération entre parties prenantes, dans le cadre d'une « démocratie entrepreneuriale » renforcée, peut être favorable à la compétitivité des entreprises, à condition de s'accompagner de modifications des comportements et attentes, ce qui ne relève pas seulement de la loi.
Tant la crise actuelle du capitalisme financier, que la chute des régimes communistes et l'entrée dans l'Union européenne des pays qui en sont issus, pourrait insuffler à terme une vision moins antagonique de l'entreprise, considérée moins comme un lieu de conflits que comme un lieu de coopération. Les gains économiques qui en résulteraient représentent un potentiel de croissance difficilement mesurable, mais sans doute significatif dans un pays tel que la France où les relations sociales sont traditionnellement conflictuelles.
Si la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise s'est développée en France sur le modèle de la représentation collective des intérêts, par le biais de mécanismes de consultation, d'information et de négociation, la participation aux instances de décision a progressé depuis les années 1980, plaçant la France en « milieu de peloton » européen dans ce domaine. Des progrès peuvent être réalisés dans les deux voix précédemment évoquées :
- D'une part, s'agissant des IRP et de la représentation collective des travailleurs, les réformes en cours sont de nature à en améliorer la légitimité et à en accroître les prérogatives. Il faut toutefois s'interroger sur d'éventuels effets économiques contradictoires de la tendance à la décentralisation de la négociation , qui permet certes de prendre les décisions au plus près des situations réelles, mais qui ne devrait pas occulter une réflexion sur le « juste » niveau de négociation, c'est-à-dire celui permettant d'atteindre un optimum du point de vue des coûts de transaction .
- D'autre part, si la participation des salariés français aux instances de décision de l'entreprise a progressé, les salariés actionnaires en demeurent les principaux bénéficiaires et la question de la participation à la décision des travailleurs en tant que tels demeure posée .
Comment aller plus loin, pour dépasser le « modèle shareholder », sans imposer aux entreprises des formalités supplémentaires qui ne modifieraient pas la nature de la prise de décision sur le fond ?
CHAPITRE IV - UN SYSTÈME DE DROIT SOCIAL DU TRAVAIL DANS UNE TRANSITION INACHEVÉE
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Le pacte social dans l'entreprise repose sur des règles de droit dont le respect s'impose aux employeurs et aux salariés (droit du travail et de la sécurité sociale et droits fondamentaux de la personne humaine) mais aussi sur un réseau conventionnel qui va de l'accord national interprofessionnel au contrat individuel de travail. Les normes légales et réglementaires sont principalement destinées à protéger les travailleurs et elles sont hiérarchisées, chacune d'entre-elles se trouvant validée par sa conformité à celle qui lui est supérieure. Les conventions étaient traditionnellement soumises à cette hiérarchie et en formaient elles-mêmes une, allant du niveau interprofessionnel (accords nationaux) à la branche et à l'entreprise et s'imposant au contrat de travail. Progressivement, cet ordonnancement a été remis en cause par des évolutions juridiques « justifiées » par les exigences liées aux progrès de l'intégration européenne, de nouvelles attentes de la société (éthiques et environnementales), ainsi que par des changements de l'économie (mondialisation, modifications du fonctionnement et des structures des entreprises...) : formellement, les sources communautaires (règlements et directives) ont une importance de plus en plus grande dans le droit social français puisque les traités et le droit européen dérivé l'emportent désormais sur une loi nationale même postérieure 182 ( * ) ; l'irruption, depuis les années soixante, de la « soft law » dans le droit des entreprises (codes de bonnes pratiques environnementales et sociales) et ses implications sur les règles qui régissent le pacte social sont venues, par ailleurs, compliquer encore davantage la situation. Certes les dispositions en question, qui correspondent à des engagements unilatéraux pris par de grands groupes, n'ont pas le caractère contraignant des lois et des traités. Néanmoins, leur non-respect par des « parties prenantes » de l'entreprise, salariés, filiales, partenaires ou fournisseurs, peut entraîner des ruptures de contrats, donc des actions en justice. l'ordonnancement juridique a, en outre, été profondément modifié, ces dernières années, par le législateur, dans l'ordre juridique interne , en ce qui concerne le droit négocié (issu des conventions collectives et des accords entre partenaires sociaux). L'importance de ce droit par rapport à la loi a été promue. Il a ainsi été autorisé que des accords de rang inférieur puissent déroger, sous certaines conditions, à ceux de rang supérieur d'une façon qui ne soit pas nécessairement plus favorable aux travailleurs. Les accords d'entreprise, notamment , sont désormais prioritaires par rapport à ceux conclus au niveau de la branche, en ce qui concerne l' aménagement du temps du travail . Cependant, même dans ce domaine, les nouvelles possibilités de dérogation paraissent encore peu utilisées, les syndicats ne souhaitant pas, en particulier, que les négociations de branche perdent de leur importance. Le nombre des accords d'entreprise est cependant élevé et progresse (27 100 accords en 2008, + 10 % par rapport en 2007). Cette tendance correspond à la décentralisation de la gestion des groupes et s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics, depuis les lois Auroux de 1982, de renforcer le dialogue social à ce niveau. Au total, le droit social s'est considérablement complexifié , notamment le droit de la négociation collective - à propos duquel on peut lire dans un document récent du ministère du travail 183 ( * ) - qu'il laisse les parties prenantes, y compris les professionnels et spécialistes de la matière , dans l'incapacité d'en comprendre la logique et d'en saisir les potentialités. Ce droit apparaît comme moins hiérarchisé, moins pyramidal, articulé, de façon différente, entre ses différents niveaux. Si ceci est conforme à la réticulation du monde de l'entreprise, ces évolutions ne favorisent pas la pérennité d'un ordre public social, socle protecteur du salariat, non plus que l'homogénéité d'un monde du travail de plus en plus segmenté. |
I. HISTORIQUE - LES NORMES DU DROIT SOCIAL DU TRAVAIL, UNE STRUCTURATION PAR LE MIEUX-DISANT SOCIAL...
Le pacte social dans l'entreprise repose sur un ensemble de règles de droit dont le respect s'impose aux employeurs et aux salariés (droit du travail et de la sécurité sociale et droits fondamentaux de la personne humaine). Elles sont principalement destinées à prévenir et à sanctionner d'éventuels abus de pouvoir des premiers à l'encontre des seconds.
Les sources de ce droit sont variées : lois, règlements, accords collectifs des partenaires sociaux, pour l'ordre juridique interne, auxquels s'ajoutent les traités internationaux, le droit communautaire...
Il s'agit de normes hiérarchisées, chacune d'elles se trouvant validée par celle qui lui est supérieure, ce qui correspond à l'approche positiviste du droit qui s'est imposée dans l'ensemble du monde occidental durant le XXème siècle.
A. LA CONSÉCRATION D'UNE APPROCHE POSITIVISTE DU DROIT
1. L'idée de faire du droit une science
La notion de hiérarchie des normes a d'abord été formulée par le juriste et théoricien du droit austro-américain Hans Kelsen (1881-1973). Selon sa théorie pure du droit , à l'origine du positivisme juridique, le droit devait s'apparenter à une science, c'est-à-dire s'affranchir de tout fondement idéologique ou moral. Il fallait pour cela que chaque norme ne soit légitimée que par sa compatibilité avec la norme supérieure, l'ensemble, appelé « pyramide des normes », constituant un ordre hiérarchisé.
2. Une cohérence reposant sur une norme fondamentale
La cohérence de cette théorie du droit supposait la reconnaissance, au sommet de cette hiérarchie, d'une « norme fondamentale » (jouant, en droit, le rôle d'un axiome en philosophie ou en mathématiques), généralement la Constitution.
Toutefois, dans certains Etats 184 ( * ) , la loi peut avoir une valeur identique et constituer, elle aussi, la « norme suprême ».
B. UN ÉDIFICE STRATIFIÉ
1. Une structuration pyramidale des règles du droit...
Selon l'approche positiviste, le droit est donc constitué d'une pyramide des normes strictement hiérarchisées.
Dans les grandes lignes, ceci est encore vrai pour un pays comme la France.
Le règlement doit être conforme à la loi qui, elle-même doit respecter la Constitution ; celle-ci (en son article 55) reconnait la supériorité des traités internationaux sur les textes législatifs nationaux.
2. dont le respect est contrôlé par le juge
La hiérarchie des normes juridiques suppose un contrôle par le juge de la conformité de chacune d'entre elles à celle qui lui est supérieure, notamment en ce qui concerne la constitutionnalité des lois.
Cette dernière est appréciée en France, depuis 1958, par le Conseil constitutionnel 185 ( * ) .
C. DES PRINCIPES QUI S'APPLIQUENT AU PACTE SOCIAL MAIS DANS UNE PERSPECTIVE DE MIEUX-DISANT SOCIAL
Le principe de hiérarchie des normes s'applique à celles qui régissent le pacte social dans l'entreprise avec cette particularité notable que le droit social ne comprend pas seulement des lois votées par le Parlement et des règlements pris par l'exécutif mais aussi des conventions collectives, négociées et conclues par les partenaires sociaux, elles aussi structurées de façon pyramidale avec au sommet les accords interprofessionnels, puis les accords de branche et enfin, à la base, les accords d'entreprise.
1. Un système normatif qui suit le droit commun moyennant un fort particularisme
Les normes constitutives du pacte social comprennent une partie élaborée par le législateur et l'administration (pour la part réglementaire) et une partie issue des accords conclus par les partenaires sociaux, enfin une partie d'origine internationale (droit communautaire et traités) ou correspondant à ce qu'on appelle « soft law » (engagements pris par les multinationales).
a) Un schéma d'ensemble classique
En principe, les normes constitutives du pacte social demeurent structurées de façon pyramidale.
La soumission aux traités, à la Constitution et à la loi est la règle. Ce qui pose problème, c'est :
- les possibilités de déroger à la norme supérieure dans le corpus conventionnel (voir II) ;
- la détermination des rangs hiérarchiques respectifs de la Constitution et du droit communautaire ;
- le statut et l'autorité de la « soft law ».
Très schématiquement, la pyramide des normes du droit du travail peut être présentée de la façon suivante :
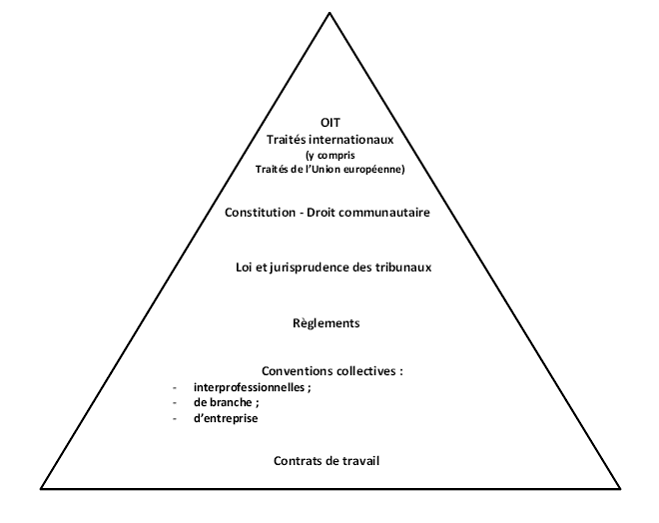
b) La prééminence contestée de la Constitution
La jurisprudence française accorde actuellement à la constitution une valeur supérieure à celle du droit international, dans l'ordre interne, mais cette suprématie, en ce qui concerne le droit communautaire, fait l'objet d'un débat doctrinal important (la Cour de justice des communautés européennes pose, pour sa part, le principe de la primauté absolue des normes communautaires).
Ce n'est pas seulement le texte de la Constitution lui-même qui prime mais tous ceux qui sont inclus dans ce qu'on appelle le « bloc de constitutionnalité » (préambule de 1946, déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, grands principes issus des décisions du Conseil constitutionnel...).
La Constitution, et plus précisément le préambule de 1946, est donc la référence la plus importante, notamment pour la Cour de Cassation, s'agissant de déterminer les règles du pacte social dans l'entreprise.
Le Conseil constitutionnel veille au respect de la hiérarchie des normes, notamment entre la loi et les conventions collectives : il a ainsi jugé conforme à celle-ci le rôle de pré-législateur ou de quasi-pouvoir réglementaire des partenaires sociaux 186 ( * ) , tout en précisant que la primauté du Parlement, en matière législative, et son droit d'amendement ne devaient pas s'en trouver limités.
Dans une décision récente 187 ( * ) , le Conseil a, par ailleurs, rappelé, à propos de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires que s'il était loisible au législateur de renvoyer aux accords collectifs le soin de préciser les modalités concrètes d'application du droit du travail, il devait au préalable en définir les conditions de mise en oeuvre (selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail).
Il a ainsi fait prévaloir à la fois la supériorité de la Constitution par rapport à la loi et celle de la loi sur les conventions collectives.
Cependant, il a jugé excessive une disposition du même projet de loi tendant à annuler toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires des conventions existantes, estimant qu'une telle atteinte au droit conventionnel n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
La rigidité de la hiérarchie des normes, selon le juge constitutionnel, a donc ses limites. Toutefois, s'agissant de l'articulation entre les différents niveaux de normes conventionnelles, le Conseil a précisé que la primauté des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche, même antérieurs, était d'application immédiate.
2. L'importance croissante du droit européen
Le droit du travail français est par ailleurs profondément marqué 188 ( * ) par le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE).
Mais dans l'Europe à 27, « le plus petit commun multiple est souvent préféré au plus grand commun dénominateur » (cf. Jean-Emmanuel Ray : « Droit du travail, droit vivant »).
En témoignent, entre autres :
- le minimalisme des dispositions du traité de Lisbonne relatives au droit du travail ;
- les restrictions apportées par la directive sur les services (ex-« directive Bolkestein »), et par la CJCE, à l'application aux travailleurs détachés des dispositions les plus favorables des conventions collectives du pays où est exécutée une prestation.
a) La prééminence théorique du droit social européen
Dans la hiérarchie des normes définissant le pacte social dans l'entreprise, le droit social européen occupe une place plus élevée que le droit légal national, qu'il s'agisse :
- du droit originel de l'UEO (Union de l'Europe occidentale) 189 ( * ) et du Conseil de l'Europe, notamment la charte sociale européenne de 1961 (dite « de Turin »), révisée en 1996 190 ( * ) ;
- du droit de l'Union européenne, d'une part, avec la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux de 1989, inspirée de la charte de Turin, à laquelle se réfèrent, depuis le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, tant le préambule du traité sur l'Union européenne (UE) que plusieurs articles du traité instituant la Communauté européenne (CE) 191 ( * ) , et avec, d'autre part, les différentes directives prises en matière sociale.
L'article 55 de la Constitution reconnaît la primauté des traités internationaux sur les lois internes qui s'applique aux conventions auxquelles la France a adhéré dans le cadre de l'UEO ou du Conseil de l'Europe.
La spécificité du droit communautaire, en outre, est d'être, selon les termes de l'arrêt Costa, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), un système juridique à la fois autonome et intégré aux droits des Etats membres en ce qu'il est d'applicabilité directe et que ses dispositions peuvent être invoquées en justice par les particuliers devant les tribunaux nationaux.
A côté du droit primaire (traités) et du droit dérivé (règlements et directives), la jurisprudence occupe une place essentielle parmi les sources du droit social communautaire.
Néanmoins, certains Etats, dont la France, considèrent (cf. supra) que la prééminence du droit social communautaire par rapport aux droits nationaux ne concerne pas la Constitution qui demeure la norme suprême 192 ( * ) .
b) Une contribution non négligeable à la défense des travailleurs français
Un des avantages les plus évidents, pour les salariés français, de l'existence d'un droit social européen est, cependant, de leur ouvrir des voies de recours supplémentaires pour la défense de leurs intérêts.
Ainsi :
- la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) veille, en ce qui concerne les droits sociaux fondamentaux, à l'application de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 193 ( * ) ;
- la charte sociale européenne, pour sa part, est accompagnée d'un « protocole additionnel » prévoyant un système de réclamations collectives.
Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) peut jouer un rôle important, à l'occasion de renvois préjudiciels, pour éclairer les juges nationaux sur l'interprétation de certaines dispositions de droit communautaire. Elle encadre notamment, au profit des travailleurs concernés, la mise en concurrence par les dirigeants d'entreprises multinationales (compagnies aériennes lowcost en particulier) des systèmes juridiques nationaux des différents Etats membres de l'UE 194 ( * ) .
Ainsi, les droits européens des travailleurs de l'Union sont-ils non seulement des droits fondamentaux théoriques et abstraits découlant des principes généraux du droit communautaire mais aussi des droits de procédure , pratiques et concrets, mobilisés devant des instances nationales ou européennes.
Initialement axé en priorité sur la libre circulation des salariés et l'absence entre eux de discrimination fondée sur la nationalité au sein de l'Union, en vue de favoriser l'intégration économique de celle-ci, le droit communautaire a progressivement diversifié ses ambitions et légèrement élevé leur niveau.
En même temps qu'un droit de liberté et de procédure, il est devenu un droit d'égalité formelle, se préoccupant de lutter contre les discriminations fondées non seulement sur la nationalité, mais aussi d'abord sur le sexe 195 ( * ) , puis sur la race, les origines ethniques ou sociales, l'âge, le handicap...
Echappent désormais à la règle de l'unanimité, l'adoption des textes n'intéressant plus uniquement la santé et la sécurité des travailleurs mais également, en vertu du traité d'Amsterdam :
- l'intégration des personnes exclues du marché du travail ;
- les conditions de travail ;
- l'information et la consultation des salariés, etc.
En ce qui concerne les partenaires sociaux, non seulement ils doivent être consultés par la commission, avant qu'elle ne présente une proposition dans le domaine de la politique sociale mais ils peuvent lui demander de prier le conseil de transformer en norme législative un accord conclu par eux 196 ( * ) . Ces dispositions n'ont été reprises que récemment par le droit français à la suite du vote de la loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social.
Mérite aussi d'être signalée, l'institution par la directive du 22 septembre 1994 d'un comité d'entreprise européen ou de procédures spécifiques d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises ou les groupes de dimension communautaire.
Au total, le droit communautaire ne se contente pas d'exiger des nouveaux membres de l'Union, à la suite de leur adhésion, le respect d'un minimum de prescriptions sociales.
Le traité de Rome, tel qu'il a été modifié par l'accord européen du 7 février 1992 sur la politique sociale (en vertu du traité d'Amsterdam de 1997 qui l'y a intégré) a désormais pour objectif une harmonisation, dans le progrès - et non un alignement par le bas - des législations sociales nationales.
La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux s'intéresse à tous les aspects, tant individuels que collectifs, des relations de travail qu'elle est susceptible d'affecter par sa portée générale.
« Elle exerce sur les droits nationaux de travail une pression.... aux normes nationales, un effort d'adaptation supplémentaire peut être ainsi imposé » (Bernard Teyssié - Droit européen du travail).
Par exemple, la pression de la norme communautaire a élargi le champ d'application des dispositions du code du travail protégeant les travailleurs à temps partiel.
Pour équilibrer les effets de la « flexibilisation » croissante des activités et des structures des entreprises, le législateur européen s'est préoccupé « des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements » (directive du 12 mars 2001).
La CJCE a interprété de façon extensive cette notion de transfert dans son abondante jurisprudence sur la question. Le maintien des contrats de travail en cours a été érigé au rang de principe général de droit du travail. Une directive précédente (du 20 juillet 1998) s'était intéressée, de son côté, aux licenciements collectifs pour motif économique, s'efforçant d'encadrer les procédures et de prévoir des mesures d'accompagnement de la rupture des contrats de travail.
Il reste cependant que les principes communs de flexisécurité préconisés par la Commission (voir plus loin) ne sont, par exemple, pas traduits juridiquement : assouplissement et sécurisation des contrats de travail 197 ( * ) et mesures en faveur des exclus du marché du travail, stratégies d'apprentissage tout au long de la vie, politiques actives du marché du travail tendant à assurer « l'employabilité des salariés » et modernisation, en conséquence, des systèmes de sécurité sociale.
c) Un apport à la protection des salariés qui peut toutefois sembler limité
De prime abord, la contribution du droit européen à la protection des salariés, recherchée par le pacte social dans l'entreprise, risque de se trouver limitée en raison :
- de la priorité accordée à l'intégration économique des Etats membres de l'Union par rapport à l'harmonisation de leurs législations sociales ;
- de l'application assez large, dans ce domaine, du principe de subsidiarité et de la règle de l'unanimité pour la prise de décisions ;
- du caractère, au départ, très fondamental des droits sociaux pris en considération qui peut sembler conférer au droit européen un simple rôle de filet de protection ou de plus petit dénominateur commun social.
Beaucoup des dispositions protectrices de textes adoptés dans ce cadre du Conseil de l'Europe semblent, en effet, ne rien apporter à celles qui figurent déjà dans notre droit social (la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par exemple, et la charte, précitée, de Turin, proclament la liberté syndicale et le droit de grève ou le droit à la sécurité sociale...).
La charte communautaire, susmentionnée, des droits sociaux fondamentaux a également, de son côté, un caractère basique, se fixant comme objectifs le dialogue social, une protection adéquate, l'amélioration des conditions de travail...
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le texte a été proclamé à l'issue du sommet de Nice, en décembre 2000, est demeurée pour sa part dépourvue d'autorité juridique jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
3. La primauté des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)
La Cour de cassation, s'alignant sur une décision du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005 relative au contrat « nouvelles embauches » (CNE) a estimé, le 29 mars 2006, que certains articles des conventions de l'OIT sont « d'application directe » devant les juridictions nationales 198 ( * ) .
C'est ainsi que ce nouveau type de contrat mis en place par une ordonnance de 2005, a été jugé par les tribunaux français 199 ( * ) non conforme à la convention 158 de l'OIT, donc contraire au droit international du travail 200 ( * ) , ce qui a entraîné son abrogation par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
4. Le rôle toujours essentiel de la loi
La loi qui a été, à l'origine, la source essentielle du droit du travail français continue, d'autre part, de jouer, en la matière, un rôle primordial, malgré la montée en puissance des sources négociées.
C'est elle qui définit tout d'abord le contenu de l' ordre public absolu , auquel nulle convention collective ne peut déroger s'agissant par exemple des compétences des inspecteurs du travail ou des conseils de prud'hommes.
Seule une loi peut, par ailleurs, autoriser un texte conventionnel à déroger à une norme légale (ou à un autre accord de rang hiérarchique supérieur) dans un sens moins favorable 201 ( * ) au salarié (ces exceptions concernent, essentiellement, la durée et l'aménagement du temps de travail).
C'est également la loi 202 ( * ) , qui crée une obligation pour les entreprises de négocier chaque année des accords sur des thèmes tels que les salaires effectifs, l'égalité entre les hommes et les femmes (rémunérations), la durée effective du travail (temps partiel, temps choisi), l'organisation du temps de travail, l'insertion des travailleurs handicapés...
La transformation en loi d'un accord interprofessionnel, enfin, est facultative et ne limite pas (cf. supra) l'usage par le Parlement de son droit d'amendement.
La loi conserve donc une prééminence certaine, dans la hiérarchie des normes, ce qui limite l'autonomie des accords d'entreprise.
5. Les branches au coeur du dispositif conventionnel
Cette autonomie se trouve également restreinte par le rôle des branches. Parfois déclarées en déclin, celles-ci conservent une grande importance dans le droit social français. Grâce à leur extension par la puissance publique, les conventions de branche couvrent, en effet, 97 % des salariés français (les accords d'entreprise 30 %). Elles définissent leurs garanties sociales essentielles, notamment en matière de salaires minima et de classifications. Elles permettent de s'affranchir des contraintes de la gestion de court terme des entreprises sans en être trop éloignées, donc sans les méconnaître.
Certes elles suppléent seulement les accords d'entreprises lorsqu'il s'agit de temps de travail. Mais elles peuvent toujours, autrement, interdire expressément à ces accords de leur déroger.
Les auteurs d'un rapport de 2007 sur l'évaluation de l'application du volet « dialogue social » de la loi « Fillon » du 4 mai 2004 soulignent, en outre, que le recours à la dérogation, qui devrait être pourtant devenue la règle de droit commun, « s'est heurtée à la pratique des acteurs ». Les accords autorisant la dérogation ne représentent, en effet, finalement moins de 20 % de l'ensemble des accords signés au niveau de la branche. Très peu d'entreprises se sont donc saisies des possibilités éventuelles de dérogation 203 ( * ) qui leur étaient offertes (mais elles n'en ont peut-être pas moins signé des accords qui « diffèrent » des conventions de branche), les syndicats ayant veillé au maintien du « principe de faveur » et du rôle « pivot » des branches en droit social (entre le niveau interprofessionnel et celui des entreprises).
Au total, l'équilibre entre les différentes normes qui fondent le pacte social en France subit des modifications en profondeur.
Celles-ci ne sont pas aussi radicales qu'on le présente parfois mais elles sont indéniables :
- diminution du rôle de la loi, qui demeure important, au profit des traités au-dessus d'elle, et du droit négocié, au dessous ;
- accroissement progressif de l'importance des conventions et des accords d'entreprise, limitée par la place encore occupée par la loi et les textes négociés au niveau des branches.
II. ... MAIS, UN ORDONNANCEMENT QUI S'EST TROUVÉ REMIS EN CAUSE
A. DES CHANGEMENTS DONT TÉMOIGNE L'ÉVOLUTION RÉCENTE DU PAYSAGE CONVENTIONNEL FRANÇAIS
1. Un système particulier
Chaque année, la Direction générale du travail (Bureau des relations collectives du travail) du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité de la Ville, dresse un bilan de la négociation collective en France, par niveau et par thèmes, en prenant en considération le point de vue des différentes organisations professionnelles et le rôle de l'Etat.
Le rapport pour 2008 rappelle que « le système français de relations professionnelles présente la particularité d'articuler trois niveaux actifs de négociation collective, celui de l'entreprise, celui de la branche et celui de l'interprofession ».
Notre système se caractérise également, d'après la lecture de ce document, par une intervention importante de l'Etat, non seulement en tant que législateur et à travers l'extension et l'élargissement des textes conventionnels, mais aussi dans le processus de négociation lui-même : sur des thèmes importants, la loi oblige en effet les partenaires sociaux à négocier ou les y invite de façon pressante 204 ( * ) ; les négociations nationales interprofessionnelles se déroulent, note la CGT, « sous une pression constante du pouvoir politique, tant sur les objectifs assignés que sur les échéances », avec le recours à des « lettres d'orientation » 205 ( * ) . Enfin, en cas de difficulté ou de blocage, des commissions mixtes paritaires présidées par un représentant de l'Etat sont constituées, avec le concours du Ministère chargé du Travail 206 ( * ) .
Le système français de relations professionnelles est également celui d'un pays centralisé . Pourtant, le rapport du Ministère du Travail semble se féliciter d'une évolution tendant à renforcer, au niveau surtout de la branche, le dialogue social territorial , notamment dans le bâtiment, les travaux publics, la métallurgie ou les industries des carrières et matériaux et les entreprises d'architecture. Cependant, deux textes sur trois environ sont conclus au niveau national. En outre, une large majorité de conventions régionales (et a fortiori départementales ou locales) ne sont pas actualisées par la conclusion d'accords ou d'avenants 207 ( * ) . Des textes nationaux viennent ainsi suppléer ou compléter les textes locaux, même sur les questions salariales que ces derniers ont vocation à préciser. Ainsi, la négociation nationale apparaît comme un élément essentiel de régulation susceptible de compenser une certaine tendance à l'« émiettement conventionnel » au niveau de la branche.
Un autre enseignement qu'il est possible de tirer de la lecture de ce rapport concerne les carences du dialogue social dans les petites entreprises :
Plus la proportion de petites entreprises dans un secteur est grande, plus le dialogue social y est réduit 208 ( * ) .
La loi du 4 mai 2004 209 ( * ) qui permet, en l'absence de délégués syndicaux, la négociation avec des élus (dans les entreprises de moins de 200 salariés) ou avec des salariés mandatés (dans celles de moins de 50 salariés, dépourvues de comités d'entreprise), sur d'autres sujets que l'épargne salariale, « ne semble avoir qu'une application réduite », selon les rédacteurs du rapport.
Une autre innovation institutionnelle importante et récente tarde elle aussi à être mise en pratique. Il s'agit de la possibilité offerte aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement du temps de travail 210 ( * ) . Cette priorité, désormais conférée aux accords d'entreprise, est regrettée par les syndicats. La CFTC observe la faible utilisation actuelle des nouvelles possibilités de dérogation en question. Elle émet l'hypothèse que ce pourrait être la conséquence d'un manque de légitimité des nouveaux interlocuteurs qui sont, à présent, habilités à intervenir dans les négociations concernées.
Pourtant les délégués syndicaux demeurent les négociateurs légitimes au sein de l'entreprise dans le cadre rénové de la négociation collective. En outre, un nouvel acteur syndical non représentatif, le représentant de la section syndicale, peut négocier et conclure des accords, à condition qu'ils soient validés par les suffrages des salariés, lorsqu'aucun autre mode de négociation ne trouve à s'appliquer. Enfin, la loi récemment promulguée sur la démocratie sociale 211 ( * ) , envisage la mesure de l'audience des syndicats dans les très petites entreprises (moins de onze salariés) en vue de leur participation à des commissions paritaires tendant à concourir à l'élaboration et à l'application, dans ces entreprises, d'accords collectifs.
2. Un cadre rénové mais non lisible
Le bilan qu'il est possible de dresser de la négociation collective en France en 2008 doit tenir compte de ces changements de contexte importants soulignés tout au long du rapport, avec en particulier deux tendances :
- tendance au renforcement de la négociation collective par rapport à la loi, tout d'abord, qui implique une légitimation de l'activité des syndicats selon de nouveaux critères de représentativité ;
- tendance, d'autre part, à ce que soit privilégiée la détermination au niveau de l'entreprise, des règles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.
L'avant-propos du rapport souligne que la négociation collective ne doit pas se développer au détriment de l'ordre public social. D'un côté, si la législation du travail ne peut plus désormais être modifiée sans concertation préalable avec les partenaires sociaux et si un accord national interprofessionnel peut préfigurer une loi, rien n'empêche, de l'autre côté, que le domaine de l'ordre public social soit agrandi. C'est ainsi que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 encadre dorénavant de façon plus précise la période d'essai préalable à l'embauche d'un salarié.
Toutefois, concernant l'organisation et l'aménagement du temps de travail, la loi du 20 août 2008 a été plus loin que la position commune préalable du 9 avril 2008 des partenaires sociaux. Elle ne s'est pas contentée, en effet, de donner plus d'espace à la négociation collective en la matière, s'agissant notamment du contingent d'heures supplémentaires et du repos compensateur. Les prérogatives de la loi, sont désormais cantonnées à la garantie du respect des règles essentielles nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Mais encore le texte considéré a, en plus, inversé la hiérarchie des normes entre celles fixées par les conventions de branche et celles déterminées par les accords d'entreprises . Ce sont à présent ces dernières qui priment, y compris sur d'éventuels accords de branche antérieurs (cf. décision n° 2008-568 du Conseil constitutionnel du 7 août 2008).
Il existe d'autres domaines de prédilection, pour les accords d'entreprises , notamment l'épargne salariale, qui fait l'objet de négociations particulières, les salaires et primes (en coordination avec les branches), l'emploi (seniors, handicapés, GPEC 212 ( * ) ) et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le niveau de la branche est, en revanche, celui où se négocient principalement les salaires minima conventionnels (ils peuvent être inférieurs au SMIC, leur assiette en est plus proche ou plus large), ainsi que des dispositions relatives à la formation professionnelle, ou aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. Sont également traités à cet échelon, les problèmes de classifications ou de contrats de travail et, plus généralement, tout ce qui nécessite une vision plus large que le point de vue de l'entreprise.
Les accords interprofessionnels , qui sont, quant à eux, de portée nationale, ont évidemment un caractère plus exceptionnel et sont donc moins nombreux, ce qui ne signifie pas pour autant que les discussions qui se déroulent à ce niveau ne soient pas particulièrement intenses.
3. Une négociation dynamique en 2008
Le rapport-bilan de la négociation collective souligne que 2008 apparaît comme une année durant laquelle la négociation, à tous les niveaux professionnels, a été particulièrement dynamique.
Les deux tableaux suivants, qui en sont extraits, rendent compte de l'évolution thématique des accords conclus aux niveaux, respectivement, des branches et des entreprises.
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS PAR LES
AVENANTS
ET LES ACCORDS SIGNÉS EN 2008 ET 2007 AU NIVEAU DES
BRANCHES
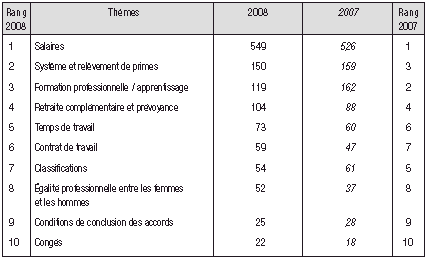
Lecture : ce tableau présente la fréquence des différents thèmes, sachant qu'un texte peut en aborder plusieurs.
Source : ministère du Travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la Ville - DGT
LES THÈMES DE NÉGOCIATION EN 2008 DANS
LES ENTREPRISES
PARMI LES ACCORDS SIGNÉS PAR DES
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX OU SALARIÉS
MANDATÉS
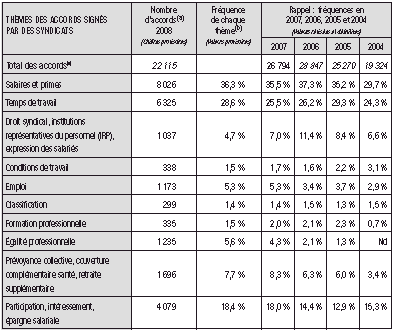
Lecture : en 2008, 8 026 textes signés par des délégués syndicaux ou salariés mandatés ont abordé le thème de salaires et primes, soit 36,3 % de l'ensemble des accords conclus par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés.
(a) Il s'agit des accords, avenants, procès-verbaux de désaccord et des dénonciations d'accords signés en 2008 par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés. Les accords relatifs à la prime exceptionnelle de 1 000 euros et au déblocage exceptionnel de la participation sont exclus de ce décompte.
(b) Dans ce tableau on compte la fréquence des différents thèmes sachant qu'un texte peut en aborder plusieurs. Le total des thèmes est donc nécessairement supérieur à 100 %.
Source : ministère du Travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la Ville - DARES
Les salaires et primes apparaissent comme le principal sujet de discussion en ce qui concerne aussi bien les branches que les entreprises. Dans ces dernières, le temps de travail constitue la deuxième préoccupation des négociateurs, conséquence de la loi TEPA de 2007, en attendant les effets de celle du 20 août 2008 sur la démocratie sociale et le temps de travail, qui ne pouvaient pas être encore pleinement mesurés par les auteurs du rapport. L'épargne salariale (plan et dispositifs d'intéressement) demeure le troisième thème le plus souvent évoqué par les partenaires sociaux dans l'entreprise.
Au niveau des branches, c'est la formation professionnelle et l'apprentissage qui occupent cette place, devant les questions de retraites complémentaires et de prévoyance (au quatrième rang) qui retiennent aussi l'attention des négociateurs dans l'entreprise.
Le rapport souligne, par ailleurs, l'accélération et le développement de la négociation sur des thèmes soutenus par des incitations légales : l'égalité entre les femmes et les hommes (professionnelle et, plus particulièrement, salariale), traitée aussi bien au niveau de la branche (avec une certaine latence) que de l'entreprise ; les contrats de travail (en application de la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail) et la participation financière (accords de branche et d'entreprise), en application des mesures en faveur du pouvoir d'achat prévues par les lois du 8 févier et du 3 décembre 2008.
Deux nouveaux accords nationaux interprofessionnels ont, enfin, été signés en 2008 :
- le premier, le 11 janvier, transformé en loi, sur la modernisation du marché du travail ;
- le deuxième, du 2 juillet, sur le stress au travail.
Ce dynamisme de la négociation interprofessionnelle en 2008 s'est amplifié en 2009, notamment en ce qui concerne l'emploi (en application de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion des conséquences de la crise économique sur l'emploi). Ce thème est également traité de façon croissante au niveau de l'entreprise (emploi des seniors, ...).
En revanche, le nombre des accords sur le temps de travail diminue de façon assez nette. Les salaires restent le sujet de discussion le plus important (un tiers des accords d'entreprises) malgré une diminution du nombre global de signatures au niveau tant de la branche que des entreprises.
B. L'IMPORTANCE GRANDISSANTE DONNÉE AU DROIT CONVENTIONNEL ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE
Au départ, d'un point de vue historique, les salariés se trouvent dans l'entreprise en situation de subordination hiérarchique vis-à-vis de leur employeur qui détermine librement le règlement intérieur de l'entreprise. Ils n'ont aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil de production dont ils ne sont pas propriétaires.
Pour compenser ce déséquilibre, leur sont octroyés une rémunération, une protection et des avantages qui sont déterminés soit individuellement, par contrat, soit de façon collective, par des conventions ou des accords négociés par les partenaires sociaux (représentants des employeurs et du personnel).
L'entreprise d'aujourd'hui est créée, de plus en plus, sous la forme d'une petite unité. Elle s'insère dans des groupes qui fonctionnent désormais davantage en réseau que de façon centralisée. La taille moyenne des établissements diminue.
La fragmentation du processus de production dans l'économie mondialisée actuelle et le développement des services aux particuliers et aux entreprises diversifient et accentuent, de façon différenciée, les contraintes auxquelles doit se soumettre chacun des acteurs concernés dans un contexte où, globalement, la pression concurrentielle s'accroît.
Dans ces conditions, l'entreprise, par sa proximité avec le marché, n'est-elle pas l'échelon le plus approprié pour la définition, dans l'intérêt commun des parties concernées, des normes du pacte social qui régissent son fonctionnement ?
Ne faut-il pas lui laisser un maximum de souplesse pour lui permettre de s'adapter à l'environnement plus complexe et différencié qui est aujourd'hui le sien ?
Ce qui est évident en matière d'aménagement du temps de travail ne l'est pas nécessairement s'agissant, notamment, de concilier flexibilité des entreprises et garantie de l'« employabilité » des salariés.
Ainsi, l'autonomie plus grande laissée aux entreprises dans la production des normes du pacte social ne conduit pas à renoncer à toute forme d'encadrement de ces dernières, par le législateur ou au niveau des branches.
De toute façon, la loi et le règlement continuent à jouer en France un rôle plus important que dans d'autres pays dans la détermination des règles du pacte social, du fait des carences historiques du dialogue social dans notre pays.
1. Une volonté d'implication croissante, voulue par le législateur, des partenaires sociaux dans l'élaboration du droit du travail
La place du droit conventionnel s'est progressivement agrandie aux dépens de celle du droit légal, ce qui rapproche notre droit social de celui, notamment, de nos partenaires de l'Union européenne.
• Ainsi, les lois Auroux de 1982, tout d'abord, ont
permis aux partenaires sociaux, en ce qui concerne la durée du travail,
de négocier des accords d'entreprise contenant des dispositions
différentes, voire moins favorables, donc dérogatoires à
celles de la loi.
• Puis, la loi du 31 janvier 2007 sur la
modernisation du dialogue social a rendu possible la reprise, sous la forme
d'un projet de loi, d'accords nationaux interprofessionnels signés par
les partenaires sociaux, tout texte législatif envisagé devant
faire l'objet, en outre, d'une concertation préalable obligatoire avec
ces derniers.
2. Une facilitation des possibilités de déroger à la hiérarchie des normes au profit, notamment, des entreprises
Par ailleurs, le droit conventionnel a été assoupli par une remise en cause des liens de subordination hiérarchique entre les accords conclus à différents niveaux.
La loi Fillon du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle et le dialogue social a ainsi autorisé, tout d'abord, les accords d'entreprise à déroger, sous certaines conditions, aux accords de branche (qui, eux-mêmes, peuvent différer, de la même façon, des accords interprofessionnels).
La loi du 20 août 2008, a ensuite privilégié l'accord d'entreprise pour les négociations concernant l'aménagement du temps de travail pour lequel la branche n'intervient en principe que « par défaut ».
Sur toute autre question, l'accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si celui-ci l'interdit ou lorsqu'il s'agit de certaines matières 213 ( * ) que l'entreprise ne semble pas apte à traiter.
Les partenaires sociaux peuvent décider si un accord concerne tout ou partie de entreprises constitutives d'un groupe, cet échelon étant reconnu pertinent pour négocier sur la question de la « gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences » (GPEC).
3. Un ensemble de normes désormais moins hiérarchisées et davantage articulées
Les normes qui régissent le fonctionnement du pacte social à l'intérieur de l'entreprise sont définies aujourd'hui plus largement au sein de cette dernière. Mais elles résultent aussi d'accord négociés par les partenaires sociaux à une plus vaste échelle, pour répondre à des besoins variés, l'accord interprofessionnel constituant un quasi règlement ou une pré-loi, à caractère national, et la branche définissant les conditions économiques et sociales de l'exercice d'une profession, notamment en ce qui concerne les PME et la concurrence.
Le tout constitue un ensemble désormais moins hiérarchisé, plus articulé, dans lequel devraient régner, dans l'idéal, la subsidiarité et la suppléance entre les différents niveaux.
En contrepartie de l'accroissement du rôle des conventions collectives en général et des accords d'entreprises en particulier dans l'élaboration des normes du pacte social, les exigences de représentativité des syndicats pour la négociation et la validation des conventions ont été renforcées à tous les niveaux.
Le tableau suivant rend compte de ces nouvelles règles et détaille la hiérarchie des normes au sein des conventions collectives.
CONVENTIONS COLLECTIVES
|
NIVEAU |
DOMAINE |
CONCLUSION |
DÉROGATION/NORME SUPÉRIEURE |
||
|
Qui négocie ? |
Conditions de validité |
Condition |
Modification apportée |
||
|
Interprofessionnel (ANI : accord national interprofessionnel) |
Chômage, formation au long de la vie, seniors, stress, modernisation du marché du travail, gestion sociale des conséquences économique de la crise sur l'emploi |
- Jusqu'en 2013, les « cinq grands » - Au-delà : syndicats ayant obtenu plus de 8 % des suffrages exprimés aux élections |
Signataires : au moins 30 % des suffrages Absence d'opposition de syndicats représentant au moins 50 % des suffrages (ou, jusqu'en 2013, de trois des « cinq grands » |
- Conformité à l'ordre public social défini par la Constitution et par la loi - Autorisation par une loi |
- Un ANI préalable peut être transformé en loi 214 ( * ) puis modifié par celle-ci - Principe de faveur (+) |
|
Branche (CCB : Convention collective de branche) |
Garanties sociales essentielles et régulation économique au sein de quelques 700 branches |
- Jusqu'en 2017, les « cinq grands » - Au-delà : 8 % des suffrages exprimés au niveau de la branche |
- Jusqu'en 2013, absence d'opposition de la majorité des syndicats représentatifs dans la branche. La loi de 2004 permettait aussi à la branche d'opter pour des élections spéciales ou pour la référence aux résultats des dernières élections professionnelles. - A partir de 2013 30 % pour, absence d'opposition de 50 %, selon les résultats des élections |
- Conformité à l'ordre public social défini par la Constitution et par la loi - Autorisation par une loi |
Plus favorable (+) Moins favorable (-) ou complémentaire (?) |
|
Entreprise |
Temps de travail + toute autre question (salaires, participation...) pour laquelle la dérogation n'est pas interdite et l'entreprise s'avère un échelon de négociation pertinent, notamment seniors, handicapés, égalité homme/femme... Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) du ressort des groupes. |
> 10 % des suffrages |
> 30 % favorables < 50 % s'opposant à l'accord En cas d'anomalie (carence, absence de dépouillement, ...) : référendum : = 50 % |
Les mêmes que pour les ANI et les CCB (respect de l'ordre public et de la loi) + Interdiction de déroger aux ANI et CCB concernant : - les salaires minima - les classifications - les garanties sociales - la formation professionnelle continue (fonds mutualisé) + Absence de clauses d'une CCB et d'un ANI interdisant la dérogation |
+ - ? |
|
PME TPE ( ?) |
Identique à celui des autres entreprises |
En l'absence de DS 215 ( * ) (200 salariés) ou de DP 216 ( * ) désigné comme tel (50) : - Elus du CE ou DP - Salariés mandatés - RSS 217 ( * ) (10 salariés) |
50 % des suffrages |
Les mêmes que pour les autres entreprises |
+ - ? |
C. LA DIVERSIFICATION PEU CONTRÔLÉE DES SOURCES DE PRODUCTION DE RÈGLES JURIDIQUES : L'EXEMPLE DE LA « SOFT LAW »
Dans son bilan de l'année 2006, le Conseil d'Etat voit dans la multiplication des sources du droit, externes et internes, l'une des principales raisons de la complexité croissante des normes qui, selon lui, menace l'Etat de droit (voir titre II de ce rapport).
Il met en cause, notamment, les récents développements du droit communautaire et la création continue d'un réseau complexe de conventions internationales.
Ces observations générales s'appliquent aux normes juridiques relatives au pacte social dans l'entreprise.
L'importance des conventions de l'OIT et le développement d'un droit social européen ont déjà été analysés dans ce chapitre. Il reste à rendre compte de l'essor d'un droit nouveau au statut incertain, la soft law, tâche particulièrement délicate !
1. Tentative de définition
La « soft law » est un ensemble de règles et de conventions dont il est difficile de préciser les contours, le contenu et les effets juridiques. Comme son nom l'indique, c'est un droit « mou », qui trouve plus facilement sa place dans un système de « common law » que dans celui des pays de droit écrit, héritiers du droit romain, attachés, comme la France, à la clarté et à la précision des règles juridiques.
La soft law peut se définir en fonction des personnes qui l'établissent, généralement des entités non étatiques, multinationales ou organisations non gouvernementales...
On peut se référer aussi, pour préciser le concept en question, aux domaines auxquels il s'applique (droits sociaux fondamentaux, préservation de l'environnement ou respect de principes éthiques), ou à la portée des dispositions considérées, généralement dépourvues d'effet juridique direct et contraignant.
S'il s'agit seulement de caractériser par ce terme des règles imprécises, alors certains articles des conventions de l'OIT ou de lois françaises 218 ( * ) font partie de la soft law lorsqu'ils se contentent d'afficher des objectifs souhaitables ou des principes à respecter sans indiquer ni les moyens d'y parvenir ni les sanctions encourues en cas d'échec ou de manquement aux obligations définies.
La soft law fait partie des règles du pacte social, au sens le plus large de la notion, en ce qu'elle concerne les normes concernant non seulement les relations entre les « parties prenantes » de l'entreprise mais aussi les droits et devoirs de cette dernière vis-à-vis de la société, en réponse aux exigences et aux attentes nouvelles des citoyens, notamment en matière environnementale et sur le plan éthique.
En ce sens, la notion est très proche de celle de la responsabilité sociétale (ou sociale) de l'entreprise (RSE), sorte de déclinaison de ce qu'implique pour cette dernière le respect des principes du développement durable dans ses trois composantes, environnementale, sociale ou économique.
2. Un phénomène incontournable ?
Indéniablement, le développement de la « soft law » participe d'une complication croissante des normes. Mais on peut considérer que si ce phénomène doit être maîtrisé, il est cependant inévitable car inhérent à la complexité de la société post moderne, mondialisée et décentralisée, dont le fonctionnement requiert une certaine souplesse mais aussi des garde-fous passant par l'affirmation de nouvelles formes de définition et d'adjudication du droit.
La « soft law » présente incontestablement, à cet égard, l'avantage de la flexibilité. Ne nécessitant pas l'intervention du Parlement, pour sa rédaction ou sa ratification, elle peut être élaborée et révisée plus facilement et plus rapidement qu'une loi ou un traité.
Elle ne connaît pas non plus les limites qui sont celles de l'intervention des Etats et peut donc s'imposer simultanément dans tous les pays, même si leurs systèmes juridiques diffèrent sensiblement, dans lesquels une entreprise multinationale est implantée. Elle permet ainsi, notamment, d'homogénéiser le niveau de protection sociale des travailleurs concernés, au profit de ceux au départ les plus défavorisés.
La soft law, quand elle n'est pas « autodéterminée » par l'entreprise mais « codéterminée », est aussi un moyen de faire participer à la définition des normes des personnes qui, bien qu'intéressées, n'y sont généralement pas associées (ONG, associations de consommateurs et de défense de l'environnement ou des droits de l'homme...).
Dans le meilleur des cas, le cadre dans lequel se négocie ainsi la soft law peut constituer une sorte de laboratoire juridique d'où émergent des normes aux effets, dans l'immédiat, moins contraignants que les lois ou les traités mais qui préfigurent le droit de demain.
Même en cas d'autorégulation, la soft law permet de soumettre aux mêmes exigences non seulement l'entreprise elle-même mais ses fournisseurs et ses sous-traitants à travers le monde, sous la surveillance et la sanction du juge.
Rien n'empêche, par ailleurs, les syndicats de s'impliquer sur les thèmes mis en avant par les entreprises en ce qui concerne la RSE. Il est d'ailleurs parfois prévu de les faire participer au contrôle du respect par celles-ci de leurs engagements en la matière.
Certaines entreprises comme Reebok ou Levi Strauss (Levi's) vont même jusqu'à confier cette tâche à leurs propres salariés en ce qui concerne, par exemple, la fidélité de leurs sous-traitants.
Les accords cadres internationaux (ACI) entre les firmes multinationales et les syndicats internationaux sont, dans un cadre plus large, une occasion pour ces derniers de se saisir du concept de RSE et d'en faire un objet de négociation.
Ainsi, la soft law peut être vue comme un instrument adapté à une économie mondialisée dans laquelle les Etats et les organisations internationales ne sont plus en mesure d'être les seuls créateurs de règles de droit.
Le développement de la soft law, au total, participe de plusieurs tendances qui caractérisent l'évolution du droit social :
- décentralisation dans la définition des règles du pacte social avec un recul du rôle des Etats et un essor des sources de droit négociées ;
- assouplissement de certaines contraintes juridiques mais extension par ailleurs du champ des obligations imposées aux entreprises ;
- complexité accrue du droit applicable du fait, notamment, d'une prolifération de normes dont l'ensemble constitue un subtil dégradé.
Si, à ce stade, elle peut témoigner d'un affaiblissement de l'état de droit, il n'est pas sûr que ses potentialités étant mieux exploitées elle ne réussisse pas à inverser ces effets.
3. Aperçus critiques
Malgré son essor, la soft law apparaît, en l'état, comme un instrument soumis à la critique.
De nombreux reproches ont été adressés à la soft law par des tenants de l'ordre juridique établi : sa prétention à créer des normes de source non étatique, ses effets juridiques de ce fait indéterminés qui introduisent ainsi une incertitude dans le droit existant, le fait que son application pose de difficiles problèmes d'interprétation, pour le juge, et d'évaluation pour les experts chargés de vérifier le respect des engagements pris en son nom...
Un éminent spécialiste du droit public français, Prosper Weil, s'est inquiété notamment, dès les années quatre-vingt, de ce que la soft law portait atteinte à la hiérarchie des normes en droit international.
La création de références par des organisations ou des collectivités dépourvues de personnalité juridique provoquait selon lui le passage d'une normativité graduée à une normativité diluée, d'un droit établi à un droit désiré. Cette relativisation de la normativité antérieure tendait à affaiblir, d'après ses analyses, le droit international dans son ensemble.
On pouvait légitiment s'inquiéter de ce que le droit international public ne soit pas seul en cause, les entreprises ayant, elles aussi, eu recours de plus en plus à la soft law.
S'agissant de la RSE, les obligations faites aux sociétés cotées par la loi NRE (nouvelles régulations économiques) de 2001 ont été étendues par les lois Grenelle I et surtout Grenelle II aux sociétés non cotées, s'agissant de la publication, en même temps que de leurs comptes annuels, d'informations sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
Les multinationales peuvent souscrire aussi, en la matière, des engagements volontaires, formalisés notamment dans des chartes rendues publiques ou des codes de bonnes pratiques.
Pour certains 219 ( * ) , la RSE n'est qu'une tentative de nature politique tendant à permettre aux dirigeants d'entreprise de gérer, dans le nouveau contexte post-Fordien, leurs relations avec leurs actionnaires, leurs clients et leurs partenaires, sans que la situation des salariés s'en trouve transformée de façon évidente.
De fait, se conformer à des engagements environnementaux, éthiques ou autres, déterminés de façon unilatérale ou avec des partenaires ou des organisations de consommateurs, implique généralement, pour l'encadrement et les employés, des contraintes supplémentaires, voire de nouveaux motifs de licenciement éventuel pour faute grave 220 ( * ) .
Se pose aussi le problème de l'objectivité de l'évaluation du respect par l'entreprise de ses engagements, surtout lorsqu'il s'agit d'auto-réglementation, plutôt que d'une réglementation négociée (« co-réglementation »), selon la distinction à laquelle la Commission européenne tient à se référer.
Il règne un flou certain en ce qui concerne aussi bien les critères et les méthodes de cette évaluation qu'il s'agisse des personnes qui en sont chargées ou des sanctions encourues par les entreprises en cas de manquement à leurs obligations d'information et d'action.
Les agences de notation sociale et environnementale, clientes de l'entreprise, ne vont-elles pas se montrer trop complaisantes envers celle-ci ?
La priorité, en tout cas pour les dirigeants, est de donner au consommateur, dans le monde entier, la meilleure image possible de leur société qui doit apparaître comme irréprochable sur le plan environnemental et éthique. Les préoccupations sociales peuvent sembler davantage « externes » (respect des droits les plus fondamentaux des travailleurs dans les filiales des pays les plus pauvres) que tournées réellement vers l'amélioration des relations professionnelles dans les sociétés mères.
La RSE risque ainsi d'être récupérée pour devenir essentiellement un instrument de la politique de communication de l'entreprise, sans autre ambition.
Au total, il paraît dangereux que la « soft law » puisse dessaisir le législateur de ses prérogatives et faire apparaître comme la poursuite d'objectifs d'intérêt général, la satisfaction des intérêts privés de l'entreprise.
DEUXIÈME PARTIE : LE SCÉNARIO DU PIRE
CHAPITRE I : UNE
RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE JOUANT DE PLUS EN PLUS CONTRE LA
CROISSANCE ?
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE La faible progression des salaires aboutit à ce que la part des revenus de la production distribuée aux salariés est à un point historiquement bas. Ainsi, même quand on raisonne dans les conventions de comptabilité nationale, qui n'appréhendent pas complètement les phénomènes de richesses, la part de celles-ci allant au travail est à l'étiage. Ce constat est encore plus net quand on s'intéresse à la quasi-totalité des salariés (99 % d'entre eux) étant donné la concentration des salaires au profit du centième le mieux payé d'entre eux. Mais, ce diagnostic ne serait pas complet sans une recherche des causes de cette situation. En matière de prospective, cette recherche étiologique est d'autant plus nécessaire qu'elle conditionne la vision du futur et informe sur les leviers d'action à mobiliser, ce qui est tout l'objet de la prospective. Dans les approches des économistes classiques, des évolutions du partage de la valeur ajoutée peuvent se produire sous l'effet de variations des prix relatifs des facteurs de production. Mais théoriquement, la répartition de la valeur ajoutée est stable sur longue période, les effets des évolutions des coûts relatifs des facteurs de production n'étant que transitoires. Ainsi, la forte hausse du coût du travail intervenue au moment du premier choc pétrolier, après s'être traduite par une hausse de la part salariale dans la valeur ajoutée, a été suivie d'une modération salariale qui en a entraîné le reflux, en deçà de sa position initiale. Pourtant, la persistance de la modération salariale n'a pas permis de rétablir celle-ci, l'intensification capitalistique (rapport du stock du capital au travail) se poursuivant et les dynamiques salariales continuant d'être contenues par une série de facteurs au premier rang desquels le chômage. Tout se passe comme si la combinaison productive ne répondait plus à l'évolution des coûts relatifs des facteurs de production, ce qui conduit à atténuer la portée de l'explication par les coûts des facteurs. Cet enseignement peut être utile pour l'action publique en ce qu'il atténue la portée normative des mécanismes de marchés et invite à en approfondir les déterminants. En ce sens, d'autres explications ont donc été avancées : l'existence d'un nouveau régime technologique réservant structurellement une place plus grande au capital, la mondialisation qui pèserait sur les salaires des non-qualifiés (mais certaines études en concluent que ce sont les qualifiés qui sont les plus touchés), des recompositions de la structure productive... Prises une à une, ces explications peinent à convaincre, chacune d'entre elles peuvent être assorties d'objections, plus ou moins dirimantes, venant en limiter la significativité. Pourtant, elles ont individuellement une certaine portée et, réunies, dessinent un décor qui suggère qu'un affaiblissement du pouvoir de négociation des salariés pourrait expliquer la répartition actuelle de la valeur ajoutée, d'autant qu'il se combine avec une hausse sans précédent des revenus versés aux détenteurs du capital, en lien avec le renforcement conséquent de l'organisation de la gestion de l'épargne et avec la libération de plus en plus complète des flux de capitaux. Parmi les causes de cet affaiblissement, qui n'est pas homogène (certains salariés défendent plus efficacement leurs positions que d'autres), il faut faire toute sa place à la restructuration des entreprises où les phénomènes d'externalisation s'accompagnent d'une multiplication des situations de domination dans l'organisation des chaînes productives. Un scénario noir se dessine : celui d'un cercle vicieux où la répartition de la valeur ajoutée serait de plus en plus déséquilibrée au détriment des rémunérations du travail. En outre, des facteurs exogènes majeurs vont intervenir en relation avec le vieillissement démographique qui pourrait peser significativement sur la part du revenu national dédié au travail. Ce processus pourrait être justifié s'il s'accompagnait d'un réemploi de la valeur susceptible d'aboutir à une élévation du potentiel de croissance réel. Malheureusement, outre qu'il s'est accompagné d'excès financiers susceptibles de remettre en cause la soutenabilité de la croissance (l'effet de levier de l'endettement), le taux d'investissement n'a pas suivi l'essor des capacités potentielles d'épargne des entreprises. D'un côté, la concentration des revenus des ménages a débouché sur des bulles d'actifs. De l'autre, le supplément de richesses attrait par les entreprises a, au mieux, servi à élargir leurs actifs étrangers, au pire, été consacré à entretenir des plus-values purement financières. Dans un tel contexte, la croissance économique ralentirait sous l'effet d'une demande de plus en plus atone tandis que l'épargne relativement abondante, notamment pour des motifs de précaution, s'investirait de moins en moins dans l'appareil productif national. Elle se porterait sur des actifs patrimoniaux qui connaîtraient des bulles déstabilisantes ou sur les zones étrangères de croissance dynamique. L'Etat courrait après l'équilibre budgétaire et serait amené à sacrifier le financement de biens publics pourtant essentiels à une croissance potentielle dont les déterminants naturels sont en voie d'attrition. |
I. LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE À UN POINT HISTORIQUEMENT BAS
Même en s'en tenant aux indicateurs de la comptabilité nationale un constat s'impose : la part des salaires dans la valeur ajoutée a rétrogradé si bien qu'elle se situe aujourd'hui à un point bas .
Ce constat est souvent assorti de l'observation selon laquelle ce recul n'est pas significatif et que, depuis des années, la répartition de la valeur ajoutée est stabilisée.
Outre que ce dernier diagnostic est, comme on l'a indiqué, tributaire de trop d'incertitudes de méthode pour être accueilli sans de sérieuses réserves, il reste à souligner que la part des salaires dans la valeur ajoutée est aujourd'hui à un point historiquement bas quand celle des revenus versés aux actionnaires est à un sommet, historique lui aussi .
ÉVOLUTION DES REVENUS DISTRIBUÉS AUX
PROPRIÉTAIRES DU CAPITAL
(EN % DE LA VA) ET DE LA PART DES
SALARIÉS AU COÛT DES FACTEURS
DE 1959 À 2007
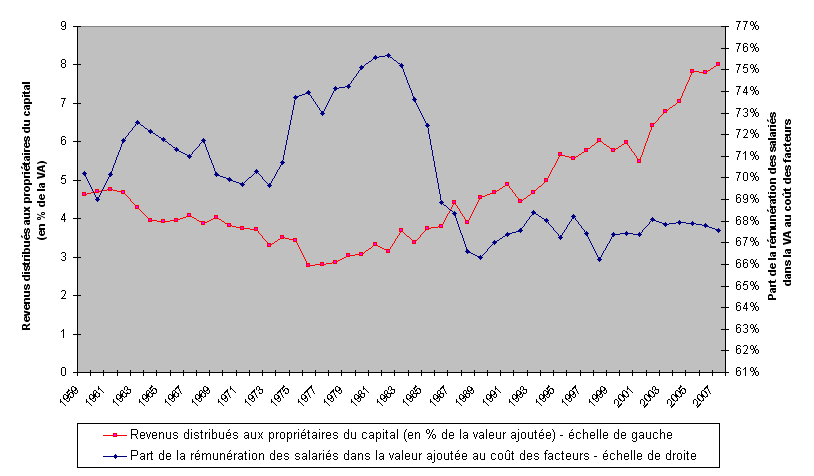
Au bas niveau atteint par les salaires dans la valeur ajoutée correspond une faible progression du pouvoir d'achat des revenus du travail dont la perception n'est pas entièrement restituée par les indicateurs usuellement mobilisés : le salaire net croît moins que le salaire brut ; la concentration des salaires accroît les inégalités, la relative résistance des bas salaires cédant devant la montée des emplois atypiques et la récurrence, pour certains, des périodes de chômage.
L'érosion globale du salariat est ainsi souvent amplifiée quand on considère les rémunérations réellement perçues par les salariés individuellement.
Sans prétendre expliquer complètement la déformation du partage de la valeur ajoutée, on en propose en annexe quelques interprétations , utiles dans la réflexion sur l'avenir de la répartition de la valeur ajoutée.
Même dans le cas où l'on tient pour acquise la stabilité du partage de la valeur ajoutée depuis vingt ans, ce qu'on ne peut faire étant donné les problèmes posés par le concept et la mesure de la répartition de la valeur ajoutée, force est de reconnaître que la part des salaires dans la valeur ajoutée se situe à un point historiquement bas.
A. UNE FORTE BAISSE DE LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE
PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
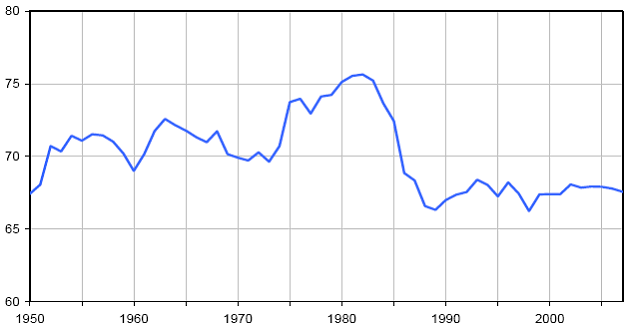
Source : INSEE. Mai 2009
La période de stabilité du partage de la valeur ajoutée commencée au début des années 1990 a succédé à une phase (débutée au début des années 80), où la part des salaires dans la valeur ajoutée a connu une chute considérable, de l'ordre de 10 points dans le champ des entreprises non financières , et même au-delà quand on considère l'ensemble de l'économie (dans certaines estimations).
Inversement, l'excédent brut d'exploitation (EBE) a progressé de sorte que le taux de marge des entreprises non financières (rapport entre l'EBE et la valeur ajoutée) dépassait 30 % en 2007 contre moins de 25 % au début des années 80.
De nombreuses analyses considèrent que la baisse de la part de la valeur ajoutée revenant aux salaires peut être vue comme un processus de normalisation.
Le poids des salaires dans la valeur ajoutée se serait accru brutalement au cours des chocs pétroliers de la seconde moitié des années 70 en raison d'une rigidité des salaires qui se seraient alignés sur l'inflation provoquée par l'augmentation du prix du pétrole. Un décrochage entre les salaires et la productivité du travail serait intervenue, d'autant plus net que les entreprises n'auraient pas bien anticipé le ralentissement de l'activité économique. Leur taux de marge se serait contracté dans des proportions non soutenables.
Le processus de décrue de la part des salaires dans la valeur ajoutée qui a suivi ne serait qu'un phénomène de normalisation prédit par la théorie .
Ces analyses comportent à la fois une observation des faits et des jugements de valeur qui proposent sur les faits observés un jugement économique normatif souvent implicite.
A sa base se trouve l'idée selon laquelle il existe un partage de la valeur ajoutée « quasiment naturel » qui, reflétant la situation des marchés des facteurs de production et des biens, garantit un optimum économique.
Face à ces présupposés, il apparaît utile de décomposer l'analyse pour se demander successivement :
- si les faits décrits rendent pleinement compte de ce qui s'est produit ;
- quels sont les facteurs qui ont pu influencer les évolutions observées ;
- et, enfin, si ces évolutions rapprochent ou non d'une situation économique souhaitable.
B. QUELQUES FAITS STYLISÉS COMPLÉMENTAIRES
Sur le plan des faits , il convient de compléter la description qui vient d'en être proposée par quelques constats.
• Le
premier
d'entre eux est que
la France est probablement le pays qui a subi la plus forte baisse de
la part des salaires dans la valeur ajoutée
au cours de cette
période. Autrement dit, même en tenant pour valide le constat
d'une relative stabilité de la valeur ajoutée ces
dernières années, on pourrait voir dans celui-ci la simple
cessation d'une forte décrue de la part salariale réalisée
plus tôt que dans de nombreux pays.
• Deuxième constat
: si,
dans le champ des seules entreprises non financières, la France
appartient au groupe des pays où la part des salaires dans la valeur
ajoutée est plutôt élevée, elle est
accompagnée dans ce groupe par des pays aux institutions aussi
différentes que les Etats-Unis
221
(
*
)
et la Suède et a été
rattrapée par le pays souvent décrit (mais sans doute à
tort) comme le moins réglementé d'Europe, le Royaume-Uni. Ceci
conduit à relativiser considérablement les hypothèses
d'une influence décisive des institutions sur la répartition de
la valeur ajoutée et, plus encore, l'idée que la France se
caractériserait par une rigidité qui nuirait (et dans quel
sens ?) à un partage de la valeur ajoutée compatible avec un
rendement élevé du capital.
Il est vrai que les comparaisons internationales sur cette question sont particulièrement fragiles ainsi qu'on l'a indiqué plus haut.
|
COMPARAISONS INTERNATIONALES : CERTAINES
CONVERGENCES
Les comparaisons internationales - qui sont fragiles du fait de la diversité qualitative des données - montrent que les pays développés connaissent des situations et des évolutions différenciées sur le plan du partage global.
COMPARAISON INTERNATIONALE - PART DE LA
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
Source : Calculs INSEE pour la France, BEA pour les Etats-Unis, ONS (Blue Book 2008) pour le Royaume-Uni, OCDE pour les autres pays S'agissant des pays figurés dans le graphique à peu près comparables sous l'angle des données utilisées, on observe un écart de 12 points entre l'Allemagne et les Etats-Unis s'agissant de la part des salaires. Les Etats-Unis sont le pays où celle-ci est à son niveau le plus élevé et ce phénomène est structurel. Il contredit l'opinion commune qui associe au « capitalisme américain » singulièrement « financiarisé » un sacrifice systématique des salariés. Dans le même esprit, on peut relever que si le Royaume-Uni n'est pas le pays européen où la part des salaires est la plus élevée, il n'en est pas très loin n'étant séparé de la Suède et de la France que de deux points. Du reste, si l'on raisonnait au niveau de l'ensemble de l'économie, on observerait que le Royaume-Uni a une part de sa valeur ajoutée revenant aux salaires sensiblement supérieure à celle de nombreux pays d'Europe continentale. Le poids des services financiers au Royaume-Uni où la proportion prise par les salaires dans la valeur ajoutée est plus forte est relativement important ce qui explique cette situation. |
|
Les données italiennes n'étant pas du même ordre que les autres, la singularité de l'Allemagne ressort du graphique : la part des salaires dans la valeur ajoutée y est beaucoup plus basse que dans les autres pays. Par ailleurs, la répartition globale de la valeur ajoutée a évolué différemment . Dans les pays où elle était relativement élevée (Etats-Unis, Suède), elle s'est repliée dans les années 2000 mais vers un niveau qui reste plutôt haut. Au Royaume-Uni elle a, au contraire, progressé (de près de 4 points entre 1996 et 2006). Stable en France, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises non financières a, en revanche, beaucoup diminué en Allemagne (- 7,2 points par rapport au niveau de 1995). PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES EN 2007 (EN %)
PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES ÉVOLUTION (2007-2000) - (en points de la valeur ajoutée)
|
|
Une première observation s'impose : les évolutions relevées ici confirment que le partage de la valeur ajoutée n'est pas nécessairement stable contrairement aux prédictions de certaines théories économiques qui lui attribuent cette propriété (les économistes classiques). Manifestement, les forces qui le déterminent n'ont pas l'automaticité décrite. Seconde observation : si les évolutions observées manifestent une certaine convergence des conditions de partage de la valeur ajoutée, qui pourrait traduire l'existence des contraintes communes auxquelles se seraient trouvées confrontées les différentes économies, des pays peuvent se singulariser . Ainsi, l'Allemagne, première économie européenne, diverge nettement . Cette dernière évolution qui concerne le premier « partenaire économique » de la France et l'économie la plus influente d'Europe n'est évidemment pas sans poser de problèmes. La désinflation compétitive (qui passe en Allemagne par une compression des salaires) appelle, pour le futur, des développements dont certains pourraient se solder par une baisse prononcée de la part des salaires dans la valeur ajoutée dans l'ensemble des pays européens. |
PART CORRIGÉE DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE AU COÛT DES FACTEURS - ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE (2007-2001)
|
Belgique |
Allemagne |
France |
Italie |
Pays-Bas |
Suède |
Royaume-Uni |
Norvège |
Etats-Unis |
Japon |
Canada |
Australie |
|
|
1991 |
70,4 |
66,8 |
68,1 |
68,2 |
67,8 |
70,8 |
75,8 |
59,7 |
68,4 |
69,5 |
70,7 |
65,6 |
|
1992 |
70,7 |
68,0 |
67,7 |
67,9 |
68,9 |
69,2 |
75,5 |
60,4 |
68,0 |
69,8 |
71,3 |
65,0 |
|
1993 |
71,6 |
68,0 |
68,1 |
67,1 |
69,7 |
67,2 |
73,5 |
59,1 |
67,8 |
69,8 |
70,6 |
64,9 |
|
1994 |
70,9 |
66,7 |
67,3 |
65,0 |
68,1 |
66,0 |
72,1 |
59,2 |
67,2 |
70,7 |
68,1 |
64,9 |
|
1995 |
70,3 |
66,3 |
67,3 |
63,2 |
67,6 |
63,9 |
71,2 |
58,7 |
67,1 |
71,0 |
66,8 |
65,6 |
|
1996 |
70,7 |
66,0 |
67,4 |
63,2 |
67,2 |
67,1 |
69,3 |
57,3 |
66,3 |
70,2 |
66,5 |
66,0 |
|
1997 |
70,5 |
65,2 |
66,9 |
63,8 |
66,4 |
67,3 |
69,1 |
57,3 |
66,1 |
70,1 |
66,5 |
65,2 |
|
1998 |
69,9 |
65,0 |
66,1 |
62,9 |
66,9 |
68,0 |
70,2 |
61,9 |
67,3 |
71,2 |
67,4 |
65,3 |
|
1999 |
70,8 |
65,5 |
66,7 |
62,6 |
66,8 |
67,8 |
70,7 |
60,4 |
67,5 |
70,5 |
65,9 |
64,9 |
|
2000 |
69,7 |
66,3 |
66,2 |
61,7 |
65,9 |
69,0 |
71,9 |
52,6 |
68,6 |
69,4 |
64,2 |
64,9 |
|
2001 |
70,8 |
65,9 |
66,0 |
61,4 |
66,2 |
71,1 |
72,5 |
53,6 |
68,2 |
69,4 |
64,5 |
63,4 |
|
2002 |
71,1 |
65,5 |
66,3 |
61,6 |
66,6 |
70,5 |
71,5 |
56,2 |
67,8 |
68,0 |
64,7 |
63,1 |
|
2003 |
70,3 |
65,4 |
66,2 |
61,9 |
66,9 |
69,9 |
71,3 |
55,2 |
67,3 |
66,8 |
64,1 |
62,2 |
|
2004 |
68,8 |
64,5 |
66,2 |
61,7 |
66,7 |
68,9 |
71,2 |
52,9 |
66,5 |
65,1 |
63,5 |
62,5 |
|
2005 |
67,9 |
63,6 |
66,2 |
62,3 |
65,0 |
68,3 |
71,3 |
50,0 |
66,0 |
65,0 |
63,1 |
62,3 |
|
2006 |
67,5 |
62,6 |
65,8 |
63,0 |
64,7 |
67,1 |
71,2 |
49,2 |
65,8 |
65,1 |
63,5 |
61,9 |
|
2007 |
67,4 |
62,2 |
65,4 |
62,4 |
64,9 |
68,3 |
70,1 |
51,7 |
65,8 |
63,8 |
63,7 |
Nc |
|
Différence
|
- 3,0 |
- 4,6 |
- 2,7 |
- 5,8 |
- 2,9 |
- 2,5 |
- 5,7 |
- 8,0 |
- 2,6 |
- 5,7 |
- 7,0 |
- 3,7
|
Troisième constat : le niveau des salaires dans la valeur ajoutée est aujourd'hui à un échelon historiquement bas , inférieur à ce qu'il était avant les chocs pétroliers des années 70 et 4 à 5 points plus bas que pendant les Trente Glorieuses.
Autrement dit, le soi-disant processus de retour vers un état « naturel » de partage de la valeur ajoutée n'a pas abouti à une convergence des salaires vers un point d'équilibre du partage de la valeur ajoutée analogue à ce qu'il était sur longue période en France mais vers un point d'équilibre plus bas de l'ordre de 5 points de PIB .
Enfin, quatrième constat : le processus de concentration des salaires vers le haut de l'échelle salariale, à supposer même qu'on l'appréhende dans les termes conventionnels restrictifs généralement utilisés, établit que la part de la quasi-totalité des salariés dans la valeur ajoutée a baissé en France.
Ces constats conduisent à considérer que le point d'équilibre du partage de la valeur ajoutée est singulièrement bas aujourd'hui en France par rapport aux valeurs historiques qui ont été les siennes. Ils montrent aussi que le point d'équilibre du partage de la valeur ajoutée n'est pas nécessairement « naturel » et que la considération de quelques variables institutionnelles (comme le niveau de règlementation du marché du travail) ne suffit pas à expliquer le partage constaté.
C. LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE AU CONFLUENT D'INFLUENCES DIVERSES QUI, À L'AVENIR, RISQUENT DE PROLONGER LA BAISSE DE LA PART SALARIALE DANS LA VALEUR AJOUTÉE
On évoque parfois une « loi d'airain » du partage de la valeur ajoutée au terme de laquelle les parts respectives des revenus du travail et du capital atteindraient un niveau invariant.
Or, cette référence nous paraît moins exacte que celle qui voit dans la répartition de la valeur ajoutée et son évolution une forme d'énigme dont la résolution passe par un effort patient d'élucidation.
De « loi d'airain » il n'y aurait qu'à la condition, ou que les relations sociales soient entièrement dominées par les entrepreneurs (le salaire de subsistance serait alors la règle), ou que les conditions régnant sur les marchés soient de concurrence pure et parfaite (les revenus des facteurs de production seraient alors déterminés par leur productivité).
Alors seulement, il pourrait y avoir, à la limite, stabilité de la répartition de la valeur ajoutée. L'histoire récente montre que tel n'a pas été le cas et elle invite à comprendre les ressorts du partage tels qu'ils ont fonctionné.
On trouvera en annexe la présentation technique des principales explications avancées dans les études réalisées sur ce thème. Chacune d'entre elles a suscité des objections.
Vos rapporteurs retirent de cet entrelacs d'explications que la détermination du partage de la valeur ajoutée est multifactorielle .
Surtout, il leur apparaît improbable que ces facteurs s'inversent de façon spontanée suffisamment pour limiter la décrue de la part salariale dans la valeur ajoutée .
Si les explications par le coût des facteurs de production ne suffisent pas, elles sont partiellement éclairantes. Mais, elles ne sont guère rassurantes dans un monde où la constitution de segments mondialisés du marché du travail et les écarts de rendement du capital sont un défi pour les pays les plus développés.
A cet égard, si la rigidité salariale n'est évidemment pas une solution adaptée, la flexibilité des salaires ne le serait qu'à la condition d'accepter des baisses de rémunération qui ne correspondent pas à la vocation des salariés et ruineraient la cohésion sociale .
Mais, à son tour, la mondialisation n'explique pas tout, la capacité des Nations économiques à s'y adapter comptant sans doute beaucoup plus comme en témoigne le niveau relativement élevé de la part salariale aux Etats-Unis. De ce point de vue aussi, il y a une source d'inquiétudes si l'on considère que ni le travail, ni le capital mis en oeuvre en Europe n'ont suffisamment atteint la frontière technologique , qui permet les performances de productivité nécessaires à la perspective d'une forte rétribution des facteurs de production. La probabilité importante de transitions difficiles pour s'adapter à l'économie mondialisée s'ajoute à ce panorama, alors même que le besoin d'investissement pour rejoindre la frontière technologique est grand.
Enfin, la financiarisation des économies a certainement joué mais plus comme une contrainte que comme une opportunité. Le redressement de la rentabilité du capital qu'elle a favorisé n'a pas été suivi des investissements productifs que cette forme de prélèvement sur les revenus du travail aurait dû financer.
Face à ces phénomènes très puissants, le risque encouru est qu'une attrition plus ou moins rapide de la base productive de Nations dominées par des facteurs de production et des revenus mobiles se produise .
Au total, de ce que l'équilibre de la répartition de la valeur ajoutée est, sans aucun doute, un état obéissant à des déterminations multifactorielles qui peuvent être lues comme résultant les unes les autres d'un système (qui les englobe), on peut tirer plusieurs conséquences :
- les chances de succès de mesures qui ne modifieraient pas le contexte du système lui-même et se contenteraient d'agir à l'intérieur de celui-ci sont faibles ;
- en outre, comme ce contexte est international, les marges de manoeuvre strictement nationales sont des plus réduites ; à cet égard, les politiques salariales conduites au coeur de l'Europe dont, au premier rang, celle de notre voisin allemand pose un problème majeur à toute politique refusant de pratiquer la déflation des salaires à des fins compétitives ;
- enfin, à supposer qu'il reste des marges de manoeuvre dans le système économique qui s'est mis en place, il est douteux que promouvoir une orientation donnée, isolément d'autres éléments, permette d'agir efficacement sur le partage de la valeur ajoutée. L'action publique appelle, en ce domaine aussi, la mobilisation d'une diversité de leviers d'action : enrichissement du capital humain à travers l'objectif d'employabilité, négociations salariales de bon niveau qui n'est plus toujours celui de l'entreprise ou de la branche mais plutôt de la chaîne de production, affectation de l'épargne prélevée sur la valeur ajoutée pour accroître le potentiel de croissance, redistribution secondaire du revenu dans la mesure d'une identification fine des externalités qu'elle permet...
D. LES PERSPECTIVES D'UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Le ralentissement des gains moyens de pouvoir d'achat du salaire brut a été amplifié au niveau du salaire net par l'augmentation des prélèvements sur les salaires destinés principalement à financer les dépenses sociales.
A rendement constant des cotisations sociales, les prélèvements sur les salaires bruts peuvent être considérés comme de purs salaires différés. Ainsi, la répartition du salaire brut entre le salaire net réellement perçu par les salariés à l'instant « T » et les cotisations sociales peut-elle être analysée comme le résultat d'un choix (plus ou moins) implicite entre la perception immédiate et la perception différée du revenu d'activité.
Encore faut-il que le rendement des cotisations soit constant et uniforme pour les salariés, ce qui n'a que peu de chances d'être le cas s'agissant de systèmes dont les variables sont naturelles (la nature change comme le montre le vieillissement démographique) ou/et institutionnelles (les institutions font l'objet de choix politiques qui n'ont pas de constance nécessaire).
A cet égard, le vieillissement démographique prévu à l'horizon 2060 et l'augmentation du ratio de dépendance économique qui en découlerait sont deux tendances susceptibles d'augmenter les besoins sociaux sur fond de ralentissement de la croissance potentielle des économies concernées.
Pour la France, les prévisions démographiques de l'INSEE, d'octobre 2010, peuvent être résumées par les deux graphiques ci-dessous :
ÉVOLUTION DE LA PART DES 60 ANS OU PLUS
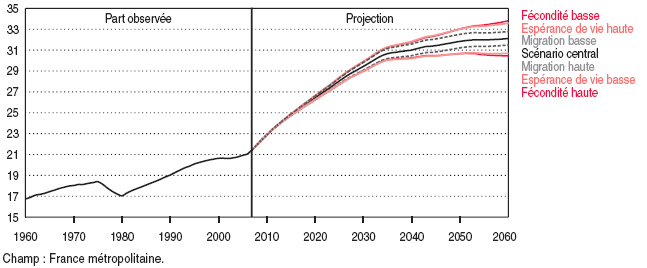
Source : Insee, estimations de population et projection de population 2007-2060
ÉVOLUTION DU RATIO DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
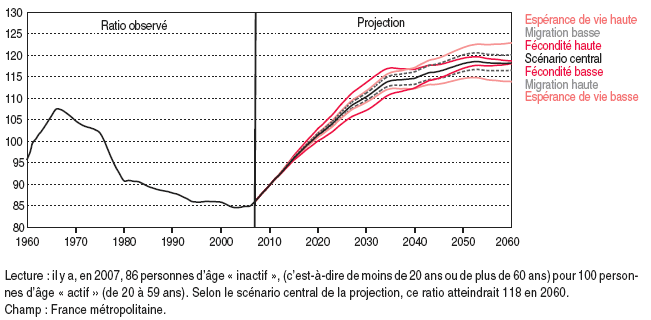
Source : Insee, estimations de population et projection de population 2007-2060
Dans le scénario central, la part des 60 ans et plus augmenterait de 80 % contre une diminution de la population des 20-59 ans (la plus active) qui passerait de 53,8 à 45,8 % du total.
Pour la France, le ratio de dépendance économique qui rapporte les personnes d'âge inactif (les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) aux personnes d'âge actif s'élèverait de 0,86 en 2007 à 1,18 en 2060.
Ces prévisions s'accompagnent de la perspective d'une augmentation des dépenses liées à l'âge des populations.
Le tableau ci-après récapitule les projections réalisées en ce domaine par la Commission européenne.
AUGMENTATION DES DÉPENSES LIÉES À L'ÂGE 2010-2060 (EN % DU PIB)
|
Pensions |
Santé |
Dépendance |
Chômage et éducation |
TOTAL |
|||||||
|
2010 |
Variation
|
2010 |
Variation
|
2010 |
Variation
|
2010 |
Variation
|
2010 |
2060 |
Variation
|
|
|
Belgique |
10,3 |
4,5 |
7,7 |
1,1 |
1,5 |
1,3 |
7,3 |
-0,3 |
26,8 |
33,4 |
6,6 |
|
Bulgarie |
9,1 |
2,2 |
4,8 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
3,0 |
0,2 |
17,1 |
20,3 |
3,2 |
|
République tchèque |
7,1 |
4,0 |
6,4 |
2,0 |
0,2 |
0,4 |
3,3 |
0,0 |
17,0 |
23,3 |
6,3 |
|
Danemark |
9,4 |
-0,2 |
6,0 |
0,9 |
1,8 |
1,5 |
8,0 |
0,1 |
25,2 |
27,4 |
2,2 |
|
Allemagne |
10,2 |
2,5 |
7,6 |
1,6 |
1,0 |
1,4 |
4,6 |
-0,4 |
23,3 |
28,4 |
5,1 |
|
Estonie |
6,4 |
-1,6 |
5,1 |
1,1 |
0,1 |
0,1 |
3,2 |
0,3 |
14,8 |
14,7 |
-0,1 |
|
Irlande |
5,5 |
5,9 |
5,9 |
1,7 |
0,9 |
1,3 |
5,3 |
-0,2 |
17,5 |
26,2 |
8,7 |
|
Grèce |
11,6 |
12,5 |
5,1 |
1,3 |
1,5 |
2,1 |
3,8 |
0,1 |
21,9 |
37,9 |
16,0 |
|
Espagne |
8,9 |
6,2 |
5,6 |
1,6 |
0,7 |
0,7 |
4,8 |
-0,2 |
20,0 |
28,3 |
8,3 |
|
France |
13,5 |
0,6 |
8,2 |
1,1 |
1,5 |
0,7 |
5,8 |
-0,2 |
29,0 |
31,2 |
2,2 |
|
Italie |
14,0 |
-0,4 |
5,9 |
1,0 |
1,7 |
1,2 |
4,3 |
-0,2 |
26,0 |
27,6 |
1,6 |
|
Chypre |
6,9 |
10,8 |
2,8 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
-0,6 |
15,5 |
26,2 |
10,7 |
|
Lettonie |
5,1 |
0,0 |
3,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
3,3 |
0,3 |
12,3 |
13,6 |
1,3 |
|
Lituanie |
6,5 |
4,9 |
4,6 |
1,0 |
0,5 |
0,6 |
3,5 |
-0,4 |
15,1 |
21,1 |
6,0 |
|
Luxembourg |
8,6 |
15,3 |
5,9 |
1,1 |
1,4 |
2,0 |
4,0 |
-0,3 |
19,9 |
38,1 |
18,2 |
|
Hongrie |
11,3 |
2,6 |
5,8 |
1,3 |
0,3 |
0,4 |
4,5 |
-0,3 |
21,8 |
25,8 |
4,0 |
|
Malte |
8,3 |
5,1 |
4,9 |
3,1 |
1,0 |
1,6 |
5,0 |
-0,7 |
19,2 |
28,4 |
9,2 |
|
Pays-Bas |
6,5 |
4,0 |
4,9 |
0,9 |
3,5 |
4,6 |
5,6 |
-0,2 |
20,5 |
29,9 |
9,4 |
|
Autriche |
12,7 |
1,0 |
6,6 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
5,2 |
-0,2 |
25,7 |
29,0 |
3,3 |
|
Pologne |
10,8 |
-2,1 |
4,1 |
0,8 |
0,4 |
0,7 |
3,8 |
-0,6 |
19,1 |
18,0 |
-1,1 |
|
Portugal |
11,9 |
1,5 |
7,3 |
1,8 |
0,1 |
0,1 |
5,6 |
-0,4 |
24,9 |
27,8 |
2,9 |
|
Roumanie |
8,4 |
7,4 |
3,6 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
-0,2 |
14,7 |
23,2 |
8,5 |
|
Slovénie |
10,1 |
8,5 |
6,8 |
1,7 |
1,2 |
1,7 |
5,1 |
0,7 |
23,1 |
35,8 |
12,7 |
|
Slovaquie |
6,6 |
3,6 |
5,2 |
2,1 |
0,2 |
0,4 |
2,9 |
-0,6 |
14,9 |
20,4 |
5,5 |
|
Finlande |
10,7 |
2,6 |
5,6 |
0,8 |
1,9 |
2,5 |
6,4 |
0,0 |
24,7 |
30,6 |
5,9 |
|
Suède |
9,6 |
-0,2 |
7,3 |
0,7 |
3,5 |
2,2 |
6,6 |
0,0 |
27,1 |
29,8 |
2,7 |
|
Royaume Uni |
6,7 |
2,5 |
7,6 |
1,8 |
0,8 |
0,5 |
4,0 |
0,0 |
19,2 |
24,0 |
4,8 |
|
UE-27 |
10,2 |
2,3 |
6,8 |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
4,9 |
-0,2 |
23,2 |
27,8 |
4,6 |
|
Zone euro-16 |
11,2 |
2,7 |
6,8 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
5,0 |
-0,2 |
24,5 |
29,6 |
5,1 |
Le tableau suivant, extrait des travaux de l'OCDE, montre que ces perspectives d'augmentation (des seules dépenses publiques ici) sont déjà assez nettes à l'échéance 2025.
PROJECTION DES AUGMENTATIONS DES DÉPENSES
PUBLIQUES LIÉES AU VIEILLISSEMENT DANS CERTAINS PAYS DE L'OCDE
Variation 2005-2025, en points de pourcentage du PIB
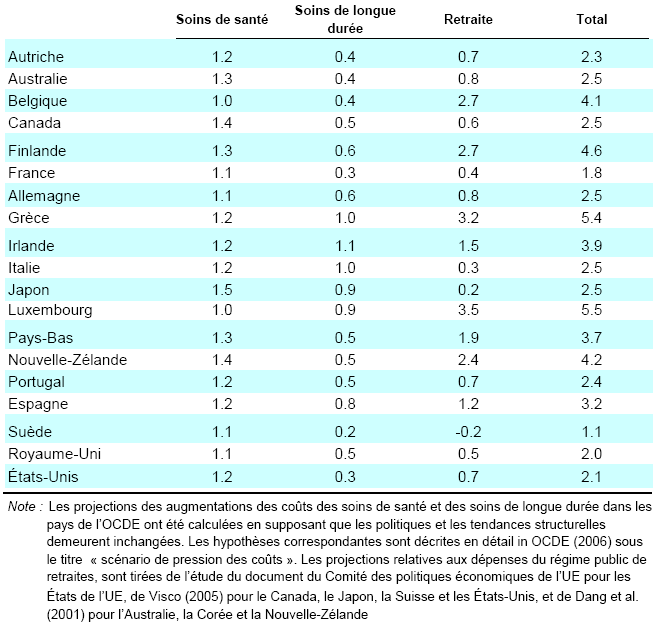
Source : OCDE
On voit que la France ne serait pas le pays le plus touché . Avec un accroissement des dépenses de 2,2 points de PIB (à l'horizon 2060) et de 1,8 point de PIB (à l'horizon 2025), la France est, par exemple, loin derrière l'Allemagne (+ 5,1 points de PIB en 2060 et + 2,5 points en 2025).
Il n'empêche « qu'à législation inchangée », les perspectives de croissance du salaire net seraient limitées par celles des dépenses nécessitées par le vieillissement de la population, même si l'ampleur du freinage n'est pas considérable. Toutefois, la France resterait dans le peloton de tête des pays où les dépenses liées à l'âge sont les plus élevées, étant donné un point de départ relativement important. En 2060, ces dépenses atteindraient 31,2 points de PIB (contre 29 points en 2010) contre 28,4 points de PIB en Allemagne (23,3 points de PIB en 2010). Une certaine convergence interviendrait entre les Etats européens mais des écarts parfois importants demeureraient.
Face à ces perspectives, il existe sans doute des marges de manoeuvre. Elles sont différenciées :
- la réduction de la dynamique des dépenses par une inflexion des besoins (diminution des rythmes de croissance des dépenses de pension, de soins...) ;
- l'augmentation de la croissance potentielle qui, comptablement, dépend du taux de croissance de la population active et des gains de productivité.
Si certaines mesures peuvent agir sur les deux termes de l'équation (l'augmentation du taux d'emploi), d'autres mesures, favorables pour l'un ne le sont pas pour l'autre. Par exemple, la réduction des dépenses de santé peut contrarier l'objectif d'élévation de la croissance potentielle si l'état de santé de la population se détériore ou/et si elle entraîne un ralentissement du progrès technique.
Par ailleurs, des marges de manoeuvre qui sont évidemment difficiles à mobiliser n'ont pas nécessairement l'efficacité qu'on est tenté de leur prêter.
S'agissant de l'élévation du taux de croissance potentielle, il n'est pas certain que, même couronnée de succès, elle puisse conduire à elle seule à une baisse des dépenses de pension 222 ( * ) , sauf, par exemple, à consentir à une baisse des taux de remplacement.
De même, les actions sur les dépenses peuvent buter sur des résistances. Ainsi, l'augmentation de l'âge de liquidation des pensions n'est une alternative crédible à l'inflexion des salaires nets qu'occasionnerait une augmentation des cotisations et/ou à la baisse du taux de remplacement qu'impliquerait une réduction du taux de liquidation qu'à la condition que le taux d'emploi de la population active augmente à due proportion.
Au-delà de ces interrogations importantes, il existe une assez forte probabilité pour que, quoi qu'il en soit, la pression des dépenses résultant du vieillissement exerce une contrainte sur la dynamique des salaires nets. Dans ces conditions, le conflit de répartition prévisible serait d'autant moins douloureusement ressenti que la croissance serait forte, ce qui implique d'accorder une priorité aux politiques la croissance.
En effet, l'alternative, que paraissent choisir certains grands Etats européens qui serait de faire porter l'effort de financement des besoins prévisibles par les espaces économiques extérieurs, comporte des risques considérables et suppose des sacrifices qui peuvent être cumulatifs. Il faut, en effet, alors, à la fois financer les besoins des générations déjà vieillies et ceux des futures générations âgées .
A cet égard, les conditions dans lesquelles les pays européens s'adaptent aux perspectives de vieillissement démographique, et celles-ci en elles-mêmes, devaient être considérées comme des questions d'intérêt commun. Par leur ampleur, elles ne sont pas loin de représenter un choc analogue à celui subi par ces économies à l'occasion de l'actuelle crise globale .
II. LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE TOUJOURS PLUS UN OBSTACLE À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?
Constater une déformation du partage de la valeur ajoutée en défaveur des salaires ne suffit pas à poser le constat d'une anomalie .
Sans doute, le freinage des dynamiques salariales qu'une telle déformation implique pose-t-il un problème en soi.
Mais ce phénomène pourrait tout aussi bien être vu comme nécessaire et souhaitable s'il devait déboucher sur un niveau plus élevé de croissance, ce qui pourrait être le cas si le partage de la valeur ajoutée devait favoriser l'investissement et, plus globalement, l'augmentation de la productivité.
Ainsi, pour juger si le partage de la valeur ajoutée est ou non optimal, il faut encore examiner s'il peut être justifié économiquement et si ses conséquences sont ou non favorables.
|
SALAIRES ET COÛT DU CAPITAL, OÙ SONT LES RIGIDITÉS ? La baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée en France (très probablement sous-estimée du fait des conventions de mesure utilisées) fait l'objet de deux interprétations théoriques radicalement contradictoires. Elle peut être vue, ou comme une confirmation, ou comme un démenti à l'idée souvent proposée d'une rigidité excessive du travail (qu'on désigne par cette idée les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise à ajuster la main d'oeuvre ou les salaires) . Empiriquement, les évolutions du taux de marge des entreprises au terme desquelles celui-ci a progressé, de façon parfois très spectaculaire, accréditent plutôt le sentiment que ce sont les rémunérations du capital qui présentent une rigidité exclusivement imputée, généralement, aux salaires . La hausse importante du taux de marge des entreprises, comme celle qui est intervenue dans les années 80, est venue de ce que les gains de productivité du travail, plutôt que d'être entièrement distribués aux salariés ou utilisés pour réaliser des gains de compétitivité-prix, ont été « captés » par les profits. Ce processus historique peut être vu comme le résultat d'une « normalisation » des salaires par le jeu des mécanismes de marché après la hausse des salaires dans la valeur ajoutée intervenue au moment du choc pétrolier de la moitié des années 70 mais cette explication « naturaliste » n'est pas pleinement convaincante comme on l'a indiqué précédemment. L'idée d'un équilibre entre productivité marginale et salaire procède d'une conception plutôt abstraite de la façon dont se forment les équilibres économiques. Au demeurant, les approches théoriques de la formation des salaires ont été profondément renouvelées pour mieux rendre compte de réalités plus complexes que celles que peut appréhender le cadre formel classique et il est rare que les équations de salaires n'intègrent pas des paramètres qui induisent des écarts par rapport au sentier idéal que ce cadre dessine. En économie ouverte et dans un contexte de chômage persistant , l'équilibre entre productivité marginale et salaire paraît imposer un plafond aux salaires mais nullement un plancher du moins pour une part grandissante du salariat. S'il est finalement assez peu éclairant d'évoquer une « normalisation » des salaires pour rendre compte du processus de baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée, l'idée connexe d'une « normalisation » de la part des profits ne l'est pas davantage. Elle suppose de se référer à un rendement économique naturel du capital alors que les tentatives théoriques de détermination d'un tel rendement ne sont que partiellement consensuelles. Tout juste peut-on avancer l'idée que le profit est justifié comme rémunération d'un renoncement à d'autres emplois du revenu et comme prime au risque pris par l'investisseur, idée sans doute féconde mais dont l'énoncé doit être précisé. Car cette idée, si elle impose une sorte de profit minimum, ne borne plus guère le profit par le haut dans un monde économique largement décloisonné et où le capital a pour lui d'être rare (et donc recherché) et mobile. Malgré tout, elle permet d'analyser, à travers l'écart entre le taux plancher et le taux observé, le degré d'influence exercé par les épargnants sur la répartition du revenu. Dans cette dernière analyse, il faut bien sûr faire une place particulière au diagnostic selon lequel une éventuelle « escalade » des taux de marge est associée à un défaut de concurrence sur le marché des biens et services au terme duquel, plutôt qu'à une hausse de la production, on assiste à la constitution de profits excessifs. Enfin, l'hypothèse d'un ajustement de la répartition du revenu selon un état d'équilibre « naturel » des marchés jure notamment avec les évolutions nettement plus contrastées des taux d'intérêt dont les inflexions n'ont pas toujours été suivies des évolutions attendues de la répartition du revenu. En particulier, ainsi qu'on l'exposera, la baisse des charges d'intérêts, qui diminue le coût microéconomique du capital, n'en a pas allégé le coût macroéconomique, les investisseurs se substituant aux créanciers, et au-delà, dans le prélèvement opéré sur les revenus issus de la production . En conclusion, plutôt donc que d'en appeler exclusivement à un cadre théorique de formation idéale des revenus des facteurs de production qui négligerait les écarts avec les conditions concrètes du partage du revenu, il paraît nécessaire également de tenir compte des réalités . Or celles-ci sont, comme d'habitude, complexes et ambivalentes. D'un côté, la concurrence ne peut être niée comme élément structurel qui joue sur les mécanismes de marché. Elle s'est accentuée entre espaces géographiques, sur un marché du travail qui s'élargit et sur le marché du capital où se déroule une course à l'attraction de l'épargne 223 ( * ) . D'un autre côté, les firmes s'efforcent d'échapper aux rigueurs de la concurrence et ceci ouvre la piste d' un défaut de concurrence comme explication plausible du partage de la valeur ajoutée. Dans ce sens, la restructuration des entreprises aurait entraîné une tendance à la constitution, sinon toujours de monopoles du moins d'oligopoles, qui aurait favorisé l'attribution d'une part plus importante de revenus de la production aux profits, du moins aux profits de certaines entreprises. A cet égard, la dissociation entre les grandes entreprises multinationalisées et les autres entreprises est une observation fondamentale. Mais, l'augmentation du taux de marge des entreprises, qui accompagne une déformation de la valeur ajoutée aux dépens des salariés, n'équivaut pas nécessairement à une modification des conditions du partage de la valeur ajoutée au profit du capital. Pour que ce dernier processus soit vérifié, il faudrait que le surcroît de valeur ajoutée attribué au capital ne soit pas seulement le reflet d'une augmentation de la quantité de capital mobilisé pour la production. Si le taux de marge augmente parallèlement aux investissements totaux, la déformation du partage de la valeur ajoutée n'est pas attribuable à une croissance de la rémunération unitaire du capital et ne traduit que l'intensification capitalistique, c'est-à-dire l'augmentation du stock de capital dans l'économie nationale. Il y a alors déformation du partage de la valeur ajoutée mais sans déformation des conditions de ce partage. A supposer que tel soit le cas 224 ( * ) , cela n'établirait pas pour autant que la part des richesses créées allant au capital soit justifiée : - l'intensification capitalistique n'est pas nécessairement un processus obéissant à un plan rationnel 225 ( * ) ; - mais surtout, la stabilité de la rémunération unitaire du capital n'équivaut pas à sa normalité, s'il en ressort que le rendement du capital est supérieur (ou inférieur) à un niveau d'équilibre garantissant une perspective de croissance économique soutenue et durable. |
Or, dans un scénario noir, la répartition de la valeur ajoutée nuirait à plus d'un titre à la croissance :
- la demande pâtirait de la contraction des dynamiques salariales ce qui pèserait sur la production et les perspectives d'investissement ;
- l'épargne relativement abondante du fait de la hausse du taux de marge des entreprises et de l'essor d'une épargne de précaution des ménages s'investirait de moins en moins dans l'appareil productif national au profit d'actifs patrimoniaux qui connaîtraient des bulles déstabilisantes ou d'investissements dans le zones émergentes de forte croissance ;
- le revenu national ne progresserait que de façon très ralentie quand, dans le même temps, les besoins sociaux augmenteraient sous l'effet du vieillissement et des restructurations d'un système de production s'ajustant aux nouvelles spécialisations internationales ;
- l'Etat courrait après l'équilibre budgétaire et sacrifierait les investissements indispensables à la maximisation de la croissance potentielle.
A. MICROÉCONOMIE ET MACROÉCONOMIE, DEUX APPROCHES THÉORIQUES DIFFÉRENTES POUR UNE MÊME CONCLUSION : LE PROFIT OPTIMUM N'EST LE PROFIT MAXIMUM QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS
Il a pu exister une tendance, probablement assez forte encore si l'on en juge par les objectifs assignés par les marchés financiers aux entreprises et par les engagements pris par leurs dirigeants lors de leurs tournées de communication, à considérer comme un objectif primordial de maximaliser les profits.
Or, les économistes qu'ils soient microéconomistes, plutôt classiques, ou macroéconomistes, plutôt keynésiens, n'ont jamais validé cette approche du profit que sous la réserve que d'autres conditions soient réunies.
|
LE PROFIT : REGARDS MICROÉCONOMIQUES ET MACROÉCONOMIQUES Deux approches complémentaires de la question du profit coexistent. L'une, microéconomique , s'interroge sur le rôle incitatif du taux de profit sur l'investissement des producteurs. L'autre, plutôt macroéconomique , complète cette approche par une analyse des incidences de la rémunération du capital sur la répartition du revenu, sur la demande des agents et sur la croissance . Le taux de profit (mesuré par le rapport de l'excédent brut d'exploitation des entreprises à leur valeur ajoutée) représente le gain que le capital investi dans une économie donnée - et non le capital investi à partir d'une économie donnée 226 ( * ) - peut espérer. Il en est donc la rémunération. En tant que tel, il joue a priori tous les rôles que jouent les prix dans un système économique : source de revenus, guide de l'allocation des ressources, révélateur des préférences... Comme pour tout prix, la question est de savoir si le taux de profit obéit à des déterminations telles qu'il existerait un prix idéal, c'est-à-dire un prix tel que les agents économiques adopteraient des comportements économiques souhaitables. Question évidemment difficile, et approche autrement plus complexe, que celle qui consiste simplement à constater les faits empiriques et à en déduire un principe de normalité. Autrement dit, il s'agit ici de ne pas se contenter de l'observation que le rendement du capital atteint un niveau donné pour conclure que c'est vers ce niveau qu'il faut tendre 227 ( * ) . Les analyses microéconomiques - c'est-à-dire celles qui se placent du point de vue des agents individuellement - insistent sur le rôle du taux de profit dans la décision d'investissement de chaque détenteur de capital. Elles tendent, en général, à conclure à un lien positif entre rémunération du capital et investissement et incitent à déduire que le taux de profit est positivement corrélé avec la croissance économique. Toutefois, cette dernière conclusion pose un problème en ce sens qu'elle suppose que les analyses microéconomiques peuvent servir de fondements utiles à la macroéconomie. Or, il existe un hiatus entre la rationalité individuelle et la rationalité collective. Les interactions entre les différents acteurs d'un ensemble économique peuvent modifier le point de vue auquel la considération de l'action d'un agent isolé peut conduire. Sans doute, les microéconomistes s'attachent-ils à corriger les limites d'une analyse centrée sur les agents économiques individuellement en envisageant les conséquences de l'agrégation de comportements individuels. Mais c'est, généralement, en considérant les comportements des seuls agents relevant de la même catégorie que cette correction intervient : pour ce qui occupe ici, on prendra en compte les effets sur un investisseur des comportements des autres investisseurs mais beaucoup moins ceux des salariés par exemple alors que ceux-ci influencent évidemment les investisseurs. C'est pourquoi le raisonnement macroéconomique doit être pris en considération . Ceci ne signifie évidemment pas qu'il faille en exclure tout « ingrédient » microéconomique, au contraire. Mais, comme en l'état de la connaissance économique cette dissociation des approches n'a pas été entièrement surmontée, il est à recommander de varier les points de vue. La microéconomie a pour elle de restituer le jeu des forces mais il lui manque la cohérence que seule apporte une approche macroéconomique. |
Une sorte de conciliation intervient entre les deux analyses autour d'une conclusion commune et fondamentale : le profit optimum n'est pas le profit maximum 228 ( * ) ou, plus précisément, il n'est le profit maximum que sous réserve que d'autres conditions de l'équilibre économique (équilibre du marché du travail et de biens dans un contexte de concurrence pure et parfaite pour la microéconomie classique ; équilibre de la demande pour le keynésianisme) soient respectées .
Que ce soit microéconomiquement ou macroéconomiquement, il existe un niveau de profit justifié : le dépasser c'est s'exposer à des pertes de bien-être (pour le microéconomiste) ou à des pertes de croissance (pour le macroéconomiste), en tout cas, à des pertes.
A cet égard, la macroéconomie keynésienne procède essentiellement à un enrichissement de la microéconomie classique qu'elle ne remet que marginalement en cause, faisant essentiellement valoir que la répartition du revenu et son utilisation ne sont pas nécessairement conformes à un équilibre économique garantissant le plein emploi des facteurs de production.
Dans le monde contemporain, ces deux approches ressortent comme plus complémentaires que concurrentes si l'on veut bien considérer que la constitution d'oligopoles - voire de monopoles - et le renforcement des positions dominantes sont une tendance structurelle qui déséquilibre les marchés (école classique) et les conditions d'égalisation de l'offre et de la demande (école keynésienne) .
Sans doute, l'une et l'autre approche aboutissent à des recommandations de politique économique qui, en partie, leur sont propres : pour la microéconomie, l'instauration de conditions de concurrence plus tangibles ; pour la macroéconomie, la réorientation du partage de la valeur ajoutée si nécessaire.
Mais, il existe également des recoupements notamment dans l'analyse des conséquences d'une répartition de la valeur ajoutée éloignée de conditions équilibrées : le danger est que les surprofits viennent rompre la dynamique de la croissance économique par un désajustement, conjoncturel ou structurel, entre offre et demande qui peut miner les perspectives de croissance à long terme.
En bref, pour les uns (les classiques) il s'agit de restaurer des conditions de concurrence plus tangibles. Cela passe par la lutte contre les monopoles sur le marché des biens mais aussi par davantage de flexibilité. Celle-ci peut concerner le capital dont l'allocation doit être libérée de sorte qu'il puisse être apporté aux activités les plus efficaces économiquement. La flexibilité concerne aussi le marché du travail où productivité et salaires doivent mieux s'apparier. Il vaut de souligner que toutes ces mesures doivent être entreprises ensemble sans quoi l'équilibre économique ne serait pas atteint. Par exemple, la flexibilité d'un salaire déréglementé ne servirait pas la croissance économique si elle n'était accompagnée d'un démantèlement des possibilités offertes à un employeur d'en abuser.
En bref, les conditions de validité de l'équilibre économique classique qui consacrent l'efficacité théorique des mécanismes de marché sont exigeantes notamment parce qu'elles sont holistes (c'est-à-dire qu'elles doivent être toutes réunies).
Les approches moins orthodoxes conduisent à s'inquiéter du réalisme d'une fiction classique au formalisme qui, au demeurant, pour être presque impeccable ne l'est point complètement. Fondamentalement, l'imperfection de ce modèle réside dans les effets de la distribution du revenu et de la concurrence entre firmes et salariés sur les conditions mêmes de validité d'un modèle théorique appelé à s'altérer nécessairement. Autrement dit, la vision classique de l'économie repose sur une condition, la concurrence, qui ne saurait résister au fonctionnement concret du modèle. Cette critique débouche sur la recommandation de privilégier un réalisme des analyses et des pratiques qui, sans oublier l'horizon idéal dessiné par les auteurs classiques, ne négligent pas les inconvénients d'ignorer les écarts entre idéal et réalité.
Les agents économiques ne sont pas atomisés et certains ont plus de pouvoir que d'autres. La distribution du revenu, inégalitaire parce que l'efficacité est inégale et parce que des processus de domination existent, pose un problème constant d'équilibre. La demande peut être insuffisante pour placer l'offre au niveau justifié qui permettrait le plein emploi. Ainsi, la répartition du revenu, qu'elle obéisse à la nature des choses ou qu'elle soit biaisée par des asymétries de position, peut perturber la dynamique de la croissance économique (et ainsi de suite, dans un cercle négatif).
Dans cette perspective, la répartition du revenu est un enjeu de politique économique . Celle-ci peut certes s'attacher à restaurer les conditions de concurrence - encore que l'innovation, source du progrès économique, suppose, dans une vision à la Schumpeter, quelques entorses à ce modèle -, mais elle doit surtout se préoccuper de promouvoir un objectif d'emploi des revenus au service de la croissance économique.
Or, cette question implique de trouver le meilleur couple entre demande et investissement et cette bonne union suppose d'identifier un niveau de profit et des utilisations de l'épargne qui la permettent :
- le profit ne doit pas réduire à l'excès les bases de la demande et les incitations au travail ;
- le profit doit être suffisant pour inciter à l'investissement et ses usages ne doivent pas perturber l'équilibre de la demande (par exemple, en créant des bulles de prix d'actifs) tout en respectant un programme d'essor économique (par l'investissement, qu'il soit matériel ou immatériel).
Il existe donc une répartition équilibrée du revenu (au service d'un équilibre économique de croissance) dont les mécanismes de marché n'assurent pas nécessairement la réalisation .
Les modalités de répartition du revenu national qu'il importe d'observer sont :
- la répartition entre les salaires et les profits ;
- la répartition des revenus primaires (salaires et profits) au sein de la population ;
- la répartition des revenus entre les classes d'âge (du fait notamment des effets du cycle de vie sur l'affectation des revenus entre consommation et épargne).
*
* *
En bref, il existe des répartitions du revenu national plus ou moins favorables à la croissance économique, et si le rendement du capital doit être suffisant pour que les incitations à investir soient préservées, il ne doit pas être excessif. Tel serait le cas s'il traduisait l'existence de surprofits ou si la demande devait en être affectée au point que l'investissement productif serait découragé, en même temps qu'apparaîtraient des surcapacités de production.
Il va de soi que ce souci d'équilibre est perturbé par l'existence d'une globalisation renforcée.
B. ACTUALITÉ ET PROSPECTIVE : QUELS PEUVENT ÊTRE AUJOURD'HUI LES PROLONGEMENTS PRATIQUES DE CE CONSENSUS DANS UNE ÈRE DE GLOBALISATION ?
Si, sur le plan théorique, un consensus existe sur l'idée que le profit optimal n'est pas le plus élevé (tout juste peut-il être le plus élevé qui se puisse), les prolongements pratiques de ce consensus 229 ( * ) ne sont pas évidents, en dépit du point de référence que représente le taux de croissance d'une économie, dans un contexte où les possibilités d'arbitrages financiers sont fortes, incitant les dirigeants d'entreprise à donner la priorité à l'affichage d'un profil financier favorable .
Ce problème a toujours existé mais il est plus aigu - voire change de nature - dans les économies ouvertes sur l'extérieur que sont les économies contemporaines .
En outre, ce qui est vrai au niveau microéconomique du choix des détenteurs de capital peut aussi être vrai au niveau macroéconomique. Certaines nations peuvent faire des choix de modèles de croissance tirée par l'extérieur ou reposant sur la constitution d'un patrimoine étranger. Or, ces choix s'imposent à leurs partenaires, notamment dans des espaces économiques aussi intégrés que l'Europe.
1. Le capital, un facteur de production dont la mobilité favorise un niveau de rémunération relativement élevé
|
UN PROBLÈME STRUCTUREL L'activité économique et le taux de croissance d'une économie s'accompagnent d'une grande diversité des performances microéconomiques des agents sans compter le fait que certaines productions sont plus exigeantes en capital que d'autres. Il est a priori justifié que la part du profit dans la valeur ajoutée de chaque entreprise varie microéconomiquement. Cette variété des taux de profit pose un problème de cohérence, mais qui apparait transitoire dans une économie fermée. Théoriquement, ce problème y est réglé par l'égalisation de la rentabilité du capital. Celui-ci s'investit dans les activités les plus prometteuses. Dans ce processus, les productions les moins efficaces sont éliminées faute de capitaux pour s'y investir. Par ailleurs, survient une égalisation des rendements offerts par les entreprises subsistantes puisque le capital des plus efficaces voit sa valeur augmentée du fait de la demande qui se porte sur lui jusqu'au niveau qui permet aux entreprises moins efficaces, mais subsistantes, de trouver du financement. Dans une économie fermée, ces enchaînements ne sont pas sans poser des problèmes d'adaptation successive, mais ces problèmes sont considérablement amplifiés dans un monde ouvert mettant en relation des espaces économiques de niveaux de développement différents et connaissant des modalités de répartition de la valeur ajoutée hétéroclites ainsi que des rythmes de croissance inégaux. |
Dans une économie ouverte, les choix d'allocation de ce facteur rare qu'est le capital sont considérablement élargis. Le capital y devient presque complètement mobile ce qui représente, en soi, un aout, notamment dans les « négociations » qui président aux processus d'attribution du revenu. Par ailleurs, il faut ajouter les effets de la diversité des économies.
Sans doute, est-il vrai que, dans un monde globalisé, l'égalisation des taux de rendement ne se produit pas nécessairement 230 ( * ) . Mais, il est toujours possible, tant que la convergence des économies n'est pas réalisée, d'arbitrer l'allocation du capital vers des zones où son rendement et ses perspectives sont supérieurs. Il en résulte, théoriquement, une pression constante à rapprocher les rendements du capital où il est comparativement faible du niveau élevé des zones où les structures économiques tendent à ce niveau élevé .
2. Quelles voies d'adaptation aux exigences des détenteurs du capital ?
Dans ce contexte, il est primordial de s'interroger sur les réponses données par les agents économiques aux tensions qu'exerce la mobilité du capital .
Les effets de la mondialisation sur les conditions de formation des revenus du capital ont pu être discutés notamment parce que les évolutions du partage de la valeur ajoutée et celles des indices de mondialisation n'ont pas été toujours parallèles.
Mais, une certaine corrélation existe malgré tout entre ces phénomènes et, surtout, la globalisation financière n'a pas attendu la mondialisation pour produire des changements structurels du type de ceux engendrés par la mondialisation et qu'il paraît difficile de considérer comme n'étant pas encore amplifiés par elle.
Par exemple, le marché unique européen n'est pas strictement un élément de la mondialisation (c'est un phénomène de régionalisation économique) mais ses effets sont proches de ceux que la mondialisation produit, même si celle-ci en accroît l'intensité.
La réallocation mondiale du capital peut être l' une de ces réponses , avec une affectation du capital dans les zones de rentabilité comparativement élevée.
Sans doute, pourrait-on être rassuré par les observations empiriques, et les réflexions des théoriciens de l'économie industrielle. Elles conduisent à penser qu'une partie des investissements financiers est complémentaire des investissements physiques, de sorte que les prises de participation dans un but de croissance externe répondant à la même logique que l'investissement physique (à savoir assurer le développement de l'entreprise), il y aurait, plutôt que concurrence entre ces investissements, une complémentarité. De fait, lorsqu'on exclut du montant des investissements financiers les placements en valeurs mobilières correspondant à une logique de court terme, on observe une corrélation positive entre investissements financiers et investissements physiques. Autrement dit, les entreprises qui investissent le plus en prises de participations externes sont aussi celles qui dépensent le plus pour leurs investissements physiques .
Mais, il n'est pas sûr que ces observations aient résisté à la globalisation croissante , qu'elle s'exerce dans un cadre régional ou dans un cadre mondial.
Sur le plan mondial, par exemple, d'un côté, on remarque que les flux d'épargne mondiaux voient les pays émergents financer les pays développés ce qui correspond a priori à une inversion des flux de capitaux par rapport à ce que le processus de rattrapage laisse présager. Mais, d'un autre côté, une analyse plus fine des capitaux en cause montre que les flux sortants des pays émergents financent les dettes souveraines des pays développés dont les flux sortants vers les pays émergents financent davantage les entreprises qui font concurrence aux établissements localisés dans les pays d'origine.
En bref, les opérations patrimoniales nourries par les financements des entreprises du Nord (qu'ils viennent de leur épargne ou des dettes qu'elles contractent) contribuent à une recomposition de la localisation de la valeur ajoutée à l'échelle mondiale au terme de laquelle le produit de la valeur ajoutée territorialisée dans les pays du Nord est de plus en plus consacré au financement du développement de valeurs ajoutées à l'extérieur .
D'autres processus peuvent intervenir qui passent par l'élévation de la rentabilité du capital dans les zones concurrencées .
Celle-ci peut emprunter des voies financières comme l'exploitation de l'effet de levier (fondé sur l'écart entre les charges d'endettement externe - les taux d'intérêt - et la rentabilité du capital investi) ou des voies plus « réelles ». Il s'agit alors d'attribuer davantage de valeur ajoutée au capital, ce qui passe par une réduction de la part des salaires, autrement dit par une augmentation du rendement économique du capital.
Le contexte de mobilité des capitaux à l'intérieur ou à l'extérieur accentue les probabilités de déséquilibres d'autant qu'il se combine avec une autonomisation - du moins une autonomisation imaginée 231 ( * ) - de la sphère financière.
A cet égard, la quasi-totalité des chefs d'entreprise auditionnés par vos rapporteurs se sont inscrits dans le courant actuel des réflexions théoriques sur le capitalisme qui s'interroge sur sa cohérence.
En théorie, le profit est justifié par les risques pris par le capital et permet aux capitalistes d'en prendre de nouveaux en investissant.
On connaît la phrase du chancelier allemand Helmut Schmidt justifiant le profit en faisant valoir que : « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui sont les emplois d'après-demain » .
Au demeurant, cet enchaînement n'est pas une simple promesse visant à justifier les profits pour le potentiel d'épargne qu'ils contiennent (du reste, l'épargne peut aussi bien être prélevée sur les salaires), c'est une condition nécessaire à la justification des profits dans une économie où existe un objectif de croissance 232 ( * ) .
Quoi qu'il en soit, pour les personnalités auditionnées par vos rapporteurs, y compris pour les chefs d'entreprise, l'horizon temporel semble s'être tellement rétréci que les profits d'aujourd'hui ne riment plus qu'avec eux-mêmes, les investissements étant désormais considérés comme des ennemis d'un profit de court terme qui, dans le capitalisme financier, seul compterait.
Cette suggestion aboutit à considérer un problème de cohérence du capitalisme qui, pour être microéconomique au départ, concerne au-delà les équilibres macroéconomiques dans leur ensemble .
3. Le problème au niveau macroéconomique
Schématiquement, le problème macroéconomique posé par la répartition est le suivant. Pour que la répartition du revenu soit cohérente avec un objectif d'équilibre économique et de croissance forte, il faut, d'une part, que la production crée sa propre demande et, d'autre part, que l'investissement soit suffisant pour élever le potentiel de croissance.
La condition que la production crée sa demande n'est pas nécessairement respectée dans un contexte où il est possible de thésauriser ou d'affecter ses revenus à consommer des biens étrangers ou à une épargne destinée au désendettement ou à l'achat d'actifs étrangers.
Or, il faut envisager que la concentration des salaires sur les plus hauts revenus et la déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salaires puissent favoriser ces fuites hors du circuit économique national.
Par ailleurs, le gonflement de l'épargne auquel aboutit un mode de répartition de la valeur ajoutée devenant de plus en plus inégalitaire peut entraîner une attrition de la consommation sans pour autant être suivie d'une utilisation de l'épargne correspondante pour investir dans l'économie dont cette épargne est issue.
La question de l'optimalité de la répartition du revenu est entièrement reposée dans un contexte de globalisation économique .
Certains pays peuvent faire le choix d'un modèle de croissance tirée par l'extérieur. Puisqu'ils comptent sur la demande étrangère, ils peuvent être indifférents aux ressorts de la demande domestique. Plus encore, ils peuvent estimer avoir intérêt à ce que ces ressorts soient les moins tendus qu'il se peut. Ils gagnent en compétitivité-prix à une décrue des coûts salariaux et ils comptent sur le fait que le prix à payer en termes de croissance économique de la faiblesse de la demande domestique peut être compensé par la dynamique d'une demande étrangère d'autant plus forte qu'ils escomptent des gains de parts de marché.
Il existe, avec l'Allemagne, au coeur de l'Europe, un pays qui a fait ce choix. La soutenabilité de ce modèle de croissance sans salaires internes dépend de la dynamique des demandes adressées à ce pays par ses partenaires. Mais, des déséquilibres commerciaux sont la résultante de cette stratégie. Sa pérennité dépend de la soutenabilité de ces déséquilibres mais aussi de l'hypothèse d'un maintien de l'écart de salaires entre l'Allemagne et le reste du monde (et, tout particulièrement, de ses partenaires européens).
Par ailleurs, la stratégie allemande occasionne un creusement nécessaire des inégalités internes. En effet, les salaires sont comprimés et le taux de profit augmente. L'Allemagne est le pays d'Europe où ces dernières années le partage de la valeur ajoutée s'est le plus déformé aux dépens des salaires. Dans un tel modèle, la question de l'utilisation des profits est décisive. On ne voit pas les raisons pour lesquelles ces profits pourraient s'investir localement dans le système productif. Il est sans doute plus rentable de les investir à l'étranger, à la source même de la croissance économique. Cependant, les mécanismes de marché et les inégalités qu'ils engendrent entre ménages peuvent aussi s'accompagner d'investissements locaux, mais dans des actifs patrimoniaux. Sauf si des surcapacités existent, il est alors à prévoir que des bulles d'actifs traditionnelles (sur l'immobilier, en particulier), surviennent tôt ou tard 233 ( * ) . L'Etat peut lui aussi tirer bénéfice de l'augmentation des profits à travers des recettes fiscales élevées. C'est une des raisons pour lesquelles, malgré des comportements de concurrence fiscale passant notamment par une baisse du taux d'imposition des sociétés, l'Allemagne a pu résorber son déficit public. Cette dernière performance financière permet à l'Allemagne de supporter de bas taux d'intérêt sur sa dette publique.
Une question ultime est cependant de savoir à quoi sert à un pays qui se désendette de disposer de bas taux d'intérêt et, au-delà, à quoi sert de disposer d'excédents budgétaires.
Une réponse vient : une telle stratégie n'est justifiable que par une volonté de constituer un patrimoine. Pour l'Etat allemand, cela peut aller dans le sens d'une sorte de fonds souverain. Cet objectif est d'ailleurs assez cohérent avec la perspective d'un vieillissement important du pays et d'une baisse drastique de sa croissance potentielle en lien avec le déclin de sa population.
Quoi qu'il en soit, le modèle allemand pose un problème majeur à ses partenaires, dont notre pays. Calquer la stratégie allemande, ce qui serait très préjudiciable à notre voisin d'outre-Rhin, reviendrait à accepter de renoncer à des perspectives justifiées de croissance interne, ce qui entraînerait une forte augmentation du chômage. Continuer à s'en démarquer serait sans doute favorable à l'Allemagne mais entraînerait des déséquilibres commerciaux et financiers intenables sauf à ce que les excédents de ce pays soient recyclés pour financer la croissance de ses partenaires.
Une chose est sûre : la stratégie conduite par notre premier partenaire commercial, du point de vue économique mais aussi pour tout ce qui concerne son propre pacte social, est, pour la France notamment, une variable tout à fait décisive pour le futur de son pacte social. La prolongation des tendances actuelles conduirait à des troubles sans précédents.
*
* *
En bref, le contexte de globalisation financière affaiblit considérablement la portée des approches traditionnelles du profit, dans le sens d'un renforcement de la position des détenteurs du capital , mieux à même de maximaliser son rendement.
En même temps, elle amplifie les problèmes d'équilibre économique en augmentant la probabilité d'occurrence de désajustements entre la valeur créée par un espace économique et la répartition de sa contrepartie dans cet espace .
A cet égard, on devrait mieux tenir compte de ce que le niveau élevé des rendements du capital dans les économies émergentes s'accompagnent d'un taux d'investissement également élevé qui ne paraît pas exclusif de la constitution d'actifs sur le reste du Monde.
A l'inverse, dans certains pays avancés, le rendement du capital ne semble pas s'accompagner d'une dynamique satisfaisante de l'investissement productif mais plutôt d'investissements directs à l'étranger dans le « meilleur » des cas ou, dans le pire, de bulles d'actifs .
C. DANS LES FAITS, LA RESTAURATION DU TAUX DE MARGE DES ENTREPRISES NE S'EST PAS ACCOMPAGNÉE D'UNE RELANCE DE L'INVESTISSEMENT
La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée s'est accompagnée d'une hausse du taux de marge des entreprises. Elle peut être analysée comme une restauration de la rentabilité économique du capital et comme une source potentielle de financement d'un surcroît d'investissement.
Par ailleurs, les conditions monétaires se sont significativement détendues avec la baisse des taux d'intérêt qui a permis un redressement de la profitabilité du capital.
Ces événements auraient dû déboucher sur une élévation du rythme de l'investissement qui aurait pu contribuer à hausser le rythme de la croissance effective mais aussi de la croissance potentielle.
Mais, les données empiriques ne permettent pas de vérifier cet enchainement.
La déformation du partage de la valeur ajoutée n'a pas débouché sur une relance de l'investissement des entreprises non financières, malgré des conditions financières et monétaires devenues particulièrement favorables .
De plus, elle n'a permis d'alléger l'endettement des entreprises que transitoirement, celles-ci ayant largement recouru à l'effet de levier d'endettement, et la baisse des charges d'intérêt a été plus que compensée par la hausse des dividendes versés aux propriétaires du capital .
|
L'UTILISATION DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION
(EBE)
En comptabilité nationale, la différence entre la valeur ajoutée et les salaires est appelée excédent brut d'exploitation. Comme la part de la valeur ajoutée n'allant pas à la rémunération des salariés et donc au travail doit bien être rattachée à l'autre facteur de production, le capital, on considère que l'EBE rémunère celui-ci, autrement dit, qu'il est le profit qui va aux détenteurs du capital. La réalité est plus complexe.
Ainsi, outre les profits de l'exploitation courante, l'EBE, les revenus du capital, comportent des revenus ou des charges qui ne peuvent pas toujours être rattachés directement à cette exploitation, soit qu'ils correspondent à des actifs ou passifs longs, soit qu'ils soient pluriannuels.
En réalité, l'expression doit être comprise non dans le sens que l'EBE serait versé aux capitalistes mais dans celui que l'EBE accroît la valeur de leurs actifs et donc de leur patrimoine . Encore faudrait-il réserver : - la partie de l'EBE qui correspond à la dépréciation des actifs de sorte que seul l'excédent net d'exploitation (ENE) soit considéré car seul il accroît la valeur du patrimoine des détenteurs du capital (à qui cependant incombent les charges de compenser la dépréciation de leurs actifs) ; - certaines opérations prises en compte au niveau de l'utilisation de l'EBE (les régimes d'employeurs, les assurances-dommages) dont le lien avec la valeur du capital n'est pas évident ; - l'impôt sur les sociétés en ce sens, que, sauf à considérer qu'il ne finance que des « retours » vers les entreprises, il réduit la rémunération du capital. |
Etant précisé que, par convention , l'EBE ne comporte pas les profits qui sont redistribués aux salariés 234 ( * ) , il se répartit entre cinq grand usages :
- le paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) ;
- le versement d'intérêts, net des intérêts reçus ;
- la distribution de revenus aux propriétaires du capital, nette des mêmes revenus reçus ;
- diverses autres opérations (prestations sociales versées au titre des régimes d'employeurs, nettes des cotisations reçues, primes d'assurance-dommage, nettes des indemnités reçues, autres transferts courants divers) regroupées en une seule catégorie ;
- l'épargne, solde de ces opérations, reste disponible pour l'autofinancement des investissements ou la réalisation d'opérations financières de bilan.
COMPOSANTES DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION, EN % DE L'EBE
|
1950 |
1955 |
1959 |
1967 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1981 |
1987 |
1988 |
|
|
Revenus distribués aux propriétaires du capital |
16,3 |
21,5 |
16,0 |
14,4 |
12,6 |
11,0 |
12,0 |
13,2 |
10,8 |
13,9 |
14,2 |
11,9 |
|
Intérêts nets versés |
6,1 |
5,1 |
8,8 |
11,2 |
16,8 |
18,1 |
22,7 |
23,2 |
23,1 |
30,3 |
16,4 |
16,0 |
|
Impôt sur les sociétés |
11,5 |
13,5 |
16,3 |
11,1 |
10,8 |
11,3 |
14,2 |
10,3 |
13,9 |
13,5 |
10,9 |
11,2 |
|
Autres opérations |
9,2 |
9,9 |
9,4 |
9,4 |
10,8 |
10,7 |
11,4 |
12,2 |
12,3 |
12,8 |
8,1 |
7,3 |
|
Épargne |
57,0 |
50,0 |
49,5 |
53,9 |
49,1 |
48,8 |
39,6 |
41,1 |
39,9 |
29,6 |
50,4 |
53,6 |
|
1989 |
1994 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Revenus distribués aux propriétaires du capital |
13,8 |
16,1 |
18,0 |
19,1 |
17,5 |
21,0 |
22,0 |
22,9 |
25,5 |
25,1 |
25,6 |
|
Intérêts nets versés |
16,7 |
20,2 |
18,1 |
7,1 |
6,8 |
6,1 |
8,4 |
10,0 |
8,3 |
8,3 |
9,8 |
|
Impôt sur les sociétés |
11,6 |
7,9 |
9,5 |
12,9 |
14,3 |
12,0 |
10,3 |
10,8 |
12,1 |
14,7 |
14,5 |
|
Autres opérations |
7,2 |
5,3 |
8,1 |
7,9 |
8,3 |
11,4 |
8,1 |
8,5 |
9,4 |
9,1 |
9,5 |
|
Épargne |
50,8 |
50,5 |
46,4 |
53,0 |
53,0 |
49,5 |
51,3 |
47,8 |
44,7 |
42,9 |
40,6 |
Source : Insee, Comptabilité nationale en base 2000
COMPOSANTES DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION, EN % DE LA VA
|
1950 |
1955 |
1959 |
1967 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1981 |
1987 |
1988 |
|
|
Revenus distribués aux propriétaires du capital |
5,2 |
6,1 |
4,6 |
4,1 |
3,7 |
3,3 |
3,5 |
3,4 |
2,8 |
3,3 |
4,4 |
3,9 |
|
Intérêts nets versés |
1,9 |
1,5 |
2,6 |
3,2 |
5,0 |
5,4 |
6,6 |
6,0 |
5,9 |
7,3 |
5,1 |
5,2 |
|
Impôt sur les sociétés |
3,7 |
3,8 |
4,7 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
4,1 |
2,7 |
3,6 |
3,2 |
3,4 |
3,7 |
|
Autres opérations |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
2,5 |
2,4 |
|
Épargne |
18,2 |
14,2 |
14,4 |
15,2 |
14,5 |
14,6 |
11,6 |
10,7 |
10,3 |
7,1 |
15,7 |
17,6 |
|
1989 |
1994 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2006 |
|
|
Revenus distribués aux propriétaires du capital |
4,6 |
5,0 |
5,7 |
6,0 |
5,5 |
6,4 |
6,8 |
7,1 |
7,8 |
7,8 |
8,0 |
|
Intérêts nets versés |
5,5 |
6,2 |
5,7 |
2,2 |
2,1 |
1,9 |
2,6 |
3,1 |
2,5 |
2,6 |
3,1 |
|
Impôt sur les sociétés |
3,8 |
2,4 |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
3,7 |
3,2 |
3,3 |
3,7 |
4,6 |
4,5 |
|
Autres opérations |
2,4 |
1,6 |
2,6 |
2,5 |
2,6 |
3,5 |
2,5 |
2,6 |
2,9 |
2,8 |
3,0 |
|
Épargne |
16,7 |
15,6 |
14,6 |
16,5 |
16,6 |
15,2 |
15,9 |
14,7 |
13,8 |
13,3 |
12,7 |
Source : Insee, Comptabilité nationale en base 2000
1. Un impôt sur les sociétés qui prélève entre 11 et 14 % des profits (entre 2,4 et 4,6 points de valeur ajoutée)
L'analyse du prélèvement fiscal sur les profits opéré par l'impôt sur les sociétés (IS) à partir des données de la comptabilité nationale (parts de l'IS dans l'excédent brut d'exploitation et dans la valeur ajoutée respectivement) est délicate notamment parce que les règles de détermination de l'assiette fiscale créent des écarts entre la base imposable et l'assiette théorique fournie par la comptabilité nationale 235 ( * ) .
Par ailleurs, il faudrait pouvoir reconstituer l'historique des taux effectifs d'imposition des sociétés pour disposer d'informations pleinement utilisables pour analyser le prélèvement fiscal et séparer dans sa dynamique ce qui relève d'un côté de la politique fiscale, de l'autre, des évolutions économiques.
Enfin, l'analyse des effets de l'imposition des sociétés suppose de disposer d'une analyse solide de son incidence. Sur qui le prélèvement pèse-t-il in fine ? Par quels mécanismes ? Avec quels effets sur la répartition de la valeur ajoutée et sur la croissance économique ? De ce dernier point de vue malgré des avancées louables dans la formalisation des mécanismes en jeu (v. notamment l'intéressant article de L. Simula et A. Trannoy « Incidence de l'impôt sur les sociétés » dans Revue française d'économie n° 3, vol. XXIV), on en reste trop souvent à des constructions formelles aux résultats dépendant de trop nombreuses hypothèses simplificatrices.
Par exemple, s'il est exact que l'impôt sur les sociétés en augmentant le coût d'usage du capital réduit sa rentabilité nette, il n'est pas certain que cet effet s'accompagne macroéconomiquement d'un découragement de l'accumulation du capital (pour le vérifier, il faudrait, en particulier, mesurer l'importance d'éventuels surprofits et apprécier l'utilisation faite des ressources fiscales liées à l'IS) non plus que d'un ajustement à la baisse des salaires. Au demeurant, celui-ci s'est produit dans un contexte marqué par la baisse du taux effectif d'imposition des sociétés qui, symétriquement, aurait dû, selon les analyses réalisées avec l'aide des modèles de simulation classiques, avoir les effets inverses.
L'analyse de l'impôt sur les sociétés est encore compliqué par le fait qu'il porte sur un facteur a priori mobile (et dont la mobilité potentielle s'est accrue dans le contexte de régionalisation puis de mondialisation), et donc, théoriquement très sensible aux phénomènes de concurrence fiscale, qui se sont renforcés 236 ( * ) .
Mais, sous cet angle aussi, la réalité peut être plus complexe que les analyses théoriques qui, quant à elles, procèdent par supposition d'un « toutes choses égales par ailleurs ». Le capital est certes mobile mais les désinvestissements ont aussi un coût qui peuvent retarder les effets de la concurrence fiscale en les concentrant sur les flux d'épargne (et en épargnant relativement le stock déjà investi). En outre, la concurrence fiscale n'est pas le seul déterminant des investissements et a des effets différents selon le type d'investissement concerné. Les holdings financières lui sont sans doute plus sensibles que les centres de recherche.
Sous le bénéfice de ces remarques de précaution, on peut observer qu' en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS) , la part de l'EBE qui est prélevée à ce titre oscille entre un point bas autour de 7 % en 1992 et un point haut d'environ 16,3 % en 1959. Entre 1992 et 2007, l'IS a absorbé une part croissante de l'EBE (+ 7,5 points) dans un contexte de prétendue stabilité du partage de la valeur ajoutée et de croissance modérée. Mais, l'année 2007 peut être vue comme un point haut et l'IS a absorbé en moyenne annuelle 11,9 % de l'EBE.
L'IS est théoriquement proportionnel à l'EBE. Ainsi, le prélèvement qu'il réalise devrait être constant aux variations de taux près. Cependant, outre que des changements législatifs interviennent, il existe entre l'EBE - solde de la comptabilité nationale - et l'assiette fiscale de l'IS des différences. Et ces facteurs expliquent que le produit de l'IS exprimé en points d'EBE varie 237 ( * ) .
Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas négligeable, l'impact microéconomique de l'impôt sur les sociétés sur la rentabilité du capital ressort comme plutôt modeste (par exemple, un prélèvement de 15 % sur un rendement de 7 % réduit celui-ci de 1,05 point le faisant passer à 5,95), d'autant que, d'un point de vue macroéconomique, il est généralement contra-cyclique .
Quant à l'écart entre la part de la valeur ajoutée prélevée par l'IS, elle n'a jamais dépassé 5 % (à comparer par exemple avec les 8 % de dividendes versés en 2006) et se trouve étroitement corrélée avec la croissance économique. Par ailleurs, l'écart entre l'évolution de cette part et celle de la part de l'impôt sur les sociétés exprimés en points d'EBE appelle quelques commentaires. Il peut s'expliquer du fait des évolutions relatives au partage global de la valeur ajoutée.
ÉVOLUTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(EN % DE L'EBE ET DE LA VA)
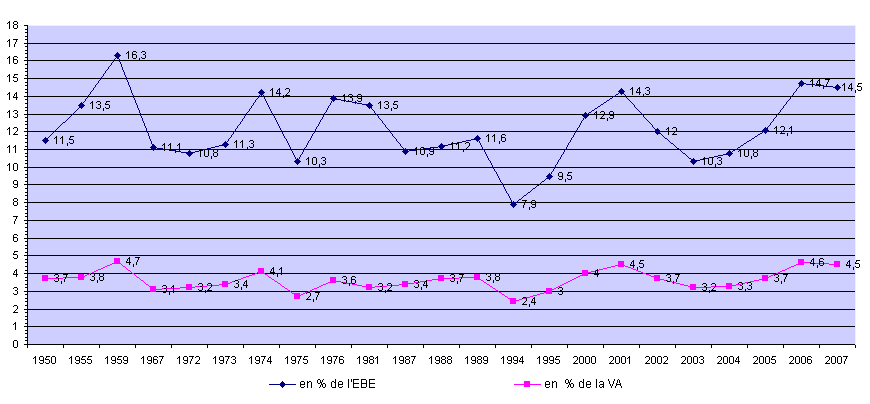
Théoriquement, à taux de prélèvement dans l'EBE inchangé, le produit de l'IS en points de VA devrait augmenter quand la part de l'EBE dans la VA augmente, résultat arithmétique mais aussi économique puisqu'alors la part des profits, et donc le produit relatif de leur imposition, renforce sa place dans l'économie.
2. Une baisse de la charge d'intérêts qui a profité aux actionnaires
En ce qui concerne les intérêts nets versés qui correspondent aux coûts du capital emprunté diminués du rendement des prêts effectués par les entreprises, leur variabilité est très grande. Leur montant dépend du taux de recours à l'endettement et du coût de la dette. Leur poids dans l'EBE varie selon le différentiel d'évolution des charges de l'endettement et de l'EBE.
Ces évolutions peuvent correspondre à des réalités économiques très différentes, l'histoire récente fournissant une illustration de cette diversité des configurations possibles .
Le maximum de la charge des intérêts est atteint en 1983, année où l'EBE est à un niveau relatif particulièrement faible, l'endettement des entreprises et les taux d'intérêt étant élevés. Suit une phase de désendettement et de décrue des taux d'intérêt et la charge des intérêts en proportion de l'EBE recule de 20 point, de 30 à 10 %. Cette évolution est contemporaine d'un redressement de la part de l'EBE dans la VA.
Dans le contexte présumé de stabilité de la part de l'EBE dans la valeur ajoutée qui succède à cette période avec des taux d'intérêt durablement bas, les années 2000 voient la charge des intérêts croître à nouveau plus que l'EBE si bien que le poids des intérêts augmente à nouveau dans des proportions qui restent toutefois mesurées puisqu'il atteint 9,8 % de l'EBE en 2007 contre 7,1 % en 2000.
A l'occasion de ce dernier épisode, une différence majeure intervient avec d'autres phases d'augmentation du poids des intérêts . Cette augmentation est parallèle à une réduction de l'épargne (de 53,8 % de l'EBE en 1998 à 40,6 % en 2007) qui est corrélée avec la hausse des revenus distribués aux détenteurs de capital et non à une baisse de la part de l'EBE dans la valeur ajoutée comme cela avait été le cas dans les années 70 238 ( * ) .
|
PRÉCISIONS TECHNIQUES SUR LES REVENUS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES Les revenus distribués ne correspondent pas strictement aux dividendes versés par les entreprises. En premier lieu, la comptabilité nationale les comptabilise en valeur nette diminuant les versements des perceptions de revenus de même nature. La complexification des structures d'entreprises entraîne une amplification de ces flux dans un sens ou dans l'autre. Il est intéressant de relever que les revenus non distribués, ou réinvestis directement dans l'entreprise de provenance, sont considérés comme s'ils avaient été perçus puis réinvestis. En second lieu, la comptabilité nationale distingue, pour les sociétés : - les dividendes qui constituent un revenu de la propriété pour les actionnaires qui ont mis des capitaux à la disposition d'une société, la comptabilité nationale ayant une définition assez large des dividendes puisqu'il s'agit de tout produit financier lié à une participation dans une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS). Ainsi, dès lors qu'une filiale d'entreprise assujettie à l'IS distribue un revenu à son entreprise mère, ce flux financier est classé avec les dividendes ; - les autres revenus distribués des sociétés qui correspondent aux revenus distribués par les entreprises assujettis à l'impôt sur le revenu. La comptabilité nationale leur fait distribuer l'ensemble de leur résultat à leur propriétaire. L'essentiel des autres revenus distribués des sociétés est le fait de sociétés en nom collectif (SNC), de sociétés civiles professionnelles (SCP) et de SARL. |
Le supplément d'endettement n'est pas non plus lié à une poussée de l'investissement mais au choix d'augmenter les rémunérations versées aux actionnaires 239 ( * ) sur fond de recours à l'endettement dans le cadre d'une gestion financière recourant à l'effet de levier de la dette.
Comme le montre le graphique ci-dessous, il a existé, au cours des années 2000, une forme de décorrélation entre l'évolution de l'épargne et celle des revenus versés aux propriétaires de l'entreprise.
On peut l'interpréter comme une option d'affecter les ressources de l'entreprise à la rémunération des épargnants plutôt qu'à la préservation des ressources financières des entreprises, choix qui aurait pu répondre au souhait de conserver des capacités d'autofinancement et, avec elles, une structure financière solide.
Mais, l'option inverse choisie est pleinement compatible avec ce que la plupart des études décrivent en soulignant les excès du recours au « levier d'endettement ».
ÉPARGNE ET REVENUS FINANCIERS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES
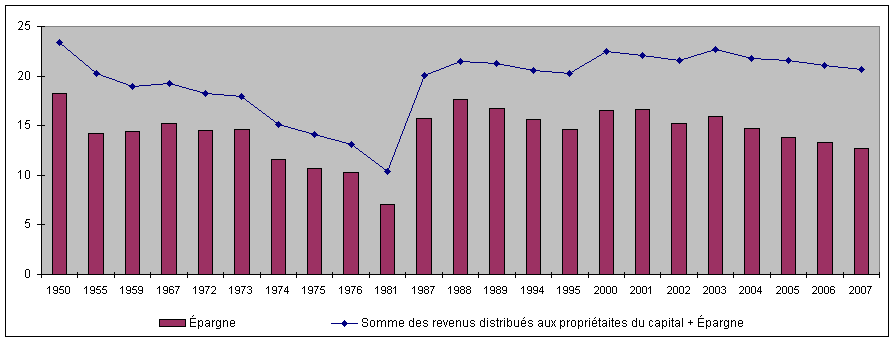
Ainsi, la rentabilité du capital a été optimisée à travers un ensemble d'actions visant, les unes, à améliorer la rentabilité économique du capital, les autres, par des stratégies purement financières, à maximiser les revenus des capitaux propres.
Cependant, si le partage de la valeur ajoutée semble pouvoir subir des pressions durables (pas infinies malgré tout), le recours à des stratégies d'optimisation financière pose plus rapidement un problème de soutenabilité.
Or, celui-ci risque bien d'aggraver les pressions pesant sur la part de la valeur ajoutée consacrée aux salaires sauf à ce que les propriétaires du capital des entreprises acceptent de supporter la charge du rétablissement de conditions financières plus saines .
C'est là un enjeu important de la sortie de crise, à court terme, mais aussi pour le plus long terme, un défi majeur si l'on souhaite que s'instaure un équilibre plus durable du modèle de croissance.
L'augmentation des dividendes versés aux actionnaires a porté le prélèvement sur le profit des entreprises destiné à ceux-ci à un niveau historique : le quart de l'EBE en 2006-2007 soit plus de deux fois plus qu'en 1981 et un niveau jamais atteint depuis 1949 .
ÉVOLUTION DES REVENUS FINANCIERS NETS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES (EN POINTS DE VA)
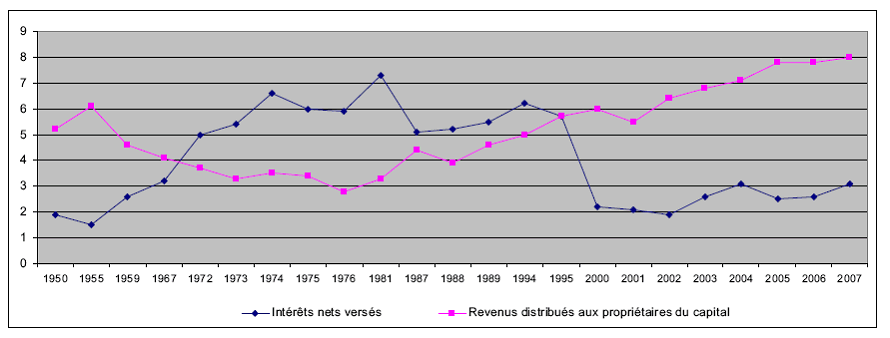
L'augmentation du poids des dividendes versés peut correspondre à plusieurs phénomènes.
Les premiers peuvent être internes à la sphère de l'EBE. La modification de la répartition de l'EBE en faveur des dividendes peut être liée :
- à l'extension des opérations de répartition de la valeur ajoutée dans les groupes complexes où les flux croisés de dividendes sont logiques et peuvent correspondre à des spécialisations financières au sein des groupes. Ainsi, quand certaines entités supportent l'endettement du groupe et son abondées en ressources via des flux de revenus en provenance des autres composantes du groupe ;
- à un accroissement de la part des fonds propres dans le financement des entreprises ;
- à une amélioration de la rentabilité du capital empruntant la voie de la distribution des profits plutôt que celle de l'augmentation des valeurs d'actifs.
Mais, l'augmentation des dividendes peut aussi refléter une modification du partage global de la valeur ajoutée liée à une augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée indépendamment du déroulement des processus décrits ci-dessus.
Cette dernière hypothèse, si elle ne ressort pas comme validée par les récents rapports consacrés au partage de la valeur ajoutée pour toute la période considérée (1981-2007) l'est évidemment pour la première phase de cette période (entre 1981 et 1990).
Quant à la seconde phase, on a mentionné dans la première partie du présent rapport les incertitudes de méthode concernant les indicateurs de rentabilité du capital et la dimension contradictoire des conclusions sur les évolutions de cette rentabilité selon l'indicateur choisi.
Il n'est pas possible dans ces conditions de faire sien le constat parfois dressé que, rapportés au passif des firmes, les revenus versés (auxquels on ajoute les plus-values) n'extérioriseraient pas de modification sensible du niveau du rendement du capital .
Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans la question délicate et particulièrement débattue depuis le déclenchement de la crise globale en cours de la mesure de la valeur intrinsèque d'une entreprise.
Toutefois, un constat s'impose : la stabilité du partage global de la valeur ajoutée s'est accompagné d'une hausse des revenus versés aux détenteurs du capital des entreprises qui ont absorbé les bénéfices de la baisse des charges d'endettement externes.
Il semble qu'il faille même dépasser ce constat et remarquer que, dans les dernières années, la baisse théorique du coût du capital emprunté (financé par la création monétaire) n'a pas diminué le coût réel du capital productif, non seulement parce que les dividendes ont augmenté mais encore parce que des entreprises ont choisi de supporter des charges financières supplémentaires en s'endettant pour améliorer les revenus des propriétaires des entreprises .
Dans cet arbitrage, la réduction des taux d'intérêt n'a pas été accompagnée d'une relance de l'investissement. Manifestement, les détenteurs du capital ont fait le choix d'augmenter leurs rémunérations immédiates plutôt que de parier sur un enrichissement différé, et plus hypothétique, tiré du développement de leurs actifs.
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION, ÉPARGNE ET
INVESTISEMENT
DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
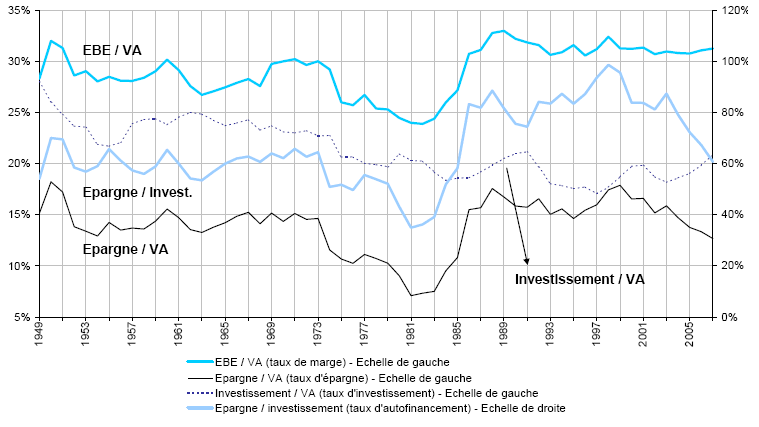
Source : Insee - Comptabilité nationale en base 2000
Ainsi que le montre le graphique ci-dessus, si le taux d'investissement (rapport de l'investissement à la valeur ajoutée) a bien régressé avec le taux de marge des entreprises (rapport de l'EBE à la valeur ajoutée) entre 1974 et 1982, le redressement du taux de marge à partir de cette date ne s'est pas accompagné d'un essor de l'investissement à due proportion.
Depuis 1992, le taux d'investissement est en deçà de 20 %, étiage où il se trouvait quand le taux de marge a touché son point bas au début des années 80 .
La faiblesse du taux d'investissement, mesuré ici en fonction de la valeur ajoutée, apparaîtrait encore plus si on l'estimait à partir de l'EBE puisque la place de celui-ci dans la valeur ajoutée a augmenté de 8 points entre son point bas et son point de « régime de croisière ».
Autrement dit, l'augmentation de la profitabilité des entreprises n'a pas suscité d'effort d'investissement accru contrairement aux prédictions des théories classiques de l'investissement .
L'augmentation des profits des entreprises a été principalement consacrée à accroître les revenus versés aux propriétaires du capital.
TAUX D'INVESTISSEMENT / REVENUS DISTRIBUÉS
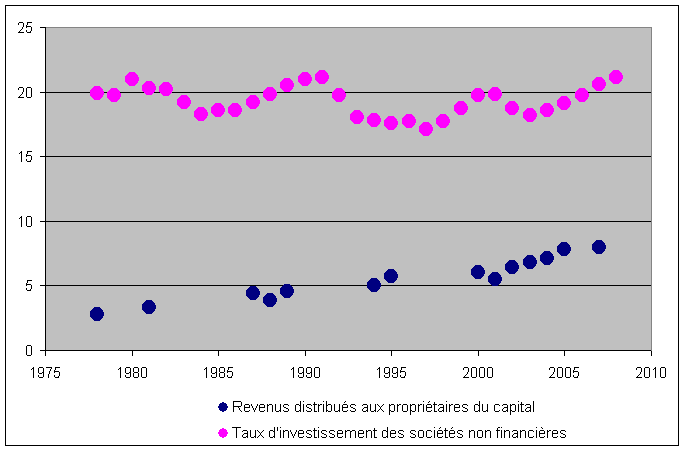
Dans ces conditions, le taux d'épargne des entreprises a pu bénéficier d'un rétablissement de même ampleur que celui du taux de marge.
L'augmentation des profits des entreprises n'a pas été consacrée à l'investissement si bien que la distribution qui en a été faite sous forme de dividendes n'a pas entamé l'épargne des entreprises .
Sans doute, ce constat doit-il être nuancé à partir de la fin des années 90 où le décrochage de l'épargne des entreprises, venant de l'augmentation des revenus financiers versés par elles (dans un contexte de poursuite d'une politique des dividendes et de recours au levier d'endettement), combiné avec un maintien de l'effort d'investissement s'est soldé par une baisse du taux d'autofinancement (ici mesuré par l'inverse du ratio épargne/investissement). Cependant, celui-ci, ne doit pas être exagéré. Malgré une forte diminution 240 ( * ) , il est à un niveau proche de son niveau historique des Trente glorieuses, période marquée par un rigoureux effort d'investissement.
III. LES REVENUS DU CAPITAL, DES INÉGALITÉS QUI FONT BOULE DE NEIGE : VERS UNE SOCIÉTÉ ÉCLATÉE ?
Il est particulièrement difficile de suivre les revenus versés par les entreprises non financières. Une partie d'entre eux est versée à l'étranger, certains sont destinés à des entreprises financières et d'assurances...
Par ailleurs, les revenus du patrimoine des ménages englobent des produits qui sont liés à d'autres actifs que ceux représentatifs d'une créance ou de la propriété des entreprises non financières.
Quoi qu'il en soit, les revenus du patrimoine des ménages ont augmenté plus que les revenus salariaux et le dynamisme des revenus versés par les entreprises non financières, qui a été plus fort que celui de leur valeur ajoutée, y a contribué.
Or, ces revenus sont particulièrement concentrés ce qui amplifie les inégalités salariales.
A. DE FORTES INÉGALITÉS DE REVENUS...
Les inégalités de revenus du patrimoine augmentent les inégalités salariales.
Selon un rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) sur les inégalités économiques de 2001 241 ( * ) , les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités salariales. Les 5 % les plus riches détiennent 30 % du patrimoine. Le rapport interdécile (les 10 % aux deux extrêmes) dépasse 75. Le centième des ménages les plus fortunés possèdent entre 15 et 20 % du patrimoine. Par ailleurs, alors que pour les « petits patrimoines » les placements sont essentiellement liquides, les plus importants sont majoritairement composés d'actifs de rapport. Entre les deux extrémités se situent des patrimoines réunissant des placements du type assurance-vie ou épargne logement et des biens immobiliers.
Si, en tendance, les patrimoines paraissent s'être un peu rapprochés du fait de l'apparition dans des couches sociales où ils étaient ignorés de véhicules d'épargne (ou de réserve) comme les comptes chèques, les revenus du patrimoine sont de plus en plus inégalitaires .
Il faut d'abord relever qu' au cours des années 80 et 90, les revenus du patrimoine ont davantage progressé que les revenus du travail , et, ce, en dépit de la baisse de rendement observée dans les années 90 avec le repli des taux d'intérêt.
PERFORMANCES DU PATRIMOINE DE RAPPORT
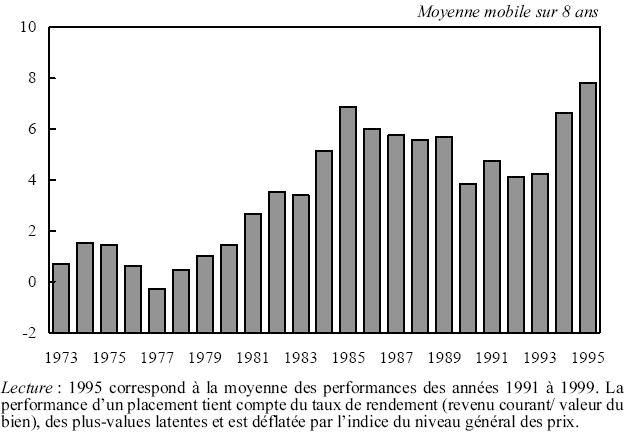
Source : Calculs INSEE d'après données INSEE, BDF, SBF, SAFER et Notaires parisiens
Ensuite, les revenus du patrimoine se concentrent chez les plus fortunés . Entre 1984 et 1994, la part des revenus du patrimoine perçus par le quart supérieur serait passée de 58 à 62 %.
Encore ces données négligent-elles les loyers fictifs correspondant à l'avantage que procure la détention d'un logement qu'on habite ainsi que les plus-values latentes. Ces plus-values auraient représenté, par exemple, 200 milliards par an en moyenne entre 1988 et 1997 soit de 40 à 50 % des revenus courants du patrimoine de rapport des ménages.
Il est, à ce sujet, à relever que les plus-values semblent avoir augmenté en même temps qu'a baissé la part des salaires dans la valeur ajoutée, phénomène qui traduit le fait que le rendement financier n'est pas sans lien avec le rendement économique du capital 242 ( * ) .
Ces informations sont précisées dans la dernière édition de la monographie consacrée par l'INSEE aux revenus et patrimoine des ménages.
|
UNE CLASSIFICATION DES SITUATIONS DE REVENUS PAR L'INSEE C'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré (net) annuel par unité de consommation, qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches 243 ( * ) . Ces plus riches sont rangés dans « les personnes à très hauts revenus ». Ils sont distingués « personnes à hauts revenus » qui regroupent les autres individus relevant du plus haut décile de revenus (9 % des individus proches du sommet de la distribution) de la très grande majorité (soit 90 % de la population). Les « personnes à très hauts revenus » sont segmentées en trois groupes. ÉCHELLE DES REVENUS DÉCLARÉS PAR UNITÉ DE CONSOMMATION EN 2007
Source : INSEE « Les revenus et patrimoine des ménages 2010 ». Julie Solard. - 90 % des très hauts revenus sont classés dans les « aisés » qui déclarent entre 84 469 euros et 225 767 euros par unité de consommation ; - 9 % d'entre eux sont les « très aisés » : ils déclarent entre 225 767 euros et 687 862 euros par unité de consommation ; - 1 % des très hauts revenus sont les « plus aisés » : leur revenu déclaré par unité de consommation excède ce seuil. Ces pourcentages s'appliquant à une faible proportion de la population (1 %), le nombre de personnes concernées est faible. Par exemple, les « plus aisés » sont 5 800 personnes (soit 0,01 % de la population). La dispersion des situations de revenu des personnes à « très hauts revenus » s'ajoute aux effets de leur situation de revenus sur la dispersion générale des revenus. La médiane des revenus des personnes à très hauts revenus (qui divise par moitié cette population) s'élève à 112 000 euros et représente plus de 6 fois la médiane des revenus déclarés par unité de consommation (17 644 euros). En outre, le revenu moyen des personnes concernées est de 149 638 euros à comparer avec 21 038 euros de revenu moyen annuel pour l'ensemble de la population. La dispersion interne à la catégorie des très hauts revenus est maximale pour les « plus aisés » dont le revenu va de 688 000 euros (39 fois le revenu médian) à plus de 13 millions d'euros 244 ( * ) (700 fois le revenu médian). En bref, la concentration des très hauts revenus est forte. REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION SELON LA CLASSE - EN 2007
Source : INSEE « Les revenus et patrimoine des ménages 2010 ». Julie Solard. |
Les 10% les plus riches reçoivent un quart des revenus d'activité déclarés, mais près des deux tiers des revenus du patrimoine et plus de quatre cinquièmes des revenus exceptionnels (plus-values, dont gains de levées d'option...). Les très hauts revenus ont un pouvoir d'attraction des revenus encore plus important : ils ne constituent que 1 % de la population, mais représentent 5,5 % des revenus d'activité, 32,4 % des revenus du patrimoine et 48,2 % des revenus exceptionnels déclarés. Enfin, la part du revenu total détenue par les seules personnes les plus aisées est très élevée au regard de leur poids dans la population.
PART DU REVENU DÉTENU PAR CHAQUE CLASSE
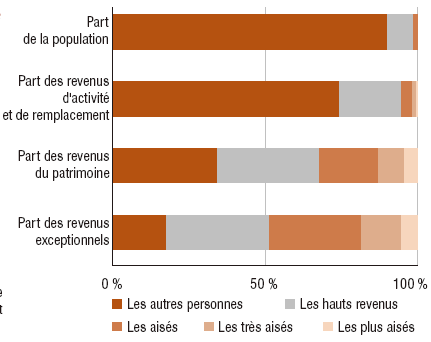
Champ : personnes appartenant à des ménages fiscaux de France métropolitaine dont le revenu déclaré par unité de consommation est strictement positif.
Source : DGFiP, exhaustif fiscal 2007, calculs Insee.
Alors qu'ils représentent 0,01 % de la population, ils perçoivent 0,6 % des revenus déclarés. Leur pouvoir économique, au sens de la part du revenu détenu par personne, est ainsi 75 fois plus important que celui de la très grande majorité des personnes.
Encore doit-on observer que seuls les revenus imposables sont ici considérés ce qui, en raison des régimes fiscaux favorables au capital, conduit sans doute à une sous-estimation de la concentration des revenus du patrimoine.
B. ... QUI ENTRAÎNENT DES INÉGALITÉS DE POSITION SOCIALE
Ces inégalités ne sont pas seulement quantitatives. Elles débouchent sur des différences de nature dans les positions occupées dans le champ social.
La dépendance au salariat est très inégale entre les français.
Ainsi que le rappelle l'INSEE :
Les revenus d'activité occupent une part décroissante des revenus totaux au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des revenus déclarés par unité de consommation. À l'inverse, les revenus du patrimoine et les revenus exceptionnels y prennent une part croissante : alors qu'ils ne représentent à eux deux que 2,6 % des revenus totaux des neuf premiers déciles, ils constituent 48 % des revenus totaux des personnes les plus aisées. Ainsi, contrairement au reste de la population, qui ne perçoit que des revenus d'activité, c'est-à-dire des revenus du « travail », les plus aisés perçoivent pour moitié des revenus du « capital » et pour moitié des revenus du travail »
COMPOSITION DES REVENUS TOTAUX DE CHAQUE CLASSE
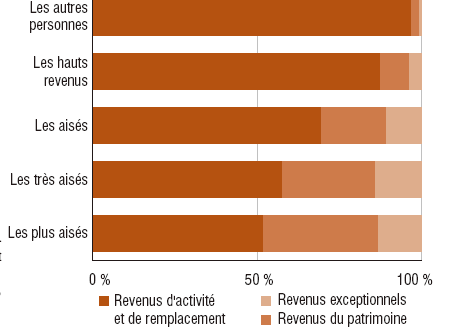
Champ : personnes appartenant à des ménages fiscaux de France métropolitaine dont le revenu est déclaré par unité de consommation est strictement positif.
Lecture : 51% des revenus des plus aisés sont des revenus d'activité, 34% des revenus du patrimoine et 15% des revenus exceptionnels.
Sources : DGFiP, exhaustif fiscal 2007, calculs Insee.
Plus les revenus sont élevés, plus la diversification des sources de revenus est importante. En 2007, 40 % de la population a touché des revenus du patrimoine contre 93 % des très hauts revenus. Seuls 2 % de la population sont concernés par des revenus exceptionnels ; 64 % des plus aisés en ont touché.
De même que les revenus du patrimoine, les revenus exceptionnels sont très corrélés au niveau de revenu. Ils représentent d'ailleurs une part non négligeable des ressources des très hauts revenus. Par ailleurs, ce sont en grande partie les mêmes personnes qui perçoivent des revenus exceptionnels chaque année. Sur les ménages que l'on peut suivre de 2006 à 2007 (83 %), 40 % de ceux touchant des revenus exceptionnels en 2007 en avaient déjà touché en 2006. Cette proportion croît avec le niveau de revenu puisque 60 % des ménages aisés, 68 % de ménages très aisés et 77 % des ménages les plus aisés sont dans ce cas.
Le processus d'accumulation renforce la concentration des richesses patrimoniales.
Les revenus élevés peuvent provenir, et aussi être la source de patrimoines importants. Plus les revenus sont importants, plus les possibilités de constitution d'un patrimoine sont fortes. Inversement, la possession d'un patrimoine important est source de revenus, souvent différenciés. Par ailleurs, le patrimoine se diversifie au fur et à mesure qu'il augmente (Girardot et Marionnet, 2007) , ce qui permet de se prémunir contre les risques, mais aussi de disposer plus sûrement (v. supra) d'un patrimoine de rendement.
Si pour la grande majorité de la population, les revenus d'activité demeurent la source principale de leurs revenus, il existe une petite frange des plus aisés pour lesquels ces revenus pèsent moins de 20 % .
En effet, les revenus d'activité représentent plus de 80 % des revenus totaux de 44 % des plus aisés, mais moins de 20 % des revenus totaux de 32 % des plus aisés. Il y a donc deux grands groupes parmi les plus aisés, ceux dont les revenus sont essentiellement des revenus d'activité, et ceux dont les revenus sont essentiellement des revenus du capital, les intermédiaires étant beaucoup moins fréquents. Cette bipolarisation n'est pas observée pour les autres très hauts revenus, pour lesquels les intermédiaires sont fréquents. Enfin, pour les neuf premiers déciles, la part des revenus d'activité est quasiment toujours supérieure à 80 %.
PROPORTION DE PERSONNES DONT LA PART DES REVENUS
D'ACTIVITÉ
ET DE REMPLACEMENT DANS LES REVENUS TOTAUX
EST.....
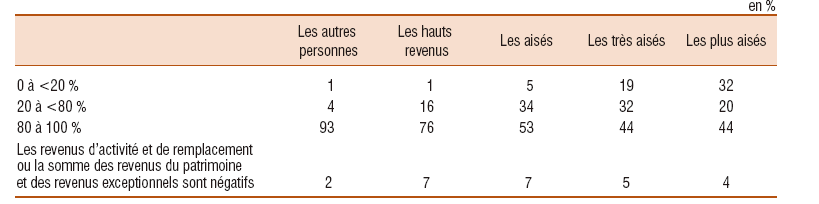
Champ : personnes appartenant à des ménages fiscaux de France métropolitaine dont le revenu déclaré par unité de consommation est strictement positif.
Lecture : 44 % des personnes les plus aisées dont plus de 80 % de revenus d'activité et de remplacement.
Note : les personnes dont les revenus d'activité et de remplacement ou les revenus du patrimoine et les revenus exceptionnels sont négatifs sont mis à part afin de ne pas fausser les constats sur les autres profils.
Source : DGFiP, exhaustif 2007, calculs Insee.
CHAPITRE II : UN MANAGEMENT DE MOINS EN MOINS RESPECTUEUX DU TRAVAIL
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Une préférence généralisée pour la rentabilité financière à court terme conduirait de nombreuses entreprises à agir sur le levier de l'organisation du travail pour soutenir tant bien que mal une productivité plombée par un déficit cumulé de recherche et d'investissement. Avec un niveau de qualification général sans progrès notable et un dialogue social toujours médiocre, les organisations à flux tendus s'approfondiraient au détriment des organisations « apprenantes ». Une proportion accrue de contrats courts, de droit (CDD, intérim) ou de fait (gestion « flexible » du CDI), participerait à la flexibilité nécessaire, la dualité du marché du travail s'en trouvant encore accrue. Le reflux du chômage attendu se heurterait au socle de chômage structurel d'une population restée trop longtemps éloignée de l'emploi tandis que le régime d'assurance chômage serait fragilisé par la contrainte globale d'un désendettement public. Cette rigueur stériliserait les velléités d'acclimater une « flexisécurité » efficace mais onéreuse, notamment dans les domaines de la formation et du logement. A cette insécurité persistante, se superposeraient les contraintes multipliées d'organisations toujours plus finement calibrées en effectifs, si bien que le déséquilibre actuel résultant, du point de vue des salariés, d'une évolution défavorable du compromis sécurité/autonomie, s'accentuerait. Il en résulterait un stress accru et une multiplication des troubles psycho-sociaux tandis qu'un nombre croissant de salariés, découragés par les conditions locales, quitteraient le territoire. |
La concurrence internationale continuerait de s'accroître dans la plupart des secteurs avec la « montée en gamme » des pays émergents, tandis qu'aucune force de rappel ne s'exercerait réellement pour freiner la mobilité des capitaux.
Cette configuration consoliderait les conditions menant à une préférence généralisée pour la rentabilité financière à court terme dont l'exigence, dans les pays industrialisés, nécessiterait la réalisation continuelle de gains de productivité par tête allant au-delà des contributions du stock de capital productif et du strict progrès technique, lesquelles stagneraient notamment en raison 245 ( * ) :
- de l'absence de ressaut technologique majeur, faute d'avoir pu engager, dans un contexte de désendettement public et privé, les moyens d'une relance très énergique de la recherche et de l'innovation,
- d'un niveau d'investissement relativement faible, qu'expliqueraient des perspectives macro-économiques et financières où la contrainte de désendettement pèse durablement sur la demande,
- ainsi que des incidences sur l'investissement productif, entendu au sens large, de la priorité accordée à l'affichage de rentabilités financières élevées.
Dès lors, la réalisation des gains de productivités requis impliquerait, pour de nombreuses entreprises, d' agir sur le levier de l'organisation du travail , qui permet notamment d'optimiser le retour sur investissement dans les NTIC.
Avec un niveau de qualification général sans progrès notable et un dialogue social d'une qualité toujours médiocre, le recours à des organisations du travail à flux tendus - ou leur approfondissement - constituerait alors, en France, une alternative s'imposant à de nombreuses entreprises, au détriment de l'adoption d'« organisations apprenantes » qui, plus favorables au bien-être des salariés, nécessitent une forte qualification jointe à un véritable climat de confiance.
Dans ce contexte, il semblerait « logique » qu'afin de satisfaire à des besoins de flexibilité encore accrus, la part des contrats courts (CDD, intérim) dans l'emploi, après avoir connu un palier au cours des années 2000, reprenne au cours des prochaines décennies la trajectoire ascendante observée durant les années quatre-vingt-dix, sans que le « statut » du contrat à durée indéterminée ne soit par ailleurs remis en cause, excepté dans son degré d'application (de tels contrats seraient réservés à une portion de plus en plus étroite du salariat, hautement qualifiée ou confirmée ; en sens inverse, une gestion plus « flexible » du CDI pourrait se banaliser).
En effet, le CDI s'affirmerait en véritable « graal » des parcours professionnels, sur la préservation duquel continueraient à se crisper, non seulement les « insiders », mais aussi l'opinion et les syndicats, voyant dans toute perspective d'assouplissement le spectre d'une généralisation de la précarisation. Pour leur part, les entreprises y verraient un moyen d'attirer, en la fixant, la partie de la main d'oeuvre la plus productive.
La dualité du marché du travail s'en trouverait encore approfondie, de même que les difficultés des « outsiders » pour devenir « insiders » ainsi que, concernant ces derniers, la peur tétanisante d'un déclassement durable. Cet état d'esprit s'avèrerait peu favorable aux redéploiements d'effectifs requis par une adaptation continue de l'appareil de production conforme aux exigences concurrentielles, toujours accrues, de la mondialisation.
Le déséquilibre actuel résultant, du point de vue des salariés , d'une évolution défavorable du compromis sécurité/autonomie , ne se résorberait pas.
En raison des pertes de capital humain liées à la prégnance du chômage de longue durée et faute d'une formation professionnelle suffisamment orientée vers les « outsiders », le reflux du chômage attendu -plutôt en conséquence du départ à la retraite des nombreux effectifs issus du « baby boom » que du retour durable d'une croissance forte- ne s'effectuerait que très lentement, se heurtant au socle de chômage structurel d'une population restée trop longtemps éloignée de l'emploi et apparaissant comme insuffisamment productive même au regard des minimas salariaux, qui pourraient n'être pas préservés.
Dès lors, la sécurité matérielle des salariés ne s'améliorerait pas, avec une proportion de contrats courts qui tendrait plutôt à s'accroître et un régime d'assurance chômage dont la générosité pourrait même subir la contrainte globale du désendettement public, alors que les mobilités géographiques seraient toujours compliquées par de nombreuses tensions locales sur le coût du logement qu'un taux de fécondité longtemps élevé en France ne contribuerait pas, d'une façon générale, à atténuer.
En dépit des discours et des intentions, la « sécurité de l'employabilité » , c'est à dire la « flexisécurité », qui nécessite des moyens de formation importants et articulés de l'enfance à la retraite en anticipant et accompagnant toutes les transitions professionnelles, un engagement des entreprises dans la gestion des compétences ainsi que diverses politiques d'accompagnement matériel visant à faciliter, d'un point de vue financier et géographique, les changements d'emploi, peinerait à s'acclimater.
Soumis à de fortes contraintes budgétaires (voire politiques) et donnant à l'attractivité sa signification la plus pauvre de réduction des coûts de travail (et non celle d'une amélioration de la qualité de l'emploi), le pouvoir central ne prendrait pas les décisions énergiques - ou n'inciterait pas assez fortement entreprises, collectivités territoriales et partenaires sociaux à certains consensus - susceptibles de faire évoluer profondément la régulation en des domaines (formation, logement...) qui demeureraient ainsi opaques, complexes et marqués par la multiplicité d'acteurs insuffisamment coordonnés ou pilotés, ainsi que par certains manques de moyens. In fine , rien ne viendrait véritablement se substituer , du point de vue des salariés, aux pertes enregistrées en termes de « sécurité de l'emploi ».
Ce sentiment d'insécurité persistant, joint à la superposition des contraintes caractérisant des organisations du travail « au plus juste » , toujours plus nombreuses et plus finement calibrées en effectifs, engendrerait un stress accru et une multiplication des troubles psycho-sociaux , cela à la plupart des échelons de la production, la mise sous tension englobant les grandes entreprises, leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Dans un climat persistant de défiance relative entre salariés et employeurs, les formules de télétravail, susceptibles d'aider à concilier des contraintes professionnelles multipliées avec celles de la vie privée, ne connaîtraient pas un développement optimal dans les champs professionnels qui s'y prêtent.
Marquée par une mobilisation insuffisante de la population en âge de travailler et un déséquilibre accru de ses comptes sociaux, la France ne parviendrait pas à sortir de l'ornière caractérisée par un déficit de production, d'innovation et de compétitivité , dans laquelle elle s'enfoncerait. On ne saurait alors exclure qu'à terme, un nombre croissant de salariés découragés par les conditions locales ne décident de quitter le territoire, les moins qualifiés rejoignant des zones de production moyennement intensives (Afrique du nord, Europe centrale) où de faibles rémunérations (dont le différentiel avec les rémunérations nationales irait cependant en diminuant) seraient compensées par un logement bon marché et complétées par des revenus de transfert, les plus qualifiés étant attirés par des zones de production à forte valeur ajoutée, caractérisées par de fortes dépenses publique et privée de recherche et d'innovation, ainsi que par des salaires élevés.
CHAPITRE III : DES ENTREPRISES MAL GOUVERNÉES DANS UN MONDE INGOUVERNABLE ?
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE L'observation du passé montre que parmi les principaux facteurs déterminants du pacte social, s'agissant de la gouvernance des entreprises, figurent l'évolution des conditions économiques, financières et de concurrence, la légitimité et à la solidité du « système » de relations sociales, plus éventuellement l'impact des politiques publiques et leur capacité à infléchir les évolutions subies. Dans ce cadre, le scénario tendanciel est un scénario conflictuel susceptible de nuire à terme aux objectifs de productivité et de compétitivité de l'entreprise et de l'économie nationale : - le transfert de pouvoir de l'entrepreneur familial au manager technocrate puis à l'investisseur financier « dilué » se poursuit dans le cadre d'une mondialisation non coopérative secouée par des crises ponctuelles ; - la distance physique aux lieux de décisions et la poursuite d'objectifs principalement financiers continuent de miner le pacte social ; - le dialogue social national demeure bipolaire et se révèle de plus en plus inadapté à la résolution de problèmes de dimension mondiale ; - l'Etat renonce à agir et le gouvernement des entreprises ne trouve plus de contrepoids que dans une opinion publique influençable et versatile. |
Comme l'a montré le titre I du présent rapport, le système français de représentation collective combine plusieurs formes de participation des salariés à la gestion des entreprises. Ces formes de participation à la gestion, issues de différentes strates historiques, sont censées permettre de faire entendre la voix des salariés dans la marche de l'entreprise.
En réalité, les auditions réalisées ont montré le caractère quelque peu virtuel de cette participation, qui fait du reste l'objet d'adaptations permanentes, en fonction des nouvelles problématiques surgissant au gré des mutations économiques et sociales.
Ces auditions ont également mis en évidence les contradictions des acteurs, tant syndicaux que patronaux. Les uns critiquent le caractère brusque ou lointain des décisions des entrepreneurs, sans souhaiter toutefois d'implication directe des salariés dans les organes de décision ; les autres tiennent des discours sur la responsabilité sociale dont l'objet et les destinataires réels (salariés ou marchés ?) sont ambigus.
Ces contradictions sont le reflet d'une crise de la représentativité qui participe à la crise du capitalisme dessinée par le présent rapport. Ce scénario « noir » se caractérise par la poursuite de tendances tendant à accroître le questionnement sur la légitimité d'un système qui apparaîtrait de moins en moins comme le corollaire de la démocratie sur le plan économique et de plus en plus comme l'expression d'un rapport de force.
Les principaux traits de ce scénario « noir » sont les suivants :
- La dépersonnalisation des relations dans l'entreprise tend à s'accroître : le transfert de pouvoir de l'entrepreneur familial au manager technocrate puis à l'investisseur financier « dilué » se poursuit dans le cadre d'une mondialisation non coopérative secouée par des crises ponctuelles. Cette dépersonnalisation affecte l'ensemble du tissu économique, à tous les niveaux y compris locaux, en raison des relations de dépendance existant entre entreprises. Le fonctionnement en réseau est déséquilibré, tous les points du réseau ne pesant pas le même poids.
- Dans ce réseau hiérarchisé, la dépersonnalisation est accrue par la distance physique aux lieux de décision et la poursuite d'objectifs d'ordre principalement financier . Dans le contexte d'une internationalisation toujours croissante des entreprises, lesdits lieux de décision, ainsi que les finalités poursuivies, sont de moins en souvent clairement identifiés par l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, la tertiarisation se poursuivant, les salariés travaillent dans de petits établissements de proximité, mais toujours davantage dépendants d'autres acteurs, nationaux voire mondiaux. Les objectifs de rentabilité financière l'emportent sur la logique de service. Dans d'autres entreprises, ces objectifs supplantent durablement la logique industrielle , ce qui freine l'avènement de projets de long terme porteurs de croissance pour l'entreprise et d'effets externes pour l'ensemble de l'économie (par exemple par la diffusion du progrès technique). La « démocratisation » de l'entreprise se fait au profit des actionnaires minoritaires, au risque d'affaiblir la cohérence des stratégies d'ensemble des entreprises.
- La violence des crises financières et de leurs effets sur l'économie réelle souligne de façon récurrente les divergences d'intérêts entre parties prenantes . Les positions bipolaires des partenaires sociaux et les failles du système de représentation collective empêchent toute reformulation du pacte social, d'autant que le dialogue social national est un cadre inadapté à la résolution des questions soulevées par l'évolution des conditions économiques, financières et de concurrence au niveau mondial. En conséquence de ces divergences d'intérêt croissantes, dans un contexte de faiblesse persistante du syndicalisme, la conception contractuelle de l'entreprise tend à l'emporter sur la conception institutionnelle, l'entreprise n'étant plus perçue comme le lieu de la poursuite de finalités partagées.
- Le corollaire de la conception institutionnelle de l'entreprise que constitue le droit du travail, censé protéger le salarié, ne joue plus son rôle :
• d'une part car les États, peu enclins
à accroître les rigidités susceptibles de nuire à la
compétitivité de leurs entreprises nationales, jouent un jeu non
coopératif améliorant temporairement leur situation individuelle
tout en dégradant à long terme la situation collective
d'ensemble ;
• d'autre part en raison d'une externalisation
croissante des activités des entreprises, qui fait prévaloir les
hiérarchies informelles.
Dans ce scénario « noir », correspondant à une accentuation des tendances actuelles, le pacte social vole en éclats et le gouvernement des entreprises ne trouve plus de contrepoids que dans une opinion publique influençable et versatile . L'État, lui-même soumis aux marchés financiers, n'a plus les moyens nécessaires pour jouer son rôle d' « État-providence ». Les divergences d'intérêt entre des États s'arque-boutant sur des cadres de souveraineté dépassés, empêchent l'émergence d'une coordination internationale qui soit à la hauteur des enjeux. A terme, cette situation a inévitablement des conséquences politiques, la démocratie étant érodée par l'absence d'un corollaire sur le plan économique.
CHAPITRE IV : UN DROIT DE TRAVAIL EN VOIE D'EFFRITEMENT
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE L'effritement du droit social du travail s'amplifierait. La dérégulation refléterait les politiques d'Etats témoignant de stratégies individuelles de « cavalier seul », le moins-disant social devenant le point de référence d'un droit international du travail qui peinerait à émerger. Les nouvelles normativités, à commencer par la « soft law », se développeraient de façon anarchique, sans nulle certification et ne seraient l'expression que d'un marketing généralisé dont les grandes lignes seraient décidées, à leur profit, par les grandes entreprises monopolistiques. |
I. UN DROIT SOCIAL SUBISSANT DE TOUJOURS PLUS PROFONDS CHANGEMENTS
A. UN SYSTÈME NORMATIF PROFONDÉMENT MODIFIÉ D'UN POINT DE VUE CONCEPTUEL
L'ensemble des normes juridiques du pacte social a enregistré de profondes transformations, décrites ci-avant, qui ont affecté tant les conditions de leur production que celles de leur application, ainsi que leur contenu.
1. Une production diversifiée et décentralisée
Les sources de production de normes concernant le pacte social dans l'entreprise se sont diversifiées avec la montée en régime du droit communautaire et l'émergence, encore modeste, de la « soft law ».
Mais en même temps qu'il tend à devenir « transnational », le droit applicable aux relations entre les parties prenantes concernées par les activités de l'entreprise se révèle aussi plus endogène, plus décentralisé.
Les évolutions récentes de la législation ont conféré, en effet, au droit négocié, particulièrement au sein de l'entreprise, une importance relativement plus grande qu'auparavant, dans le système normatif.
2. Une application assouplie
Avec la possibilité pour les accords de rang hiérarchique inférieur de déroger à ceux qui leur sont supérieurs, dans un sens pas nécessairement plus favorable au salarié, le système normatif social français a profondément évolué. Il est devenu plus souple, moins pyramidal, comme les groupes d'entreprises auxquelles il s'applique, organisées désormais en réseau. L'articulation entre ses différents niveaux est censée être moins hiérarchique, plus pragmatique.
3. Un contenu diversifié
Le contenu des normes du pacte social dans l'entreprise a été adapté aux changements du contexte dans lequel les entreprises exercent leurs activités : mondialisation de la production de biens et services, concurrence exacerbée, vieillissement de la population.
Le périmètre du pacte social s'est étendu. Il ne s'agit plus seulement d'un compromis entre les principales différentes parties prenantes de l'entreprise, salariés, employeurs et actionnaires mais aussi de satisfaire à des exigences éthiques et environnementales, celles de la société, des citoyens et des consommateurs, en matière de développement durable, de respect, dans le monde entier, des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, etc.
Le droit du travail d'aujourd'hui est moins statutaire qu'hier et plus individualisé. Il s'est élargi à la préoccupation de l'exclusion et de la précarité, de l'insertion des jeunes et des handicapés, de l'emploi des seniors.
Les relations professionnelles ont profondément évolué. Ce qui prime désormais, c'est l'aptitude du salarié à exercer une fonction dans un groupe, son employabilité, plutôt que le fait, pour lui, d'occuper un emploi permanent qui trouve sa place dans une classification ou une grille prédéterminée par une convention collective. S'il est cadre, il doit gérer lui-même sa carrière, sa rémunération dépend désormais, de plus en plus, de ses propres performances et pas seulement des gains de productivité de l'entreprise. Il lui est demandé d'accepter une certaine mobilité professionnelle et géographique.
La loi s'est efforcée d'entériner ces modifications et de satisfaire ces exigences. En revanche, des évolutions restent à entreprendre s'agissant de garantir aux salariés une réelle employabilité malgré l'objectif déjà affiché par la loi du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
B. DES CHANGEMENTS DONT LA MISE EN oeUVRE NE VA PAS DE SOI
1. Le cas de la GPEC
L'exemple, qui vient d'être évoqué ci-dessus de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, montre que l'application des lois sociales récentes n'est pas toujours à la hauteur de leurs ambitions.
Selon une enquête récente 246 ( * ) , les salariés ont ainsi une faible connaissance de ces dispositifs qui se sont avérés décevants concernant les seniors (dont les parcours professionnels n'ont pas été réellement redynamisés), malgré la mise en place d'entretiens de carrière et de bilans de compétences. Alors qu'il s'agissait d'anticiper les mutations de l'emploi, les personnes inquiétées ont estimé que ce nouvel instrument constituait surtout une aide à la mise en oeuvre des plans sociaux. Si la mobilité interne s'en est trouvée facilitée, cette occasion d'améliorer le dialogue social ne semble pas avoir été saisie et il n'y a pas eu de diagnostic partagé par les partenaires sociaux qui permette d'intégrer la GPEC dans la stratégie de l'entreprise.
2. La faible utilisation des possibilités de déroger à un accord de rang hiérarchique supérieur
Les dispositions de la loi du 4 mai 2004 permettent aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche, avec l'autorisation de ces derniers.
En ce qui concerne plus particulièrement la durée et l'aménagement du temps de travail, la loi du 20 août 2008 a même été jusqu'à renverser la hiérarchie des normes en donnant aux accords d'entreprise la primauté sauf avis contraire au niveau de la branche.
Mais, comment ces possibilités de dérogation sont-elles utilisées ?
« La bonne vieille hiérarchie reste dans les faits et dans un premier temps très majoritaire » estime le professeur Jean-Emmanuel Ray dans son manuel sur le droit du travail. « Rien ne semble avoir bougé à aucun niveau » conclut-il.
Les négociateurs de branche, auxquels une marge de manoeuvre importante avait été laissée, ont préféré, en effet, tout d'abord, ne pas déroger aux accords interprofessionnels.
A l'échelon inférieur, ensuite, moins de 20 % seulement des accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche 247 ( * ) . En outre, très peu le font alors (une soixantaine à peine depuis 2004). Peut-être sera-ce différent lorsqu'ils sont prioritaires, comme en matière de durée et d'aménagement du temps du travail, mais il est encore trop tôt pour en juger, s'agissant d'une loi récente (août 2008).
Comment expliquer, par ailleurs, dans les cas autorisés, la faible utilisation par les entreprises des possibilités qui leur sont offertes ?
Les premières analyses de ce phénomène 248 ( * ) proposent plusieurs explications : défense, par les syndicats, des prérogatives de la branche ; notion de dérogation étrangère à la culture des négociateurs ; sous-information des partenaires sociaux ; complexité des dispositions en cause et manque de compétence juridique pour les manier ; difficulté de déterminer si un accord d'entreprise déroge véritablement à un accord de branche ou en diffère simplement...
3. Un dialogue social toujours difficile dans les PME
La loi, précitée, du 4 mai 2004, a aussi constitué une étape importante dans la volonté des pouvoirs publics d'encourager la négociation collective dans les très petites entreprises (TPE).
Dans celles de moins de 50 salariés, qui n'ont pas de délégués syndicaux, elle autorise, en effet, la signature d'accords soit par des salariés extérieurs à l'entreprise mandatés 249 ( * ) par des organisations syndicales, soit par des élus.
Mais là encore, il s'agit, semble-t-il, de modalités qui ont été très peu utilisées (quelques dizaines d'accords seulement).
S'agissant des entreprises de moins de onze salariés, il est à espérer que le dialogue s'y trouve amélioré par la loi du 15 octobre 2010 complétant, en ce qui concerne la démocratie sociale, celle du 20 août 2008.
*
* *
Dans un tel contexte, la tentation pour l'Etat de s'abstenir de prendre des initiatives législatives importantes pour se contenter, éventuellement, de transformer en lois des accords nationaux interprofessionnels conclus par les partenaires sociaux ou de prendre des arrêtés d'extension de conventions collectives paraît répondre à l'objectif de donner tout son développement au droit issu des négociations de conventions collectives, notamment au niveau des entreprises (groupes ou établissements).
Une telle option pourrait être dictée par des considérations politiques ou doctrinales (confiance dans les lois du marché et de la négociation décentralisée). Mais, elle suppose que l'hypothèse de nouvelles relations professionnelles dans notre pays, moins conflictuelles, plus équilibrées et constructives soit crédible.
Elle engendre le risque de laisser subsister les principaux inconvénients de notre cadre juridique actuel qui tiennent à sa complexité et à ses carences et que ne s'accentue la segmentation du statut du travail.
II. LE RISQUE D'UN ENLISEMENT DANS LA COMPLEXITÉ
Sauf construction d'une infrastructure solide des négociations sociales, seul l'Etat semble en mesure, en France, de pouvoir :
- simplifier, d'une part, les règles juridiques du pacte social dans l'entreprise (la tâche est difficile et a déjà été tentée) ;
- entreprendre, d'autre part, la vaste réforme nécessaire pour optimiser l'employabilité en France.
A cet égard, un scénario d'inaction de l'Etat et d'abstention législative apparaît comme un scénario du pire, un scénario repoussoir.
A. LA COMPLEXIFICATION DU DROIT SOCIAL DU TRAVAIL, UN PHÉNOMÈNE D'AUTANT PLUS PERNICIEUX QU'IL SERAIT NON MAÎTRISÉ
1. Un phénomène en partie inévitable
Le fait que le droit social devienne de plus en plus complexe apparaît comme plus ou moins inévitable pour plusieurs raisons :
- les sources de production de normes se superposent et se multiplient : conventions internationales, « soft law », droit communautaire, lois nationales, conventions collectives ;
- les activités et les structures des entreprises évoluent profondément, parfois de façon contradictoire : le processus de production s'est allongé, internationalisé et segmenté. L'économie s'est « tertiarisée » et « financiarisée » : on assiste à la fois à une concentration et à une décentralisation de groupes qui cherchent à maximiser leur croissance tout en externalisant beaucoup de leurs activités, pour se recentrer sur leur coeur de métier.
Sur le plan juridique, il n'est pas facile, dans ces conditions, de définir précisément la notion d'entreprise, ni d'identifier qui prend réellement les décisions, qui a autorité sur les salariés, à quel niveau les conventions collectives doivent être négociées (groupe multinational, européen ou français ? établissement, unité de production ou collectivité de travail ?...).
Le développement de la « parasubordination » (ou de la fausse sous-traitance) complique en outre les choses dans un contexte de chômage important qui tend à entraîner un développement du travail indépendant en compensation d'une certaine érosion de l'emploi salarié. Par ailleurs, le nombre de contrats « atypiques » se multiplie, ce qui, naturellement, augmente encore la complexité du droit du travail.
La complication du droit est donc, dans une certaine mesure, inhérente à celle d'une économie non seulement de plus en plus mondialisée et concurrentielle, mais aussi davantage diversifiée dans le poids économique de ses intervenants, ses produits et les attentes des consommateurs, et soumises à des réglementations proliférantes (environnementales, sécuritaires, etc.).
Le phénomène n'est donc pas, à cet égard, propre à la France. Tous les pays de droit écrit, héritiers du droit romain, peinent, notamment, à mettre les nouvelles règles qu'ils adoptent en cohérence avec les dispositions préexistantes. Dans les pays de « common law », cette remise en ordre est plus aisée. Elle incombe au juge. Mais le droit y est aussi moins précis. En tout cas, la République française, malgré son caractère « indivisible » proclamé par notre Constitution, subit une complexification juridique qui est de nature à remettre en cause, sinon cette indivisibilité, du moins les principes républicains les plus fondamentaux.
Comme cela a été exposé plus haut, le système français de relations professionnelles, tout d'abord, présente la particularité d'articuler trois niveaux de négociation collective. D'autres pays privilégient soit la branche, soit l'entreprise. En France, les accords interprofessionnels importent également du fait du caractère centralisé de notre pays et d'un besoin de régulation nationale pour remédier aux inconvénients de l'émiettement conventionnel constaté au niveau de la branche.
La France apparait comme un pays caractérisé par ses divisions, bien qu'administré par un Etat unitaire :
- méfiance entre les partenaires sociaux et entre ceux-ci et l'Etat qui préfère rédiger des lois complexes plutôt que de remettre franchement en cause certaines législations unitaires ;
- rivalités syndicales ;
- forte segmentation des statuts des travailleurs (au-delà du simple dualisme le plus souvent évoqué) ;
- multiplicité d'aides et de formes d'intervention des collectivités publiques...
- coexistence, dans les établissements de représentants des syndicats (délégués, sections) et d'élus du personnel (comités d'entreprise).
Cette situation peut apparaître comme inextricable : des tentatives de simplification de notre droit du travail ont déjà eu lieu. Elles n'ont pas empêché ce dernier de demeurer particulièrement complexe. Les complications juridiques tenant souvent au souci de tenir compte du plus grand nombre de cas particuliers, il est difficile, dans ces conditions, de simplifier le droit sans paraître plus ou moins remettre en cause certains avantages spécifiques, donc provoquer des mécontentements.
Enfin, légiférer sur le pacte social sans complexifier davantage les codes du travail, de la sécurité sociale ou le code général des impôts, peut sembler relever de la gageure.
Ces différents motifs paraissent militer pour une inertie voire une inaction du législateur, l'Etat se contentant de faciliter la conclusion par les partenaires sociaux de conventions collectives.
Mais s'abstenir de tenter de réduire actuellement des règles du pacte social en France présente plus d'inconvénients que d'avantages.
2. Une tendance pernicieuse
Le penchant français pour la complexité est illustré par les mécanismes dérogatoires souvent présents dans nos lois. Dans une évaluation 250 ( * ) , déjà citée plus haut, de la loi du 4 mai 2004, concernant la négociation d'accords de ce type, dans les entreprises il est écrit que « les entreprises perçoivent cette loi comme indéchiffrable , incompréhensible , y compris par des responsables des affaires sociales formés au droit et informés des évolutions conventionnelles et jurisprudentielles ».
Les auteurs de ce document d'études estiment, plus généralement, que « le droit de la négociation collective (qui, dans un scénario de « laisser faire » supplanterait la loi) a atteint un tel degré de complexité qu'il laisse les parties prenantes - y compris les spécialistes de la matière - dans l'incapacité d'en comprendre la logique et d'en saisir les potentialités ».
La loi ne définit plus de façon assez précise ce qui relève de chaque niveau de négociation. Les branches se sont dès lors arrogées le pouvoir de substituer une hiérarchie conventionnelle à la hiérarchie légale par le biais de clauses d'interdiction de déroger particulièrement sophistiquées dont l'intrication finit par rendre abscons l'ensemble du système.
On imagine l'effet dissuasif qu'une telle complexité peut produire sur des investisseurs étrangers, son impact négatif sur l'attractivité du territoire national.
Le surcoût imposé en conséquence aux entreprises et aux administrations (ministère du travail, sécurité sociale, justice...) concernées par le fonctionnement de notre système social ou chargées de sa gestion, est difficilement mesurable mais probablement considérable.
La complexité favorise par ailleurs, sinon la fraude 251 ( * ) , du moins un certain arbitraire, qui affaiblit le système notamment en nourrissant un sentiment d'injustice chez les Français.
Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être présentées, il parait nécessaire de ne pas se contenter de ce qui a déjà été accompli 252 ( * ) mais d'aller plus loin dans la simplification des règles du droit du travail, de veiller à la qualité de la rédaction de textes issus de la négociation entre partenaires sociaux et d'assurer un contrôle sur les normes seraient-elles issues des conventions ou des formes informelles prises par la « soft law ».
Comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son rapport sur l'année 2006, la complexité croissante des normes crée une insécurité juridique préjudiciable, notamment, aux opérateurs économiques. Elle menace l'Etat de droit , égare l'usager et laisse les juges perplexes. Elle justifierait donc des réactions appropriées suffisamment vigoureuses de la part du législateur.
B. UN MANQUE DE CLAIRVOYANCE STRATÉGIQUE
Un scénario de « laissez-faire » serait assurément un scénario noir si l'Etat, non content de s'abstenir de mener les réformes nécessaires, renonçait en même temps à se doter d'une vision d'ensemble de long terme sur l'avenir du pacte social dans l'entreprise en France.
Parlant de « tour de Babel », à propos de la multiplication d'instances de dialogue social dans notre pays, le rapport Chertier 253 ( * ) évoque la fonction exercée autrefois par les commissions de l'ancien Commissariat au Plan. Leur rôle en matière d'expertise et de diagnostic a été repris par le centre d'analyse stratégique mais pas celui qu'elles remplissaient dans le domaine de la concertation.
Il n'existe plus désormais en France de service comparable à la fois généraliste, prospectif et où puissent se confronter, dans tous les domaines, les points de vue des partenaires sociaux, sans qu'il soit exigé d'eux de conclure un accord au terme d'une négociation.
Des conseils spécialisés ont été mis en place pour les grands sujets de réforme sociale : Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) et Conseil d'orientation des retraites (COR).
Il est à espérer que l'Etat les dote de moyens d'expertise suffisants, écoute leurs avis et s'en inspire pour mener les actions nécessaires qui lui incombent.
Les problèmes posés par le vieillissement de la population concernant l'avenir de notre pacte social méritent, notamment, une attention particulière. L'emploi des seniors n'est pas seul en cause, bien que la question soit d'importance et constitue un point faible de la France.
Cette évolution, par ailleurs bienvenue, entraîne aussi un alourdissement tendanciel des dépenses non seulement de retraite mais aussi de santé. Leur financement étant davantage assis, en France, que chez nos principaux concurrents, sur des cotisations proportionnelles aux salaires, c'est à la fois la compétitivité des entreprises et le niveau des rémunérations nettes des travailleurs qui risquent de s'en trouver affectés.
TROISIÈME PARTIE :
QUELS FACTEURS D'ÉMANCIPATION ?
CHAPITRE I : UNE RÉALLOCATION DE LA
VALEUR AJOUTÉE AU SERVICE DE LA CROISSANCE ET DE LA RELANCE DU CONTRAT
SOCIAL ?
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Dans un contexte où les Etats sont de moins en moins capables de piloter la sphère économique et sociale, les marges sont étroites et la reconquête d'un espace de liberté suppose de prendre acte de ce que le bon niveau d'action ne peut plus être réduit au niveau national . Les obstacles majeurs à surmonter sont celui des excès de concurrence entre espaces économiques, le court-termisme d'un capital mis à même de se réallouer à tout moment ainsi que de faibles perspectives de croissance attribuables à des politiques économiques non coordonnées . Un nouvel équilibre macroéconomique conciliant incitations au travail, dynamisme de la demande et renforcement de la qualité de l'offre s'impose. Symétriquement la complexification des structures et l'accélération des changements requièrent des méthodes d'action plus décentralisées , passant par le recours à une information mieux partagée et à des instruments de négociation adaptées.
Tout en respectant les mécanismes de marché dans
toute la mesure où ils sont compatibles avec une amélioration de
la croissance potentielle
, l'Etat s'attacherait à conduire
toutes les politiques nécessaires à la production des biens
publics
Un partage de la valeur ajoutée plus adapté à la reconnaissance du rôle du travail et plus favorable à la croissance suppose de tendre vers un rééquilibrage de l'économie contemporaine dans laquelle évolue l'économie française afin de desserrer les contraintes qu'elle recèle, quand ces contraintes sont contreproductives, pour mieux en saisir les opportunités. Cette entreprise est un préalable à toute relance du contrat social . Dans la mesure où elle est conditionnée par l'adhésion de nos partenaires, ou de certains d'entre eux, elle a un caractère « héroïque ». Elle suppose un vigoureux effort de diplomatie économique. La priorité doit être de retrouver le sens, et de restaurer les conditions, de véritables progrès de productivité . A cet effet, disposer d'une grille de lecture de l'économie contemporaine plus pertinente serait un premier pas qu'il faudrait faire suivre par des actions tendant à ce que les conditions du progrès économique et social soient à nouveau réunies . Sur le premier point , une double confusion devrait être dissipée : celle qui assimile compétitivité (notamment microéconomique) et performance économique ; celle qui voit dans l'économie contemporaine une tendance univoque vers l'accentuation des concurrences, même si celle-ci n'est pas récusable. Il faut ajouter que la financiarisation et la mondialisation des économies ne doivent pas être sous-estimées, au nom d'indicateurs trop partiels qui en nuancent d'autant plus le poids qu'ils sont construits de sorte d'être insusceptibles d'en saisir tous les effets 254 ( * ) . Sur le second point , il faut savoir admettre que les mécanismes de marché, malgré leurs vertus, peuvent ne pas avoir toute l'efficacité théorique qu'on leur prête parfois, et qu'il doit exister une place, soit pour les restaurer, soit pour les stabiliser. Enfin, en écho à la prégnance grandissante de la globalisation - qui ne concerne pas seulement les rapports Nord-Sud mais aussi, et probablement surtout, les économies développées entre elles -, il faut bien reconnaître que le système économique et social est lui-même pris dans des dynamiques globalisantes qui conduisent à marginaliser le rôle de régulateurs de plus en plus intégrés au système. Sans compter que le bon niveau de pilotage - le niveau international - n'a pas les pilotes qu'il faudrait - et l'Europe en témoigne malheureusement -, il faut aussi reconnaître que les Etats ont de plus en plus de mal à s'imposer. C'est en partie affaire de volonté, en partie affaire d'institutions. Sous ce dernier angle, outre les nécessaires traités coopératifs qu'il faudrait conclure entre Etats pour être en mesure de défendre des politiques économiques, financières et sociales respectant les équilibres nécessaires à la prospérité, on peut mentionner la nécessité de rénover les modalités de l'action publique. En dehors, ce qui a été mentionné sur le caractère stratégique de la diplomatie économique - une diplomatie qui pourrait parfois être utilement repensée -, d'autres innovations consistant à mieux informer et mobiliser les éléments du corps social doivent être envisagées. |
I. UN IMPÉRATIF DE LUCIDITÉ
La représentation d'une économie où, pour être importantes, la financiarisation et la mondialisation seraient des phénomènes de second ordre est susceptible de faire écran en occultant la dimension structurante de ces deux tendances.
Par ailleurs, l'assimilation entre compétitivité microéconomique des entreprises, compétitivité macroéconomique des Nations et productivité, entretient une confusion sur les facteurs de richesse des Nations.
Ces conclusions ont été largement abordées dans les premières parties du présent rapport, qui le seront ici en mettant l'accent sur les conséquences qu'elles devraient avoir en termes de conception de l'action publique.
A. NE PAS SOUS-ESTIMER LES GRANDES TENDANCES EN COURS DANS L'ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
Il existe une tendance 255 ( * ) à présenter la financiarisation et la mondialisation des économies comme des phénomènes importants mais de second ordre. Or, cette tendance est dangereuse car elle entretient l'illusion du « pré-carré » et une vision erronée des phénomènes réellement à l'oeuvre.
A titre d'exemple de cette minoration, on peut citer :
- s'agissant de la financiarisation , le discours récurrent sur la relative modestie de la capitalisation boursière en France et l'importance des financements bancaires, comme si ceux-ci étaient fondamentalement autonomes, c'est-à-dire régis par des logiques différentes de celles des marchés d'actions ; on peut également s'étonner que le processus de diffusion des stratégies financières des entreprises faisant appel aux marchés sur les autres entreprises soient systématiquement négligé ;
- s'agissant de la mondialisation , tant ses effets sur l'emploi (qui, généralement, sont calculés à partir de définitions restrictives) que son ampleur (usuellement mesurés à travers des taux d'ouverture, mais négligeant trop souvent la répartition internationale du stock de capital et du chiffre d'affaires des entreprises) sont trop souvent sous-estimés.
En bref, la diffusion de ces deux contraintes n'est pas correctement appréciée sauf, sans doute, par les « décideurs », notamment privés, qui en mesurent concrètement la valeur et paraissent concevoir leur action dans ces deux termes.
Ce constat n'est pas anecdotique. Si l'on présume que ces tendances se renforceront encore à l'avenir, le scénario le plus probable étant que cette accentuation se produira et sera suivie d'une stabilisation relative non sans que des crises de plus en plus aiguës surviennent, on s'expose à ne pas pouvoir infléchir ce scénario et à en subir le pire.
B. NE PAS CONFONDRE COMPÉTITIVITÉ ET PRODUCTIVITÉ ET NE PAS IMAGINER QUE L'ÉCONOMIE EST DE CONCURRENCE PURE ET PARFAITE
Il faut alors conjurer l'erreur de confondre compétitivité et productivité, en imaginant, ce qui aggraverait encore les choses, que le monde économique est un monde de concurrence pure et parfaite. Il faut ajouter d'emblée que l'imperfection de la concurrence ne peut être vue comme l'absence de toute concurrence.
Les conséquences nocives de telles confusions ont été exposées dans le précédent chapitre du présent rapport.
Il s'agit ici de montrer quelles difficultés l'économie contemporaine conduit à surmonter pour restaurer un avenir possible de prospérité économique et pour un pacte social dans l'entreprise de progrès 256 ( * ) .
Dans les économies modernes ouvertes sur l'extérieur et financiarisées, la compétitivité microéconomique des entreprises est une contrainte qui a des visages différents.
Dans la sphère de l'économie réelle , on assiste à une dualisation des entreprises avec, d'un côté, de souvent très grandes entreprises opérant sur de vastes marchés internationaux placées dans des situations où les concurrents sont soit inexistants (monopoles) soit peu nombreux (oligopoles) et, de l'autre, de nombreuses entreprises soumises à une très forte concurrence, qu'elles produisent des biens et services pour les consommateurs ou comme fournisseurs des grands donneurs d'ordre.
Une forte pression s'exerce généralement sur les prix des biens et services (ce qui explique le rythme généralement faible de l'inflation) excepté pour les entreprises oligopolistiques ou monopolistiques qui, dans une certaine mesure, peuvent fixer leurs prix comme elles le souhaitent.
Dans un tel contexte, la valeur ajoutée tend à se déplacer vers les grandes entreprises . Face à l'attrition de la valeur ajoutée restant, aux entreprises ordinaires, celles-ci subissent des tensions sur la répartition de leur valeur ajoutée. Elles s'efforcent de préserver leur taux de marge (rapport de l'EBE à la valeur ajoutée) mais celui-ci est structurellement inférieur à celui des grandes entreprises financières. En effet, elles sont partiellement contraintes par l'état du marché du travail, que celui-ci résulte de mécanismes de marché ou d'institutions (salaires minima, cotisations sociales...) qui peut être dans un équilibre les empêchant de flexibiliser l'emploi ou/et les salaires jusqu'au point qui serait nécessaire pour défendre un niveau souhaité de rentabilité économique du capital.
Pour autant, les salaires versés par ces entreprises sont structurellement inférieurs à ceux des grandes entreprises. En outre, l'emploi y est plus précaire. Cette situation vient d'un ensemble de facteurs qui se cumulent :
- une plus faible capacité à maintenir des prix « rémunérateurs » pour leur production ;
- la productivité plus basse de la plupart des activités économiques auxquelles se livrent ces entreprises ;
- la qualification inférieure des emplois concernés ;
- l'existence d'une forte concurrence sur les segments du marché du travail où recrutent les entreprises en cause avec un niveau relativement élevé du chômage (le taux de chômage des non-qualifiés est plus élevé que le taux de chômage moyen) ;
- le ratio comparativement important des emplois atypiques (contrats courts, travail à temps partiel...)...
La faiblesse relative des salaires dans ce qui représente la partie majoritaire du tissu des entreprises provient ainsi de facteurs structurels, en lien avec la nature économique de leurs productions mais aussi avec l'organisation des marchés de biens et services sur lesquels elles opèrent et avec l'état du marché du travail sur lequel elles interviennent.
A l'inverse, les salariés des grandes entreprises bénéficient, mais relativement seulement, des facteurs inverses. Leurs salaires sont structurellement plus élevés et leur emploi est mois précaire. Pour autant, les entreprises qui les emploient ont également un taux de marge structurellement supérieur à celui des petites et moyennes entreprises. La rentabilité économique du capital y est plus forte. La « dépendance » de ces entreprises aux marchés financiers explique sans doute cette situation parmi d'autres facteurs dont les modalités particulières de rémunérations de leurs dirigeants. Sur ce point, il n'y a pas de raison particulière de considérer que les systèmes de rémunérations fondés sur une variabilité de celles-ci en fonction des « performances » financières des entreprises financières n'ont pas les mêmes effets dans le secteur non financier 257 ( * ) .
Avec ces grandes entreprises, le joint est établi entre les systèmes productifs nationaux et l'économie mondiale, ou, à tout le moins, régionale, ainsi qu'avec la sphère financière .
Si, microéconomiquement, leur valeur ajoutée est fractionnée dans des espaces économiques supranationaux, leur influence économique sur chaque espace national est forte à la fois par les revenus distribués à leurs salariés ou aux propriétaires locaux de leur capital et par les commandes passées aux fournisseurs locaux. Autrement dit, si elles attraient une part croissante de la valeur ajoutée de leurs pays d'origine, les grandes entreprises internationales participent à la création de valeur ajoutée locale, ce qui leur attribue une position-clef dans le système économique des Nations.
En outre, comme elles sont hautement financiarisées, à la fois par l'importance absolue du capital financier qu'elles réunissent (alors que leur capital technique matériel peut être assez faible) mais aussi par l'importance relative que le capital occupe dans les ressources qu'elles mettent en oeuvre, elles atteignent un niveau élevé de mobilité potentielle. Celle-ci, combinée avec l'ouverture du monde, leur offre un vaste choix de localisation mais les soumet aussi aux règles du concours de beauté que les grandes entreprises passent, quotidiennement, devant les marchés financiers et les épargnants.
Au total, la dualisation des entreprises est un phénomène essentiel de l'économie contemporaine qui implique d'en interpréter les évolutions dans des termes différents de ceux de la concurrence pure et parfaite.
Les phénomènes de domination sur les marchés des biens et services trouvent un prolongement dans la situation des salariés, qu'il faut prendre en compte pour résorber les déséquilibres qu'ils entraînent.
Parmi ces déséquilibres, il faut tant particulièrement relever la dissociation entre les performances productives réalisées par certaines grandes entreprises et celles des autres entreprises, dissociation qui semble étroitement liée aux effets asymétriques des contraintes de compétitivité subies par chacun des producteurs.
Dans un tel contexte, les progrès de productivité des uns peuvent se faire au détriment de celle des autres avec un bilan comptable nul pour l'économie et des perspectives économiques incertaines.
Sous ce dernier angle, l'utilisation de l'EBE des entreprises les plus productives est une question majeure dont tend à dépendre la prospérité économique de tous.
II. RESTAURER UN ESPACE DE PILOTAGE DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Dans ce contexte, les Etats tendent à devenir transparents aux intérêts des entreprises ; de plus, ils sont peu armés pour faire face à la complexification des structures productives et à ses effets .
Ces deux obstacles, de nature et d'ampleurs différentes, doivent être surmontés.
Ceci suppose tout particulièrement que l'Etat renouvelle ses modes d'intervention.
Au préalable, il faut souligner que les critiques du fonctionnement de l'économie de marché, du capitalisme et de ses effets sur le pacte social dans l'entreprise relèvent de démarches plus ou moins radicales. Or, les analyses proposées dans le présent rapport, si elles se sont efforcées de mentionner les points de désaccords sur tel ou tel point controversé, se situent dans une perspective générale approuvée par les Etats européens qui, avec l'objectif de fonder une économie sociale de marché, pour ne pas mésestimer les conflits potentiels entre les mécaniques de l'économie de marché - et leurs contradictions - et le progrès social, ne leur dénient pas pour autant par principe toute efficacité sur ce plan-là.
Dans le scénario (ou le modèle) du pire, où ont été extrapolées 258 ( * ) les tendances récentes du capitalisme contemporain, ce sont souvent les perversions de l'économie de marché qui ont été vues comme susceptibles de réunir ce qui reste du pacte social dans l'entreprise notamment. C'est pourquoi les traits de ce qui pourrait constituer un scénario alternatif de relance du progrès social passe par la correction des dysfonctionnements actuels du capitalisme et de l'économie du marché. Pour autant, « on ne peut être plus libéral que les libéraux » et ignorer que pour les pères fondateurs de l'économie, certains dysfonctionnements de l'économie de marché sont structurels, c'est-à-dire indépendants des contingences du moment.
En outre, à supposer même que les mécanismes de marché produisent des effets économiques supérieurs à toute autre forme d'organisation, il ne faut pas négliger que leurs aboutissements sociaux ont toujours été indéterminés, pouvant, en particulier, déboucher sur des situations sociales peu supportables aux hommes d'aujourd'hui et qui, économiquement, posent les problèmes qu'on a exposés au cours de ce rapport.
Ces considérations obligent à admettre la grande complexité des problèmes à résoudre aujourd'hui, ce qui nous semble représenter en soi un progrès dans un contexte trop souvent marqué par la simplification excessive des solutions proposées. Dans cet esprit, il convient de ne pas confondre les pathologies d'un système et les évolutions nécessaires qui conditionnent sa capacité à nourrir le progrès. Moins que jamais l'histoire économique n'est finie sinon pour ceux qui feraient l'erreur historique de le croire. L'émergence de grands pays, les perspectives du changement démographique, le rythme rapide de l'innovation dans certaines zones économiques... invitent à tourner le dos au rêve d'un avenir mort, d'une et simple prolongation des structures du passé.
Mais il faut prendre conscience que cette histoire accélérée ne s'accommode pas des pathologies économiques actuelles et qu'aux difficultés de conception s'ajoutent les difficultés pratiques (qui peuvent interférer avec les premières) que suscite un monde de plus en plus global.
A cet égard, vos rapporteurs pensent que l'Europe, qui ne part pas de rien pour affronter l'histoire en marche, est un projet cohérent à condition qu'on le prenne au sérieux .
Par son existence même, le projet européen leur paraît montrer que les Etats d'Europe ont refusé de céder à la crise actuelle des Etats.
De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui, l'autonomie des Etats est d'autant plus réduite qu'ils se perçoivent comme les simples adjudicateurs de contextes politico-juridiques favorables aux intérêts de leurs entreprises, de leurs champions nationaux. Dans ces conditions, ils ont tendance à reproduire entre eux la compétition que ces acteurs économiques se livrent. Ils deviennent les agents d'un système économique qui les englobent et qu'ils ne contrôlent plus, comme acteurs souverains .
On pourrait penser que la compétition entre les Etats doive être d'autant moins forte que les niveaux atteints dans leurs développements économique sont proches et élevés, notamment parce que de tels Etats auront pour fondation des Nations aux préférences analogues et parce que la compétition met aux prises des agents de force comparable, laissant entrevoir l'hypothèse de devoir supporter des coûts élevés dans une compétition frontale entre eux. Mais, dans une large mesure, c'est l'inverse qui semble advenir.
Or, la situation européenne est, de ce point de vue, particulièrement déconcertante puisque les Etats semblent se livrer au coeur de l'Europe à une compétition exacerbée 259 ( * ) alors même que la construction européenne peut être analysée comme un profit qui n'est pas exclusivement destiné à mettre aux prises les entités productives les unes avec les autres dans un marché élargi par rapport aux marchés nationaux fragmentés. Autrement dit, ce qui est devenu une « économie sociale de marché » par le récent traité de Lisbonne a toujours été pensé comme un projet libéral mais mitigé des doses nécessaires à l'élaboration d'une Europe puissance et d'une Europe sociale.
Or, dans le processus, les Etats européens semblent avoir mis entre parenthèses ces deux derniers piliers. Ils adoptent des politiques économiques, sociales, fiscales..., qui tendent toutes 260 ( * ) à favoriser l'attractivité de leurs espaces pour les entreprises. Les possibilités de compensation des excès des mécanismes de marché s'en trouvent réduites (v. la concurrence fiscale notamment), si tant est que cette volonté de compensation ne disparaisse pas plus ou moins entièrement (v. la course à la réduction du coût du travail).
Il faut ajouter à cette logique de retrait de la puissance organisatrice des Etats dans un environnement économique où les grandes firmes peuvent poursuivre leurs intérêts économiques en dominant les autres firmes mais aussi les Etats eux-mêmes, les difficultés pratiques de toute régulation macroéconomique, macrosociale, macrofinancière... dans un contexte de dualisation de plus en plus complète.
Dans le contexte de l'économie contemporaine, les règles générales non seulement deviennent difficiles à adopter mais encore à concevoir étant donné la diversité des situations des agents économiques .
A chaque règle générale, risquent d'être associés des coûts qui peuvent être plus élevés au total que les gains attendus de la règle. Et, pourtant, il est pratiquement impossible de moduler les règles en fonction de chaque situation singulière.
III. LE PARTAGE GLOBAL DE LA VALEUR AJOUTÉE, UNE GRANDE DIVERSITÉ DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DONT L'ACTION PUBLIQUE DOIT TENIR COMPTE
Les constats macroéconomiques portant sur la répartition de la valeur ajoutée s'accompagnent d'une très grande diversité des situations réelles qui rend difficile de concevoir et de conduire une politique pertinente.
Une chose est sûre : les variations des coûts de production ne sont pas un handicap pour l'économie française et la modération salariale a globalement amélioré sa compétitivité .
A la faveur de la dégradation du commerce extérieur, on a pu évoquer une perte de compétitivité économique.
En toute hypothèse, celle-ci ne vient pas de l'évolution des coûts unitaires de production.
Ceux-ci vont dans le sens d'une amélioration de la compétitivité économique française.
COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
(Indicateurs déflatés par les coûts salariaux unitaires dans le secteur manufacturier)
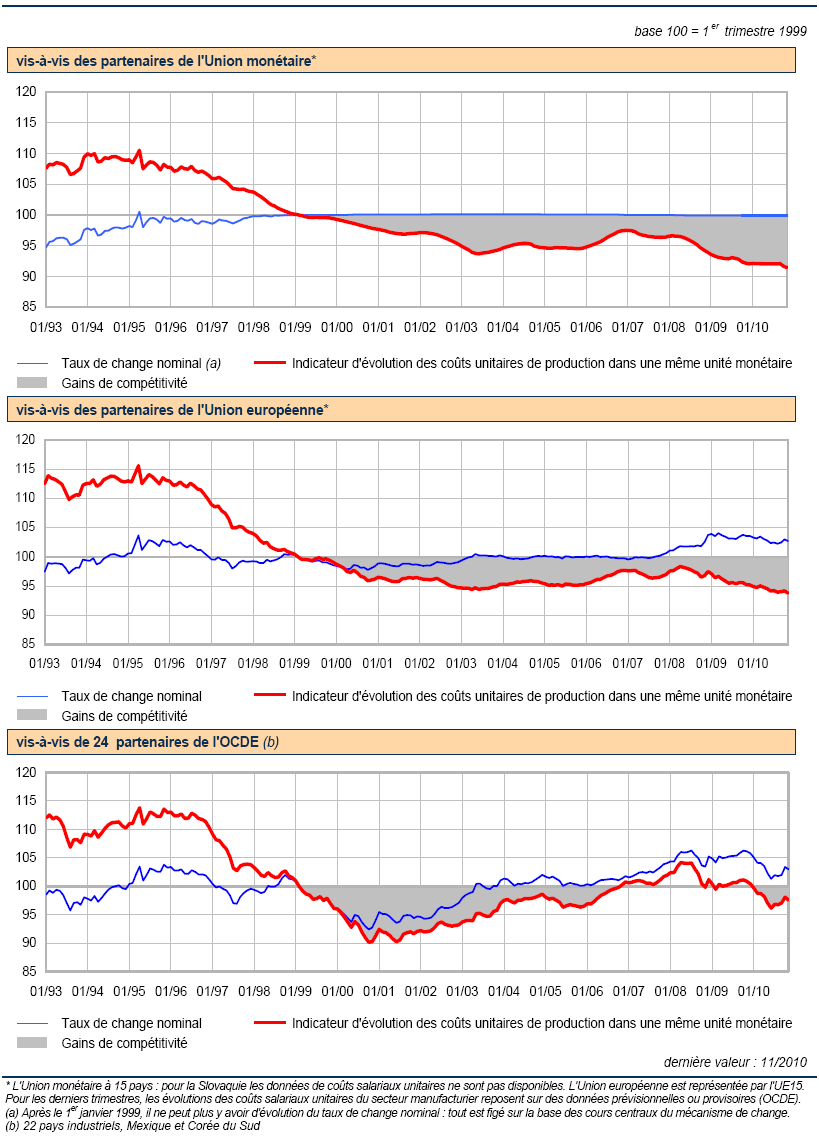
Source : Banque de France. Zone euro. Principaux indicateurs économiques et financiers. Janvier 2011.
Une partie importante de cette évolution favorable résulte de la modération salariale relative de l'économie française.
Si l'on exclut l'Allemagne, la France connaît des variations de ses coûts salariaux unitaires qui lui permettent d'améliorer sa compétitivité notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.
COÛTS SALARIAUX UNITAIRES DU SECTEUR MANUFACTURIER
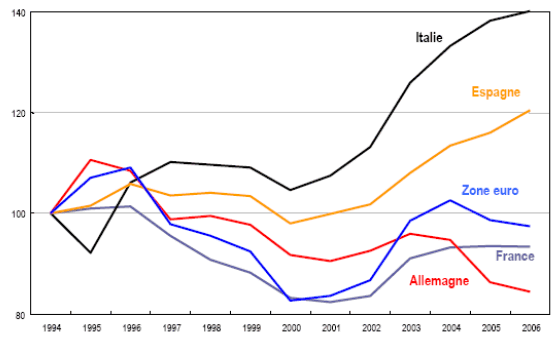
Note de lecture : les coûts salariaux unitaires mesurent le coût du travail en le corrigeant de son efficacité relative (la productivité du travail).
Source : OFCE
Autrement dit, dans les problèmes de compétitivité que rencontre la France, les facteurs salariaux ne pèsent pas vraiment.
Sont en cause les spécialisations, l'existence de voies alternatives de pénétrations des marchés étrangers (les investissements directs comme substituts à l'exportation) et les variations du change de l'euro, toutes variables qui influencent considérablement le pacte social du travail en France et sa perception.
A. LE PARTAGE GLOBAL SALAIRES/PROFITS, UNE LARGE GAMME DE SITUATIONS MARQUÉE PAR LA DUALISATION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Le rapport de M. Jean-Philippe Cotis souligne la grande dispersion des situations de partage de la valeur ajoutée selon le secteur ou le type d'entreprise : un quart des entreprises consacre aux salaires 89 % de leur valeur ajoutée (contre 67 % en moyenne) ; un quart moins de 44 %.
Le rapport indique qu'il est difficile de déterminer si ce constat vient de données techniques (part plus ou moins élevée du capital) ou de pratiques salariales. Mais quelques éléments structurels évoqués plus haut (voir la partie du présent rapport consacrée à décrire la diversité des situations salariales en fonction des entreprises) paraissent exercer un rôle important sur les conditions de répartition de la valeur ajoutée .
A cet égard, la complexification des entreprises joue un rôle particulier .
On a observé à quel point on était passé d'une « entreprise conglomérale » à une « entreprise réticulée », c'est-à-dire d'une entreprise intégrée à une entreprise où la chaîne de production se trouve désormais segmentée avec l'intervention de filiales spécialisées ou de sous-traitants.
Ce processus paraît s'accompagner d'une différenciation accrue des situations salariales sur lesquelles les indicateurs de partage de la valeur ajoutée donnent des indications paradoxales.
Ainsi, la part de la valeur ajoutée des entreprises dominées revenant aux salaires ressort comme plus élevée que chez les donneurs d'ordre. Mais, les salaires y sont d'un niveau beaucoup plus faible .
Si, en apparence, au niveau microéconomique des entreprises, il n'existe pas de conflit entre rentabilité économique du capital et salaires, c'est en partie à des phénomènes de restructuration des entreprises que cela est dû.
|
ÉCLATEMENT DU MODÈLE DE L'ENTREPRISE
INTÉGRÉE
L'éclatement du modèle de l'entreprise intégrée en un modèle en réseau d'entreprises participant à la production d'un bien ou d'un service (des opérations les plus en amont à l'aval de la filière) ne produit pas (nécessairement) d'effets sur la valeur ajoutée à l'occasion de la production de ce bien. En revanche, elle modifie la répartition de cette valeur ajoutée entre les différents intervenants . Par la différenciation des positions de marché des entreprises résultant de la segmentation de la production, certains acteurs se trouvent à même de peser sur le prix de certains des éléments de la production. Si cette stratégie leur réussit, ils se procurent à des coûts plus bas de leurs consommations intermédiaires, ce qui augmente leur productivité. La productivité des fournisseurs baisse en contrepartie si bien que l'opération est neutre macroéconomiquement : la productivité globale ne s'élève pas. Si les salaires sont inchangés, la part des salaires dans la valeur ajoutée des fournisseurs augmente (puisque leur valeur ajoutée a baissé) tandis que pour l'entreprise « tête de pont » elle baisse (sa valeur ajoutée a augmenté). Le surplus de productivité dégagé par cette dernière entreprise peut aller aux salaires ou aux profits. Si on pose l'hypothèse qu'une partie de ce surplus va aux salaires, dans un tel cas, la part des salaires dans la valeur ajoutée de cette entreprise baisse mais les salaires s'améliorent. On peut former l'hypothèse inverse pour les entreprises dominées où la part des salaires dans la valeur ajoutée augmente mais un peu moins que, si les salaires ne s'ajustaient pas à l'inflexion de leur productivité. En revanche, les rémunérations des salariés et des détenteurs du capital de l'entreprise dominée se détériorent. Ces processus semblent particulièrement importants pour expliquer la différenciation des situations salariales. Elles font écho à la diversification des productivités au niveau microéconomique suite aux processus des restructurations des entreprises. Pourtant, macroéconomiquement, la productivité est inchangée. |
Au niveau microéconomique, la diversification des productivités résulte de plus en plus, dans une proportion qui reste à déterminer, non de l'existence de performances économiques différentes associées à des gains d'efficacité divergents des facteurs de production, mais de modifications institutionnelles qui permettent à certains d'exploiter des positions de marché plus favorables quand les autres subissent la détérioration de leur position. Ceci pose un problème manifeste d'équité.
Si l'on ajoute que le processus de segmentation de la production s'est déroulé parallèlement à la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, on mesure à quel point, sur le long terme, les situations salariales ont pu se diversifier en fonction de l'appartenance à telle ou telle entreprise.
Ce constat, qui nourrit l'ambition de restaurer les conditions de situations plus équilibrées entre entreprises, tant du point de vue de la rentabilité du capital que de celui des salaires, invite à s'interroger sur la mise en place de mécanismes tendant à restaurer un partage plus équitable de la valeur ajoutée par chacun des acteurs concourant à la production d'un bien ou service.
B. L'AFFECTATION DES PROFITS DIFFÈRE ÉGALEMENT BEAUCOUP
La diversité des situations concrètes se vérifie également au niveau des conditions d'affectation des profits.
A un niveau microéconomique, on constate une nette segmentation des entreprises qui oppose les PME et les grandes entreprises. Elle ne concerne pas tant l'investissement que les comportements financiers.
En effet, alors que le comportement d'investissement ne varie guère selon le critère de taille de l'entreprise, il joue un rôle important sur la politique de distribution des dividendes et sur les comportements de trésorerie des entreprises .
En ce qui concerne l'investissement , les situations moyennes des différentes catégories d'entreprise sont assez proches. On observe par ailleurs que ce sont les quelques entreprises qui investissent beaucoup qui « tirent » l'investissement moyen vers le haut.
INVESTISSEMENT RAPPORTÉ À LA VALEUR AJOUTÉE*
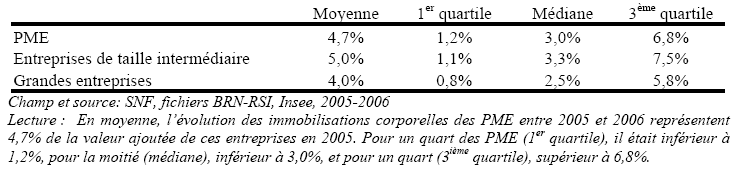
Lecture : En moyenne, l'évolution des immobilisations corporelles des PME entre 2005 et 2006 représente 4,7 % de la valeur ajoutée de ces entreprises en 2005. Pour un quart des PME (1 er quintile), elle était inférieure à 1,2 %, pour la moitié (médiane), inférieure à 3,0 %, et pour un quart (3 ème quintile), supérieure à 6,8 %.
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Ces observations contrastent avec la dispersion des conditions de répartition de la valeur ajoutée puisque les grandes entreprises dégagent des profits nettement plus élevés que les autres. Dans ces conditions, on devrait s'attendre à ce que leur investissement représente aussi une part plus importante de leur valeur ajoutée. Or, c'est l'inverse qu'on constate et c'est une confirmation de plus d'un phénomène de déliaison entre le niveau des profits et celui des investissements.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les comportements relatifs à la distribution de dividendes soient beaucoup plus diversifiés.
PART DES DIVIDENDES DANS LA VALEUR AJOUTÉE*
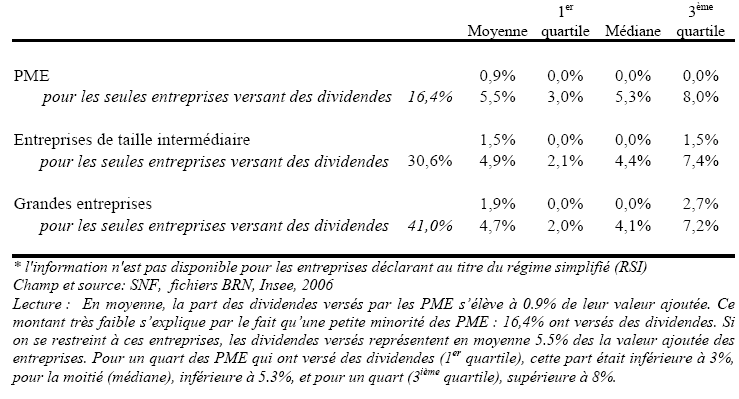
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Un très grand nombre de PME ne versent pas de dividendes 261 ( * ) ; seules 16 % d'entre elles le faisant contre 41 % des grandes entreprises. En bref, la plus grande partie des dividendes est versée par les quelques entreprises qui ont la plus forte valeur ajoutée .
Au demeurant, cette observation vaut pour toutes les composantes financières de l'EBE excepté la trésorerie.
La part de l'IS et celle des intérêts dans la valeur ajoutée augmentent avec la taille des entreprises et, pour chaque catégorie d'entreprise, la diversité des situations est de règle.
La part des intérêts dans la valeur ajoutée augmente en fonction de la taille, mais cette corrélation est d'une interprétation difficile. D'un côté, elle est attribuable à la faiblesse relative de la proportion des PME endettées (elles représentent 57,1 % des PME contre 98,4 % pour les grandes entreprises). Mais, d'un autre côté, comme pour les seules entreprises endettées, les PME sont obligées de consacrer davantage de leurs richesses à acquitter leurs charges d'intérêt, et que ceci ne semble pas résulter d'un niveau d'endettement plus élevé 262 ( * ) , c'est le coût de la dette qui est discriminant.
ENDETTEMENT FINANCIER BRUT/VALEUR AJOUTÉE AU COÛT DES FACTEURS (EN %)
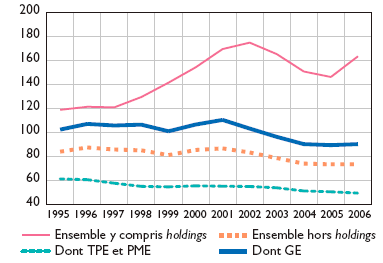
Source : Bulletin de la Banque de France n° 170. Février 2008.
L'essentiel est qu'alors que leur taux de marge (rapport de l'EBE à la valeur ajoutée) est plus élevé et leur taux d'investissement plus faible, les grandes entreprises sont celles qui versent le plus de revenus financiers à leurs créanciers et à leurs propriétaires tout en accordant à leurs salariés la plus faible part de leur valeur ajoutée.
PART DES INTÉRÊTS VERSÉS DANS LA VALEUR AJOUTÉE*
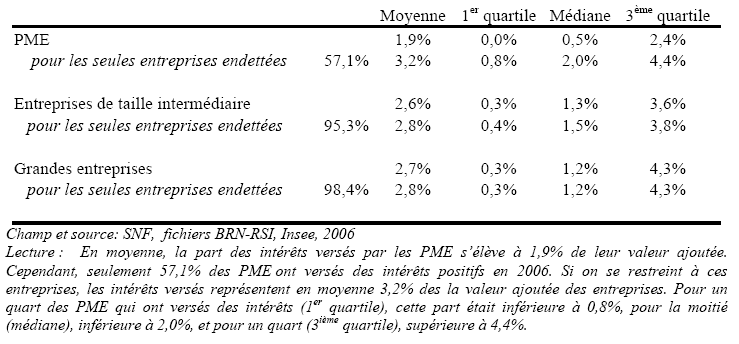
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
Les comportements de trésorerie sont à rebours de ces constats. Les PME qui sont plus rarement endettées que les grandes entreprises - « reflet d'un accès au financement bancaire difficile » selon le rapport - conservent une part importante de leurs résultats en trésorerie sans doute pour faire face à des dépenses de fonctionnement courant dans des conditions financières acceptables.
TRÉSORERIE RAPPORTÉE À LA VALEUR AJOUTÉE
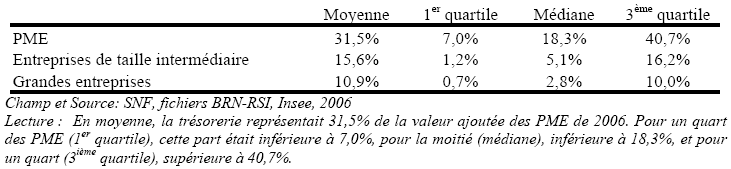
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés, c'est principalement la proportion des entreprises bénéficiaires qui varie et explique les écarts entre entreprises en fonction de leur taille.
PART DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DE LA VALEUR AJOUTÉE*
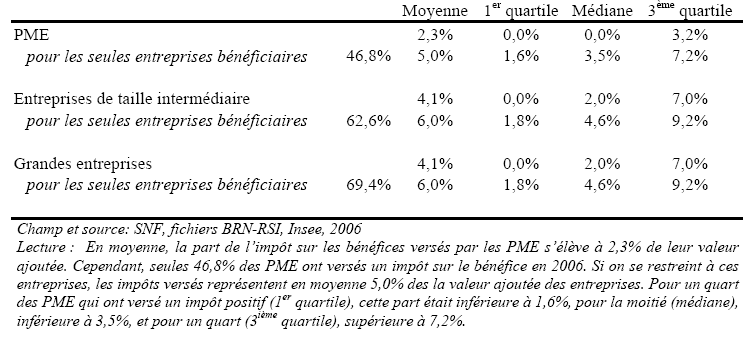
Source : Rapport sur « le partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », de M. Jean-Philippe Cotis. Mai 2009.
C. APPRÉHENDER LES PROBLÈMES DE RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE AU BON NIVEAU
La fragmentation des chaînes de valeur est une tendance forte de l'économie contemporaine qui concourt à la dualisation du salariat mais aussi aux déséquilibres de la répartition des revenus.
S'ils ne bénéficient pas de la totalité de la valeur ajoutée attraite par elles du fait de leur seule position de marché, les salariés des entreprises dominantes « profitent » partiellement de cette domination. Les salariés des entreprises dominées la subissent.
Les bénéficiaires sont les détenteurs du capital des entreprises dominantes même si leurs bénéfices ne correspondent pas toujours à des surprofits. L'existence de ceux-ci est dépendante de la situation de marché concrète que ces entreprises occupent.
Un examen systématique des marchés devrait être entrepris pour évaluer leur état alors que jusqu'ici les outils de la politique de la concurrence restent utilisés de manière « existentielle ». On peut attendre d'un tel examen la mise en oeuvre de politiques visant à un fonctionnement plus concurrentiel des marchés qui peut s'accompagner d'un rééquilibrage de la répartition de la valeur ajoutée entre les firmes mais aussi d'une baisse des prix 263 ( * ) .
Celle-ci serait favorable à des gains de pouvoir d'achat des revenus d'activité, en particulier des salaires, et à une production plus forte.
Par ailleurs, il pourrait être utile d'adapter le niveau de la négociation des salaires aux réalités économiques d'une économie marquée par un tissu productif en voie de dualisation. Ceci suppose d'identifier le niveau le plus pertinent de négociation et que des interlocuteurs représentatifs puissent animer celle-ci.
Mais, compte tenu de l'internationalisation des chaînes de production et du contexte d'ouverture mondialisée des économies, une telle orientation implique la définition d'un espace transnational de négociation, tâche qu'on devine peu aisée.
D. STABILISER LES INVESTISSEMENTS
L'un des problèmes majeurs que pose l'affectation du revenu est son réinvestissement dans la combinaison productive nationale, que ce soit sous forme matérielle ou immatérielle, aux fins d'élever la croissance potentielle.
Ce problème est particulièrement crucial pour un pays comme la France dont l'objectif doit être, dans le mouvement de redistribution mondiale des activités économiques, de rejoindre la frontière technologique. Or, cet objectif suppose d'allouer suffisamment de moyens pour développer le stock de capital ce qui suppose un prélèvement sur le revenu mais aussi des investissements soutenus en quantité mais aussi dans le temps.
Une telle allocation du revenu pose manifestement problème dans les conditions actuelles de répartition du revenu national et de mobilisation de l'épargne : le taux d'investissement n'a pas suivi l'élévation du taux de marge des entreprises, l'effort de recherche et développement est stagnant, les moyens consacrés à la formation du capital humain sont, soit insuffisants, soit remis en cause, alors que l'employabilité, qui devrait être une priorité, nécessite une mise à niveau dans un contexte de montée en gamme impérative des activités de production.
Avant d'évoquer quelques voies d'amélioration, il faut s'interroger sur la question de l'adéquation entre le niveau de l'épargne et les investissements nécessaires.
Il existe en France un véritable paradoxe de l'épargne .
|
LE PARADOXE FRANÇAIS DE L'ÉPARGNE Sur la base d'équations purement comptables, le déficit extérieur d'un pays peut s'analyser comme le résultat d'une insuffisance d'épargne. Il montre que la demande domestique y excède les capacités du système productif local à la satisfaire 264 ( * ) . Ainsi, en France, le déficit extérieur observé depuis plusieurs années témoignerait d'une insuffisance d'épargne. Pourtant, le taux d'épargne des ménages français est l'un des plus élevés du monde développé tandis que l'évolution du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits montre que les entreprises ont réuni les conditions nécessaires à la disposition d'une épargne abondante. Or, cette relative abondance, combinée avec le plafonnement du taux d'investissement, qui devrait avoir favorisé le respect de l'équilibre extérieur, après avoir un temps permis aux entreprises de dégager une capacité de financement, les laisse aujourd'hui en situation de besoin de financement et s'accompagne d'un besoin de financement de la Nation. Le besoin de financement de la Nation étant égal à la somme des besoins de financement des différentes catégories d'agents économiques, on pourrait voir dans le besoin de financement de la Nation le résultat du besoin de financement des administrations publiques. Mais, si, de fait, les administrations publiques ont connu un déficit public année après année, cette analyse serait erronée. En effet, hors la période récente où les déficits publics ont été gonflés par la crise globale, ils n'ont jamais connu une dégradation suffisante pour expliquer à eux seuls le besoin de financement de la Nation. Sans doute y ont-ils contribué dans la mesure où l'épargne des administrations publiques n'a pas été suffisante au cours de ces années pour couvrir le financement de l'investissement mais, leur contribution a été loin d'être exclusive. La baisse du taux d'épargne des entreprises (rapport de leur épargne à leur valeur ajoutée) passé entre 2000 et 2006 de 16,5 à 12,7 % (- 3,8 points de leur valeur ajoutée) largement dû à leurs stratégies financières (augmentation des revenus versés aux actionnaires, recours à l'endettement...) et apparemment pas à un accroissement du stock de capital productif national (le taux d'investissement des entreprises est resté stable) a autant compté que la dégradation des comptes des administrations publiques. Le potentiel d'épargne des entreprises françaises a été absorbé par des stratégies financières qui ont augmenté leur recours à l'endettement sans profiter au socle productif national. Autrement dit, une partie des efforts des agents économiques localisés en France paraît structurellement distraite du circuit économique national. Il est donc important de réintroduire cette épargne potentielle dans le circuit de production française. |
Les conditions d'une disponibilité abondante de l'épargne semblent réunies. Mais, la mobilisation de l'épargne pour renforcer la base productive présente plus de difficultés .
Ce constat semble faire l'objet d'un consensus et les propositions abondent pour remédier à une situation très peu satisfaisante.
Un récent rapport du Conseil d'analyse économique 265 ( * ) s'attache à proposer les moyens propres à favoriser l'investissement de l'épargne dans des projets de long terme, ce afin de répondre au court-termisme des investisseurs et à ses effets sur la gestion des firmes. On renvoie à ses dix propositions dont les unes tendent au développement de l'offre de capitaux longs par les ménages, dont les autres concernent le cadre de la gestion de l'épargne par les investisseurs de long terme, et les dernières la place des partenariats publics/privés.
Pour utile que soit l'examen détaillé de ces propositions, elles ne sauraient se substituer à la nécessaire mise en place d'un cadre macroéconomique plus favorable à l'investissement productif. Celui-ci implique de réfléchir à un partage de la valeur ajoutée qui concilie de meilleures perspectives de demande et le renforcement des capacités de production.
De ce point de vue, la répartition des revenus de la croissance, sujet sur lequel le Président de la République avait souhaité que s'ouvre un débat, doit être au coeur d'un pacte social et économie de progrès .
Sur ce point, compte tenu des tendances oligopolistiques de l'économie française, il n'est pas évident que l'élévation du taux de marge de certaines grandes entreprises ne soit pas un obstacle majeur à un recyclage des revenus propice à une plus forte croissance.
Autrement dit, si la question de l'utilisation de leur excédent brut par certaines entreprises se pose, devrait aussi être posée celle de la répartition de l'EBE entre les différentes entreprises localisées en France .
Une résolution des déséquilibres du circuit économique, qui peut enfin passer par l'augmentation des revenus des ménages tout à fait compatible, sous certaines conditions, avec le financement de l'investissement national, suppose un projet concerté entre Etats européens de développement analogue. Faute d'accord entre eux, le cadre macroéconomique risque d'être structurellement dissuasif pour une affectation des revenus épargnés à l'investissement sur leurs territoires, en plus que d'être défavorable à la demande nécessaire pour consolider les perspectives de l'investissement.
Enfin, dans le projet d'une refonte de la fiscalité, toute mesure visant à favoriser la conciliation entre une demande dynamique et une épargne suffisamment consacrée à améliorer l'efficacité productive en France devrait être prioritairement examinée .
IV. RENFORCER LE RÔLE DES MÉCANISMES DE REDISTRIBUTION : UN INSTRUMENT IMPOSSIBLE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE FISCALE EN EUROPE ?
Une des recommandations fréquemment formulées pour moderniser les rapports sociaux dans l'entreprise consiste à aller plus loin dans la dérégulation, des marchés des facteurs de production notamment, en réservant à la redistribution l'objectif de promouvoir un niveau d'égalité donné.
Dans cette perspective, plus généralement, la répartition globale de la valeur ajoutée, et la répartition au sein de ses deux grandes composantes - les salaires, les profits - devraient être laissées au libre jeu des marchés :
• la répartition de la valeur ajoutée
entre salaires et profits devrait résulter du libre fonctionnement des
marchés de facteurs de production. Elle s'établirait alors
à son point d'équilibre optimal ;
• de même, la fixation du niveau individuel de
salaire ou de rémunération du capital ne devrait dépendre
que des mécanismes de marché.
Les questions à envisager dans ce cadre de réflexion - qui visent à restaurer le libre jeu des mécanismes de marché - sont très nombreuses et particulièrement complexes. On se bornera ici à celle initialement posée de la place que peut occuper la redistribution. Mais, il faut relever que la proposition générale de dérégulation recouvre d'autres aspects. Par exemple, elle comporte le voeu que la plus entière liberté soit laissée aux choix d'allocations des revenus (salaires et profit) en évitant d'instaurer des cadres impliquant de possibles distorsions ou encore que les choix de financement de l'investissement soient réalisés dans un contexte de neutralité fiscale.
S'agissant du travail, l'éventail des recommandations visant à restaurer les conditions de marché idéales est assez large. Il va de la disparition du rôle des syndicats dans les négociations salariales - perspective qui semble extrême mais qui, dans les faits, est parfois vérifiée comme lorsque les salaires sont fixés indépendamment de toute référence à une norme collective - jusqu'à des remises en cause du rôle de l'Etat, notamment dans la détermination d'un salaire minimum.
En théorie, il serait possible de remédier aux inégalités primaires par des systèmes de redistribution passant par les transferts publics, passant, soit par les impôts (qui peuvent être plus ou moins redistributifs), soit par les dépenses publiques.
Mais, dans les faits, les mécanismes de redistribution paraissent mis à l'épreuve .
S'agissant du partage global de la valeur ajoutée entre salaires et profits , on pourrait envisager de corriger la répartition primaire par des prélèvements sur les profits des entreprises réalisés à travers l'imposition des sociétés.
On n'entrera pas ici dans une discussion détaillée, pourtant essentielle, des effets réels d'une augmentation des prélèvements sur les bénéfices des entreprises, notamment sur la dynamique des salaires et sur la répartition de la valeur ajoutée.
Il faut cependant mentionner que deux résultats radicalement différents sont envisagés :
- dans le premier, l'incidence ultime d'un alourdissement de l'impôt sur les profits est reportée sur les salariés si bien que la part des salaires dans la valeur ajoutée peut aller jusqu'à baisser contrariant les effets redistributifs attendus d'une telle mesure ;
- dans le second, les propriétaires du capital sont ceux qui supportent l'incidence de l'impôt et l'objectif redistributif peut être atteint à travers l'utilisation des recettes ainsi dégagées.
Les deux résultats diffèrent donc radicalement du fait d'appréciations différentes des réactions que déclencherait la mesure. Or, ces différences d'appréciation proviennent de considérations contrastées sur de nombreux éléments du contexte économique et social : la nature des profits (existence ou non de surprofits), l'élasticité de la combinaison productive, la capacité de défendre un objectif de rentabilité du capital, la situation du marché de l'emploi, les effets de l'ouverture des économies, les perspectives de croissance...
Parmi les très nombreuses variables importantes, on remarquera tout particulièrement : l'éloignement entre les situations concrètes des agents économiques et la situation qu'ils occuperaient dans le cadre d'un fonctionnement de marché où la concurrence pure et parfaite serait respectée et le degré d'ouverture des économies pour ses effets sur la mobilité du capital.
Sur le premier point, il n'y a pas de raison de penser que les inégalités observées dans le pouvoir de marché des différents agents économiques, dont les effets sur les conditions de distribution des revenus primaires ont été envisagés précédemment, pourraient avoir des conséquences très différentes sur la distribution de la charge fiscale.
Quant au second point, la mobilité du capital paraît avoir été largement intériorisée par les décideurs et, dans un contexte marqué par la concurrence fiscale, les données relatives à l'impôt sur les sociétés n'invitent pas à un grand optimisme sur la capacité des Etats à régler le partage de la valeur ajoutée par cet instrument.
Sans doute, le produit de l'impôt sur les sociétés a-t-il augmenté dans l'OCDE depuis 1981 (de 2 à 3 points de PIB).
PART DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DANS LE PIB
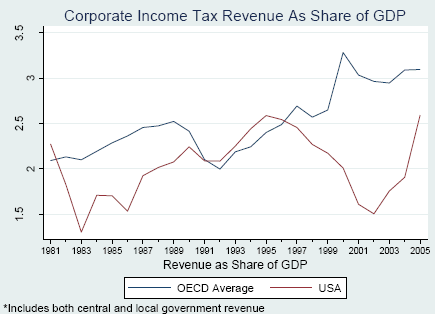
Source : Les impôts dans le monde : une brève histoire de la politique fiscale (1981-2007)
Mais cette augmentation ne semble pas avoir suivi entièrement celle de l'assiette de l'imposition des bénéfices qui a été particulièrement forte, en lien notamment avec la déformation du partage de la valeur ajoutée.
Sans doute aussi est-il observable que le niveau des recettes résultant de l'imposition des entreprises est variable. Mais, cette situation ne paraît pas correspondre à l'existence de taux différenciés. Plus précisément, les pays dans lesquels le produit de l'impôt sur les bénéfices des entreprises est élevé sont aussi des pays où les taux sont bas, ce qui paraît démontrer, au moins partiellement, l'efficacité comptable de la concurrence fiscale.
Au demeurant, il existe un mouvement mondial de réduction des taux marginaux d'imposition des sociétés (avec des exceptions comme, semble-t-il, aux Etats-Unis).
ÉVOLUTION DES TAUX MARGINAUX D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
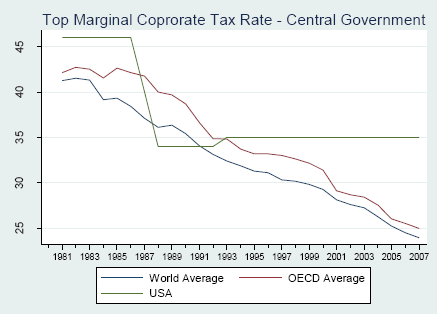
Source : Les impôts dans le monde : une brève histoire de la politique fiscale (1981-2007)
Ce processus est également à l'oeuvre en Europe où les taux légaux supérieurs ont connu un déclin continu.
ÉVOLUTION DU TAUX LÉGAL SUPÉRIEUR D'IMPÔT SUR LES ENTREPRISES (1995-2010)
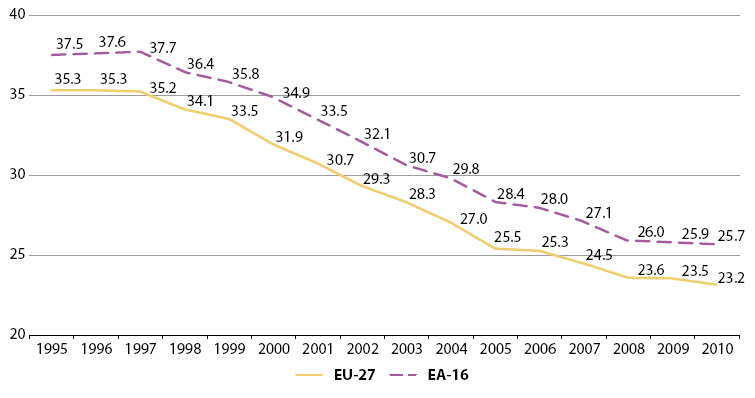
Source : Tendance des impositions dans l'Union européenne - 2010. Eurostat
La France n'a pas fait cavalier seul puisque de 41,7 % en 1997 le taux d'impôt y a été ramené à 34,4 % en 2010, mais elle se trouve à un niveau de taux relativement élevé dans l'ensemble européen.
COMPARAISON DES TAUX SUPÉRIEURS LÉGAUX
D'IMPÔT
SUR LES ENTREPRISES EN EUROPE EN 2010
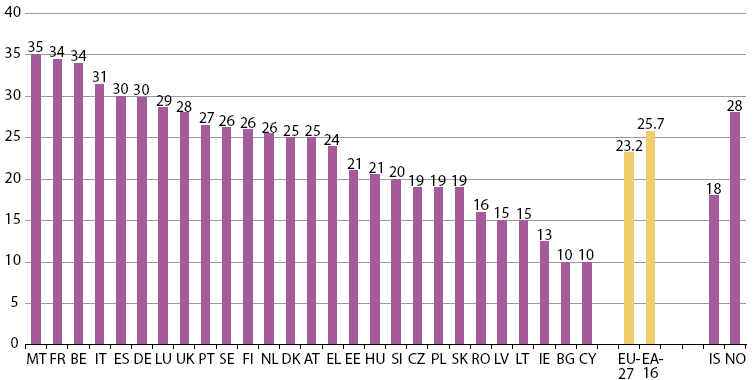
Source : Tendance des impositions dans l'Union européenne - 2010. Eurostat
Avec 34 % (arrondi), la France a un taux marginal d'impôt supérieur de 4 points au taux allemand et de 8 points par rapport à la Suède.
Cette singularité se vérifie quand on compare les taxations implicites du capital en Europe , comparaison qui porte sur des données plus complètes que le taux supérieur légal d'imposition des sociétés :
• elles incluent d'autres impositions sur le revenu
du capial comme l'imposition des revenus de l'épargne des
ménages ;
• elles sont corrigées des « effets
d'assiette » qui du fait de la diversité des règles de
détermination des bases d'imposition peuvent associer à un taux
apparent donné un taux effectif d'imposition très
différent.
ÉVOLUTION DES TAUX IMPLICITE D'IMPOSITION DU CAPITAL EN EUROPE 1995-2008
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Belgique |
25.6 |
27.0 |
28.3 |
30.4 |
31.3 |
29.6 |
29.5 |
30.7 |
31.6 |
32.7 |
32.8 |
33.1 |
31.8 |
32.7 |
|
Danemark |
29.9 |
30.9 |
31.7 |
38.7 |
38.6 |
36.0 |
31.0 |
30.8 |
36.9 |
45.9 |
49.9 |
44.6 |
47.0 |
43.1 |
|
Allemagne |
21.8 |
24.9 |
23.8 |
25.1 |
28.3 |
28.4 |
21.9 |
20.3 |
20.3 |
20.5 |
21.5 |
23.4 |
24.5 |
23.1 |
|
Estonie |
14.1 |
9.3 |
10.5 |
11.6 |
9.2 |
6.0 |
4.9 |
6.4 |
7.8 |
8.1 |
7.7 |
8.2 |
9.2 |
10.7 |
|
Irlande |
14.9 |
16.8 |
17.9 |
19.5 |
21.2 |
18.6 |
15.7 |
|||||||
|
Grèce |
19.9 |
17.7 |
17.7 |
16.4 |
16.0 |
16.8 |
15.8 |
|||||||
|
Espagne |
29.8 |
28.3 |
30.0 |
30.3 |
32.7 |
36.5 |
40.7 |
43.4 |
32.8 |
|||||
|
France |
32.5 |
35.5 |
36.2 |
36.3 |
38.8 |
38.3 |
38.7 |
37.4 |
36.5 |
37.9 |
39.2 |
40.9 |
39.8 |
38.8 |
|
Italie |
27.4 |
27.8 |
31.4 |
28.8 |
30.5 |
29.5 |
29.0 |
29.1 |
31.5 |
29.8 |
29.5 |
33.8 |
35.3 |
35.3 |
|
Pays-Bas |
21.6 |
23.7 |
22.7 |
22.9 |
23.0 |
20.8 |
22.6 |
24.3 |
21.0 |
20.4 |
18.2 |
17.1 |
15.9 |
17.2 |
|
Autriche |
27.1 |
30.0 |
30.0 |
30.3 |
28.7 |
27.7 |
36.2 |
29.6 |
28.6 |
27.6 |
24.7 |
24.9 |
26.3 |
27.3 |
|
Portugal |
21.8 |
24.4 |
27.4 |
28.0 |
30.5 |
33.6 |
31.7 |
33.5 |
32.2 |
28.2 |
29.4 |
31.9 |
35.0 |
38.6 |
|
Finlande |
28.0 |
30.5 |
31.3 |
32.6 |
32.1 |
36.1 |
25.5 |
27.5 |
25.9 |
26.4 |
26.9 |
23.9 |
26.4 |
28.1 |
|
Suède |
19.9 |
27.0 |
29.8 |
30.2 |
36.1 |
43.2 |
34.0 |
29.1 |
30.1 |
28.7 |
35.7 |
29.2 |
32.9 |
27.9 |
|
Royaume-Uni |
34.6 |
34.2 |
36.1 |
38.4 |
41.8 |
44.7 |
45.6 |
41.6 |
36.9 |
38.3 |
40.5 |
43.1 |
42.9 |
45.9 |
|
Europe à 16 |
||||||||||||||
|
Moyenne pondérée (PIB) |
26.0 |
28.1 |
28.6 |
28.7 |
30.6 |
30.2 |
28.1 |
27.6 |
27.6 |
27.9 |
28.8 |
30.9 |
31.5 |
29.8 |
|
Moyenne arithmétique |
23.9 |
25.3 |
25.5 |
26.0 |
26.6 |
26.5 |
25.6 |
25.6 |
25.3 |
25.1 |
25.9 |
26.9 |
28.2 |
27.2 |
Source : Eurostat
Sur la base des données ici mentionnées, avec un taux de 38,8 % en 2008, la France ressort comme un des pays où l'imposition implicite du capital est la plus élevée 266 ( * ) .
On relèvera :
• la situation de l'Allemagne et des Pays-Bas
où ce taux apparaît comme particulièrement faible au vu du
développement du capital ;
• l'existence d'une assez grande diversité des
taux implicites de taxation du capital en Europe, et même dans des pays
réputés partager des modèles redistributifs analogues
(ainsi du Danemark et de la Suède) ;
• la forte imposition implicite du capital au
Royaume-Uni
267
(
*
)
.
Incidemment, on peut mentionner qu' il est a priori surprenant de trouver des valeurs d'imposition implicite du capital si différentes dans un espace où la liberté des capitaux est totale . Sans doute existe-t-il quelques difficultés de construction des indicateurs. Peut-être encore faut-il se référer à des différences structurelles dans les actifs considérés. Par exemple, il est possible que les actifs des entreprises soient moins taxés que ceux des ménages et que la valeur comparée des uns et des autres varie selon les pays.
Les différences de taxation implicite peuvent aussi s'expliquer par l'existence d'une certaine illusion fiscale ou par des taux de rendement du capital avant impôts différenciés.
En toute hypothèse, la convergence des taux d'imposition vers le bas est une réalité que ne vérifie pas seulement l'imposition des sociétés. Elle concerne aussi les taux marginaux d'imposition des ménages . Or, dans ces conditions, toute singularité fiscale de la France risque à terme, sauf à être compensée par des singularités de l'économie réelle allant dans le sens opposé, de devoir être démantelée.
Ce constat paraît poser un défi à l'instrument de redistribution par les transferts publics au sein d'un salariat dont on a constaté la différenciation.
La baisse des taux marginaux d'imposition des revenus a été constante.
ÉVOLUTION DES TAUX MARGINAUX D'IMPÔT SUR
LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES EN EUROPE (1995-2010)
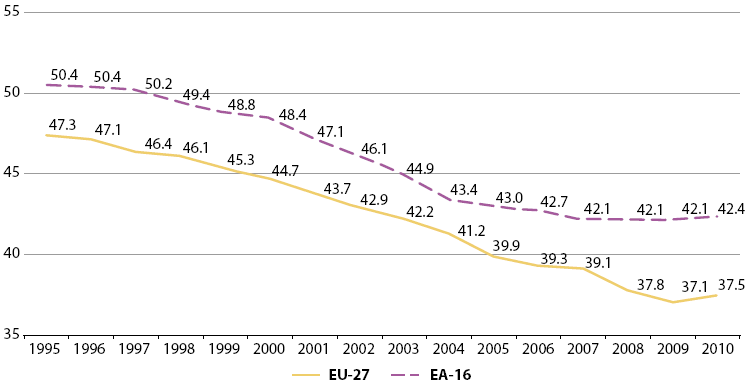
Source : Tendance des impositions dans l'Union européenne - 2010. Eurostat
On relèvera que, dans ces conditions, la hausse du taux implicite d'imposition du capital mentionnée plus haut pourrait refléter un pic cyclique qui aurait vu les revenus des actifs connaître un dynamisme inhabituel plutôt qu'être le résultat de politiques fiscales qui indiquent plutôt suivre des orientations contraires, d'allègement de l'imposition du capital.
La France a particulièrement réduit son taux marginal supérieur d'imposition.
TAUX MARGINAUX SUPÉRIEURS D'IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES (1995-2010)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Belgique |
60.6 |
60.6 |
60.6 |
60.6 |
60.6 |
60.6 |
60.1 |
56.4 |
53.7 |
53.7 |
53.7 |
53.7 |
53.7 |
53.7 |
|
Danemark |
63.5 |
62.0 |
62.9 |
61.4 |
61.1 |
59.7 |
59.6 |
59.8 |
59.8 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
|
Allemagne |
57.0 |
57.0 |
57.0 |
55.9 |
55.9 |
53.8 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
47.5 |
44.3 |
44.3 |
47.5 |
47.5 |
|
Estonie |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
24.0 |
23.0 |
22.0 |
21.0 |
|
Irlande |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
46.0 |
46.0 |
44.0 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
41.0 |
41.0 |
|
Grèce |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
42.5 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
Espagne |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
43.0 |
43.0 |
|
France |
59.1 |
59.6 |
57.7 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
58.3 |
57.8 |
54.8 |
53.4 |
53.5 |
45.8 |
45.8 |
45.8 |
|
Italie |
51.0 |
51.0 |
51.0 |
46.0 |
46.0 |
45.9 |
45.9 |
46.1 |
46.1 |
46.1 |
44.1 |
44.1 |
44.9 |
44.9 |
|
Luxembourg |
51.3 |
51.3 |
51.3 |
47.2 |
47.2 |
47.2 |
43.1 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
|
Pays-Bas |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
Autriche |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
Portugal |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
|
Finlande |
62.2 |
61.2 |
59.5 |
57.8 |
55.6 |
54.0 |
53.5 |
52.5 |
52.2 |
52.1 |
51.0 |
50.9 |
50.5 |
50.1 |
|
Suède |
61.3 |
61.4 |
54.4 |
56.7 |
53.6 |
51.5 |
53.1 |
55.5 |
54.7 |
56.5 |
56.6 |
56.6 |
56.6 |
56.4 |
|
Royaume-Uni |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
EU-27 |
47.3 |
47.1 |
46.4 |
46.1 |
45.3 |
44.7 |
43.7 |
42.9 |
42.2 |
41.2 |
39.9 |
39.3 |
39.1 |
37.8 |
|
EU-25 |
47.5 |
47.3 |
46.9 |
46.3 |
45.7 |
45.0 |
44.1 |
43.6 |
42.8 |
41.8 |
41.4 |
40.9 |
40.6 |
39.8 |
|
EA-16 |
50.4 |
50.4 |
50.2 |
49.4 |
48.8 |
48.4 |
47.1 |
46.1 |
44.9 |
43.4 |
43.0 |
42.7 |
42.1 |
42.1 |
Source : Eurostat
Dans ces conditions, les niches fiscales jouant également, le taux d'imposition 268 ( * ) moyen des revenus des personnes à très hauts revenus apparaît faible à 20 % .
Pour les revenus de 2007, la dernière tranche d'imposition, à laquelle est appliqué un taux d'imposition de 40 %, concerne les revenus supérieurs au nombre de parts multiplié par 67 546 euros. En appliquant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les revenus des plus aisés devraient donc, en grande partie, être imposés à 40 % (à 36 % en considérant les abattements). Or, pour les personnes très aisées et les personnes les plus aisées, le poids de l'imposition, même s'il est un peu plus important que pour les autres personnes à très hauts revenus, est de l'ordre de 25 % seulement. Cela représente, en moyenne, 270 000 euros par an pour les personnes les plus aisées. Manifestement, les réductions d'impôt et déductions fiscales contribuent à diminuer le taux moyen d'imposition.
Les situations des personnes à très hauts revenus face à l'impôt sont cependant variées. Pour les personnes aisées, la dispersion des taux d'imposition est relativement faible, une grande majorité des personnes ayant un taux d'imposition des revenus déclarés compris entre 15 et 25 %. Pour les personnes les plus aisées, dont on a déjà constaté l'hétérogénéité des revenus, la dispersion est beaucoup plus forte. En effet, presqu'un quart des plus aisés a un taux d'imposition des revenus déclarés inférieur à 15 %, et plus d'un autre quart un taux d'imposition supérieur à 35 %.
MOYENNE DES TAUX D'IMPOSITION
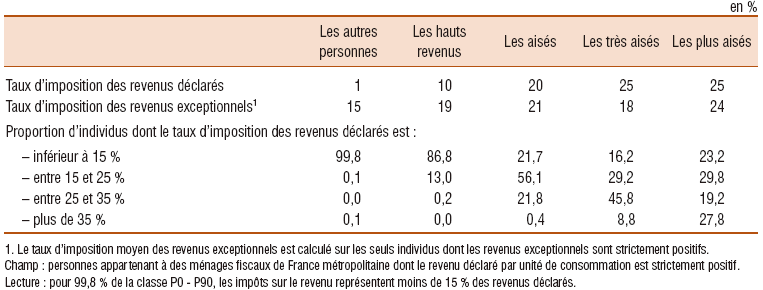
Source : INSEE. Dossier « Les très hauts revenus : des différences de plus en plus marquées... »
Si le système fiscal est appelé à exercer des effets redistributifs, les dépenses publiques peuvent aussi jouer ce rôle 269 ( * ) . On peut même se demander si ce rôle n'est pas d'autant plus essentiel que le système de prélèvements obligatoires est moins redistributif.
Or, l'étiolement des marges de manoeuvre fiscales dans un contexte de compétitivité fiscale risque de rendre incompatible cette fonction avec la perspective nécessaire de rééquilibrer les comptes publics.
V. ADAPTER LE RÉGIME DU SMIC ?
L'existence d'un salaire minimum est souvent mentionnée comme l'une de ces « institutions » du marché du travail français qui freinerait la production (et la croissance) et nuirait à la résorption du chômage.
C'est pourquoi des réformes du SMIC plus ou moins radicales sont parfois proposées (notamment par les « experts ») avec des effets pratiques inégaux 270 ( * ) .
Il n'est pas exclu que le SMIC ait des effets ambigus. Pour autant, toute réforme du SMIC ne saurait produire des effets favorables et tolérables que sous des conditions qui ne semblent pas entièrement réunies.
|
PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
L. 3231-2 - Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° la garantie de leur pouvoir d'achat ; 2° une participation au développement économique de la Nation. L. 3231-4 - La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire. L. 3231-5 - Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. L. 3231-6 - La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1 er janvier. L. 3231-8 - En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail. L. 3231-9 - Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution de conditions économiques générales et des revenus. |
|
LIBRE SYNTHÈSE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ANALYSE
ÉCONOMIQUE (CAE)
Dans son rapport de 2008, consacré au salaire minimum et aux bas revenus, le Conseil d'analyse économique fait trois grandes préconisations destinées à réformer les politiques publiques en faveur des bas revenus. Ces propositions sont assises sur trois considérations d'ensemble : L'uniformité réglementaire du SMIC français en contraste avec les institutions adoptées à l'étranger (des régimes conventionnels et souples des minimas salariaux) pose problème. « Son mode de revalorisation » (du SMIC) diffère sensiblement de ceux qui sont mis en oeuvre dans de nombreux pays où le salaire minimum est fixé soit par voie conventionnelle soit par voie légale, mais en admettant généralement des minima différents par âge, secteur, profession ou région. Une telle situation déresponsabilise les partenaires sociaux en réduisant l'espace conventionnel et l'intérêt de la négociation collective. L'inefficacité du SMIC comme instrument de lutte contre les inégalités, en particulier contre la pauvreté « Le salaire minimum n'est pas un instrument efficace de lutte contre les inégalités. L'idée selon laquelle le salaire minimum réduit les inégalités à un coût moindre pour la société que des politiques fiscales redistributives (qui prélèvent des impôts et versent des prestations sociales) est erronée. En réalité, la politique du salaire minimum légal uniforme et élevé comprime la distribution des salaires et contribue à réduire le dialogue social, sans grande efficacité pour lutter contre la pauvreté. Afin d'éviter les effets défavorables d'un SMIC élevé, d'importantes ressources publiques sont actuellement mobilisées sous forme d'allègements de charges sociales ciblés sur les bas salaires. Une autre approche permettrait, sans préjudice pour l'emploi, de déployer tout ou partie de ces ressources dans des prestations conditionnelles à l'activité, plus adaptées à la réduction des inégalités, tout en laissant une plus forte place à la négociation collective. » Les effets discriminants du SMIC pour les jeunes d'autant qu'il s'accompagne d'une absence de politiques ciblée de réduction de la pauvreté « Ce sont surtout les jeunes qui pâtissent d'une politique de soutien des bas revenus fortement adossée au salaire minimum et faisant peu de place à une politique fiscale cohérente ciblée vers la réduction de la pauvreté. En France, les jeunes sont condamnés à une double peine : le salaire minimum contribue à les exclure de l'emploi plus que leurs aînés et leur inéligibilité au RMI jusqu'à l'âge de 25 ans limite leurs ressources lorsqu'ils ne peuvent accéder à l'emploi. Ainsi, la proportion de pauvres est une fois et demie plus élevée parmi les personnes âgées de 18 à 24 ans que parmi celles de 25 à 54 ans. »
Les propositions du rapport sont
présentées comme autant de remèdes à ces
diagnostics qui ne sont pas consensuels. L'accent est mis sur la mise en oeuvre
de dispositifs plus efficaces pour réduire les inégalités
et lutter contre la pauvreté en donnant une place importante au dialogue
social et à des mécanismes de redistribution
Il s'agit de passer à une situation caractérisée par : - un mode de détermination des salaires planchers qui permet de prendre en compte la diversité des situations économiques des salariés et des entreprises, ce qui fait jouer un rôle de premier plan à la fixation des minima conventionnels par la voie de la négociation collective. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de profondément modifier les règles actuelles de détermination du salaire minimum ; - une amplification de la politique fiscale ciblée sur l'amélioration des bas revenus et la réduction de la pauvreté. La redistribution qu'elle opérerait serait principalement fonction du revenu d'activité et de la situation familiale . Cette politique fiscale devrait par ailleurs ne pas avoir d'effet négatif sur l'offre de travail , comme c'est le cas actuellement du fait de son extrême complexité et du faible gain financier associé à une augmentation de l'activité pour les personnes les moins qualifiées travaillant à temps partiel. La réforme des règles de revalorisation du salaire minimum Un préalable est posé. La réforme du salaire minimum ne doit pas être synonyme d'une baisse du pouvoir d'achat des personnes à bas revenus. Le soutien du pouvoir d'achat des bas revenus par des mesures fiscales est, au contraire, jugé moins coûteux socialement qu'une politique reposant exclusivement sur le salaire minimum. Par exemple, les hausses du SMIC effectuées entre 1971 (instauration du SMIC) et 2002 (avant le processus de convergence des minima salariaux) sont présentées comme répondant à des motivations politiques de court terme qui ont orienté les hausses du SMIC sans considération sérieuse pour les effets néfastes à long terme sur l'emploi, le dialogue social et la cohérence d'ensemble du système fiscal si bien qu'à l'avenir, il est souhaitable de choisir des règles garantissant une évolution du salaire minimum cohérente avec des préoccupations de moyen et long terme et avec l'ensemble de la politique fiscale . Il est préconisé d' intégrer les revalorisations du SMIC aux projets de loi de finances (cette proposition ne semble pas en phase avec l'idée de décentraliser et de contractualiser les évolutions des salaires). De même, la création d'une commission d'experts chargée de donner un avis sur les revalorisations du SMIC et des minima sociaux est préconisée. Cette recommandation a trouvé une issue concrète dans la création d'un groupe d'experts sur le SMIC (loi du 3/12/2008). Mais le souhait de voir le mandat d'une commission « salaire minimum » ne pas se limiter à l'étude des conséquences des modifications du salaire minimum et d'intégrer l'ensemble des politiques de soutien aux bas revenus a-t-il été satisfait ? Il ne le semble pas. Les règles de revalorisation automatique du SMIC seraient caduques 271 ( * ) excepté pour les revalorisations infra-annuelles. Seule subsisteraient les revalorisations du salaire minimum lorsque l'indice des prix à la consommation hors tabac dépasse d'au-moins 2 % le dernier indice pris en compte lors de la précédente revalorisation. Les deux autres modalités actuelles de revalorisation du salaire minimum (automatique sur la moitié des gains de pouvoir d'achat du salaire horaire ouvrier et discrétionnaire par les « coups de pouce ») disparaîtraient. La réforme des minima sociaux et des prestations devrait conduire, quant à elle, à : - unifier les minima sociaux afin d'améliorer leur lisibilité, - et à en étendre le bénéfice aux jeunes de 18 à 25 ans présentés comme subissant actuellement de plein fouet les défauts du système actuel. L'objectif d'unification des minima sociaux et des prestations liées à l'activité a été retenu dans la logique du revenu de solidarité active (RSA) appelé à remplacer par un dispositif unique la prime pour l'emploi (au moins en partie), le revenu minimum d'insertion (l'allocation de parent isolé et d'autres transferts sociaux comme le complément de libre choix d'activité ainsi que les dispositifs transitoires d'intéressement à la reprise d'activité qui y sont associés ?). Cette unification est vue comme un moyen d'amélioration de la lisibilité des prestations et des impôts pour mieux cibler les publics en difficulté. Elle permettrait de rendre plus transparent le lien entre le revenu d'activité et le revenu disponible, après impôts et prestations . |
A. LE SMIC, UN FACTEUR DE RIGIDITÉ POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ?
Il y a de nombreux arguments pour réformer le SMIC ou, du moins, lui restituer son rôle initial de minimum salarial. On peut estimer que tout salaire minimum limite la production, crée du chômage et exerce des effets inéquitables sur les salariés, soit en réduisant certains de ceux-ci au chômage, soit en limitant la rémunération d'autres salariés en-deçà de leur productivité propre.
1. Le SMIC limiterait le volume des emplois et contribuerait au chômage notamment à celui des non-qualifiés
En situant le coût du travail à un seuil minimum élevé, le SMIC découragerait la production de biens et services qui, si leurs prix étaient plus bas, seraient demandés. Plus globalement, toutes les offres qui reposent sur des productivités marginales du travail inférieures au SMIC sont appelées à disparaître. En outre, en élevant le coût des biens et services, le SMIC altère la compétitivité des entreprises consommatrices, ce qui est défavorable à la création d'emplois.
Le SMIC contribue ainsi au chômage, notamment des peu qualifiés. Premièrement, les offres d'emplois peu qualifiés sont limitées. Deuxièmement, les salariés peu qualifiés passent aux derniers rangs dans la file d'attente que représente le chômage, car les employeurs leur préfèrent des salariés qualifiés, même pour ces emplois.
Il en résulte incidemment des phénomènes de surqualification qui sont synonymes de frustrations mais aussi de gaspillage de capital humain.
Ces processus seraient d'autant plus à l'oeuvre que
l'économie d'aujourd'hui est globalisée et expose les
salariés peu qualifiés à la concurrence des pays à
bas coûts de la main d'oeuvre. Cette concurrence tend d'ailleurs à
se renforcer au sein même des pays développés puisque si
certains d'entre eux ont mis en place un salaire minimum parfois
élevé (le Royaume-Uni), dans beaucoup d'autres, les salaires
minima sont très faibles (faisant d'ailleurs naître une
catégorie de plus en plus vaste de travailleurs pauvres
- cf.
l'Allemagne).
2. L'assouplissement du SMIC permettrait en outre de retrouver un système plus harmonieux des salaires
Le SMIC serait « payé » par les salariés du milieu de la distribution. De plus en plus de salariés « tombent » dans le SMIC, ce qui d'ailleurs pose pour l'avenir le problème de la revalorisation du salaire minimum. Par ailleurs, le salaire médian est rattrapé par le SMIC, ce qui signifie que ses revalorisations sont compensées par une inertie relative des autres salaires.
Sous contrainte de plafonnement du coût du travail les augmentations du SMIC doivent être compensées par la stagnation des autres salaires. Seuls échappent à cette dernière contrainte les hauts salaires, que ce soit pour des raisons économiques (la rareté des compétences disponibles ; le niveau élevé de la productivité de cette catégorie de salariés...), ou pour des raisons sociologiques (la communauté d'origine, la proximité avec les actionnaires...).
L'assouplissement du SMIC entraînerait un élargissement de l'échelle des salaires qui restaurerait les incitations au travail, et les conditions d'une mobilité salariale ascendante plus fluide. Il permettrait de redonner du sens à la négociation des salaires qui est aujourd'hui bloquée par l'absence de « grain à moudre » une fois le SMIC revalorisé.
3. Dans ces conditions une réforme du SMIC peut apparaître équitable d'autant que le SMIC est aujourd'hui « subventionné »
Le SMIC pose un triple problème du point de vue de l'équité :
- s'il a des effets défavorables sur les non-qualifiés (en particulier, les jeunes non qualifiés), cela signifie que les « effectifs sous SMIC » exercent un effet d'éviction du marché du travail sur une partie de la population, la plus vulnérable (évictions des outsiders par les insiders ) ;
- en déconnectant la rémunération de la productivité des salariés, il peut favoriser des comportements de passager clandestin puisque rémunération et efficacité sont en partie déliées 272 ( * ) . Par ailleurs, les efforts de qualification ne sont pas encouragés dans toute la plage d'emplois qui correspondent à une rémunération au SMIC 273 ( * ) ;
- enfin, en élevant le prix des biens et services généralement ordinaires, le SMIC peut contribuer à limiter l'accès à des « aménités » qui s'adressent principalement aux publics les moins fortunés.
Ces problèmes d'équité sont d'autant plus sensibles que le SMIC fait l'objet d'un quasi-subventionnement.
C'est ainsi qu'on peut apprécier les exonérations de cotisations sociales qui sont appliquées autour du salaire minimum. Ainsi, non seulement le SMIC exerce-t-il des effets de freinage des rémunérations supérieures à lui mais encore celles-ci se voient-elles imposer des cotisations sociales supérieures à ce qu'elles seraient sans les exonérations en question qui visent à compenser des effets du SMIC sur le coût du travail à ce niveau.
En pratique, le subventionnement du SMIC est d'autant plus accentué que s'ajoute la prime pour l'emploi ou le RSA, du moins pour les salariés à temps partiel.
B. DES ARGUMENTS À CONSIDÉRER SOIGNEUSEMENT MAIS DONT L'ISSUE NE PARAÎT PAS DEVOIR ÊTRE UNE RÉFORME RADICALE DU SMIC
L'opportunité d'une réforme du SMIC est évidemment discutée.
Ses effets favorables sur l'emploi sont notamment suspendus à la vérification qu'une partie du chômage est explicable par un coût du travail trop élevé.
Ses conséquences sur le salariat sont incertaines, notamment dans un contexte où la négociation collective des salaires peut être déséquilibrée, tandis que les mécanismes de redistribution n'offrent pas de garantie d'efficacité.
Les effets du SMIC sur la production passent par une analyse du sous-emploi. Or, l'analyse du chômage distingue usuellement au moins deux formes de sous-emplois :
- le « chômage classique » résultant d'un coût du travail trop élevé qui limite les possibilités d'emploi ;
- le « chômage keynésien » qui provient d'une offre bridée par une demande insuffisante.
Les deux explications peuvent se cumuler : une partie du chômage relevant d'un coût du travail excessivement élevé, l'autre étant plutôt keynésienne.
L'assouplissement du SMIC est cohérent avec une configuration du chômage classique. En revanche, il est inefficace pour lutter contre le chômage keynésien et est même de nature à l'aggraver.
La composition du chômage, entre chômage classique et chômage keynésien, fait partie des questions les plus controversées à l'image de celle portant sur le niveau du taux du chômage structurel.
En lien notamment avec la modération salariale, l'enrichissement de la croissance en emplois ainsi qu'inversement la persistance du chômage paraissent plaider pour l'existence d'une composante classique du chômage.
Dans le sens contraire, la flexibilité du chômage à la baisse dans les périodes d'accélération de la croissance économique montre que la croissance a de forts effets sur le chômage et qu'alors le niveau des salaires ne représente pas un obstacle à la création d'emplois. Ceci jette un doute sur les estimations pessimistes du niveau du chômage structurel qui pourrait être sensiblement moins élevé que les 9 % évoqués dans différentes analyses aux méthodes plus ou moins convaincantes.
De même, les expériences étrangères fournissent des résultats ambivalents : l'introduction d'un salaire minimum porté à un haut niveau au Royaume-Uni ne paraît pas y avoir pénalisé l'emploi tandis que l'instauration d'emplois à très faibles rémunérations en Allemagne est citée comme un facteur de résistance de ce pays contre le chômage.
La question n'est donc pas vraiment tranchée même si différents leviers de politique ont été mobilisés pour réduire le coût du travail sans réforme du SMIC en profondeur. Ainsi en va-t-il des exonérations de charges sociales au niveau du SMIC qui permettent de délier la rémunération nette perçue par les salariés de la charge qu'elle représente pour les employeurs.
Dans le même sens, différentes tentatives ont été faites pour assouplir pour certaines catégories de salariés l'application du SMIC. Ainsi, du CNE et du CPE.
Il est d'ailleurs à observer qu'au total, le niveau relatif du salaire minimum par rapport au salaire médian est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était au milieu des années 70.
RATIO DU SMIC AU SALAIRE MÉDIAN (1959-2006)
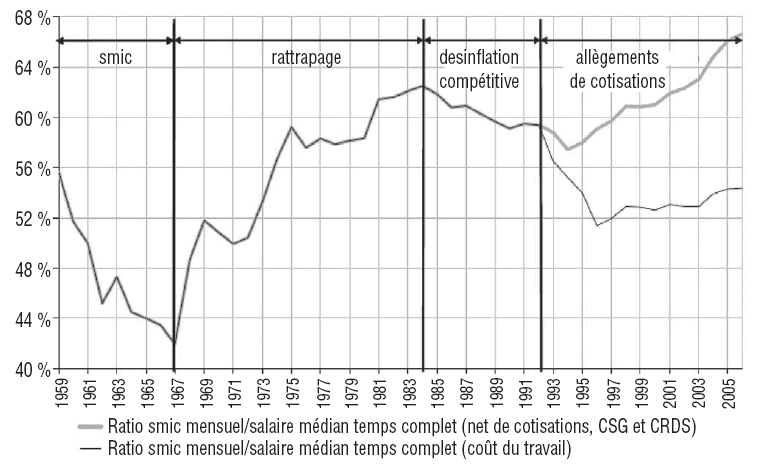
Note : sur la période 1998-2006, le salaire minimum considéré correspond à la moyenne des situations des salariés à 35 heures et à 39 heures, pondérées par leurs poids respectifs.
Source : DGTPE, « Le smic », conférence emploi, pouvoir d'achat, 23 novembre 2007
Ainsi, au niveau des entreprises, il n'est pas évident que l'assouplissement du SMIC soit une urgence même si d'un point de vue social la concentration des dépenses fiscalo-sociales, au bénéfice des salaires au SMIC et autour, pose un problème d'équité.
En outre, de même que les exonérations de cotisations sociales peuvent parfois comporter des effets d'aubaine , toute réforme déréglementant le SMIC pourrait entraîner de tels effets , d'autant que les négociations salariales paraissent marquées par une inégalité des positions des parties à la négociation, défavorable aux salariés.
L'application d'une règle générale a le mérite, parfois ambigu, de résoudre un problème économique classique : celui des effets en termes de distribution du bien-être de l'asymétrie d'information entre des cocontractants. En l'absence de règle, chacun d'eux tend à dissimuler ses préférences : ici, l'employeur ne révèlera pas le salaire auquel il consentirait pour employer le salarié et celui-ci ne dévoilera pas le vrai prix auquel il estime son renoncement au loisir ou la contrepartie de ses efforts. Or, sur un marché du travail où il existe du chômage, et compte tenu des connaissances supérieures de l'employeur sur sa situation, il y a toutes chances pour qu'il existe une asymétrie d'informations jouant au détriment des salariés. En imposant un salaire minimum, l'Etat agit comme régulateur et rétablit un certain équilibre de cette information en obligeant les employeurs à révéler leurs préférences.
Cela peut ne pas être bénéfique macroéconomiquement si le superviseur fixe une référence trop élevée. Mais, du moins, en ce cas, la rente de l'employeur résultant de son niveau particulier d'information est réduite, voire supprimée.
Cet acquis n'est pas négligeable pour l'équilibre de la répartition du revenu national, notamment dans une situation qui, comme celle d'aujourd'hui, est caractérisée par une complexification de la structure productive, par un chômage réduisant les possibilités de négociation des salariés et par une segmentation du marché du travail où les salariés ont des capacités très inégales notamment du fait d'une insuffisante mobilité.
Toute baisse du SMIC, plutôt que d'entraîner davantage de production et plus d'emplois, pourrait se traduire par une érosion supplémentaire de la part salariale dans la valeur ajoutée .
Un tel enchaînement, qui s'accompagnerait d'une élévation du nombre des travailleurs pauvres, serait particulièrement difficile à compenser, dans un contexte où les mécanismes de redistribution sont difficiles à mobiliser.
Et, il n'est pas acquis étant donné les secteurs concernés, fortement concurrencés par les pays à bas salaires et pas nécessairement très intensifs en capital, que l'amélioration du rendement économique de celui-ci apporte beaucoup plus d'investissements et de croissance à une économie française dont l'avenir est plutôt de se spécialiser dans les secteurs très productifs à haut niveau de qualification de la main d'oeuvre.
Au total, l'assouplissement du SMIC s'il devait être démontré qu'il puisse avoir des vertus sur le niveau de l'emploi et de la production semble ne pas devoir représenter une solution généralisable à un problème qui n'apparaît pas général.
Toutefois, le recours à des situations salariales marquées par la perception de salaires inférieurs au SMIC n'est pas à exclure d'emblée d'autant que, dans les faits, de telles situations ne sont pas rares si l'on se base sur une norme de SMIC mensuel. De nombreux salariés à temps de travail atypiques connaissent une position salariale de cette nature. En outre, une approche prospectiviste ne peut ignorer que la diffusion de bas salaires dans des pays voisins (l'Allemagne, par exemple) risque de peser sur le maintien d'un salaire minimum comparativement élevé en France. Dans ces conditions, il serait utile de prendre la mesure de la contrainte économique s'exerçant sur les conditions de rémunération du travail peu qualifié mais aussi de la resituer dans une perspective de progrès. Autrement dit, l'éventuel assouplissement du SMIC devrait être non seulement ciblé mais encore accompagné de la perception de revenus de compensation et d'un projet personnalisé visant à garantir une meilleure employabilité des personnes concernées à des conditions salariales plus favorables.
Au demeurant, plus globalement, c'est bien à un enrichissement des qualifications que la prospective invite afin que le capital humain des salariés réponde mieux aux conditions de la valorisation du travail dans une économie soumise à la nécessité de redistribuer ses activités productives pour faire face aux nouvelles demandes susceptibles de lui être adressées dans un contexte économique mondialisé où il importe plus que jamais de valoriser ses avantages comparatifs.
*
* *
Au total, l'intuition que les facteurs les plus mobiles (capital, travail « très qualifié »...) qui sont les plus à même de défendre leurs positions dans la distribution des revenus primaires sont aussi ceux qui peuvent le mieux les défendre relativement aux systèmes de redistribution secondaire du revenu paraît confirmée par les évolutions des structures fiscales des pays développés.
Ces tendances limitent la redistributivité des systèmes fiscaux mais aussi, compte tenu des contraintes de soutenabilité budgétaire, les facultés de financer des dépenses publiques destinées à égaliser les conditions et/ou à produire des biens publics. Si l'on considère que les dépenses publiques peuvent jouer un rôle important de rééquilibrage et de dynamisation de la croissance économique, on mesure les effets de la concurrence fiscale.
Or, celle-ci n'a sans doute pas produit l'ensemble de ses « potentialités » :
- les écarts de taux effectifs d'imposition de capital n'ont sans doute pas encore été entièrement traduits dans la réallocation des stocks de capital, qui prend du temps ;
- ces écarts pourraient encore s'accentuer dans un contexte où, le recours à l'endettement pour financer l'investissement étant mois facile, l'attraction de l'épargne serait, encore plus qu'aujourd'hui, un enjeu fort pour les entreprises ;
- cette perspective s'imposerait d'autant plus que les Etats, notamment européens, pourraient diverger dans leurs stratégies économiques et sociales, soit par des « croyances » différentes dans les vertus de tel ou tel modèle, soit par des capacités inégales à convaincre leurs populations des mérites de telle ou telle orientation...
Manifestation d'une rivalité entre Etats, la concurrence fiscale semble désarmer le projet de résoudre les difficultés économiques et sociales résultant d'une distribution primaire des revenus sous-optimale par le recours aux transferts publics.
Seul un rapprochement politique des Etats pourrait desserrer cette contrainte.
En interne, il est encore possible d'identifier et de mobiliser les quelques marges de manoeuvre qu'offre malgré tout la réforme fiscale. Mais, sans doute faut-il aussi compter sur l'acclimatation de nouvelles formes d'action publique. On a mentionné la détermination d'un bon niveau de négociation des salaires. On évoque, dans le même sens, ci-après des mécanismes de gouvernance réformée allant dans le sens d'une meilleure prise en compte des équilibres du pacte social du travail ainsi que des procédés de certification sociale maîtrisés.
CHAPITRE II : TROUVER UN NOUVEL ÉQUILIBRE ENTRE AUTONOMIE ET SÉCURITÉ POUR LES SALARIÉS
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Une inflexion sociale du management et de l'organisation du travail ? Outre une plus grande implication des salariés dans la « conduite du changement » et des formations au management sensibilisant au besoin de respecter et soutenir les collaborateurs, l'intéressement du « top management », exclusivement financier, pourrait être diversifié au profit d'indicateurs de « performance sociale ». Cette démarche s'assortirait d'une responsabilisation financière des entreprises pour leurs externalités sociales négatives , notamment en termes de chômage ou de maladie. Un procédé de labellisation pourrait avertir les clients de la conformité des conditions de production à certains standards sociaux, par exemple dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Ces évolutions pourraient amorcer un reflux de la « tyrannie des clients » sur l'organisation du travail, ces derniers pondérant le rapport qualité-prix des biens et services par la réputation sociale des entreprises. Un objectif d'employabilité réellement poursuivi ? D'importants efforts seraient déployés pour placer les salariés en situation d'assumer financièrement et professionnellement les conséquences des mobilités requises dans une économie ouverte, adaptable et compétitive. A coté de l'assurance chômage et d'un accès au logement facilité, l' employabilité des personnes deviendrait l'axe majeur d'une « flexisécurité » de pointe, qualifiable de « mobication 274 ( * ) ». Un véritable pilotage de la formation professionnelle française serait organisé en vue d'optimiser continuellement l'employabilité des salariés et des chômeurs. Le système donnerait toute sa mesure pour les personnes à faible « capital humain » (sur le marché du travail), atténuant les phénomènes de mobilité subie par des « outsiders » à l'employabilité souvent déclinante. Aiguillonnées, le cas échéant, par une obligation juridique de préserver l'employabilité de leurs salariés, les entreprises s'orienteraient, en synergie, vers une gestion plus responsable des emplois et des formations de leurs salariés via une authentique GPEC. Dans ce scénario, le volontarisme politique s'étendrait à l'Europe car seule une politique de croissance coordonnée, basée sur la consommation et l'investissement, parviendrait à résorber un fort chômage « keynésien ». Sans quoi certains seront toujours moins « employables » que d'autres... |
Ces trente dernières années, les leviers déterminant l'équilibre entre sécurité et autonomie des salariés dans l'entreprise ont évolué. On peut, au prix d'une certaine schématisation, avancer la représentation suivante :
• Dans la régulation fordiste, la
sécurité des salariés résidait dans la
sécurité de l'emploi globalement procurée par des
entreprises soucieuses de les fidéliser et l'existence d'une forte
demande de main d'oeuvre peu qualifiée, ainsi que des
rémunérations dont les pouvoirs publics s'employaient à
organiser l'orientation à la hausse.
Cette évolution des salaires était permise par les gains de productivité engendrés par le progrès technique et des économies d'échelle, avec la prégnance d'organisations du travail de type taylorien caractérisées par une faible autonomie des salariés.
Ces gains de productivité suffisaient à garantir la compétitivité globale d'un appareil productif encore peu inclus dans la mondialisation et soumis à de moindres exigences financières.
• Dans le mode de régulation actuel,
l'exposition croissante de l'appareil de production à une concurrence
internationale aguerrie s'est accompagnée de la diffusion
d'organisations du travail à flux tendus afin de procurer la
flexibilité nécessaire à la réalisation de nouveaux
gains de productivité.
La souplesse et l'intelligence requise de la part de ces organisations productive requièrent toute l'implication et les capacités d'initiative du personnel, qui dispose à cet effet de nouvelles marges d'autonomie et se voit parallèlement fixer des obligations de résultat en lieu et place d'obligations de moyens.
L'accélération des mutations des combinaisons productives ne permet plus de garantir l'emploi au sein d'entreprises pérennes, dont le contrôle étroit des coûts de production par des détenteurs de capitaux plus mobiles et soucieux de rentabilité à court terme, tend au versement - hormis pour les qualifications les plus rares - de rémunérations moins progressives, évolution qui apparaît cohérente d'un point de vue aussi bien microéconomique (les rapports de force sur le marché du travail deviennent globalement plus favorables aux entreprises) que macroéconomique (les exportations peuvent constituer un débouché massif).
• Dans ce nouveau paradigme, les leviers
d'action sur l'équilibre du salarié, c'est-à-dire sur les
degrés respectifs d'autonomie et de sécurité dont il
jouit, connaissent un
déplacement.
D'une part, la sécurité ne peut plus résulter de carrières et d'emplois plus ou moins garantis, mais du maintien de l' employabilité , dont la réalité repose d'abord sur des initiatives publique et conventionnelles, une entreprise n'étant pas spontanément encline à endosser une responsabilité coûteuse - les formations sont chères - dont le bénéfice se situerait globalement en dehors de son périmètre.
Cette inflexion des politiques, de la protection de l'emploi du salarié à la protection de son employabilité, peut être désignée sous le vocable de « flexisécurité », concept largement indéterminé comme on le verra.
D'autre part, une certaine autonomie a du être accordée aux salariés afin de permettre, corrélativement, leur responsabilisation progressive sur les résultats. Aujourd'hui, le débat ne se situe plus tant autour de la responsabilisation des salariés que sur la réalité de leur autonomie dans des organisations qui tendent à les enserrer dans un faisceau de contraintes étroites pour garantir l'adaptation d'une production fréquemment renouvelée de biens ou services à une demande fluctuante, tout en satisfaisant à diverses exigences normatives, de reporting ou de coordination.
L'organisation du travail et le management se trouvent ainsi au coeur de la tension entre flexibilité de la production et autonomie du salarié.
RÉSULTANTE DE LA NOUVELLE
RÉGULATION
POUR L'ÉQUILIBRE DU SALARIÉ
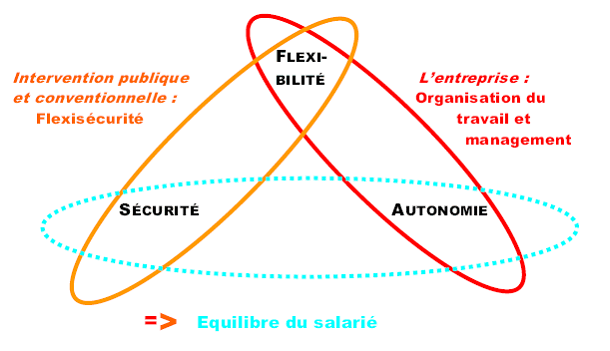
Source : services des études économiques du Sénat
Ainsi, pour conjurer l'approfondissement du « mal-être » des salariés sans s'abstraire des impératifs concurrentiels, deux leviers principaux, constituant autant de facteurs d'émancipation du scénario tendanciel , sont susceptibles de rééquilibrer leur situation : d'une part, les pratiques attenantes à l' organisation du travail , dont certaines s'avèrent dommageables et, d'autre part, les politiques orientées vers la flexisécurité .
I. UNE INFLEXION SOCIALE DU MANAGEMENT ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL ?
On recensera ici les voies d'amélioration susceptibles d'être empruntées afin de préserver l'autonomie et la dignité de salariés oeuvrant au sein d'entreprises soumises à des impératifs de productivité et de flexibilité que des organisations du travail « au plus juste », assorties d'un management obnubilé par des objectifs financiers, sont souvent destinées à satisfaire. Elles tournent autour des thématiques de reconnaissance et de participation.
A. UNE IMPLICATION DU PERSONNEL DANS LA « CONDUITE DU CHANGEMENT »
Bien que, selon la doxa managériale d'aujourd'hui, l' instauration autoritaire de nouvelles organisations s'avère généralement néfaste pour les salariés -et donc décevante pour les entreprises 275 ( * ) - ( supra ), aucun texte ne débouche sur une implication incontournable du personnel sur les choix organisationnels, la plupart des employeurs estimant qu'ils ressortissent au champ de leurs prérogatives exclusives.
Pourtant, d'aucuns estiment qu'une implication, voire une association systématique des représentants du personnel à la réflexion sur les évolutions envisagées dans l'entreprise serait préférable. Par exemple, Henri Rouilleaut 276 ( * ) estime que « l' association des salariés directement concernés et des représentants du personnel à la conduite du changement sous des formes variables selon les types d'entreprise est une nécessité .
« Au-delà de la capitalisation des bonnes pratiques de certaines entreprises, la négociation d'un accord-cadre interprofessionnel sur la conduite du changement, à décliner dans les branches et les entreprises , serait bienvenue ».
L'association des salariés n'est pas sans exemple à l'étranger et l'on indiquera qu'en Allemagne, « en ce qui concerne les changements d'organisation du travail, l'employeur ne peut pas prendre une décision ayant des conséquences sur le travail des salariés sans l'accord préalable du comité d'entreprise. Le comité d'entreprise participe ainsi aux décisions relatives aux heures de travail, pauses et d'éventuelles heures supplémentaires. Le comité d'entreprise peut par ailleurs, lors d'un changement dans la nature de l'activité, dans le processus de fabrication ou de l'environnement de travail, entraînant une charge de travail supplémentaire, réclamer des mesures appropriées pour supprimer, atténuer ou compenser cette charge » 277 ( * ) .
Une telle perspective ne s'avèrerait réellement porteuse de changement qu'à la condition d'être accompagnée d'une modification des modalités et des équilibres de la négociation sociale. A cet égard, il serait souhaitable que les représentants , notamment syndicaux, soient formés aux questions de changements organisationnels , sans que ces derniers doivent recourir systématiquement à des experts 278 ( * ) .
En effet, ce type d'intervention compliquerait singulièrement la démarche et pourrait les conduire à amalgamer, dans une certaine confusion, mission d'expertise et défense des intérêts des salariés.
Enfin, au quotidien, le management devrait expliquer systématiquement , le cas échéant, les raisons conduisant à imposer aux salariés des contraintes nouvelles , quelles qu'elles soient.
B. UN MANAGEMENT RESPONSABLE ET RESPONSABILISÉ...
L'enjeu est ici de réconcilier, au quotidien, les salariés avec un management qui s'avère parfois - spécifiquement dans les organisations « au plus juste » - trop orienté par des logiques financières et ignorant de la dimension spécifique des ressources humaines.
1. Une meilleure formation au management
L'accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, signé à l'unanimité des partenaires sociaux, relève qu'« une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des responsables hiérarchiques et des salariés réduisent la probabilité des cas de survenance de harcèlement et de violence au travail » .
Les partenaires sociaux observent qu'aujourd'hui, « la formation au management proposée dans les différentes écoles ou universités ne prend pas suffisamment en compte la formation à la conduite des équipes. Aussi, ces programmes de formation doivent davantage intégrer la dimension relative à la conduite des hommes et des équipes, et aux comportements managériaux 279 ( * ) . Cette sensibilisation et cette formation passent par la mobilisation des branches professionnelles qui mettront en place les outils adaptés à la situation des entreprises de leur secteur professionnel .
« Ainsi, les outils nécessaires pourront être élaborés afin de favoriser la connaissance des employeurs et des salariés des phénomènes de harcèlement et de violence au travail et de mieux appréhender leurs conséquences au sein de l'entreprise ».
Par ailleurs, les formations au management devraient insister sur la nécessité de préserver une certaine autonomie des salariés, dont on sait qu'elle se trouve compromise par la superposition des contraintes propre aux nouveaux modes de production.
Enfin, il n'apparaîtrait pas inutile, d'après certains représentants syndicaux, de former le management au dialogue social, cette préconisation générale prenant un relief particulier, si les représentants du personnel devaient, un jour, être associés à la conduite du changement dans l'entreprise.
On observera que l'intégration progressive de la « responsabilité sociale de l'entreprise » ( infra ) dans les cursus des écoles de commerce 280 ( * ) est susceptible de favoriser ou consolider certaines des orientations précédentes.
2. Une inflexion de l'intéressement financier
Dans le cadre d'une « corporate governance » actionnariale tempérée, pondérant son tropisme pour la rentabilité financière par une attention nouvelle portée à la dimension sociale de l'entreprise, le « top management » 281 ( * ) ne devrait plus être massivement - sinon exclusivement - intéressé à la valorisation financière des entreprises (intéressement que permet notamment le mécanisme des stock-options).
Des indicateurs sociaux 282 ( * ) fondés, par exemple, sur l'accidentologie et la morbidité au travail, ou sur la fréquence du recours aux formes de travail les plus précaires, pourraient systématiquement contribuer au calcul des primes allouées au « top management » 283 ( * ) . Ces indicateurs seraient susceptibles d'être déclinés auprès de l' encadrement intermédiaire .
Il est à noter que, dans la mouvance de la « responsabilité sociale de l'entreprise » ( infra ), certaines firmes ont d'ores et déjà engagé ce type d'inflexion en termes d'intéressement financier 284 ( * ) .
|
UNE TENTATIVE D'ACCLIMATATION D'INDICATEURS SOCIAUX À FRANCE TELECOM Pour prévenir les risques de suicide, France Télécom a décidé de mettre en oeuvre un « nouveau contrat social ». Présenté, le 21 septembre 2010, il met l'accent sur la formation des 12.000 cadres du groupe, leur mode de rémunération et leurs marges de manoeuvre. En application de ce « contrat », 30 % de la rémunération variable des 700 plus hauts cadres de France Telecom doivent être indexés sur des indicateurs de « performance sociale ». Deux indicateurs de référence seraient appliqués dès le second semestre 2010 : un baromètre général de satisfaction des salariés de France Télécom, et le taux d'absentéisme du secteur supervisé par le cadre 285 ( * ) . |
3. Une responsabilisation des entreprises au titre de certaines externalités sociales négatives
Selon le principe du « pollueur payeur », l'entreprise pourrait être amenée à supporter de façon plus individualisée les risques spécifiques engendrés par une gestion de la ressource humaine par trop dédiée au respect des « flux tendus », que ces risques concernent l'intégrité physique et psychique de ses salariés, ou leur situation au regard de l'emploi.
• Une
responsabilisation plus forte des
entreprises
pour leurs résultats en termes d'
accidents
du travail
et de
maladies professionnelles
286
(
*
)
pourrait inciter le
management à
pondérer
plus
systématiquement l'ampleur des
objectifs fixés aux
salariés
par les
risques physiques et psycho-sociaux
que leur réalisation peut entraîner.
L'emprunt d'une telle orientation, suggérée par certaines centrales syndicales, peut, en partie, tirer argument de l'expérience américaine, ainsi qu'elle est rapportée dans « Les désordres du travail » ( op. cit ) par Philippe Askénazy.
Les Etats-Unis, qui avaient adopté, une dizaine d'année avant l'Europe, les nouvelles formes organisationnelles, ont initialement connu une hausse similaire des accidents et maladies du travail, pour assister ensuite à une baisse spectaculaire de ces sinistres, de l'ordre du tiers.
Ce reflux s'expliquerait parce que syndicats et organismes publics se sont mis à publier des informations sur la sinistralité des entreprises, faisant peser sur certaines d'entre elles le risque d'un discrédit quant à leur stratégie de communication sur la qualité, tandis que dans le même temps, les assureurs revoyaient leurs primes (fonction du risque potentiel dans l'entreprise) à la hausse pour les « mauvais élèves ».
En bref, « les « forces de marché » et la contrainte financière ont fait passer de nombreuses entreprises d'un équilibre nocif (faible investissement sur la sécurité et la santé/fort coût des accidents et maladies) à un équilibre vertueux (sensibilisation/coût maîtrisé) ».
En France, de nouvelles règles de tarification AT-MP (qui doivent s'appliquer à partir de 2012 287 ( * ) ) font évoluer les modalités de responsabilisation des entreprises dans le sens, semble-t-il, d'une plus grande réactivité de la tarification à leur sinistralité.
|
L'INDIVIDUALISATION TARIFAIRE DE LA COUVERTURE DU
RISQUE AT/MP
La tarification appliquée aux entreprises de faible effectif est collective et dépend de l'activité exercée, mais à partir de 10 salariés (20 salariés à compter de 2012), la tarification s'individualise à mesure que l'effectif s'élève, pour prendre progressivement en compte les frais occasionnés par les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus dans l'entreprise au cours des trois dernières années. L'individualisation tarifaire devient complète à partir de 200 salariés (150 salariés à compter de 2012), à l'exception de majorations de taux correspondant à quelques risques demeurant mutualisés (le coût des accidents de trajet, les frais de fonctionnement et un reversement à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration des sinistres ainsi que certains transferts vers d'autres régimes et les fonds dédiés à la prise en charge spécifique des salariés exposés à l'amiante). En application des nouvelles règles, la « part individuelle », calculée pour chaque entreprise en fonction de sa sinistralité, du taux de cotisation qui lui est appliqué, ne sera plus calculée sur la base du coût effectif de chaque sinistre pris isolément, mais sur la base d'une grille de coûts moyens dépendants de la gravité des sinistres. En réduisant les délais entre un sinistre et sa prise en compte dans le calcul des taux de cotisation, cette tarification veut refléter plus rapidement l'évolution de la sinistralité d'une entreprise, et inciter davantage à la prévention. |
Outre le problème de la responsabilisation des TPE, le cadre AT-MP demeure largement inadapté à la prise en compte des risques psychosociaux, un nombre singulièrement faible de dépressions nerveuses parvenant à être reconnues comme maladies professionnelles 288 ( * ) .
• La même démarche pourrait
être appliquée au
comportement des entreprises en termes
d'embauche précaire ou de licenciement
, au regard du coût
collectif engendré par l'indemnisation du chômage.
D'ores et déjà, des systèmes d'« experience rating » (personnalisation des risques) sont appliqués aux Etats-Unis en matière de cotisations de chômage.
|
LA RESPONSABILISATION DES ENTREPRISES POUR LE RISQUE DE
CHÔMAGE
Les Etats-Unis sont le seul pays de l'OCDE ayant largement recours à une taxe sur les licenciements pour financer les indemnités d'assurance-chômage versées aux travailleurs licenciés. En pratique, les cotisations de sécurité sociale des entreprises sont en partie modulées en fonction de leurs pratiques antérieures ou de leurs antécédents en matière de licenciements. Au niveau de chaque Etat, le taux de cotisation d'une entreprise est déterminé sur la base des prestations de chômage versées aux salariés qu'elle a récemment licenciés. Les modalités de calcul des taux de cotisation patronale et l'étendue des risques financés par les cotisations varient cependant selon les Etats. En 2002, la part prise en charge par les employeurs s'est ainsi échelonnée de 72 % dans le New Hampshire à 14 % en Géorgie, le solde étant implicitement financé par les recettes fiscales générales. Source : OCDE, 2004 |
M. Francis Kramarz 289 ( * ) , auditionné par la Délégation à la prospective, suggère ainsi d'étudier l'idée de faire cotiser davantage les employeurs qui sollicitent le plus les assurances chômage ou ceux qui ont recours aux durées de contrat les plus courtes.
Pour s'adapter à un marché dual, ce type de responsabilisation devrait, en effet, dépendre des allocations de chômage versées, non seulement en conséquence du licenciement de salariés en CDI, mais encore à la suite de contrats courts non renouvelés.
D'après M. Bruno Coquet 290 ( * ) , il semblerait qu'en l'état actuel, les modalités de l'assurance chômage française puissent être précisément considérées comme favorisant les firmes utilisatrices de contrats courts, qui « peuvent tirer avantage de la flexibilité sans en payer le prix et, en plus, bénéficier d'une subvention indirecte ».
« En effet, si au sein d'un même secteur coexistent des contrats longs et des contrats courts dont le coût salarial horaire et la productivité sont identiques, les firmes qui utilisent la flexibilité des contrats courts ont in fine des coûts de production plus faibles, permettant l'accroissement de leur part de marché et / ou de leur taux de profit. Ces effets sont exacerbés pour l'intérim, car l'avantage est d'autant plus grand que les contrats sont courts et permettent un large cumul allocations/salaire ».
C'est pourquoi, afin de neutraliser ces effets indésirables, Bruno Coquet estime que les règles d'assurance-chômage « devraient inciter les entreprises à internaliser le coût de la gestion de leur main-d'oeuvre , en modulant les contributions à l'assurance chômage : une cotisation dégressive avec la durée observée du contrat permettrait de bien cibler le risque de récurrence au chômage, qui est d'autant plus fort que la durée du contrat est faible ». Un tel système s'appliquerait alors à tous les contrats (CDI, CDD ou intérim).
Quelles qu'en soit les modalités concrètes, « l'experience rating » constitue probablement une voie d'avenir pour résoudre, dans un cadre micro-économiquement efficace, le problème de la responsabilisation des entreprises pour les conséquences sociales de la gestion de leurs effectifs. Dans cette éventualité, il serait probablement utile de s'atteler à la construction et au renseignement d'indicateurs pertinents de stabilité de l'emploi ; d'aucuns 291 ( * ) expriment qu' « avec toutes les limites inhérentes à la définition d'indicateurs, on peut cependant espérer possible, à la différence de certaines critiques formulées parfois à l'encontre de l'importation du principe américain d'experience rating, que soient mis en place des indicateurs permettant d'évaluer la stabilité de l'emploi et la nature des licenciements opérés (volontaires ou contraints, technique ou financier...) et de faire de cette évaluation une connaissance commune et partagée permettant de soutenir « l'esprit collectif de l'emploi » .
D'une façon générale, l'acclimatation ou l'approfondissement de dispositifs de responsabilisation « sociale » 292 ( * ) ne pourraient que favoriser une inflexion « sociale » de l'intéressement des cadres qui trouverait ici une légitimation financière immédiate.
4. Une formalisation de la responsabilité sociale de l'entreprise
Afin de donner corps à une responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) 293 ( * ) qui, pour être assez répandue dans les grandes entreprises, forme un ensemble encore trop flou, indéfini et déterminé de façon largement unilatérale, le recours à un procédé de labellisation facultative pour les entreprises permettrait d'avertir leurs clients de la conformité des conditions de production à certains principes 294 ( * ) .
Dans cette perspective, une « charte » ou un « code » de bonne conduite managérial inspiré par une certaine « éthique » du management, pourrait être élaboré par les partenaires sociaux puis proposé à l'adhésion des chefs d'entreprise.
Les conditions d'adhésion ou de labellisation pourraient porter sur l' ensemble des problématiques inhérentes à l'entreprise où le management est partie prenante (stress, harcèlement...). Elles comprendraient, par exemple, certaines prescriptions réalisant quelques unes des orientations évoquées dans le présent rapport : association des salariés à la conduite du changement, formation à un management « humain » des responsables hiérarchiques, quotité d'intéressement « social » dans l'intéressement des managers, voire responsabilité du maintien de l'employabilité des salariés...
Afin qu'une entreprise voulant exercer - et afficher - cette bonne conduite ne soit pas indifférente aux conditions de travail régnant à sa périphérie, les conditions d'éligibilité s'appliqueraient non seulement à l'entreprise candidate, mais aussi, en tout ou partie, à ses sous-traitants et fournisseurs (dont une certaine forme d'adhésion serait donc requise), selon des critères de dépendance économique, de quotité de consommation intermédiaire ou de proximité géographique à préciser dans une logique de filière .
C. ... À LA FAVEUR D'UNE INVERSION DE LA « TYRANNIE DU CLIENT » ?
L' efficacité des moyens de protection qui viennent d'être évoqués peut être renforcée par le ressort commercial, puissamment incitatif, de la réputation , notamment pour les entreprises dont la consommation des ménages est le principal débouché.
Ainsi, les affichages de type « éthique » tels que la proclamation par l'entreprise de sa RSE ou son adhésion à un « code de bonne conduite », tout en correspondant à une pratique effective, ont pour objet d'apporter un bénéfice commercial à l'entreprise, ce qui est parfaitement normal pour une entité qui, par essence, n'est pas philanthrope.
Si les démarches de type RSE sont encore peu acclimatées en France, d'autres pays sont plus avancés dans cette voie. Par exemple, en Belgique, l'ambassade de France constate qu'« en plus de recevoir des subventions et des privilèges fiscaux, les entreprises belges ont bien compris l'importance de la RSE. Le label RSE en Belgique est un label de confiance qui apporte de la plus value aux produits où il est apposé. C'est une stratégie qui garantit une fidélisation à long terme du client et offre une marque de différentiation permettant de justifier un coût plus important ».
Suivant cette même logique de « veille » des clients sur les conditions humaines de la production, les dispositifs de responsabilisation au regard des externalités sociales négatives des entreprises sont susceptibles d'être accompagnés par une publicité des résultats obtenus, qui pourrait être organisée.
Or, on se souvient que la focalisation sur la satisfaction des clients est un des facteurs structurants des organisations du travail et du management contemporains (voir supra la « consécration du client roi »), qu'elle oriente dans le sens d'une réactivité et d'une qualité toujours accrues tout en minimisant les coûts de surveillance interne grâce à l'intériorisation et l'acceptation par les personnels d'une contrainte leur apparaissant après tout bien légitime, en tout cas plus légitime que ne l'aurait été celle résultant d'une pression hiérarchique accrue en vue de préserver ou accroître le revenu des détenteurs de capitaux.
Il y aurait donc ici le germe d'un renversement de perspective , susceptible de contrebalancer - jusqu'à quel point ? - la « tyrannie » des clients sur l'organisation du travail, orientée collectivement par les entreprises au détriment des conditions réservées à leurs salariés , par une autre « tyrannie » des clients sur l'organisation, orientée cette fois au profit des salariés .
Une telle inversion de tendance, aujourd'hui suggérée par les « signaux faibles » des labels touchant à la responsabilité sociale et de certaines modalités de l'« experience rating », pourrait déboucher un jour sur des phénomènes plus ou moins marqués de préférences.
On ne saurait exclure qu'une prise de conscience assez générale de ce que la « condition de consommateur », toujours plus florissante, doit à la « condition de salariés », symétriquement dégradée, ne finisse par émerger . Il faudrait que se trouve brisé le cercle vicieux des publicités et des objectifs internes axés sur la « qualité totale » qui incite d'autant plus volontiers les consommateurs à élever leur niveau d'exigence qu'ils sont sommés, en tant que salariés, de satisfaire au même type d'exigences accrues.
Sans discours politique ou syndical destiné à engendrer une certaine « prise de conscience », il est naturel que de nombreux travailleurs-consommateurs reportent sur autrui la pression (sinon la violence) dont ils peuvent être victime. La manifestation, le cas échéant, d'un commencement de maturité pourrait consister, par exemple, en un refus délibéré de répondre aux multiples enquêtes de satisfaction 295 ( * ) qui encombrent le quotidien des consommateurs 296 ( * ) et dont Internet facilite une prolifération hypnotique à moindres coûts.
Mais quelles qu'en soient les manifestations, ces évolutions , dont la concrétisation constituerait une rupture majeure , ne peuvent que rencontrer des freins puissants , qui tiennent non seulement à l'individualisme des consommateurs (que des revenus mal orientés, avec la crise, peut accroitre dans les mêmes proportions que la pression qu'ils subissent en tant que salariés), mais encore à la difficulté d'élaborer des indicateurs pertinents et retraçant l'intégralité de la chaîne des valeurs ajoutées, y compris hors du territoire national.
Plus fondamentalement, Jean Baudrillard 297 ( * ) a observé qu'à la différence du travail, « l'objet de consommation isole » : « l'exploitation par la dépossession (de la force de travail) , parce qu'elle touche un secteur collectif, celui du travail social, se révèle (à partir d'un certain seuil) solidarisante . La possession dirigée d'objets et de biens de consommation est, elle, individualisante, désolidarisante, déshistorisante . En tant que producteur, et par le fait même de la division du travail, le travailleur postule les autres : l'exploitation est celle de tous. En tant que consommateur, l'homme redevient solitaire, ou cellulaire, tout au plus grégaire ».
Si la tendance à une désorganisation des collectifs de travail préjudiciable à la représentation collective devait se poursuivre, la question de l'organisation des consommateurs au profit des salariés pourrait, à l'avenir, se poser de façon plus pressante - en tout cas beaucoup plus pressante que dans le contexte de cette citation - car elle constituerait rien moins que l'ultime palliatif à une défense non violente et bien comprise de leurs intérêts.
II. UN OBJECTIF D'EMPLOYABILITÉ RÉELLEMENT POURSUIVI ?
Pour sécuriser les salariés, il ne s'agit plus de garantir leur emploi, mais de placer ces derniers en situation d'assumer financièrement et professionnellement les conséquences d'une mobilité, qu'elle soit imposée par un licenciement, ou choisie par le salarié, notamment pour préserver son employabilité.
On peut en effet considérer, sous un certain angle, que « la mobilité est une forme d'assurance pour les salariés contre les variations cycliques et les évolutions sectorielles de l'activité » 298 ( * ) .
A. LE CONSTAT PRÉALABLE D'UNE FORMATION CONTINUE N'OPTIMISANT PAS L'EMPLOYABILITÉ DES FRANÇAIS
Sans approfondir ici le sujet de la formation professionnelle initiale, on relèvera qu'en la matière, pour reprendre les termes de la Cour des comptes, « [des] politiques souvent conservatrices (...) ne permettent pas toujours de tirer les conséquences de l'évolution de la demande sociale et économique en fermant les filières dont les débouchés ne sont plus assurés au bénéfice de l'ouverture de nouvelles formations dans des secteurs mieux adaptés aux demandes et aux besoins » 299 ( * ) .
Il ne semble pas que la formation continue vienne, le cas échéant, apporter les compléments nécessaires à la formation initiale et, d'une façon générale, préserver, restaurer ou améliorer de façon satisfaisante l'employabilité des personnes, notamment celles qui sont les plus exposées au risque de perte d'emploi ou de chômage prolongé.
1. Une formation insuffisamment orientée vers l'amélioration du « capital humain général »
Les droit à formation laissés à l'initiative partielle (DIF 300 ( * ) ) ou complète (CIF 301 ( * ) ) des salariés, apparaissent encore insuffisamment dimensionnés 302 ( * ) . Par ailleurs, les obligations de formation pesant sur l'entreprise sont essentiellement financières, le « plan de formation » n'étant pas obligatoire.
En réalité, l'introduction dans le droit positif d'une obligation de l'employeur quant à l'employabilité de ses salariés ne résulte que d'un arrêt de 2007 303 ( * ) . Cette jurisprudence fait peser sur les entreprises une obligation de maintien de l'employabilité de leurs salariés, que le seul versement des cotisations obligatoires ne saurait toujours satisfaire. Mais faute d'instruments adéquats pour organiser et imposer ce soutien direct, il serait probablement vain d'attendre, de ce seul arrêt, une attention nouvelle et généralisée portée par les employeurs à l'employabilité de leurs salariés.
L' employabilité peut être comprise comme la conséquence de l'accumulation de capital humain , dès lors que ce dernier est acquis à la faveur de formations adaptées (et ainsi souvent générales), attachées aux salariés et transférables d'une entreprise à l'autre.
|
CAPITAL HUMAIN, FORMATION GÉNÉRALE ET FORMATION SPÉCIFIQUE La théorie du capital humain a été développée au cours des années soixante. Le capital humain peut se définir comme l'ensemble des capacités qu'un individu acquiert par accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. Il constitue un investissement personnel dont le rendement s'évalue idéalement par la différence entre la somme des dépenses initiales de formation et du coût d'opportunité (le salaire auquel il est renoncé), et les revenus futurs actualisés. La théorie du capital humain distingue deux types de formation :
|
Le rapport du Conseil d'analyse économique sur « Les mobilités des salariés » 304 ( * ) constate que la formation continue dispensée auprès des salariés débouche trop systématiquement sur une augmentation du « capital humain spécifique » (ainsi emmagasiné à l'occasion de formations spécifiques) et insuffisamment sur l'accumulation de « capital humain général » (qui résulte de formations générales).
Les formations étant, globalement, plutôt mobilisées par des « insiders » (soit, dans le secteur privé, les personnes bénéficiant d'un CDI 305 ( * ) ), on aboutit à des compétences hautement spécifiques concentrées sur des emplois de longue durée .
D'après le rapport précité, cette configuration « est propice à un faible taux de rotation sur le marché de l'emploi (puisque les travailleurs possédant des compétences spécifiques n'ont aucune incitation à quitter leur emploi et perdre leurs compétences) ; cela rend les coûts de mutation extrêmement élevés (puisque les travailleurs ayant surinvesti dans leurs compétences spécifiques et sous-investi dans leurs compétences générales nécessitent de très lourdes nouvelles formations).
« Toutes choses égales par ailleurs, les employeurs ont tendance à préférer des employés possédant des compétences spécifiques et à faible mobilité tant qu'ils demeurent productifs , car ces travailleurs sont attachés à l'entreprise et ont peu d'opportunités à l'extérieur de celle-ci ».
2. Une formation ne ciblant pas les personnes les plus fragiles au regard de l'emploi
En dépit des dispositifs déjà mis en oeuvre, on déplore toujours en France le faible accès à la formation des personnes bénéficiant de contrats temporaires (voir supra Titre I).
De même, le constat d'un accès problématique des chômeurs à la formation est récurrent. En dernier lieu, un rapport sur « La formation professionnelle des demandeurs d'emploi » destiné au Secrétariat d'Etat chargé de l'emploi 306 ( * ) relève que « l'orientation et la concrétisation du projet de formation du demandeur d'emploi doivent être accompagnées et s'inscrire dans un processus responsabilisant et de confiance », « la réussite de l'action de formation [étant] largement conditionnée par la prise en charge en amont et en aval du demandeur d'emploi ».
D'après le même rapport : « Les situations de rupture, d'abandon de parcours sont fréquentes, ce qui génère de l'insatisfaction de la part du demandeur d'emploi, le cas échéant de son entreprise d'accueil et de l'organisme de formation. Elles sont liées à la complexité des dispositifs d'orientation et d'accès à la formation, au grand nombre d'interlocuteurs, à des délais trop longs et à un manque de confiance entre acteurs ».
D'une façon générale, en raison d'une forte parcellisation d'acteurs au surplus mal coordonnés, la stratégie nationale de formation professionnelle des adultes demeure largement indéfinie. La Cour des comptes 307 ( * ) estime ainsi que, « plutôt que d'offrir un droit indifférencié à une formation différée, qui n'est pas toujours exercé par les bénéficiaires, il convient que les acteurs de la formation conjuguent leurs efforts afin d' identifier et de former prioritairement les publics dont la situation sur le marché du travail est la plus fragile » , s'agissant aussi bien des chômeurs, des personnes bénéficiant de contrats temporaires que de salariés bénéficiant d'un CDI dans un secteur dont les difficultés sont prévisibles .
Une des trois recommandations finales de la Cour des comptes consiste du reste à « Créer les conditions d'une stratégie coordonnée en matière de formation tout au long de la vie ».
B. UNE « FLEXISÉCURITÉ » PERMETTANT UNE SOCIALISATION EFFICACE DES RISQUES PROFESSIONNELS ?
La « flexisécurité » constitue une démarche consistant, du point de vue du salarié, à passer de la « sécurité de l'emploi » à la « sécurité de l'employabilité » (ou, ce qui revient au même, à la « sécurité du travail ») pour faciliter des transitions professionnelles dont la fréquence et le niveau d'exigence augmentent.
1. Un concept plastique : de la « flexisécurité » à la « mobication » ?
Reposant sur des dispositifs nationaux volontaires, la « flexisécurité » (ou « flexicurité ») est susceptible d'apporter les réponses, en termes de sécurité matérielle, que des entreprises soumises à une concurrence pesant sur leurs coûts et contraintes à une grande flexibilité sont de plus en plus difficilement à même de procurer à leurs salariés.
Cette incapacité des entreprises à protéger les emplois devient flagrante dans l'hypothèse de restructurations et de fermetures d'entreprises, pourtant nécessaires au processus de « destruction créatrice » (Schumpeter) qui se trouve au coeur de la croissance.
L'Union européenne promeut la flexisécurité , qu'elle définit comme « une stratégie intégrée visant à améliorer simultanément la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail » 308 ( * ) , inspirée du « modèle danois ».
Schématiquement, elle repose sur une libéralisation des licenciements tout en garantissant aux salariés, grâce à des prestations de chômage d'un niveau élevé et à l'accès à des formations destinées à préserver leur employabilité , une sécurité matérielle tout au long de leur vie professionnelle.
Ce modèle facilite les mobilités requises par des mutations permanentes de la structure productive, gages d'une compétitivité préservée dans un environnement marqué par une forte concurrence internationale.
D'après l'Union européenne 309 ( * ) , « la flexicurité suppose de combiner, de manière délibérée, la souplesse et la sécurisation des dispositions contractuelles , les stratégies globales d' apprentissage tout au long de la vie , les politiques actives du marché du travail efficaces et les systèmes de sécurité sociale modernes , adaptés et durables ».
Cette combinaison dessine un ensemble assez flou . De fait, « les approches en matière de flexicurité ne consistent pas à proposer un modèle unique de marché du travail, de vie active ou de stratégie politique; (...). En se fondant sur les principes communs, chaque État membre devrait mettre au point ses propres dispositions de flexicurité ».
Par ailleurs, ces combinaisons apparaissent comme mouvantes . Si l'on s'en tient au Danemark, « patrie » de la flexisécurité, il apparaît que, dans un contexte marqué par une pénurie de main d'oeuvre qualifiée assortie d'une contrainte budgétaire renforcée 310 ( * ) , « le modèle de flexicurité est (...) contraint d'évoluer . C'est dans ce sens que doit être interprétée la récente décision prise par la coalition parlementaire au pouvoir, dans le cadre du plan de redressement des finances publiques sur la période 2011-2013 présenté en mai, de raccourcir de 4 à 2 ans la durée de perception des allocations chômage à compter du 1 er juillet 2010 ».
« La décision a été prise sur la base d'un rapport de la commission sur l'emploi, publié au mois d'août 2009, qui soulignait qu'un nombre relativement important de demandeurs d'emploi revenait sur le marché du travail peu de temps avant la fin de la durée légale de perception des allocations chômage .
« La réduction de la durée de perception des allocations chômage vient s'ajouter à la baisse de 25 points de pourcentage du taux de couverture moyen des allocations chômage depuis les années 80. En d'autres termes, même si le montant des allocations chômage reste relativement généreux, le volet sécurité du modèle danois de flexicurité peut difficilement faire l'objet d'un nouvel affaiblissement sans prendre le risque de changer de nature ».
D'ailleurs, il se pourrait que, sur place, la flexisécurité ne soit plus le concept en pointe : « L'accent mis sur la formation continue constitue une autre caractéristique du modèle de flexicurité. Le renforcement de cette tendance devrait faire émerger une nouvelle version du modèle de flexicurité, la « mobication » , terme conjointement attribué à Ove Kaj Pedersen, professeur à l'Ecole de Commerce de Copenhague (CBS) et à Søren Kaj Andersen, Directeur du FAOS (Employment Relations Research Center, Université de Copenhague) et qui résulte de la contraction des mots « mobilité » et « éducation » ...
Cette dernière orientation rejoint la préoccupation, essentielle, de favoriser un développement continu du capital humain général (au sens d'un capital qui n'est pas utile qu'à l'entreprise ayant dispensé la formation qui en est à l'origine) - et donc l' employabilité - tout au long de la vie : « Dans un tel modèle, élaboré dans le but d'adapter le marché du travail aux défis à venir (division du travail au niveau international, impact des nouvelles technologies, changements démographiques...), le recours systématique au développement des compétences et à la formation continue permettrait d'accentuer la flexibilité, en orientant la main-d'oeuvre vers les branches les plus dynamiques en termes d'emploi, et de renforcer l'employabilité des citoyens danois. Les organisations syndicales sont d'autant plus ouvertes à cette nouvelle version du modèle de flexicurité que son succès dépend étroitement de la mise en oeuvre d'efforts particuliers visant à développer la flexibilité du système éducatif ».
Il ne s'agit donc plus seulement d'avoir une démarche « active » face au chômage, mais « proactive » , en mettant l'accent sur une mobilisation de la formation propre à optimiser en permanence l'employabilité des salariés présents et à venir, ce qui rejoint la prise de conscience française quant à l'urgence de développer une véritable stratégie nationale en termes de formation professionnelle, initiale et continue.
2. Un volet « sécurité » encore lacunaire en France
Certaines mesures récentes peuvent être rattachées au volet « sécurité » d'une flexisécurité qui en serait plus ou moins l'inspiratrice. On citera notamment la « portabilité » du droit individuel à la formation, ou l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, destinée à sécuriser cette dernière.
|
QUELQUES MESURES RATTACHABLES AU VOLET
« SÉCURITÉ »
? La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a introduit diverses mesures destinées à répondre aux besoins de sécurisation des parcours, dont notamment :
Destiné à faciliter l'accès à la formation des demandeurs d'emploi et des salariés les moins qualifiés, le FPSPP doit être financé par une partie des contributions obligatoires des employeurs pour la formation professionnelle. L'objectif affiché est de permettre chaque année la formation de 500.000 salariés peu qualifiés et de 200.000 demandeurs d'emploi supplémentaires.
On rappelle que le DIF consiste en l'octroi à tout salarié d'un crédit d'heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures. Avec la « portabilité », l'employé a la possibilité de bénéficier de son DIF durant une période de deux ans après la rupture du contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde). Il peut l'utiliser au cours d'une période de chômage ou chez son nouvel employeur. En accord avec Pôle emploi, une personne licenciée peut ainsi mobiliser son DIF pour une formation, un bilan de compétences ou une VAE 311 ( * ) . Elle peut encore utiliser son DIF après une embauche avec l'accord de son nouvel employeur afin, par exemple, de faciliter son adaptation à son nouveau poste de travail. ? Le contrat de transition professionnelle (2006) Le contrat de transition professionnelle (CTP) est un dispositif expérimental 312 ( * ) mis en place dans vingt-cinq bassins d'emploi, où il se substitue à la convention de reclassement personnalisé. Proposé aux salariés licenciés pour motif économique des entreprises de moins de 1 000 salariés et en redressement ou en liquidation judiciaire quel que soit leur effectif, ce contrat, d'une durée maximale de douze mois, permet de suivre un parcours susceptible de comprendre : - un bilan de compétences approfondi ; - des mesures d'appui social ; - l'évaluation préalable à la création ou la reprise d'une entreprise ; - des actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) ; - des périodes de formation notamment orientées vers des métiers qui recrutent et impliquant une mobilité professionnelle ; - des périodes de travail , pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, son bénéficiaire perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion du CTP. ? La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a relevé les indemnités légales de licenciement en alignant le calcul de celles versées en cas de licenciement pour motif personnel sur celui, jusqu'alors plus avantageux, de celles versées en cas de licenciement pour motif économique, et réduit de 2 ans à 1 an l'ancienneté requise pour prétendre à ces indemnités. |
Mais on rappelle surtout que, faute de stratégie d'ensemble, la formation des adultes ne cible ni suffisamment, ni pertinemment les personnes dont la situation au regard de l'emploi est fragile, ce constat étant complémentaire de celui de formations peu diplômantes, trop centrées sur le capital humain spécifique à l'emploi, voire au poste et aux tâches des salariés, au détriment du capital humain général.
Les formations dispensées échouent ainsi, d'une façon générale, à développer l'employabilité indispensable à une mobilité réussie des salariés , qu'elle soit volontaire ou subie.
3. Les moyens d'une véritable protection contre les aléas économiques
• Le premier objectif de toute réforme tendant
à préserver la sécurité des individus dans leurs
parcours professionnels, devrait être celui d'une prise en charge
d'
actions de formation générales
destinées à
préserver ou restaurer
l'employabilité
, qui soit
largement mobilisées
au profit des « outsiders »
, chômeurs et
bénéficiaires de contrats de travail temporaires.
Elle devrait aussi conduire au versement de revenus de remplacement élevés , conditionnés par le suivi d'un parcours de retour à l'emploi comprenant notamment les actions de formation susvisées, dans une logique accrue d'« activation » des dépenses de la politique de l'emploi.
Bien sûr, les différents « parcours » imposés par l'ANPE puis par Pôle emploi, dont le suivi conditionne le versement d'allocations, ainsi que le volet « insertion » du RMI (revenu minimum d'insertion) 313 ( * ) , s'inscrivent depuis longtemps dans cette logique, mais nul n'ignore qu'il y a souvent, parfois faute de moyens, loin des ambitions que reflètent les intitulés de ces parcours, à la réalité de leur mise en oeuvre.
D'autres leviers de sécurisation des trajectoires professionnelles que les rémunérations et la formation peuvent être actionnés, la créativité des partenaires sociaux étant ici susceptible de s'exprimer très librement.
Le logement devrait faire partie des leviers complémentaires les plus utiles. La hausse des prix du foncier et des loyers intervenue au cours de dernière décennie décourage particulièrement la mobilité des propriétaires ou des titulaires d'un logement social, tout en renforçant à due proportion les exigences des bailleurs en termes de garanties - au détriment, alors, de la mobilité des locataires. Des mécanismes permettant, par exemple, un cautionnement des preneurs à bail ou l'assurance des acheteurs emprunteurs, pourraient être étudiés.
En Allemagne, la stratégie allemande en matière de flexicurité « se concentre pour l'essentiel dans la sécurisation des emplois, au travers notamment du chômage partiel , très aidé et qui l'est encore plus s'il est combiné avec de la formation » 314 ( * ) . Ici, la sécurisation repose sur les aides et la formation, le chômage partiel étant une forme de « flexibilité interne » ( infra ).
• Les coûts élevés que sont
susceptibles d'engendrer les différents « postes »
du volet « sécurité » de la
flexisécurité, supposent de
recourir à des
procédés de mutualisation
, soit par une intervention
directe des l'Etat, soit au moyen de structures suscitées par les
partenaires sociaux, afin de financer les allocations, les diverses actions de
formation et d'insertion.
Comment la France est-elle susceptible de progresser dans cette voie ? Compte tenu de l'« existant », c'est-à-dire la Sécurité sociale et l'assurance-chômage, une possibilité consisterait à « construire les instruments d'une sécurité sociale de nature conventionnelle » 315 ( * ) qui, superposée aux institutions présentes, serait exclusivement destinée à sécuriser les parcours professionnels.
Mais une augmentation des prélèvements sociaux ou des impôts du chef de nouveaux dispositifs de sécurisation des parcours nuirait, à court terme, à la compétitivité des entreprises ou au pouvoir d'achat des salariés, ce qui réduit l'acceptabilité de cette politique.
4. Un volet « flexibilité » problématique dans un marché français dual et en équilibre stable
Pour adapter le niveau de la production à la demande, une entreprise peut recourir à la « flexibilité externe », en adaptant le niveau de ses effectifs, ou à la « flexibilité interne », en modulant leur degré d'occupation et leur rémunération.
a) Flexibilité externe : une orientation déterminante ?
Quelque degré de cohérence auquel atteignent les représentations du modèle de flexisécurité, les tentatives pour populariser en France l'objectif d'un système de protection donnant la primeur aux individus sur les emplois , dès lors que ces derniers seraient « flexibilisés » par un assouplissement des conditions de licenciement , ne rencontrent qu'un succès mitigé .
En définitive, ni la prégnance intellectuelle du libéralisme anglo-saxon - du moins jusqu'à une époque récente-, ni la cohérence du modèle de flexisécurité danois, pourtant plus « social » et interventionniste, n'auront véritablement entamé l'attachement des Français aux « statuts » qui structurent la société, de l'obtention du diplôme à la « situation » de fonctionnaire ou même de salarié en contrat à durée indéterminée qui, malgré la sécurité toute relative qu'il procure, conditionne dans une certaine mesure l'accès au logement et au crédit.
Ceux qui ont accédé à ces situations, parfois à l'issue d'un véritable « parcours du combattant », ainsi que ceux qui espèrent y accéder, considèrent volontiers que toute remise en cause des droits des « insiders » constituerait une rupture du pacte social.
On peut, certes, s'interroger sur l'échéance à laquelle cette facette du pacte social pourrait s'éroder, avec un volet « flexibilité » de la flexisécurité ne reposant plus sur la mobilité subie d'« outsiders » enregistrant des pertes de capital humain au gré des fluctuations d'un marché du travail fondamentalement dual, mais sur un assouplissement général des conditions de rupture de tous les contrats de travail 316 ( * ) .
On peut encore s'interroger sur le fait de savoir si le CDI constitue véritablement un obstacle à une gestion flexible des effectifs - le CDD comporte en comparaison des éléments de formalisme et de rigidité substantiels - et si la dualité du marché du travail, dont on admettra l'existence sur la base du capital humain, ne transcende pas, pour une part non négligeable, les catégories contractuelles que sont le CDI, le CDD et l'intérim. En ce sens, il existe évidemment une corrélation inverse entre le degré de diplôme et la probabilité de bénéficier d'un contrat court 317 ( * ) .
Quoi qu'il en soit, il semble que le passage d'un modèle dual à un modèle caractérisé par l'unification (ou l'absence) de statut soit difficile . Le rapport précité sur « Les mobilités des salariés » relève avec réalisme qu'« il existe (...) des équilibres multiples liés à l'existence de complémentarités politiques : les institutions protégeant les travailleurs renforcent leurs droits mais diminuent le bien-être des outsiders, ce qui renforce l'incitation des insiders à conserver leurs droits, en raison de l'écart grandissant entre la situation objective des deux statuts .
« On peut ainsi avoir deux équilibres, l'un où les écarts de statut sont difficilement réformables et donc pérennes, ce qui est plutôt le modèle français et sud-européen, et l'autre où les différences de statut n'existent pas et où les salariés ne sont pas en demande de plus de protection comme dans le monde anglo-saxon et en partie les pays nordiques ».
A ce jour, la trajectoire française de moyen terme est bel et bien caractérisée par une « protection » globalement inentamée du CDI , doublée d'une élévation du nombre de contrats temporaires 318 ( * ) sur lesquels reposent une part importante des mobilités requises par les fluctuations et les mutations de l'activité ( supra ). Le même constat peut être dressé, depuis la fin des années quatre-vingt, dans les pays européens où la législation protectrice de l'emploi (LPE) était alors la plus stricte, les assouplissements constatés depuis résultant surtout d'un recours facilité aux différentes formes d'emploi temporaire.
Ainsi qu'on l'a vu (cf. titre I), l'amélioration de la flexibilité emprunte vraisemblablement en France le chemin d'un renforcement d'une « couche de flexibilité » (CDD et intérim) en partie subie - même si la gestion des CDI peut aussi participer à cette flexibilité, tandis que le recours à des contrats courts est susceptible de répondre à d'autres objectifs.
Cette évolution se traduit par un dualisme accru du marché du travail , ce qui est bien entendu problématique . Lorsqu'elles n'ont pas débouché sur un échec 319 ( * ) , les mesures prises, à ce jour, dans le sens d'une flexibilité contractuelle accrue, n'ont pas bouleversé les équilibres existants.
|
QUELQUES MESURES RATTACHABLES AU VOLET
« FLEXIBILITÉ »
? la rupture conventionnelle du contrat de travail La rupture conventionnelle du contrat de travail s'effectue d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. L'employeur et le salarié conviennent des conditions de la rupture du contrat de travail et de l'indemnité de rupture à verser, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Le salarié a droit aux allocations de chômage dans les mêmes conditions qu'un salarié licencié. En dépit d'une forte montée en charge de ce dispositif, « il est encore trop tôt pour évaluer les effets proprement économiques de la rupture conventionnelle » 320 ( * ) . ? l' allongement des périodes d'essai Antérieurement fixée à un mois en moyenne pour les employés et à trois mois en moyenne pour les cadres, la période d'essai, renouvelable une fois, a été portée à deux mois au maximum pour les ouvriers et les employés, trois mois au maximum pour les agents de maîtrise et les techniciens et quatre mois au maximum pour les cadres. ?le CDD à objet défini (ou « de mission ») Ne pouvant servir qu'au recrutement de cadre ou d'ingénieurs, ce contrat ne saurait être a priori considéré comme le vecteur d'un approfondissement du dualisme du marché du travail. Subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise l'instituant, ce contrat, d'une durée comprise entre 18 et 36 mois, prend normalement fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. |
b) Flexibilité interne : limites et facteurs d'optimisation
En cas de ralentissement économique, il arrive que la compression du volant de contrats temporaires ne suffise plus à garantir l'équilibre entre les ressources et les charges d'une entreprise.
Alors, en jouant sur le temps et le rythme de travail, voire en suspendant son activité, l'entreprise peut, sans licencier, absorber certaines inflexions de la demande n'ayant pas un caractère structurel mais résultant du cycle économique, dans l'attente de jours meilleurs. Une flexibilité exclusivement salariale, via l'indexation directe de certains éléments de rémunération sur la performance de l'entreprise, peut également aider à passer un cap difficile.
Au plus fort de la crise actuelle, le chômage partiel a été largement utilisé en Allemagne et parfois sollicité en France où, par ailleurs, les « 35 heures » avaient débouché dans de nombreuses entreprises sur une annualisation du temps de travail qui a permis, dans cette phase critique, de lisser le repli de l'activité nationale. Ces instruments de flexibilité interne expliquent, toutes choses étant égales par ailleurs, de moindres pertes d'emploi -surtout en Allemagne- qu'en Angleterre ou aux Etats-Unis.
En France, l'imprévisibilité engendrée par la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail, rend plus difficile la conciliation de l'activité professionnelle et de la vie privée, et peut contribuer dans une proportion importante au « mal être » des salariés. Elle demeure cependant souhaitable, dès lors qu'elle conditionne le maintien de l'emploi à court terme, évitant toute dégradation de capital humain.
On peut toutefois lui préférer la « solution » allemande qui, reposant sur le recours massif à un chômage partiel financé par la solidarité collective, ne fait pas peser sur les seuls salariés concernés le coût de l'ajustement, tout en préservant leur capital humain : « alors qu'en 2005 l'Allemagne a considérablement durci les conditions d'indemnisation du chômage (réformes Hartz), la stratégie allemande en matière de flexicurité se concentre pour l'essentiel dans la sécurisation des emplois, au travers notamment du chômage partiel, très aidé et qui l'est encore plus s'il est combiné à de la formation » 321 ( * ) .
C. DES ENTREPRISES ENGAGEANT UNE GESTION DES COMPÉTENCES RESPONSABLE ?
Préserver ou accroître l'employabilité des salariés suppose, de la part de l'employeur, de confier aux salariés des postes valorisant leurs compétences et d'engager, à leur endroit, certaines actions de formation .
En cohérence avec les conclusions de l'arrêt de 2007 précité, Francis Mer, ancien ministre des finances, a estimé, lors de son audition, que « l'employabilité est la première responsabilité de l'employeur » et relève que « licencier une personne employée trente ans à faire la même chose, même avec un chèque conséquent, est irresponsable ».
Aujourd'hui, outre la diffusion de principes managériaux tendant à favoriser l'adaptabilité des salariés , la préservation de leur employabilité peut s'appuyer sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui est, en France, obligatoire dans les entreprises de plus de 300 employés depuis 2005.
Il semble pourtant que la démarche peine à s'imposer.
|
LA GPEC : UNE ACCLIMATATION LABORIEUSE Introduite par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (dite loi Borloo), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences tend, en particulier, à favoriser une adaptation continue des compétences des salariés qui soit cohérente avec les choix stratégiques de l'entreprise. C'est ainsi un outil d'employabilité mais, d'abord, d'employabilité dans une entreprise précise, même si elle peut aussi inclure une réflexion plus générale sur la prospective des métiers. De nombreux observateurs déplorent que l'attitude conjointe des employeurs et des syndicats au regard de la GPEC oscille souvent entre une attention convenue et la plus complète indifférence, lorsqu'elle n'est pas mobilisée dans la seule perspective de ne pas compromettre la validité d'un plan social 322 ( * ) . |
Pourtant, mobilisée avec énergie et conviction, la GPEC pourrait constituer une réponse ou, du moins, un complément de réponse au délitement actuel des carrières prévisibles .
D'une façon générale, une gestion sociale préventive du risque de chômage de la part de l'employeur se trouverait plus systématiquement soutenue :
- à la faveur d'une jurisprudence innovante sur la base de l'arrêt de 2007 précité, qui pourrait cependant engendrer, sans autre intervention législative, une relative insécurité juridique ;
- par des normes de type « soft law » tenant à la « responsabilité sociale de l'entreprise » (RSE) ;
- par des mécanismes de responsabilisation directs (« experience rating ») pour le calcul des cotisations de chômage, qui reposerait sur le montant des allocations versées aux anciens salariés de l'entreprise ;
- par la publication d'indicateurs engageant la réputation de l'entreprise (ce point venant, le cas échéant, en complément des deux précédents) ;
- en recourant à certains procédés de mutualisation entre entreprises qui s'inscriraient, à partir d'un certain degré de généralité des accords, dans une démarche de type flexisécurité.
* *
*
La qualité des emplois et la maximisation de l'employabilité des salariés sont des enjeux reconnus pour une croissance plus forte et un travail mieux valorisable.
Pourtant, une meilleure employabilité ne permet pas forcément de trouver un emploi s'il ne s'en trouve pas en nombre suffisant 323 ( * ) : quel que soit le niveau général d'employabilité, certains seront toujours moins « employables » que d'autres. En France, avec la persistance d'un chômage de masse, le « discours » sur l'employabilité demeure équivoque.
En effet, la valorisation de ce concept laisse accroire à la société et particulièrement aux sans-emplois que le chômage constitue un risque que soit des prétentions salariales plus mesurées, soit des actions de formation habiles et calibrées peuvent arriver à conjurer. Sur ce dernier point, ce qui peut être vrai si les formations s'appliquent à une collection d'individus, peut s'avérer faux si elles devaient concerner l'ensemble de la population active car il est alors vraisemblable que le travail viendrait à manquer pour occuper tout le monde sur le territoire national.
Ainsi, prétendre que chacun devient plus ou moins l'« acteur » d'une trajectoire professionnelle optimisable c'est oublier volontiers que, collectivement, les salariés subissent plus le chômage qu'ils ne peuvent renforcer leur employabilité dans le cadre d'un système et de politiques économiques s'accommodant d'un sous-emploi chronique.
En réalité, ce dernier ne saurait être éradiqué sans l'appui d'authentiques politiques de croissance, axées sur la consommation et l'investissement. De telles politiques sont nécessaires pour donner un sens à l'objectif d'améliorer l'employabilité et la qualité des emplois. Mais, elles ne peuvent qu'être concertées et consolidées au niveau européen. En effet, spontanément, le contexte d'économies ouvertes et d'endettements publics élevés donne une prime, à la fois économique et financière, aux politiques déflationnistes conduites unilatéralement mais dont l'adoption concomitante conduirait à un effondrement général de la production.
CHAPITRE III : RÉÉQUILIBRER LE GOUVERNEMENT DES ENTREPRISES
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Face aux tendances lourdes, deux types d'inflexions peuvent être recherchées. - Une consolidation du rôle des partenaires sociaux : initiée par le renforcement de leur légitimité (loi du 20 août 2008), cette consolidation pourrait passer notamment par une réforme de leur financement et par l'apparition d'un « syndicalisme de services » plus proche des préoccupations concrètes des salariés. La question du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises pourrait également resurgir. Enfin, la représentativité des organismes patronaux demeure une question non résolue. - Une gouvernance plus partenariale , n'excluant pas une réflexion sur la codétermination, et une protection renforcée de l'actionnariat de long terme, afin de favoriser l'inscription des stratégies d'entreprises dans temps long, ainsi qu'une évaluation multicritères systématisée de leurs performances . |
I. LA CONSOLIDATION DU RÔLE DES PARTENAIRES SOCIAUX
Pour répondre au malaise du salariat, le canal traditionnel du renforcement de la représentation collective peut être employé. Il a d'ailleurs commencé à l'être, au cours des années récentes, par des réformes qui demeurent pour l'heure insuffisantes mais se révèleront peut-être rétrospectivement avoir constitué des « signaux faibles » porteurs d'avenir.
La loi tend à investir les partenaires sociaux de pouvoirs croissants dans le champ social :
- au niveau national, le rôle institutionnel des partenaires sociaux s'est accru, par le biais de leur consultation préalablement à toute réforme sociale ;
- au niveau décentralisé, le champ des accords d'entreprises, désormais susceptibles d'intervenir non seulement in melius mais aussi in pejus , s'est élargi au fil des ans.
Ces évolutions juridiques ont accentué la nécessité d'une légitimation nouvelle des partenaires sociaux, qui demeure inachevée .
A. LA LOI DU 20 AOÛT 2008
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail s'est efforcée d'améliorer les conditions du dialogue social, dans le cadre de la procédure de concertation mise en place par la loi de modernisation du dialogue social de 2007.
Son premier volet établit de nouvelles règles de nature à consolider la légitimité des organisations syndicales et des accords collectifs.
1. La rénovation des critères de représentativité syndicale.
Ces critères, fixés par une circulaire de 1945, repris par la loi du 11 février 1950, étaient les suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté ;
- l'attitude patriotique durant l'occupation.
Les dispositions datées de l'après-guerre avaient toutefois été complétées par une jurisprudence tendant à prendre en considération l'audience des syndicats, leur activité et leur influence.
Par ailleurs, l'existence d'une présomption irréfragable de représentativité, au bénéfice des cinq principales confédérations syndicales françaises, constituait un obstacle à l'émergence de structures syndicales nouvelles.
|
LA PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE DE REPRÉSENTATIVITÉ (1966-2008) Un arrêté du 31 mars 1966 avait conféré à cinq confédérations syndicales une présomption irréfragable de représentativité. Ces cinq confédérations étaient les suivantes : - la Confédération générale du travail (CGT), créée en 1895 ; - Force ouvrière (CGT-FO), née en 1947 d'une scission avec la précédente ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), fondée en 1919 ; - la Confédération démocratique du travail (CFDT), née en 1964 d'une scission avec la précédente ; - la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFD-CGC), créée en 1944. La loi de rénovation de la démocratie sociale de 2008 a mis fin à cette présomption irréfragable. |
Après une période de réflexion, marquée par les rapports de Raphaël Hadas-Lebel 324 ( * ) et du Conseil économique et social 325 ( * ) , et à la suite d'une phase de négociation, ayant abouti à l'adoption d'une position commune par une partie des partenaires sociaux 326 ( * ) (9 avril 2008), les règles de la représentativité syndicale ont été modifiées par la loi précitée du 20 août 2008, pour donner une place plus grande à l'audience des organisations, telle que mesurée lors des élections professionnelles.
Les nouvelles dispositions législatives font reposer la représentativité syndicale sur 7 critères cumulatifs 327 ( * ) :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l'indépendance ;
- la transparence financière ;
- une ancienneté minimale de deux ans ;
- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
- les effectifs d'adhérents et les cotisations ;
- l'audience , établie à partir des résultats aux élections professionnelles 328 ( * ) . Ce nouveau critère d'audience s'accompagne de la fixation d'un seuil, en deçà duquel un syndicat ne peut être considéré comme représentatif. Ce seuil est de 10 % des suffrages exprimés au premier tour, au niveau de l'entreprise et de 8 % au niveau des branches ou au niveau national interprofessionnel .
Ces seuils, relativement élevés, compte tenu de la diversité syndicale française, sont de nature à favoriser des regroupements d'organisations pour celles dont l'avenir est incertain (par exemple la CFE-CGC).
2. Les règles de validité des accords collectifs
La loi dispose par ailleurs que la validité d'un accord collectif, à tous niveaux (entreprise, branche, ou au niveau national) est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Ces nouvelles règles ont pour objectif de promouvoir « un syndicalisme d'engagement et de compromis plus constructif que le syndicalisme d'opposition 329 ( * ) ». Elles constituent un pas vers un mode de conclusion majoritaire des accords collectifs. Cet objectif est d'ailleurs explicite dans la position commune du 9 avril 2008.
Enfin, la loi assouplit les règles relatives à la capacité à signer un accord, afin de renforcer la légitimité des délégués syndicaux et de développer la négociation collective dans les PME.
B. UNE RÉFORME EN DEVENIR
La loi de 2008 constitue un tournant en direction de la signature d'accords majoritaires, qui constitue la prochaine étape d'une réforme en devenir. La position commune précitée des partenaires sociaux, en date du 9 avril 2008, évoquait en effet : « une première étape préparant au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords », c'est-à-dire leur conclusion par des organisations syndicales représentatives totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés. Ce passage pourra être envisagé lorsque la loi de 2008 sera pleinement appliquée, c'est-à-dire à l'issue de la période transitoire prévue jusqu'en 2013.
La réforme de 2008 a toutefois laissé plusieurs questions en suspens .
1. Le dialogue social dans les PME et les TPE
Dans les PME sans délégué syndical, des possibilités de négociation sont ouvertes avec les représentants élus au CE ou les DP.
Il reste toutefois à définir les conditions du dialogue social dans les entreprises de moins de 11 salariés , qui n'organisent pas les élections professionnelles sur la base desquelles l'audience des syndicats est désormais appréciée.
Les organisations patronales (MEDEF, CGPME) ayant refusé l'ouverture d'une négociation à ce sujet, le gouvernement a présenté un projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale 330 ( * ) , proposant l'organisation d'élections de représentativité au niveau régional , à l'occasion desquelles les salariés voteraient non pour élire des candidats mais en faveur d'une étiquette syndicale. Dans le secteur agricole, l'audience des syndicats serait appréciée sur la base des suffrages recueillis lors des élections aux chambres départementales d'agriculture.
D'après ce projet de loi, les partenaires sociaux seraient par ailleurs libres d'instaurer des commissions paritaires locales qui auraient pour mission d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs et d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et employeurs des TPE. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a toutefois supprimé ce dispositif en première lecture, le jugeant trop contraignant alors qu'il ne revêtait aucun caractère obligatoire.
Le compromis trouvé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat en commission mixte paritaire a consisté à amender l'article 4 du projet de loi afin de préciser :
- que la composition des commissions paritaires territoriales déjà prévues par le code du travail (depuis 2004) peut prendre en compte les résultats de la nouvelle mesure de l'audience des syndicats de salariés (mais ce n'est pas une obligation) ;
- et que les compétences de ces commissions peuvent être aménagées par les accords qui les instituent (afin de privilégier éventuellement le dialogue social dans les TPE et PME mais, là encore, c'est une simple faculté).
L'avenir dira quel usage les partenaires sociaux font de la faculté que la loi leur a ainsi conférée. Il est toutefois probable que la question du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises se posera à nouveau, à l'avenir , car les questions qui affectent leurs salariés sont souvent communes à un secteur ou à un territoire, l'écueil étant toutefois de briser les équilibres fragiles existants au sein des petites structures.
2. Le financement des organisations syndicales
Étant donné, d'une part, le rôle institutionnel croissant des syndicats, et, d'autre part, le contexte économique, social et juridique décrit précédemment qui est plutôt défavorable à la syndicalisation, la question d'un financement public des syndicats se pose.
En l'absence de données officielles sur le financement des syndicats, la part des cotisations dans l'ensemble de leurs ressources est estimée entre 20 % (CFTC) et 57 % (FO) 331 ( * ) . Les autres ressources des syndicats proviennent de leurs activités propres, notamment la rémunération des activités d'intérêt général qu'ils effectuent (participation à la gestion des organismes paritaires : organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle et organismes de sécurité sociale). Cette rémunération ne prend que faiblement en compte le critère de l'audience. L'État et les collectivités locales leur versent enfin des subventions ou les font bénéficier d'avantages, fiscaux notamment. Ces ressources viennent bien sûr s'ajouter aux facilités diverses accordées par les entreprises.
Le modèle français de financement des organisations syndicales est singulier au sein de l'Union européenne, comme l'a démontré un rapport de l'IGAS 332 ( * ) . En dépit des différences entre pays européens, de fortes similarités existent s'agissant du financement des syndicats, en dehors du cas de la France.
Le financement des syndicats dans les pays considérés obéit en effet à 4 principes :
- les adhérents et l'autonomie financière qu'ils garantissent sont le fondement de la légitimité des syndicats (les cotisations représentent en moyenne 80 % du financement des syndicats) ;
- les employeurs ne donnent aux syndicats que les moyens nécessaires à la représentation des salariés dans l'entreprise ;
- les missions d'intérêt général, définies strictement, font l'objet d'un financement cloisonné ;
- les contrôles peuvent être conçus de manière à respecter l'autonomie des syndicats.
En France, au contraire, le financement des syndicats est largement déconnecté du nombre d'adhérents. La plupart des organisations syndicales réclament une réforme de ce financement, mais elles divergent entre elles sur le lien qu'il convient d'établir entre financement public et représentativité. Le rapport précité de Raphaël Hadas-Lebel envisage deux scénarios d'évolution :
- Un scénario d'adaptation : amélioration de la transparence des comptes par leur publication annuelle, extension du mécanisme du chèque syndical, confirmation par la loi du statut fiscal propre aux organisations syndicales, encadrement de la mise à disposition de salariés du secteur privé... ;
- Un scénario de transformation , où serait renforcée la place de l'adhérent et de l'audience dans le système de financement des syndicats : augmentation de l'avantage fiscal actuel 333 ( * ) , remplacement par un crédit d'impôt (chèque syndical financé sur le budget de l'État), réexamen de la répartition des financements entre organisations syndicales en fonction de leur audience, mise en place d'une contribution spécifique des entreprises destinée au financement du dialogue social.
3. La représentativité des organismes patronaux
Si la loi de 2008 a traité de la représentativité des organisations syndicales, elle n'a pas fait de même pour les organismes patronaux , ce qui constitue une autre lacune. Cette représentativité n'est pas définie dans les textes, que ce soit au niveau des branches ou au niveau interprofessionnel.
Dans la mesure où les élections professionnelles, dont les résultats permettent de mesurer la représentativité des organisations syndicales depuis la loi de 2008, ne concernent pas les organisations d'employeurs, il serait nécessaire d'imaginer pour celles-ci un autre instrument de mesure.
4. Vers un syndicalisme de services ?
La faiblesse du syndicalisme français est parfois attribuée à son caractère idéologique, éloigné des préoccupations concrètes des salariés, en contraste avec le modèle nordique dans lequel l'adhésion à un syndicat conditionne l'obtention d'un certain nombre d'avantages. En créant une concurrence électorale entre organisations, la loi du 20 août 2008 est susceptible d'inciter les syndicats français à accroître leur offre de services.
Une note récente du Centre d'analyse stratégique 334 ( * ) a montré que l'opposition entre ces deux modèles, bien que largement exagérée , expliquait néanmoins pour partie les différences de taux de syndicalisation selon les pays.
Au nombre des services susceptibles d'être fournis en contrepartie d'une adhésion syndicale figure notamment l'assurance chômage (Belgique, Suède) .
On remarquera toutefois qu'en conséquence de décisions étatiques ayant entraîné une augmentation du montant des cotisations chômage, la désyndicalisation s'est accélérée en Suède. De façon plus générale, l'efficacité de ce système dit « de Gand » a été remise en cause dans plusieurs pays qui, à la suite de décisions de l'Etat « durcissant » certaines conditions des régimes d'affiliation intermédiés par les syndicats, ont pu entraîner une réduction des effectifs syndicaux .
Ces expériences confirment la corrélation entre offre de services et taux de syndicalisation, mais elles montrent aussi que l'autonomie des syndicats s'agissant de leur offre en ce domaine n'est pas absolue.
Il existe, dans ce système, un risque de bureaucratisation de syndicats à la merci des réformes décidées par l'État (ce qui est susceptible de réduire l'indépendance syndicale).
D'autres services peuvent être rendus par les syndicats : conseil juridique, soins de santé, indemnisation des jours de grève, séjours de vacances, aide aux migrants... voire fourniture d'une carte de crédit (Canada). En France, ce type de services peut être rendu par le Comité d'entreprise, mais seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le syndicalisme de services tend à banaliser l'activité des syndicats , qui devient de type assuranciel ou revêt le caractère d'une centrale d'achats, au-delà de la défense des droits et intérêts des salariés qui constitue la légitimité première de leur activité. L'adhérent tend à devenir « client » de l'organisation syndicale, ce qui modifie profondément les relations entre travailleurs, syndicats et entreprises.
Une telle évolution permettrait toutefois d'étendre à l'ensemble des salariés un certain nombre d'avantages aujourd'hui réservés à ceux des grandes entreprises . Elle est également susceptible d'améliorer la sécurisation des parcours professionnels , si les syndicats peuvent mettre aussi à disposition un réseau de contacts et de formations professionnelles.
Elle permettrait, en tout état de cause, d'étendre le syndicalisme aux mondes respectifs des travailleurs précaires et des cadres, qui en sont souvent exclus (d'eux-mêmes ou involontairement), jusqu'à aujourd'hui.
|
SYNDICALISME DE SERVICES : LES PROPOSITIONS DU CAS Proposition n° 1 : Ne pas se limiter, si les organisations syndicales investissent de nouveaux domaines d'action, au seul champ professionnel (en proposant des services répondant aux préoccupations concrètes des salariés, comparables à ceux rendus par les comités d'entreprise par exemple). Trois axes sont particulièrement mentionnés : la défense juridique des salariés, la défense des consommateurs, la mise en place d'un maillage territorial de proximité pour le suivi des travailleurs précaires. Proposition n° 2 : Mutualiser les moyens des organisations syndicales pour rendre directement certains services spécifiques. Proposition n° 3 : S'appuyer sur la participation à la gestion d'organismes paritaires ou tripartites (formation professionnelle, assurance chômage) pour s'impliquer davantage dans l'élaboration des dispositifs collectifs d'accompagnement des parcours professionnels. Source : note précitée du CAS |
On pourrait imaginer aller plus loin encore en réservant le bénéfice des accords négociés par les syndicats à leurs adhérents . Cette pratique, éloignée de la culture universaliste française, n'irait pas sans difficultés concrètes. Mais, elle résorberait peut-être une certaine forme de manque de prise de responsabilité de la part des salariés, qui peuvent parfois avoir tendance à se comporter en passagers clandestins d'un système de négociations sociales que, par là-même, ils affaiblissent.
*
* *
Au-delà d'un renouveau du rôle des syndicats, qui semble un facteur possible d'amélioration des relations sociales en France, faut-il envisager la participation des salariés à la prise de décision stratégique comme susceptible de constituer une « variante » par rapport au scénario « noir » précédemment décrit ?
II. UNE PARTICIPATION ACCRUE DES SALARIÉS À LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES ?
Une participation accrue des salariés à la gouvernance des entreprises est parfois évoquée, comme devant permettre une meilleure prise en compte des intérêts de long terme de l'entreprise et de ses salariés , en favorisant l'investissement et l'emploi et en venant contrebalancer les priorités court-termistes des investisseurs financiers.
On explique notamment que, si les conditions dans lesquelles les entreprises allemandes et françaises s'adaptent à la mondialisation - avec dans le second cas un recours plus radical aux délocalisations - diffèrent, c'est à l'implication des syndicats dans le gouvernement des entreprises en Allemagne qu'on le doit.
A. DES MODÈLES ÉTRANGERS DE CODÉTERMINATION À L'EFFICACITÉ CONTESTÉE
Tandis que les conseils d'administration ou de surveillance sont progressivement devenus les principaux organes décisionnels de l'entreprise, l'accent a été mis sur l'exigence d'indépendance des administrateurs , tant au niveau international 335 ( * ) qu'au niveau français 336 ( * ) . Le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF préconise ainsi la présence d'un tiers d'administrateurs indépendants pour les sociétés à actionnariat concentré, et 50 % pour celles dont le capital est dispersé.
L'indépendance réelle de ces administrateurs, leur compétence, ainsi que leur capacité à défendre les intérêts de toutes les parties prenantes, ont toutefois été mises en cause 337 ( * ) .
Dans ce contexte, faut-il privilégier une représentation plus exhaustive de l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise, c'est-à-dire une gouvernance partenariale sur le modèle « stakeholder » plutôt que « shareholder », de façon directe plutôt que par l'intermédiaire d'administrateurs à l'indépendance incertaine ?
1. Les modèles étrangers
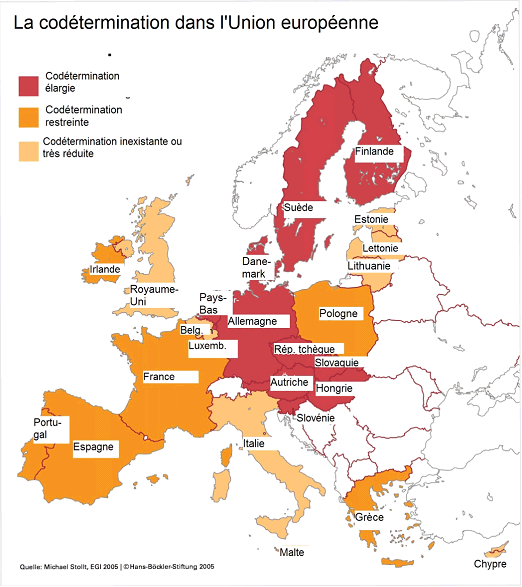
Source : Fondation Hans Böckler (Allemagne)
L'association des salariés à la définition des stratégies de l'entreprise est considérée comme un fondement du modèle social allemand . Ainsi que l'ambassade de France en Allemagne l'a indiqué à vos rapporteurs, « la perception de l'efficacité de ce modèle a été renforcée en 2009 lors de la crise et vantée, par le patronat comme par le syndicat, comme une des raisons de la bonne résistance des entreprises et de l'emploi ».
La loi allemande prévoit en effet la participation de représentants des salariés au sein des conseils de surveillance, selon des modalités qui varient en fonction du statut de l'entreprise et du nombre de ses salariés (cf. titre I du présent rapport) :
- depuis 1976, les sociétés de capitaux de plus de 2 000 salariés ont un conseil de surveillance composé pour moitié de représentants des salariés ;
- les entreprises employant entre 500 et 2 000 personnes ont un conseil de surveillance composé au tiers de représentants des salariés ;
- pour les autres entreprises, aucune obligation n'est prévue.
Au Danemark , les salariés sont autorisés à choisir des représentants dès lors que l'entreprise concernée a employé au moins 35 personnes au cours des trois dernières années. Les salariés choisissent un nombre de représentants égal à la moitié de ceux élus par l'Assemblée générale de l'entreprise concernée. Les représentants des salariés ont les mêmes droits, obligations et responsabilités que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance. 26 % des entreprises danoises ont des représentants de salariés au sein de leur conseil d'administration .
En Suède , une loi de 1987 prévoit la participation de représentants des syndicats au sein des conseils d'administration des entreprises. Leur nombre varie en fonction de la taille de l'entreprise : 2 pour celles qui emploient au moins 25 salariés, 3 au-delà de 1.000 salariés. Ces membres ne peuvent qu'être minoritaires.
En France, les salariés sont représentés dans plusieurs grandes entreprises (Air France, Renault, France Telecom, LCL, GDF Suez, Thalès, EDF...). Dans d'autres entreprises, des sièges d'administrateurs salariés ont été récemment supprimés (Arcelor-Mittal, Bull), au motif d'accroître le nombre d'administrateurs « indépendants ».
2. Des appréciations contrastées
Des voix critiques s'élèvent néanmoins, selon lesquelles :
- la codétermination ralentirait le fonctionnement de l'entreprise notamment dans les périodes de crise où des décisions urgentes mériteraient d'être prises ;
- la codétermination ne serait pas adaptée aux exigences de la gouvernance de grands groupes internationaux , notamment car elle n'accorde de représentation qu'aux seuls salariés travaillant sur le territoire allemand.
Comme il a été dit au titre I du présent rapport, la Commission gouvernementale mise en place pour évaluer le système de codétermination allemand, présidée par M. Kurt Biendenkopf (2006), a toutefois conclu que le système d'implication des travailleurs allemands était bénéfique à l'économie de ce pays et qu'il pourrait l'être encore davantage dans le futur , tout en soulignant que l'Allemagne n'était pas aussi isolée en Europe qu'on le laissait parfois croire, d'autres pays pratiquant des formes diverses de codétermination.
La Commission souligne notamment deux points :
- d'une part, les membres des conseils et les managers jugent souvent le système positif : le fait qu'il implique des réunions séparées préalablement aux réunions du conseil de surveillance (représentants des actionnaires d'une part et représentants des salariés d'autre part) est notamment considéré comme un facteur d'efficacité ;
- d'autre part, les études économétriques ne plaident pas non plus massivement pour une remise en cause du système de codétermination , même si leurs résultats sont nuancés.
Toutefois, en pratique, la codétermination demeure fragile. La capacité réelle des salariés à peser sur les décisions est dépendante de conditions qui ne sont pas toujours réunies. Le champ des entreprises concernées est, presque par nature, réduit à celui des très grandes entreprises qui sont déjà celles où les intérêts des salariés sont a priori les mieux défendus. Par ailleurs, la participation des salariés au gouvernement des entreprises pose des problèmes délicats de conflits d'intérêts.
Dans la mesure où il est unanimement considéré qu'elle doit être mise en oeuvre sans nuire à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité du territoire, il peut être difficile d'imposer des points de vue qui, sans être incompatibles avec ces objectifs, supposent des démonstrations complexes peu en harmonie avec le fonctionnement courant des entreprises financiarisées du capitalisme contemporain.
Néanmoins, une telle participation pourrait avoir un intérêt pour la gouvernance de l'entreprise afin de faire émerger un consensus , qui peut se révéler très utile en période de crise, mais qui ne sera de toute façon possible que si le contexte est par ailleurs apaisé, s'agissant du dialogue social et de la participation des salariés à leur environnement de travail direct.
Le succès de cette idée repose aussi sur une modification du mode d'évaluation de la performance des entreprises. En effet, comment la gouvernance partenariale pourrait-elle émerger si l'entreprise demeure jugée à l'aune de ses performances actionnariales ?
B. D'AUTRES MODÈLES À PROMOUVOIR ?
Lors de leurs auditions, d'autres modèles ont été évoqués devant vos rapporteurs, susceptibles de constituer des contrepoids à la gouvernance actionnariale et aux logiques purement financières.
1. La promotion de l'actionnariat de long terme
Lors de son audition par la Délégation à la prospective, M. Jean-Louis Beffa a indiqué : « La question de l'actionnariat des entreprises n'a pas été convenablement traitée : en France les investisseurs court-termistes, sans affectio societatis , représentent une menace pour l'industrie. »
Pour contrer ces investisseurs court-termistes, M. Jean-Louis Beffa a critiqué les options choisies lors de la transposition en 2006 de la directive européenne relative aux offres publiques d'acquisition de 2004.
Il a préconisé :
- d'une part, de renforcer les dispositifs de protection existants contre les offres publiques d'acquisition hostiles (bons « Breton ») en les rendant possibles dans toutes les entreprises d'une certaine taille alors qu'ils font à l'heure actuelle l'objet d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires et en s'inspirant de l'exemple de l'Allemagne qui a transposé la directive OPA de façon plus souple que la France ;
- d'autre part, d'abaisser le seuil de déclenchement des OPA obligatoires, de 33,3 % à 20 % du capital ou des droits de vote, afin de réduire le risque de prise de contrôle « rampante ».
|
LE DISPOSITIF DE « POISON PILL » À LA FRANÇAISE : LES BONS « BRETON » Lors du vote de la loi relative aux offres publiques d'acquisition n° 2006-387 du 31 mars 2006, le gouvernement a introduit la faculté pour l'assemblée générale de la société visée par une OPA de décider ou d'autoriser l'émission, en période d'offre, de bons de souscription d'actions (BSA), susceptibles d'être attribués à tous les actionnaires de la société et permettant de souscrire à des conditions préférentielles. Toutefois, les modalités d'émission de tels bons demeurent strictement encadrées, en application de l'article 9 de la directive européenne de 2004 sur les OPA . Le principe de l'émission, les conditions d'exercice et les caractéristiques des BSA requièrent en effet une décision ou une délégation de compétence préalable de l'assemblée générale. Dans tous les cas, l'assemblée générale doit fixer le montant maximal de l'augmentation de capital et le nombre maximal de bons émis, selon un régime analogue à celui du droit commun des augmentations de capital. Si un ou plusieurs attaquants n'appliquent pas l'article 9 de la directive ou des mesures équivalentes, la société cible peut invoquer la clause de réciprocité et les dirigeants peuvent prendre des mesures de défense, en particulier émettre des BSA, sans réunir à nouveau l'assemblée générale . L'émission des BSA peut donc procéder d'une délégation antérieurement accordée par l'assemblée générale. Lorsque les mesures de défense ont été décidées « à froid », elles doivent avoir été expressément autorisées par l'assemblée générale dans les 18 mois précédant l'offre. Plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne) ont pour leur part choisi de rendre l'article 9 de la directive facultatif, conservant ainsi une plus grande souplesse d'utilisation de leurs mesures de défense. |
D'autres conditions d'un engagement de plus long terme des propriétaires du capital des entreprises sont mentionnées plus avant dans le présent rapport, qui montrent le caractère quelque peu héroïque d'un tel objectif dans un contexte où le capital, par sa mobilité même, peut, à tout moment, redéfinir ses modalités d'allocation.
2. La promotion de modes alternatifs de gouvernance
Les auditions menées par vos rapporteurs ont mis en évidence la diversité des entreprises et l'intérêt de certains modes de gouvernance qui reflèteraient davantage que d'autres l'existence d'un pacte social à l'intérieur de l'entreprise .
a) L'entreprise familiale
Ainsi, par exemple, M. Luc Darbonne, Président de FBN 338 ( * ) -France, a vanté les mérites de l'entreprise familiale .
En l'absence de définition juridique de ce type d'entreprises, on se réfère à un « faisceau d'indices » pour les identifier. Un certain nombre de critères prévalent, relatifs notamment au contrôle de la société : détention par la famille d'une partie significative du capital (mais pas forcément la majorité), pouvoir d'influence des actionnaires familiaux, direction familiale de l'entreprise. La pérennité du contrôle familial, c'est-à-dire sa transmission sur plusieurs générations, entre en compte.
D'après M. Luc Darbonne, ces entreprises seraient davantage fondées sur les relations humaines que les autres ; elles seraient plus structurantes pour leur région ; s'inscrivant sur plusieurs générations, elles seraient davantage ancrées dans le long terme . En conséquence, leur responsabilité sociale serait plus grande (« les employés font un peu partie de la famille »).
Par ailleurs, des études montrent que les entreprises familiales, comparées aux entreprises non familiales, se caractérisent par de meilleurs indicateurs de performances économique et financière ainsi que par une meilleure situation financière en termes de liquidité et de solvabilité : « Les résultats de ces études sont souvent interprétés comme la manifestation d'une gestion plus efficace résultant de la nature familiale des entreprises. Les arguments avancés, multiples, s'articulent essentiellement autour de quatre grands axes, eux-mêmes entremêlés : la réduction des coûts de contrôle et d'incitation des dirigeants non familiaux, l'orientation à long terme intergénérationnelle, l'homogénéité du système de valeurs et, enfin, l'imbrication de deux systèmes sociaux qui s'alimentent réciproquement, la famille et l'entreprise » 339 ( * ) .
La multiplication des travaux académiques au sujet de l'entreprise familiale constitue peut-être un « signal faible » pour l'avenir : loin d'être dépassé, ce modèle ne doit pas être négligé . En ce sens, les problèmes spécifiques qu'il rencontre, relatifs notamment à la succession des dirigeants, au salaire des membres de la famille, à l'indépendance de l'entreprise et à l'impact des querelles familiales sur la gouvernance, appellent des réflexions pour les surmonter.
Toutefois, il faut bien reconnaître que la création d'entreprises familiales ne se décrète pas et que ce « modèle » 340 ( * ) semble assez peu compatible dans les faits avec le développement du capitalisme financier qui paraît pour l'avenir représenter une tendance lourde.
b) L'entreprise coopérative
L'entreprise coopérative pourrait constituer un autre modèle de gouvernance partenariale et socialement responsable, fondée sur des valeurs communes à l'ensemble des participants.
La règle « 1 sociétaire = 1 voix » y entraînerait « une primauté de la personne sur le capital » 341 ( * ) , par opposition à la règle capitaliste qui institue la proportionnalité des voix aux apports.
D'après le Conseil supérieur de la coopération, « Les coopératives sont des sociétés qui placent l'homme, et non le capital, au coeur de leurs préoccupations et qui par leur sociétariat et leurs activités sont fortement ancrées dans les territoires ». Elles s'inscriraient « dans un mouvement historique de démocratisation de l'économie » 342 ( * ) .
D'après la Déclaration sur l'identité coopérative (1995) de l'Alliance coopérative internationale : « Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. »
Selon l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les coopératives sont des sociétés dont l'objet essentiel n'est pas de réaliser un bénéfice mais de répondre aux besoins économiques et sociaux de leurs membres. La loi énonce les principes régissant la vie des coopératives : démocratie, double qualité d'usager et de sociétaire, liberté d'adhésion, impartageabilité des réserves, rémunération limitée du capital. D'après le rapport précité du Conseil supérieur de la Coopération : « Aujourd'hui, dans une société en pleine mutation, marquée par la globalisation et l'émergence de nouvelles attentes , ces principes démontrent combien ils sont actuels et de nature à façonner l'avenir ».
|
LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES La loi du 10 septembre 1947 détermine les principes fondamentaux communs à l'ensemble des coopératives. Certaines sont par ailleurs régies par des dispositions particulières. - Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) , considérées lors de leur création (1978) comme une alternative au salariat, et formées par des travailleurs associés pour exercer en commun leur profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ; - les sociétés coopératives agricoles ; - les sociétés coopératives de commerçants détaillants ; - les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), créées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui ont pour objet la production et la fourniture de biens d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale, et associent autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... ( selon un modèle de multi-sociétariat typiquement « stakeholder » ) ; - la société coopérative européenne , issue d'un règlement de 2003 qui tente de concilier les principes humanistes de la coopérative avec les exigences de la concurrence. En France, la plus grande organisation coopérative est le Crédit Agricole (environ 6 millions de sociétaires, 2 500 caisses locales qui détiennent l'essentiel du capital de 39 caisses régionales). |
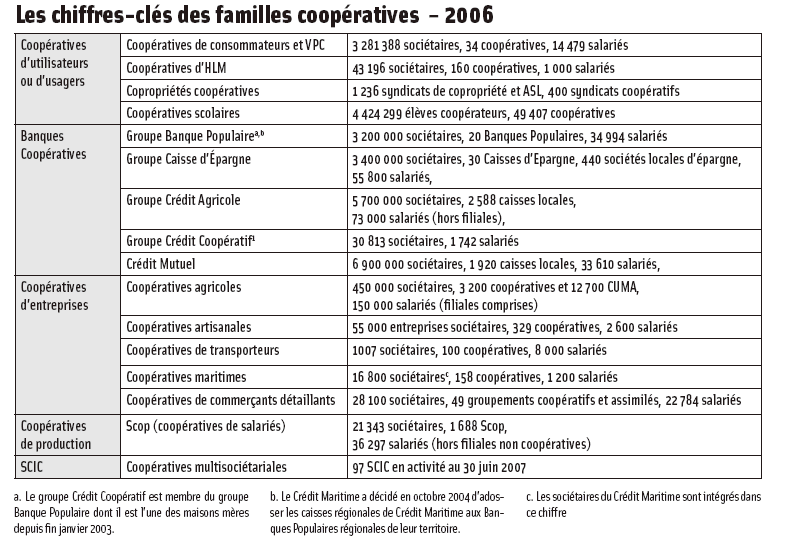
Source : Conseil supérieur de la coopération (2007)
Toutefois, « confrontées aux réalités économiques, les coopératives ont parfois du mal à préserver leur identité » 343 ( * ) . Certaines n'ont pas résisté à la concurrence, par exemple les coopératives de consommation qui se sont heurtées à l'expansion de la grande distribution.
Les coopératives n'échappent pas non plus au risque de distribution de leurs « bénéfices » (ristourne), préjudiciable à l'investissement.
Leur principal handicap réside dans le risque d'insuffisance de financement. Si la loi a été modifiée à plusieurs reprises, notamment pour autoriser l'appel à des capitaux extérieurs et préserver la compétitivité de ce type d'entreprises, c'est au risque d'une perte du contrôle des entreprises par leurs sociétaires et d'une modification de leurs orientations, c'est-à-dire d'une perte de leur identité spécifique.
c) La généralisation des comités indépendants portant sur des variables essentielles du pacte social dans l'entreprise ?
Depuis les années 1990, à la suite des rapports sur la gouvernance des entreprises de MM. Viénot (1995, 1999) et Bouton (2002), les conseils d'administration ou de surveillance de la plupart des grandes sociétés cotées ont mis en place, sur une base informelle à défaut de disposition législative expresse, des démembrements chargés de préparer leurs décisions relatives à la situation financière et comptable (comités des comptes), aux nominations (comités des nominations) et aux modalités de rémunération des dirigeants (comités des rémunérations).
Le code AFEP-MEDEF recommande une part prépondérante d'administrateurs indépendants dans ces comités : au moins 2/3 dans les comités des comptes, au moins la majorité dans les comités des nominations et les comités des rémunérations.
Les comités ne doivent pas dessaisir les conseils mais préparer leurs décisions et leur rendre compte. Pour exercer cette mission, ils peuvent solliciter des études techniques externes. Leur activité doit être décrite dans le rapport annuel de l'entreprise.
|
COMITÉS SPÉCIALISÉS DES CONSEILS
D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
Le nombre et la structure des comités dépendent de chaque conseil. Cependant, il est recommandé que : - l'examen des comptes, - le suivi de l'audit interne, - la sélection des commissaires aux comptes, - la politique de rémunération, - les nominations des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, fassent l'objet d'un travail préparatoire par un comité spécialisé du conseil d'administration. Source : code AFEP-MEDEF |
A l'avenir, il pourrait être utile d'explorer la possibilité de créer des comités sur d'autres variables essentielles du pacte social, ce qui contribuerait à rééquilibrer celui-ci dans un sens plus favorable au travail.
Ces variables auraient trait à la responsabilité sociale de l'entreprise notamment dans les domaines de l'emploi, de la politique des ressources humaines et du partage de la valeur ajoutée.
Ces comités pourraient être chargés d'examiner un certain nombre d'indicateurs de performance à définir et à publier dans leurs domaines de compétence respectifs.
*
* *
Pour échapper au scénario « noir » un certain nombre d'orientations peuvent donc être envisagées, consistant à encourager des modèles de gouvernance partenariale, assortis d'une évaluation « professionnelle » multicritères de la performance des entreprises.
Comme on le voit toutefois, s'agissant des coopératives, ou s'agissant plus généralement de la participation des salariés à la gouvernance des entreprises, la voie à emprunter est très étroite , notamment en raison du contexte mondial qui semble devoir dicter assez largement les évolutions futures. Cette voie devrait donc s'inscrire dans le cadre d'une coopération internationale, et notamment européenne, renforcée.
CHAPITRE IV : RETOUR VERS UN DROIT SOCIAL MAÎTRISÉ
|
RÉSUMÉ DU CHAPITRE Le droit social du travail se dirigerait vers une architecture rénovée où, sans vouloir définir à lui seul l'intérêt général, l'Etat ne renoncerait pas à intervenir. La négociation sociale se développerait de façon plus équilibrée à la faveur d'un respect généralisé du dialogue social mais aussi d'un renforcement des légitimités syndicales, notamment par la mise à niveau de l'expertise, tandis qu'émergeraient les conditions d'édiction de normes internationales disciplinant le « dumping social ». Par ailleurs, les nouvelles normativités sociales feraient l'objet de certification et le « consumérisme social » gagnerait en maturité. |
I. LES PRÉALABLES À UNE MEILLEURE LÉGISLATION
Moins légiférer ne doit pas empêcher l'Etat de mieux légiférer en matière sociale, en se donnant, tout d'abord, les moyens d'évaluer et d'anticiper les besoins de normes nouvelles afin de s'attaquer aux vraies priorités en fonction d'une analyse à long terme des problèmes.
A. L'ÉVALUATION
Il importe, avant d'entreprendre une réforme, d'évaluer en profondeur la législation existante, en particulier les raisons de ses insuffisances, de forme, de fond ou liées à des difficultés d'application.
Le rapport annuel, précité, du Conseil d'Etat pour 2006, déplore, à cet égard, l'abandon implicite des études d'impact préalables à l'élaboration, pas seulement dans le domaine social, de nouvelles législations ou réglementations.
Dans un article publié dans la revue Esprit 344 ( * ) , Jean-Claude Barbier 345 ( * ) évoque, par ailleurs, à propos des tentatives récentes d'amélioration du fonctionnement du marché du travail « des réformes incessantes qui se succèdent depuis dix ans sans qu'elles soient clairement évaluées ».
Il affirme, plus loin, que « le système d'évaluation des actions (qu'il s'agisse d'emploi, d'insertion, de formation...), la connaissance de leurs résultats et de leur coût ont toujours été défectueux... ».
B. L'ANTICIPATION
Les priorités doivent être déterminées non seulement en fonction de l'ordre des urgences (d'après des considérations tactiques de court terme), mais aussi selon l'importance stratégique des problèmes à résoudre, ce qui nécessite une vision prospective des choses.
L'ancien Plan traitait des conditions du développement économique et social de la nation. Sa préparation faisait appel à une concertation entre les partenaires sociaux. Le rapport Chertier, précité, suggère une répartition des rôles, joués précédemment par le Commissariat, entre le Conseil économique social et environnemental (CESE), s'agissant du dialogue social et le Centre d'analyse stratégique (CAS) 346 ( * ) , responsable de la coordination d'une « co-production d'expertise » au sein de l'administration.
Sans faire leur l'ensemble de ces propositions, vos rapporteurs soulignent qu'il est souhaitable que l'Etat puisse disposer d'une analyse prospective de l'ensemble des déterminants du pacte social , intégrant des éléments économiques et des contributions des nouvelles instances de diagnostic (COR, COE, HCAAM) dans leurs domaines de compétence respectifs (retraites, emploi, dépenses de santé). Qu'il leur soit permis, incidemment, de souhaiter que la volonté de doter le Sénat d'une institution chargée de la prospective soit suivie de tous ses effets afin que la Haute Assemblée puisse constituer un pôle d'anticipation efficace au service du Sénat et du pays .
II. QUELLES PRIORITÉS ?
L'inversion des tendances au « laisser-aller », caractéristique du scénario au fil de l'eau, suppose, a contrario , une action réformatrice vigoureuse de l'Etat.
Le fonctionnement des entreprises et le droit social du travail créent des externalités (positives ou négatives) et un pacte social harmonieux représente un bien public, constats qui justifient l'intervention d'une autorité publique.
Mais, son intervention doit être guidée par le choix de priorités stratégiques, le respect d'exigences de qualité législative et s'accompagner d'un renouvellement de ses voies d'influence.
En effet, mieux légiférer ce peut être aussi légiférer autrement, en instaurant un cadre propice à la conclusion de normes sociales plus équilibrées.
A. LA PRÉPARATION DE L'AVENIR ET L'AMÉLIORATION DE LA COHÉSION SOCIALE
On en cite ci-après quelques exemples qui illustrent la légitimité d'une implication de l'Etat dans la définition du pacte social dans l'entreprise.
Des mesures d'ordre financier devront être prises pour couvrir les charges résultant du vieillissement de la population . L'emploi des seniors n'est pas seul en cause. La question concerne le pacte social dans l'entreprise dans la mesure où les prestations considérées sont financées majoritairement par des prélèvements obligatoires, domaine de choix régalien par excellence. Toute modification de notre système de prélèvements obligatoires nécessite une intervention du législateur (changement d'assiette, création de recettes nouvelles, privatisation...).
Les mêmes observations peuvent être faites au sujet d'une éventuelle augmentation des dépenses liées au chômage et, plus généralement, au financement de celles que devrait entraîner la mise en oeuvre, hautement souhaitable, d'une politique tendant à garantir l' employabilité de tous les travailleurs français.
Un recours à la loi serait également nécessaire pour la prise de toute mesure (modification du droit des sociétés, etc.) tendant à associer , d'une manière ou d'une autre, les salariés aux décisions stratégiques concernant l'avenir de leurs entreprises. Ceci permettrait aux travailleurs d'être associés à la gestion des entreprises et de ne pas être placé devant le fait accompli en cas de restructurations pouvant entraîner la fermeture de leur établissement ou une diminution de ses effectifs. Il pourrait en résulter une nette amélioration du climat social dans nos entreprises.
Mais il est probable que l'Etat devrait l'imposer.
B. CLARIFIER LA HIÉRARCHIE DES NORMES DU PACTE SOCIAL
1. Entre la branche et l'entreprise
Dans le document d'études, précité, de la DARES 347 ( * ) sur la négociation d'accords dérogatoires dans les entreprises, autorisée par la loi du 4 mai 2004, ses auteurs 348 ( * ) s'interrogent : « l'idée de donner plus d'autonomie aux négociateurs d'entreprise était sans doute très bonne pour relancer la négociation collective - reconnaissent-ils - mais fallait-il pour autant leur permettre de déroger à une convention couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ? « On peut en douter » estiment-ils.
Dans un article paru dans la revue Droit social 349 ( * ) , Gérard Lyon-Caen observait, de son côté, au vu du document de travail préparatoire remis par le Ministère du Travail aux partenaires sociaux, avant le vote du texte en question, qu'« on ne peut donner vie à un tel système que si la loi a strictement défini ce qui relève de la compétence de chaque niveau ». Cela reste à faire.
En attendant, constatent les experts de la DARES, les branches ont substitué une hiérarchie conventionnelle à la hiérarchie légale. « Elles l'ont fait - soulignent-ils - par le biais de clauses d'interdiction de déroger particulièrement sophistiquées dont l'intrication finit par rendre indéchiffrable cette hiérarchie ».
Elles se sont ainsi arrogé des pouvoirs importants.
La loi doit préciser les règles du jeu pour mettre fin à l'insécurité juridique que crée une complexité excessive des règles de droit.
2. Une nouvelle articulation entre contrat de travail et accords collectifs ?
Dans un récent numéro de la revue française d'économie 350 ( * ) , Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, partisans d'une refondation du droit social 351 ( * ) à partir d'un développement du droit conventionnel aux dépens du droit réglementaire, se posent la question de l'autonomie du contrat de travail à l'égard des conventions collectives.
Constatant qu'en Allemagne des accords conventionnels de réduction transitoire de la durée du travail et des salaires s'incorporent au contrat de travail et permettent de préserver les emplois, dans une conjoncture défavorable, ils se demandent si les relations entre les accords collectifs et le contrat de travail ne pourraient pas être réformées dans cet esprit en France.
Il conviendrait, selon eux, d'empêcher que le respect des éléments individuels du contrat de travail puisse faire obstacle à l'application d'un accord d'entreprise favorable à l'emploi.
Mais une telle restriction de l'autonomie des contrats par rapport aux conventions collectives (à défaut de pouvoir, comme en Allemagne, incorporer les avantages de l'accord d'entreprise dans le contrat lui-même) irait à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation 352 ( * ) .
Jacques Barthélémy et Gilbert Cette préconisent donc que seuls les éléments substantiels absolus du contrat 353 ( * ) puissent désormais être opposés à un accord collectif.
Un ANI (accord national interprofessionnel), décliné dans des accords de branche, puis d'entreprise, définirait cette nouvelle articulation entre contrat de travail et accord collectif, qui permettrait aux partenaires sociaux de protéger plus efficacement les emplois en cas de retournement défavorable de la conjoncture.
Cependant, un tel dispositif constituerait une atteinte particulièrement forte aux principes ordonnant le droit des conventions si bien que même la suggestion des deux experts, qu'à moyen et long terme, ce soit la protection des personnes « qui (paraisse) l'axe stratégique le plus efficace... car elle permet de limiter le coût social des ajustements économiques structurels souhaitables », ne parvient pas à dissiper tous les doutes.
Au demeurant, même si, formellement, de telles analyses peuvent sembler pertinentes, il n'est pas sûr qu'elles décrivent la réalité. Dans ces conditions, il est douteux qu'elles débouchent sur des solutions satisfaisantes.
C. SIMPLIFIER PAR AILLEURS LE DROIT DU TRAVAIL
1. La nécessité de légiférer
Le Conseil d'Etat conclut son rapport sur 2006, dans lequel il dénonce l'insécurité juridique résultant de la complexité excessive de la législation, par les propos suivants auxquels votre délégation ne peut que souscrire :
« Pour éviter que l'intempérance normative ne débouche sur l'insignifiance des normes... on ne saurait tenir pour dérisoire qu'il faille encore écrire une loi, c'est le moyen d'arracher les lois au désordre, d'en faire moins et de meilleures ».
« Y renoncer reviendrait à s'abandonner à des fatalités dont on a assez dit les conséquences perverses pour mesurer l'urgence de les conjurer ».
2. Des exemples récents et des propositions nouvelles
La fusion au sein de « pôle emploi », par la loi du 13 février 2008, de l'ANPE et des ASSEDIC, procède de la volonté d'adresser les demandeurs d'emploi à un seul et même interlocuteur.
La création du contrat unique d'insertion (CUI) par la loi du 1 er décembre 2008 sur le revenu de solidarité active (RSA) constitue un autre exemple de recherche de simplification.
Le rapport « Cahuc-Kramarz » du 2 décembre 2004 proposait d'aller encore beaucoup plus loin dans cette voie avec l'unification de tous les contrats de travail en un seul. La pratique des licenciements aurait été, de son côté, facilitée avec un calcul des indemnités en fonction de l'ancienneté et l'instauration d'une contribution de solidarité à la charge de l'employeur.
Cette dernière proposition n'a, semble-t-il, recueilli qu'un accueil mitigé de la part des partenaires sociaux.
3. Un effort à amplifier et à poursuivre
La loi de modernisation du marché du travail du 26 juin 2008 n'a pas été dans ce sens.
Au contraire, elle a créé une variété de plus de contrat à durée déterminée (CDD), à objet défini. Mais elle a, en revanche, simplifié le droit de licenciement en supprimant, dans la détermination du montant de l'indemnité légale, la distinction faite selon le caractère économique ou non de la mesure.
Dans ces conditions, Jean-Claude Barbier 354 ( * ) a pu écrire dans la revue Esprit 355 ( * ) que « plus qu'un dualisme du marché du travail (CDI et CDD), c'est plutôt une multiple segmentation qu'on observe... un émiettement des statuts d'emploi ». Tous les CDD ne s'équivalent pas, l'intérim s'est extrêmement diversifié. La part des formes particulières d'emploi est particulièrement élevée chez les jeunes.
Concernant la prévision des effets des réformes de 2007-2008, il s'interroge :
« va-t-on constater une rupture de trajectoire dans les faits ? » (une amorce d'émancipation ?)
« ou le poids du passé, l'empreinte des origines, la lourdeur des systèmes d'acteurs vont-ils graduellement digérer les projets qui ne déboucheront, à la fin que sur une couche supplémentaire de complexité ? » (triomphe du « fil de l'eau » ?).
D. RECOURIR À D'AUTRES VOIES DE PRODUCTION DE NORMES SOCIALES
On a pu indiquer (v. le rapport annuel du Conseil d'Etat pour 2006) que le développement de la « soft law » pouvait être vu comme une atteinte possible à l'Etat de droit.
Mais, inversement, ne peut-on pas prévoir que la « soft law » puisse devenir un droit de l'Etat ?
Dans les démocraties, la question de la source réelle du pouvoir s'est toujours posée au-delà de la fiction essentielle mais un peu formelle du pouvoir majoritaire.
Dans les démocraties contemporaines, cette question doit être actualisée au vu du rôle de plus en plus important des « faiseurs d'opinion » et de l'incidence d'un décalage entre l'espace de la souveraineté politique et celui (mondialisé) où se posent concrètement les questions politiques.
En bref, les conditions formelles de la souveraineté nationale doivent se frotter au principe de réalité qui révèle des horizons radicalement différents de celui de ces conditions.
Dans ce contexte, plutôt que d'imaginer maintenir les formes traditionnelles de son action, l'Etat peut avoir intérêt à en susciter des formes nouvelles.
Ainsi, en raison d'un état donné de l'opinion de l'électeur médian, il peut vouloir en appeler à d'autres influences qui peuvent lui permettre de surmonter ces résistances. De même, le recours à une diplomatie par l'opinion publique transnationale peut être un moyen de passer outre les limites de la diplomatie la plus traditionnelle.
A condition qu'il soit maîtrisé, l'essor de la « soft law » peut devenir un moyen efficace pour modifier le pacte social dans l'entreprise.
S'il est bien vrai que c'est à partir d'une culture de marché que des variables fondamentales du pacte social dans l'entreprise ont été dessinées, d'autres cultures pourraient être suscitées ou, du moins, reconnues par les Etats.
A cet égard, les critiques adressées aux agences de notation sociale qui épousent étroitement celles des agences de notation financière symbolisent l'importance d'ordonner selon des fins stratégiques un droit nouveau pouvant devenir un référentiel efficace pour une réforme du pacte social dans l'entreprise.
Un tel programme suppose de définir les conditions d'une culture plus diversifiée et d'une adjudication des normes qu'elle suscite, conformes aux principes d'un Etat démocratique c'est-à-dire où la majorité agit dans le respect de la minorité et des valeurs de la Nation.
III. DES CONDITIONS HÉROÏQUES
A. L'AMÉLIORATION DU CLIMAT SOCIAL
Il ne suffit pas d'élaborer de bonnes lois, encore faut-il que les innovations juridiques qu'elles contiennent soient réellement acceptées et appliquées par les partenaires sociaux.
Les exemples des dérogations à la hiérarchie des normes ou des modalités spécifiques de négociations d'accords dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical montrent que ce n'est pas toujours le cas. De nouvelles facultés prévues par le législateur, n'ont été pour le moment que faiblement utilisées.
Par ailleurs, le dialogue social laisse encore à désirer dans notre pays, c'est un lieu commun que de le souligner.
Dans le numéro, précité, de la revue Esprit 356 ( * ) , Jacques Le Goff 357 ( * ) rappelle les propos de l'ancien secrétaire national de la CFDT, Jean-Paul Jacquier, comparant, dans son récent ouvrage « L'introuvable dialogue social », la négociation collective en France à « une pratique sans la foi ».
Jacques Le Goff estime cependant qu'à l'« antagonisme systématique d'antan » se substitue progressivement un « protagonisme » dans des négociations devenues plus transactionnelles.
Dans le même numéro d'Esprit, Annette Jobert 358 ( * ) fait référence à une autre expression de Jean-Paul Jacquier parlant d'« un pays qui n'aime pas négocier ».
Elle estime que « malgré des progrès certains, le constat global, formulé par de nombreux observateurs, est celui d'un dialogue social fragmenté, incomplet, fragile, qui ne répond pas aux exigences d'une véritable démocratie sociale (dont la faiblesse peut être mesurée par celle du taux de participation aux élections prud'homales), ni aux enjeux des transformations économiques et sociales ».
Dénonçant les « faux-semblant de la concertation », elle constate le rôle central que l'Etat continue à jouer dans les relations sociales et met en cause aussi bien les réticences du patronat que les faiblesses et la division du mouvement syndical. Il est à craindre que la loi - celle du 4 mai 2004 prévoit déjà une obligation préalable de concertation sur tout projet gouvernemental de réforme sociale - ne suffise pas, à elle seule, à accélérer le changement des mentalités autant qu'il serait souhaitable.
Il est à espérer - comme cela a déjà été souligné plus haut - que les acteurs sociaux parviennent d'abord à un diagnostic partagé des problèmes (à partir d'une analyse commune réellement prospective et stratégique), sur lequel ils puissent ensuite construire des compromis.
En ce sens, outre le rôle que doivent jouer les institutions de débat (tel le Conseil économique, social et environnemental) ou de dialogue entre partenaires sociaux et responsables politico-administratifs, l'idée de partager un état des lieux entre partenaires sociaux et Etat peut apparaître comme un progrès.
B. LA LABORIEUSE GESTATION D'UNE EUROPE SOCIALE PLUS INTÉGRÉE
1. Une harmonisation voulue par les traités fondateurs de l'Union
Dans le traité de Rome de 1957, modifié par les traités de Maastricht et de Lisbonne, et intégré dans le traité CE sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est prévu que l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main d'oeuvre dépende d'une harmonisation des systèmes sociaux découlant elle-même :
- d'une part, des effets bénéfiques du fonctionnement du marché commun ;
- d'autre part d'un rapprochement des dispositions législatives et réglementaires, et administratives des Etats membres .
La santé et la politique sociale font l'objet d'articles spécifiques de ce traité consolidé, dit « traité CE » ou « premier pilier » de l'architecture institutionnelle européenne, pour lequel les transferts de compétence et de souveraineté des Etats membres à l'Union sont les plus importants.
Cela signifie que les Etats membres peuvent légiférer et adopter dans ces domaines des actes juridiquement contraignants, mais seulement en ce qui concerne les aspects définis par ledit traité.
2. Une progression heurtée
a) Des avancées significatives
Par rapport à celui initialement signé dans la capitale italienne, en 1957, des avancées ont été réalisées par :
- l' Acte unique européen de 1986 qui a consacré l'importance du dialogue social au niveau européen (la directive relative aux comités d'entreprise européens a, sur ces bases, favorisé, en 1994, la défense des droits des travailleurs dans les entreprises multinationales) ;
- le traité de Maastricht de 1992 , auquel a été annexé un pacte social postérieurement intégré au traité d'Amsterdam de 1997 (il est prévu, notamment, que les partenaires sociaux, obligatoirement consultés par la commission européenne sur toute proposition sociale de celle-ci, puissent en outre demander que leur avis soit transmis au Conseil pour être transformé en loi ou appliqué par chaque Etat membre) ;
b) Des ambitions réduites
En revanche, le traité d'Amsterdam, à d'autres égards, s'est révélé décevant, en substituant, notamment, à la volonté d'harmoniser les politiques sociales ou d'élaborer des normes communes, l'objectif d'un simple effort de coordination des actions des différents pays concernés.
La commission ne peut formuler dans ces domaines que des recommandations non contraignantes.
Les matières « sensibles » sont soit exclues de la compétence communautaire (droit d'association et de grève, ...), soit régies par la règle de l'unanimité (sécurité sociale, ...).
c) Des espoirs renaissants
Néanmoins, certaines mesures concernant la protection des travailleurs peuvent être décidées à la majorité qualifiée 359 ( * ) , en vertu de l'article 137 du traité CE, ou par une décision unanime du Conseil.
En outre, les domaines dans lesquels ces décisions à la majorité peuvent être prises sont importants : il s'agit de la santé et de la sécurité des travailleurs, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail , de l'égalité entre hommes et femmes, etc.
Le Conseil pourrait également, s'il l'entend, ajouter à ces questions celle de la protection des travailleurs en cas de résiliation de leurs contrats .
Concernant les directives adoptées, non seulement elles ont cherché à faciliter la mobilité du travail et des entreprises en Europe, mais elles se sont efforcées aussi d'améliorer la protection des salariés à d'autres égards, notamment lorsque des restructurations se produisent (directives sur les droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, sur le rapprochement des législations relatives aux licenciements collectifs , ...).
3. Des compétences partagées entre l'Union et les Etats
De fait, les questions sociales en Europe relèvent de compétences partagées entre l'Union et les Etats.
a) Les intentions de la commission
La commission, on l'a vu, ne dispose, en la matière, que d'un simple pouvoir de recommandation.
Dans un livre vert, publié en 2006, intitulé « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle », elle s'est intéressée notamment à la flexisécurité avec le souci d'associer un minimum de droits sociaux aux nouvelles formes de travail plus souples qui se développent (en vue de remédier aux inconvénients de l'insécurité juridique liée aux contrats de travail atypiques).
Plus récemment, en novembre 2010, elle a présenté cinquante propositions tendant à relancer le marché unique et à lui donner une dimension plus sociale . Elle fait figurer, parmi ses objectifs, des mesures destinées à :
- renforcer la solidarité (droits sociaux fondamentaux) ;
- assurer à tous un accès à l'emploi et à la formation tout au long de la vie ;
- lancer une consultation publique en matière de gouvernance des entreprises.
b) Les propositions du Centre d'analyse stratégique
Dans un document 360 ( * ) paru en 2007, le Centre d'analyse stratégique (CAS) s'était demandé, de son côté, comment relancer la dimension sociale du projet européen.
« On se rend compte aujourd'hui - était-il écrit - que le progrès social ne résulte pas automatiquement du fonctionnement du marché intérieur et que celui-ci peut aussi, notamment à court terme, accroître les inégalités ».
Le CAS faisait figurer parmi ses priorités « un fonctionnement harmonieux du marché intérieur sur le plan social », ainsi que « la mise en place d'outils facilitant la prévention et la gestion des transitions professionnelles répétées ».
c) Les obstacles au rêve d'un modèle social européen
Mais la concrétisation de ces intentions échappe à la seule volonté de la France.
Une réelle harmonisation des législations tendant à empêcher les distorsions de concurrence d'origine fiscale et la course, en Europe, au moins-disant social, serait pourtant l'un des principaux facteurs souhaitable d'émancipation par rapport aux pesanteurs du scénario au fil de l'eau.
Mais est-elle possible ?
Dans le numéro précité de la revue Esprit, Jacques Le Goff s'interroge : « Peut-on concevoir - se demande-t-il - un modèle européen qui ne soit pas seulement défensif ou résiduel ? ».
Il appelle, d'un côté, de ses voeux une flexisécurité européenne qui lie travail et protection, « en étendant la sécurité au-delà des risques classiques » (maladie, chômage), y compris la formation et les transitions professionnelles (et aussi l'égalité et la conciliation entre travail et vie privée).
Mais il estime, par ailleurs, que « partout, la crise provoque le retour de l'Etat. Et ce retour se traduira sans doutes - selon lui - par l'accentuation des spécialités nationales, y compris dans le mode de négociation collective ».
Dans cette même édition de la revue précitée, Alain Supiot 361 ( * ) regrette que l'élargissement ait conduit, selon ses termes, « à saper les bases politiques d'un modèle social européen déjà bien fragile ».
De son côté, Marc Clément 362 ( * ) estime que « l'émergence d'une protection sociale européenne ne pourra que prendre la forme de normes, en l'état actuel d'une Europe qui se construit par le droit ».
« Nous devrons vivre encore de nombreuses années » observe-t-il « dans un régime où la question de l'articulation entre les différents systèmes de protection sociale nationaux et le marché unique continuera de se poser ».
Beaucoup des concepts fondamentaux en cause sont entendus, selon lui, différemment par les Européens suivant leur culture nationale. C'est là que se situe une des très grandes difficultés d'une approche européenne de la protection sociale. En effet, les mêmes termes ne signifient pas les mêmes choses dans les différentes langues (les expressions françaises « partenaires sociaux » ou « précarité », par exemple, sont difficilement traduisibles en anglais).
Il faut d'abord, conclut-il, que les citoyens européens aient le sentiment d'appartenance à une même communauté avant de vouloir leur imposer un même système de protection sociale .
Ces remarques sont évidemment transposables au périmètre du pacte social dans l'entreprise. Elles posent la question des facteurs de rapprochement des préférences collectives des Etats membres.
Cette interrogation a bien sûr de multiples facettes. Parmi elles, il semble utile de réfléchir à des conditions plus démocratiques et plus pluralistes de décision publique en Europe. L'ouverture d'un chantier politique de définition de l'Europe sociale et de sa gouvernance (pourquoi pas un « pacte social de croissance » ?) paraît une priorité non seulement d'ordre social mais aussi d'ordre économique et sur le plan même de la cohésion politique de l'Europe.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa séance du mardi 18 janvier 2011, tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin, président , la délégation sénatoriale à la prospective a procédé à l'examen du rapport d'information sur la prospective du pacte social dans l'entreprise, de M. Joël Bourdin et Mme Patricia Schillinger, rapporteurs .
M. Joël Bourdin, président, rapporteur . - Le Président du Sénat a souhaité, par lettre du 15 décembre 2009, que la Délégation à la prospective réfléchisse à l'avenir du pacte social tel qu'il fonctionne à l'intérieur des entreprises et qu'elle développe ainsi une réflexion pour une nouvelle gouvernance dans l'entreprise.
Un certain nombre de champs ont été offerts à nos analyses par la lettre du Président : le partage de la valeur ajoutée et les domaines que recouvre la notion de relations sociales : la politique managériale, la politique salariale, la représentation et l'implication des salariés.
Nous avons travaillé sur ces sujets, dans l'esprit des travaux de prospective, c'est-à-dire en commençant par établir des diagnostics pour, ensuite, dessiner des futurs possibles.
Nous avons procédé à de nombreuses auditions et à une revue très considérable de littérature. Nous avons aussi sollicité les représentations extérieures de la France par un questionnaire portant sur dix pays.
Avant d'exposer nos principales conclusions, il faut mentionner quelques-unes des nombreuses difficultés que rencontre la réflexion sur le pacte social dans l'entreprise.
La première difficulté est, bien sûr, de délimiter le sujet. Il n'est pas évident de définir ce qu'est l'entreprise et d'identifier les acteurs qu'elle mobilise. Il est également difficile de circonscrire ce qui, dans notre pacte social national, relève spécifiquement du système de relations qui s'instaure dans l'entreprise.
Ce sont d'ailleurs des conclusions à nos yeux importantes du rapport que d'insister sur la complexification des entreprises, sur la diversification de leurs situations et sur leur intégration à un système économique et social englobant où leurs marges de manoeuvre, ainsi que celles d'éventuels régulateurs, sont très loin d'être absolues.
Deuxième difficulté : au-delà des observations qu'on peut réunir, l'autre élément du diagnostic, celui concernant les causes, est souvent hypothétique et incertain.
Cette difficulté invite à la modestie ; elle plaide aussi pour des politiques publiques reposant davantage sur l'expérimentation, avec cependant les problèmes que pose toute expérimentation dans le champ du social, qui implique des hommes. Par ailleurs, les positions des acteurs, si elles sont souvent conflictuelles, sont aussi souvent déconcertantes, comme en témoigne l'opposition des syndicats à une plus forte implication dans les conseils d'administration des entreprises.
J'en viens au coeur du rapport, qui s'ordonne en trois parties, la première consacrée aux diagnostics, les deux dernières aux perspectives.
Dans l'ensemble, la ligne directrice du rapport est que, sauf à s'exposer à de sérieux revers, le fonctionnement du pacte social dans l'entreprise doit être significativement amélioré dans le sens d'une meilleure reconnaissance des salariés et d'une revalorisation du travail.
Les trois parties du rapport ont une structure commune qui traite successivement des rémunérations, de la gestion du personnel, des relations sociales et du gouvernement des entreprises et des aspects juridiques.
Dans la première partie, celle qui porte sur les diagnostics, nous constatons en premier lieu que le pouvoir d'achat des salaires ne s'améliore plus que très lentement. Par ailleurs, les inégalités se renforcent, le chômage étant en permanence la toile de fond du salariat.
En ce qui concerne le ralentissement de la progression du pouvoir d'achat du salaire par tête, la responsabilité de ce phénomène est souvent recherchée, à juste titre, du côté de la décélération des gains de productivité. Mais cette explication n'épuise pas le sujet : il faut encore compter avec les conditions de partage de la valeur ajoutée.
Le ralentissement des gains de productivité est paradoxal alors même que l'objectif de maximisation de la productivité est une caractéristique dominante de l'air du temps. On peut même avancer que des composantes essentielles de la situation sociale du pays, la faible dynamique des salaires, les inégalités, le chômage, les conditions de travail... résultent de cet impératif de productivité, et que ce qui apparaît comme des « coûts sociaux » a été engagé pour améliorer la productivité du système de production français. Or, quand on réunit tous les indicateurs, on relève que le rythme des gains de productivité est plus faible qu'il n'a jamais été depuis des décennies. On ne peut s'empêcher de constater que les modifications destinées à maximiser la productivité ont entraîné des coûts sociaux mais n'ont pas exercé d'effets très favorables. Ce problème est développé dans les parties plus prospectives du rapport. Sa résolution apparaît comme un enjeu essentiel pour l'avenir et nous y reviendrons.
Mais, l'atonie du pouvoir d'achat du salaire par tête nous semble devoir s'expliquer aussi par la déformation du partage de la valeur ajoutée, qui est commune à de très nombreux pays.
Pour la France, deux rapports récents, l'un au Président de la République, l'autre au Premier Ministre, ont défendu l'idée d'une stabilité de ce partage depuis les années 1990.
Pour notre part, nous inclinons, pour des raisons techniques et conceptuelles, que nous exposons longuement dans le rapport, à nuancer la conclusion selon laquelle le partage de la valeur ajoutée entre la rémunération du travail - les salaires - et celle du capital - les profits - aurait été stable depuis vingt ans en France. En réalité, il est assez probable que la déformation très nette du partage de la valeur ajoutée intervenue dans les années 80 se soit, quoiqu'avec plus de modération, prolongée.
Mais, même en raisonnant sur les données conventionnelles utilisées dans les rapports cités, la part de la valeur ajoutée allant aux salaires est plus basse de plusieurs points de PIB par rapport à la moyenne historique sur soixante ans, et inférieure de près de 10 points de PIB par rapport au pic des années 70. En outre, on doit relever que la concentration des gains salariaux sur quelques-uns implique pour près de 80 % des salariés une réduction encore plus nette de la valeur ajoutée qui leur est attribuée.
Ainsi, les modalités de la répartition du revenu national constituent bien un frein aux salaires.
Quant aux inégalités salariales, qui sont souvent plus faibles en France qu'ailleurs, elles augmentent et restent paradoxales dans un pays où il existe, notamment avec le SMIC, des instruments de politique des revenus. Elles sont le produit de multiples facteurs où jouent notamment l'envolée des rémunérations des cadres dirigeants et la précarisation de nombreux salariés, en lien avec celle des emplois qu'ils occupent.
La part des salaires attribuée au centième des salaires les mieux payés augmente continuellement depuis la fin des années quatre-vingt-dix.
Le salariat moyen n'obtient, quant à lui, que peu de revalorisations salariales. Plus qualitativement, on observe que le régime salarial se variabilise avec la généralisation des revalorisations salariales conditionnées à la performance et un écart grandissant des situations selon l'appartenance à tel secteur économique ou à telle entreprise. Cette dernière dimension des inégalités salariales, qui se combinent avec une répartition inégale des risques de chômage ou de travail atypique, ressort comme particulièrement importante. Par ailleurs, la situation des salariés dépend négativement de leur appartenance à une entreprise sous-traitante. La pire des situations semble être celle des salariés à temps partiel des entreprises sous-traitantes, plus globalement celle des « intermittents du travail ».
Au total, plusieurs constats s'imposent. Il apparaît d'abord que la dynamique des salaires est faible. La masse salariale brute augmente moins vite que la production ; le salaire brut par tête croît moins vite que la masse salariale ; les salaires nets progressent moins que les salaires bruts.
On constate également un accroissement des inégalités devant le travail. Les inégalités de salaires augmentent ainsi que les inégalités face au chômage et face aux modalités du travail. Les travailleurs des secteurs économiquement dominés ainsi que les jeunes et les seniors sont discriminés par les mécanismes de marché.
En second lieu, le diagnostic sur le pacte social dans l'entreprise conduit à constater d'indéniables tensions sur les conditions de travail.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - L'analyse des évolutions relatives au management, aux conditions et à l'organisation du travail, montre les tensions créées par l'impératif de productivité. Une véritable redéfinition des termes du rapport de travail est intervenue.
Naguère, les salariés bénéficiaient d'une certaine sécurité matérielle faite de protection des emplois, de progressivité des rémunérations et de carrières prévisibles, moyennant une liberté réduite dans le travail caractérisée par une faible autonomie. Ce modèle « fordiste », reposant largement sur un équilibre de droits et de devoirs définis dans autant de statuts, s'est considérablement affaibli depuis une trentaine d'années, au profit d'un couple « opportunités-responsabilités ».
Pour la sécurité, dans le nouveau modèle, on mise désormais sur l'« employabilité ». Mais, dans les faits, cet objectif ne comble pas toujours le vide creusé par le délitement des carrières. Malgré certaines évolutions du système de formation continue et l'acclimatation théorique d'une « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » dans les grandes entreprises, pour nombre de salariés, le compte n'y est pas. La perte d'emploi est un déclassement, plus ou moins durable, dont pâtit également l'économie sous forme de pertes de croissance.
Parallèlement, l'autonomie dont jouiraient désormais les salariés - en contrepartie de leur responsabilisation - paraît souvent illusoire. Sur fond d'intensification du travail, d'horaires flexibilisés et d'exigences financière de court terme, un faisceau accru de contraintes de toutes sortes enserre de plus en plus leur activité. En contraste avec un travail souvent « mythifié » par le discours managérial, de nombreux salariés se sentent « mystifiés »...
Le rapport sécurité/autonomie évolue donc défavorablement, avec d'importantes nuances selon la configuration productive. Cette dégradation de la qualité du travail peut se révéler in fine préjudiciable à la performance globale des entreprises et de l'économie nationale.
Il faut ici souligner que la précarisation du travail est subie différemment selon l'entreprise à laquelle on appartient et selon le rang occupé dans le salariat - ce qui va dans le sens d'une segmentation du salariat. Toutefois, les opérateurs relativement protégés semblent de moins en moins nombreux comme l'illustre l'apparition d'un chômage des cadres de plus en plus courant dans les années 90.
En troisième lieu, le diagnostic porte sur les relations sociales et la gouvernance.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - A la segmentation du salariat répond le processus de segmentation des entreprises. Celles-ci ont beaucoup évolué ces dernières années. L'entreprise, unité de base de notre organisation économique, est l'un des principaux lieux d'élaboration et d'application du pacte social. Pour plus de 17 millions de salariés, elle constitue l'un des principaux cadres normatifs de leur vie quotidienne sans pour autant que la légitimité de l'entreprise et de son organisation soit un sujet majeur du débat public.
Ce point nous amène à la question de la gouvernance des entreprises.
S'il n'existe pas un modèle unique, on observe néanmoins quelques grandes tendances historiques. D'abord, au cours du vingtième siècle, en conséquence de la nécessité d'accumuler du capital en vue de l'industrialisation, le pouvoir est passé progressivement de l'entrepreneur familial au manager technocrate, puis aux actionnaires et investisseurs financiers. Il en a résulté une progressive dépersonnalisation des relations dans l'entreprise.
Ensuite, les salariés travaillent aujourd'hui en moyenne dans des entreprises plus grandes qu'il y a trente ans, mais au sein d'établissements plus petits ce qui accroît le sentiment de distance par rapport aux lieux de décision.
Enfin, l'émergence d'entreprises fonctionnant en réseaux a aussi modifié les relations entre parties prenantes, les relations interentreprises devenant un facteur déterminant de réalisation du pacte social.
La question que nous avons envisagée est de savoir si la gouvernance des entreprises s'est adaptée à ces évolutions.
La participation des salariés à la gestion des entreprises s'est développée, en France, grâce à des mécanismes de représentation, d'information et de consultation, plutôt que par l'association aux instances décisionnelles. Parallèlement, le contexte de la démocratie sociale a évolué dans un sens plutôt mitigé. Parmi les points négatifs, il faut mettre en évidence la baisse du taux de syndicalisation, passé d'environ 30 % à environ 8 % des salariés depuis l'après-guerre. Au regard des pays étrangers, la France apparaît comme particulièrement peu syndiquée.
Par ailleurs, alors qu'on pouvait espérer une certaine réhabilitation de l'entreprise, comme lieu de poursuite de finalités partagées, les excès du capitalisme financier ont au contraire mis l'accent sur les divergences d'intérêts des parties prenantes, divergences qui peinent à se résoudre de façon pragmatique, dans la négociation.
Les salariés semblent en effet avoir été les « oubliés » de la gouvernance, au nom de l'efficacité économique. Tandis que la cogestion apparaît comme un « serpent de mer » du débat politique, la suprématie actionnariale s'est progressivement instaurée dans les grandes entreprises tandis que dans le tissu économique des entreprises dominées, nécessité faisait de plus en plus loi. La suprématie actionnariale est pourtant contestée tant parce qu'elle déséquilibre les relations sociales que parce qu'elle déséquilibre les décisions économiques dans un sens peu compatible avec une croissance forte et durable. Dans ce contexte, la place des salariés est résiduelle et s'inscrit davantage dans le sens d'une reconnaissance de la place de l'actionnariat salarié que dans celui d'une prise en compte des intérêts du facteur de production que constitue le travail.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - En dernier lieu, le droit social du travail porte la marque de l'affirmation de l'objectif de maximisation de la productivité mais aussi des difficultés rencontrées dans la transition d'un modèle à l'autre.
L'un des principes les plus essentiels de l'édifice juridique qui constitue le droit social du travail, sa soumission à un objectif de mieux-disant social selon lequel les conventions entre partenaires sociaux ne pouvaient déroger aux dispositions plus générales que pour autant que le sort du salarié en soit amélioré, a été remis en cause. La perspective est de coller le plus possible aux réalités économiques et ainsi de favoriser l'élévation du niveau de productivité.
Dans ce même esprit, la légitimité de l'intervention de l'Etat dans le champ du social d'entreprise a été questionnée et, avec elle, la légitimité de l'Etat à définir l'intérêt général dans les domaines concernés.
Enfin, un droit international est apparu, tant au niveau mondial qu'européen, de même que de nouvelles formes de normativité dont la « soft law » représente un exemple archétype.
Mais, il faut bien reconnaître que cette diversification normative peine à remplir les mêmes fonctions que celles exercées par l'Etat dans le régime juridique traditionnel. Dans le même temps, la cohérence entre les assouplissements des principes du droit du travail et la préservation des intérêts des salariés, mais aussi des principes juridiques aussi essentiels que celui de l'égalité, peut être difficile à vérifier, notamment dans un contexte de désyndicalisation.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - J'en arrive à la deuxième partie du rapport, qui dessine un scénario noir pour le pacte social dans l'entreprise, celui de son éclatement. Il est préoccupant que ce scénario corresponde à la poursuite des tendances lourdes relevées dans la première partie du rapport.
Dans ce scénario noir, les conflits de répartition continueraient à se résoudre au détriment des rémunérations salariales. Le travail « paierait » d'autant moins que le vieillissement démographique s'accompagnerait d'un prélèvement accru sur les revenus de la production distribués aux salariés. Les différentes variables à l'oeuvre pour déterminer les parts respectives de la valeur ajoutée attribuées aux salaires et aux profits sont notamment le niveau du chômage, la diversification des opportunités d'investissement du capital, la financiarisation de l'économie, la constitution d'un marché du travail mondial, la restructuration des économies développées autour de leurs avantages comparatifs, la diffusion de modèles de croissance orientés vers la compétitivité et l'attractivité à court terme. Toutes ces variables pèseraient sur les salaires tout en permettant aux propriétaires du capital de défendre efficacement leur part du revenu national.
Mais le revenu national augmenterait de plus en plus lentement. La croissance potentielle baisserait notamment sous l'effet du choc démographique. Si l'épargne restait relativement abondante, la crainte de l'avenir entraînant une augmentation de l'épargne de précaution, elle pèserait sur la consommation sans s'investir pour autant sur le territoire économique national faute de perspectives de croissance. Elle préfèrerait les placements patrimoniaux, d'où la multiplication de bulles d'actifs, ou les profits offerts par les pays émergents à forte croissance.
Face à l'attrition des revenus, les besoins sociaux résultant du vieillissement démographique et des effets des restructurations économiques augmenteraient dans des proportions telles que toutes les faibles marges de manoeuvre des Etats y seraient consacrées. L'Etat n'investirait plus et les effets attendus des biens publics (éducation, environnement, innovation...) sur la croissance ne se produiraient pas.
Le chômage structurel augmenterait par incapacité à s'adapter au nouveau contexte économique et par sédimentation d'un chômage conjoncturel qui ne se résorberait jamais.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - Il n'y aurait pas d'autre choix que de flexibiliser les salaires et les emplois mais ces mesures aggraveraient le coût de transitions qui, du fait de la spirale récessive enclenchée par ces évolutions, n'en auraient que le nom. La segmentation du travail atteindrait des sommets avec une explosion des inégalités de répartition qui mineraient le contrat social dans son ensemble.
Dans ce scénario noir, le management exercerait des tensions renforcées sur le travail. Les entreprises se rabattraient, encore et toujours, sur le levier de l'organisation du travail pour soutenir tant bien que mal une productivité handicapée par un déficit cumulé de recherche et d'investissement.
Avec un niveau de qualification stagnant et un dialogue social toujours médiocre, les organisations « à flux tendus » s'approfondiraient avec un recours accru à des contrats courts pouvant aller jusqu'à la disparition du contrat de travail dans la mouvance de l'idée que chacun doit devenir un entrepreneur de lui-même.
Le reflux attendu du chômage se heurterait au socle structurel d'une population restée trop longtemps éloignée de l'emploi et de la formation. Cela fragiliserait le régime d'assurance chômage confronté à la contrainte globale du désendettement public et à la volonté de désengagement des entreprises les plus performantes, voire de certains salariés qui, copiant l'attitude de l'Etat, pourraient arguer de la stabilité de leur emploi pour se retirer du système.
La rigueur compromettrait aussi l'acclimatation de toute politique visant à améliorer vraiment l'employabilité, onéreuse en termes de formation et de logement.
Finalement, avec les contraintes multipliées d'organisations toujours plus finement calibrées en effectifs, les salariés endureraient une dégradation radicale du compromis sécurité/autonomie. On assisterait à une prolifération de troubles psychosociaux, à la généralisation des rancoeurs nées du défaut de reconnaissance, à une désincitation au travail, à la prolifération du travail clandestin et à l'amplification d'une émigration économique.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - Dans ce cadre, le scénario noir est aussi un scénario conflictuel susceptible de nuire à terme aux objectifs de productivité et de compétitivité de l'entreprise et de l'économie nationale.
Le transfert de pouvoir de l'entrepreneur familial au manager technocrate puis à l'investisseur financier « dilué » se poursuivrait dans le cadre d'une mondialisation non coopérative secouée par des crises ponctuelles. La distance physique aux lieux de décisions et la poursuite d'objectifs principalement financiers continueraient de miner le pacte social. Le dialogue social national demeurerait bipolaire, se révélant de plus en plus inadapté à la résolution de problèmes de dimension mondiale. Le gouvernement des entreprises ne trouverait plus de contrepoids que dans une opinion publique influençable et, peut-être, versatile.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - Dans le scénario noir, enfin, l'effritement du droit social du travail s'amplifierait. Au nom de la nécessaire souplesse sociale, la dérégulation se poursuivrait à la faveur d'un renoncement de l'Etat à préserver des « acquis » jugés contre-productifs et inégalitaires.
La normativité sociale serait de plus en plus issue des processus de négociation. Or, l'emploi devenant un bien rare et les syndicats étant perçus comme peu à même de résoudre les problèmes sociaux du travail, le rapport de forces dans la négociation serait radicalement déséquilibré, aux dépens des salariés.
Les politiques des Etats témoignant de stratégies individuelles de « cavalier seul », le moins-disant social deviendrait le point de référence d'un droit international du travail qui peinerait à émerger.
Enfin, les nouvelles normativités se développeraient de façon anarchique, sans nulle certification. La « soft law » ne serait qu'une expression parmi d'autres d'un marketing généralisé dont les grandes lignes seraient décidées, à leur profit, par les entreprises monopolistiques.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - J'en viens à la troisième partie du rapport, qui s'attache à identifier les marges d'émancipation par rapport au scénario très noir décrit dans la partie précédente.
En préambule à cette réflexion, il faut souligner combien ces marges paraissent étroites. En effet, le système économique est de plus en plus englobant et les Etats de moins en moins autonomes, donc de moins en moins capables de surplomber et de piloter les phénomènes économiques et sociaux.
Cependant, si le contexte exerce de très fortes contraintes, elles ne sont pas entièrement mécanistes et il reste un espace de choix, dont témoigne une certaine différenciation des « modèles » nationaux, à la condition que les modalités de l'action publique se renouvellent.
Cet impératif de renouvellement nous paraît devoir passer par une double reconnaissance. D'une part, celle que le bon niveau d'action ne peut plus être réduit au niveau national, idée généralement admise « sur le papier » mais dont l'exemple européen montre qu'elle a du mal à trouver tous les prolongements concrets qu'il faudrait. D'autre part, celle que la complexification des structures et l'accélération des changements appellent des méthodes d'action plus décentralisées, avec une place plus grande accordée à l'expression des demandes sociales, mais sans être pour autant abandonnées à l'initiative des éléments du corps social.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il faut voir dans la promotion d'un objectif politique prioritaire de maximisation de la croissance économique reposant sur la conciliation de la créativité nécessaire au dynamisme de l'économie de marché et d'une répartition équilibrée de ses fruits, tout aussi nécessaire à ce dynamisme, la clef de voûte d'un pacte social du travail de progrès.
Ces orientations générales impliquent que les mécanismes de marché soient respectés dans toute la mesure où ils sont compatibles avec un bouclage du circuit économique allant dans le sens d'une amélioration de la croissance potentielle. De même, toutes les politiques publiques régressives de ce point de vue devraient être remises en cause.
Dans le même temps, l'Etat devrait conduire toutes les politiques nécessaires à la production des biens publics - improduits par le marché - sans lesquels la croissance potentielle ne serait pas optimisée. Parmi ces politiques, celle qui s'attache à promouvoir un statut du travail digne et rémunérateur n'est pas la moindre, non plus que celle qui corrige les inégalités excessives dans la distribution des revenus primaires.
Les obstacles majeurs à surmonter sont celui des excès de concurrence entre espaces économiques ainsi que le court-termisme d'un capital mis à même de se réallouer à tout moment. A cet égard, la concurrence fiscale entre Etats est évidemment un obstacle majeur qui explique, en partie, la dimension peu redistributive de l'imposition des revenus en France. Ces défis sont considérables et les Etats qui souhaitent promouvoir une refonte du capitalisme, qui suppose une défense de leur pacte social du travail, doivent s'entendre sur des objectifs politiques et accepter d'impliquer leurs corps sociaux dans ce projet.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - Les voies d'une orientation plus sociale et humaine du management et de l'organisation du travail sont a priori plus ouvertes. Il s'agirait d'éviter que ne s'approfondisse une certaine forme de mal-être au travail avec ses effets finalement contreproductifs.
Plusieurs voies concomitantes se présentent. D'abord, une implication systématique des salariés et non un simulacre de consultation - dans toute « conduite du changement ». Ensuite, des formations au management insistant sur la considération, le respect et le soutien des collaborateurs. Enfin, un intéressement du « top management » à la « performance sociale » et non plus seulement financière.
Cette dernière démarche serait cohérente avec une responsabilisation financière des entreprises pour leurs externalités sociales négatives, notamment pour le chômage ou la maladie. Un procédé de labellisation pourrait alors informer les clients de la conformité des conditions de production à certains standards sociaux, par exemple dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).
Ces évolutions marqueraient un reflux de la « tyrannie » plus ou moins consciente des clients sur l'organisation du travail, ces derniers pondérant le rapport qualité-prix des biens et services par la réputation sociale y compris locale des entreprises. L'émergence de labels de type « Max Havelaar » ou signalant la proscription du travail des enfants constituent ici les « signaux faibles » d'une sensibilité émergente.
La sécurisation des salariés constitue l'autre volet d'une restauration de la qualité de l'emploi et du travail. Dans un scénario volontariste, les salariés seraient placés en situation d'assumer financièrement et professionnellement les mobilités requises dans une économie ouverte, adaptable et compétitive.
A coté de l'assurance chômage et d'un accès au logement facilité, l'employabilité des personnes deviendrait l'axe majeur d'une « flexisécurité » de pointe, d'ores et déjà qualifiée, au Danemark, de « mobication », soit un condensé de mobilité et d'éducation.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics parviendraient à rendre « pilotable » le système de formation français, en vue d'optimiser continuellement l'employabilité présente et à venir des salariés, des étudiants et des chômeurs.
Le système donnerait alors toute sa mesure pour les personnes à faible « capital humain » (sur le marché du travail !), réduisant les mobilités subies par des « outsiders » à l'employabilité souvent déclinante.
En synergie, les entreprises seraient conduites à une gestion plus responsable des emplois et des formations de leurs salariés en pratiquant une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La consécration d'une obligation juridique de préserver l'employabilité des salariés pourrait contribuer à ce mouvement.
A noter que dans ce scénario de l' « employabilité », le volontarisme politique devrait s'étendre à l'Europe car seule une politique de croissance coordonnée, basée sur la consommation et l'investissement, parviendrait à résorber un fort chômage « keynésien ». Sans quoi certains seront toujours moins « employables » que d'autres...
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - Pour le gouvernement des entreprises et du dialogue social, deux types d'inflexions pourraient être recherchés.
En premier lieu, la consolidation du rôle des partenaires sociaux franchirait des étapes décisives. Initiée par le renforcement de leur légitimité (loi du 20 août 2008), cette consolidation pourrait passer notamment par une réforme favorisant leur financement et par l'apparition d'un syndicalisme de services plus proche des préoccupations concrètes des salariés, voire par des clauses réservant les avantages négociés aux syndiqués. La question du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises pourrait également resurgir. Enfin, la représentativité des organismes patronaux serait mieux assurée.
En second lieu, une gouvernance plus partenariale s'instaurerait. Elle comprendrait une réflexion sur la codétermination, et une protection renforcée de l'actionnariat de long terme face aux capitaux « prédateurs ». Par ailleurs, des modes alternatifs de gouvernance s'inspirant de ceux des entreprises familiales ou coopératives redeviendraient à la mode, la question se posant toutefois de leur compatibilité avec les exigences de la compétition économique.
Pour la codétermination, appliquée en Allemagne dans les entreprises de plus de 500 salariés, elle demeure fragile dans la mesure où elle doit être mise en oeuvre sans nuire à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité du territoire. Une telle participation pourrait néanmoins avoir un intérêt pour faire émerger un consensus qui ne sera de toute façon possible que si le contexte du dialogue social est par ailleurs apaisé. Le succès de cette idée repose aussi sur une modification du mode d'évaluation de la performance des entreprises. En effet, comment la gouvernance partenariale pourrait-elle émerger si l'entreprise demeure jugée à l'aune de ses seules performances actionnariales ?
Toutes ces orientations, qui constituent autant de facteurs d'émancipation par rapport au scénario « noir », pourraient contribuer à favoriser l'inscription des stratégies d'entreprises dans le temps long, ainsi qu'une évaluation multicritères de leurs performances qui ne se décrète pas aisément.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - Enfin, le droit social du travail se dirigerait vers une architecture rénovée où, sans vouloir définir à lui seul l'intérêt général, l'Etat ne renoncerait pas à intervenir quand, seul, il peut régler les problèmes dans la sphère du travail. La négociation sociale se développerait de façon plus équilibrée à la faveur d'un respect généralisé du dialogue social et d'un renforcement des légitimités syndicales.
Une atmosphère coopérative s'instaurerait entre des Etats conscients de la communauté de leurs intérêts, cette conscience étant favorisée par l'institutionnalisation de nouveaux forums de normativité internationale, transparents et participatifs, où se délibéreraient, autour d'orientations politiques communes, les normes internationales garantissant une juste rétribution du travail et de bonnes conditions d'employabilité. Ces normes seraient administrées selon des procédures consensuelles.
Les nouvelles normativités sociales se développeraient, mais elles feraient l'objet de certification et le « consumérisme social » gagnerait en maturité.
Un large débat s'est alors ouvert.
M. Jean-François Mayet . - Il convient d'insister sur le poids des contraintes internationales sur le pacte social dans l'entreprise.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur . - J'estime que l'Union européenne devrait être le cadre d'un vrai partenariat entre Etats permettant d'asseoir solidement les pactes sociaux du travail des différents pays européens.
M. Jean-Pierre Leleux . - Des actions tendant à la mise à niveau des taux de syndicalisation des salariés permettraient de renouveler le dialogue social. Un tel processus aboutirait sans doute à apaiser les relations sociales aujourd'hui trop souvent exclusivement conflictuelles.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure . - J'observe que la faible syndicalisation provient en partie d'un problème culturel et de formation aux relations sociales dans l'entreprise.
Mme Odette Terrade . - Je regrette la faiblesse du niveau d'engagement syndical et souhaite que des mesures favorisant le syndicalisme soient prises. L'effet de ciseaux entre les salaires et les dividendes versés aux actionnaires est déplorable. J'appelle de mes voeux l'exploitation des voies de réforme sous-jacentes au scénario optimiste présenté par les rapporteurs.
M. Alain Chatillon . - J'estime qu'une partie de l'écart entre les taux de syndicalisation français et allemand vient du sous-développement des petites et moyennes entreprises en France. J'appelle l'attention sur les problèmes de comparaison des conditions du partage de la valeur ajoutée, même s'il est indéniable que la croissance de l'excédent brut d'exploitation n'a pas suffisamment profité à l'investissement productif. Par ailleurs, j'appelle les salariés à reconsidérer leur position de principe de ne pas participer au capital des entreprises.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur . - Les auditions ont montré que les syndicats de salariés ne souhaitent pas participer à l'administration des entreprises. La même rigidité se rencontrant chez les syndicats patronaux, la situation semble bloquée. Pour remédier au très faible taux de syndicalisation des salariés français (5 %), une possibilité serait de pratiquer un syndicalisme de service, qui se rencontre dans de nombreux pays. Par ailleurs, la rémunération des salariés, c'est-à-dire du facteur travail, est primordiale car on sait, depuis Keynes, qu'elle conditionne la croissance. Il existe une « tyrannie des actionnaires », qui sont souvent des fonds de pension extérieurs ; cette observation nous ramène aux théories économiques de Galbraith, qui conduisent à dénoncer un certain type d'actionnariat.
Mme Elisabeth Lamure. - La productivité ralentit depuis vingt ans et je m'inquiète, à cet égard, de l'impact d'une transmission des savoir-faire qui ne serait plus optimale.
Mme Patricia Schillinger, rapporteure. - A cet égard, la formation tout au long de la vie revêt un caractère primordial.
Mme Elisabeth Lamure. - Sans doute, mais le problème est certainement plus global et l'apprentissage devrait jouer un plus grand rôle.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - La baisse de la productivité enregistre essentiellemnent l'impact du tassement de la productivité générale des facteurs. Je rejoins Mme Lamure sur l'importance du « learning by doing ».
M. Bernard Angels. - Le problème majeur est aujourd'hui celui de l'intensification du travail en Europe et celui résultant de la baisse générale de la part des salaires dans la valeur ajoutée. La France, malgré les 35 heures, ne décroche pas de l'Europe en raison d'une très forte productivité horaire. La politique salariale de l'Allemagne est une contrainte très forte pour ses partenaires et elle menace la pérennité de la zone euro par les déséquilibres commerciaux qu'elle contribue à alimenter.
M. Gérard Bailly. - J'observe, sur la base d'un graphique figurant dans le rapport provisoire, que la part des salaires dans la valeur ajoutée serait beaucoup plus stable en France que dans d'autres pays. Par ailleurs, il me semble que les problèmes posés aux salariés par l'accroissement de la part dévolue aux dividendes pourraient s'estomper en développant l'actionnariat salarié. Enfin, il me semble que, lorsqu'une entreprise doit passer un cap difficile, les syndicats n'orientent pas forcément leur action en conséquence.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - Je précise que l'effet de ciseaux entre les revenus du capital et les salaires, sur la diapositive qui vous a été projetée, est accentué par des effets d'échelle, mais que le graphique permet de visualiser la coexistence d'une baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée et d'une hausse des dividendes. J'abonde, par ailleurs, dans le sens de l'intérêt que peut en effet présenter l'actionnariat salarié. Je relève aussi qu'une proportion significative des salaires les plus élevés - ceux du dernier centile - pourrait ne pas être considérée comme ayant la nature de salaires, pour être largement liée aux résultats de l'entreprise. Par ailleurs, les maladies professionnelles constituent un indicateur, parmi d'autres, du « mal-être » au travail.
M. Alain Chatillon. - Il est possible que les « 35 heures » aient accru le stress au travail et la prévalence des maladies professionnelles. Pour la productivité, les charges sociales qui pèsent sur les entreprises françaises sont sensiblement plus lourdes que celles pesant sur les entreprises allemandes. Afin de soulager les entreprises nationales, peut-être faudrait-il s'orienter vers un basculement d'une partie des charges sociales sur la TVA. Par ailleurs, nos finances publiques souffrent indirectement du déséquilibre de la balance commerciale, déficitaire en France et largement excédentaire en Allemagne. Je me pose aujourd'hui la question de l'opportunité de la mise en place de fonds dédiés spécifiquement aux entreprises. En effet, l'argent des livrets transite par les banques et il me semblerait utile qu'une quotité fixe - par exemple, 20 % - des sommes collectées soient réservées aux PME.
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - Pour ce qui concerne les politiques économiques de la France et de l'Allemagne, une convergence est évidemment souhaitable, mais la question demeure du choix de ce vers quoi l'on converge.
M. Jean-François Mayet. - J'insiste ici sur l'exceptionnelle réussite économique de l'Allemagne, qui a absorbé, lors de la réunification, 17 millions de chômeurs d'Allemagne de l'Est. Ne convient-il pas, par ailleurs, de se réjouir lorsque la part des salaires dans la valeur ajoutée se réduit, dès lors que ce mouvement traduit une automatisation et une rentabilité croissantes de la production, comme on l'observe chez Renault ? J'ajoute un élément de diagnostic sur la bonne santé de l'Allemagne : elle réside largement dans une bonne aptitude à transmettre les savoirs dans l'entreprise, notamment grâce à un apprentissage qui fonctionne. Mais en France, 75 % des jeunes veulent devenir fonctionnaires...
M. Joël Bourdin, président, rapporteur. - En suivant un raisonnement macroéconomique, on ne peut se réjouir de ce que la part des salaires décroisse en deçà d'un certain seuil, car la consommation participe largement au soutien de l'activité. Par ailleurs, si décrue des salaires il y a, au moins faudrait-il que l'investissement suive.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur la prospective du pacte social dans l'entreprise , de M. Joël Bourdin et Mme. Patricia Schillinger, rapporteurs .
ANNEXES
Les annexes ne sont disponibles qu'au format pdf.
* 1 Hormis pour les pays qui ont été tirés par l'extérieur, l'équilibre des systèmes économiques nationaux a de plus en plus été assuré par la dette, qu'elle soit privée ou publique. En dépit, d'une équivalence apparente, le choix entre endettement privé et endettement public ne peut pour autant être considéré comme secondaire. Une étude approfondie de ses termes et de ses conséquences présenterait un intérêt majeur.
* 2 Au rôle près de la création monétaire.
* 3 Sauf à compter, comme le font les pays excédentaires, comme l'Allemagne, sur la demande étrangère pour maintenir la production.
* 4 La question du chômage n'est évidemment pas éludée dans le présent rapport. Toile de fond du salariat, elle contribue à modeler le « pacte social du travail ». Mais elle appellerait un rapport à elle seule et n'est analysée dans la présente étude que sous l'angle de ses liens avec son sujet principal qui est la question de la place du travail dans l'entreprise.
* 5 Il existe cependant deux périodes (fin des années 80 et 90) où la masse salariale augmente nettement plus vite que le salaire par tête. Dans ces périodes, un enrichissement de la croissance en emplois s'est produit mais les taux de croissance du pouvoir d'achat du salaire par tête semblent alors moins compter que l'accélération de la croissance du PIB pour expliquer ce phénomène.
* 6 Ce qui ne signifie pas que la modération salariale n'exerce pas d'effets sur la dynamique de l'emploi mais qu'à elle seule elle ne suffit pas ; toute la question étant de savoir comment combiner modération salariale et croissance dans une économie où la demande domestique est de loin le premier contributeur à la croissance.
* 7 Cette expression de la langue courante recouvre à peu près les catégories « les plus aisés » et « les très aisés » utilisées par l'INSEE.
* 8 Les fixations réglementaires du SMIC n'excluent pourtant pas les négociations collectives. Une partie importante des conventions collectives conclues viennent des nécessités de traduire les décisions réglementaires dans les dispositifs conventionnels.
* 9 Sans doute un peu fragile.
* 10 Entreprises de 10 salariés et plus.
* 11 Les inflexions des gains de productivité et du rythme de croissance semblent se répercuter différemment sur les salaires, selon qu'il s'agit d'accélération ou de ralentissement, et de façon inégale en fonction du niveau de salaire.
* 12 Les statistiques considèrent les revenus de la participation financière comme des revenus salariaux (ils sont d'ailleurs largement exemptés des cotisations sociales sur les salaires), option qui est discutable et n'est pas retenue dans la construction des indicateurs de partage de la valeur ajoutée (v. infra).
* 13 Ce nombre concerne les bénéficiaires potentiels des dispositifs qui n'exercent pas tous leurs droits d'accès.
* 14 « Partage des profits et épargne salariale en 1999 » (avril 2001, n° 14-1)
* 15 Et 12 % de leur profit.
* 16 16 % des entreprises industrielles de plus de 20 salariés travaillent exclusivement pour le compte d'une autre entreprise.
* 17 Excepté la taille, car les entreprises dont il s'agit sont la plupart du temps des PME. Mais, même avec les PME non sous-traitantes, il existe un écart de 4 points.
* 18 Ce qui ne signifie pas pour autant que la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profits soit « équitable » ou optimale.
* 19 Le raisonnement sur le salaire par tête s'appuie sur une référence (la masse salariale divisée par un nombre d'emplois en équivalent temps plein) qui n'est pas la seule référence d'emploi et le devient d'autant moins que les emplois dits atypiques se diversifient.
* 20 A la différence du salaire moyen par tête, le revenu salarial exclut l'épargne salariale et, surtout, il est corrigé de la durée effective d'emploi.
* 21 L'écart entre le taux de pauvreté des salariés - relativement élevé - et des ménages salariés - comparativement faible - vient de ce qu'un salarié pauvre peut appartenir à un foyer où l'autre (ou les autres) membre(s) n'est pas pauvre.
* 22 Quand on considère que les chômeurs de longue durée sont hors du raisonnement, on prend conscience que le fonctionnement du marché du travail aboutit à une grande variété de situations individuelles.
* 23 De fait, les revenus du patrimoine accentuent les inégalités.
* 24 Il s'agit d'une potentialité et non d'un enchaînement nécessaire. Si les gains de productivité du travail sont absorbés par le capital (autrement dit, s'il y a déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salaires), il peut n'y avoir pas de progrès de pouvoir d'achat par tête.
* 25 La décélération de la croissance de la population active recouvre non seulement l'inflexion de l'augmentation naturelle de la population en âge de travailler mais aussi la flexion des taux d'activité et, plus qualitativement, celle de la durée du travail.
* 26 Si le taux de chômage n'a pas davantage augmenté, c'est grâce à des sorties du marché du travail de plus en plus précoces dans un contexte d'abaissement de l'âge de départ en retraite et d'élargissement des dispenses de recherche d'emploi, notamment dans le cadre des dispositifs de préretraite.
* 27 Ou à statut atypique.
* 28 C'en est aussi une cause, une des discussions les plus importantes des sciences sociales étant d'identifier les interactions à l'oeuvre et leurs causes.
* 29 Ce qui peut contribuer à l'augmentation du PIB/tête (dont le dénominateur inclut les inactifs et les chômeurs).
* 30 Cependant, les données utilisées n'ont pas une robustesse telle qu'on puisse prendre ces résultats sans une grande prudence.
* 31 Le niveau souvent faible des taux d'utilisation des capacités de production en serait un indice parmi d'autres.
* 32 Dans la Zone euro, la France n'est pas le pays qui devrait subir le plus fort ralentissement de sa croissance potentielle. Ses grands voisins - l'Italie, l'Allemagne - ont des perspectives de croissance encore moins favorables, ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour la France compte tenu de l'importance des relations économiques qu'elle entretient avec ces pays.
* 33 A ce sujet, il serait intéressant de mettre en rapport les performances de croissance économique et le développement du chiffre d'affaires de ces conseils en organisation.
* 34 « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunération en France ». Rapport au Président de la République. Mission présidée par M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l'INSEE. Mai 2009. « Le partage des fruits de la croissance en France ». Conseil d'analyse économique. Gilbert Cette, Jacques Delpla et Arnaud Sylvain. Mai 2009.
* 35 Homogénéisation qui, compte tenu d'une rentabilité du capital structurellement supérieure dans les pays émergents, devrait peser sur la part de la valeur ajoutée attribuée aux salaires.
* 36 On verra infra que leurs performances peuvent en partie s'expliquer par la dégradation de leur situation subie par les autres entreprises.
* 37 Toutes choses égales par ailleurs.
* 38 Document de travail G2009/07 : « Commerce intragroupe, fiscalité et prix de transferts : une analyse sur données françaises. INSEE. Direction des Études et Synthèses Économiques.
* 39 Au total, la base théorique d'influence sur le PIB de la pratique des prix de cession est égale à l'addition des exportations et des importations de consommations intermédiaires multipliée par la part du commerce intragroupe dans les échanges extérieurs qui est de l'ordre de 52,5 % pour les groupes industriels (70 % des 75 % du commerce international réalisés par les groupes).
* 40 Et portant sur la part de la main-d'oeuvre rémunérée en France dont l'activité consiste à créer de la valeur à l'étranger.
* 41 Les salaires des chercheurs sont, quant à eux, pleinement intégrés aux salaires pris comme numérateur du rapport salaires/valeur ajoutée.
* 42 Ces effets sont ambigus. D'un côté, la hausse des revenus financiers courants perçus est constitutive d'une augmentation des revenus des entreprises qui peut, théoriquement, favoriser une dynamique des salaires plus forte. De l'autre, les revenus financiers courants versés par les entreprises non financières peuvent représenter une utilisation alternative des revenus financiers qu'elles perçoivent - en neutralisant l'impact possible sur les salaires - mais aussi exercer une pression à la baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée que ces revenus soient versés en contrepartie d'un endettement extérieur plus coûteux ou qu'ils le soient aux fins d'augmenter le rendement effectif du capital.
* 43 Ceci afin d'étayer l'idée que la très forte hausse des revenus financiers provient essentiellement d'une augmentation des fonds propres et que le diagnostic de stabilité de rendement du capital n'est pas perturbé lorsqu'en plus des revenus courants on inclut les plus-values au numérateur du ratio de rendement.
* 44 Et, en particulier, au sens et à l'ampleur de l'effet de levier (qui rapporte l'endettement à la valeur des actifs).
* 45 C'est ainsi un problème inverse de celui mentionné plus haut qui se pose ici.
* 46 En outre, le ROCE ne comprend que le revenu d'exploitation à l'exclusion des revenus financiers courants.
* 47 Cette règle ne semble pas appliquée sur les revenus d'actifs non financiers.
* 48 Le constat que les Etats-Unis réunissent à la fois une part des salaires dans la valeur ajoutée et une profitabilité du capital supérieures à ce qu'elles sont en France, conduit à s'interroger sur la portée d'une appréciation de la rémunération des facteurs de production à partir des seuls concepts de la comptabilité nationale.
* 49 Ce qui est logique comptablement mais pose un problème d'appréciation des inégalités de rémunération dans la mesure où ces options pourraient être vues comme une forme nouvelle de rémunération.
* 50 Plus flexible mais aussi moins coûteuse en raison du statut fiscalo-social favorable réservé à ces « rémunérations ».
* 51 Sur un plan économique, les relations entre salaires et croissance sont, par de nombreux aspects, positives sachant que les bénéfices peuvent, en dynamique, augmenter avec les salaires et de ce fait augmenter l'ampleur de la participation et de l'investissement.
* 52 En revanche, sauf à disposer de séries longues et internationales sur le montant des corrections correspondantes, il n'est pas possible d'en estimer les effets dans le temps et dans une optique de comparaison entre pays.
* 53 Cependant, compte tenu de la qualification juridique du salaire qui suppose des liens de droit particulier, il n'est pas arbitraire de choisir cette solution.
*
54
La
règle est de les comptabiliser même si elles ne sont pas
payées en vertu du principe d'enregistrement en droits constatés.
Dans les périodes où le taux de recouvrement est proche de
100 %, cette règle est sans inconvénient. En revanche, quand
il s'éloigne de ce niveau
- notamment dans les périodes
de crise économique comme celle qui est en cours - cette
règle conduit à exagérer la part des salaires dans la
valeur ajoutée et à donner une image fausse de la
flexibilité des coûts salariaux.
* 55 Dans plusieurs pays, la protection sociale est financée moins par les cotisations sociales que par l'impôt sur le revenu. Dans ces pays, les cotisations sociales sont donc peu élevées mais les salaires ne le sont pas nécessairement puisqu'alors le salaire direct est plus important.
* 56 Les salaires superbruts sont l'addition des salaires, des cotisations sociales des salariés et des cotisations sociales des employeurs.
* 57 Déflaté par les prix de la demande intérieure qui sont influencés par les impôts indirects (TVA, accises...).
* 58 Cependant, l'augmentation de la quantité de travail mobilisée par l'activité économique a certainement infléchi la tendance du chômage et le niveau relativement élevé de la productivité de la main d'oeuvre en France laisse imaginer qu'il reste de la marge pour partager le travail.
* 59 C'est-à-dire ceux pour lesquels l'obligation de provisionnement est posée.
* 60 Le Monde du 18 décembre 2009, Aurélien Acquier, professeur à l'ESCP Europe et chercheur associé à l'Ecole des mines Paris Tech.
* 61 Henri Fayol (1841-1925) a énoncé au début du 20ème siècle un ensemble de principes de gestion des hommes dans l'entreprise (ajoutant la fonction « administrative » aux fonctions commerciales, financières, de production et d'approvisionnement, qui étaient déjà définies) et y focalise son attention. Ce faisant, il aboutit à légitimer le pouvoir des cadres dans l'entreprise, en lieu et place de ceux qui détiennent le capital, car ces derniers n'ont pas nécessairement le talent de savoir gouverner les hommes dans le sens de l'intérêt collectif.
* 62 Galbraith montre dans « Le Nouvel Etat Industriel » (1967, traduction française 1969) que le pouvoir dans l'entreprise n'appartient plus aux détenteurs de capitaux, mais aux gestionnaires, catégorie émergente caractérisée par ses connaissances technologiques et organisationnelles. Ce constat s'inscrit dans une démarche, plus générale, de réfutation des mécanismes de l'économie de marché. Dans sa théorie de la « filière inversée », Galbraith estime ainsi que les consommateurs ne conditionnent plus l'offre des entreprises par la formulation d'une demande autonome, mais sont conditionnés par le marché, lui-même guidé par les décisions de la technostructure des entreprises.
* 63 Il est estimé, dans l'approche marxiste, que la « superstructure » juridique dépend étroitement des besoins de l'« infrastructure » économique.
* 64 Le développement de l'actionnariat salarié, initié dans les années soixante, ne s'est pas accompagné de l'attribution aux salariés d'un quelconque pouvoir de codécision ès qualités.
* 65 Henri Ford s'inspire des travaux de Taylor pour la parcellisation des activités et y ajoute la pratique de salaires relativement élevés, engendrant de nouveaux débouchés pour sa propre production (la Ford modèle T). La diffusion de salaires plus élevés garantit des débouchés à la production en général et c'est en ce sens, plus macro-économique, qu'on parle de « modèle fordiste ».
* 66 « Nouvelle Economie, nouveau mythe ? », Flammarion, août 2000.
* 67 Dans la réalité, cette nouvelle façon de voir suppose de ne plus prendre la « carrière », au cours de laquelle salaires et productivité peuvent varier à chaque moment tout en « s'annulant » sur l'ensemble de la carrière, comme un concept utile de management. Mais, la disparition du concept de carrière pose d'autres problèmes, notamment de motivation car disparait alors la notion de « perspectives de carrière » au sein de l'entreprise et survient avec acuité le problème de la précarité.
* 68 Gallimard, octobre 1999.
* 69 A noter que ces observations ne sous-entendent pas l'existence d'une intentionnalité, mais tendent simplement à élucider l'équilibre d'un système sous forte contrainte économique.
* 70 Dont Milton Friedman constitue une figure souvent citée (« le seul rôle social de l'entreprise, c'est d'enrichir l'actionnaire en maximisant le profit »).
* 71 Abraham Maslow (1 er avril 1908 - 8 juin 1970) est un psychologue connu pour son explication de la motivation par la « hiérarchie des besoins » publiée en 1943 (« A theory of human motivation »), théorie qu'il a adossée sur une étude du comportement humain. Maslow estime que les besoins élémentaires (physiologiques et de sécurité) d'une personne doivent être comblés avant de pouvoir satisfaire des besoins d'ordre supérieur. En appliquant ce modèle au monde professionnel, il apparaît vain de motiver les salariés aux niveaux de l'estime et de l'accomplissement sans sécurité, c'est à dire sans exclure les menaces de licenciement ni verser des salaires suffisants pour satisfaire pleinement les besoins physiologiques.
* 72 Flammarion, 2000.
* 73 Dans ses travaux les plus récents, Williamson tend à aborder les entreprises comme un « noeud de contrats » où employés et employeurs sont appréhendés comme des fournisseurs et des clients.
* 74 « Wikinomics : Wikipédia, Linux, YouTube... Comment l'intelligence collaborative bouleverse l'économie », 2007, Pearson Education.
* 75 Les auteurs retiennent Linux et Wikipédia pour exemples pionniers de production par les pairs, expliquant le titre de l'ouvrage.
* 76 D'un certain point de vue, l'acculturation n'était pas si grande, si l'on rappelle que la direction par objectifs promue par Peter Drucker dans les années cinquante et sur laquelle repose en partie le toyotisme, est une invention américaine.
* 77 Philippe Askenazy, « Les désordres du travail » (Seuil, 2004).
* 78 Cf. travaux antérieurs de Philippe Askenazy et Christian Gianella.
* 79 La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail réalise tous les cinq ans des enquêtes sur les conditions de travail. La troisième enquête a été effectuée dans les quinze États membres de l'Union européenne en mars 2000, auprès de 21.703 personnes représentatives de la population active (une quatrième enquête, menée en 2005, a été publiée en 2007). A noter que la Fondation européenne est un organe tripartite de l'Union institué en 1975 dans le but de contribuer à la planification et à la mise en place de meilleures conditions de vie et de travail en Europe.
* 80 Les quinze variables retenues : travail en équipe ; rotation des tâches ; autonomie dans le travail (dans les méthodes, dans les cadences) ; gestion de la qualité (respect de normes de qualité précises, autocontrôle de la qualité du travail) ; contenu cognitif du travail (résolution de problèmes imprévus, apprentissage de choses nouvelles dans le travail, complexité des tâches) ; monotonie des tâches ; répétitivité des tâches ; contraintes de rythme de travail (liées à la vitesse automatique d'une machine ou du déplacement d'un produit, aux normes quantitatives de production, au contrôle direct des chefs, à la dépendance à l'égard du travail fait par des collègues).
* 81 Indicateur composite, fondé sur deux indicateurs, l'un intitulé « travailler à des cadences élevées » et l'autre, « travailler selon des délais très stricts et très courts ».
* 82 Institut de recherches économique et sociales, in « La France au travail - données, analyses, débats », 2009.
* 83 Un allongement de la durée du travail implique habituellement, toutes choses égales par ailleurs, une diminution de la productivité horaire.
* 84 La question posée était : « D'une façon générale, êtres-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait des conditions de travail de votre travail principal rémunéré ? »
* 85 Voir « Les mobilités des salariés », rapport de Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer, Conseil d'analyse économique, La documentation Française, juin 2010.
* 86 Sondage conduit par la TNS Sofres auprès d'un échantillon de près de 1.000 actifs sondés entre le 28 janvier et le 2 février 2008.
* 87 Agence Nationale pour l'amélioration des Conditions de Travail
* 88 A la demande du ministre en charge du travail, un collège d'experts présidé par Michel Gollac a reçu pour mission, en septembre 2008, de formuler des propositions en vue d'un suivi statistique des risques psychosociaux au travail. Les conclusions définitives sont attendues pour le mois de décembre 2010.
* 89 Enquête surveillance médicale des risque. Copilotée par la Dares et la DGT, cette enquête décrit les contraintes organisationnelles et les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés. Une nouvelle enquête est en cours.
* 90 Un état de stress survient lorsqu'il y a un « déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face » (définition de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail).
* 91 Enterprise Ressources Planning.
* 92 Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, novembre 2009.
* 93 Seuil, avril 2004.
* 94 INRS, Documents pour le Médecin du travail, n°11, 3 ème trimestre 2007.
* 95 Les TMS sont devenus la première cause de déclaration de maladie professionnelle en France (74 % en 2008). En augmentation de 17 % par an depuis 10 ans, 36 900 nouveaux cas de TMS ont été indemnisés en 2008.
* 96 Trends in quality of work in EU-15: Evidence from the European Working Conditions Survey (1995-2005), avril 2010.
* 97 Une surqualification croissante ou une certaine habitude du changement pourraient contribuer à expliquer ce ressenti.
* 98 L'article L. 2323-27 du code du travail précise encore que le comité d'entreprise « bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence » et que « les avis de ce comité lui sont transmis ».
* 99 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. La directive s'applique, selon le choix fait par les États membres, aux entreprises employant au moins 50 travailleurs, ou aux établissements employant dans un État membre au moins 20 travailleurs. Cette directive devait être transposée le 23 mars 2007 au plus tard mais, compte tenu de certains retards, une résolution ad hoc du Parlement européen en date 19 février 2009 presse les États membres qui ne l'ont pas transposée « de le faire dans les plus brefs délais ».
* 100 « Faire face aux exigences du travail contemporain », Editions du réseau Anact, mai 2007.
* 101 Rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par les actionnaires.
* 102 La situation tend à s'inverser vis-à-vis des multinationales détenant des marques à très forte notoriété, dont la grande distribution tendrait plutôt à subir, lors des négociations tarifaires, la situation de monopole.
* 103 Rachat d'une société en ayant massivement recours à l'endettement bancaire, avec la perspective d'une revente à terme générant fort effet de levier au regard de la faiblesse des capitaux propres initialement exposés.
* 104 Ainsi que le suggère M. Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la CFDT, auditionné le 6 mai 2010 dans le cadre du présent rapport.
* 105 Cf. supra l'« entreprise de soi ».
* 106 Le taux de rotation est la demi-somme du taux d'entrée et du taux de sortie. Pour un trimestre donné, le taux d'entrée (respectivement de sortie) est le rapport entre le nombre total d'entrées (respectivement de sorties) du trimestre et l'effectif de début de trimestre (source DARES).
* 107 Chiffres 2007, données INSEE.
* 108 Nietzsche.
* 109 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
* 110 Rapport public thématique « La formation professionnelle tout au long de la vie », septembre 2008.
* 111 Seuil, 2009.
* 112 En France, l'accès restreint à certaines professions, que manifeste l'existence d'un numerus clausus, est souvent perçu comme une survivance plus ou moins archaïque de l'Ancien Régime. Cela dit, il n'est pas indifférent de constater qu'en dépit des nombreuses tentatives de réforme ayant eu lieu à l'époque contemporaine, les professions réglementées présentent une remarquable stabilité.
* 113 Terme désignant les personnes bénéficiant des formes d'emplois les plus protégées, qui s'oppose à celui d'outsider, qui désigne les personnes connaissant les diverses formes d'emploi précaire et les chômeurs.
* 114 Expression ayant cours aux Pays-Bas.
* 115 Ces chiffres sont avancés dans le rapport intitulé « Les mobilités des salariés » de Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer (Conseil d'analyse économique, La documentation Française, juin 2010), qui en précise ainsi la signification : « Au moment de la récession de 1993, une baisse d'un point de pourcentage de la croissance annuelle du PIB entraînait une augmentation de 1,4 point de pourcentage de la croissance annuelle du nombre de chômeurs après un trimestre. Pendant la récession actuelle, après un trimestre, une réduction d'un point de pourcentage de la croissance du PIB sur un an conduit à une hausse de 7,5 points de pourcentage de la croissance annuelle du nombre de chômeurs ».
* 116 « Forte augmentation des mouvements de main-d'oeuvre en 2007 », Premières informations n° 24.2 (juin 2009), DARES.
* 117 Dans son rapport sur les trajectoires et les mobilités professionnelles du 16 septembre 2009.
* 118 Matthieu Bunel (document de travail n° 82 du Centre d'étude de l'emploi intitulé « Analyser la relation entre CDD et CDI : emboîtement et durée des contrats » de mars 2007) note ainsi que les CDD « ne sont pas qu'un instrument, peu coûteux, d'adaptation aux variations de la conjoncture. Les entreprises utilisent les CDD simultanément comme mode de gestion interne et externe de la main-d'oeuvre. Ainsi, c'est la polyvalence de ce type de contrat qui intéresse les entreprises. Enfin, les CDD constituent une étape dans l'accès à un emploi stable. Ce résultat milite contre la mise à l'écart définitive du modèle de file d'attente. Dans ce processus de transition, il apparaît que la durée de la période pendant laquelle un salarié occupe un CDD affecte positivement la probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail lorsque celle-ci n'est pas interrompue par une période de chômage ou d'inactivité ».
* 119 Dans ce sens : « Le Contrat à Durée Indéterminée dans la tourmente de la firme flexible», par Alain Pichon, Revue des Sciences de Gestion, n°230 - spécial stratégie, mai 2008.
* 120 « Si la branche « travail temporaire » laisse les salariés cumuler l'ancienneté acquise au cours des contrats de mission effectués dans différentes entreprises pour le congé individuel de formation, le congé de bilan de compétences, la validation des acquis d'expérience ou le droit individuel à la formation, cela ne suffit pas à leur garantir le même accès à la formation que les autres salariés » (rapport précité en note).
* 121 OCDE, Rigueur de la LPE - séries temporelles (1985-2003).
* 122 « Comment les salariés perçoivent-ils la protection de l'emploi ? » par F. Postel-Vinay et A. Saint-Martin, Économie et statistique n° 372, 2004.
* 123 « Travail : la révolution nécessaire », éditions de l'aube, février 2010.
* 124 Voir le lien : http://videos.senat.fr/video/videos/2010/video4116.html
* 125 « Les risques psychosociaux sont souvent résumés par simplicité sous le terme de « stress », qui n'est en fait qu' une manifestation de ce risque en entreprise . Ils recouvrent en réalité des risques professionnels d'origine et de nature variées, qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. On les appelle "psychosociaux" car ils sont à l'interface de l'individu ( le "psycho") et de sa situation de travail » (site du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique).
* 126 Cette décision s'inscrit dans un « Plan d'urgence opur la prévention du stress au travail », présenté le 9 octobre 2009, organisant par ailleurs des réunion au niveau régional afin que les entreprises ayant de bonnes pratiques puissent les exposer aux partenaires sociaux, ainsi qu'une information des PME et TPE.
* 127 « La sanction, c'est la transparence », a déclaré, le 14 février 2010, Xavier Darcos, alors ministre du travail.
* 128 Nommer et faire honte.
* 129 Droit mou. La « soft law » se caractérise par l'absence de contrainte. Relativement fréquente en droit international, son caractère incitatif repose souvent sur la réputation.
* 130 Ce que souhaitaient en revanche les syndicats de salariés.
* 131 Par ses articles L. 1153-1 et 1152-1.
* 132 L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
* 133 Cass. Soc., 10 novembre 2009, Moret contre société HSBC, n° 08-41.497. A noter qu'en toute hypothèse, un élément intentionnel demeure requis pour les sanctions pénales.
* 134 Cass. soc. 10 novembre 2009, Association Salon Vacances Loisirs contre Marquis,
n° 07-45.321.
* 135 Voir le rapport de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 7 juillet 2010.
* 136 Arrêts « amiante » de 2002.
* 137 Cass. soc., 5 mars 2008, société Snecma, n° 06-45.888.
* 138 Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
* 139 Voir le rapport de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 7 juillet 2010.
* 140 Audition de Stéphane Pimbert, directeur général, et Valérie Langevin, psychologue du travail,
de l'INRS, mercredi 24 février 2010, par la Mission d'information sur le mal-être au travail.
* 141 Rapport coécrit par Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, Christian Larose, vice-président du Conseil économique, social et environnemental et Muriel Penicaud, directrice générale des ressources humaines de Danone.
* 142 « Bien-être et efficacité au travail - 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail - », février 2010.
* 143 « La société de défiance - Comment le modèle social français s'autodétruit », par Yann Algan et Pierre Cahuc, éditions rue d'Ulm, 2007.
* 144 On rappelle que ces quatre types d'organisation concerneraient en France respectivement 47 %, 25 %, 18 %, et 11 % des salariés d'établissements d'au moins dix personnes (supra).
* 145 Audition de Marie Pezé, psychologue en charge de la consultation « Souffrance et travail » au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, mercredi 20 janvier 2010, dans le cadre de la mission d'information sur le mal-être au travail du Sénat.
* 146 Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la Mission d'information sur le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 7 juillet 2010
* 147 Rapport op. cit. de M. Gérard DÉRIOT.
* 148 Hors agriculture.
* 149 Repères statistiques sur les dimensions économique, sociale et environnementale de la société française, 2009 ; source UNEDIC et calculs du Conseil économique, social et environnemental.
* 150 De 1976 à 2008.
* 151 « L'entreprise en droit », Jean-Philippe Robé, Droit et société 29-1995
* 152 The nature of the firm, Economica, New Series 1937, vol. 4, N° 16 p. 386-405.
* 153 Article 1832 du code civil.
* 154 L'entreprise en droit, Jean-Philippe Robé, Droit et société 29-1995
* 155 « Etat ou entreprises : qui gouvernera le monde demain ? », Actes du colloque du 23 janvier 2007, Rapport de M. Joël Bourdin n° 262 (2006-2007).
* 156 L'entreprise dans la démocratie, Pierre-Yves Gomez et Harry Korine, éditions de Boeck (2009).
* 157 Source : « Depuis trente ans, les grandes entreprises concentrent de plus en plus d'emplois », Vincent Cottet, INSEE Première (avril 2010).
* 158 « Le rôle des salariés dans la gouvernance des entreprises en France : un débat ancien, une légitimité en devenir », Catherine Sauviat, Document de travail n° 06.02, IRES (avril 2006).
* 159 Le droit du travail, Alain Supiot (Que sais-je ?, 2009)
* 160 « La transformation du paysage syndical depuis 1945 », Thomas Amossé, Maria-Teresa Pignoni, Données sociales édition 2006.
* 161 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
* 162 Plus exactement, « une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie » (article L. 2252-1 du Code du travail).
* 163 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
* 164 Élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
* 165 « Évaluation de la loi du 4 mai 2004 sur la négociation d'accords dérogatoires dans les entreprises », Document d'études de la DARES n° 140 (août 2008).
* 166 Document d'études de la DARES précité.
* 167 Rapport au Premier ministre sur la négociation collective et les branches professionnelles de M. Jean-Frédéric Poisson, député (La Documentation française, 2009).
* 168 « Pour une modernisation du dialogue social », rapport de M. Dominique-Jean Chertier (mars 2006).
* 169 Discours de M. Jacques Chirac, président de la République, devant le Conseil économique et social le 10 octobre 2006.
* 170 « A qui appartiennent les entreprises ? », Jean-Philippe Robé, Le Débat n° 155 (mai-août 2009)
* 171 « A quoi servent les actionnaires ? », sous la direction de Jean-Philippe Touffut (Albin Michel, 2009).
* 172 L'idée que le profit maximal est le profit optimal est analysée dans la partie du présent rapport consacrée à la valeur ajoutée et à son partage.
* 173 Anderson et Reeb (2003), cité dans : « L'enjeu de l'actionnariat des grandes entreprises cotées en France », Jean-Louis Beffa, Xavier Ragot in « A quoi servent les actionnaires ? » précité.
* 174 « Corporate governance and equity prices », Paul Gompers, Joy Ishii et Andrew Metrick (Quarterly Journal of economics, février 2003). Selon cette étude, les performances des entreprises assurant une bonne protection de leurs actionnaires sont supérieures de 8,5 % sur la décennie 1990 à celles des autres entreprises.
* 175 Association française des entreprises privées
* 176 « Il y a une troisième solution : c'est la participation, qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que des gens se mettent ensemble pour une oeuvre économique commune, par exemple, pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail, il s'agit que tous forment ensemble une société, une société où tous aient intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement et un intérêt direct. Cela implique que soit attribuée de par la loi, à chacun, une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés d'une manière suffisante de la marche de l'entreprise et puissent, par des représentants qu'ils auront tous nommés librement, participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions. C'est la voie que j'ai toujours cru bonne. C'est la voie dans laquelle j'ai fait déjà quelques pas; par exemple en 1945, quand, avec mon gouvernement, j'ai institué les comités d'entreprises, quand, en 1959 et en 1967, j'ai, par des ordonnances, ouvert la brèche à l'intéressement. C'est la voie dans laquelle il faut marcher. » Charles de Gaulle (1968)
* 177 Rapport de la Commission gouvernementale pour la modernisation du système allemand de codétermination au niveau de l'entreprise présidée par M. Kurt Biedenkopf (2006) http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2006/12/Anlagen/2006-12-20-mitbestimmungskommission,property=publicationFile.pdf
Résumé en français (par la fondation Hans Böckler, proche de la Confédération allemande des syndicats DGB) : : http://www.boeckler-boxen.de/files/Zusammenfassung_BiKo-FR.pdf
* 178 BDA (confédération des associations d'employeurs allemands) et BDI (confédération de l'industrie allemande)
* 179 Mitbestimmung modernisieren, Bericht des Kommission Mitbestimmung (BDA, BDI) : http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/res/547B1EE4EA194F30C12574EF0053DBFF/$file/Mitbestimmung_Modernisieren.pdf
* 180 Rapport précité de la Commission Biedenkopf, pages 19-20.
* 181 Indice regroupant les 250 plus fortes capitalisations boursières inscrites au premier et au second marchés de la Bourse de Paris.
* 182 Toutefois, la jurisprudence française accorde actuellement à la constitution une valeur supérieure à celle du droit international, dans l'ordre interne, mais cette suprématie, en ce qui concerne le droit communautaire, fait l'objet d'un débat doctrinal important (la Cour de justice des communautés européennes pose, pour sa part, le principe de la primauté absolue des normes communautaires).
* 183 Document d'études n° 140. Août 2008. Évaluation de la loi du 4 mai 2004. DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques). Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité.
* 184 Lorsque la Constitution peut être modifiée par une loi ordinaire.
* 185 Il s'agit d'un contrôle qui, étant exercé par un organe habilité, est dit « par voie d'action » par opposition au contrôle « par voie d'exception » qui relève du juge ordinaire. Depuis juillet 2008, existe aussi un recours au Conseil constitutionnel par voie de « question préjudicielle » transmise par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction.
* 186 Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.
* 187 Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008.
* 188 Dans un arrêt du 2 août 1993, la CJCE a souligné la primauté absolue, reconnue par le Conseil constitutionnel, le 15 juin 2004, dans sa décision Costa, du droit communautaire sur tout autre système juridique national ou international.
* 189 C.f. convention du 17 avril 1950 concernant les travailleurs frontaliers, l'UEO est en cours d'intégration dans l'UE.
* 190 C.f. code européen de la sécurité sociale et convention européenne relative au statut du travailleur migrant.
* 191 Traité (UE) de Maastricht du 7 février 1992.
Traité (CE) de Rome (1957) refondu par les traités de Maastricht puis de Lisbonne (2007).
* 192 Ainsi, le Conseil constitutionnel a estimé que la ratification par la France du traité de Maastricht impliquait une révision préalable de la Constitution.
* 193 Les tribunaux se réfèrent souvent aux droits fondamentaux s'agissant pourtant d'affaires très spécifiques, il en est ainsi de notre chambre de cassation et du préambule de la constitution de 1946.
* 194 Arrêts Mulox (1993) et Ratten (1997).
* 195 Article 141 du traité CE, directives du 10 février 1975 et du 9 février 1976.
* 196 Disposition de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 intégrée dans le traité de Rome (CE) par le traité d'Amsterdam en 1997.
* 197 D'ores et déjà, une directive du 28 juin 1999 interdit, sauf raisons objectives, de traiter les travailleurs à durée déterminée (sous CDD), d'une manière moins favorable que ceux à durée indéterminée (CDI).
* 198 Les quatre droits fondamentaux que doivent respecter les signataires de la déclaration de juin 1989 de l'OIT sont :
- la liberté d'association et le droit de négociation collective ;
- l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
- l'abolition effective du travail des enfants ;
- l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Dans un pays au droit social évolué comme la France, seuls le premier et le quatrième de ces droits ont parfois besoin d'être rappelés et défendus.
* 199 Décisions du Conseil d'Etat, suite à des recours syndicaux, puis de plusieurs conseils de prud'hommes, confirmées par les cours d'appel de Bordeaux et de Paris et, enfin, par la Cour de cassation.
* 200 Selon cette convention, un salarié ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable et avant que les moyens de se défendre lui aient été donnés. Or il était prévu une période d'essai de deux ans, durant laquelle l'employeur n'aurait pas à justifier un licenciement.
* 201 Dans l'ordre public dit « social » ou « dérogeable », un accord collectif peut toujours comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, en application du « principe de faveur » consacré par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.
Une norme inférieure peut aussi toujours déroger, dans les mêmes conditions, à une norme supérieure dans la hiérarchie des textes collectifs.
* 202 D'abord les lois Auroux de 1982, puis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (obligation triennale). La loi du 3 décembre 2008 pénalise les employeurs qui ne satisfont pas à cette obligation.
* 203 De 2004 à 2007, les accords potentiellement dérogatoires ont porté sur les thèmes suivants :
- éléments du salaire (autres que minima) : 35 %
- contrat de travail et droit des salariés : 35 %
- aménagement du temps de travail et congés : 27 %
- formation professionnelle : 15 %
* 204 cf. Lois Auroux d'octobre 1982 (obligation annuelle concernant les salaires et le temps de travail) + emplois de séniors (2003) + handicapés (2005) + égalité salariale entre les femmes et les hommes (2006) + consultation du comité d'entreprise sur les conséquences de la stratégie de l'entreprise (GPEC), selon des modalités à négocier tous les trois ans (loi de cohésion sociale de janvier 2003), etc. L'obligation de négocier peut aussi découler d'un accord national interprofessionnel conclu sous l'égide de l'Etat.
* 205 Par exemple, une impulsion a été donnée par les pouvoirs publics en matière de revalorisation des bas salaires conventionnels (négociations de branche).
* 206 Le rapport évoque le cas des transports publics urbains. Selon ses termes, l'implication, particulièrement forte dans ce secteur, de l'Etat dans la négociation sociale « laisse planer un doute » sur la qualité bilatérale de celle-ci.
* 207 Les accords et avenants représentent environ 95 % des textes conventionnels conclus chaque année. Les branches dont les effectifs salariés sont les plus nombreuses sont celles qui ont l'activité conventionnelle la plus régulière. L'industrie est particulièrement dynamique : alors qu'elle ne représente que 20 % des salariés, 40 % des accords d'entreprise y sont conclus.
* 208 14 % seulement des entreprises de 10 salariés ou plus ont ouvert au moins une négociation en 2007, cette proportion passe à 50 % dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Les conventions de branches compensent en partie les inconvénients de la rareté des négociations d'entreprises dans les secteurs les plus atomisés.
* 209 Loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social.
* 210 Cf. rapport précité de 2007 sur l'application du volet « dialogue social : de la loi Fillon susvisée du 4 mai 2004.
* 211 Loi complétant des dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008.
* 212 Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences (Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
* 213 Salaires minima, classification, garanties sociales (art. L.912-1 du code de la sécurité sociale), mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue.
* 214 Alors que l'initiative des lois appartient, normalement, au Premier ministre et au Parlement (art. 39 de la Constitution).
* 215 DS : délégué syndical
* 216 DP : délégué du personnel
* 217 RSS : Représentant de la section syndicale
* 218 En principe, la loi a pour vocation, en France, d'énoncer des règles de droit suffisamment précises et doit être revêtue d'une portée normative. Mais certaines dispositions, qui se contentent de formuler de voeux pieux, échappent à la censure du Conseil constitutionnel.
* 219 Revue de la régulation n° 1. Juin 2007. La responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle.
* 220 Cf. jurisprudence de la Cour de cassation.
* 221 L'extrême concentration des salaires dans ce pays ôte à ce constat une grande partie de sa portée.
* 222 Qu'elles soient publiques ou privées.
* 223 On peut analyser l'accentuation de la concurrence dans le processus de mondialisation comme une mise à l'épreuve des différentes rentes existant dans des cadres moins concurrentiels. Dans une telle analyse, l'issue de l'épreuve dépend de la capacité plus ou moins forte à défendre sa rente. La maturation de l'industrie financière pourrait alors répondre au double objectif d'ordonner cette mise à l'épreuve et d'en tirer le meilleur parti.
* 224 Sur ce point, l'analyse par les comptes de surplus mentionnée plus haut paraît indiquer qu'un processus de ce genre s'est déroulé. Sous réserve de la robustesse de cette analyse, on serait conduit à estimer que le partage de la valeur ajoutée s'est adapté aux propriétés mouvantes de la combinaison productive.
* 225 Elle peut par exemple provenir d'une obsolescence accélérée d'une fraction du salariat dans un processus de maximisation du rendement du capital indépendant d'un quelconque objectif de croissance économique.
* 226 Du fait de la libéralisation des flux de capitaux, le capital investi à partir d'une économie peut l'être dans d'autres espaces économiques.
* 227 Cette approche est favorisée par l'existence d'une concurrence internationale dans l'attraction du capital. Mais si elle permet d'identifier une contrainte elle ne devrait pas pour autant être considérée comme normative.
* 228 Voir annexe n°1.
* 229 Consensus qui vaut aussi pour le niveau des salaires.
* 230 Théoriquement, il devrait y avoir convergence vers un niveau de rendement du capital donné, mais il peut y avoir des primes de risque (ou, à l'inverse des facilités de risque) en lien avec la situation intrinsèque des agents ou la volonté de diversification prudentielle des placements.
* 231 Les excès d'endettement à laquelle conduit ce fantasme d'autonomie ont buté sur le réel.
* 232 Lorsqu'on ne se préoccupe pas de la croissance, on peut justifier les profits par la nécessité de constituer une base de rentes. Mais alors les profits ne sont plus justifiés économiquement mais par des considérations sociales, qui à l'examen, sont évidemment contestables.
* 233 Cela ne s'est pas encore vérifié en Allemagne. Mais l'absence de bulle immobilière y semble due à l'existence de surcapacités immobilières dont la persistance est à prévoir dans un pays démographiquement exsangue.
* 234 Qui sont, conventionnellement, imputés à la part de la valeur ajoutée allant aux salaires, convention qui peut être discutée.
* 235 Notamment, les « bénéfices fiscaux » prennent en compte des opérations réalisées hors-frontières.
* 236 Concurrence fiscale qui, s'agissant de l'imposition du capital, bat son plein au sein même de l'Union européenne et paraît immunisée contre toutes les remises en cause pratiques si l'on se réfère au récent épisode de renflouement de l'Irlande.
* 237 Par exemple, outre les effets des opérations internationales des groupes, on peut relever un effet de « vases communicants » entre la part de l'EBE prélevé par l'impôt sur les sociétés et l'évolution des charges d'intérêt dont les variations s'accompagnent de variations de sens contraire du produit de l'impôt sur les sociétés.
* 238 La concomitance entre l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires et celle des changes d'intérêts traduit un choix financier des entreprises qui ont privilégié l'endettement et, compte tenu du constat sur la stabilité du taux d'investissement, ce afin, non d'investir, mais d'augmenter les revenus financiers versés aux détenteurs de leur capital. Ce choix a pu être favorisé par l'existence de taux d'intérêt de bas niveaux permettant de contenir la charge d'une dette grandissante. Il faut ajouter que l'impact de l'accroissement de la dette sur les bilans a pu être neutralisé par les effets d'une liquidité abondante sur la valeur des actifs.
* 239 Arbitrage qui provoque une baisse de l'épargne des entreprises.
* 240 A la fin des années 90, les entreprises non financières se trouvaient très près de dégager une capacité de financement c'est-à-dire de disposer d'une épargne supérieure à leurs besoins d'investissement, situation économique inédite.
* 241 « Inégalités économiques ». Conseil d'analyse économique. Rapport n° 33, Tony Atkinson, Michel Glaude, Lucile Olier et Thomas Piketty, 14 juins 2001.
* 242 Ces liens sont apparemment évidents mais l'autonomisation de la sphère financière - qui traduit l'existence de dynamiques causées en son sein par des variables purement financières - oblige à constater des phénomènes de découplage entre sphère réelle et financière.
* 243 Le recours à la notion d'unité de consommation vise à épouser les données économiques concrètes des individus en tenant compte de leur appartenance à un ménage. Une personne seule est une unité de consommation, mais lorsqu'elle est dans un ménage elle le reste si elle est le premier adulte du ménage ou n'est comptée que pour 0,5 si elle a 14 ans ou plus ou 0,3 en-deçà de 14 ans. Un couple de cadres supérieurs gagnant chacun 5 300 euros nets par mois relève du 1 % le plus riche.
* 244 Ou 700 années.
* 245 A quoi il faut ajouter les considérations relatives à la globalisation et à la contraction des structures industrielle d'un coté et à l'éparpillement des fournisseurs de l'autre.
* 246 Regards croisés sur la mise en oeuvre de la GPEC. Oasys Consultants. 2010. Enquête auprès de responsables de ressources humaines et de représentants du personnel.
* 247 Soit parce que ces derniers le leur interdisent (15 % des cas), soit parce qu'il s'agit de questions (les salaires, par exemple) qui relèvent, de par la loi, d'un autre niveau de négociation (2/3 des cas).
* 248 Manuel précité de Jean Emmanuel Ray. Évaluation de la loi du 4 mai 2004 (DARES. Document d'études n° 140. Août 2008. Olivier Meriaux).
* 249 En ce qui concerne plus particulièrement la création de comptes épargne temps, une loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise avait prévu, jusqu'au 31 décembre 2008, un dispositif spécial de mandatement dans les entreprises de moins de 20 salariés.
* 250 Document d'études de la DARES n° 140, août 2000, évaluation sous la direction d'Olivier MERIAUX.
* 251 Le travail au noir représenterait 3,3 % de la richesse produite et un manque à gagner pour les collectivités publiques d'environ 2 % du PIB.
* 252 Nouvelle codification du droit du travail - le 1 er mai 2008 - proposition de loi, en cours d'examen, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit - ordonnances du 25 mars 2003 -.
* 253 Rapport au Premier ministre - « Pour une modernisation du dialogue social » - 31 mars 2006.
* 254 A cet égard, certaines estimations des incidences sur l'emploi national de la restructuration de l`économie mondiale sont plus qu'étonnantes par les biais de méthode qui conduisent à des effets systématiquement minorés.
* 255 Assez française, semble-t-il, si l'on veut bien se fier aux impressions de vos rapporteurs qui relèvent que ces deux dimensions de l'économie contemporaine sont plus pleinement prises en compte dans des pays proches, le Royaume-Uni et l'Allemagne, par exemple.
* 256 Les facteurs d'émancipation ici identifiés, qui concernent le contexte économique du pacte social dans l'entreprise ne sont bien-sûr pas les seuls nécessaires mais on peut douter que les autres facteurs puissent intervenir sans que les premiers soient mis en oeuvre.
* 257 Alors que jusqu'à présent les mesures réglementant la partie variable des rémunérations en fonction des performances financières ont été réservées au secteur financier.
* 258 Ce parti pris d'extrapolation ne recouvre pas les convictions de vos rapporteurs qui imaginent qu'un mauvais scénario passerait plutôt par une accumulation de tensions se succédant avec des pauses plus ou moins salvatrices. Mais, l'extrapolation permet de simplifier l'exposé des difficultés rencontrées et d'explorer les variables à modifier pour aboutir à un système plus souhaitable.
* 259 Voir notamment les deux rapports consacrés à ce sujet par la délégation à la planification : « la coordination des politiques économiques en Europe : le malaise avant la crise ? », rapport d'information n° 113 (2007-2008) du 5 décembre 2007 (tome I), et « la coordination des politiques économiques en Europe (tome II) : surmonter le désordre économique en Europe », rapport d'information n° 342 (2008-2009) du 8 avril 2009, par MM. Joël Bourdin et Yvon Collin.
* 260 Si cette tendance structure la vie économique et les changements sociaux en Europe, il faut observer que les Etats européens ont suivi des trajectoires différentes par rapport à elle. Le rythme des restructurations productives a été inégal ainsi que les voies empruntées par ces restructurations. Cette arythmie a favorisé l'ampleur des restructurations effectuées par les pays les plus avancés dans cette voie (l'Allemagne) en soutenant leur activité économique qui, sans elle, aurait été sensiblement ralentie et elle a provoqué une amplification insoutenable des déséquilibres commerciaux et financiers au sein de l'Europe, notamment dans la zone euro.
* 261 Il est vrai qu'elles sont considérées comme versant des revenus en comptabilité nationale dès lors qu'elles dégagent un résultat positif - v. supra.
* 262 Même si le graphique n'est pas entièrement significatif puisqu'il recouvre l'ensemble des entreprises qu'elles soient endettées ou non, les écarts entre les ratios d'endettement des différentes catégories d'entreprises accréditent cette idée.
* 263 Les positions dominantes se traduisent par des surprofits gagnés au détriment non seulement des autres entreprises mais aussi des consommateurs à travers un niveau de prix excessif.
* 264 Economiquement, cette situation n'implique pas nécessairement un excès de demande que permettrait de résorber un surcroît d'épargne. Elle peut résulter d'une dégradation de la compétitivité des produits et/ou d'une demande étrangère insuffisamment dynamique.
* 265 Investissements et investisseurs de long terme - Analyse économiques n° 05/2010 - Rapport CAE n° 91 de Jérôme Glachant, Jean-Hervé Lorenzi, Alain Quinet et Philippe Trainar
* 266 Le niveau résultant de l'estimation du taux implicite d'imposition du capital pour la France paraît excessivement élevé compte tenu des informations disponibles concernant le taux marginal d'imposition des sociétés et le taux moyen d'imposition des revenus des ménages qui disposent de l'essentiel du patrimoine.
* 267 Cette dernière observation confirme les doutes exprimés sur la robustesse des données utilisées pour construire ces taux implicites. Les difficultés sont nombreuses, en effet, qu'il s'agisse de la collecte des impositions pertinentes ou de l'estimation des valeurs prises aux dénominateurs des ratios qui sont censées mesurer le capital engagé dans les différentes économies (autrement dit, refléter la valeur des actifs capitalisés).
* 268 Le taux d'imposition des revenus déclarés est calculé ici comme la somme des impôts sur les revenus d'activité, des impôts sur les revenus du patrimoine et des prélèvements libératoires, rapportée au revenu déclaré. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (de l'ordre de 3% du revenu déclaré pour les personnes à très hauts revenus), les impôts locaux et l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont donc pas pris en compte.
* 269 Cependant, le rapport de notre collègue Bernard Angels « L'économie des dépenses publiques ». Délégation du Sénat pour la planification. Rapport n° 441 (2007-2008), du 2 juillet 2008, a montré que l'efficacité redistributive des dépenses publiques pouvait être optimisée.
* 270 Les propositions récentes de réforme de l'indexation du SMIC paraissent avoir étroitement inspiré les pratiques de revalorisation suivies ces dernières années.
* 271 Le SMIC serait revalorisé par les lois de finances.
* 272 A la perspective du chômage près toutefois.
* 273 Voire au-delà compte tenu des effets du SMIC sur les salaires au-dessus de ce seuil.
* 274 Mobilité et éducation ; concept ayant récemment émergé au Danemark, « patrie » de la flexisécurité.
* 275 Les réorganisations sournoises sont encore plus décevantes et déstabilisantes pour l'ensemble organisationnel qu'elles frappent.
* 276 Membre du Centre d'analyse stratégique, auditionné dans le cadre du présent rapport.
* 277 Contributions annexées des ambassades.
* 278 Il existe d'ailleurs une tyrannie de l'expertise manifestée par le recours parfois cosmétique à des consultants extérieurs dont l'intervention au service des seules directions tend à être déséquilibrant car, probablement assez souvent, exclusivement communicationnelle et ignorante des contraintes réelles imposées aux salariés. On relève ici que le rapport « Lachmann » précité sur le bien-être et l'efficacité au travail, préconise de mesurer l'impact et la faisabilité humaine du changement pour tout projet de réorganisation ou de restructuration.
* 279 Cette préconisation rejoint une de celles du rapport « Lachmann » précité.
* 280 Ainsi, la CEMS (Community of european managment schools) -regroupement d'écoles de commerce européennes qui comprend, par exemple, HEC-, entend faire de la responsabilité sociale des entreprises l'un des piliers de sa mission de formation.
* 281 C'est-à-dire les dirigeants.
* 282 D'autres types d'indicateurs sont encore envisageables, qu'ils concernent l'activité (création d'emploi) ou l'environnement.
* 283 Ainsi que le suggère M. Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la CFDT, auditionné le 6 mai 2010 dans le cadre du présent rapport. Cette proposition rejoint une de celles du rapport « Lachmann » précité.
* 284 Voir l'étude sur le déploiement des démarches de RSE du cabinet Ernst&Young (février 2008).
* 285 Par ailleurs, un baromètre de satisfaction des clients représentera 20 % de la part variable, les 50 % restants étant consacrés aux indicateurs classiques de performance économique.
* 286 A l'inverse des autres risques gérés par la sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse...), qui sont financés via des ressources fiscales et des cotisations à taux uniformes, les risques professionnels peut-être trop limitativement apprécié - sont assurés au moyen de contributions différenciées.
* 287 A la suite du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
* 288 La dépression nerveuse ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, il appartient au salarié de prouver le lien avec le travail et de justifier d'un taux d'incapacité de plus de 25 %. Il n'y aurait chaque année que 200 demandes de reconnaissance de dépressions nerveuses en maladies professionnelles (source : MiroirSocial).
* 289 Dans un rapport intitulé « De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle » de décembre 2004, MM. Pierre Cahuc et Francis Kramarz ont formulé la proposition d'un contrat unique à durée indéterminée (en lieu et place des CDI et CDD) donnant lieu, pour chaque licenciement, au versement d'une « contribution de solidarité » servant à garantir le reclassement du salarié et à financer une partie de l'assurance chômage.
* 290 « Assurance chômage et emplois précaires - contrats courts et segmentation du marché du travail en France : le rôle paradoxal de l'assurance chômage » par Bruno Coquet, Futuribles n° 368 - novembre 2010.
* 291 « Le capitalisme raisonnable et la responsabilité de l'emploi : entre responsabilité individuelle et responsabilité sociale de l'entreprise. Quelle actualité de la controverse Commons / Morton ? », Contribution à un colloque, par Laure Bazzoli (Université de Lyon, LEFI) et Thierry Kirat (CNRS, IRISES-Paris Dauphine), version en date du 12 octobre 2008.
* 292 Sans perdre de vue que certaines exigences d' « entreprises dominantes » vis à vis de leurs fournisseurs et sous-traitants peuvent induire chez ces dernières entreprises la production d'externalités sociales négatives dont les premières auront su, ainsi, s'exonérer.
* 293 Dans la mouvance de la « soft law », la RSE joint les préoccupations économiques et environnementales aux préoccupations sociales ; elle a, d'une façon générale, vocation à concerner, sur une base volontaire et souvent indicative, l'ensemble des interactions de l'entreprise avec ses « parties prenantes ». Par exemple, PSA Peugeot Citroën met en avant une politique de RSE dont la composante « sociale » repose sur 5 axes (dialogue social, respect des droits humains au travail, performance des organisations et qualité des conditions de travail, internationalisation de l'emploi, équité des rémunérations), chacun étant explicité et décliné en « axes prioritaires », voire en « actions prioritaires ».
* 294 D'ores et déjà, à l'attention des centres d'appel, un label « responsabilité sociale » a été créé sous l'égide du Ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale, de l'AFRC (Association Française de la Relation Client) et du SP2C (Syndicat Professionnel des Centres de Contacts) en 2004 afin d'être « le garant éthique des bonnes pratiques sociales des acteurs de la chaîne de la relation clients ».
* 295 Dont, cependant, l'objectif est peut-être autant, sinon davantage, de signifier aux clients l'importance accordée à leur satisfaction, que de mesurer celle-ci pour en tirer les conséquences.
* 296 Qui ne trouvent aucun répit, à cet égard, au contact des services publics.
* 297 « La société de consommation », 1970.
* 298 « Les mobilités des salariés », rapport de Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer, Conseil d'analyse économique, La documentation Française, juin 2010.
* 299 Rapport public thématique « La formation professionnelle tout au long de la vie », septembre 2008.
* 300 Droit individuel à la formation.
* 301 Congé individuel de formation.
* 302 Dans le rapport précité, la Cour des comptes indique, concernant le CIF, qu'« en raison d'un coût élevé (21 000 euros en moyenne par bénéficiaire) et de la durée importante des formations, le public concerné reste(...) limité à un peu plus de 40 000 personnes par an » et qu'« avec 500 000 bénéficiaires attendus en 2008, [le DIF] ne saurait encore à lui seul compenser les inégalités d'accès qui caractérisent le système français de formation professionnelle », même s'il s'agit d'un « dispositif récent dont la montée en charge n'est pas encore totalement achevée ».
* 303 Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007, n° 06-40-950.
* 304 Rapport de Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer, La documentation Française, juin 2010.
* 305 La qualité d'intérimaire ou le bénéfice d'un emploi aidé diminue la probabilité d'accès à la formation au cours d'une période d'emploi de 8,3 points par rapport au bénéfice d'un CDI ; les salariés en CDD voient encore leur probabilité diminuer de 3,45 points par rapport au CDI. (INSEE, 2009). L'étude des formations dispensées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ou du congé individuel de formation (CIF) ne donne pas de meilleurs résultats.
* 306 Rapport commandé par M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, à un groupe de travail présidé par Jean-Marie Marx, directeur général d'AGEFAFORIA et ancien directeur général délégué de l'ANPE, et remis en janvier 2010.
* 307 Rapport public thématique « La formation professionnelle tout au long de la vie », septembre 2008.
* 308 Communication de la Commission européenne intitulée « Vers des principes communs de flexicurité : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité », juin 2007.
* 309 Communication précitée.
* 310 Réponse à un questionnaire adressé par vos rapporteurs à l'ambassade de France au Danemark.
* 311 Validation des acquis de l'expérience.
* 312 Mis en place par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.
* 313 Remplacé depuis le 1 er juin 2009 par le RSA (revenu de solidarité active).
* 314 Réponse à un questionnaire adressé à l'ambassade de France en Allemagne.
* 315 Hypothèse envisagée dans le rapport « Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique », par Jacques Barthelemy et Gilbert Cette, Conseil d'analyse économique, 2010.
* 316 Outre que l'assouplissement du CDI compte parmi les demandes réitérées du MEDEF pour favoriser les créations d'emploi, les rapports et proposition allant dans ce sens abondent ; en dernier lieu, on citera l'Institut Montaigne, qui, parmi ses « 15 propositions pour l'emploi des jeunes et des seniors », propose simultanément de supprimer le CDD et de rendre le CDI plus flexible (septembre 2010).
* 317 Voir, sur le site de l'INSEE, le document intitulé « Statut d'emploi et type de contrat des actifs occupés selon le diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale » dernièrement mis à jour en juillet 2010.
* 318 Contrats à durée déterminée, intérim, stages et contrats aidés, apprentissage.
* 319 Instauré par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, le contrat nouvelles embauches ( CNE ), proposé aux entreprises de vingt salariés au plus, comportait une période de « consolidation de l'emploi » de deux années au cours desquelles une rupture sans annonce du motif de licenciement était théoriquement possible. Ces caractéristiques ont été déclarées contraires au droit international par l'Organisation internationale du travail (OIT) le 14 novembre 2007. Le CNE a été abrogé par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. On rappelle que le contrat première embauche ( CPE ), instauré par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances à destination des moins de 26 ans, présentait, entre autres spécificités, les caractéristiques précitées. A la suite de vives contestations, le CPE a été retiré par le gouvernement (abrogation par la loi du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise).
* 320 Note d'analyse n° 198 du Centre d'analyse stratégique, octobre 2010.
* 321 Réponses des ambassades figurant en annexe.
* 322 Si la Cour de cassation a finalement jugé que l'engagement de négociations sur la GPEC ne s'imposait pas comme préalable à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (Soc, 30 septembre 2009), il semble que cet outil permette cependant aux employeurs de mieux justifier des obligations qui leur incombent d'adaptation et de formation des personnels.
* 323 S'il est un fait qu'en France, beaucoup d'emplois demeurent non pourvus (le chiffre de 500 000 emplois - estimation difficilement vérifiable - est parfois avancé), leur nombre demeure sans commune mesure avec celui des chômeurs. Il serait cependant exagéré de procéder à une comparaison directe car la compétence de la main d'oeuvre est un élément majeur de l'attractivité du territoire pour les implantations d'entreprises, et une politique d'employabilité réussie serait donc susceptible de créer beaucoup plus d'emplois qu'il n'existe d'emplois non pourvus.
* 324 « Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales », rapport au Premier ministre de M. Raphaël Hadas-Lebel, président de section au Conseil d'État (mai 2006).
* 325 « Consolider le dialogue social », avis du CES présenté par Paul Aurelli et Jean Gautier (2006).
* 326 Position commune du 9 avril 2008 signée par la CGT, la CFDT, le MEDEF et la CGPME. Ont en revanche refusé de signer ce texte : FO, la CFTC, la CGC et l'UPA.
* 327 Article L. 2121-1 du code du travail.
* 328 Élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
* 329 Rapport n° 470 (2007-2008) de M. Alain Gournac, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 15 juillet 2008.
* 330 Projet de loi substantiellement modifié par le Parlement, ayant abouti à la loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n° 2010-1215 du 15 octobre 2010) : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-446.html
* 331 Cf. rapport précité de Raphaël Hadas-Lebel.
* 332 Étude d'administration comparée sur le financement des syndicats (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suède), IGAS, n° 160 (2004).
* 333 Les cotisations syndicales peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant.
* 334 « Le syndicalisme de services : une piste pour un renouveau des relations sociales ? », Note de veille du CAS n° 190 (août 2010).
* 335 Principes directeurs pour le gouvernement d'entreprise de l'OCDE (2004).
* 336 Code AFEP MEDEF (article 8) : « Un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par administrateur indépendant, il faut entendre, non pas seulement administrateur non-exécutif c'est-à-dire n'exerçant pas de fonctions de direction de la société ou de son groupe, mais encore dépourvu de lien d'intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, autre) avec ceux-ci. ».
* 337 Par exemple par David Thesmar et Francis Kramarz (2006), « Social networks in the boardroom », IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit) discussion paper n° 1940, insistant sur les effets de réseau.
* 338 Family business network
* 339 J. Allouche, B. Amman, P. Garaudel (2006), "2006-02 : Performances et caractéristiques financières comparées des entreprises familiales et non familiales", Cahiers de recherche - GREGOR (Groupe de recherche en gestion des organisations).
* 340 Même si certains contre-exemples brillants existent.
* 341 Audition par vos rapporteurs de MM. Dominique Lefebvre, Président, M. Bertrand Corbeau, Directeur général, M. Bernard Philippe, Directeur général adjoint de la Fédération nationale du Crédit Agricole (29 juin 2010).
* 342 Rapport du Conseil supérieur de la Coopération (2007)
* 343 Droit des sociétés, Dominique Vidal, LGDJ (2008).
* 344 « Travail et protection sociale : un droit malmené » (janvier 2009).
* 345 Sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à la Sorbonne.
* 346 Il est regrettable que le CAS ne soit plus piloté par un Secrétariat d'Etat spécifique dans le nouveau gouvernement constitué le 14 novembre 2010.
* 347 Document d'études. DARES n° 140. Août 2000.
* 348 Olivier Meriaux, Jean-Yves Kerbourc'h, Carine Seiler.
* 349 « Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective ».
* 350 Volume XXV, octobre 2010.
* 351 Rapport du Conseil d'analyse économique (CAE). Février 2010.
* 352 Toute modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié (mais un refus de ce dernier peut constituer un motif de licenciement pour motif disciplinaire). Un contrat individuel ne peut pas, par ailleurs, en principe, déroger in pejus à un accord collectif. Il s'agit de faire du contrat un instrument de protection du salarié face à la flexibilité croissante du droit du travail.
* 353 Eléments constitutifs majeurs du contrat : son objet, la qualification attachée à la fonction concernée, la rémunération correspondante.
* 354 Sociologue - directeur de recherche au C.N.R.S. - professeur à la Sorbonne
* 355 Janvier 2009 - Travail et protection sociale - un droit malmené
* 356 Janvier 2009. Travail et protection sociale : un droit malmené.
* 357 Ancien inspecteur du travail, professeur de droit du travail.
* 358 Sociologue-directrice de recherche au CNRS.
* 359 En co-décision avec le Parlement.
* 360 Quelle dimension sociale pour le projet politique européen ? Contributions et pistes d'action.
* 361 Juriste et sociologue, professeur d'université.
* 362 Magistrat administratif.