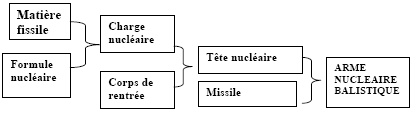Rapport d'information n° 630 (2008-2009) de M. Jean FRANÇOIS-PONCET et Mme Monique CERISIER-ben GUIGA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 25 septembre 2009
Synthèse du rapport (244 Koctets)
Disponible au format Acrobat (102 Moctets)
-
RECOMMANDATIONS
-
AVANT-PROPOS
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE IER - TABLEAU D'ENSEMBLE
-
I. DES SOCIÉTÉS EN PLEINE
ÉVOLUTION
-
II. LE RETOUR DU RELIGIEUX : UNE CRISPATION
IDENTITAIRE
-
III. LE FOSSÉ ENTRE LES PEUPLES ET LES
GOUVERNANTS
-
IV. UNE RELATION DIFFICILE AVEC L'OCCIDENT
-
V. ATOUTS ET CONTRAINTES
-
VI. L'ÉMERGENCE POLITIQUE DU CHIISME
-
I. DES SOCIÉTÉS EN PLEINE
ÉVOLUTION
-
CHAPITRE II - LE DOUBLE DÉFI
-
I. PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS:
CRÉER L'ETAT PALESTINIEN
-
A. LA DIFFICILE RÉCONCILIATION
INTERPALESTINIENNE
-
B. L'ACCEPTATION, SOUS CONDITIONS, PAR ISRAËL
D'UN ÉTAT PALESTINIEN
-
C. LA POSSIBILITÉ D'UNE PAIX
-
A. LA DIFFICILE RÉCONCILIATION
INTERPALESTINIENNE
-
II. EVITER LA PROLIFÉRATION
NUCLÉAIRE AU MOYEN-ORIENT
-
A. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE IRANIENNE
ENTRE RÉVOLUTION ET NATIONALISME
-
1. La politique étrangère
« islamique » et son échec : 1979-1989
-
2. Le retour au nationalisme et à une
politique de puissance régionale 1989-2001
-
3. L'Iran après le 11
septembre 2001
-
4. L'extrémisme verbal d'Ahmadinejad
-
5. La victoire de Mir Hossein Moussavi aurait-elle
changé en profondeur l'orientation de la politique
iranienne ?
-
1. La politique étrangère
« islamique » et son échec : 1979-1989
-
B. L'AMBITION NUCLÉAIRE DE L'IRAN
-
C. COMMENT CONVAINCRE L'IRAN DE NE PAS SE DOTER
D'ARMES NUCLÉAIRES ET ÉVITER LA NUCLÉARISATION DU
MOYEN-ORIENT ?
-
A. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE IRANIENNE
ENTRE RÉVOLUTION ET NATIONALISME
-
I. PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS:
CRÉER L'ETAT PALESTINIEN
-
CHAPITRE III - LES FRAGILITÉS
-
CHAPITRE IV - LES INTERROGATIONS
-
CHAPITRE V - LES ÉVOLUTIONS PORTEUSES
D'AVENIR
-
CHAPITRE VI - LA FRANCE ET L'EUROPE AU
MOYEN-ORIENT
-
CHAPITRE VII.- LES RECOMMANDATIONS
-
I. QUEL CADRE POUR QUELLE POLITIQUE ?
-
II. LES MESURES À PRENDRE
-
A. LES PRINCIPES STRATÉGIQUES
-
B. LES ACTIONS À MENER
-
1. Assurer un avenir au peuple palestinien tout en
confortant l'existence de l'Etat d'Israël et consolider la paix avec la
Syrie et le Liban
-
2. En Iran, éviter la bombe et le
bombardement
-
3. Sauver l'Etat yéménite de la
faillite afin qu'il ne devienne pas la prochaine base d'Al-Qaïda
-
4. Accompagner l'Irak sur la voie de la
reconstruction de son Etat
-
1. Assurer un avenir au peuple palestinien tout en
confortant l'existence de l'Etat d'Israël et consolider la paix avec la
Syrie et le Liban
-
A. LES PRINCIPES STRATÉGIQUES
-
I. QUEL CADRE POUR QUELLE POLITIQUE ?
-
CONCLUSION
-
Comptes rendus devant la commission des
déplacements effectués au Moyen-Orient
-
Premier déplacement - Arabie saoudite,
Yémen, Abu Dhabi, Dubaï, Qatar du 19 au 30 octobre 2008 - (compte
rendu du 12 janvier 2009)
-
§ Deuxième déplacement - Syrie,
Liban, Israël, Palestine, du 18 au 31 janvier 2009., (compte rendu du 3
février 2009)
-
§ Troisième déplacement -
Egypte, du 22 au 27 février 2009. - (compte rendu du 11 mars
2009)
-
§ Quatrième déplacement - Iraq,
Jordanie, Bahreïn et Koweït du 28 mars au 6 avril 2009 et
cinquième déplacement - Kurdistan, Turquie du 6 au 12 mai 2009
(compte rendu du 13 mai 2009)
-
Premier déplacement - Arabie saoudite,
Yémen, Abu Dhabi, Dubaï, Qatar du 19 au 30 octobre 2008 - (compte
rendu du 12 janvier 2009)
-
Présentation des conclusions des
rapporteurs
-
ANNEXE 1 - Liste des personnes
rencontrées
-
ANNEXE 2 - La Charte du mouvement de la
résistance islamique palestinienne (Hamas)
-
ANNEXE 3 - Carte de La Bande de Gaza
-
ANNEXE 4 - Compte rendu d'entretien entre la
mission sénatoriale française et Khaled Mechaal - chef du bureau
politique du Hamas À Damas le 20 janvier 2009 - (traduction des notes
prises par M. Peter Harling - international Crisis Group)
-
ANNEXE 5 - Le partage de la Palestine
-
ANNEXE 6 - Ce qui reste de la Cisjordanie
-
ANNEXE 7 - Le système politique
d'Israël et la proclamation d'indépendance
-
ANNEXE 8 - Le « document des
prisonniers » (signé par des leaders emprisonnés du
Fatah, du Hamas, du Jihad islamique, du FPLP et du FDLP)
-
ANNEXE 9 - Lettre de Son Exc. M. Seyed Mahdi
Miraboutalebi, relative à la position officielle de l'Iran sur son
programme nucléaire
N° 630
SÉNAT
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2009 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1), à la suite d'une mission effectuée du 22 septembre 2008 au 7 juillet 2009 sur la situation au Moyen-Orient .
Par M. Jean FRANÇOIS-PONCET et Mme Monique CERISIER-ben GUIGA,
Sénateurs.
|
(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, Jean-Pierre Bel, René Beaumont, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca. |
RECOMMANDATIONS
|
I. LE CADRE ET LES PRINCIPES 1. Le cadre Définir, une ligne d'action européenne sur la politique à conduire au Moyen-Orient, qui ne soit pas un consensus a minima, dans le cadre d'une coopération étroite entre les pays qui le souhaitent et, en priorité, avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne ; Associer la Turquie à la définition de cette politique ; Rendre le Quartet plus opérationnel ; Mieux coordonner nos actions avec la nouvelle administration américaine . 2. Les principes Donner la priorité au conflit israélo-palestinien, qui reste central ; Déconnecter le traitement des conflits ; refuser par exemple de conditionner les avancées sur le dossier palestinien à celles sur le dossier iranien ; Cibler les actions diplomatiques sur les questions mettant en jeu notre sécurité, notre économie et la consolidation de nos relations bilatérales. II. LES ACTIONS À MENER 1. S'engager dans la création d'un Etat palestinien Les Etats-Unis font pression sur Israël pour l'arrêt total de la colonisation. L'Europe doit continuer à soutenir cette action , y compris à Jérusalem, comme elle l'a fait jusqu'à présent, mais elle doit maintenant agir de concert avec les Etats-Unis pour obtenir du Gouvernement d'Israël la levée du blocus de Gaza . L'Europe doit faire pression sur les Palestiniens dans le but qu'ils constituent un Gouvernement capable de négocier en leur nom . La constitution de ce nouveau Gouvernement passera moins par une hypothétique réconciliation que par de nouvelles élections, dont le résultat sera respecté par les puissances occidentales. Pour organiser ces élections, la nomination d'une Autorité palestinienne transitoire s'impose . Cette autorité devra notamment trancher la question du mode de scrutin. Pour permettre la nomination d'une Autorité palestinienne transitoire, l'Europe peut proposer sa médiation. Cette médiation européenne, en étroite liaison avec les Etats-Unis et la Turquie, pourrait proposer en échange d'un accord sur l'Autorité transitoire et la tenue d'élections, la levée du blocus de Gaza et le retour de l'aide européenne. Cela suppose d'accepter de parler au Hamas. 2. En Iran, éviter la bombe et le bombardement Appuyer la démarche américaine de la main tendue et tout faire pour éviter , par la négociation , que le programme nucléaire iranien ne devienne un programme militaire . Dans l'hypothèse où la négociation échouerait, préparer des sanctions économiques sévères contre le Gouvernement iranien. 3. Sauver l'Etat yéménite de la faillite afin qu'il ne devienne pas la prochaine base d'Al-Qaïda La réunion d'une conférence internationale sur l'avenir de ce pays devrait être organisée dans les meilleurs délais. 4. Accompagner l'Irak dans la reconstruction de son Etat Pour que l'Irak renaisse, les élections libres ne suffisent pas. Il lui faut aussi un Etat impartial : des fonctionnaires, des juges, des administrateurs, des enseignants, des universitaires, des militaires et des policiers au service de l'Etat. L'Europe et la France peuvent l'y aider si le Gouvernement irakien le veut réellement. |
AVANT-PROPOS
« Si vous avez compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est sûrement qu'on vous a mal expliqué » - Percy Kemp - Le système Boone.
Mesdames, Messieurs,
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a confié le 22 septembre 2008 à deux de ses membres, M. Jean François-Poncet, sénateur UMP, vice-président de la commission, et Mme Monique Cerisier-ben Guiga, sénatrice socialiste, secrétaire du bureau du Sénat, une mission d'information sur le Moyen-Orient.
Afin de remplir la mission qui leur a été confiée, les deux rapporteurs ont effectué sept déplacements entre octobre 2008 et juin 2009, au cours desquels ils se sont rendus dans les quinze pays du Moyen-Orient, à l'exception du Sultanat d'Oman et de l'Iran. Ils y ont eu 357 entretiens et audiences.
Les deux rapporteurs ont également procédé, à Paris, à 40 auditions de spécialistes permettant d'éclairer la région sous ses différents aspects. Ils ont effectué six déplacements, en particulier à la Direction des Applications Militaires du Commissariat à l'énergie atomique et à EADS Astrium pour comprendre l'état d'avancement du programme nucléaire iranien et ses capacités balistiques.
Afin de préserver la confidentialité des informations recueillies, les rapporteurs ont décidé de ne pas rendre publics les procès-verbaux qui ont été dressés de ces entretiens et auditions.
Les rapporteurs n'ont pas pu se rendre en Iran avant les élections du 12 juin 2009, en raison du refus, signifié d'une façon discourtoise, de l'ambassadeur d'Iran à Paris, M. Seyed Mehdi Miraboutalebi, de leur accorder des visas.
En Israël, aucun des leaders politiques n'a accepté de les recevoir, à l'exception notable de M. Haïm Oron, leader du Meretz, du fait de leur rencontre à Damas avec Khaled Mechaal, leader politique du Hamas.
Les rapporteurs se sont également rendus en Turquie, à Washington et à New-York ainsi qu'à Bruxelles pour y rencontrer les personnalités les plus impliquées dans les affaires du Moyen-Orient.
Le présent rapport présente une vision d'ensemble de cette région, avec ses points communs et ses problèmes particuliers, et s'efforce d'en appréhender l'ensemble des aspects. Il ne prétend pas examiner le cas de chaque pays à la hauteur de son importance. En outre, certains rappels historiques seront superfétatoires pour tous ceux qui connaissent la région.
L'objectif de ce rapport est d'aider la représentation nationale à former son jugement propre sur la politique étrangère de notre pays, dans le cadre et dans les limites du principe de la séparation des pouvoirs.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
A l'Est, il y a du nouveau.
Il y a, dans l'immédiat, les soubresauts consécutifs aux dernières élections présidentielles en Iran, qui soulèvent des questions quant à la légitimité du régime en place, mais qui surtout rendent plus difficile encore le dialogue avec ce pays. Si l'Iran arrivait à se doter de l'arme nucléaire, comme l'Occident lui en prête l'ambition, une nucléarisation de l'ensemble de la région, qui n'a pas été déclenchée par la nucléarisation d'Israël, serait cette fois-ci à redouter.
Il y a ensuite, dans le temps long, un retour du religieux dans toute la région. Ce phénomène est en grande partie l'expression d'une crispation identitaire. Derrière le voile, la quête de soi. Derrière la barbe, la politique. La réislamisation est vraisemblablement une mutation du « panarabisme », ce rêve de l'unité du monde arabe porté avec panache par Gamal Abdel Nasser, qui s'est fracassé sur les défaites de l'Egypte et de ses alliés arabes face à Israël. Le Moyen-Orient rejette les normes occidentales et veut réinventer les siennes propres. Attiré pendant plus d'un siècle par l'Occident et simultanément agressé par lui, il le perçoit comme éminemment injuste parce que faisant deux poids et deux mesures entre les Arabes et Israël.
Ces deux images, celle d'un retour du religieux et celle d'une nucléarisation, se superposant, dessinent les possibles contours d'un Moyen-Orient nucléaire.
Vu de près, le tableau est plus nuancé.
D'abord, parce que le fait nucléaire n'est pas une nouveauté au Moyen-Orient. Israël posséderait la bombe atomique depuis la fin des années 1960. Par ailleurs, aux marges de la région, mais dans la même zone culturelle, le Pakistan, pays musulman à majorité sunnite, possède, lui aussi, un arsenal nucléaire depuis la fin des années 1980.
Ensuite parce que l'Islam ne désigne pas un camp, mais une religion qui divise autant qu'elle unit les pays musulmans de la région.
D'un côté, l'Iran. La religion qu'il pratique est l'Islam chiite, aussi différent de l'Islam sunnite pratiqué dans la majorité des pays arabes que peut l'être le protestantisme du catholicisme. Pourtant, ce pays a su se constituer un groupe de clients ou d'alliés arabes, en utilisant la religion, le problème palestinien ou encore le rejet de l'Occident comme facteur de cohésion. Il s'agit de la Syrie, gouvernée par une minorité alaouite apparentée au chiisme, du Hezbollah libanais et chiite, du Hamas palestinien, pourtant d'obédience sunnite. C'est le « croissant chiite » évoqué par le Roi de Jordanie il y a plusieurs années. De surcroît, l'Iran dispose d'une grande influence en Irak où les Chiites représentent 60 % de la population. A ce groupe de pays appelés souvent « radicaux » en Occident, se joint, en fonction des sujets, le riche et influent Qatar qui abrite le quartier général de l'aviation américaine dans la région et qui a forgé le plus puissant porte-voix du Moyen-Orient : la chaîne de télévision Al Jazeera.
De l'autre côté, Israël n'a pas pu ou pas voulu s'insérer dans son environnement régional. Israël est perçu et se pense comme une enclave de l'Occident dans une terre résolument hostile, attirant de facto ce dernier dans une confrontation qui n'est pas forcément la sienne. Depuis 1948, les Gouvernements d'Israël qui se sont succédé n'ont jamais reconnu que le peuple palestinien avait une identité distincte du reste des peuples arabes et que ses élites nourrissaient, dès le début du XX ème siècle, le rêve d'une renaissance nationale au sein d'un Etat. Israël, triomphant dans la guerre, s'est montré incapable de faire la paix.
Entre ces deux pôles de puissance opposés, se placent l'ensemble des autres pays arabes qu'on regroupe en Occident sous l'appellation de « modérés » car leur diplomatie s'aligne souvent sur celle des Etats-Unis. Loin de former un « camp » homogène, ces pays sont aussi différents les uns des autres que peuvent l'être les pays européens entre eux et pensent avant tout, comme les Européens, à la sauvegarde de leurs propres intérêts.
Les Gouvernements des pays arabes « modérés » craignent les velléités hégémoniques de l'Iran que l'accession à un armement nucléaire ne pourrait que renforcer tout en sanctuarisant son territoire.
Les peuples arabes ne voient pas nécessairement les choses de la même façon. Ils détestent l'Iran quand celui-ci prétend leur dicter leur conduite, mais l'admirent quand, défiant l'Occident, il se prétend le héraut du peuple palestinien.
Que va-t-il se passer ? Personne n'est en mesure de le dire. Une chose est sûre, nous sommes arrivés à un carrefour où tout reste possible. La paix ou la guerre. C'est ce que les Grecs anciens appelaient le kairos : le moment de vérité, lorsque le temps se densifie et que chacun doit choisir une voie et renoncer aux autres.
Le blocus de Gaza dure depuis avril 2006 et n'a toujours pas été levé. Rien ou presque n'ayant changé, le statu quo est insupportable et Gaza est une bombe qui n'a pas été désamorcée.
Par ailleurs, rarement autant d'élections décisives auront eu lieu dans un si court laps de temps dans une région où, plus qu'ailleurs, les Gouvernements prennent prétexte de la prochaine élection, chez eux ou chez leur voisin, pour justifier leur inaction.
Un nouveau Premier ministre, appuyé par une majorité comportant des éléments d'extrême droite, gouverne Israël depuis février 2009.
Des élections législatives ont eu lieu au Liban le 7 juin 2009, qui ont vu la victoire du camp pro-occidental « du 14 mars » emmené par Saad Hariri, le fils du défunt Premier ministre Rafic Hariri et qui peine depuis à former son Gouvernement.
L'Iran a voté le 12 juin 2009. La sincérité du scrutin est mise en cause par les observateurs. Ahmadinejad reste Président, mais son pouvoir a été fortement remis en question.
A la fin de l'année, des élections législatives auront lieu en Irak. Nouri Al Maliki, le Premier ministre chiite, sera-t-il reconduit et sa politique d'unité nationale poursuivie malgré le départ des forces américaines qu'il a pourtant souhaité célébrer ?
Et puis, surtout, un nouveau Président des Etats-Unis a été élu. Il dispose encore d'une grande marge de manoeuvre. Il a décidé le retour de l'Amérique dans le conflit israélo-palestinien, et a pris le temps de redéfinir sa politique dans la région.
Une nouvelle partie a donc commencé et ses premières manches se jouent en Israël et en Iran.
Quels sont les joueurs ? Les seize pays situés d'est en ouest entre l'Iran et l'Egypte et du nord au sud entre la Syrie et le Yémen. La spécificité de la région tient à la place qu'y ont toujours occupée les puissances extérieures. Décrire la partie qui se joue au Moyen-Orient sans prendre en compte ce qu'Henry Laurens appelle « le jeu pervers des implications et des ingérences » extérieures, serait proprement impossible.
Les Etats-Unis d'Amérique sont sans conteste le partenaire le plus influent. L'ensemble de la région a suivi avec passion la dernière élection présidentielle. Cela se comprend, tant un battement d'aile à Washington peut provoquer une tempête en Israël, en Palestine ou en Irak. Cette hyper-présence des Etats-Unis fait-elle partie du problème ou bien de la solution ? Toujours est-il que rien ne pourra se dénouer sans que les Etats-Unis en soient partie prenante. Toutes les routes du Moyen-Orient passent par Washington.
La Turquie, absente de la région depuis la fin de l'empire ottoman, y déploie depuis quinze ans une diplomatie habile qui lui permet de parler avec tout le monde, d'avoir un partenariat stratégique avec Israël tout en menant des manoeuvres militaires avec la Syrie, de parler au Hamas sans craindre l'anathème, de jouer les médiateurs au Kurdistan iraquien et d'avoir de bonnes relations avec l'Iran.
Même si l'empreinte de l'Union soviétique ne s'est pas complètement effacée et si elle a laissé des stigmates du stalinisme dans les systèmes politiques de l'Egypte ou de la Syrie, ainsi que dans l'organisation de leurs forces armées, la Russie ne joue pas un rôle central dans la région.
La Chine fait son apparition, commerce et énergie obligent. Elle offre à la région un horizon asiatique. L'Inde et le Pakistan ne peuvent se désintéresser du sort de leurs millions de concitoyens qui travaillent dans le Golfe.
Enfin, l'Europe. Quelle est sa politique au Moyen-Orient ? Que font l'Angleterre et la France, dernières puissances impériales à avoir occupé les lieux ? Elles portent la responsabilité historique d'en avoir découpé les frontières sans tenir compte de la volonté des peuples. Mais y ont-elles encore une politique ?
En quoi la partie qui est en train de se jouer au Moyen-Orient concerne-t-elle l'Europe ? Il y a, bien sûr, l'énergie et les intérêts commerciaux. L'Europe dépend du Moyen-Orient pour ses importations de pétrole et de gaz. Inversement, l'Europe exporte quantité de biens et de services vers cette région. La France seule a exporté en 2008 vers le Bahreïn l'équivalent de 6,2 milliards d'euros, autant que vers le Brésil. Nos liens sont très forts, historiques, avec le Liban, la Syrie et l'Egypte. Des liens nouveaux, des partenariats stratégiques, à la fois culturels, économiques et militaires, ont été tissés avec les Emirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie saoudite.
Il y a ensuite la sécurité. Le terrorisme inquiète de la même façon Européens, Américains et Gouvernements du Moyen-Orient. De jeunes Européens prennent le chemin des madrasas, au Yémen ou ailleurs, tandis que d'autres meurent dans des attentats au Caire, à Londres ou à Madrid.
Mais il y a plus. Il y a cette communauté de destins qui résulte de la présence en Europe, sur notre territoire, de plusieurs millions de Musulmans et de Juifs. Cette communauté va au-delà des intérêts économiques et des préoccupations sécuritaires. Elle nous unit plus qu'elle ne nous sépare. Elle est faite de « passés » dont certains « ne passent pas », mais surtout de futurs qui concernent directement la construction de l'identité européenne. C'est le cas, en particulier, pour notre pays.
Alors où en est la partie et quels en sont les enjeux ? Quels sont les éléments communs - il y en a - qui fondent l'identité politique de cette région et permettent d'en dresser un tableau d'ensemble ?
Le problème palestinien et le problème iranien dominent, par leur ancienneté ou leur gravité, la scène politique régionale. Comment faut-il les traiter ?
Quelles sont les zones de fragilité et celles où un processus de consolidation est à l'oeuvre ? Quelle a été la politique de la France jusqu'à présent et comment l'Europe s'est-elle affirmée ?
Et, en conclusion, quelles devraient être les orientations de notre diplomatie et celles de la diplomatie européenne si, après la ratification du Traité de Lisbonne, elle voit enfin le jour ?
Telles sont les questions que nous nous sommes posées.
Le Moyen-Orient
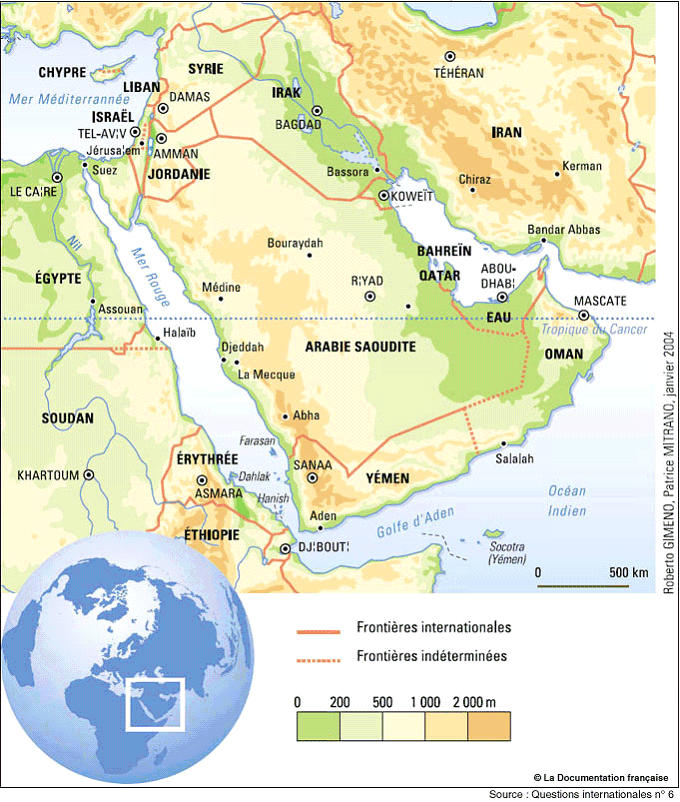
Les pays du Moyen-Orient
Éléments statistiques
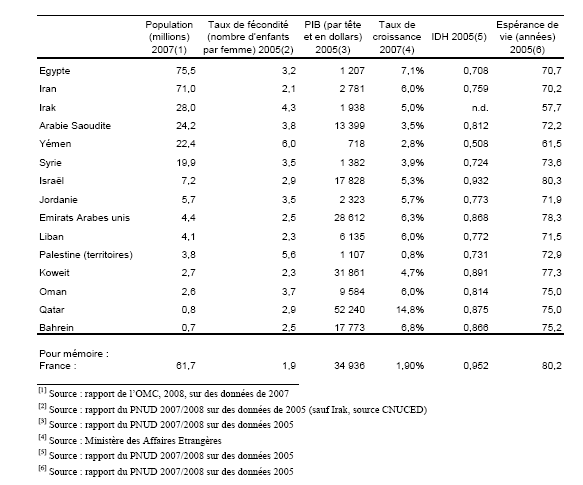
CHAPITRE IER - TABLEAU D'ENSEMBLE
Pour reprendre en l'inversant la belle image de Carl Poirier citée par Pascal Ménoret 1 ( * ) , le Moyen-Orient est situé à « distance d'imagination ». Cette formule appliquée par son auteur à la seule Arabie saoudite éclaire l'ensemble de la perception que les Américains et les Européens ont de cette région du monde.
D'où viennent notre difficulté à comprendre réellement les sociétés de ces régions, notre absence d'empathie, le rejet ethnocentrique de leurs cultures, notre indifférence trop fréquente à leurs malheurs, l'acceptation tranquille du fait qu'ils subissent des dictatures prédatrices -républicaines ou monarchiques- et souffrent du retard de développement humain qu'elles provoquent ?
Une première hypothèse est l'amnésie qui nous frappe sur la nature des relations entre l'Europe (et ensuite les Etats-Unis) et le Moyen Orient au XIX ème et au XX ème siècles. Nous avons oublié que « la colonisation et l'impérialisme ont brutalisé les sociétés » 2 ( * ) -campagne d'Egypte, interventions françaises et anglaises au Proche-Orient pour affaiblir l'Empire ottoman, puis dépeçage de cet empire dans les années 1920, création d'Etats au mépris de la volonté des peuples concernés : Irak, Syrie amputée du Liban, Jordanie, lot de consolation aux Hachémites, Arabie offerte à la famille Saoud, tous pays soumis à des régimes de protectorat officiel (Irak-Syrie) ou officieux (Jordanie-Arabie). La diplomatie de la canonnière, nous l'avons oubliée. Et pourtant elle n'a jamais cessé. La guerre d'Irak en est le dernier épisode. Ce passé que nous avons occulté passe mal au Moyen-Orient et, comme le dit Henry Laurens, il resurgit, instrumentalisé, dès que les puissances publiques étatiques et non étatiques en ont besoin pour ressouder une opinion publique dont le bâillon lâcherait.
Une deuxième hypothèse tient à la méconnaissance des caractéristiques réelles des sociétés du Moyen-Orient. Jamais -à l'exception du Yémen- les peuples n'ont été si jeunes, si alphabétisés et, les élites si hautement compétentes. Jamais tant de femmes n'ont été instruites, n'ont accédé à des études supérieures, aux professions prestigieuses, source de pouvoir aussi bien au fin fond de la péninsule arabe qu'en Egypte.
Une troisième hypothèse concerne notre conception essentialiste de l'Islam et du Moyen-Orient qui nous conduit à réduire abusivement cette religion à certaines pratiques archaïques et cette région du monde à sa dimension religieuse. Cela s'explique par la manipulation quasi systématique de la religion par les régimes arabes et la présence d'extrémistes. Or nous devrions être capables de faire le tri. Pas plus que le catholicisme ne se confond avec l'Inquisition, le protestantisme avec les pasteurs condamnant les « sorcières » au bûcher du XVII ème siècle ni avec les créationnistes d'aujourd'hui, l'Islam n'est réductible ni aux talibans, ni aux mollahs iraniens. C'est à la fois une source d'élévation spirituelle pour les uns et le terrible alibi aux guerres les plus cruelles pour les autres. L'Islam, comme toutes les religions, est ce que les hommes en font.
Les caractères communs aux pays du Moyen-Orient que nous allons rappeler sont connus en Occident des spécialistes de la région. Mais ils sont dramatiquement ignorés par l'opinion publique. Comment, sans référence à cet arrière-plan, les crises qui font la une des journaux télévisés, pour quelques secondes sanglantes, pourraient-elles être comprises ?
Ces images confortent dans l'opinion occidentale des stéréotypes d'arriération, de violence, d'étrangeté irréductible et, pour tout dire, de rejet hors de l'humain. Avant d'exposer l'évolution du Moyen-Orient, rappelons quelques faits sociologiques, historiques et économiques, dans le but de rendre plus intelligible aux yeux des Occidentaux cet Orient qui ne nous semble si compliqué que parce qu'il est méconnu.
I. DES SOCIÉTÉS EN PLEINE ÉVOLUTION
A. LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE EST PARTOUT COMMENCÉE ET NULLE PART ACHEVÉE
1. La transition démographique au Moyen-Orient
Le terme de « transition démographique » désigne une phase de la vie de la société où les couples commencent à contrôler leur fécondité. 3 ( * )
Le Moyen-Orient est entré dans cette phase. Depuis une trentaine d'années la fécondité est tombée de 6,8 enfants par femme en 1975 à 3,7 en 2005. C'est le signe d'un bouleversement profond des équilibres traditionnels touchant les rapports d'autorité au sein de la société civile et politique. Le moment décisif d'un tel basculement est atteint lorsque la première génération majoritairement alphabétisée arrive à l'âge adulte. C'est le cas au Moyen-Orient. La volonté de contrôler les naissances se diffuse alors dans la population. Ce progrès vers la modernité produit une désorientation générale de la société et fragilise fréquemment l'autorité politique. La période de l'alphabétisation et de la contraception est aussi souvent celle de la Révolution.
2. Perturbations sociales
Les perturbations sociales sont en général d'autant plus fortes que les traditions familiales sont puissantes. C'est le cas au Moyen-Orient où la famille patriarcale est davantage l'expression d'une solidarité de frères/soeurs et de cousins/cousines que celle d'une dictature d'un pater familias . L'alphabétisation, l'exode rural et le contrôle des naissances ont projeté les individus dans un nouveau cadre moderne, peut-être plus propice à l'épanouissement personnel mais si déstabilisant qu'il provoque la nostalgie du passé. Les fixations sur le statut des femmes, l'ostentation de pratiques religieuses autrefois privées sont des symptômes de cette désorientation. Au Moyen-Orient, la famille patriarcale offre de solides protections aux individus en contrepartie de l'acceptation de ses contraintes. L'alphabétisation, l'exode rural et le contrôle des naissances ont détruit la protection en même temps que le patriarcat, d'où un regain d'anxiété.
3. Mise en perspective
Ce système familial subit avec une violence particulière ce choc de la modernisation qui ébranle les relations d'autorité et menace le principe de prédominance masculine par l'alphabétisation des femmes et la modification des conduites sexuelles. Ces séquences révolutionnaires, typiques aux périodes de transition démographique, ne sont pas propres au Moyen-Orient. Ainsi, en 1649, l'Angleterre qui venait de franchir le seuil de l'alphabétisation majoritaire entra dans la révolution puritaine qui aboutit en 1689 à la magna carta . De même, en France, vers les années 1730, alors que la majorité des hommes de 20 à 24 ans savaient lire et écrire et que la fécondité commençait à baisser s'ouvrit une crise idéologique et politique qui enfanta la Révolution de 1789.
B. LES FEMMES ENTRE ASCENSION ET CONSERVATISME
1. Des tendances contradictoires
La situation des femmes au Moyen-Orient est déterminée par des tendances contradictoires. Certains éléments prouvent une ascension et une émancipation. Le rôle joué par les femmes au moment de l'élection présidentielle iranienne plaide en ce sens, mais on pourrait prendre d'autres exemples, comme la multiplication des femmes d'affaires en Arabie saoudite ou dans le Golfe. Au contraire, d'autres éléments font apparaître une régression du statut des femmes, marqué par des préceptes conservateurs que les femmes transmettent inconsciemment aux générations futures. Libéralisation de la condition féminine ou retour vers un statut de dominée : il est difficile de se faire une idée précise.
2. La scolarisation des filles
Cette transformation du statut des femmes résulte de l'augmentation du taux de scolarisation féminine qui a atteint 50 % en moyenne. Avec le développement des universités et la fréquentation sans précédent de l'enseignement supérieur, les compétences professionnelles des femmes se sont considérablement élevées durant les trois dernières décennies et la région a connu le plus fort accroissement au monde de la participation des femmes à l'activité économique entre 1990 et 2003 (19 % contre 3 % au niveau mondial). Écoles et universités destinées aux jeunes filles, avancées législatives, telles l'obtention du droit de vote et la possibilité d'être candidate aux élections parlementaires (Oman et Qatar en 2003, Koweït en 2005), tout a bougé en moins de 50 ans.
Cette transformation qualitative et quantitative du rôle des femmes a aussi provoqué en réaction, et sur une large échelle, le retour de conceptions conservatrices qui s'efforcent de cantonner les femmes à être « gardiennes des traditions » 4 ( * ) .
Paradoxalement, le retour en force du port du voile musulman est la preuve que les milieux sociaux les plus conservateurs acceptent que leurs filles et leurs épouses étudient, aient une activité professionnelle et sortent ainsi de la maison protectrice. Le voile et l'abaya, qui sont vécus comme des régressions pour les femmes issues des bourgeoisies modernes, sont l'instrument de la libération pour la majorité des autres.
3. Féminisme et salafisme
Le mouvement féministe a en effet coïncidé avec l'essor des mouvements islamistes et l'extension du salafisme (de salaf : ancêtre). Les couches sociales populaires ont adhéré à ces mouvements islamistes avec d'autant plus de facilité qu'elles avaient été alphabétisées, lisaient le Coran, contrairement à leurs parents, et que leur niveau intellectuel les prédisposait à une interprétation littérale du texte. Ce phénomène a touché les femmes comme les hommes. Par ailleurs les femmes musulmanes, comme beaucoup d'occidentales encore, transmettent par leur exemple des valeurs d'hégémonie masculine qui se retournent contre elles et leurs filles.
Le statut des femmes, entre ascension et conservatisme, apparaît ainsi comme l'indicateur du degré d'évolution de sociétés en pleine mutation.
II. LE RETOUR DU RELIGIEUX : UNE CRISPATION IDENTITAIRE
A. LE REJET DE LA NORME OCCIDENTALE
L'Islam est redevenu la norme sociale dominante des sociétés moyen-orientales longtemps tentées par l'occidentalisme. Cela ne date pas d'hier, mais de la défaite du nationalisme arabe après la guerre de 1967. La « réislamisation » se caractérise par l'adoption d'une mode vestimentaire (voile pour les femmes) et de comportements islamiques destinés à se rendre plus respectable. La prière est pratiquée avec plus d'ostentation, chacun jeûne pendant le ramadan ou fait semblant. Tout cela relève du rejet du modèle des moeurs occidentales par un mouvement de repli identitaire 5 ( * ) .
En effet, les croyances religieuses, transmises d'une génération à l'autre, se démodent moins vite que les idéologies. En offrant à ses adeptes un ancrage identitaire, la religion apporte une réponse à toutes les générations vaincues et humiliées par les défaites face à Israël.
L'islam s'est ainsi imposé progressivement comme le territoire de la dignité retrouvée des populations musulmanes, l'ultime sanctuaire de leur estime de soi. C'est en instrumentalisant la religion que les anciens nationalistes ont canalisé le mal être de la jeunesse et lui ont redonné sa fierté 6 ( * ) .
B. LES TROIS GÉNÉRATIONS DE L'ISLAMISME
L'islamisme moderne a connu trois générations successives. La première fut celle de la résistance à la présence coloniale. Elle a été remplacée par la génération de la résistance aux élites nationalistes issues des indépendances. Enfin, la troisième génération, celle d'Al-Qaïda a vu le jour, en se démarquant du reste de l'islamo-nationalisme propre aux territoires occupés ou en guerre contre l'Occident : Bosnie, Tchétchénie, Afghanistan, Pakistan, Irak et bien sûr Palestine 7 ( * ) .
C. JIHADISME ET SALAFISME
L'une des composantes de cette dernière génération a opté pour une lecture radicale et une instrumentalisation guerrière du référentiel musulman. S'étant opérée contre l'Occident en général, les Etats-Unis et Israël en particulier, cette radicalisation prône le recours à la lutte à mort contre les Chrétiens et les Juifs, mais aussi contre les élites dites « laïques» au pouvoir. Ce mouvement se démarque de celui des Frères Musulmans, accusés de faire des concessions inacceptables au primat de la norme divine en acceptant les principes de la démocratie.
D. VERS UNE MODERNITÉ MUSULMANE ?
Faut-il voir dans cette crispation identitaire un frein à la modernisation ? Pas nécessairement. On peut être à la fois médecin et bon musulman, ingénieur et croyant fervent. Pascal au XVIII ème siècle fut à la fois un grand mathématicien et un mystique au jansénisme militant. Le phénomène des Frères Musulmans en Égypte et en Jordanie en est un exemple caractéristique. Depuis quelques années ce mouvement est passé d'une logique de transformation profonde de la société à un combat politique plus classique. Officiellement, il a abandonné tout projet d'État théocratique, et la nouvelle garde clame son respect de la souveraineté populaire, de l'alternance démocratique et des droits des minorités. Véritable nébuleuse, le mouvement né en Égypte s'est propagé dans une grande partie des Etats du Moyen-Orient, sous diverses formes, en Palestine bien sûr, mais aussi en Jordanie où, comme en Égypte, le parti milite pour que des réformes constitutionnelles soient mises en place : autonomie du Parlement, abolition du scrutin majoritaire, amorce de réformes économiques dans un sens libéral et adoption de la liberté d'expression.
Comment appréhender ce mouvement : s'agit-il d'une sorte de « démocratie chrétienne » islamique ? Les revendications démocratiques sont-elles compatibles avec le discours moralisateur des Frères Musulmans, leurs activités de prédication dans la société, l'appel à la pratique religieuse, le respect des coutumes et de la tradition islamique et la critique de certaines émissions ou publications considérées comme immorales ? Les peuples du Moyen-Orient peuvent-ils, au travers de l'adhésion à de tels mouvements, trouver une échappatoire à leurs frustrations et, par un phénomène dialectique connu, rebondir vers une modernité originale enracinée dans leur histoire ?
III. LE FOSSÉ ENTRE LES PEUPLES ET LES GOUVERNANTS
Lorsque, en avril 2003, la statue de Saddam Hussein, figure emblématique du tyran arabe, est abattue en plein centre de Bagdad, l'espoir est grand de voir le monde arabe s'engager enfin sur le chemin de la démocratie. La plupart des régimes affichent alors une volonté de réforme et multiplient élections et gestes conciliants face à leur propre opposition. Pourtant, aucun d'entre eux ne peut être vraiment qualifié de démocratique. En effet la démocratie n'est pas seulement un mode opératoire limité à des élections. C'est également un ensemble de valeurs, au centre desquelles figurent les droits de l'Homme garantis par un Etat impartial et par un Etat de droit.
A. DIVERSITÉ DU TABLEAU POLITIQUE RÉGIONAL
Le tableau politique régional est en fait assez diversifié : au sein même des monarchies, une différence existe entre celles qui prohibent toute activité politique ou rechignent à se prêter au jeu électoral et celles qui disposent d'une véritable arène politique et de Parlements élus. Quant aux Républiques, il y a celles qui sont devenues héréditaires, ou qui aspirent à l'être, celles qui excluent totalement les élections et les partis politiques et celles qui consentent à la presse et aux opposants une liberté d'expression encadrée.
B. DES DÉMOCRATIES EN TROMPE-L'OEIL
Loin de s'implanter véritablement dans le champ institutionnel du Moyen-Orient, la question démocratique ne semble offrir en réponse que de simples apparences, et les élections qui s'y multiplient, après avoir longtemps été réduites à un simple exercice plébiscitaire, en offrent une illustration particulièrement intéressante. L'année 2005 a ainsi été marquée par une vague d'élections en Irak, en Libye, en Arabie saoudite, mais également en Égypte, où le Président Moubarak, au pouvoir depuis 1981, a organisé, sous la contrainte des Etats-Unis, la première élection présidentielle aux apparences pluralistes puis, à la faveur des élections législatives, a laissé les Frères Musulmans devenir la première force d'opposition dans un Parlement sans pouvoir. Mais ces élections ont rarement été pluralistes et concurrentielles. Elles ont été administrées par des régimes résolus à en contrôler les résultats à travers la manipulation de la loi électorale, l'interdiction des partis d'opposition et une combinaison de fraude et de répression.
C. LA CRISE DE LA LÉGITIMITÉ POLITIQUE
Les causes de cette carence démocratique sont multiples et tiennent majoritairement au manque de légitimité de certains Gouvernements. La légitimité permet aux peuples d'accepter, sans contrainte excessive, l'autorité d'une institution. Or, la majorité des régimes de l'Orient arabe connaissent une crise aiguë de légitimité. Peu d'entre eux ont une authentique légitimité historique ou démocratique. Les peuples se soumettent à leur pouvoir, mais les détestent. Ne restent que les solidarités de proximité : confessionnelles, tribales, claniques.... Seule la légitimité « patriotique », accordée à celui qui combat les ennemis de la Nation (arabe) et lui restitue ainsi sa dignité, semble désormais devoir s'imposer. Or depuis Nasser, aucun chef d'Etat ne correspond plus à cette attente populaire 8 ( * ) .
IV. UNE RELATION DIFFICILE AVEC L'OCCIDENT
Le ressentiment des Etats arabes à l'égard des Etats occidentaux plonge ses racines dans la période coloniale, mais c'est avec la création de l'Etat d'Israël qu'il a trouvé son plein développement.
L'incapacité des Etats arabes à s'opposer militairement à Israël, jointe aux paix séparées négociées par cet Etat avec l'Egypte et la Jordanie qui lui permettent maintenant de dicter ses conditions pour une paix globale à toutes les autres parties, à commencer par les Palestiniens, explique que le conflit israélo-arabe se perpétue depuis 60 ans. Les peuples et les Gouvernements arabes en ont rejeté, non sans raison, la faute sur les puissances occidentales. Mais ce discours auto-justificateur a fini par trouver ses limites et c'est en raison de cette impuissance à gagner la guerre comme à faire la paix que les mouvements islamistes ont pu se développer. Ils se sont réappropriés le discours nationaliste arabe et y ont substitué un corpus religieux, avec d'autant plus de facilité que le discours de la principale puissance occidentale, les Etats-Unis de Georges W. Bush, était devenu lui-même truffé de références religieuses telles que la « croisade » ou « l'axe du mal ».
A. LE REJET DES ETATS-UNIS
Partout au Moyen-Orient, nous avons ressenti un rejet explicite de la puissance américaine, de son image et de ses valeurs. Ce rejet n'est plus seulement le fait de « la rue arabe » mais se rencontre également chez les élites dirigeantes des plus fidèles alliés de l'Amérique.
Toutes les opinions publiques arabes et musulmanes ont fustigé la politique moralisatrice, la stigmatisation « islamo-terroriste » des régimes arabes par l'administration Bush, ainsi que l'invasion de l'Irak et le soutien indéfectible à la politique de colonisation d'Israël. Tous les gouvernants arabes et musulmans ont dû en tenir compte.
Pourtant, dès qu'une menace surgit, ces mêmes gouvernants sont les premiers à demander aux Etats-Unis de jouer le rôle de parrain et de protecteur. C'est le jeu pervers des implications et des ingérences dénoncé par Henry Laurens. Qui appelle-t-on pour résoudre le conflit israélo-palestinien ? Les Etats-Unis. A qui demande-t-on de faire pression sur l'Iran ? Aux Etats-Unis. On leur demande de s'impliquer, mais dès qu'ils le font, on dénonce leur ingérence. Les Etats arabes entretiennent avec les Etats-Unis une relation schizophrénique et c'est pour se sortir de ce tête-à-tête oppressant qu'ils demandent à l'Europe d'accroître sa présence.
B. UNE VÉRITABLE ATTENTE D'EUROPE
L'Europe est louée pour son gradualisme, sa capacité de dialogue et sa préférence pour les valeurs face à une Amérique attachant trop d'importance à une définition procédurale de la démocratie. Les Européens sont appréciés pour leur culture et leurs liens historiques avec la région. A ce jeu là, la France ne manque pas d'être flattée en raison de sa sensibilité ancienne aux revendications arabes.
Mais soyons clairs, si les élites arabes souhaitent plus d'Europe, c'est surtout pour avoir moins d'Amérique. Si elles plébiscitent le soft power européen, c'est qu'elles en ont eu assez de l'unilatéralisme de l'administration précédente. Que le Président Obama fasse preuve de davantage de sensibilité, de culture et d'ouverture, comme il a su le faire avec un talent remarquable au Caire, et ces mêmes élites arabes retrouveront bien vite le chemin de Washington. Il n'en reste pas moins que la méfiance envers l'Occident et la volonté de préserver une identité menacée continueront à semer des chausse-trapes sur le chemin de la relation entre le Moyen-Orient et l'Occident.
V. ATOUTS ET CONTRAINTES
A. DES RESSOURCES ENERGÉTIQUES ABONDANTES MAIS UNE PÉNURIE D'EAU
1. Les ressources énergétiques
Le Moyen-Orient, en 2006, possède, de très loin, les plus importantes réserves d'hydrocarbures de la planète. Les cinq pays de l'OPEP autour du Golfe persique détiennent les deux tiers des réserves de pétrole et fournissent 30 % du pétrole brut consommé, jouant ainsi un rôle fondamental dans l'équilibre des besoins énergétiques.
Sur une production journalière totale de pétrole de 25 millions de barils, près de 20 millions sont destinés à l'exportation, dont presque la moitié provient d'Arabie saoudite, premier producteur mondial de brut. Ces exportations sont majoritairement destinées aux pays de l'OCDE. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont ainsi importé 2,5 millions de barils par jour en 2005, dont 70 % d'Arabie saoudite, 10 % d'Irak et 10 % du Koweït, le reste provenant du Qatar et des Émirats arabes unis. En Europe, 25 % des importations provient de l'Iran.
Le Moyen-Orient dispose également de très importantes réserves de gaz naturel, estimées en 2006 à 73 milliards de m 3 . La région est amenée à jouer un rôle central sur le marché gazier puisqu'elle détient 41 % des réserves mondiales. L'Iran et le Qatar se positionnent respectivement au deuxième et au troisième rang mondial et représentent à eux deux, 30 % des ressources mondiales. Avec les besoins croissants en électricité de certains pays tels que la Chine, et le développement rapide des filières du gaz naturel, la ressource de la région devrait, dans les années à venir, trouver de nombreux débouchés.
L'Asie devient le principal client du Moyen-Orient et cela changera en peu d'années le poids politique relatif de l'Occident et de l'Asie au Moyen-Orient.
2. Le problème de l'eau
En tant que ressource naturelle vitale, et épuisable, l'eau est au coeur des préoccupations des Etats du Moyen-Orient. Le volume d'eau disponible devrait diminuer de 80 % entre 1960 et 2025, passant de 3.400 m 3 par habitant et par an à 600 m 3 , alors que le seuil minimum est estimé à 2.000 m 3 . L'absence d'efficience dans la gestion de l'eau, la vétusté des installations contribuant au gaspillage de la ressource en eau, estimée entre 40 % à 50 % dans les villes, les utilisations de la ressource parfois effrénées, notamment par les Etats du Golfe qui ont une consommation équivalente à celle des Etats-Unis, ainsi que l'appropriation de la ressource par certains Etats au détriment d'autres, sont autant de facteurs permettant d'expliquer la pénurie d'eau au Moyen-Orient.
La ressource en eau est ainsi devenue objet de convoitise et source de conflits. L'État d'Israël contrôle, par exemple, les ressources de la région du fleuve Litani, qui couvre le quart de l'approvisionnement en eau du Liban, ainsi que celles du Jourdain. Israël dispose en outre d'une large maîtrise des nappes phréatiques des territoires palestiniens, lui permettant de réguler l'approvisionnement en eau de ces derniers, ce qui lui donne un contrôle total sur Gaza. L'eau est une composante à part entière de la politique israélienne sur les territoires palestiniens. Les plus grandes colonies sont situées sur les principaux aquifères de la région. Le problème de l'épuisement des aquifères se pose également de façon cruciale en Jordanie. Enfin, les barrages sur le Tigre et l'Euphrate et leurs affluents, par l'Iran, la Syrie et surtout la Turquie ont entrainé l'assèchement du Chatt-el-Arab, ce qui constitue un problème crucial pour l'Irak.
Le manque d'eau douce et la mauvaise gestion de cette ressource ont conduit les Etats du Golfe et Israël à se tourner vers le dessalement. Le Moyen-Orient totalise ainsi la moitié de la production en eau douce issue de la désalinisation au monde, soit une production de 11 millions de m 3 par jour. Si elle contribue à l'autonomie hydrique des Etats qui l'utilisent, et leur permet de répondre à une demande en constante augmentation, la désalinisation a des conséquences néfastes sur la préservation de la ressource en eau et l'environnement.
Les installations de dessalement nécessitent en effet un apport énergétique important pour leur fonctionnement, fourni pour l'instant par une utilisation massive d'énergies fossiles. Ce gâchis énergétique rend d'ailleurs pertinente l'utilisation du nucléaire civil dans la région. Quoi qu'il en soit, cette désalinisation entraîne la production de saumures, qui, rejetées dans la mer ou dans les cours d'eau, accroît leur salinisation. Cette surconcentration en sel augmente la température des eaux, accélérant ainsi leur évaporation, et déséquilibre les écosystèmes aquatiques. De surcroît, l'utilisation intensive du chlore nécessaire à l'entretien des installations, (vingt-deux tonnes par jour dans le Golfe), et les forts rejets de cuivre dus à l'usure des tuyaux ont des conséquences dramatiques sur l'environnement d'une région fragilisée par le réchauffement climatique. Si les conflits du Moyen-Orient ont eu une dimension pétrolière éventuelle au XX ème siècle, ceux du XXI ème siècle seront des guerres de l'eau.
B. L'IMPACT DIFFÉRENCIÉ DE LA CRISE ÉCONOMIQUE
Il ne s'agit pas ici de dresser un tableau d'ensemble de l'économie de la région, mais deux observations doivent néanmoins être faites.
La première observation est que l'impact de la crise économique est très différencié en fonction de la situation de départ de chaque pays. Les pays qui avaient constitué des réserves financières importantes tels l'Arabie saoudite ou les pays du Golfe ont vu la valeur de leurs actifs diminuer. Mais globalement leur situation reste bonne, même si, dans certains cas, comme Dubaï, la facture des excès de la spéculation immobilière sera élevée et difficile à payer.
En revanche, trois pays risquent de souffrir davantage que les autres au point que leur stabilité intérieure pourrait s'en trouver menacée.
Le premier de ces pays est l'Iran dont l'économie souffre depuis plusieurs années des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations unies et qui aborde la crise dans une position de faiblesse structurelle. En outre, la diminution du prix du pétrole a certainement aggravé les tensions, ce qui a pu contribuer à nourrir le mécontentement qui s'est exprimé lors des manifestations de juin dernier.
Le second pays à souffrir particulièrement de la crise est l'Egypte. Son économie repose sur trois rentes : le pétrole, les revenus tirés du canal de Suez et le tourisme. La crise économique réduit ces sources de revenu simultanément et risque de causer des troubles sociaux. Selon les informations fournies à la mission, les exportations devraient diminuer de 40 %, de même que les revenus du tourisme qui devraient aussi diminuer de 40 % ; quant aux revenus du canal, ils devraient baisser de 25 %. Au total, le taux de croissance qui était de 7 % en 2008 devrait passer à 4 % voire à 2 % en 2009.
Enfin, le troisième pays qui va sans doute souffrir de la crise économique est le Yémen, compte tenu du fait que l'une de ses seules ressources est le gaz.
La seconde observation a trait à l'intégration économique qui se réalise par le biais du Conseil économique de coopération du Golfe. Cette intégration est sans doute lacunaire et imparfaite, notamment en ce qu'elle exclut le Yémen et l'Irak et qu'elle ne comporte toujours pas de monnaie unique. Mais elle constitue néanmoins l'un des principaux espoirs de développement économique et d'unification pacifique de la zone.
VI. L'ÉMERGENCE POLITIQUE DU CHIISME
C'est sur la question de la succession du prophète que se fonde à l'origine la scission des courants chiite et sunnite. Lorsqu'il meurt à Médine, en 632, le prophète Mahomet ne laisse pour lui succéder ni descendant, ni directive, ouvrant ainsi un conflit qui va opposer durablement deux groupes. Le premier rassemble ceux qui se référent à la « tradition » (sunna) instaurée par le prophète. Ils considèrent que le « successeur » (calife) doit être choisi pour ses qualités morales, religieuses et politiques. Ce sont les sunnites. Pour les membres du second groupe, seul un membre de la famille du prophète peut guider la communauté musulmane. Ce sont les « partisans » (chiites) du cousin et du gendre du prophète : Ali. Les Kharidjites, littéralement « ceux qui sont sortis » (à l'issue de la première bataille entre les chiites et les sunnites à Siffin en 657), n'appartiennent ni à l'un, ni à l'autre groupe et forment un troisième groupe ultra minoritaire 9 ( * ) 10 ( * ) .
Bien que l'exactitude des chiffres soit sujette à caution, il ne fait aucun doute que les musulmans sunnites sont, démographiquement, ultra-majoritaires (87 %) et représentent 1,13 milliard de croyants sur un total estimé à 1,3 milliard, dont seulement 20 % dans le monde arabe.
Ensemble, les différentes communautés chiites ne représentent que 160 millions de croyants, soit un peu moins de 12 % des musulmans. Les Kharidjites ne comptent que pour moins d'un pour cent et sont présents dans le sultanat d'Oman, à Djerba et à Zanzibar.
La rivalité entre chiites et sunnites s'impose en facteur commun à l'ensemble des pays du Moyen-Orient.
Il s'agit là d'un phénomène nouveau car cette rivalité n'a pas été une constante de l'histoire du Moyen-Orient. Elle n'est politiquement importante que lorsque elle est instrumentalisée par des Gouvernements, comme ce fut le cas au XVI ème siècle lorsque la dynastie iranienne des Safavides utilisa l'identité chiite pour résister aux Ottomans et inversement. Au cours du XX ème siècle, la tendance était à la reconnaissance du chiisme comme une école doctrinale parmi d'autres dans les écoles juridiques musulmanes.
Les choses ont changé avec la Révolution islamique d'Iran et plus encore avec l'invasion américaine de l'Irak.
Au tout début des années 1980, la volonté de l'ayatollah Khomeiny d'exporter la révolution islamique, essentiellement anti-occidentale et vaguement tiers-mondiste, a conduit le régime iranien à gommer sa spécificité chiite derrière son identité musulmane.
Ce n'est qu'avec la guerre contre l'Irak que cette identité confessionnelle sera mise en avant comme l'une des composantes du nationalisme iranien, qu'il fallait exalter pour nourrir l'enthousiasme des combattants.
Des violences armées entre les chiites et les sunnites ont eu lieu au Pakistan dans les années 1980. Des violences similaires ont eu lieu en Arabie saoudite dans le Hassa et la région de Qatif dès fin 1979 et début 1980, à Bahreïn, en Irak et au Liban. Partout ou presque où vivent des chiites et des sunnites des affrontements ont eu lieu.
Il est du reste symptomatique que, hormis le cas du Pakistan, ces affrontements aient eu lieu dans le Golfe persique qui concentre à la fois les principaux gisements pétroliers du Moyen-Orient et une « géographie religieuse » 11 ( * ) à dominante chiite.
Les chiites arabes ont toujours été minoritaires, socialement et politiquement exclus. Le retour en force de l'Islam chiite en Iran a attisé les aspirations de ces populations et inquiété les Gouvernements sunnites de la région.
En dix ans, de 1984 à 2004, le clivage chiite-sunnite est devenu un élément clef du monde musulman de la Méditerranée à l'Indus, même si le « renouveau chiite » 12 ( * ) , qui a accompagné la Révolution islamique iranienne, n'a pas fait tâche d'huile et ne s'est pas traduit, sauf en Iraq mais pour d'autres raisons, par l'accession des chiites au pouvoir.
Cela n'a pas empêché, en décembre 2004, le roi Abdallah II de Jordanie de dénoncer, dans une interview donnée au Washington Post , la menace que constituerait à ses yeux le « croissant chiite ». Or le roi n'est pas un démagogue, mais un dirigeant discret et pondéré, ce qui donne d'autant plus de force à ses propos.
On peut conclure, avec Olivier Roy, que « la question chiite devient dominante » et que le nationalisme arabe, à défaut de succès dans la défense de la cause palestinienne, tend à se transformer en une défense du sunnisme contre le chiisme, ce qui représente bien une « évolution tectonique » dans le « grand Moyen-Orient » 13 ( * ) .
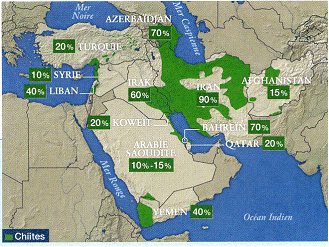
Source : « le dessous des cartes - Atlas d'un monde qui change - Tallandier 2009 - Jean-Christophe Victor - Virginie Raisson - Frank Tétart
CHAPITRE II - LE DOUBLE DÉFI
Deux problèmes dominent la scène du Moyen-Orient et constituent pour l'Occident de difficiles défis : le premier est d'assurer l'avenir du peuple palestinien, sans compromettre l'existence d'Israël, le second est de convaincre l'Iran d'arrêter son programme nucléaire sans recourir à la force des armes - ni bombe, ni bombardement - et éviter ainsi la nucléarisation du Moyen-Orient. Relever ces deux défis était, hier encore, hors d'atteinte. Aujourd'hui, l'entrée en scène d'un nouveau Président des Etats-Unis d'Amérique a changé la donne.
I. PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS: CRÉER L'ETAT PALESTINIEN
Il n'est guère possible de se déplacer au Moyen-Orient sans que le conflit israélo-palestinien soit évoqué. La résolution de ce conflit est en effet d'une importance capitale pour tous les pays de la région. Elle l'est évidemment pour la Syrie, dont le plateau du Golan est toujours occupé. Elle l'est pour le Liban, qui compte sur son sol plus de 400 000 réfugiés palestiniens. Elle l'est également pour l'Egypte, dont la diplomatie déploie des efforts considérables pour aider à un règlement pacifique. Mais, plus généralement encore, le conflit fait partie du discours politique quotidien des Arabes, chefs d'Etat, cadres supérieurs ou boutiquiers.
Le conflit est au coeur des relations entre l'Orient et l'Occident et nous concerne donc très directement. La grande majorité des musulmans est convaincue que l'Occident ne respecte pas l'Islam. Elle en veut pour preuve « cette politique injuste » qui fait deux poids, deux mesures entre Israël et le peuple palestinien, qui accepte qu'Israël se soit doté de la bombe atomique mais rejette cette perspective lorsqu'il s'agit de l'Iran, qui condamne les tirs de roquette du Hamas mais pas le blocus de Gaza qui en est la cause.
Pourtant personne n'a jamais réussi à sortir la région de l'impasse : ni le Président des Etats-Unis, Bill Clinton, qui a pourtant obtenu que Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrent la main lors des accords d'Oslo en 1993, ni les membres du « Quartet » (Organisation des Nations unies, Union européenne, Etats-Unis et Russie) qui ont pourtant adopté la « feuille de route » en 2003 afin d'aboutir, par étapes, à un règlement du conflit basé sur le principe de deux Etats.
A chaque fois, l'espoir de paix s'est fracassé sur les mêmes questions : statut de Jérusalem, sort des réfugiés palestiniens, développement des colonies de peuplement israéliennes et enchaînement fatal des assassinats et des attentats qui ont ensanglanté chaque page de l'histoire des quinze dernières années de cette région, depuis l'assassinat de Rabin jusqu'à la tragédie de Gaza en passant par la seconde Intifada.
Pourtant, nul ne doute que la paix soit nécessaire pour assainir les relations entre l'Occident et le monde arabe. Encore faut-il s'entendre sur les mots. S'agit-il de la « sécurité », comme le réclament les Israéliens, ou de la « justice », comme le veulent les Palestiniens ?
C'est du reste en ces termes que la Déclaration de Venise du 13 juin 1980 envisageait la question, affirmant que : « le moment est venu de favoriser la reconnaissance et la mise en oeuvre des deux principes universellement admis par la Communauté internationale : le droit à l'existence et à la sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, et de la justice pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. »
Trente ans après, la situation n'a pas changé. Elle a même régressé. Non seulement la paix n'est pas signée, mais il n'y a même plus de partenaires pour la négocier. Le mouvement palestinien s'est scindé en deux entités hostiles incapables de mandater un interlocuteur unique. Le Gouvernement israélien actuel n'accepte que du bout des lèvres le principe d'un Etat palestinien, même s'il n'était réduit qu'à un protectorat israélien. Quel chemin prendre pour sortir de l'impasse ?
|
L'ampleur du défi : vingt ans de « processus de paix » Le processus de paix israélo-palestinien a débuté en 1991, au lendemain de la première guerre du Golfe, avec la conférence de Madrid, lorsqu'Israël a accepté de reconnaître l'OLP comme partenaire de négociation. Ce processus regroupe l'ensemble des accords diplomatiques conclus depuis lors afin de trouver une solution au conflit. Les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993 à Washington (entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin, en présence de Bill Clinton), prévoient la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël et l'autonomie palestinienne temporaire de 5 ans. Le processus d'Oslo est complété en 1994. Il investit la nouvelle Autorité Nationale Palestinienne de pouvoirs limités. Les accords d'Oslo II, signés en 1995, divisent la Cisjordanie en trois zones selon le degré de contrôle accordé à l'Autorité palestinienne sur chacune. Le sommet de Camp David a réuni, du 11 au 25 juillet 2000 , Ehud Barak et Yasser Arafat, en présence de Bill Clinton. Les deux parties ne purent trouver de compromis en raison d'un triple désaccord, sur l'importance des concessions territoriales, le statut de Jérusalem et le droit au retour des réfugiés. Toutefois, des principes furent convenus pour les futures négociations : la recherche d'une solution juste et durable ; l'engagement de résoudre les problèmes existants le plus rapidement possible et de créer un environnement propice à des négociations, sans pression ni intimidation, ni menace de violence ; l'engagement de s'abstenir de prendre des mesures qui préfigureraient unilatéralement les termes des futurs accords ; la reconnaissance des Etats-Unis comme un partenaire essentiel à la conduite du processus de paix. Le plan de paix de Bill Clinton du 23 décembre 2000 - énonciation des « paramètres Clinton » pour une solution au problème (Shlomo Ben-Ami - Saeb Erekat - Madeleine Albright). Ces paramètres ont été discutés au sommet de Taba en janvier 2001 et les délégations ont confié postérieurement qu'elles n'avaient jamais été aussi proches d'un accord. L'initiative arabe de paix de juin 2002 : la Ligue arabe réunie à Beyrouth présente, sous l'autorité du prince Abdallah d'Arabie saoudite, un plan appelant au retour aux frontières de 1967, y compris en Syrie et au Liban, en échange d'une reconnaissance mutuelle, de la normalisation des relations diplomatiques et d'un accord de paix entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Le Gouvernement israélien refuse un retrait total de Cisjordanie et de Jérusalem-Est et s'oppose fermement au retour en nombre de réfugiés palestiniens en Israël. La feuille de route du 30 avril 2003 : le Quartet constitué du nouveau Président américain George W. Bush, de l'Union européenne, de la Russie et de l'ONU élabore la « feuille de route » pour la paix, qui appelle à la création d'un État palestinien avant 2005, sous réserve de l'arrêt des actes terroristes et de l'organisation d'élections démocratiques dans les Territoires palestiniens. L'initiative de Genève du 1er décembre 2003 : les principaux artisans en sont l'ancien ministre israélien Yossi Beilin et l'ancien ministre palestinien Yasser Abd Rabbo. Cet accord prévoit le partage de la souveraineté sur Jérusalem, l'évacuation par Israël de 98 % de la Cisjordanie et de la totalité de la Bande de Gaza ainsi que le règlement de la question de la circulation entre Cisjordanie et Bande de Gaza. Le problème du droit au retour des réfugiés est réglé par une indemnisation des réfugiés. Arafat reçut favorablement ce document et Sharon le rejeta. Le sommet de Sharm el-Sheikh du 8 février 2005 (Ariel Sharon-Mahmoud Abbas, en présence de Hosni Moubarak et d'Abdallah II de Jordanie) est essentiellement un accord de cessez-le-feu, mettant un terme à la seconde Intifada et prévoyant un échange de prisonniers. Le plan de désengagement unilatéral israélien de Gaza de 2005 , adopté le 6 juin 2004 par le Gouvernement israélien, prévoit que l'armée israélienne assurera la surveillance de la frontière entre l'Égypte et Gaza, continuera de contrôler les frontières autour de la Bande de Gaza, les côtes, l'espace aérien, et gardera le droit de mener des opérations militaires à l'intérieur de ce territoire. En outre, Gaza restera dépendante d'Israël pour la fourniture d'eau, les moyens de communication, la fourniture d'électricité et le réseau d'évacuation des eaux usées. Les importations dans le Territoire ne seront pas taxées, les exportations le seront. Israël collectera une taxe sur les produits étrangers importés à Gaza. Le shekel continuera d'avoir cours. La déclaration d'Annapolis du 26 novembre 2007 officialise, pour la première fois, la « solution de deux Etats séparés » afin de résoudre le conflit israélo-palestinien. |
A. LA DIFFICILE RÉCONCILIATION INTERPALESTINIENNE
Le mouvement politique palestinien est désormais scindé en deux organisations politiques antagonistes, qui ont chacune leur base territoriale : la Cisjordanie pour le Fatah, Gaza pour le Hamas.
1. Les origines de la discorde : la transformation du Hamas en mouvement politique
Pour comprendre la situation actuelle, un bref rappel historique est indispensable.
a) Le mouvement palestinien
Le mouvement palestinien n'a pas toujours été divisé. Depuis la création de l'OLP, en 1964, jusqu'en 1987, et sous la férule de Yasser Arafat, il a su préserver suffisamment d'unité pour mener des négociations. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.
1° Le Fatah
Le Fatah ou « Mouvement national palestinien de libération » a été fondé clandestinement en 1959 au Koweït par Yasser Arafat et d'autres responsables, convaincus que le moyen le plus efficace de défendre la souveraineté du peuple palestinien était d'organiser un mouvement national révolutionnaire indépendant des pays arabes. C'est un appel à la lutte armée dans le but de « libérer tout le territoire palestinien de l'entité sioniste ».
Bien que la quasi-totalité des représentants de ce parti soient musulmans, le Fatah se déclare laïc et politiquement neutre, contrairement au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) d'obédience marxiste. L'objectif final est l'instauration d'un Etat palestinien indépendant et démocratique dont tous les citoyens, quelle que soit leur confession, jouiront de droits égaux.
2° L'Organisation de Libération de la Palestine
A l'initiative de la Ligue arabe et à la suite de la réunion du premier Congrès national palestinien (CNP), est créée, à Jérusalem en 1964, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) conduite par Ahmed Choukeiry. Contrairement au Fatah, l'objectif de l'OLP n'est pas la création d'un Etat palestinien, mais la libération de la Palestine dans le cadre plus vaste de l'avènement d'une République arabe. La nouvelle organisation est une fédération de différentes associations. A sa tête un « Conseil exécutif » prend les décisions, tandis que le Conseil national tient lieu d'assemblée représentative.
Après la défaite militaire face à Israël en 1967, l'OLP, trop liée aux régimes arabes, entre en crise et son président démissionne. En 1968, le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), fondé en 1967 par Georges Habache et Ahmed Jibril, rejoignent l'OLP et obtiennent la moitié des sièges au CNP. Yasser Arafat fait modifier la charte de création de l'OLP dans le sens des objectifs du Fatah. Sous sa conduite, l'organisation s'engage dans la lutte armée et revendique de nombreux attentats terroristes en Israël et dans le reste du monde.
Lors du sommet de Rabat en 1974, l'OLP obtient la reconnaissance diplomatique de tous les Etats arabes, en tant que représentant unique du peuple palestinien puis, la même année, le statut d'« observateur » aux Nations unies. Yasser Arafat y prononce un discours à la tribune, tenant une arme dans une main et un rameau d'olivier dans l'autre. En 1976, l'OLP devient membre, au rang d'Etat, de la Ligue arabe. L'Espagne donne, la première, un statut diplomatique complet à une représentation de l'OLP. Elle sera suivie par le Portugal, l'Autriche, la France, l'Italie et la Grèce. Israël continue, pour sa part, à considérer l'OLP comme une organisation terroriste. Son armée la déloge de Beyrouth en 1982. Les partisans du Fatah migrent vers la Syrie et d'autres pays arabes. Arafat, entouré de ses plus proches fidèles, se réfugie à Tunis.
Peu à peu, l'OLP se désagrège. Sa disparition est imminente lorsqu'une révolte populaire spontanée éclate dans les territoires occupés par Israël : c'est la première Intifada. Elle débute le 8 décembre 1987 et durera jusqu'en 1992. Arafat récupère alors et réorganise l'OLP qui retrouve sa légitimité de représentant unique du peuple palestinien. En 1988, il proclame l'établissement d'un État palestinien ayant Jérusalem pour capitale. Il fait également adopter par le Conseil national palestinien une motion acceptant la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies de 1967 qui prévoit la « reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, de leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues ».
Amendant l'article de sa charte proclamant la destruction d'Israël et renonçant à la lutte armée, Yasser Arafat écrit une lettre le 9 septembre 1993 au Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, dans laquelle il reconnaît, au nom de l'OLP, le droit d'Israël à vivre en paix. A son tour, Yitzhak Rabin reconnaît l'OLP. Tous deux signent, le 13 septembre 1993, sous les auspices du Président américain Bill Clinton, à Washington, les accords dits d'Oslo de reconnaissance mutuelle ainsi qu'une déclaration ouvrant la voie à une administration palestinienne dans les territoires occupés.
|
Lettres de reconnaissance mutuelle échangées entre M. Arafat et Rabin Lettre de Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, reconnaissant l'Etat d'Israël (Tunis, 9 septembre 1993). « Monsieur le Premier ministre, « La signature de la Déclaration de principes marque une nouvelle ère dans l'histoire du Proche-Orient. Dans cette ferme conviction, je voudrais confirmer les engagements suivants de l'OLP : « L'OLP reconnaît le droit de l'Etat d'Israël à vivre en paix et dans la sécurité. « L'OLP accepte les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. « L'OLP s'engage dans le processus de paix du Proche-Orient et dans une résolution pacifique du conflit entre les deux parties et déclare que toutes les questions en suspens liées au statut permanent seront résolues par la négociation. « L'OLP considère que la signature de la Déclaration de principes constitue un événement historique inaugurant une époque nouvelle de coexistence pacifique, sans violence et sans autre acte qui pourrait mettre en danger la paix et la stabilité. « Ainsi, l'OLP renonce à recourir au terrorisme et à tout autre acte de violence et assumera la responsabilité sur l'ensemble des éléments et personnels de l'OLP, afin d'assurer le respect (de cet engagement), d'en prévenir les violations et de prendre des mesures disciplinaires contre les contrevenants. « Dans la perspective d'une ère nouvelle et de la signature de la Déclaration de principes, dans le cadre de l'acceptation palestinienne des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, l'OLP affirme que les articles et les points de la Charte palestinienne qui nient le droit d'Israël à exister, ainsi que les points de la Charte qui sont en contradiction avec les engagements de cette lettre sont désormais inopérants et non valides. « En conséquence, l'OLP va soumettre à l'approbation formelle du Conseil national palestinien (CNP-Parlement en exil) les modifications nécessaires dans la Charte palestinienne. « Sincèrement, « Yasser Arafat, Président de l'OLP » Lettre de Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, reconnaissant l'OLP comme représentant du peuple palestinien (Jérusalem, 10 septembre 1993). « Monsieur le Président, « En réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu'à la lumière des engagements de l'OLP qui y figurent, le Gouvernement d'Israël a décidé de reconnaître l'OLP comme le représentant du peuple palestinien et de commencer des négociations avec l'OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. « Yitzhak Rabin, Premier ministre » |
En 1996, au terme de la mise en place de l'Autorité palestinienne prévue par les accords d'Oslo, les éléments du Fatah se fondent dans cette nouvelle administration et Yasser Arafat, chef du Fatah et président de l'OLP, est formellement élu à la tête de l'Autorité. La plupart des fonctionnaires de l'Autorité sont d'anciens membres du Fatah et les forces de sécurité palestiniennes sont formées des anciennes brigades de combattants du Fatah.
3° Le Hamas et les Frères Musulmans
Le mouvement des Frères Musulmans, fondé en Egypte dans les années 1920, s'est implanté dans la Bande de Gaza immédiatement après la guerre de 1967 et a profité de la vague islamiste qui, au lendemain de la défaite, s'est alimentée des échecs successifs du nationalisme arabe face à Israël 14 ( * ) .
Au départ, le mouvement est sociétal. Il ne vise pas à conquérir le pouvoir, mais à transformer la société. Dans les territoires occupés, les Frères bâtissent un dense réseau d'institutions sociales autour des mosquées : jardins d'enfants, bibliothèques, cliniques, clubs sportifs, etc. Créé en 1973, le Centre islamique de Gaza, dirigé par le Cheikh Ahmed Yassine, devient un centre important de la vie sociale. L'organisation reçoit un appui important de l'étranger, notamment de l'Arabie saoudite, qui lui fournit des moyens considérables.
La popularité des Frères Musulmans palestiniens ne tarde pas à s'effriter du fait de leur option quiétiste. Ils concentrent leur énergie sur le développement de la piété individuelle et la mise en conformité de la société aux préceptes religieux, d'où leur inertie dans le combat nationaliste et leur relative impopularité. De ce fait, les services de renseignement israéliens -le Mossad- font preuve de mansuétude à leur égard et les considèrent comme un utile contrepoids à l'OLP 15 ( * ) . A tel point qu'en 1980 une scission frappe le mouvement : le Jihad islamique reproche aux Frères Musulmans leur passivité et se lance dans l'action violente.
La décision de créer le mouvement Hamas est lié à la première Intifada, la « révolte des pierres », en décembre 1987. A ce moment, Cheikh Yassine campe sur sa ligne traditionnelle car il est convaincu qu'une confrontation avec Israël serait trop coûteuse pour son mouvement. Ce n'est qu'après le début du soulèvement et sous la pression des générations montantes qu'il change sa vision et fait circuler un tract appelant à rejoindre l'Intifada. C'est l'acte de naissance du Hamas, acronyme de harakat al-muqâwama al-'islâmiya (« mouvement de résistance islamique »). L'ensemble des Frères Musulmans palestiniens rejoignent le Hamas, donnant à cette organisation un développement considérable, en particulier dans la Bande de Gaza où ses membres s'attaquent aux soldats israéliens isolés et incendient des propriétés appartenant à des Israéliens.
Le Hamas adopte sa Charte, le 18 août 1988 16 ( * ) , dans laquelle il reconnaît sa filiation avec l'organisation des Frères Musulmans égyptiens et considère que la terre de Palestine est « une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection ». Malgré les rivalités et parfois les affrontements, le Hamas déclare à propos de l'OLP : « Notre patrie est une, notre malheur est un, notre destin est un et notre ennemi est commun. »
b) La cause de la discorde
Elle vient de la transformation des Frères Musulmans en un mouvement politique, le Hamas, en concurrence directe avec le Fatah.
C'est du reste bien sur le terrain politique que le Hamas s'oppose à l'OLP en reprenant les thèses qui étaient celles de l'OLP avant les années 1975, revendiquant la libération de toute la Palestine, alors qu'Arafat a évolué et s'apprête, au même moment, à faire reconnaître par le CNP la partition de la Palestine.
Les responsables israéliens ne s'y trompent pas et changent complètement d'attitude vis-à-vis du Hamas. Ils cherchent alors à entraver le développement de ce mouvement dont la ligne politique est devenue plus radicale que celle du Fatah. En mai 1989, les services de sécurité israéliens arrêtent 260 militants du Hamas dont le Cheikh Yassine pour meurtre et incitation à la violence. Il ne sera relâché qu'en 1997 pour prévenir des représailles palestiniennes à la tentative d'assassinat de Khaled Mechaal par le Mossad en Jordanie.
C'est de sa prison et en se plaçant sur le terrain politique que Cheikh Yassine rejette les accords d'Oslo, en 1993. Il propose à la place une hudna (trêve), en référence à la loi islamique, qui permet une trêve conditionnelle limitée à 10 ans maximum avec des non-musulmans, à condition toutefois qu'Israël se retire des territoires occupés. La trêve qu'il envisage est temporaire et le principe de non-reconnaissance de l'Etat d'Israël revendiqué dans la Charte du Hamas n'est pas remis en cause. C'est une stratégie très différente de celle de l'OLP.
L'installation de l'Autorité palestinienne à Gaza en 1994 pose au Hamas de nouveaux défis. Tiraillé entre sa rhétorique de libération totale de la Palestine, sa volonté de ne pas provoquer une guerre civile interpalestinienne et sa détermination à préserver son réseau associatif, il engage un dialogue avec Yasser Arafat. Ce dernier joue de la carotte et du bâton, multipliant les arrestations et les intimidations, tout en dialoguant avec l'Organisation et en autorisant certains de ses organes de presse. Fin 1995, il paraît même sur le point d'obtenir la participation du mouvement aux élections du Parlement palestinien de janvier 1996, ce qu'en définitive le Hamas rejettera.
L'assassinat d'Itzhak Rabin en novembre 1995, l'escalade entre les forces israéliennes et le Hamas marquée par une vague d'attentats-suicides en 1996, l'extension permanente de la colonisation israélienne en territoire palestinien, la victoire de Benjamin Netanyahou aux élections législatives israéliennes de 1996 changent la donne et poussent le Hamas à adopter une ligne radicale d'opposition violente qui, par contraste, associe le Fatah à l'échec du processus de paix et à l'inefficacité de l'Autorité palestinienne.
Cette ligne radicale trouvera sa pleine expression avec la seconde Intifada qui commence en septembre 2000 et qui séparera définitivement les deux mouvements. Les dirigeants militaires du Hamas organisent alors une campagne d'attentats-suicides qui atteint son paroxysme en 2002, provoquant, cette seule année, la mort de plus de deux cents civils israéliens et deux mille blessés. Abdel Aziz al-Rantissi, un des co-fondateurs du Hamas, déclare en 2003 que la Shoah n'a jamais eu lieu. Les programmes télévisés de la chaîne du Hamas -Al-Aqsa TV- diffusent des émissions aux connotations antisémites. Cela ne sera pas oublié en Israël.
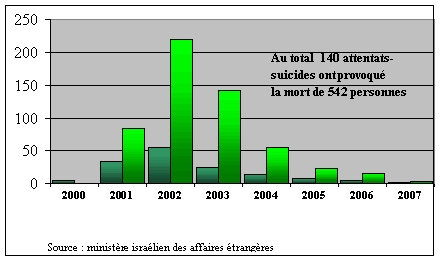
En 2002, le Hamas est inscrit sur la liste des organisations terroristes au Canada, au Japon, aux Etats-Unis, et bien sûr en Israël, puis, en septembre 2003, par l'Union européenne. En Grande-Bretagne et en Australie, seule la branche armée du Hamas -les brigades Ezzedine Al-Quassam- est déclarée terroriste. En représailles aux attentats-suicides qui continuent de se poursuivre, Cheikh Yassine est assassiné par une « exécution ciblée » de l'aviation israélienne le 22 mars 2004 à Gaza, sur ordre d'Ariel Sharon. Son successeur Abdel Aziz al-Rantissi est également assassiné quelques jours après sa désignation. Par contraste avec le Hamas, l'OLP et le Fatah apparaissent désormais modérés.
c) L'élection de Mahmoud Abbas en 2005
Quand Yasser Arafat meurt le 11 novembre 2004, Mahmoud Abbas lui succède très naturellement. Il a fait partie des fondateurs du Fatah en 1959, sous le nom de guerre d'Abou Mazen. Il avait fait partie de l'aile radicale du mouvement et avait été l'un des organisateurs de l'attentat de Munich contre l'équipe olympique israélienne en 1972 17 ( * ) . Il était un fidèle compagnon de route d'Arafat qu'il a suivi dans tous ses exils, avait participé au lancement des négociations secrètes d'Oslo et avait été Secrétaire général de l'OLP. En outre, il avait été Premier ministre de l'Autorité palestinienne et, même s'il s'est opposé à Arafat pour tenter d'asseoir son autorité sur l'administration, il a une expérience du pouvoir et jouit d'une aura certaine dans la société palestinienne.
Dès le début de la seconde Intifada, il avait demandé l'arrêt des attaques contre Israël, ce qui l'avait mué en un « interlocuteur acceptable ». Il bénéficie également du soutien des puissances occidentales qui avaient imposé à Arafat de créer pour lui le poste de Premier ministre en 2003. En outre, sa candidature était favorisée par l'emprisonnement en Israël de son principal concurrent, Marwan Barghouti, centriste laïc ayant joué un rôle de « chef de guerre » au début de la seconde Intifada.
Enfin, bien qu'opposé au Hamas et au Jihad islamique, il n'avait pas obtenu le contrôle des forces de sécurité, ce qui en faisait un candidat acceptable pour l'ensemble des Palestiniens.
Contre Mahmoud Abbas, le Hamas ne présente aucun candidat aux élections présidentielles puisqu'il persiste à refuser d'intégrer les institutions créées par les accords d'Oslo. Fort de cette absence de candidat et de son équation personnelle, Mahmoud Abbas remporte largement l'élection présidentielle le 9 janvier 2005.
Son élection change profondément la donne. Comme l'écrit l'historien Henry Laurens : « Yasser Arafat a mené une politique compliquée d'équilibre entre le Fatah et le Hamas. Il s'en est toujours tenu à son principe cardinal : refuser toute guerre civile chez les Palestiniens, quitte à ruser, à mentir ou à se désavouer d'un jour sur l'autre. » 18 ( * ) . L'élection de Mahmoud Abbas, en tant que président de l'Autorité palestinienne, marque la fin de cette politique d'équilibre, d'autant que le Hamas, changeant de stratégie et achevant sa mutation de mouvement social en force politique, aspire à prendre la tête de la représentation palestinienne.
d) La victoire du Hamas aux élections législatives et le début du blocus de Gaza19 ( * )
En 2005, le Hamas présente des candidats aux élections municipales palestiniennes. Leur succès consacre le Hamas comme une force politique significative face au Fatah.
Le 25 janvier 2006 des élections législatives ont lieu en Cisjordanie et à Gaza sous la surveillance d'observateurs internationaux. Ces élections, dont la régularité n'est pas contestée, voient la victoire du Hamas qui remporte 42,9 % des suffrages exprimés sur l'ensemble du corps électoral.
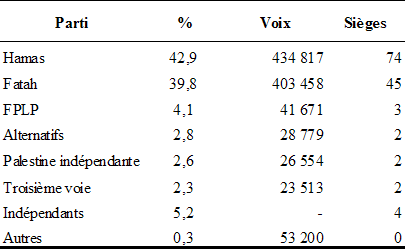
Dans la Bande de Gaza, le Hamas arrive encore plus nettement en tête avec 48,2 % contre 43,6 % pour le Fatah. Sur les 132 députés du Parlement palestinien, 74 sont membres du Hamas contre seulement 45 du Fatah.
Deux raisons semblent avoir été déterminantes dans le succès du Hamas : la corruption de l'Autorité palestinienne (et donc du Fatah) et, surtout, le fait que la voie choisie par le Fatah à Oslo, celle de la négociation et de l'abandon de la lutte armée, est dans l'impasse. Le Hamas déclare ne pas être hostile à des négociations, mais pense que celles-ci doivent s'accompagner d'une pression militaire. C'était aussi la position défendue par une partie des dirigeants du Fatah au début de la seconde Intifada, notamment par Marwan Barghouti.
Le 21 février 2006, Ismaël Haniyeh, membre du Hamas, est nommé Premier ministre par Mahmoud Abbas. Après des négociations infructueuses, le Fatah refusant de se joindre à son Gouvernement, Ismaël Haniyeh annonce la formation de son Gouvernement le 19 mars 2006.
Israël refuse tout contact avec le Gouvernement du Hamas. Ehud Olmert, le nouveau Premier ministre, décide de suspendre le virement des droits de douane qui reviennent à l'Autorité palestinienne. De nombreux donateurs, dont l'Union européenne, suspendent eux aussi leur aide financière. Les points de passage à l'entrée et à la sortie de Gaza sont le plus souvent fermés, interdisant un approvisionnement normal des un million et demi de Gazaouis qui y sont piégés. Le blocus de Gaza commence.
Le 9 juin 2006, une dizaine de civils palestiniens sont tués par des tirs de la marine israélienne. En représailles, et après dix-huit mois de trêve, des roquettes sont tirés à partir de Gaza sur le sol d'Israël. Le 25 juin 2006, des commandos palestiniens attaquent un campement de l'armée israélienne au sud de la Bande de Gaza : deux soldats sont tués, trois autres blessés, dont le caporal franco-israélien Gilad Shalit qui est enlevé.
Le 28 juin 2006, Israël réplique en lançant une campagne de bombardements, « Pluies d'été », et arrête, dans la Bande de Gaza, huit ministres, des députés et des responsables du Hamas. Elle ne mettra un terme à cette opération que le 26 novembre. En septembre, soit cinq mois après le début du blocus de Gaza, la situation humanitaire est très mauvaise, comme l'atteste le CICR.
|
12-09-2006 Communiqué de presse Gaza - Bulletin CICR n° 06 / 2006 Situation générale Le bouclage quasi-permanent des points d'entrée et de sortie, les incursions incessantes des forces militaires israéliennes et le non versement des salaires aux fonctionnaires continuent de marquer la vie des 1,4 million de personnes qui vivent dans la Bande de Gaza. Une atmosphère de désespoir règne parmi la population qui n'a qu'une faible perspective de voir sa situation s'améliorer. Environ deux tiers des habitants de Gaza vivraient aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté de deux dollars US par jour. Bon nombre ont réduit leurs dépenses de base pour pouvoir subvenir à leurs besoins nutritionnels minimaux. (...) |
A l'automne 2006, les tensions s'accroissent entre partisans du Hamas et du Fatah. Mahmoud Abbas exige du Hamas qu'il reconnaisse les accords déjà négociés avec Israël, tandis que les dirigeants islamistes refusent ce qui pourrait être interprété comme une reconnaissance implicite de l'État d'Israël. Mahmoud Abbas déclare la milice du Hamas illégale, ce qui marque le début d'affrontements violents entre les deux mouvements. L'opposition entre le Hamas et le Fatah était jusqu'à présent essentiellement politique. Elle devient désormais également militaire.
e) L'accord de La Mecque et le Gouvernement d'union nationale
Le 8 février 2007, à La Mecque, un accord est annoncé entre le Hamas et le Fatah afin de constituer un Gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre en activité, Ismaël Haniyeh. Les discussions entre le Président Mahmoud Abbas et le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, aboutissent à une répartition des postes ministériels et à un programme politique commun incluant le respect des accords israélo-palestiniens déjà signés, mais n'incluant pas la reconnaissance d'Israël.
En chargeant Ismaël Haniyeh de former le Gouvernement d'union, le Président Mahmoud Abbas affirme que le cabinet attendu devait «respecter» les accords conclus par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), y compris ceux signés avec Israël, ce qui revient implicitement à une reconnaissance de l'Etat juif.
Les Etats-Unis et l'Europe négligent cette avancée majeure et exigent, pour renouer avec le Gouvernement d'Ismaël Haniyeh, que celui-ci reconnaisse explicitement Israël.
Le Hamas refuse, en invoquant le texte de l'accord de La Mecque qui ne lui impose pas de le faire. Il admet néanmoins que le Gouvernement d'union nationale auquel il participe s'engage à respecter les accords signés par l'OLP, ce qui revient indirectement au même.
|
L'accord de La Mecque du 8 février 2007 Cet accord prévoit de :
«
«
«
«
«
|
f) Le coup de force du Hamas à Gaza
En dépit de l'accord de la Mecque, le cessez-le-feu est rompu le 18 mai 2007. Le 7 juin, des affrontements entre les deux factions font 115 morts et 550 blessés. Human Rights Watch accuse les deux factions rivales de violer le droit humanitaire international et, dans certains cas, de crimes de guerre. Le 14 juin 2007, le Hamas prend par la force le contrôle de la totalité du territoire de Gaza.
En réponse, Mahmoud Abbas déclare l'état d'urgence, congédie le Gouvernement d'union nationale et charge Salam Fayyad, ministre des finances du précédent Gouvernement, de former un cabinet d'urgence.
Le Gouvernement de Salam Fayyad prête serment le 17 juin 2007 à Ramallah. Il n'est pas reconnu par le Hamas qui déclare inconstitutionnelle la nomination d'un nouveau Premier ministre. En effet, le président de l'Autorité palestinienne aurait dû nommer un nouveau ministre issu des rangs du parti majoritaire, le Hamas 20 ( * ) .
Les puissances occidentales apportent leur soutien à Mahmoud Abbas et au Gouvernement de Salam Fayyad. Le Hamas contrôle la Bande de Gaza, tandis que la Cisjordanie est aux mains du Fatah. Les territoires palestiniens sont, de facto , scindés en deux entités contrôlées par des pouvoirs politiques rivaux.
2. La tragédie de Gaza et la lutte armée entre le Hamas et le Fatah
a) Le déroulement des événements
Un cessez-le-feu est conclu le 19 juin 2008 entre Israël et le Hamas pour six mois. De cette date à la fin octobre 2008, 38 roquettes visent le sud d'Israël. Ces tirs ne sont pas revendiqués par le Hamas qui déclare respecter son engagement de ne pas rompre la trêve. En revanche, du côté israélien, le blocus mis en oeuvre depuis juin 2006 n'est pas levé contrairement à l'accord de cessez-le-feu.
Le 4 novembre 2008 l'armée israélienne fait une incursion en territoire palestinien. En riposte, le Hamas procède à des tirs de roquettes en direction d'Israël. Le 14 décembre 2008, Khaled Mechaal annonce que la trêve ne sera pas renouvelée. Le 19 décembre Israël refuse de lever le blocus de Gaza. Les tirs de roquettes s'intensifient, en particulier le 26 décembre 2008 où plus de 80 roquettes sont tirées sur des villes du Centre-Sud d'Israël.
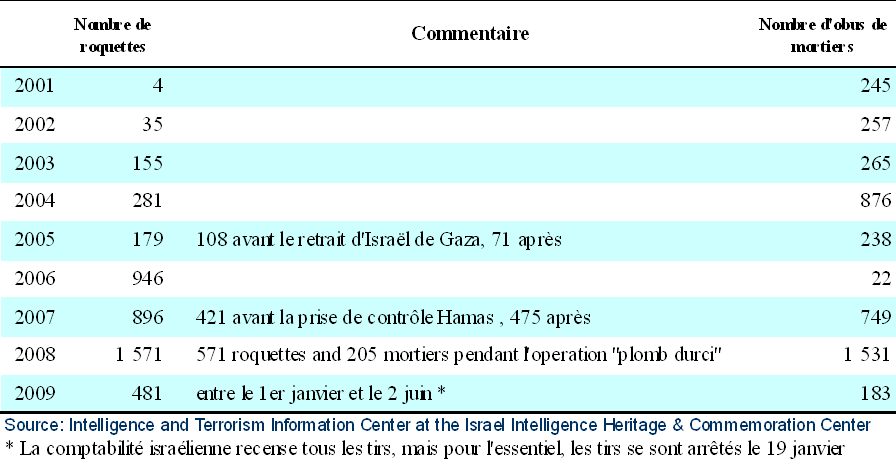
Le 27 décembre 2008, le Gouvernement israélien ordonne le bombardement des installations du Hamas dans une opération militaire de grande ampleur appelée « Plomb Durci » par les Israéliens et « Massacre du samedi noir » par les Palestiniens. Cette opération fait quatre cents morts dans les quatre premiers jours des bombardements.
Les autorités israéliennes maintiennent un black out sur les informations venues de la Bande de Gaza. L'entrée de journalistes étrangers est interdite. Les deux parties mènent une véritable guerre de l'information à travers les grands médias et sur Internet. De nombreuses manifestations éclatent dans les grandes capitales arabes et dans quelques capitales occidentales, choquées par les images transmises par la télévision. En Cisjordanie, plusieurs manifestations du Hamas rallient militants et responsables du Fatah.
La situation humanitaire déjà précaire s'aggrave dramatiquement. Le 8 janvier 2009, l'ONU suspend toutes ses activités à Gaza, et met en cause l'armée israélienne après qu'elle ait bombardé un de ses convois humanitaires. Un million d'habitants sont privés d'électricité, 750 000 d'eau courante, les hôpitaux sont surchargés et les services médicaux épuisés manquent de médicaments.
Le 17 janvier 2009, à la veille de l'entrée en fonction de Barack Obama, Israël et le Hamas décrètent des cessez-le-feu unilatéraux, jamais officialisés, mais toujours en vigueur.
b) L'étendue de la tragédie
La mission du Sénat est entrée à Gaza le 29 janvier 2009. Elle a constaté la destruction de l'école internationale américaine, celle du dépôt de l'UNWRA, ainsi que la destruction partielle de l'hôpital Al-Qods. La zone industrielle proche du point de passage de Karni a été rasée. Vos rapporteurs ont été frappés par la sélectivité et la précision des frappes israéliennes qui ont systématiquement visé les infrastructures : écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, occasionnant un nombre élevé de victimes civiles. Ils ont également été choqués par l'utilisation de bombes incendiaires au phosphore blanc sur le dépôt de l'UNWRA et l'hôpital Al Qods.

Hôpital Al-Qods à Gaza vu de dos - après le bombardement israélien -
29 janvier 2009
Mission sénatoriale

Aire de jeu du service de pédiatrie de l'Hôpital Al-Qods à Gaza - atteinte par une bombe au phosphore blanc -
29 janvier 2009
Mission sénatoriale

Dépôt de médicaments de l'UNWRA à Gaza - après un bombardement israélien -
29 janvier 2009
Mission sénatoriale

École internationale américaine de Beit Lahya - totalement détruite -
29 janvier 2009
Mission sénatoriale
On s'étonne que le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait eu aucune réaction devant les bombardements et la destruction de bâtiments appartenant à l'UNWRA.
c) Le bilan de l'opération « Plomb Durci »
Côté palestinien, le bilan en vies humaines s'établit, selon un rapport du Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) en date du 12 mars 2009, à 1 434 morts, dont 82 % de victimes civiles. Côté israélien, les chiffres fournis par le ministère israélien des affaires étrangères font état de 13 morts, dont 3 civils. Sur les 10 militaires, sept auraient été tués par des tirs fratricides. Au-delà de cette comptabilité macabre, quel bilan politique tirer de l'opération « Plomb Durci » ? Du côté israélien, bien que les buts de guerre n'aient pas été clairement énoncés, on peut penser que l'opération poursuivait au moins deux objectifs militaires et deux objectifs politiques.
Le seul objectif militaire affiché était de faire cesser les tirs de roquettes. Cet objectif a été atteint, au prix d'un grand nombre de victimes civiles palestiniennes.
L'armée israélienne cherchait aussi, semble-t-il, à rétablir le crédit entamé, aux yeux de l'opinion publique israélienne et arabe, par le demi-échec de la dernière guerre du Liban, en 2006, qui avait valu à l'armée israélienne de nombreuses pertes du fait de l'opiniâtre résistance du Hezbollah.
Les images télévisées montrant l'efficacité destructrice des forces israéliennes semblent avoir restauré la confiance de l'opinion israélienne dans son armée.
Mais l'impact sur l'opinion internationale, choquée par l'extrême brutalité de l'armée israélienne, fut profondément négatif.
Plusieurs ONG, notamment israéliennes, ont recensé les violations du droit international humanitaire commises par l'armée israélienne.
Une mission mandatée par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a enquêté sous la responsabilité du juge Richard Goldstone sur ces accusations. Elle a rendu ses conclusions le 15 septembre 2009 et établi que les attaques de l'armée israélienne contre Gaza avaient été « délibérément disproportionnées afin de punir, terroriser et humilier la population civile et visaient à affaiblir son économie afin de l'empêcher de fonctionner et d'assurer l'auto-subsistance et provoquer ainsi un sens croissant de dépendance et de vulnérabilité .» 21 ( * ) .
Elle a également relevé que : « le continuum est évident entre la politique du blocus qui a précédé les opérations et, ce qui, au regard de la mission, apparaît comme une opération de punition collective ». « Ces opérations ont été imposées à dessein par l'Etat d'Israël afin d'isoler et d'affaiblir le Hamas après sa victoire électorale (...) ». Elle conclut également que : « les opérations militaires de Gaza ont été, selon le Gouvernement israélien, minutieusement et longuement planifiées. Alors que le Gouvernement israélien s'est efforcé de faire passer ces opérations comme une réponse aux attaques de roquettes dans l'exercice de son droit à la légitime défense, la mission considère que ce plan a été dirigé, au moins en partie, contre une cible différente : le peuple de Gaza en tant que tel ». 22 ( * )
Face au déferlement de la puissance israélienne, les combattants du Hamas, en situation d'infériorité numérique, ont délibérément refusé le combat. De sorte que le potentiel militaire du Hamas, de même que son appareil politique, n'ont que modérément souffert de l'opération.
Politiquement, le premier objectif du chef du parti Kadima , Tzipi Livni, et de ses alliés était de montrer qu'ils étaient au moins aussi déterminés que leurs rivaux de droite à mettre en oeuvre une politique énergique vis-à-vis des ennemis d'Israël. Il n'empêche que Tzipi Livni, malgré de bons résultats électoraux, n'a pas été en mesure de former un Gouvernement de coalition et a finalement perdu la partie face à son rival, Benyamin Netanyahou devenu Premier ministre.
Enfin, la stratégie tendant à isoler le Hamas du reste de la population de Gaza paraît avoir échoué. Le Hamas tient solidement Gaza, sans qu'on sache de quelle popularité il jouit.
Du côté palestinien, « Plomb Durci » a accru le « désir de vengeance » contre Israël, ressentiment partagé par l'ensemble de l'opinion arabe et qui a renforcé l'hostilité de la « rue arabe » à l'égard de l'Occident, jugé complice d'Israël.
Au total, le Hamas est sorti renforcé du conflit : dans un conflit « asymétrique », il suffit au plus faible de survivre pour gagner.
Le Hamas tient d'une main de fer la Bande de Gaza. Il se pare des couleurs de la Résistance et le Fatah est laminé à Gaza. Ses bureaux de représentation ont été fermés. La pression sur les personnels du mouvement s'exerce quotidiennement et à tous les niveaux. Toutes les manifestations sont interdites. Le blocus profite au Hamas qui collecte des taxes sur les échanges effectués par les tunnels de la zone de Rafah. Il travaille avec méthode à l'islamisation de la société : embrigadant les enfants, faisant pression sur les femmes pour qu'elles portent le voile, évinçant les fonctionnaires de l'Autorité palestinienne, etc. Celle-ci est vivement critiquée, y compris en Cisjordanie, pour avoir contenu, sous l'autorité de Salam Fayyad et en coopération avec les autorités israélienne, toute démonstration de soutien à Gaza considérée comme menaçant l'ordre public.
Jamais, la division entre les mouvements palestiniens n'aura été plus grande.
d) Que veut Khaled Mechaal ?
Vos rapporteurs ont estimé qu'il était impossible d'évaluer la situation sans entendre le point de vue d'un des acteurs clés du conflit israélo-palestinien : le Hamas. C'est dans le cadre de leur déplacement à Damas qu'ils ont souhaité rencontrer le leader politique du Hamas, Khaled Mechaal.
L'entretien a eu lieu le 20 janvier 2009 à Damas, au lendemain du cessez-le-feu. Il a été organisé sans le concours de l'Ambassade de France qui n'est pas autorisée à prendre contact avec le Hamas. Les éléments suivants en ressortent 23 ( * ) .
S'agissant de la tragédie de Gaza, Khaled Mechaal a souligné que toutes les tentatives pour éliminer le Hamas par la force ont échoué. Le mouvement a désormais une double légitimité, électorale et combattante, pour avoir survécu à l'épreuve de force qu'Israël lui a imposée à Gaza. L'échec d'Israël a aussi montré qu'en dépit de toute sa puissance Israël ne peut pas défaire les Palestiniens et que la paix passera obligatoirement par la reconnaissance de leurs droits.
S'agissant de la durée de la trêve de dix ans avec Israël, dont la perspective est acceptée par le Hamas, Khaled Mechaal n'exclut pas qu'elle puisse devenir permanente, mais il exige, en préalable au débat, qu'Israël se retire auparavant des territoires occupés en Cisjordanie et permette la naissance d'un Etat palestinien.
Concernant la désignation d'un bon interlocuteur palestinien pour conduire les négociations de paix, c'est-à-dire d'un Gouvernement d'union nationale, il a indiqué que la question principale était de respecter le Hamas en tant qu'acteur incontournable de la scène palestinienne.
Enfin, concernant la possibilité d'amender la Charte du Hamas et de reconnaître l'Etat d'Israël, Khaled Mechaal répond :
« qu'est-ce que Mahmoud Abbas et, avant lui, Yasser Arafat ont obtenu en échange de la reconnaissance d'Israël et en renonçant à la Charte de l'OLP ? Rien.
« Les Arabes ont fait une offre généreuse de paix en 2002 (« l'initiative arabe de paix » du Prince Abdallah d'Arabie saoudite). Israël a-t-il répondu ? Non. Le Hamas lui-même a fait une offre généreuse en 2006, lorsque nous sommes parvenus à un consensus entre les factions palestiniennes après la réconciliation.
« Nous avons implicitement accepté de reconnaître Israël dans ses frontières de 1967, à condition évidemment que les droits des Palestiniens soient reconnus et qu'ils jouissent d'une authentique souveraineté. (...) En conséquence, la reconnaissance d'Israël n'est pas un problème. (...) La solution est de rendre possible un Etat palestinien, puis de demander à cet Etat de reconnaître Israël. »
3. L'impasse actuelle
a) Trois blocages
Le conflit des légitimités : le Hamas tire sa légitimité des élections législatives, mais aussi de la tragédie de Gaza ; il possède ce qu'Amin Maalouf appelle la « légitimité combattante ». Le Fatah contrôle l'Autorité palestinienne, seule organisation dont la légitimité est reconnue par Israël et par la communauté internationale pour conduire des négociations. Ce conflit de légitimité devrait être résolu par de nouvelles élections, présidentielles et législatives, d'autant qu'entre les deux mouvements le sang a coulé et que les règlements de compte sont monnaie courante.
La division territoriale : le Hamas contrôle Gaza. Il a payé pour y parvenir un prix trop élevé pour y renoncer sans de très sérieuses contreparties. En dépit de ses conditions de vie épouvantables tout indique que la colère de la population vise d'abord Israël. Des groupuscules extrémistes se réclamant d'Al-Qaïda sont apparus. Le Fatah exerce quelques apparences de pouvoir sur la Cisjordanie et contrôle l'OLP. Y renoncer le condamnerait à disparaître, d'autant que Mahmoud Abbas n'a obtenu aucun résultat substantiel en échange de sa coopération avec Israël. Tout au contraire, les incursions de l'armée israélienne en Cisjordanie et les « exécutions extrajudiciaires » qu'elle y commet sapent la crédibilité de l'Autorité palestinienne. Ce deuxième blocage n'interdit pas la formation d'un Gouvernement provisoire, mais il fait obstacle à la création d'un Etat palestinien.
La dernière fracture est politique . En supposant que les deux parties arrivent à un compromis et forment un Gouvernement d'union laissant à chaque mouvement le contrôle de son propre territoire, sur quelle base conduirait-il la négociation et avec quel programme ? Devrait-il commencer par reconnaître Israël, comme le Fatah l'a fait, et avec lui la communauté internationale, ou bien cette reconnaissance pourrait-elle intervenir en fin de négociation, comme le suggère le Hamas ?
b) Les négociations interpalestiniennes du Caire
Le « dialogue interpalestinien » a commencé au Caire le 26 février et n'a duré que quelques jours. Une deuxième session a eu lieu du 10 au 20 mars permettant de définir les axes du dialogue. Deux autres sessions ont eu lieu. Les discussions achopperaient sur trois points.
En premier lieu, le programme : le Hamas voudrait que le Gouvernement ait un vrai rôle politique, alors que le Fatah souhaite qu'il se concentre sur trois missions : préparation des élections ; reconstruction de Gaza et unité territoriale.
En second lieu, les engagements de l'OLP : le débat reste ouvert sur la nécessité pour le prochain Gouvernement de « reconnaître » (comme cela a été fait dans l'accord de La Mecque) ou « d'endosser », comme l'exige le Fatah, les engagements de l'OLP. Néanmoins, l'ensemble des participants reconnaissaient qu'il était vain de demander au Hamas de reconnaître Israël d'emblée et qu'il fallait s'attacher à favoriser concrètement les conditions d'une reprise des négociations avec Israël.
Enfin, la refonte des forces de sécurité pose problème, chaque formation se montrant déterminée à contrôler les forces armées dont sa survie politique dépend.
En revanche, un accord aurait été trouvé sur deux points importants.
Les élections : avant le 25 janvier 2010, les Palestiniens doivent élire un nouveau président, un nouveau conseil législatif et un nouveau conseil national (instance législative de l'OLP). Des désaccords subsistent sur le mode de scrutin pour les élections au Conseil national palestinien dont le Hamas ne fait pas à ce jour partie.
La réforme de l'OLP : l'objectif est d'accroître sa représentativité tant vis-à-vis de l'extérieur qu'à l'intérieur. Un nouveau Conseil national palestinien pourrait être élu à la représentation proportionnelle intégrale. En attendant ces élections, le Hamas refuse d'intégrer formellement l'organisation afin de ne pas avoir à reconnaître les structures actuelles et l'acquis de l'OLP.
A la date de rédaction du présent rapport le dialogue interpalestinien n'a toujours pas abouti. Pour que les négociations aboutissent, il faudrait :
- soit que le Hamas accepte de reconnaître Israël en préalable à toute négociation ;
- soit qu'Israël accepte de négocier avec un Gouvernement palestinien dont un ou plusieurs membres ne le reconnaissent pas.
Ces deux conditions paraissent hors d'atteinte.
B. L'ACCEPTATION, SOUS CONDITIONS, PAR ISRAËL D'UN ÉTAT PALESTINIEN
Israël est confronté, depuis sa création, à un dilemme : choisir entre un Etat binational sur les frontières actuelles, au risque de dissoudre l'identité juive de l'Etat, ou bien accepter l'Etat palestinien, au prix de rendre ou d'échanger la terre des colonies et de compromettre la sécurité militaire d'Israël. Entre ces deux propositions, Israël n'a jamais vraiment choisi et ses Gouvernements semblent user des négociations comme d'un procédé dilatoire.
1. Les termes du dilemme auquel Israël est confronté
a) La solution de l'Etat binational
L'Etat binational serait une entité unique englobant Israël, la Cisjordanie et Gaza, dans laquelle Juifs et Arabes seraient sur un pied d'égalité juridique. C'est la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'Etat d'Israël.
Étendu à l'ensemble des territoires palestiniens, la composante arabe de la population ne tarderait pas à devenir majoritaire, mettant en danger l'identité juive d'Israël.
En effet, Israël a, selon le dernier bulletin de l'Office des statistiques israélien, une population de 7 411 500 habitants. 75,5 % d'entre eux sont juifs, soit 5 592 600 habitants, ce qui inclut les 500 000 colons habitant hors des frontières de 1967. 1,5 million, soit 20,2 % sont arabes israéliens, principalement musulmans, mais aussi chrétiens, auxquels il faut ajouter 321 000 immigrants enregistrés au Ministère de l'Intérieur comme « non-juifs ». Les travailleurs étrangers vivant en Israël, environ 150 000, ne sont pas compris dans ce décompte.
Dans un Etat binational couvrant le territoire de la Palestine historique, 1,5 million d'habitants de la Bande de Gaza ainsi que 2,3 millions d'habitants de Cisjordanie et de Jérusalem-est s'ajouteraient aux Arabes israéliens pour former un groupe de 5,5 millions de Palestiniens.
Dans ces conditions, on comprend qu'à une écrasante majorité la population juive, attachée au caractère juif de l'Etat créé en 1948, rejette la perspective d'une entité binationale 24 ( * ) .
Observons à cet égard que la résolution 181 de l'ONU du 29 novembre 1947 emploie à plusieurs reprises les termes d'« Etat juif » pour se référer à Israël, et d'« Etat arabe » pour l'entité palestinienne. Israël est donc, depuis l'origine, un Etat dont la raison d'exister est d'être le havre du peuple Juif.
b) La solution des deux Etats
L'autre voie est celle des « deux Etats » dans les frontières définies à l'issue de la guerre de 1967 qui donnent 78 % du territoire de la Palestine historique à l'Etat d'Israël 25 ( * ) . Pourtant, les Gouvernements israéliens ont laissé, depuis cette date, s'installer de nombreuses colonies au-delà des frontières de 1967, sur les territoires internationalement reconnus comme palestiniens, à l'exception de la Bande de Gaza, évacuée en 2005 sur décision d'Ariel Sharon, approuvée par la Knesset.
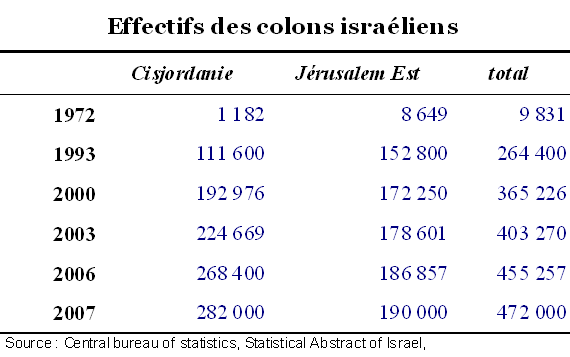
A l'expansion des colonies 26 ( * ) elles-mêmes s'ajoute le développement des infrastructures, en particulier les routes réservées aux colons qui les relient entre elles et les 600 check points destinés à contrôler les déplacements des Palestiniens. Colonies et routes disloquent l'espace palestinien et rendent insupportables les conditions de vie des Palestiniens. Le développement économique de cette sorte d'« archipel » intérieur 27 ( * ) , que forment aujourd'hui les territoires palestiniens est impossible. Israël n'a jamais pu ou voulu choisir entre ces deux voies.
2. Le moins mauvais choix pour Israël
Le propre d'un dilemme est qu'aucune des solutions proposées n'est satisfaisante. De ce point de vue, l'acceptation d'un Etat palestinien soulève la question difficile du statut de Jérusalem et celle, non moins problématique, des colonies. Leur extension en Cisjordanie fait obstacle à la création d'un Etat palestinien territorialement cohérent et politiquement indépendant, qui constituerait pourtant la moins mauvaise des solutions pour les deux parties.
a) L'intérêt à long terme d'Israël
La solution des deux Etats est la seule qui permette au peuple palestinien de connaître enfin indépendance et dignité et offre au peuple israélien une promesse de vivre en sécurité dans les frontières internationalement reconnues.
L'intérêt à long terme des Israéliens n'est pas de vivre entourés de peuples hostiles, d'être obligés de tourner le dos à la région où ils ont choisi de s'établir, enfermés entre des murs qu'ils ont eux-mêmes construits, dans la crainte d'attentats suicides ou d'Intifadas meurtrières.
Est-ce l'intérêt des Etats-Unis et de l'Europe de refuser au peuple palestinien l'Etat auquel ils aspirent légitimement et d'être détestés de ce fait par trois cent millions d'Arabes et un milliard de musulmans ?
b) Le choix des Israéliens
Tout semble indiquer que les citoyens israéliens eux-mêmes sont prêts à accepter la solution des deux Etats. De nombreux sondages montrent qu'une large majorité rejette la solution de l'Etat binational mais accepte la perspective de deux Etats. Selon un sondage récent réalisé par le mouvement Onevoice , le 22 avril 2009 28 ( * ) , ils seraient 78 % à pencher en faveur de la solution des deux Etats contre 74 % en 2007.
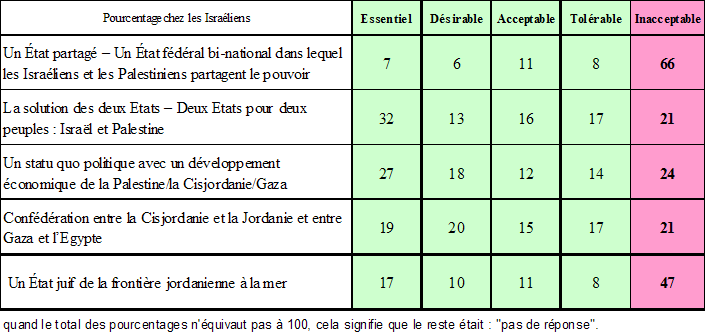
c) La faisabilité d'un accord
Les paramètres de la solution des deux Etats sont connus. Ils ont fait l'objet de longues négociations sous l'égide du Président Clinton avant de l'être au cours du processus d'Annapolis qui officialise pour la première fois, dans la déclaration conjointe de toutes les parties, la « solution de deux Etats séparés ».
Au demeurant les solutions ne se sont pas sensiblement écartées des « paramètres » élaborés par le Président Bill Clinton dans son plan de paix du 23 décembre 2000. Rappelons-en les principaux éléments.
1. Le territoire : le Président Clinton avait conclu qu'entre 94 et 96 % des territoires occupés par Israël devraient être rendus aux Palestiniens. Les territoires conservés par Israël, les colonies de peuplement, devraient faire l'objet de transferts territoriaux équivalents en faveur des Palestiniens.
2. La sécurité : des forces israéliennes resteraient stationnées, dans des postes fixes, sous le contrôle d'une force internationale, pendant une durée de trente-six mois dans la vallée du Jourdain. Cette durée pouvait être réduite si l'évolution de la situation le permettait. Trois bases israéliennes d'alerte précoce resteraient stationnées en Cisjordanie, selon des modalités renégociables tous les dix ans. S'agissant de l'espace aérien, l'Etat palestinien en aurait eu la pleine souveraineté. Néanmoins les deux parties étaient invitées à conclure des accords permettant l'entraînement des forces israéliennes. Concernant les capacités militaires du futur Etat, les Israéliens avaient suggéré de l'appeler « Etat démilitarisé » et les Palestiniens « Etat doté d'un armement », le Président Clinton avait proposé de l'appeler « Etat non militarisé. » Il était également prévu qu'une force internationale serait chargée d'assurer la sécurité aux frontières.
3. Jérusalem : le principe posé par le Président Clinton était que les zones peuplées d'Arabes seraient affectées à l'Etat palestinien et celles majoritairement juives à Israël 29 ( * ) .
4. les réfugiés : le principe posé était que les Palestiniens auraient le droit de s'installer dans l'Etat Palestinien, mais qu'Israël pourrait n'accepter qu'un nombre limité de réfugiés.
5. La fin du conflit : la signature de l'accord marquerait nécessairement la fin du conflit et l'application des résolutions 242 et 338 de l'ONU se concluant par la libération des prisonniers.
Vos rapporteurs ont questionné le négociateur palestinien, Saeb Erekat qui était également négociateur au moment de la négociation des paramètres de Clinton. Que dit-il ?
« Entre 2000 et 2007, nous n'avions pas eu de négociations du tout. Nous avions des contacts à propos des check points et des activités des colons, mais c'est tout. C'étaient des contacts au cours desquels nous ne parlions que du quotidien.
« Et puis il y a eu Annapolis en 2007. C'était la première fois que nos Premiers ministres (Olmert et Mahmoud Abbas) s'asseyaient à la même table et négociaient. Il y a eu environ une centaine d'heures de négociations. Est-ce que nous avons abouti à un accord ? Non. Est-ce que nous avons vraiment négocié en profondeur ? Oui. Est-ce que nous avons brisé des tabous et franchi des lignes ? Oui. Les négociations étaient arrivées à un stade où nous n'avions plus besoin de négocier, mais juste de décider. Cette décision n'est pas intervenue.
« Les négociations ont pris pour base les frontières de 1967, en incluant Jérusalem est et la mer Morte. Nous avons conservé l'idée d'un échange de terres. Nous avons inclus des formules sur la façon dont l'Europe pourrait jouer un rôle effectif dans la préservation de la sécurité régionale.
« Nous les Palestiniens avons écrit ces idées sur une page de papier et avons dit aux Israéliens : " êtes-vous d'accord là-dessus ?". Mais les Israéliens n'ont pas réussi à stopper le développement des colonies, notamment les trois principales : Ariel, Goush-Etsion et Maalé-Adoumin. Israël voulait que nous acceptions les faits accomplis. Cela n'était pas possible.
« A la fin des négociations, il y aura une décision. Mais ce qui fera que l'accord durera ou pas, c'est son caractère équilibré, le fait qu'il soit juste. »
Si la solution des deux Etats est revendiquée par les Palestiniens, les autres pays arabes et la communauté internationale, et qu'elle est acceptée par la majorité du peuple israélien et connue dans toutes ses modalités, pourquoi retarder la décision ?
3. La procrastination pour stratégie
Vos rapporteurs ont eu le sentiment que les Gouvernements israéliens ont tendance à se saisir de tous les prétextes, bons ou mauvais, pour gagner du temps et reporter l'heure des décisions. Trois raisons pourraient expliquer l'incapacité quasi-congénitale des Gouvernements israéliens à faire les choix permettant de conclure une paix « juste et durable » avec les Palestiniens.
a) La sécurité d'Israël
Selon la plupart des sondages, notamment celui du mouvement Onevoice , la première préoccupation des Israéliens est la sécurité.
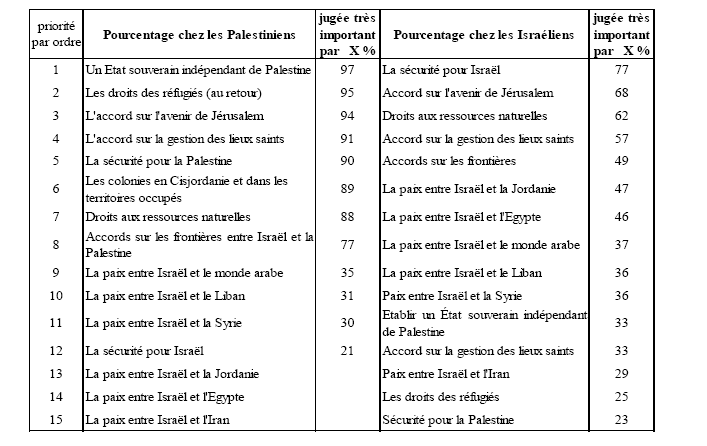
Or, Israël jouit d'une sécurité quasi complète parce que la force de son armée dissuade tout adversaire potentiel.
La supériorité de l'armée israélienne sur les armées conventionnelles de la région est écrasante. Rappelons qu'il ne s'agit pas que d'une question d'équipements militaires, d'organisation ou d'entraînement, mais aussi d'une supériorité stratégique qui trouve ses fondements dans la pensée du fondateur d'Israël, Ben Gourion 30 ( * ) . Israël a besoin, disait-il, d'une armée supérieure au total des autres armées susceptibles de la menacer. Pour cela, il faut avoir le meilleur renseignement possible, afin de disposer d'une alerte précoce, Israël ne pouvant se permettre d'être surpris. C'est le rôle du Mossad et de l'armée de l'air. Il faut également pouvoir dissuader ses ennemis de l'attaque. 31 ( * ) Enfin, en cas de conflit, il faut obtenir une victoire décisive aussi rapidement que possible. Ce sont ces principes, au moins autant que la valeur de ses armes, qui assurent la suprématie militaire d'Israël. Le résultat en est qu'aucune armée d'aucun Etat arabe, même le plus radical, n'envisage d'attaquer Israël. Toutes sont dans des postures défensives.
Concernant les conflits asymétriques, la stratégie traditionnelle d'Israël s'est en revanche révélée inefficace, en particulier lors de la dernière intervention au Liban. Certains think tanks israéliens ont alors évoqué une « infériorité stratégique » des forces israéliennes face au Hezbollah ou au Hamas et ont conçu une adaptation de la doctrine militaire. L'opération « Plomb Durci » avait entre autres pour but d'apporter une réponse adaptée aux confrontations asymétriques. Le principe en était simple : en répondant à la moindre agression, de façon impitoyable, quel qu'en soit le prix, en termes de victimes civiles et d'infrastructures, l'armée israélienne restaurerait sa capacité de dissuasion face à des agressions non étatiques.
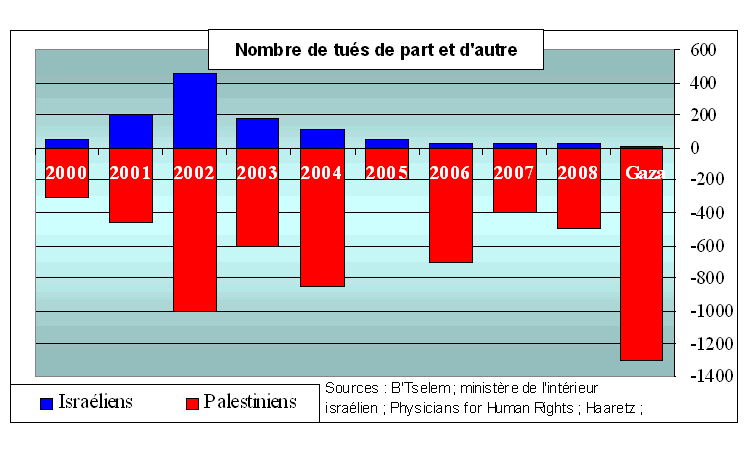
Force est d'admettre l'efficacité de cette tactique utilisée au XIX ème siècle par les armées coloniales européennes et par l'armée américaine pour la conquête de l'Ouest. La sécurité d'Israël est assurée. En 2008, 35 Israéliens ont été les victimes de violence politique dont 23 civils32 ( * ). Le Hamas a abandonné les attentats-suicide en avril 2006 et sa dernière action revendiquée remonte à janvier 2005. Depuis le début de l'année, quatre Israéliens ont été tués, dont trois militaires. La population palestinienne, au contraire, a payé un lourd tribut au cours des dernières années.
Cela ne signifie pas que les citoyens israéliens ne courent aucun danger, mais que la sécurité d'Israël a rarement été aussi bien assurée.
En conséquence, sa sécurité étant assurée, la nécessité de négocier et de concéder ne s'impose plus avec la même force.
b) La faiblesse du système politique israélien
Les élections israéliennes ont lieu à la représentation proportionnelle intégrale, ce qui conduit à une fragmentation des forces politiques en une multitude de partis politiques, contraints de former entre eux des coalitions. Aussi, le Premier ministre est-il en permanence l'otage de ses alliés. Bon nombre des partis charnières ont des positions radicales, voire extrémistes. La représentation proportionnelle intégrale donne à leurs députés un droit de vie ou de mort sur tout Gouvernement. Cela est si vrai que peu de Premiers ministres israéliens ont pu terminer leur mandat sans avoir à organiser d'élections anticipées. La perspective de scrutins trop rapprochés interdit à une telle démocratie d'élaborer une stratégie. En effet, dans un tel système, tout Premier ministre israélien déterminé à faire les concessions nécessaires à la conclusion de la paix met en danger son Gouvernement. C'est pourquoi, les Premiers ministres israéliens n'ont jamais vraiment cherché l'arrêt de la colonisation, alors même que les colonies ne concernent que 8 % de la population israélienne.
C'est même sous le Gouvernement d'Ehud Olmert, investi le 14 avril 2006, que le développement des colonies a le plus progressé. Selon l'ONG Peace Now , l'année 2008, année de l'accord d'Annapolis qui stipulait le gel de la colonisation, a vu une accélération de 60 % des constructions dans les colonies en Cisjordanie ainsi que dans les colonies dites « sauvages ». La même ONG souligne que les colons ont profité de la guerre de Gaza, qui a largement détourné l'attention de l'opinion publique, pour étendre les colonies et pour construire de nouvelles routes les reliant.
Précisons que le terme de « colonies sauvages », c'est-à-dire non autorisées par les autorités israéliennes, par opposition aux colonies « autorisées » (par le Gouvernement), n'a aucune valeur juridique. Au regard du droit international et notamment de la IV ème convention de Genève (article 47- 4), et de la Charte des Nations unies, toute annexion est proscrite, ce qui s'applique à toutes les colonies, même « autorisées ».
Si la sécurité des Israéliens est assurée et que tout Gouvernement serait en mal d'accepter les concessions nécessaires à la conclusion d'un accord, pourquoi les Israéliens retourneraient-ils à la table des négociations ?
c) Le lien indéfectible avec les Etats-Unis
1° La politique de Georges W. Bush
Jamais autant que sous Georges W. Bush le lien entre les Etats-Unis et Israël n'était apparu aussi fort. Il prit la forme d'un alignement quasi automatique sur les positions israéliennes et des livraisons massives d'équipements militaires.
Israël reçoit en permanence une assistance militaire américaine plus importante que n'importe quel autre pays, soit depuis 1987, en moyenne, chaque année, 1,8 milliard de dollars, en termes de ventes d'équipement ou de financement. Cette aide fut portée à 2,4 milliards sous l'administration Clinton. En 2007, les Etats-Unis accroissent de 25 % l'enveloppe accordée à Israël portant leur aide annuelle à 3 milliards de dollars pour toute la décennie à venir. En outre, George W. Bush assurait au Premier ministre israélien Ehud Olmert que les Etats-Unis garantiraient un avantage qualitatif dans les matériels livrés à Israël par rapport à ceux vendus aux autres pays du Moyen-Orient 33 ( * ) .
Selon l' U.S. Congressional Research Service , entre 1998 et 2005, les Etats-Unis ont fourni la quasi-totalité de l'approvisionnement de l'armée israélienne par des contrats portant sur plus de 9,5 milliards de dollars. Bien que l'accord du Gouvernement soit nécessaire pour les exportations d'armes, Israël traite directement avec les compagnies américaines pour ses approvisionnements. Israël possède, en dehors des Etats-Unis, la plus grande flotte de F-16 au monde.
Sous l'administration Bush, ce soutien militaire s'est doublé d'un soutien diplomatique sans faille qui devait autant à l'activisme du lobby pro-israélien 34 ( * ) qu'aux convictions de certains néoconservateurs proches du Président américain.
2° La nouvelle politique américaine
Le Président Obama s'est engagé dans une voie nouvelle au Moyen-Orient, en rupture avec celle de son prédécesseur. Son discours refondateur, inspiré et sincère du Caire, le 4 juin 2009, l'a montré. Beaucoup ont souligné la nécessité de voir ce discours traduit en actes. Mais, au Moyen-Orient, parler, c'est déjà en partie agir.
Du point de vue de la politique intérieure des Etats-Unis, la position de cette nouvelle administration américaine apparaît courageuse puisque 78 % des Juifs américains ont voté pour le candidat démocrate. Le soutien américain à Israël, tout en restant « indéfectible », devient plus critique. Comme on le sait, le Président Obama demande au Gouvernement israélien de reconnaître la nécessité d'un Etat palestinien et de geler tout nouveau développement des colonies.
Si le Premier ministre israélien a accepté du bout des lèvres la création d'un Etat palestinien, qu'il avait commencé par écarter, il demande, en revanche, la reconnaissance par les Palestiniens du caractère juif d'Israël, la démilitarisation du futur Etat palestinien et la garantie donnée par la Communauté internationale de la sécurité d'Israël. Pour témoigner de sa bonne volonté, il a fait évacuer quelques colonies sauvages et lever quelques barrages en Cisjordanie, tout en refusant le gel « total » des colonies, et exigeant le droit à la « croissance naturelle » des colonies autorisées.
Benyamin Netanyahu est un homme politique habile. Mais il n'est pas certain qu'il soit dans l'intérêt de son pays qu'il humilie le Président des Etats-Unis avec des réponses biaisées.
L'expérience montre, en effet, que si un Président des Etats-Unis le veut vraiment, il peut exercer une influence déterminante sur le Gouvernement israélien. La nouvelle politique américaine, parce qu'elle est relativement plus équilibrée, ouvre incontestablement de nouveaux horizons dans une situation qui paraissait totalement bloquée.
C. LA POSSIBILITÉ D'UNE PAIX
1. Comment contribuer à la réunification du mouvement palestinien ?
Un des obstacles les plus importants sur la voie de la réconciliation tient au fait qu'Israël et la communauté internationale rejettent tout contact avec le Hamas et refusent de lui accorder le bénéfice de toute aide internationale.
Les puissances occidentales souhaiteraient en effet participer à la reconstruction de la Bande de Gaza, sous l'égide exclusive de l'Autorité palestinienne, ce que le Hamas ne peut évidemment accepter. Elles se sont engagées, lors du sommet de Charm el-Cheikh du 2 mars 2009, à verser 2,8 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Mais aucune reconstruction ne pourra être entreprise aussi longtemps que le blocus israélien ne sera pas levé. L'importation de matériaux de construction, de pièces détachées et d'intrants agricoles est indispensable. En avril 2009, soit quatre mois après la fin des hostilités, les volumes importés à Gaza étaient à leur plus faible niveau depuis le début de l'année, et ce malgré l'importance des besoins humanitaires et l'arrêt des tirs de roquettes.
En réalité, le problème n'est pas seulement humanitaire, même si la levée du blocus est de ce point de vue un impératif. Il est avant tout politique. Pourquoi Israël refuse-t-il de négocier avec un Gouvernement conduit par le Hamas et pourquoi a-t-il persuadé les Etats-Unis et l'Europe de ne pas parler au Hamas, jetant l'anathème sur les contrevenants ? 35 ( * )
Sans doute le Hamas est-il une organisation terroriste ennemie d'Israël. Mais on fait la paix avec ses ennemis, pas avec ses amis. La France a dû accepter de parler au F.L.N. et le Gouvernement britannique avec l'IRA.
Comme l'ont relevé les membres de la Chambre des communes britannique, dans un rapport publié le 13 août 2007 : « Nous concluons que le fait de ne pas parler au Hamas en 2007, à la suite de l'accord de La Mecque a été contreproductif ». Nos collègues britanniques ajoutent : « Nous concluons que la décision de boycotter le Hamas, malgré l'accord de La Mecque et la suspension continue de l'aide au Gouvernement d'unité nationale, signifiait que ce Gouvernement avait toutes les chances de tomber ». 36 ( * ) Nos collègues britanniques viennent du reste de réitérer leur recommandation de parler avec les éléments modérés du Hamas dans un récent rapport sur la situation en Israël et dans les territoires occupés 37 ( * ) . Dans le même esprit, l'ancien Président des Etats-Unis, Jimmy Carter, lors d'une visite dans la Bande de Gaza le 19 juin dernier, a rencontré le « Premier ministre » Ismaïl Haniyeh.
Ne soyons pas dupes. D'après les informations fournies à vos rapporteurs par les autorités turques, les Israéliens eux-mêmes ont des contacts secrets avec le Hamas. Interdire aux Européens et aux Américains d'en faire autant n'a d'autre effet que de pousser le Hamas dans les bras de l'Iran.
Maintenir les exigences du Quartet constitue un obstacle dirimant à la formation d'un Gouvernement palestinien d'union. L'existence d'Israël sera implicitement reconnue si le Hamas participe à un Gouvernement d'unité nationale qui entre en négociation avec lui. La reconnaissance de jure viendra à l'issue de la négociation, mais entre deux entités souveraines. En faire un préalable n'a qu'une conséquence : empêcher que le processus de paix ne s'enclenche.
S'agissant de la Charte du Hamas, les Israéliens continuent à voir en elle la preuve d'une « vision du monde » islamique, incompatible avec les valeurs et les principes de l'Occident. Pourtant de nombreux chercheurs 38 ( * ) ont montré que cette charte constituait avant tout une carte dans le jeu du Hamas et qu'il s'en dessaisira le moment venu.
Lors des élections de 2006, le Hamas a dû présenter une « plate-forme électorale » puis un « programme de Gouvernement d'union nationale » qui sont plus importants pour situer le positionnement du Hamas que la Charte de 1988. Or, ces documents mettent l'accent sur la « liberté d'expression, de presse, d'association », sur le « pluralisme » et la « séparation des pouvoirs », sur l'« alternance pacifique au pouvoir », sur l'« édification d'une société civile développée » et le « respect des droits des minorités ».
Si l'on doit exiger quelque chose en préalable à toute négociation avec le Hamas, c'est bien le respect, sur le terrain, à Gaza, de ces principes et de ces valeurs, plus que la modification d'une charte écrite il y a plus de vingt ans par un étudiant exalté et auquel les dirigeants du Hamas eux-mêmes ne semblent plus accorder la moindre importance.
Concernant l'OLP, il semble de plus en plus évident que Mahmoud Abbas repousse sans cesse la réforme du mouvement palestinien à des jours meilleurs. Il en va de même avec la réforme du Fatah qui est pourtant indispensable avant les prochaines élections car chacun sait que le Fatah est traversé actuellement par des mouvements contradictoires entre conservateurs et réformistes de la « jeune garde » qui n'excluent plus le retour à la lutte armée 39 ( * ) .
Le congrès du Fatah, pendant l'été 2009, a certes re-légitimé Mahmoud Abbas et redonné un nouveau souffle à ce mouvement. Mais ce congrès n'a rien réglé sur le fond du problème : la possible réunification du mouvement palestinien.
Le Gouvernement israélien détient sans doute la clé de la réunification palestinienne en la personne d'un prisonnier, membre du Fatah mais dont la représentativité est reconnue par le Hamas : Marwan Barghouti.
D'après les informations recueillies par vos rapporteurs auprès de l'épouse de Marwan Barghouti, l'avocate Fadwa Barghouti, l'incarcération de celui-ci est sévère. Ce qui ne l'a pas empêché de se faire reconnaître comme leader par l'ensemble de ses codétenus qui se prononcent avec lui pour l'unité nationale.
Si Marwan Barghouti constituait un Gouvernement d'unité nationale, on peut penser qu'il rassemblerait aujourd'hui l'opinion palestinienne. Pour lui, la réconciliation passe par la mise en oeuvre du « document des prisonniers » endossé par l'ensemble des factions et qui garantit la protection des principes démocratiques : le pluralisme, la séparation des pouvoirs, les libertés publiques et individuelles. Le document proclame le droit à la résistance du peuple palestinien et prévoit les étapes concrètes du retour à l'unité : réforme de l'OLP, réforme de l'Autorité palestinienne, ces deux organes étant mandatés pour porter et défendre les revendications du peuple palestinien dans les négociations avec Israël. Le Gouvernement d'union nationale serait uniquement chargé de reconstruire Gaza et d'organiser des élections avant le 25 janvier 2010.
Dans ces conditions, un échange de Marwan Barghouti contre Gilad Shalit mérite d'être considéré. D'autant plus que, selon son épouse Fadwa, Marwan Barghouti aurait été placé en tête de la liste de prisonniers présentée à Israël, en échange de la libération de Gilad Shalit.
|
Marwan Barghouti Barghouti est un des principaux chefs politiques de la première Intifada dans la Bande de Gaza dès 1987. Il est arrêté dès 1987 par l'armée israélienne et expulsé vers la Jordanie. Il ne peut revenir d'exil qu'après la signature des accords d'Oslo en 1994. Il est élu au Conseil législatif de Palestine en 1996, et y défend la nécessité d'une paix avec Israël. Orateur talentueux, ayant fait ses preuves au combat, Barghouti grimpe dans l'appareil politique du Fatah et en devient secrétaire général pour la Cisjordanie. Lors de la seconde Intifada, Barghouti, chef du Tanzim-Fatah, branche armée du Fatah, se rend indispensable par ses talents d'organisation. Sa popularité croît chez les Palestiniens. Le Tanzim-Fatah lance par l'intermédiaire d'un groupe, les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, des attentats-suicides sur le territoire israélien et contre les colonies israéliennes. Son rôle dans la campagne d'attentats-suicides contre Israël en fait l'un des Palestiniens les plus recherchés par les forces de sécurité israéliennes. En 2001, il déjoue une tentative d'assassinat préparé contre lui par l'armée israélienne. Le 15 avril 2002, Israël le capture. Il est inculpé par un tribunal civil pour meurtres et tentatives de meurtres dans une entreprise terroriste sous son commandement. Les Palestiniens capturés pour des faits de résistance sont d'habitude jugés par des tribunaux militaires israéliens mais pour Barghouti, Israël doit se soumettre aux pressions étrangères et donner au procès un minimum de crédibilité juridique. Barghouti se sert de la tribune qui lui est offerte pour plaider sa cause politique. Tout au long de son procès, il refuse de reconnaître la légitimité du tribunal israélien et, par conséquent, refuse de se défendre. Il dit soutenir les attaques armées contre l'occupation israélienne mais ne pas cautionner les attaques contre des civils sur le territoire d'Israël. Il est condamné le 20 mai 2004 pour cinq meurtres dont celui d'un moine orthodoxe grec. Barghouti est aussi déclaré coupable d'une tentative de meurtre pour un attentat-suicide déjoué par les forces de sécurité israéliennes. Il affirme être innocent des chefs d'accusation portés contre lui. Il est inculpé de 21 chefs d'accusation de meurtre commis au cours de 33 attentats. Le 6 juin, Barghouti est condamné à cinq peines de réclusion à perpétuité pour cinq meurtres et 40 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. |
2. Comment aider les Israéliens à comprendre l'intérêt d'un Etat palestinien viable ?
Le paradoxe est qu'Israël est politiquement trop faible pour faire la paix et militairement trop fort pour en avoir besoin. En outre, son armée et son Gouvernement ont bénéficié, jusqu'à présent, d'un soutien sans faille des Etats-Unis.
Certes, la sécurité d'Israël n'est pas qu'un alibi et tout projet de paix devra être en mesure d'apporter des réponses sérieuses à cette légitime préoccupation. Néanmoins, l'insécurité actuelle doit être relativisée et appréhendée à sa juste mesure. Le fait est que la population d'Israël jouit aujourd'hui d'un niveau de sécurité très élevé et, d'un niveau de vie enviable, alors que les populations de Gaza et celles de Cisjordanie connaissent à la fois la misère et l'insécurité du fait de l'occupation militaire et de la colonisation. Le blocus de Gaza dure depuis trois ans et les check points sont toujours en place, même si leur nombre a été récemment réduit.
Les dirigeants palestiniens ne semblent pas prêts de leur côté à se réconcilier. Le fossé de haine entre eux est grand et il semble difficile qu'ils puissent s'entendre sur un programme de négociations, en particulier sur la question de la reconnaissance préalable d'Israël.
Dans ces conditions, la réconciliation interpalestinienne relèverait du miracle et il faudra plus que la bonne volonté des autorités égyptiennes pour y parvenir.
Les puissances occidentales ont dans cette situation une part importante de responsabilité. Elles ont poussé à des élections libres, ont participé à leur organisation, ont reconnu leur validité, et, les résultats proclamés, ont refusé de reconnaître le Gouvernement sorti des urnes. Sous la pression d'Israël, elles continuent de refuser de dialoguer avec le Hamas. Cette attitude, dont on peut comprendre les motivations, n'en constitue pas moins une erreur qu'il importe de corriger.
Une chose est certaine, Israéliens et Palestiniens ne feront pas la paix seuls, sans un arbitre capable de rétablir un minimum d'équilibre entre les parties. Pour des raisons évidentes, seuls les Etats-Unis sont capables de relever ce défi. L'Union européenne peut les y aider si elle sort de son rôle de banquier de l'autorité palestinienne et indirectement d'Israël qu'elle libère du poids financier de ses obligations de puissance occupante.
II. EVITER LA PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE AU MOYEN-ORIENT
Aujourd'hui plus que jamais, l'Iran inquiète. Au lendemain d'élections présidentielles, manifestement frauduleuses, la vraie nature du régime iranien apparaît : celle d'une dictature théocratique oppressive, et liberticide. Est-ce une surprise ? Pas vraiment. Le régime iranien vient de montrer son visage le plus détestable : celui d'un régime instable, va-t-en guerre et paranoïaque. S'il parvient à se doter de l'arme nucléaire, l'Iran de demain aura tout d'un cauchemar pour beaucoup de nations, pas seulement occidentales.
La révolte écrasée, Mahmoud Ahmadinejad peut-il s'attendre à un mandat de tout repos ? Probablement pas. Son investiture a montré l'embarras du Guide suprême. Mais Ahmadinejad devra affronter bien plus qu'une rebuffade symbolique du guide suprême : la fronde de ses alliés conservateurs. Leurs critiques tiennent à son arrogance ainsi qu'à son mépris pour les institutions 40 ( * ) . Lors de son premier mandat, les conservateurs n'ont guère apprécié les libertés prises avec la loi et le Parlement. Les critiques les plus sévères s'élevèrent lorsque, dans la foulée de l'élection présidentielle, il s'abstint de révoquer Rahim Mashai, nommé vice-président, refusant ainsi d'obéir au Guide suprême. Lors de l'investiture de son Gouvernement par le Parlement, les députés ont refusé la nomination de trois candidats proposés par Ahmadinejad, dont deux des trois femmes et l'un de ses amis personnels, Mohammad Ali-Abadi. A l'origine de la colère des conservateurs, il y a la morgue que le Président affiche vis-à-vis du clergé. Ahmadinejad agace profondément les religieux, habitués, depuis la Révolution de 1979, à s'arroger une large part du pouvoir. Il a installé ses proches, généralement d'anciens gardiens de la Révolution, aux postes clefs : intérieur, renseignement, pétrole. Enfin, de nombreux conservateurs se demandent si sa politique ne compromet pas le futur de la République islamique.
C'est pourquoi Ahmadinejad apparaît aujourd'hui de plus en plus seul, face aux critiques d'une partie des conservateurs, du Parlement, du pouvoir judiciaire, du Conseil de discernement (institution arbitrale présidée par Rafsandjani) et même de ses propres alliés, repoussés les uns après les autres dans le camp des opposants. Il semble qu'Ahmadinejad n'aura pour seule solution que de s'appuyer toujours davantage sur l'ayatollah Khamenei. Mais celui-ci a commencé à prendre ses distances avec le Président, notamment en déclarant le 26 août dernier qu'aucune preuve ne lui avait été rapportée des liens supposés entre les rivaux politiques d'Ahmadinejad et certains pays étrangers. Autre exemple de cette distanciation, Ahmadinejad a congédié le ministre des renseignements, Qolam Hussein Mohseni Ejei le 25 juillet dernier et celui-ci a aussitôt été nommé procureur général par le chef du système judiciaire, lui-même nommé par le Guide suprême.
Certes, la République islamique a toujours été caractérisée par la multipolarité du pouvoir, mais jamais à un tel point. Le Gouvernement d'Ahmadinejad sera-t-il en mesure de conduire une politique nationale et internationale qui imposerait de nouveaux sacrifices à la population iranienne ? On peut se le demander. C'est pourquoi, avant de considérer quelle politique mener à son endroit, il importe de comprendre la politique étrangère que lui-même conduit et à quel stade de développement en est son programme nucléaire. Une analyse fondée sur une remise en perspective historique des événements nous y aidera 41 ( * ) .
A. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE IRANIENNE ENTRE RÉVOLUTION ET NATIONALISME
Selon la constitution iranienne, le Guide suprême est le guide de la Révolution « islamique », et non de la Révolution « iranienne ». Les détracteurs de l'Iran y voient la preuve de sa volonté d'exporter sa révolution partout au Moyen-Orient : en Irak, en Syrie, au Liban avec le Hezbollah, en Palestine avec le Hamas, et jusque dans les provinces les plus reculées du Yémen où le Gouvernement iranien aiderait la rébellion houtiste.
Mais au-delà des rodomontades, des discours martiaux, des déclarations à l'emporte-pièce, l'Iran est un pays inquiet qui a des raisons de l'être. Il est vrai que les ingérences ont été nombreuses dans la vie du pays, depuis le renversement de Mossadegh par un coup d'Etat anglo-saxon, jusqu'à l'agression armée de son voisin irakien, jamais condamnée par le Conseil de sécurité et soutenue par l'ensemble des Gouvernements arabes et des pays occidentaux. Ces souvenirs ne sont sans doute pas étrangers à son nationalisme sourcilleux.
La politique étrangère de l'Iran a oscillé entre ces deux orientations : propagation de la Révolution et nationalisme.
1. La politique étrangère « islamique » et son échec : 1979-1989
a) La politique des débuts de la Révolution
L'acte fondateur de la politique étrangère de la République islamique d'Iran est l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran à la fin de 1979 et la rupture des relations diplomatiques avec Washington en avril 1980. Cet événement a défini, dans sa radicalité, une politique étrangère islamiste qui comportait trois éléments.
Tout d'abord la volonté d'afficher sa solidarité avec tous les musulmans du monde , conduisant le régime à gommer sa spécificité chiite. L'objectif de cette politique panislamique était de reconstituer la communauté des croyants (Ummah) autour de l'Iran, point de ralliement de tous les peuples musulmans en lutte contre l'Occident et Israël.
La politique étrangère islamique présentait, d'autre part, une dimension tiers-mondiste , sans doute directement inspirée de la vision d'Ali Shariati, partisan d'une « théologie islamique de la libération » selon laquelle le monde était divisé en deux camps : les déshérités (mostazafin) qui incluaient les musulmans et les oppresseurs (mostakberin), les impérialistes. Cette orientation a conduit l'Iran à soutenir le Nicaragua sandiniste et Cuba, tout en s'opposant aux moudjahidines afghans sunnites et réactionnaires.
Troisième élément de cette politique : un antisionisme et un antiaméricanisme virulent prolongeant la lutte contre le Shah, allié des Etats-Unis. Ceux-ci avaient non seulement contribué à la chute de Mossadegh, mais accordaient un soutien économique et surtout militaire massif à Reza Shah. Quant à l'antisionisme, il servait l'ambition des dirigeants iraniens désireux d'apparaître comme les leaders du monde musulman. Les tensions entretenues avec les puissances occidentales, en particulier l'Amérique, contribuaient au maintien d'un climat révolutionnaire renforçant la légitimité du régime. Les luttes politiques internes n'ont cessé, selon Thierry Coville 42 ( * ) , de peser sur la politique étrangère iranienne à ses débuts.
Un Conseil de la Révolution islamique fut mis en place et chargé de coordonner et de soutenir, idéologiquement et financièrement, les mouvements islamiques ou de libération nationale affrontant les puissances occidentales ou les Gouvernements musulmans « corrompus ». En 1981, au Bahreïn, des groupes chiites soutenus par l'Iran organisèrent une tentative de soulèvement. Le Koweït fut l'objet de plusieurs attentats. En Arabie saoudite, les pèlerinages de La Mecque furent l'occasion d'affrontements entre agents iraniens et forces de police saoudiennes. En Irak, l'Assemblée suprême de la Révolution islamique (ASRI), dirigée par l' hodjatoleslam Muhammad Bakir al-Hakim, organisa plusieurs attentats contre le régime de Saddam Hussein. En Afghanistan, les partis chiites de la résistance antirusse étaient aidés par l'Iran qui soutenait aussi l'OLP, puis le Hamas.
C'est surtout au Liban que l'action de l'Iran fut la plus déterminée. En 1982, Hossein Mussavi, ancien responsable d'Amal, formation chiite libanaise créée dans les années 1970, s'alliait à l'Iran et fondait le Mouvement Amal islamique, plus connu sous le nom de Djihad islamique. La même année naissait le Hezbollah, dirigé par l'ayatollah Mohammad Hussein Fadhlallah, fondateur du parti chiite Irakien Daawa. Ces deux mouvements furent à l'origine de nombreuses actions contre les intérêts occidentaux au Liban, notamment l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine à Beyrouth en 1983 et les deux attentats-suicides contre les forces françaises et américaines basées au Liban qui firent respectivement 58 et 239 morts. Après le départ des troupes occidentales du Liban, ces mouvements procédèrent à des prises d'otages occidentaux.
Notre pays fut particulièrement visé, du fait de sa présence au Liban, de son soutien à l'Irak et de l'accueil sur notre territoire de nombreux opposants iraniens, dont les Moudjahidine du peuple. Le sociologue Michel Seurat, enlevé en 1985 par le Jihad islamique, mourut en captivité. En 1986, plusieurs attentats à la bombe frappèrent Paris. La justice française chercha à interroger comme témoin l'iranien Wahid Gorji, traducteur, qui avait un statut diplomatique, ce qui déclencha une « guerre des ambassades ».
Peu à peu le Hezbollah devint un acteur majeur au Liban. Son influence grandissante entraîna, de 1985 à 1987, des affrontements armés avec l'autre mouvement chiite libanais, Amal, inquiet de voir son influence diminuer. L'émergence et l'ascension du Hezbollah fut sûrement la plus grande réussite de la politique iranienne d'exportation de la Révolution, mais ne suffit pas en dissimuler l'échec global.
b) L'échec de l'exportation de la Révolution
Nulle part, pas même au Liban, l'Iran n'a réussi à faire naître des républiques islamiques et jamais l'Iran n'est parvenu à s'ériger en leader d'un mouvement révolutionnaire au-delà de ses frontières. Au contraire, beaucoup de pays et de mouvements islamiques, surtout sunnites, se sont détournés de l'Iran dont les menées inquiétaient.
La guerre avec l'Irak a beaucoup contribué à cet échec, dans la mesure où elle a conduit le régime iranien à exalter les valeurs nationales face à l'agression de Saddam Hussein. Toute une génération de militants a reçu une formation militaire et idéologique dans le cadre de cette guerre. Le culte du martyre, à l'image du destin tragique de l'imam Hossieyn, est devenu un élément central de l'idéologie officielle, accentuant la spécificité chiite de l'Iran par rapport au reste de l'Orient sunnite.
L'Iran, d'autre part, a toujours été soucieux de défendre ses intérêts nationaux, n'hésitant pas à l'occasion à pactiser avec les Etats-Unis et même Israël, comme l'ont montré les négociations secrètes menées en 1986 qui ont débouché sur le scandale de l' Irangate . De même, en dépit de sa volonté proclamée de rassembler tous les musulmans dans sa lutte mondiale de libération, Téhéran n'a pas sourcillé lorsque la Syrie massacra des milliers de Frères Musulmans lors des affrontements dans la ville de Hamat en 1982. Enfin, les autorités iraniennes n'ont rien fait, à la fin de la première guerre du Golfe, pour empêcher le massacre des « frères chiites » d'Irak par Saddam Hussein.
A chaque fois, l'Iran a privilégié ses propres intérêts. Si bien que les mouvements islamiques sunnites n'ont pas été tentés d'adhérer au discours internationaliste et musulman de Téhéran. Le seul pays sunnite à s'être allié à l'Iran est la Syrie, mais cette alliance n'a aucun contenu idéologique. Le régime syrien a soutenu l'Iran contre l'Irak, parce que Saddam Hussein était depuis toujours son ennemi juré et que l'alliance iranienne facilitait sa main mise sur le Liban. Aussi n'est-il pas surprenant que l'Iran se soit avéré incapable de créer un mouvement islamique révolutionnaire au Moyen-Orient dont il aurait pris la tête et s'est, au contraire, trouvé isolé sur la scène internationale. L'exemple le plus frappant de cet échec fut le silence du monde musulman lors de la guerre Iran-Irak. L'OLP, pourtant soutenue par l'Iran, a finalement choisi le camp de Saddam Hussein, ce que Téhéran ne lui a jamais pardonné.
Les Chiites eux-mêmes n'ont pas toujours fait allégeance à l'Iran. C'est ainsi que le chef spirituel du Hezbollah dans les années 1980, l'ayatollah Fadlallah, avait émis des réserves sur la thèse du velayat-e faqih 43 ( * ) et admis l'impossibilité d'imposer un régime islamique dans un Etat multiconfessionnel tel que le Liban.
2. Le retour au nationalisme et à une politique de puissance régionale 1989-2001
L'échec de la politique d'exportation de la Révolution, dont le seul résultat fut d'isoler l'Iran, joint au coût de la longue guerre avec l'Irak, ont incité les dirigeants iraniens à mettre l'accent sur la consolidation du régime et la satisfaction des aspirations matérielles de la population.
Les présidences des Ayatollahs plus modérés, Ali Akbar Hachemi Rafsandjani (1989-1997) et Mohammad Khatami (1997-2005) ont été marquées par des politiques extérieures pragmatiques tendant à asseoir le rôle régional de l'Iran.
De même, après l'éclatement de l'URSS, l'Iran s'est efforcé de nouer avec les nouvelles républiques d'Asie Centrale des relations de bon voisinage exemptes de toute connotation islamique.
Dans le conflit du Haut Karabagh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme dans les démêlés entre le Gouvernement du Tadjikistan et sa mouvance islamique, l'Iran, au lieu de souffler sur les braises de l'islamisme, s'est efforcé de faire prévaloir l'entente et la coopération.
Avec la Russie post-communiste, Téhéran s'en est tenu à la défense de ses intérêts économiques et stratégiques : achat d'armements russes, construction de la centrale de Bushehr, évacuation du pétrole de la zone de la mer Caspienne.
Rien ne rapprochait l'Iran de la Turquie, pays sunnite, allié des Etats-Unis, proche d'Israël et attaché aux structures séculières mises en place par Kemal Atatürk. Cela n'a pas empêché les deux pays d'entretenir d'excellentes relations d'autant que leurs Gouvernements s'opposaient avec la même détermination aux velléités indépendantistes du Kurdistan. Le même pragmatisme a prévalu dans les relations de l'Iran avec les pays pétroliers du Golfe ainsi qu'après une période initiale de tensions, avec l'Arabie saoudite. Seuls ses rapports avec des Emirats Arabes Unis sont restés marqués par le litige opposant les deux pays sur les îles Tomb et Abou Moussa, occupées par Téhéran du temps du Shah et que la République Islamique n'a jamais restituées.
Pendant cette période, l'Iran s'est efforcé de normaliser ses relations avec l'Irak, se prêtant à des échanges de prisonniers et laissant se développer des échanges contraires aux interdits de l'ONU. L'Irak put ainsi exporter plus de pétrole et importer davantage de marchandises qu'il n'y était autorisé.
Vis-à-vis de l'Europe, l'attitude extrêmement prudente de l'Iran pendant la guerre du Golfe de 1991 (condamnation de l'offensive de la coalition, mais sans gêner les opérations militaires) a permis la levée des sanctions économiques et la mise en place d'un dialogue critique entre l'Occident et l'Iran. Ce dialogue avait plusieurs objectifs : respect des droits de l'Homme, renonciation au terrorisme, non prolifération des armes de destruction massive, abolition de la fatwa contre Salman Rushdie. Il a permis l'essor des relations économiques entre l'Europe et l'Iran. Total, associé à Gazprom (Russie) et à Petronas (Malaisie), a investi plusieurs milliards de dollars dans le secteur pétrolier et gazier iranien en dépit de l'embargo imposé par les Etats-Unis.
Les relations avec les Etats-Unis, en revanche, ne se sont pas améliorées depuis le début de la Révolution. Pourtant, le recours au terrorisme avait été définitivement abandonné par l'Iran à la fin des années 1980 et l'essentiel des réseaux terroristes iraniens avaient été démantelés en 1989 tandis que les pasdarans implantés au Liban dans la Bekaa rejoignaient le Soudan. En outre, le Président Rafsandjani encourageait la mutation du Hezbollah en une organisation politique. Cette orientation n'a pas empêché une série d'assassinats d'opposants à l'étranger dont celui de Shapour Bakhtiar, dernier Premier ministre du Shah, réfugié en France, à Suresnes. En jetant les bases du programme nucléaire iranien, Rafsandjani ne poursuivait pas de buts offensifs. Quant à la lutte contre Israël, elle se limita au soutien donné au Hamas et au Hezbollah. La politique conduite par Khatami n'a pas introduit de changement significatif par rapport à celle de Rafsandjani, dont elle a prolongé les principales tendances. Son intervention à la tribune des Nations unies et sa personnalité rassurante ont été bien perçues par le Gouvernement américain. Lors d'une interview à CNN en 1998, le Président iranien avait condamné le terrorisme et indiqué que l'Iran ne cherchait pas à imposer son point de vue aux Palestiniens concernant le processus de paix, ni à devenir une puissance nucléaire. Réagissant favorablement à la victoire électorale des réformateurs, Madeleine Albright avait annoncé la levée partielle de l'embargo sur les importations américaines de tapis et de produits alimentaires. Ces gestes n'allèrent pas jusqu'à permettre l'ouverture d'un dialogue avec Washington, qui continuait à achopper sur le soutien apporté au Hezbollah, considéré par l'Iran comme un atout dont il n'entendait pas se dessaisir.
3. L'Iran après le 11 septembre 2001
Les attentats du 11 septembre ont brutalement changé l'environnement extérieur de l'Iran.
Tout d'abord, les deux plus grands adversaires régionaux de l'Iran, les talibans à l'est et Saddam Hussein, à l'ouest, furent évincés. Un fossé séparait les talibans afghans , sunnites et fondamentalistes, des chiites iraniens. Quant à Saddam Hussein, il n'avait jamais cessé d'être tenu pour le principal adversaire du régime iranien.
En dépit de son opposition officielle à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, le Gouvernement iranien avait observé une neutralité bienveillante vis-à-vis des forces américaines, proposant même de secourir les pilotes américains récupérés en territoire iranien. Durant le conflit, les autorités iraniennes avaient aidé les forces d'Ismaël Kahn (ancien gouverneur de la province d'Herat) en lutte contre les talibans . Enfin, l'Iran avait joué un rôle important à la conférence de Bonn, fin 2001, qui avait présidé à la formation du Gouvernement afghan.
Mais alors que l'Iran était étranger aux attentats du 11 septembre, et en dépit de son attitude coopérative, la République islamique avait été rangée par Georges W. Bush, lors de son discours sur l'état de l'Union du 29 janvier 2002, parmi les Etats de l'« axe du mal ». Par la suite, Washington mena une politique systématiquement hostile à la République islamique, décrite comme une menace pour le monde. Washington alla jusqu'à en appeler à un « changement de régime » en raison du soutien donné par l'Iran au « terrorisme international », en l'espèce au Hezbollah et aux mouvements radicaux palestiniens, le Hamas et le Jihad islamique.
La rhétorique de la Maison Blanche, jointe à la présence militaire américaine aux frontières de l'Iran, furent perçues à Téhéran comme des menaces existentielles. Elles peuvent expliquer la reprise ou la poursuite d'un programme nucléaire clandestin, destiné à sanctuariser son territoire grâce à l'arme atomique.
4. L'extrémisme verbal d'Ahmadinejad
Mahmoud Ahmadinejad est issu de la droite islamique, conservatrice et religieuse. Membre des pasdarans, il est un exemple parfait de ces « ingénieurs islamistes » qui se sont illustrés dans d'autres mouvements fondamentalistes. Élu maire de Téhéran en 2003, il se pose en leader d'une seconde révolution visant à éradiquer la corruption et les valeurs occidentales. Il remet en cause, dans sa municipalité de Téhéran, les réformes libérales du président Khatami. Les valeurs qu'il défend sont celles des « déshérités ». Il s'appuie sur les basidj, milice musclée auxiliaire des pasdarans.
Ahmadinejad se présenta à l'élection présidentielle de juin 2005 et arriva, à la surprise générale, en deuxième position avec 19,4 % des voix derrière l'ancien président Hachemi Rafsandjani qui ne totalisa que 21,1 % des voix. Lors du second tour, le 24 juin, Ahmadinejad affronta Rafsandjani et l'emporta largement avec 61,69 % des voix contre 35,93 % à Rafsandjani.
En octobre 2005, Ahmadinejad, dans un discours consacré à Israël, déclara qu'il adhérait aux propos de l'Ayatollah Khomeiny, selon qui « ce régime qui occupe Jérusalem doit disparaître de la page du temps ».
Après la publication des caricatures de Mahomet en décembre 2005, il dénonça le « mythe du massacre des Juifs » et proposa de créer un État juif en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Alaska. Il mit en doute la réalité de la Shoah, qualifiant Israël de « tumeur », et demandant à l'Allemagne et à l'Autriche de céder une partie de leur territoire pour établir l'État d'Israël.
Ces déclarations incendiaires suscitèrent une vive réprobation en Occident et contribuèrent à la dégradation de l'image de l'Iran dans les pays occidentaux. Les Etats européens furent tentés de rejoindre la position américaine, selon laquelle il était impossible de négocier avec le régime iranien devenu une menace à combattre. On retrouve cette thèse chez un certain nombre d'Etats du Golfe qui, inquiets des ambitions de l'Iran et du déclin des sunnites en Irak, dénoncent, selon la formule du roi Abdallah II de Jordanie, la naissance d'un « croissant chiite ».
Deux éléments tempèrent cet apparent retour à une politique d'expansionnisme islamiste.
D'une part, la politique étrangère iranienne n'est pas du ressort du Président mais du Guide suprême. Or, depuis son accession au pouvoir, en 1989, Ali Khamenei a fait preuve de pragmatisme et a fait de la défense de ses intérêts nationaux la priorité de la politique iranienne.
D'autre part, les déclarations antisionistes et antisémites ne datent pas d'Ahmadinejad. Elles sont malheureusement fréquentes depuis la Révolution et ne signifient nullement que l'Iran est prêt à se lancer dans une aventure militaire contre Israël, dont il n'aurait du reste pas les moyens. Elles ont pour but de permettre à Ahmadinejad de flatter la « rue arabe » et d'en faire le défenseur le plus intransigeant de la cause arabe.
L'audience de l'Iran dans le monde musulman n'en reste pas moins limitée. Les mouvements d'inspiration salafiste, à l'image d'Al-Qaïda honnissent l'Iran, phare du chiisme au Moyen-Orient. Quant aux Gouvernements sunnites, notamment ceux du Golfe, ils observent la montée en puissance de l'Iran avec inquiétude. Seule la Syrie reste l'alliée fidèle de Téhéran, efficace contrepoids face aux Etats-Unis et allié utile au Liban.
En résumé, la politique étrangère d'Ahmadinejad se nourrit de déclarations outrancières qui plaisent à l'opinion publique arabe, sans inquiéter réellement les Gouvernements sunnites de la région.
5. La victoire de Mir Hossein Moussavi aurait-elle changé en profondeur l'orientation de la politique iranienne ?
C'est peu probable. La vigueur avec laquelle l'intéressé s'est opposé à Mahmoud Ahmadinejad avait fait croire aux observateurs qu'il initierait un renouveau politique et se prêterait à l'ouverture d'un dialogue constructif avec l'Occident. Rien n'est moins sûr.
Mir Hossein Moussavi avait été directeur politique du Parti de la République islamique et artisan efficace de l'ascension de l'imam Khomeiny. Il avait été brièvement ministre des Affaires étrangères lors de la prise d'otages à l'ambassade américaine en 1980, avant de devenir, de 1981 à 1989, le Premier ministre de la guerre irako-iranienne, connu comme un « faucon » et partisan de l'exportation de la Révolution.
Pendant la campagne électorale, il se prononça pour la poursuite du programme nucléaire, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on se souvient que, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), il approuva, en mars 1987, les premiers achats clandestins de centrifugeuses.
B. L'AMBITION NUCLÉAIRE DE L'IRAN
La politique de l'Iran est désormais résolument nationaliste. Elle entend dissuader tout adversaire de l'attaquer et s'opposer à toute ingérence extérieure. Pour se mettre en état de défense, l'Iran a élaboré une stratégie comportant plusieurs volets.
Il a renforcé ses défenses côtières. Celles-ci s'appuient sur les montagnes qui bordent le Golfe persique et rendraient une tentative de débarquement par la mer aléatoire et coûteuse en vies humaines.
L'Iran a développé sa capacité à encaisser une éventuelle attaque en doublant ses réseaux de communication et en répartissant ses moyens militaires sur son territoire.
Il s'est donné les moyens d'étendre un éventuel conflit à d'autres pays, dans le but de donner plus d'ampleur à une éventuelle riposte. Au-delà de ses alliés au Liban et en Palestine, il s'est doté d'embarcations légères et rapides lui donnant la possibilité d'entraver voire d'interrompre le transit des tankers dans les eaux du Golfe.
Il s'est efforcé de développer une industrie militaire nationale et ses ingénieurs ont tout fait pour maintenir en état de marche les matériels, notamment aéronautiques, hérités du Shah. Dans le même ordre d'idées, l'Iran a cherché à diversifier ses importations d'armes, en s'adressant en particulier à la Russie. On le soupçonne, malgré les constantes dénégations russes, d'avoir acquis ou d'être en passe d'acquérir des moyens de défense anti-aériens de la dernière génération : les missiles S-300.
Pour compléter ces moyens, il serait logique que l'Iran essaie de se doter de l'arme nucléaire, en tant qu'ultime garant de son indépendance, mais aussi comme support de sa politique de puissance régionale.
1. Où en est le programme nucléaire iranien ?
Beaucoup a été dit et écrit sur le programme nucléaire iranien. La question est, en effet, essentielle.
a- Programme civil ou militaire ?
La position constamment défendue par les autorités iraniennes consiste à nier toute ambition nucléaire militaire, position rappelée par M. Seyed Mehdi Miraboutalebi, ambassadeur d'Iran à Paris 44 ( * ) .
Cependant s'il n'existe à ce jour aucune preuve formelle permettant d'affirmer que l'Iran développe un programme nucléaire militaire, il y a bien un faisceau d'indices indiquant que tel est bien le but poursuivi.
Le premier de ces indices tient au fait que des activités nucléaires ont été conduites par l'Iran dans le plus grand secret, contrevenant ainsi à ses engagements vis-à-vis du traité sur la non-prolifération (TNP), et que les autorités iraniennes se refusent toujours à donner à l'AIEA les indications permettant de confirmer ou d'infirmer la finalité militaire de son programme nucléaire.
Ce sont en effet les Moudjahidines du peuple -opposants de gauche, résolus et clandestins- qui ont dévoilé l'existence du programme en août 2002. Ce programme comporte une vaste usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, ainsi que la construction d'un réacteur à eau lourde à Arak, susceptible de produire du plutonium utilisable à la fabrication d'une arme nucléaire. Pourquoi l'Iran aurait-il cherché à dissimuler son programme si celui-ci n'avait pas de finalité militaire ?
La pression des Européens incita l'Iran à signer le protocole additionnel au TNP permettant à l'AIEA de visiter, à l'improviste, ses sites nucléaires. Le régime iranien a ensuite accepté d'arrêter temporairement son activité d'enrichissement en décembre 2003. En contrepartie, les Européens s'engageaient à poursuivre les négociations dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération de l'Union européenne avec l'Iran et à soutenir l'adhésion de celui-ci à l'Organisation Mondiale du Commerce. L'arrêt des activités d'enrichissement devait durer jusqu'à ce qu'un accord définitif intervienne. Mais après l'élection d'Ahmadinejad, Téhéran décida de relancer l'activité de l'usine de Natanz et de ne plus appliquer le protocole additionnel que l'Iran n'avait d'ailleurs pas ratifié.
En 2006, l'AIEA découvrit des traces d'uranium enrichi à 36 %, provenant des centrifugeuses iraniennes, ainsi que des plans d'origine pakistanaise et des pièces d'une centrifugeuse Pak 2. Ces découvertes incitèrent l'AIEA à poser une série de questions susceptibles d'éclairer la vraie nature du programme iranien, questions auxquelles Téhéran n'a jamais répondu.
A la demande de la « troïka européenne » (Grande-Bretagne, France, Allemagne) et des Etats-Unis, le Conseil de sécurité des Nations unies a été saisi du dossier et a émis successivement six résolutions enjoignant l'Iran de prendre sans tarder les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, en février 2006.
Trois ans après, l'AIEA en est toujours au même point et on peut lire dans son rapport du 5 juin 2009 (GOV/2009/35) qu':
« il subsiste un certain nombre de questions en suspens, qui sont préoccupantes et doivent être clarifiées pour exclure une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien. (...) pour que l'Agence puisse s'occuper de ces points et progresser dans ses efforts pour donner des assurances quant à l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées en Iran, il est essentiel que l'Iran, notamment, applique le protocole additionnel, et fournisse les informations et accorde l'accès demandé par l'AIEA . L'Agence n'a toujours pas reçu de réponse positive de l'Iran en ce qui concerne ses demandes d'accès aux informations, à la documentation, aux emplacements ou aux personnes voulus ».
Il convient en deuxième lieu de relever que l'Iran ne possède aucune installation électronucléaire susceptible d'utiliser l'uranium enrichi à Natanz. La seule centrale électronucléaire iranienne qui sera bientôt en état de fonctionner est celle de Bushehr sur le Golfe persique. Elle devrait être opérationnelle à partir d'octobre 2009. Allemande à l'origine, cette centrale a été entièrement reconstruite par les ingénieurs russes et ne peut être alimentée que par des combustibles aux standards et selon les normes russes. L'uranium enrichi à Natanz ne sera pas utilisable.
En supposant que l'Iran ait des centrales nucléaires civiles capables d'utiliser l'uranium issu de l'usine de Natanz, il faudrait environ dix ans, avec 50 000 centrifugeuses IR-1 en fonctionnement dans cette usine, pour produire la quantité d'uranium enrichi nécessaire pour « charger » le coeur d'un seul réacteur. Ce temps pourrait être réduit si les centrifugeuses plus performantes en cours de développement en Iran étaient installées. Encore faudrait-il que Natanz, prévue pour abriter 50 000 centrifugeuses, fonctionne à plein régime. Or, pour l'instant, seules 4 592 centrifugeuses sont installées et fonctionnent. 3 716 autres seraient installées mais ne fonctionneraient pas encore 45 ( * ) . Avec 8 300 centrifugeuses de type IR-1, il faudrait environ 50 ans pour produire la charge d'uranium enrichi nécessaire à un réacteur civil.
Autant dire que l'usine de Natanz ne répond à aucune finalité ni économique ni technique d'autant qu'acheter le combustible nécessaire à la Russie (Rosatom) ou à la France (Areva) coûterait dix fois moins cher.
Le programme nucléaire iranien semble donc, à ce stade, dépourvu de toute utilité civile, si ce n'est d'assurer l'amorce d'un approvisionnement autonome d'uranium enrichi, quel qu'en soit le surcoût pour des centrales nucléaires qui restent à construire, et qui demanderait de toute façon la qualification du combustible correspondant pour être utilisé dans des centrales nucléaires civiles.
Le dernier indice de l'existence d'un programme militaire tient aux progrès accomplis par l'Iran dans le domaine des missiles balistiques.
Le lanceur spatial Safir-2, dernier né de la génération des lanceurs iraniens, a été lancé avec succès le 2 février 2009. Il a placé en orbite le satellite Omid à 258 km d'apogée. Ce résultat a montré la capacité de l'Iran à maîtriser la technologie de missiles balistiques à même d'atteindre n'importe quel Etat du Moyen-Orient. Par ailleurs, le 20 mai 2009, le Président Ahmadinejad a indiqué que l'Iran avait testé avec succès un missile Sejil-2 dont la portée est de 1 900 km.
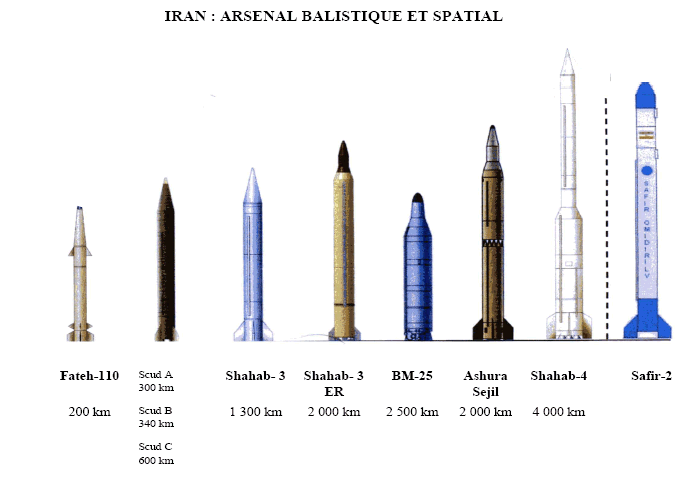
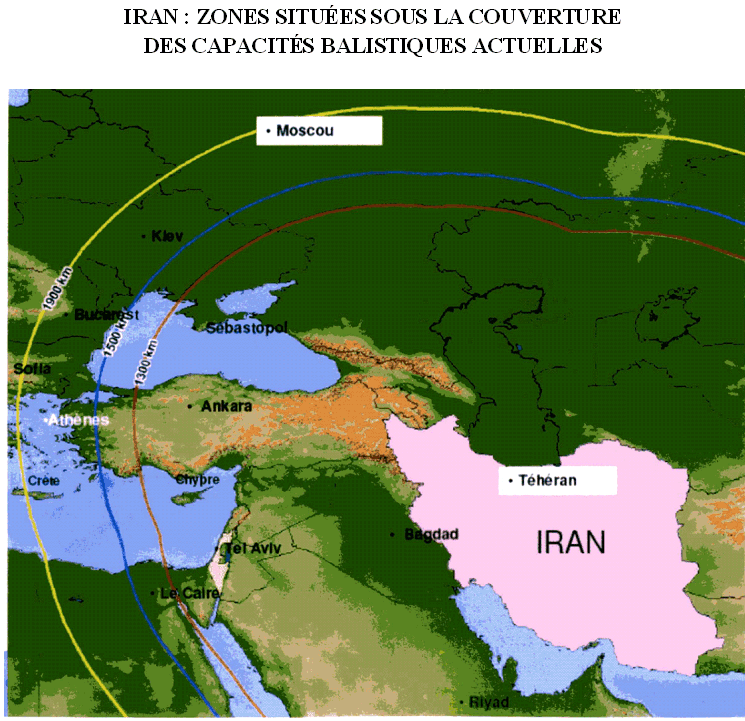
La convergence entre les activités d'enrichissement et les progrès accomplis dans les technologies balistiques sophistiquées plaide en faveur de l'existence d'un programme nucléaire militaire.
b- Une arme nucléaire dans combien de temps ?
Question essentielle mais complexe. Quelles sont les étapes à franchir par l'Iran pour produire des armes atomiques.
|
Concepts généraux sur les armes nucléaires Afin de réaliser une arme nucléaire de première génération, dite rustique, deux voies peuvent être empruntées permettant d'aboutir à une explosion par fission nucléaire (bombe A). Le choix de l'une ou de l'autre de ces voies influe sur la quantité de matière à rassembler, la complexité de la formule nucléaire à concevoir et à mettre en oeuvre et enfin la nécessité de procéder ou non à des essais. Le concept simple, dit à rapprochement (« gun type »), consiste à rapprocher deux masses sous-critiques de matière fissile, de manière à atteindre la masse critique et à déclencher l'explosion nucléaire par la simple action d'un flux neutronique. Ce concept nécessite une quantité significative de matière fissile, d'environ 50 kg d'uranium U235 hautement enrichi (UHE), c'est à dire à un taux de 90 %. La bombe aéroportée utilisée à Hiroshima mettait en oeuvre ce concept avec de l'U235 pour une énergie de l'ordre de 15 kT. Le concept plus sophistiqué, dit à implosion , consiste à densifier la matière fissile initialement sous-critique à l'aide d'un explosif chimique, de manière à atteindre la masse critique par implosion et à initier une réaction nucléaire. Ce concept peut être mis en oeuvre avec une quantité moindre de matière fissile, la quantité d'UHE retenue par l'AIEA étant d'environ 25 kg. La bombe aéroportée utilisée à Nagasaki mettait en oeuvre ce concept, mais avec du plutonium 239 et non de l'uranium, pour une énergie d'environ 21 kT. Quel que soit le concept utilisé, la réalisation d'une tête nucléaire militarisée de première génération demande la maîtrise de trois étapes clés : 1/ La disponibilité de la matière fissile : pour ce qui est de la voie à l'uranium, le processus de production de l'UHE comprend plusieurs étapes de l'extraction minière jusqu'à la mise en forme métallurgique afin de réaliser une charge nucléaire. L'étape la plus critique à franchir est l'enrichissement isotopique, pour lequel plusieurs procédés existent. Le procédé privilégié aujourd'hui pour enrichir l'uranium naturel (0,71 % en U235) utilise l'ultracentrifugation gazeuse à partir d'hexafluorure d'uranium (UF6). Les applications civiles à des fins énergétiques demandent un taux d'enrichissement allant jusqu'à 5%, sachant que le TNP autorise un taux d'enrichissement allant jusqu'à 20% pour des réacteurs de recherche. S'agissant de la voie du plutonium, il faut préciser que cette matière ne se prête pas à une utilisation dans une arme à rapprochement et seul un dispositif à implosion est envisageable. 2/ La mise au point d'une charge nucléaire fiable (ou « engin nucléaire ») demande de maîtriser les phases critiques de fonctionnement de la charge (détonation de l'explosif chimique, déclenchement du flux neutronique d'initiation de la réaction de fission), et la fabrication des sous-ensembles (explosif, matière fissile). Ensemble, ces données constituent ce que les experts appellent une formule nucléaire. Cette formule peut être acquise à partir de réseaux proliférants. L'utilisation opérationnelle d'une charge à rapprochement peut être envisagée sans expérimentation préalable de validation - l'utilisation sur Hiroshima de la bombe Little Boy à uranium enrichi n'avait pas été précédée d'un essai de validation. Pour le cas d'une bombe à implosion, une validation expérimentale préalable s'avère nécessaire - ce fut le cas avec la bombe Fat Man employée sur Nagasaki, testée préalablement dans le désert du Nouveau Mexique lors de l'expérience Trinity . Par ailleurs, les dispositifs de sûreté et de sécurité nucléaires prises par un Etat proliférant accédant à l'arme nucléaire peuvent être moindres que celles d'un Etat doté. 3/ La militarisation de la charge et son intégration dans un corps de rentrée (les deux formant, avec des équipements annexes, une tête nucléaire) doit répondre à plusieurs paramètres : le respect des conditions de masse et de volume imposées à la tête nucléaire pour garantir les performances du missile, le maintien des conditions thermiques et mécaniques acceptables par la charge nucléaire lors de son emport dans le missile et de la trajectoire de la tête nucléaire vers la cible. Cette démonstration de compatibilité entre la tête nucléaire et le missile peut être apportée en parallèle à la mise au point de la charge nucléaire et pendant la phase de mise au point du missile. Cependant, un Etat proliférant pourrait vouloir s'affranchir de cette phase de militarisation et d'intégration, en renonçant à un emport par missile balistique, au profit d'un largage par avion. A ces trois étapes nécessaires pour obtenir une tête nucléaire, il faut évidemment en ajouter une quatrième qui est l'assemblage de cette tête sur un missile , afin d'obtenir une arme nucléaire balistique. Ces étapes sont ainsi représentées de façon simplifiée :
Précisons encore que l'obtention d'une arme nucléaire balistique seule ne suffit pas à disposer d'un ensemble cohérent de dissuasion et qu'il faut pour ce faire disposer de plusieurs armes, susceptibles de pénétrer les défenses adverses, intégrées dans un système d'armes adapté (sites de lancement protégés, radars, etc...) |
1° La production de matière fissile
Concernant la voie de l'uranium enrichi, qui met en oeuvre le procédé d'ultracentrifugation, les étapes suivantes d'enrichissement sont envisageables pour produire de l'uranium enrichi de qualité « arme », si ce pays poursuit un objectif militaire :
- la première étape -enrichissement jusqu'à 5 %, limite de la finalité civile industrielle- peut être réalisée sur le site de Natanz ;
- une deuxième étape d'enrichissement jusqu'à 20 % (autorisée par le TNP pour les réacteurs de recherche) pourrait être réalisée également à Natanz ou sur un autre site de superficie beaucoup plus faible ; aucun site autre que Natanz n'est déclaré à ce jour.
La production d'uranium très enrichi pourrait être réalisée en 1 ou 2 étapes, soit sur un site non déclaré de taille plus réduite, avec environ 1 000 centrifugeuses de type IR1, soit sur le site de Natanz, l'Iran se mettant alors en position de rupture avec l'AIEA et la communauté internationale.
Le fait que seule l'usine du premier type ait été déclarée ne permet pas de conclure sur la présence ou l'inexistence d'autres usines. Compte tenu de leurs dimensions réduites, celles-ci peuvent être dissimulées soit sur le site même de Natanz, soit ailleurs, dans l'une des possibles installations du pays.
Concernant la voie du plutonium, elle concerne le réacteur d'Arak en cours de construction qui serait adapté à sa production . La mise en fonctionnement de ce réacteur n'est toutefois pas envisageable avant quelques années. Par ailleurs, l'Iran devrait ensuite disposer d'une installation de retraitement pour extraire le plutonium du combustible irradié. Aucune installation de ce type n'est à ce jour connue en Iran. La centrale nucléaire de Bushehr, actuellement en cours de chargement en combustible par la Russie, devrait être opérationnelle en 2010. Cependant, ce réacteur à eau légère pressurisée, par ailleurs sous contrôle de l'AIEA, semble mal adapté à la production de plutonium destiné à une arme.
2° La disponibilité de la quantité suffisante de matière fissile
Concernant la voie par « uranium enrichi », l'Iran avait produit début 2009, une tonne d'UF6 contenant environ 700 kg d'uranium enrichi à 3,5 %.. Une quantité de 1.430 kg a été obtenue en août 2009. Il est nécessaire de disposer de 1,6 tonne d'UF6 enrichi à 3,5 % pour pouvoir obtenir à terme 25 kg d'uranium enrichi à 90 %, quantité jugée nécessaire par l'AIEA pour réaliser une charge nucléaire de première génération à implosion. On peut donc considérer que l'Iran est tout proche d'avoir achevé la première étape d'enrichissement, si son objectif est militaire.
Pour réaliser les étapes ultérieures, et selon les informations dont disposent vos rapporteurs, il est possible de dire que si le programme se déroulait dans les meilleures conditions possibles (avec un taux de casse faible des centrifugeuses), l'Iran pourrait alors disposer de la quantité suffisante d'uranium hautement enrichi aux environs de l'été 2010, sous réserve qu'il ait déjà construit les usines correspondant aux autres étapes.
Concernant la voie par le plutonium, l'Iran ne dispose pas aujourd'hui d'installation connue en mesure de produire du plutonium.
3° La mise au point d'une charge nucléaire et sa vectorisation
Dès lors qu'il aurait produit la quantité suffisante d'uranium hautement enrichi pour réaliser une arme nucléaire, en ayant opté pour un concept à implosion (quantité d'UHE de 25 kg) et qu'il maîtrise la détonique (ce qui paraît vraisemblable), il ne faudrait que quelques mois à l'Iran pour disposer d'une charge nucléaire, soit à l'horizon de la fin de l'année 2010.
L'étape suivante, après un essai nucléaire de validation et de démonstration de sa capacité nucléaire, consisterait pour l'Iran en la vectorisation de sa charge, l'intégration à un missile balistique pouvant être privilégiée par ce pays à la confection d'une bombe larguée par avion, compte tenu des systèmes de défense qu'il aurait à franchir.
On peut considérer que le passage de l'étape de la charge nucléaire à celle de la tête nucléaire vectorisée peut ensuite s'effectuer en parallèle à la mise au point du missile et prendre de quelques mois à quelques années, selon le niveau des connaissances acquis par ce pays dans ce domaine.
L'étude à laquelle la mission a procédé l'a convaincue que l'Iran pourrait, à l'horizon de 18 mois, c'est-à-dire à la fin de 2010, disposer d'une arme nucléaire de la toute première génération. Encore faudrait-il que l'ensemble des étapes à franchir le soient de façon optimale. Il ne s'agirait que d'un seul « engin nucléaire », qui n'aurait fait l'objet d'aucun essai, et dont l'adaptation à un missile balistique n'aurait pas été démontrée.
Autant dire que l'Iran ne serait pas alors en mesure de faire la preuve de sa maîtrise de l'arme et ne pourrait donc pas s'en servir à des fins de dissuasion face à d'éventuels adversaires. Il faudrait qu'il dispose d'au moins deux « engins », ce qui exigerait un délai supplémentaire d'au moins un an et demi, soit en 2011-2012.
Il faudrait, en outre, que l'Iran :
• ait déjà construit les usines secrètes nécessaires pour produire de l'uranium hautement enrichi (UHE) ou qu'il reconfigure le site de Natanz au vu et su de l'AIEA ;
• ait développé en parallèle l'ensemble des techniques permettant la militarisation de l'arme.
La probabilité d'un tel scénario semble très faible.
Si on considère, au contraire, que l'Iran cherche à se doter d'un arsenal nucléaire, certes réduit, mais capable de dissuader un éventuel agresseur, il semble, après consultation de plusieurs experts français, que cette étape pourrait probablement être franchie aux environs de 2015.
Cette estimation ne diffère guère des autres études connues sur la question. Dans son rapport de 2008, la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des communes britannique a estimé que « la date la plus proche pour que l'Iran puisse produire suffisamment d'UHE pour une arme se situe à la fin de l'année 2009, mais que cela est très improbable. Nous considérons que l'Iran serait techniquement capable de produire suffisamment d'UHE entre 2010 et 2015 ».
Vos rapporteurs concluent donc que :
• rien ne permet aujourd'hui d'affirmer ou d'infirmer que l'Iran a un programme nucléaire militaire ;
• il y a, en revanche, de bonnes raisons de penser qu'il a bien cette ambition : caractère secret de son programme à ses débuts, impossibilité où se trouve l'AIEA d'effectuer les vérifications qui lui paraissent nécessaires, très faible rationalité économique et technique du programme en cours s'il est destiné à des fins pacifiques, convergence entre la maîtrise des technologies d'enrichissement de l'uranium et celle des missiles balistiques de longue portée ;
• dans l'hypothèse où l'Iran poursuivrait l'option militaire, il serait en mesure, dans le meilleur des cas, de disposer d'un premier « engin » nucléaire à la fin de l'année 2010 et d'un ensemble cohérent de dissuasion aux environs de 2015.
2. Quels dangers présenteraient l'accession de l'Iran à l'arme atomique ?
a- Une attaque israélienne sur les sites nucléaires
Un Iran nucléaire ne constituerait pas a priori une menace grave pour l'Europe ou pour les Etats-Unis.
La question, en revanche, se pose pour Israël. Compte tenu de l'exiguïté de son territoire, une seule arme nucléaire mettrait en péril l'avenir de l'Etat juif. On peut comprendre que ses dirigeants refusent de prendre le moindre risque et estiment que la destruction préventive des capacités nucléaires militaires iraniennes s'impose, comme ce fut le cas pour les capacités irakiennes en 1982 et syriennes en 2007.
Les déclarations des leaders iraniens n'ont pu que renforcer la perception de cette menace. L'ayatollah Khomeiny aurait déclaré en 1980 : « Nous ne vénérons pas l'Iran, nous vénérons Allah. Le patriotisme est le masque du paganisme. Je vous le dis : ce pays peut brûler. Je vous le dis : ce pays peut bien partir en fumée, du moment que l'Islam en ressort triomphant dans le reste du monde » 46 ( * ) . Il a fallu 500.000 morts iraniens avant que Khomeiny se décide à stopper la guerre avec l'Irak, qui aurait pu être arrêtée beaucoup plus tôt. L'ayatollah Khamenei a fait son éducation religieuse au séminaire de Mashad où on développe une interprétation ésotérique des textes sacrés et où l'on considère que la raison et la foi sont incompatibles. Le président Ahmadinejad a été influencé par le messianisme de l'ayatollah Mohammed Taqi Mezbah Yazdi. Même le discours des dirigeants iraniens réputés pragmatiques suscite des interrogations. La formule de Hashemi Rafsandjani, selon laquelle « l'emploi d'une seule arme nucléaire contre Israël détruirait tout sur cette terre (d'Israël), mais ne causerait que des dommages limités au monde musulman » 47 ( * ) incite à la méfiance.
A rebours, de nombreux spécialistes de l'Iran estiment que ses dirigeants, quelles qu'aient été leurs déclarations, sont prudents et nullement des va-t-en guerre. Il n'en reste pas moins que l'accession de l'Iran à un armement nucléaire n'irait probablement pas dans le sens de la stabilité.
Dans ce contexte, une attaque des forces armées israéliennes n'est pas invraisemblable. En ont-elles, seules, les moyens ou doivent-elles bénéficier du concours des forces américaines ?
Une récente étude du CSIS, think tank américain réputé, apporte à ce sujet un intéressant éclairage que vos rapporteurs ont confronté à leurs propres investigations 48 ( * ) .
Une réponse nuancée s'impose. Il est probable que, même si elles ne disposent pas des armes permettant de détruire à coup sûr des sites profondément enterrés, tels que Natanz 49 ( * ) , les forces aériennes israéliennes sont en mesure, seules, mais au prix, sans doute, de pertes significatives, de détruire Natanz, ou d'endommager sérieusement deux ou trois sites tels que Natanz, Arak et Isfahan.
En revanche, il est presque certain qu'Israël ne dispose pas des moyens de détruire, en un seul raid, l'ensemble des sites concourant au programme nucléaire iranien dont le nombre est trop important, et la protection trop bien assurée.
Une telle attaque retarderait donc le programme iranien de plusieurs années, mais ne le stopperait pas . D'autant que s'il s'agit bien d'un programme militaire, il est probable qu'un ou des sites cachés existent. Dans tous les cas, le savoir-faire technologique des ingénieurs iraniens ne pourrait pas être détruit.
Les représailles que Téhéran pourrait déclencher sont nombreuses et pénalisantes : blocage du détroit d'Ormuz, attaque contre certains Etats du Golfe, offensives du Hezbollah et du Hamas, tirs iraniens de missiles balistiques à charge conventionnelle contre le territoire d'Israël, etc. Toutefois l'Iran pourrait être tenté de limiter ses représailles pour ne pas donner aux Etats-Unis des raisons d'intervenir.
Une attaque israélienne provoquerait probablement la sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Celui-ci a pour objet de convaincre les pays de renoncer à l'arme nucléaire, en leur facilitant l'accès au nucléaire civil. Mais il est vrai que son intérêt a été sérieusement mis en doute depuis que l'Inde, le Pakistan et Israël ont montré qu'en n'adhérant pas au traité, ces pays ont pu se doter de l'arme nucléaire en échappant à tout contrôle de l'AIEA.
b- La prolifération nucléaire au Moyen-Orient et la fin du TNP.
L'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire déclencherait presque certainement la nucléarisation de la région. L'Arabie saoudite, l'Egypte et la Syrie chercheraient à suivre son exemple. Au-delà, la Turquie et l'Algérie pourraient lancer ou relancer des activités dédiées au nucléaire militaire.
L'Arabie saoudite , dont la diplomatie s'oppose le plus souvent à celle de l'Iran, ne manquerait pas de réagir. Le prestige que l'Iran tirerait, au sein du monde musulman, de la possession de l'arme nucléaire inciterait sûrement l'Arabie saoudite à ne pas le laisser franchir seul ce seuil stratégique. Pour l'instant, ce pays ne dispose que d'installations nucléaires limitées : l'Institut de recherche sur l'énergie atomique, créé en 1988, et le département d'ingénierie nucléaire de l'Université King Abdul Aziz fondé en 1977. Le pays dispose également de quatre laboratoires qui pourraient contribuer à un programme de production de plutonium de qualité militaire. En revanche, l'Arabie possède un nombre significatif de missiles chinois CSS-2 achetés en 1988. Ces missiles sont en état de fonctionner et peuvent emporter chacun une charge explosive de plus de deux tonnes. L'option la plus rapide et la plus efficace consisterait à conclure une alliance avec le Pakistan. Dès 2003, des responsables pakistanais évoquaient ouvertement la possibilité de mettre en place, avec l'Arabie saoudite, dans le domaine nucléaire, un mécanisme analogue à celui de l'OTAN. Certains experts 50 ( * ) font état d'un dialogue avancé entre les deux pays et les responsables pakistanais ne cachent pas que l'octroi d'une garantie de sécurité pakistanaise à l'Arabie saoudite est parfaitement envisageable.
L'Egypte a sans doute l'infrastructure et l'expérience les plus développées de la région dans le domaine nucléaire. Le pays dispose de deux réacteurs de recherche. Il possède également depuis 1998 deux installations fabriquant du combustible. Le centre de recherche d'Inshas aurait procédé à de nombreuses expériences non déclarées pouvant être utiles à la réalisation d'un programme militaire. En outre, Le Caire et Tripoli auraient coopéré dans ce domaine, jusqu'à l'arrêt du programme libyen en 2003. L'Egypte dispose donc de bases lui permettant de développer un programme nucléaire militaire et ses réserves de minerai lui donneraient une certaine autonomie. En 1998, le Président Hosni Moubarak avait déclaré que : « le moment venu, si nous avons besoin de l'arme nucléaire, nous n'hésiterons pas ». Si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, il est donc probable que l'Egypte « n'hésiterait pas ». Elle considère l'Iran comme un danger et s'inquiète, depuis que le Hamas contrôle Gaza, que l'Iran développe son influence à ses frontières. L'inimitié entre les deux pays ne s'est jamais démentie : ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques et le Gouvernement iranien vient d'autoriser la diffusion d'un film à la gloire des assassins d'Anouar El Sadate. Une capacité nucléaire saoudienne jouerait dans le même sens et l'on peut supposer que l'Egypte ne voudrait pas apparaître comme étant à la traîne dans le monde arabe. Il y va de sa fierté nationale. Il est vrai, cependant, que les finances de l'Egypte ne lui laissent guère de marge de manoeuvre, sauf à obtenir une participation financière des Emirats du Golfe.
La Syrie ne dispose que d'un programme nucléaire embryonnaire. Les deux centres de recherche créés près de Damas sont d'un faible niveau technique. Elle dispose, toutefois, d'importants gisements de phosphates dont elle peut extraire à grande échelle de l'uranium et elle a construit à cet effet, en 1996, une installation qui est opérationnelle depuis cette date. La découverte du réacteur d'Al-Kibar près de Dayr az Zawr a surpris la plupart des analystes. En avril 2008, l'administration américaine a présenté au Congrès et à la presse des documents montrant que le site détruit par l'aviation israélienne en septembre 2007 était un réacteur nucléaire, construit avec l'assistance de la Corée du Nord.
Si l'Iran se dotait de l'arme atomique, la prolifération nucléaire dans l'ensemble du Moyen-Orient constituerait un scénario probable qui signifierait la fin du TNP.
Les Etats-Unis et leurs alliés européens envisageraient sans doute d'offrir des garanties de sécurité aux pays arabes de la région mais ceux-ci hésiteraient à les accepter pour ne pas apparaître comme des protégés de l'Occident. Il ne s'agirait donc au mieux que d'une solution transitoire. Une fois l'Iran doté d'armes nucléaires, il sera difficile de convaincre les pays du Golfe et l'Egypte de ne pas suivre son exemple.
C. COMMENT CONVAINCRE L'IRAN DE NE PAS SE DOTER D'ARMES NUCLÉAIRES ET ÉVITER LA NUCLÉARISATION DU MOYEN-ORIENT ?
1. Le programme nucléaire iranien n'a pas pu être arrêté par la négociation
Les Etats-Unis ont déclaré que la nucléarisation de l'Iran était inacceptable et que, faute d'un arrêt de son programme d'enrichissement, « toutes les options étaient sur la table ». Les Etats-Unis n'ayant aucune relation avec l'Iran depuis l'occupation de son ambassade en 1979, c'est à l'Europe qu'il est revenu d'engager avec l'Iran un « dialogue critique ». Ce qu'elle fit à partir de 2003 en confiant à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne et à la France la mission de conduire une négociation au nom de l'Union européenne. Après plusieurs années d'efforts infructueux, l'Europe s'est décidée à transmettre le dossier iranien au Conseil de sécurité. Celui-ci a enjoint Téhéran d'interrompre son activité d'enrichissement. Faute de s'être conformé à cette injonction, le Conseil a décidé de lui imposer des sanctions, qui sont restées bénignes.
Parmi les raisons pour lesquelles l'Iran ne s'est pas rendu aux arguments et aux propositions européennes, il y a le fait qu'un consensus national iranien fort existe en faveur du programme nucléaire . De plus, les mécanismes de la prise de décision à Téhéran sont complexes. Le pouvoir est réparti entre plusieurs factions qui jouent leur propre jeu, de sorte qu'arrêter un programme aussi stratégique que le programme nucléaire se heurte à des obstacles difficilement surmontables.
2. Il est peu probable que le programme nucléaire iranien puisse être arrêté par la force
L'hypothèse d'une destruction des sites par une attaque aérienne a été étudiée par les Etats-Unis et présentée comme une « solution » possible pendant le mandat de Georges W. Bush. Au début de 2005, le journaliste américain Seymour M. Hersh a révélé que le Gouvernement américain continuait de privilégier l'option militaire et avait entrepris de localiser l'ensemble des sites de production iraniens. Pourtant le Président Bush a renoncé à une attaque qui ne semble pas non plus être envisagée par le Président Obama.
En Israël non plus, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, rien n'est décidé. La position officielle est claire : un arsenal nucléaire iranien constitue pour le pays un risque « existentiel ». Pourtant, il y a deux écoles sur le sujet. L'une se résignerait à la prolifération nucléaire et mettrait l'accent sur les futurs équilibres stratégiques. L'autre est résolue à stopper l'Iran quoiqu'il en coûte. Vos rapporteurs ont rencontré, au sein des think tanks israéliens, des représentants de chacune de ces deux écoles.
Une partie du débat en Israël porte non pas sur la faisabilité d'une attaque, mais sur son opportunité eu égard aux représailles auxquelles il faudrait s'attendre de la part de l'Iran. Dans cette perspective, les forces armées israéliennes ont, selon toute vraisemblance, renforcé la capacité de frappe en second de leur force de dissuasion : nucléarisation des missiles Harpoon tirés à partir de sous-marins Dolphin -durcissement des silos etc... La défense antibalistique a elle aussi été modernisée par la mise en oeuvre de systèmes anti-missiles américains de type Arrow 2 et Arrow 3 .
3. Seule reste la voie des sanctions
Il faut bien admettre que les sanctions économiques décidées à cinq reprises par le Conseil de sécurité, mais restées relativement inoffensives, n'ont eu pour l'instant aucun effet sur le comportement de l'Iran. Le soutien de l'Iran au Hezbollah n'a pas cessé, la fatwa contre Salman Rushdie n'a pas été rapportée et le protocole additionnel au TNP n'a toujours pas été ratifié, ni appliqué, laissant l'AIEA à ses interrogations. Pour que l'Iran envisage de reconsidérer sa position, il faudrait que l'Allemagne, l'Italie et la France, mais aussi la Russie et la Chine, acceptent de mettre en place des sanctions plus lourdes. Seraient-elles efficaces ? On peut en douter. Les cas de Cuba et de l'Irak n'ont-ils pas montré que les embargos pénalisent les populations mais n'ébranlent pas les régimes ?
Mais alors, comment convaincre le régime iranien de renoncer à son ambition nucléaire militaire ? Le régime iranien, comme la plupart des dictatures, a besoin de crises extérieures pour échapper à ses problèmes intérieurs. Il nourrit son emprise des menaces qui lui sont adressées.
La perspective d'un Iran nucléaire ne saurait, en soi, nous effrayer . Il n'y a pas de raison de penser que la dissuasion ne fonctionne pas à son égard comme elle a toujours fonctionné. Les dirigeants iraniens détestent l'Occident et Israël. Mais ils tiennent à leur pays, à leur pouvoir et sont des gens rationnels.
En revanche, la nucléarisation de l'Iran entraînerait celle de l'entière région et cela serait une menace pour la paix dans le monde.
C'est pourquoi, il faut s'apprêter à renforcer les sanctions, en étroite coopération avec la Chine et la Russie .
Les sanctions, pour modestes qu'elles aient été, ont eu des effets pénalisants pour la population et les réactions suscitées par la falsification des résultats des dernières élections présidentielles ont montré l'ampleur du mécontentement populaire.
Ahmadinejad ne doit d'avoir résisté à la fureur populaire qu'au soutien que lui accorde le Guide suprême et à la poigne de fer des pasdarans et des basidj ainsi qu'au réseau clientéliste qu'il entretient avec assiduité.
En tendant la main au pouvoir iranien et en déclarant, dans son discours du Caire, que les Etats-Unis étaient prêts à engager avec l'Iran un dialogue global, sans conditions préalables, le Président Obama a fait un geste significatif. Cette approche coïncide et renforce celle de l'Europe. Elle devrait permettre de vérifier d'ici la fin de 2009 si la politique d'ouverture a quelques chances de succès.
S'il n'en était pas ainsi, le moment serait venu de prendre à l'encontre de l'Iran des sanctions vraiment efficaces. Il en est une qui répondrait à ce critère : l'embargo sur les livraisons de pétrole raffiné, notamment d'essence. L'Iran importe 40 % de l'essence dont sa population est grande consommatrice. Le rationnement instauré par le Gouvernement pendant l'été 2007 avait provoqué émeutes et violences, à telle enseigne que les autorités furent obligées de faire précipitamment machine arrière. Il y a toutes raisons de penser qu'un arrêt plus ou moins complet des livraisons de produits pétroliers raffinés à l'Iran inciterait le pouvoir à la réflexion. Une telle mesure devrait être concertée avec les puissances pétrolières du Golfe pour limiter l'impact sur le marché mondial des probables représailles iraniennes en matière de livraisons de brut. Pour s'assurer de l'efficacité de cette politique, il est impératif d'y associer la Chine et la Russie.
CHAPITRE III - LES FRAGILITÉS
Outre les fragilités d'ordre général évoquées dans le chapitre premier, trois zones de fragilités existent au Moyen-Orient. La première concerne le Yémen. Occupant une position stratégique entre la Corne de l'Afrique et l'Orient arabe permettant de contrôler le détroit de Bab-el-Mandeb , ce pays n'est pas encore un Etat failli. Mais il est en passe de le devenir. Son président n'a d'autorité que sur Sanaa, sa capitale. Sa population est au bord de la famine. Son relief de hautes vallées encaissées sert de refuge à des membres d'Al-Qaïda et son armée affronte pour la sixième fois une rébellion coriace dans le nord. La deuxième fragilité résulte, bien sûr, de la situation en Irak. Est-ce que ce pays restera uni après le départ des forces américaines ? Enfin, les élections du 7 juin 2009 au Liban ont marqué la victoire du camp pro-occidental du 14 mars. Cette victoire, dont on peut se réjouir, ne doit pas masquer l'importance du confessionnalisme dans ce pays et l'impossibilité d'en dépasser les clivages.
I. L'ANARCHIE AU YÉMEN
Le Yémen est l'homme malade de la péninsule arabique. Idéalement situé au sud de l'Arabie saoudite et à l'ouest du sultanat d'Oman, sur un territoire d'une taille équivalente à celui de la France, il est, avec 24 millions d'habitants, le pays le plus peuplé, mais aussi le plus pauvre de la péninsule arabique.
Il dispose néanmoins de quelques atouts : un peu de pétrole et de gaz ainsi qu'un potentiel touristique et culturel important. L'ancienneté de sa civilisation, la beauté de ses paysages, le charme de son urbanisme et l'hospitalité de ses habitants font de lui un pays captivant et lui ont valu dans l'antiquité le nom d'Arabie heureuse : Arabia felix.
Pourtant ce pays a raté le train du développement et souffre de problèmes endémiques tels que la corruption, la mauvaise administration, le manque d'eau et la surconsommation du qat, cette drogue qui anesthésie la population et la rend léthargique.
A. LES SIX PLAIES DU YÉMEN
1. L'absence d'Etat et une réunification manquée
On parle souvent du Yémen comme d'un Etat failli. Or, il n'y a pas eu un Yémen, mais deux Yémen. Celui du Nord, des hauts plateaux où la géographie et les rivalités tribales favorisent l'émiettement et se prêtent à la guérilla. Celui du Sud, dont Aden est le port sur l'océan Indien et qui a toujours aspiré à l'indépendance. Celui-ci comprend l'Hadramaout, berceau de la famille Ben Laden, qui prolonge géographiquement le désert d'Arabie saoudite.
A cette diversité géographique se superpose une division historique. La partie septentrionale du Yémen fit partie de l'Empire ottoman jusqu'en 1918. La monarchie, ou Imamat, y fut abolie en 1962, date à laquelle le pays prit le nom de République arabe du Yémen. La partie méridionale correspond à l'ancien hinterland britannique formé progressivement, à partir de 1839, autour du port d'Aden. Après le départ des troupes britanniques en 1967, un État indépendant vit le jour, qui prit le nom de République démocratique populaire du Yémen et se rangea dans le camp soviétique.
Le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen fusionnèrent pour former la République du Yémen. A peine formé, le Yémen soutint l'Irak durant la première Guerre du Golfe, ce qui lui valut des représailles de la part des Etats-Unis et surtout de l'Arabie saoudite qui expulsa de son royaume un million de travailleurs yéménites.
L'unification des deux régions fut un échec. Les nordistes abusèrent de leur pouvoir et mirent en coupe réglée les populations du sud. En 1994, le Yémen du Sud tente vainement de faire sécession sous le nom de "République démocratique du Yémen", avant de retomber sous la coupe du Gouvernement de Sanaa. Les cicatrices de la division n'ont toujours pas disparu.
2. La mauvaise administration
L'appareil d'Etat est miné par une corruption généralisée, alors que les élites se constituent des avoirs à l'étranger. Néanmoins, des réformes ont été entreprises. Un comité national anti-corruption, directement rattaché au Chef de l'État, a été créé ; la justice a été réformée et une loi sur les marchés publics visant à moraliser la gestion des appels d'offres a été adoptée. La fonction publique a par ailleurs été reprise en main et un recensement des fonctionnaires a été effectué afin d'identifier ceux d'entre eux, apparemment nombreux, qui multiplient les emplois fictifs pour augmenter leurs revenus. Rien n'y a fait. Le Yémen demeure, pour l'essentiel, une vaste zone de non-droit.
3. Un retard de développement
Le Yémen se distingue du reste de la péninsule arabe par un important retard en termes de développement humain. Sa croissance démographique est alimentée par une fécondité particulièrement élevée (6,8 enfants par femme en 2005) et l'analphabétisme touche 30 % des hommes et 71 % des femmes. Près d'un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. La très grande pauvreté touche une large fraction de la population. 42 % des Yéménites vivent avec moins de deux dollars par jour. Des situations de sous-nutrition et non plus seulement de malnutrition ainsi que des maladies endémiques sont fréquentes.
4. Une économie fragile
L'économie du Yémen repose sur trois piliers :
- le pétrole qui, avec 312 000 barils/jour en 2007, fournit la plus grande partie des ressources et qu'exploite la compagnie française Total. Elle est le plus gros investisseur du pays au travers du consortium gazier Yémen LNG ;
- l'agriculture : la surface agricole utile est importante et de bonne qualité. Malheureusement, 60 % des ressources en eau sont utilisées pour la culture du qat qui représente un tiers de la production agricole ;
- les transferts d'argent des nombreux travailleurs yéménites émigrés.
Par ailleurs, le Yémen bénéficie d'une aide internationale significative, notamment sous forme de rééchelonnements et d'annulations de dette.
5. L'insécurité
Le Yémen a fait preuve de laxisme vis-à-vis des mouvements islamistes qui trouvaient sur son sol un appui logistique et un refuge pour leurs camps d'entraînements. Son relief montagneux, la perméabilité de sa frontière avec l'Arabie saoudite, la proximité de la Somalie et du Soudan en font un refuge idéal.
Mais les réactions de l'Occident à la montée de l'insécurité ont obligé le Gouvernement yéménite à réagir. L'émergence d'Al-Qaïda et l'origine yéménite d'Oussama Ben Laden, les attentats du 11 septembre 2001, l'agression contre le destroyer USS Cole le 12 octobre 2000 et contre le pétrolier français Limburg le 6 octobre 2002 dans le port d'Aden, ont modifié l'approche du Président Saleh. Sous la pression des Occidentaux et en particulier des Américains, celui-ci a pris conscience de la nécessité de lutter contre le terrorisme islamique de façon plus efficace. Pour autant, le pouvoir yéménite doit ménager une opinion publique très conservatrice et acquise aux thèses islamistes.
Par ailleurs, une grave rébellion a éclaté en juin 2004 dans la région montagneuse de Saada, au nord du pays. Cette rébellion était menée par un chef religieux zaydite (une des branches du chiisme), Hussein Badr ed-Din Al-Houti, qui a été tué en septembre 2004 et remplacé par son frère Abdelmali Al-Houti. Pendant deux mois les forces gouvernementales ont affronté les rebelles, causant la mort de près de 2 000 combattants de part et d'autre. Malgré de nouveaux combats en 2005, 2007 et 2008, le Gouvernement central n'a non seulement pas rétabli son autorité sur cette région qui reste aux mains des rebelles houtistes, mais ces derniers auraient réussi à ouvrir de nouveaux fronts en s'alliant à des tribus des gouvernorats d'Amran, du Jawf et de Sanaa. Le conflit aurait entraîné le déplacement d'une centaine de milliers de personnes.
Le mouvement houtiste est d'origine tribale et reflète la volonté de défendre la spécificité du zaydisme face au développement par le régime du Président Saleh d'un Islam d'Etat perçu comme uniformisé et à connotation sunnite (même si le Président Saleh est lui-même zaydite).
6. L'isolement d'avec les autres pays du Golfe
Le Yémen a payé cher ses positions pro-irakiennes pendant la première guerre du Golfe en 1990 et son instabilité chronique depuis la réunification. Le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCEAG) n'a jamais accepté qu'il en devienne membre et ses relations avec l'Arabie saoudite sont restées empreintes de méfiance.
Cette situation s'est en partie améliorée après qu'en juin 2000 le Yémen eut signé avec l'Arabie saoudite un traité délimitant leur frontière commune. Le tracé de celle-ci a été arrêté définitivement en 2006. Cette normalisation constituait pour Saana la condition de sa réinsertion régionale et le versement des subsides qui lui sont alloués par son puissant voisin et les Etats du Golfe.
Lors du 22 ème sommet du CCEAG en 2001, le Yémen a été admis dans certaines instances de coopération technique de l'organisation (santé, éducation, travail et affaires sociales, sport). Décision heureuse mais limitée dans les retombées qu'elle comporte pour le Yémen, même si on peut y voir un signe encourageant de l'intérêt que les pays du Golfe lui portent. Une adhésion pure et simple au CCEAG n'en demeure pas moins, pour l'instant, une perspective improbable du fait de l'insécurité qui règne au Yémen et dont ses voisins craignent la contagion.
B. UN FOYER D'INSTABILITÉ QU'IL FAUT AIDER AU PLUS VITE
Le Yémen est un inquiétant foyer d'instabilité dans la péninsule arabique et constitue avec la Somalie, située de l'autre côté du détroit de Bab-el-Mandeb , une zone économiquement sinistrée qui tend à échapper à toute légalité internationale.
Les mesures prises pour consolider l'Etat ne semblent pas à la hauteur du danger.
1. Un foyer d'instabilité
Depuis la fin de 2005 la situation s'est beaucoup dégradée. Des groupes de touristes suisses, allemands, italiens, coréens, ont été retenus en otage pour servir de monnaie d'échange dans les négociations entre certaines tribus et les autorités gouvernementales. Quatre touristes français ont été pris en otage en septembre 2006 puis relâchés.
Des attentats à la voiture piégée ont visé des sites pétroliers près de Marib et de Mukalla en septembre 2006. Un attentat suicide à la voiture piégée a tué sept touristes espagnols et deux Yéménites près de Marib en juillet 2007. Depuis, la liste des attentats s'est allongée, jusqu'à l'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis à Sanaa, le 17 septembre 2008, qui a fait seize morts. Une cellule d'Al-Qaïda a été démantelée en août 2008 et une trentaine de membres présumés de l'organisation ont été arrêtés. Il est intéressant de relever que les Yéménites forment le plus important contingent de détenus à Guantanamo : 96 sur 240.
Par ailleurs, l'irrédentisme est toujours vivant dans le sud du pays. Pour la population de cette région, la réunification est perçue comme une annexion et la présence des « nordistes » assimilée à une occupation. Nombre de fonctionnaires et de militaires originaires du sud ont été licenciés et remplacés par des cadres civils ou militaires originaires du nord dont la corruption est notoire. La population du sud se juge spoliée de ses terres et reproche aux dirigeants du nord d'accaparer les revenus tirés des ressources naturelles du sud. Le mécontentement déboucherait vraisemblablement sur une nouvelle sécession, si les forces de sécurité yéménites ne contrôlaient pas, souvent brutalement, Aden et sa région.
La conjugaison de ces différents facteurs et l'insécurité qui en résulte font du Yémen un havre idéal pour les jihadistes : un Etat faible, des tribus puissantes enclines à abriter des activistes au nom de l'hospitalité, un relief de hautes montagnes où les forces régulières hésitent à s'engager. Les similitudes avec l'Afghanistan sont frappantes.
Deux des jihadistes saoudiens les plus recherchés ont été arrêtés en mars 2009 près de Taez, au sud de Saana. Une centaine d'autres sympathisants jihadistes saoudiens recherchés par les autorités de Ryad se sont vraisemblablement repliés au Yémen.
La menace islamiste a été pendant un temps neutralisée par un programme de réhabilitation de près de 400 sympathisants yéménites d'Al-Qaïda. Mais selon certaines sources 51 ( * ) , ce programme aurait surtout permis aux autorités de sceller un pacte avec les jihadistes aux termes duquel ces derniers s'engageaient à ne pas commettre d'attentats au Yémen, en contrepartie de quoi le Gouvernement fermerait les yeux sur leurs agissements à l'extérieur du pays. Compromis qui a profondément indisposé les autorités américaines, déjà excédées en 2007 par la libération d'un des cerveaux de l'attentat contre l'USS Cole.
En janvier 2009, l'une des branches d'Al-Qaïda au Yémen a annoncé la création d'Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) -née de la fusion des branches saoudiennes et yéménites du mouvement.
2. Comment aider le Yémen ?
La capacité des Occidentaux à aider le Yémen est limitée et les Saoudiens sont fatigués de verser de l'argent à un régime aussi corrompu. Les pays du Golfe s'en soucient peu et préfèrent importer de la main d'oeuvre du Pakistan et de l'Inde plutôt que d'ouvrir leurs frontières aux travailleurs yéménites. Lors de la réunion à Londres, en novembre 2006, du groupe consultatif de la Banque mondiale sur le Yémen, des promesses d'aide de l'ordre de 5,3 milliards de dollars, confirmées lors de la réunion de suivi du 4 février 2008, ont été faites pour la période 2007-2010. L'Arabie saoudite s'est engagée à hauteur d'un milliard de dollars, le Qatar pour 500 millions, de même que les Emirats Arabes Unis. Les pays européens ont participé à l'effort général. La situation n'en reste pas moins préoccupante et incite à reconsidérer la politique d'aide à ce pays.
A défaut d'une intégration véritable du Yémen au sein du CCEAG, que ses membres ne semblent pas prêts à envisager, il serait souhaitable que ces pays ouvrent leurs portes aux travailleurs yéménites. Les puissances occidentales pourraient s'engager dans la mise en oeuvre de projets visant à consolider l'Etat : construction d'écoles, routes, formation de policiers et de fonctionnaires. En contrepartie, les donateurs pourraient tenter d'imposer une solution négociée à la rébellion houtiste et déployer des observateurs dans le sud afin d'y assurer un meilleur respect des libertés publiques.
Afin de mettre en oeuvre une stratégie d'ensemble, une nouvelle conférence internationale pourrait être organisée. Le potentiel de développement de ce pays n'est pas négligeable, notamment dans le domaine du tourisme, mais exige au préalable le rétablissement d'un minimum de sécurité.
II. LA RENAISSANCE DE L'IRAK
En janvier 2002, dans le discours sur l'Etat de l'Union, Georges Bush accusa les Etats de « l'axe du mal », Iran, Irak, Corée du Nord, d'être les instigateurs du terrorisme international dont l'Amérique avait été la cible lors des attentats du 11 septembre 2001 contre New York et Washington. Deux ans plus tard, le 19 mars 2003, les troupes américaines envahissaient l'Irak. En trois semaines, l'armée irakienne était mise en déroute et Bagdad occupée sans coup férir.
On s'est beaucoup interrogé sur les motifs qui poussèrent Bush et ses conseillers à se lancer dans une opération qui se transforma très vite en un sanglant bourbier. Les raisons mises en avant sont multiples : afficher aux yeux du monde la puissance des Etats-Unis après l'humiliante tragédie du 11 septembre 2001, informations erronées des services de renseignements américains concernant l'existence et la production d'armes de destruction massive, perspective d'une victoire rapide et peu coûteuse en vies humaines sur le régime dictatorial et impopulaire de Saddam Hussein.
Ces mobiles n'eussent sans doute pas suffi si l'invasion n'avait eu un objectif plus ambitieux : faire de l'Irak la première démocratie du monde arabe, appelée à servir d'exemple et de modèle pour le reste de la région. Projet présomptueux, inspiré à l'administration Bush par les doctrinaires de l'école néo-conservatrice américaine.
A. L'INVASION DE L'IRAK : UNE TRAGIQUE ERREUR
L'utopie -car c'en était une- se fracassa en quelques mois, au contact des réalités irakiennes. Le soulagement consécutif à la chute du dictateur et de son régime fut, en effet, de courte durée. L'armée américaine fut très vite perçue non comme libératrice mais comme une force d'occupation. La résistance s'organisa. Le 19 août, à peine six mois après l'intervention américaine, un camion piégé détruisit les locaux de l'ONU à Bagdad, tuant un des fonctionnaires les plus respectés de l'organisation, Sergio De Mello.
Il est vrai que les décisions prises par le premier administrateur américain nommé par le Pentagone, M Paul Bremer, furent catastrophiques. En licenciant sans solde ni retraite l'ensemble des officiers et sous-officiers de l'armée irakienne et en écartant de toute responsabilité l'encadrement du parti Bass, il jeta dans l'insurrection un réservoir d'hommes expérimentés, aguerris, déterminés, que les Etats-Unis mirent près de cinq ans à éliminer ou à rallier. L'insurrection prit rapidement de l'ampleur. Plusieurs éléments expliquent son extension et la férocité qu'elle revêtit.
Essentiellement anti-américaine pendant les premiers mois de l'occupation, elle prit rapidement un caractère interconfessionnel, opposant la minorité sunnite (20 % de la population) à la majorité chiite (60 %).
En créant l'Irak à la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'était appuyée sur les élites sunnites. Elle respectait la hiérarchie propre au monde bédouin où les communautés de paysans sont soumises à la loi et à la protection des seigneurs du désert, les grands chameliers sunnites.
Or, la mise en place d'institutions démocratiques donnèrent le pouvoir à ceux qui en avait été exclus, les chiites, qui constituaient 60 % de la population. Du coup, la communauté sunnite, estimant qu'elle n'avait rien à perdre, accorda un soutien tacite à la résistance armée des insurgés sunnites. Principalement concentrée dans le centre du pays alors que les gisements pétroliers sont situés soit au sud, en zone chiite, soit au nord, en pays kurde, les sunnites se voyaient, du jour au lendemain, non seulement politiquement mais économiquement marginalisés.
Ben Laden et son état-major, chassés d'Afghanistan par l'armée américaine à la fin de 2001, estimèrent que la situation en Irak leur était favorable et offrait l'occasion d'une sanglante revanche. Dirigé par un transfuge jordanien, Abou Moussab Al-Zarkaoui, « Al-Qaïda en Mésopotamie » (AQM) lança un grand nombre d'attentats-suicides contre les forces américaines, contre des sanctuaires chiites et, à l'aveugle, contre la population civile : marchés, mosquées, fêtes religieuses, mariages, enterrements, etc. étaient visés. Il s'agissait pour Al-Zarkaoui de dresser les deux communautés, chiite et sunnite, l'une contre l'autre.
Des milices confessionnelles privées sont apparues. La plus importante est l'armée du Mahdi, constituée à l'appel d'un jeune imam, Moktada Al-Sadr, fils et petit-fils d'ayatollahs illustres, assassinés par Saddam Hussein. Elle a compté jusqu'à 90 000 hommes et a contrôlé d'une main de fer un vaste quartier de la capitale, baptisé Sadr City.
Bagdad devint le champ clos de sanglants règlements de comptes quotidiens : attentats à la voiture piégée, explosifs dissimulés au bord des routes, attentats suicides, exécutions sommaires, enlèvements suivis de décapitations, rien n'a manqué pour transformer l'Irak en un inextricable enfer dans lequel l'armée américaine perdit jusqu'à plus de cent soldats par mois. De sorte que l'opinion publique aux Etats-Unis, qui avait, à l'origine, soutenu l'invasion, se mit à douter avant d'exiger, à partir de 2006, le rapatriement des GIs.
L'invasion de l'Irak n'avait pas seulement profondément détérioré l'image des Etats-Unis au Moyen-Orient et dans l'ensemble du tiers-monde, elle avait aussi provoqué une grave crise transatlantique. La France avait rejoint l'Allemagne dans son opposition à l'invasion. Paris estimait qu'une intervention ne se justifierait que si des armes de destruction massive étaient découvertes par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et si l'opération recevait l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU.
Or, ni l'une, ni l'autre de ces conditions n'était remplie lorsque Georges Bush donna l'ordre aux troupes qu'il avait massées aux frontières de l'Irak d'envahir le pays.
Malgré d'intenses et longues recherches, aucune arme de destruction massive ni aucun site de production ne fut mis à jour. L'invasion, entreprise sans autre but que d'éliminer Saddam Hussein et de changer de régime ne pouvait qu'exacerber l'hostilité du monde arabe et alimenter un extrémisme anti-occidental.
C'est précisément ce que redoutaient la France et l'Allemagne. A l'insécurité générale ne tarda pas, en effet, de s'ajouter un autre péril : l'éclatement du pays en trois communautés ethno-confessionnelles dressées les unes contre les autres : kurdes au nord, sunnites au centre, chiites au sud. A Bagdad même, dans les zones mixtes, on assista à des « nettoyages », qui rendirent les quartiers peu à peu ethniquement homogènes.
B. LA STABILISATION 2007-2009
Au début de 2007, la situation, qui n'avait cessé de s'aggraver, paraissait s'orienter vers une guerre civile inter-confessionnelle. Or, c'est à partir de la deuxième moitié de 2007, que le cours de l'histoire commença à s'inverser. Un processus de stabilisation se développa sur un triple plan : sécuritaire, politique et national.
1. La stabilisation sécuritaire
Les indications données tant par les autorités irakiennes que par le commandant en chef américain, le général Raymond T. Odierno, avec qui la mission a pu s'entretenir dans son bureau installé au Camp Victory , dans un des somptueux palais construits par Saddam Hussein, où l'état-major américain a pris ses quartiers, convergent. Quatorze provinces sur les dix-huit que compte l'Irak sont désormais considérées comme sécurisées. Quatre ne le sont pas encore, mais seraient en bonne voie de le devenir. Elles sont situées au nord et à l'est du pays. Il s'agit principalement de Mossoul et sa région et de la province de Diyala, frontalière avec l'Iran. A Bagdad, le chiffre des morts est passé de cent à dix par jour.
D'où vient cette amélioration aussi spectaculaire qu'inattendue ? Deux raisons principales l'expliquent.
En premier lieu, le renforcement du dispositif militaire américain. Les 30 000 soldats supplémentaires déployés en Irak, dans le cadre du surge , (le sursaut) décidé par George Bush, permirent d'occuper durablement les zones d'où les insurgés avaient été chassés, empêchant qu'ils ne s'y réinstallent comme ils en avaient pris l'habitude. Ces nouveaux effectifs permirent aussi la reconquête de Bagdad et sa pacification. Moktada Al-Sadr dut quitter la capitale après que son « armée du mahdi » eut été défaite par les forces américaines.
Un deuxième facteur, sans doute le plus important, explique le retournement de la situation : le ralliement aux Américains des principales tribus sunnites. Insupportées par les attentats aveugles contre la population civile perpétrés par Al-Zarkaoui, elles changèrent de camp, contraignant « Al-Qaïda », en Mésopotamie, à abandonner les zones où elle s'était implantée. Les tribus qui se mirent au service des Etats-Unis obtinrent une solde de 300 $ par homme et par mois. De sorte que l'armée américaine disposa d'une force nombreuse de supplétifs.
Une partie du mérite de l'opération revient au commandant en chef américain de l'époque, le général Petraeus. C'est à son initiative que les tribus sunnites créèrent des « conseils de réveil », les Sahwas, qui rassemblent aujourd'hui à peu près 100 000 hommes armés et rémunérés par les Etats-Unis.
2. La stabilisation politique
L'Irak n'avait jamais connu d'élections démocratiques. Or, les élections provinciales de janvier 2009 furent les cinquièmes tenues depuis 2003. Toutes se sont déroulées dans des conditions qui, malgré l'insécurité, n'ont pas été contestées et moyennant une participation qui s'est constamment maintenue aux alentours de 50 %.
Le Parlement, (l'Assemblée du peuple), est une enceinte vivante, voire passionnée. Une partie des affrontements qui ensanglantaient les rues de Bagdad se déroulent désormais au Parlement où se nouent les alliances post-électorales nécessaires à la constitution de majorités de Gouvernement. La communauté chiite, qui avait créé un front commun, s'est rapidement divisée en trois factions : le Conseil Supérieur Chiite en Irak (CSCI), alliance religieuse proche de l'Iran dirigée par le chef d'une grande famille chiite, Al Hakim, le parti Dawha, animé par le Premier ministre qui est sorti vainqueur des élections des janvier 2009 et les Sadristes, dirigés par Moktada Al-Sadr. La division des chiites a nécessité et permis la formation de majorités rassemblant chiites, sunnites et kurdes.
3. La stabilisation nationale
On assiste, depuis la mi-2008, à la résurgence d'une conscience nationale qui se superpose, sans les faires disparaître, aux fidélités ethno-confessionnelles. Cette heureuse évolution est, dans une large mesure, l'oeuvre du Premier ministre, Nouri Al-Maliki, qui a peu à peu acquis une dimension et une aura nationales. Il a fait campagne lors les élections de janvier 2009 sur les thèmes de l'Etat de droit et de l'identité irakienne et le succès qu'il a remporté témoigne de l'écho positif que ces thèmes suscitent dans l'opinion.
Né en 1950 dans une petite ville rattachée à la province de Kerbala, Nouri Al-Maliki est le petit-fils d'un ministre de l'Education en fonction sous la monarchie, en 1925. Il fit des études de théologie chiite et de langue arabe. Plusieurs membres de sa maison et de sa tribu furent arrêtés et pendus par le régime de Saddam Hussein. Lui-même dut fuir en 1979, d'abord vers l'Iran où il résida cinq ans, puis à Damas où il s'installa jusqu'à la chute de Saddam Hussein. Al Maliki avait très tôt rejoint le parti chiite minoritaire, le Dawha. De culture tribale, il n'est pas un bon orateur et ne paraît pas doué d'un grand charisme personnel. Mais il s'est présenté avec un succès croissant comme le Premier ministre de tous les Iraniens, n'hésitant pas, bien que chiite, à s'attaquer à l'armée du Mahdi tant à Bagdad qu'à Bassora. Il montra ainsi qu'il pouvait transcender son appartenance confessionnelle au service de l'unité du pays. Ceci ne l'empêche pas de rester tributaire de ses alliés politiques chiites, souvent encombrants, et d'être soupçonné par les sunnites d'être un dirigeant chiite déguisé. L'assurance et l'autorité dont il a fait preuve dans la longue et dure négociation de l'accord de retrait des forces américaines ont, elles aussi, contribué à faire de lui le leader national, défenseur de la souveraineté et de l'indépendance de l'Irak que l'opinion attendait. Choisi, au départ, en raison de son apparence effacée et du faible appui que pouvait lui apporter son parti politique, le Dawha , minoritaire dans la communauté chiite, Al Maliki s'est imposé dans l'exercice de ses fonctions par l'assurance et le courage dont il a fait preuve, au point de se voir aujourd'hui reprocher son autoritarisme.
C. LES CONSÉQUENCES DU DÉPART DES AMÉRICAINS
On aurait tort de conclure, au vu des progrès accomplis depuis l'été 2007, que la renaissance de l'Irak est un fait accompli. Une épreuve majeure attend, en effet, le pays : le retrait des forces américaines dont la présence aux cotés des forces irakiennes dans la lutte contre l'insurrection explique l'essentiel des succès remportés.
L'accord entre les Etats-Unis et l'Irak sur le retrait des forces américaines, adopté par la Parlement irakien le 27 novembre 2008, prévoit une évacuation en trois étapes.
Première étape déjà mise en oeuvre : l'armée américaine s'est retirée des villes en juin 2009. L'échéance fixée par l'accord irako-américain a été respectée. La ville de Mossoul est la seule agglomération où les Etats-Unis, en raison de l'extrême tension qui règne dans la ville et sa province, ont maintenu leurs forces avec l'accord de Bagdad.
Deuxième étape : le gros des troupes américaines doit avoir quitté l'Irak en août 2010. A cette date, il ne restera plus qu' « une force de soutien » de 35 à 50 000 hommes.
Troisième étape : l'armée américaine se sera entièrement retirée à la fin de 2011. Il ne restera plus alors en Irak que des unités militaires affectées à des tâches de formation et de logistique. Les Etats-Unis ne conserveront aucune base permanente en Irak.
Le calendrier, dont le Général Odierno nous a assurés que les Etats-Unis le respecteraient à la lettre, pourrait néanmoins être aménagé en cours de route par accord entre les deux pays. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, qui a bien voulu recevoir la mission, estime, pour sa part, qu'une telle éventualité est probable.
L'armée irakienne et la police nationale suffiront-elles à empêcher une reprise de l'insécurité ? Les 300 000 hommes de l'armée irakienne, appuyés par la police nationale dont les effectifs sont du même ordre devraient suffire à la tâche à condition que les appartenances ethno-confessionnelles ne l'emportent pas sur le devoir d'obéissance au Gouvernement. Interrogé sur ce point, le général Odierno a estimé que 75 % de l'armée et de la police nationale étaient dès à présent fidèles au pouvoir central et 20 % en train de le devenir. Quant aux 5% restants, il n'y avait rien à en attendre.
Le retrait américain des villes s'est accompagné depuis quelques mois d'un regain de violence. Des attentats au camion piégé perpétrés sur des marchés à des heures de grande affluence ont fait de nombreuses victimes. Attentats-suicides, enlèvements, exécutions sommaires, n'ont pas cessé. Il convient, cependant, de replacer ces violences dans leur contexte. Elles restent pour l'essentiel circonscrites à Bagdad ainsi que dans les quatre gouvernorats non sécurisés du Nord et du Nord-est et elles n'inversent pas la courbe décroissante des attentats ainsi que des victimes : 26 000 morts en 2006, 23 000 en 2007, 7 000 en 2008 et 3 000 au cours du premier semestre 2009. Mais elles révèlent l'indiscutable fragilité des progrès accomplis.
Les « conseils de réveil » et les « conseils de soutien », animés par les tribus sunnites ralliées aux Etats-Unis, dépendent désormais d'un Gouvernement dirigé par les chiites. Al Maliki s'est engagé à maintenir les aides financières qui leur avaient été versées par le commandement américain et à intégrer les Sahwas dans les forces de sécurité irakiennes. Mais ces promesses tardent à se réaliser. Plusieurs incidents montrent que le Gouvernement devra faire preuve de beaucoup de doigté et de compréhension s'il veut préserver une relation essentielle à la pacification du pays.
Qu'on ne se fasse pas d'illusions. L'Irak est un pays convalescent, mais pas encore guéri. Les rechutes sont possibles. Nul n'en est plus conscient que le général Petraeus. Il a déclaré récemment devant le Congrès des Etats-Unis que « l'Irak allait mettre un temps considérable à éliminer tous les éléments extrémistes restants ». Il est clair, par exemple, que si Al-Qaïda a subi des revers décisifs, elle dispose de cellules dormantes ou actives qui sont à l'origine de plusieurs des récentes violences, notamment des attentats suicides dont l'organisation de Ben Laden s'est fait une triste spécialité. Certaines informations, d'autre part, font état d'infiltrations d'éléments hostiles dans les forces de sécurité.
D'autres menaces se profilent à l'horizon : l'instabilité politique en est une. Il est probable que les élections de janvier 2010 prolongeront la tendance favorable au Premier ministre qui s'est manifestée aux élections de janvier 2009. Mais il est à peu près certain qu'aucun des partis en compétition n'obtiendra seul une majorité permettant de gouverner. Une coalition devra se constituer et il n'est pas certain que les tractations entre partis politiques seront favorables à Al Maliki et lui permettront de se maintenir dans ses fonctions de Premier ministre. Si l'opinion publique et l'étranger lui rendent volontiers hommage, il n'en va pas de même des partis politiques qui lui reprochent son autoritarisme. Le Gouvernement du Kurdistan, en particulier, l'accuse de faire la sourde oreille à ses revendications territoriales, notamment à ses visées sur Kirkouk, et lui reproche de ne pas appliquer l'article 140 de la Constitution qui prévoit la tenue d'un référendum dont les Kurdes estiment qu'il leur serait favorable.
« Tout sauf Maliki » est un slogan que la mission a entendu à plusieurs reprises. Si cet état d'esprit l'emportait après les élections de janvier 2010, la stabilité politique, dont l'Irak a bénéficié et qui lui est absolument nécessaire pour relever les nombreux défis qui l'attendent, pourrait se trouver menacée.
Le principal de ces défis concerne la reconstruction des grandes infrastructures -routes, eau, électricité, santé- dont dépend l'indispensable amélioration du niveau de vie de la population. Celle-ci vit dans le dénuement, ne dispose, dans le meilleur des cas, d'eau potable et de courant électrique que quelques heures par jour. La remise en état des réseaux exigera des investissements évalués au minimum à soixante milliards de dollars. La détérioration de ces infrastructures remonte, en effet, aux sanctions imposées à l'Irak de Saddam Hussein après la première guerre du Golfe. Les bombardements qui ont accompagné l'invasion et l'insécurité qui en a résulté n'ont rien arrangé. Un grand nombre de contrats de reconstruction ont été passés par les autorités américaines avec des sociétés irakiennes et étrangères, mais on n'en voit pas de retombées concrètes sur le terrain.
La lenteur des progrès accomplis s'explique dans une assez large mesure par l'importance des sommes englouties dans le puits sans fond de la corruption. L'ONG Transparency International place, sur une liste des pays des moins corrompus aux plus corrompus, l'Irak au 178 ème rang sur 180, à égalité avec la Birmanie et la Somalie. Les autorités ont désormais pris conscience de la gravité du problème. L'Irak a ratifié en mars 2008 la convention des Nations unies contre la corruption et mis en place un Conseil national de la lutte contre la corruption. Le ministre du Commerce vient d'être contraint à démissionner pour faits de concussion. Le montant de la fraude lié à son seul ministère s'élèverait à 5,3 milliards de dollars. L'avion dans lequel il tentait de fuir à Dubaï a été contraint de rebrousser chemin et l'intéressé arrêté. Cet épisode spectaculaire a frappé les esprits mais il reste pour l'heure un cas isolé. La règle jusqu'ici a été l'impunité ou la fuite hors du pays. Lutter contre la corruption constituera un des défis auxquels le Gouvernement qui sortira des élections devra avoir le courage de s'attaquer.
Heureusement l'Irak est un pays potentiellement riche du fait de ses très importantes ressources pétrolières. La production actuelle n'est que de 2,3 millions de barils/j et devrait atteindre, à la fin de 2009, 2,5 millions. Mais l'objectif fixé par le Gouvernement est d'atteindre 6 millions de barils /j dans les années à venir. La production pourrait même dépasser ce niveau si les travaux de remise en état des installations existantes et la mise en service de capacités nouvelles étaient entrepris. Les investissements nécessaires seraient de l'ordre de cinquante à soixante milliards de dollars, ce qui exige l'intervention des grandes compagnies étrangères. Un premier contrat vient d'être passé avec un consortium constitué autour de British Petroleum . La société Total , qui suit la situation de près, a fait savoir qu'elle était prête à devenir un partenaire privilégié de l'Irak. On estime dans les milieux pétroliers que lorsque les réserves de l'Irak auront été complètement explorées, ce qui est loin d'être le cas, le pays se situera au deuxième rang mondial après l'Arabie saoudite. C'est dire l'intérêt que l'Irak suscite dans le monde des grandes compagnies.
L'extraction et l'exportation du pétrole, qui constituent plus de 90 % des recettes extérieures et budgétaires de l'Irak, ne posent pas que des problèmes techniques et financiers. En raison de son inégale répartition géographique, le pétrole revêt une dimension politique majeure. 13 % de la production se situe dans le nord autour de Kirkouk et de Mossoul, dans une zone revendiquée par le Kurdistan. Le reste de la production et des réserves se situe au sud, dans la province chiite de Bassorah. La partie centrale de l'Irak, zone de concentration des tribus sunnites, ne dispose d'aucune ressource pétrolière, d'où l'exigence des sunnites que le pétrole devienne une ressource nationale dont l'exploitation et la répartition soient soumises à l'autorité du Gouvernement central et non à celle des gouvernorats de province. La loi pétrolière appelée à régler le problème est en panne au Parlement et ne sera reprise que par le Gouvernement issu des élections de janvier 2010. Mais elle est un élément essentiel du pacte national sans lequel l'unité du pays ne pourra pas être préservée.
D. L'IRAK RESTERA-T-IL UNI ?
Si la reconstruction des infrastructures, la lutte contre la corruption, la répartition des recettes du pétrole posent de difficiles problèmes, le vrai casse-tête qui attend l'Irak consistera à intégrer le Kurdistan dans l'ensemble national. Les deux millions et demi de Kurdes jouissent, depuis la fin de la première guerre du Golfe, d'une autonomie de fait, protégée par l'Occident. Ils disposent d'une force militaire de 90 000 hommes, les Peshmergas, dotés d'armes légères, mais disciplinés et loyaux. La Constitution irakienne a fait une place de choix au Kurdistan et dans les institutions du pays : le Président de la République, M. Talabani, est Kurde. Les trois provinces qui forment le Kurdistan bénéficient d'une très large autonomie, qui leur permet notamment de fixer librement les dates de leurs élections provinciales. Le Kurdistan s'est doté d'un aéroport international et attire d'importants investissements étrangers. Il ignore l'insécurité. Il n'y aurait donc pas lieu de s'étendre sur la situation des Kurdes s'ils ne formulaient pas d'importantes revendications territoriales que rejettent le Gouvernement de Bagdad et le reste des Arabes de l'Irak.
Ces revendications portent sur les régions adjacentes au Kurdistan et en particulier sur la ville de Kirkouk et sa province. Le Président du Gouvernement du Kurdistan, M. Barzani, qui a longuement reçu la mission, lui a déclaré sur tous les tons que Kirkouk était la capitale historique du peuple Kurde et que la ville devrait, quoi qu'il arrive lui revenir. Kirkouk représente plus ou moins pour les Kurdes ce que Jérusalem est pour les Israéliens et les Palestiniens.
Aussi longtemps que les revendications des Kurdes seront formulées en termes aussi radicaux, ils poseront un problème insoluble. Les territoires en cause, à commencer par Kirkouk, sont, en effet, considérés comme arabes par le reste de la population. Aussi le Gouvernement de M. Maliki ne fait-il pas mine de céder à l'insistance du Kurdistan et ne manifeste-t-il aucune hâte à appliquer l'article 140 de la Constitution qui prévoit la tenue d'un référendum pour décider du sort de Kirkouk. Référendum qui, selon le Gouvernement kurde, ne devrait intervenir que lorsque les habitants arabes que Saddam Hussein avait installés dans la ville pour l'arabiser auraient regagné leurs provinces d'origine.
M. Maliki, que le Président Barzani voue aux gémonies, n'a manifestement pas l'intention de bouger avant les prochaines élections législatives. En attendant, la Turquie suit de près l'évolution de la situation. Ankara a fait clairement savoir qu'elle n'accepterait en aucun cas l'indépendance du Kurdistan et que la Turquie veillerait à ce que les droits des Turcomans, nombreux à Kirkouk, soient pleinement respectés.
On peut penser que la communauté internationale fera pression sur les autorités du Kurdistan pour qu'elles en rabattent de leurs revendications et que, s'agissant de Kirkouk, elles acceptent un compromis dont les grandes lignes ont été tracées dans le rapport adressé en avril 2009 aux autorités irakiennes par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Irak, M. Staffan de Mistura, au nom de la Mission d'assistance des Nations unies en Irak (MANUI).
L'importance de l'Irak ne tient pas seulement à ses réserves pétrolières mais au fait qu'il se situe à la charnière du monde arabe et de l'Iran. Les relations entre Bagdad et Téhéran ont toujours été difficiles et contentieuses et ont été marquées par la guerre de huit ans entre les deux pays, déclenchée par Saddam Hussein en 1981. En l'éliminant, les Etats-Unis ont rendu un signalé service à l'Iran dont la stratégie régionale réserve à l'Irak une place de premier plan pour plusieurs raisons.
La première a un caractère religieux. Les plus grands lieux saints chiites se trouvent non en Iran mais en Irak où neuf Imams chiites sur onze ont leur tombeau.
La seconde est politique : dans le bras de fer nucléaire qui oppose l'Iran à Washington, les moyens d'action dont Téhéran dispose en Irak pèsent lourds. L'Iran entend, en toute hypothèse, préserver l'influence dont il jouit en Irak. Il y est d'autant plus attentif qu'il y a subi quelques échecs cuisants : la signature de l'accord de retrait des forces américaines, que Téhéran avait tout fait pour empêcher, la division de la coalition chiite, sur laquelle il s'appuyait, les déboires électoraux du Conseil Supérieur Islamique en Irak (CSII), dirigé par Abdelaziz Al Hakim, un affidé de l'Iran, la diminution de l'influence des Sadristes, alliés de l'Iran, à Bagdad.
Il ressort des réponses faites aux nombreuses questions posées par la mission sénatoriale que si les autorités irakiennes tiennent à conserver avec leur puissant voisin, frère en religion, des relations étroites et amicales, elles n'ont aucunement l'intention de laisser Téhéran dicter sa loi à Bagdad.
Parallèlement à la normalisation des relations américano-irakiennes, on assiste d'ailleurs, depuis dix-huit mois, au retour de l'Irak dans la famille arabe. Nombreux sont les pays de la région qui ont ouvert des ambassades à Bagdad et plusieurs chefs d'Etat et premiers ministres s'y sont rendus en visite officielle. Ce fut notamment le cas du Premier ministre syrien, reçu à Bagdad, accompagné d'une dizaine de ministres et de hauts fonctionnaires. La Syrie souhaite jeter les bases d'une étroite coopération économique et pétrolière avec l'Irak, dont elle souhaite devenir, grâce à la réhabilitation de l'oléoduc Kirkouk-Banias, le débouché naturel sur la Méditerranée. Au Président de la Ligue arabe en visite à Bagdad, Nouri Al Maliki a proposé d'accueillir le prochain sommet arabe que l'Irak souhaitait présider.
Le Gouvernement irakien n'a donc pas ménagé, depuis l'été 2008, ses efforts pour amener les Arabes à reprendre le chemin de Bagdad. Il y a réussi, à une exception importante près : le roi Abdallah d'Arabie saoudite attend, pour normaliser les relations de son pays avec l'Irak, de voir si Nouri Al Maliki place réellement l'intérêt de son pays au dessus de ses fidélités chiites.
Si le ciel de l'Irak s'est donc miraculeusement éclairé depuis deux ans et demi dans la plupart des domaines, la renaissance du pays demeure fragile et il reste à savoir si les trois communautés du pays -chiite, sunnite, kurde- pourront s'affirmer et se développer sans s'enfermer dans le piège du communautarisme.
III. LE CONFESSIONNALISME AU LIBAN
Les élections du 7 juin dernier ont porté au pouvoir le camp dit du « 8 mars » réputé pro-occidental. Le camp pro-syrien dit du « 14 mars », formé de l'alliance du Hezbollah et du général Aoun n'a pas fait le score qu'il attendait et que beaucoup d'observateurs internationaux avaient prédit.
Cette victoire du camp pro-occidental a été obtenue par le vote communautaire toujours aussi fort au Liban.
Rappelons que la population libanaise se répartit en trois communautés, sensiblement égales du point de vue démographique, et qui rassemblent 17 tendances religieuses différentes : les musulmans sunnites dont le leader Saad Hariri, âgé de trente-huit ans, est le fils de l'ancien Premier ministre assassiné Rafic Hariri ; les musulmans chiites regroupés au sein de la milice Amal qui ne compte plus guère et du Hezbollah dont le chef est Hassan Nazrallah ; enfin les chrétiens scindés en deux camps ; celui des forces libanaises avec Samir Geaga, Amine Gemayel et Michel El Murr qui ont fait alliance avec les sunnites et celui du général Aoun qui a fait alliance avec le Hezbollah et la Syrie. Les druzes représentent environ 5 % de la population. Ils ont pour chef Walid Jumblatt qui s'efforce de protéger au mieux les intérêts de sa communauté.
Le général Aoun déclare s'être allié avec le Hezbollah, sans égard pour l'alliance traditionnelle des chrétiens avec les sunnites, afin de prendre en compte l'intérêt national du Liban. Cette transgression le fait apparaître comme un traître aux yeux de l'autre partie de la communauté chrétienne.
Quant au Hezbollah, le fait qu'il soit resté inactif lors des événements de Gaza, de même que son acceptation du résultat des élections, montre qu'il n'est pas, comme on l'affirme souvent, une simple marionnette aux mains de l'Iran et de la Syrie mais d'abord un parti politique libanais.
Vos rapporteurs ne peuvent que se réjouir du bon déroulement des élections libanaises qui témoigne du fait que les parties ont consenti à régler leurs désaccords dans les urnes plutôt que par les armes.
Néanmoins, la scène politique libanaise reste dominée par les clivages confessionnels et communautaires. La construction d'un Etat libanais capable de transcender ces clivages prendra encore beaucoup de temps. Elle suppose que soit résolu le problème des 400 000 réfugiés palestiniens qui empoisonne les relations entre Libanais et nourrit l'instabilité depuis des années. Ce problème ne trouvera de vraie solution que le jour où sera créé un Etat palestinien dans lequel les réfugiés présents au Liban pourront vivre et s'installer. C'est dire l'importance pour le Liban, comme pour le reste du Moyen-Orient, d'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien.
CHAPITRE IV - LES INTERROGATIONS
Où en est Al-Qaïda ? Ses leaders sont-ils réfugiés dans les zones tribales du Pakistan ? Sont-ils en mesure de communiquer des ordres aux cellules se revendiquant d'elle ? Cette organisation est-elle encore en état de porter des coups contre l'Occident ou est-elle en train de muter en quelque chose de différent ? Par ailleurs, comment se passera la succession du Président Moubarak en Egypte ? Remettra-t-elle en cause la stabilité du régime ? Enfin, est-il possible de réintégrer la Syrie dans le concert arabe et de distendre son alliance avec l'Iran ? Telles sont les questions que nous nous sommes posées.
I. OÙ EN EST AL-QAÏDA ?
Al-Qaïda et son fondateur ont fait l'objet d'un nombre considérable d'analyses qui en ont retracé l'histoire et détaillé les motivations 52 ( * ) . Nous rappellerons ici les quelques points qui nous paraissent importants, avant de considérer l'évolution du mouvement et son avenir.
A. UN BREF EFFORT DE MÉMOIRE
1. La naissance d'Al-Qaïda et ses buts de guerre
Al-Qaïda est née dans les montagnes d'Afghanistan entre 1996 et 1998. Son fondateur, Oussama Ben Laden, est le fils d'une dynastie de richissimes entrepreneurs saoudiens du bâtiment originaire du Yémen. Il connaît bien l'Afghanistan pour y avoir joué un rôle aux côtés de Abdallah Azzam, figure clef du jihad arabe en Afghanistan contre l'occupant soviétique. Ben Laden retourne en Arabie saoudite durant l'hiver 1989-1990. Auréolé de son prestige de résistant afghan, il est une référence morale et financière pour les milliers de vétérans d'Afghanistan, originaires de la péninsule arabique. Il aide tout particulièrement les « Afghans » yéménites et les encourage au jihad contre le régime marxiste d'Aden. Lorsque l'Irak envahit le Koweït en août 1990, Ben Laden offre au ministre saoudien de la défense, le prince Sultan, de mobiliser les anciens d'Afghanistan pour défendre le royaume. Il déteste, en effet, Saddam Hussein, coupable à ses yeux d'apostasie, le plus grave des crimes en terre d'Islam. Le prince Sultan éconduit courtoisement Ben Laden. La famille royale a déjà décidé de recourir à la protection militaire des Etats-Unis. Pour Ben Laden, le déploiement progressif de centaines de milliers de soldats « infidèles » viole la sainteté du pays qui abrite La Mecque et Médine. Profondément perturbé par le maintien de troupes américaines sur le sol saoudien après la libération du Koweït, Ben Laden formule de virulentes critiques contre la famille royale, coupable de compromission avec les « infidèles ». Ces critiques sont très mal reçues en haut lieu à Riyad et les services de sécurité « autorisent » Ben Laden à repartir pour Peshawar à la frontière pakistano-afghane, ce qui ressemble fort à une expulsion. Finalement, il s'établit au Soudan, dirigé depuis 1989 par une junte islamique qui offre asile aux vétérans d'Afghanistan. Il s'y consacre à d'ambitieux projets de développement agricoles et à la construction de routes stratégiques. Il en profite pour enjoliver la légende d'un jihad arabe en Afghanistan responsable de l'effondrement de l'URSS. Sur le même mode, Ben Laden affirme désormais que les Américains sont un « tigre de papier ». Il n'en veut pour preuve que leur humiliation en Somalie en octobre 1993. Déchu de la nationalité saoudienne en mars 1994, il se pose en parrain généreux et chevronné d'un jihad sans frontières. Son second, Ayman Al-Zawahiri, citoyen égyptien, relance auprès de lui l'organisation égyptienne du jihad et ses activités terroristes. Le président Moubarak échappe à un attentat ourdi à Addis Abeba par lui en juin 1995. Ben Laden est mis en cause cinq mois plus tard dans deux attentats spectaculaires : l'un à Riyad contre des coopérants militaires américains, l'autre à Islamabad, contre l'ambassade d'Egypte.
Conjuguant leurs efforts, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et l'Egypte obtiennent son expulsion du Soudan en mai 1996. Ben Laden arrive à Jalalabad, au sud de l'Afghanistan, avec l'aval de l'armée pakistanaise et de ses services de renseignements (ISI). Il y est rejoint par Al-Zawhiri, qui lui apporte son savoir-faire ainsi que les ressources et les militants de son organisation : Al-Djihad .
Replié dans les montagnes de la province frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, Ben Laden croit le moment et le lieu propices pour défier solennellement ses adversaires : les Etats-Unis d'Amérique et la famille Saoud. Il reprend la tradition des conquérants de l'Islam des premiers temps qui sommaient l'ennemi infidèle de se soumettre ou de se convertir avant l'ouverture des hostilités. C'est dans cet état d'esprit qu'il diffuse une « déclaration de jihad contre les Américains qui occupent le pays des deux saintes mosquées ». Ce texte fondateur d'un jihad planétaire émane d'une « base ( qâ'ida ) sûre », nichée dans « ces sommets sur lesquels s'est écrasée la plus grande puissance militaire athée du monde ». La Palestine, le Liban, l'Irak, la Tchétchénie, la Bosnie, le Cachemire, le Tadjikistan, la Birmanie, les Philippines et la Somalie sont cités pêle-mêle pour flétrir le « complot des Américains et de leurs alliés ». Mais la priorité absolue du jihad doit être de repousser l'occupant « infidèle » hors du territoire saoudien.
Cette proclamation du jihad constitue l'acte fondateur d'Al-Qaïda . Peu après avoir lancé son défi, Ben Laden fait alliance avec le mollah Omar qui vient de se proclamer « commandeur des croyants » à Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Cette alliance se noue grâce à l'intermédiaire des services spéciaux pakistanais qui ont organisé le premier entretien entre les deux hommes. Ben Laden encourage Omar « à prescrire le bien et pourchasser le mal » et se déclare favorable à son projet d'« émirat islamique d'Afghanistan ». Le chef taliban, fruste et méfiant, est sensible aux flatteries du « cheikh Oussama » et à sa grande générosité financière. Comme l'écrit Jean-Pierre Filiu, « rien ne prédisposait le comploteur apatride et le taliban ombrageux à collaborer un jour (...) L'un comme l'autre, viennent d'entamer un invraisemblable détournement des valeurs de l'Islam, Ben Laden en appelant au jihad planétaire, Omar en endossant le manteau du prophète.» 53 ( * ) . En mars 1997, les talibans afghans annoncent officiellement que Ben Laden est leur « hôte ». Cette déclaration est prise très au sérieux à l'étranger, mais elle a aussi une forte résonance à Kandahar, où prévaut le code tribal pachtoun qui sacralise « tout invité ».
Durant les dix-huit mois suivants, Ben Laden consolide méthodiquement sa « base » dans l'émirat taliban. Avec Zawahiri, il aspire à relancer le jihad terroriste sur une échelle planétaire. Tel est le sens de la constitution, en février 1998, du « Front islamique mondial du jihad contre les Juifs et les croisés. » qui est le vrai nom de ce que nous appelons «Al-Qaïda ». La « libération » des lieux saints de Jérusalem et de La Mecque reste l'objectif affiché de ce jihad, mais sa cible devient globale : « tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est un devoir qui s'impose à tout musulman qui le pourra, dans tout pays où il se trouvera ».
Le 7 août 1998, deux attentats frappent simultanément les ambassades des Etats-Unis à Dar es-Salam et à Nairobi, provoquant un carnage. Une « Armée de libération des Lieux saints » revendique la double explosion, très vite attribuée à Ben Laden et à des terroristes recrutés en Afghanistan. Washington et Riyad exigent des talibans la livraison de Ben Laden et le démantèlement d'Al-Qaïda, mais le mollah Omar refuse catégoriquement, au nom du caractère sacré de l'hospitalité pachtoune. C'est au printemps 1999 que Ben Laden envisage avec son responsable opérationnel, l'Egyptien Mohammed Atef, une opération complexe de détournement coordonné d'avions aux Etats-Unis. Atef et lui confient ce projet à Khaled Cheikh Mohammed, responsable de l'attentat dans les sous-sols du World Trade Center en 1993. Celui-ci organise l'attentat contre le navire américain USS Cole au Yémen le 12 octobre 2000, qui est revendiqué par Ben Laden, le 26 février 2001. Le même jour, le mollah Omar décide le dynamitage des statues géantes de Bouddha à Bamyan.
Le mollah Omar ignore que la date du 11 septembre 2001 a été arrêtée par Ben Laden pour un attentat d'ampleur « apocalyptique ». Le chef d'Al-Qaïda vise les seuls Etats-Unis et n'imagine peut-être pas que les attentats du 11 septembre vont susciter une mobilisation internationale. Le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare, dès le lendemain, « prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes ». Les bombardements américains sur l'Afghanistan débutent dans la nuit du 7 au 8 octobre 2001. Ben Laden, jusqu'alors silencieux, apparaît, aux côtés d'Al-Zawahiri, sur la chaîne satellitaire Al-Jazira, installée au Qatar. En ascète du jihad, il « jure devant Allah que l'Amérique ne connaîtra pas la paix avant que la paix ne règne en Palestine et que l'armée des infidèles ait quitté la terre de Mohammed ».
2. Al-Qaïda et le concept de Jihad
Comme l'écrit Jean-Pierre Filiu, peu de concepts auront été aussi dévoyés que celui de jihad. Généralement traduit par « guerre sainte », le « jihad sur la voie de Dieu » correspond à la mobilisation guerrière de la communauté musulmane soit à des fins d'autodéfense, soit en vue de l'islamisation de nouveaux territoires. Mais qu'il soit défensif ou offensif, ce jihad militaire est moins noble que le « grand jihad » qui correspond au travail piétiste, voire mystique du musulman sur lui-même pour progresser dans l'approfondissement de sa foi.
Contrairement à ce qui est souvent dit, le jihad ne fait pas partie des cinq piliers de l'Islam que sont la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à La Mecque.
La synthèse contemporaine du Jihad avec le terrorisme remonte au 6 octobre 1981 avec l'assassinat du Président Anouar el-Sadate, dont les assassins se réclament d'un groupe appelé « Jihad » et se vantent d'avoir châtié le premier signataire arabe d'un traité de paix avec Israël.
En 1983 , apparaît à Beyrouth une mystérieuse « Organisation du Jihad islamique » qui harcèle la Force multinationale déployée au Liban et qui commet, le 23 octobre 1981, deux attentats-suicides simultanés qui font des centaines de victimes parmi les forces américaines et françaises.
Alors que ce jihad terroriste s'impose au Proche-Orient, un jihad d'une toute autre ampleur se développe en Afghanistan : la résistance à l'occupation soviétique s'organise sur le mode du jihad défensif. Une nébuleuse arabe, d'origine égyptienne et saoudienne, étoffe ses rangs et forge sa légende. C'est elle qui revendique la gloire de la victoire sur l'URSS, laquelle revient, en réalité, aux résistants afghans : les moudjahiddines. Les « nomades » du jihad global parasitent dans les mêmes conditions les combats menés en Bosnie, en Tchétchénie ou au Cachemire. Mais ils se heurtent partout aux tenants d'une lutte nationale et ils finissent par se retrouver en Afghanistan pour y fonder une base.
La mobilisation internationale contre le terrorisme, à partir de l'automne 2001, prive le jihad global de son sanctuaire afghan. Mais Al-Qaïda n'est pas éradiquée et reprend sa quête d'un territoire de substitution. Elle saisit l'opportunité de l'invasion américano-britannique de l'Irak pour se ressourcer au coeur de l'Islam et s'implanter aux frontières de l'Arabie. Le jihad sunnite irakien, dans la haine et la confusion de la résistance à l'occupation américaine, s'accommode au début du renfort d'Al-Qaïda face à l'occupation des « infidèles ». Mais l'alliance des sunnites et d'Al-Qaïda se heurte au jihad chiite sur cette terre où naquit le grand schisme musulman.
Nous retiendrons la différence fondamentale entre le jihadisme d'Al-Qaïda, mouvement déterritorialisé, aux objectifs globaux, et les mouvements dits « islamico-nationalistes », tels que le Hamas, le Hezbollah, ou encore les talibans dont les revendications sont, avant tout, nationales.
3. Jihadisme et islamico-nationalisme
Comme l'a montré Olivier Roy, Al-Qaïda est une organisation déterritorialisée, globale, relativement coupée des enjeux du Moyen-Orient, sans ancrage politique dans la population musulmane. Les radicaux d'Al-Qaïda sont « déterritorialisés » : leur pays de naissance n'est pas celui où ils entrent en action. Les pilotes des appareils qui ont percuté les tours du Word Trade Center ont eu des parcours totalement différents de ceux des médecins terroristes de Grande-Bretagne de juin 2007.
Al-Qaïda ne cherche pas à contrôler un territoire, mais à faire vivre le « conflit des civilisations » en infligeant aux puissances occidentales, au premier rang desquelles il y a les Etats-Unis, des dommages dont les médias amplifieront l'image. Celle-ci est plus importante que la réalité du mal infligé. Comme l'écrit Olivier Roy, « Al-Qaïda a besoin de ceux qui la diabolisent, car la perception induit l'action politique ». 54 ( * )
Il en va tout différemment des mouvements islamico-nationalistes. Même s'ils placent l'Islam au coeur de leur combat, ils inscrivent leur projet à l'intérieur de territoires bien définis -la Palestine, le Liban et l'Afghanistan, le Pakistan- et ils ont pour objectif, certes l'islamisation de la société, mais aussi la libération de leur pays. Il y a bien au sein de ces mouvements des divergences, voire des affrontements, entre ceux qui considèrent qu'il convient d'abord d'islamiser la société avant de la libérer -c'était la position de Cheikh Yacine avant la création du Hamas- et ceux qui, au contraire, affirment que l'islamisation n'interviendra que si le territoire a d'abord été libéré de l'emprise étrangère, directe ou indirecte. Ces divergences importent peu. Il s'agit de mouvements de « libération nationale » dont les objectifs sont très différents de ceux d'Al-Qaïda, même si l'invocation de l'Islam et leurs modes opératoires, en particulier le recours aux attentats-suicides, sont les mêmes.
B. LA FIN D'AL-QAIDA ?
1. Les erreurs de la « guerre totale contre la terreur »
En riposte aux événements du 11 septembre 2001, l'administration de Georges W. Bush a mis en place une stratégie fondée sur « la guerre globale contre la terreur » (ou contre le terrorisme) dont l'intervention militaire en Irak a été présentée comme une application.
Le concept même de guerre globale contre le terrorisme était une erreur. Le terrorisme n'est qu'un procédé. Ce sont les groupes et les hommes qui le mettent en oeuvre qu'il faut combattre. On déclare la guerre à Hitler, pas au blitzkrieg . Déclarer la guerre à un procédé -le terrorisme- ou à un sentiment -la terreur- c'est détourner l'attention d'un ennemi qu'il eut mieux valu désigner : les « jihadistes internationaux », Oussama Ben Laden ou encore « le front islamique de lutte contre les Juifs et les croisés ».
On comprend que la première puissance mondiale ait hésité à se lancer dans une chasse à l'homme contre ce qui n'était encore qu'une bande organisée de quelques centaines de fanatiques et non pas une organisation internationale d'envergure. De même, il était sans doute difficile d'admettre qu'un si petit groupe ait pu avec si peu de moyens infliger autant de dommages à la première puissance mondiale. Les Etats-Unis n'avaient pas grand chose à gagner dans une telle chasse à l'homme, sinon quelques maigres succès sans rapport avec les moyens déployés.
Il fallait donc ré-étatiser le conflit en s'en prenant non seulement aux hommes -les groupes terroristes- mais aussi aux Etats qui les abritent : les « Etats voyous ». Les Etats-Unis y parviennent sans peine en prenant le contrôle de l'Afghanistan à la fin de 2001. Mais trop rapide et trop facile, l'opération ne suffisait pas à laver l'affront. Il fallait frapper un Etat offrant suffisamment de résistance pour que sa reddition montre au monde qu'on ne peut s'attaquer impunément aux Etats-Unis. L'Irak était d'autant mieux placé pour jouer ce rôle de bouc émissaire que le groupe des néo-conservateurs et de leurs alliés républicains comme Donald Rumsfeld ou Dick Cheney, voulaient « finir le travail » entamé par Georges H.W. Bush lors de la première guerre du Golfe qui avait stoppé les troupes américaines à la frontière de l'Irak.
Cette focalisation sur le terrorisme et l'Irak a pris la forme d'une doctrine dans la « stratégie nationale de sécurité » du Président Georges W. Bush, publiée à l'automne 2002. On a, sans doute, trop insisté sur les frappes militaires « préventives » que la « doctrine Bush » préconisait, lorsque les intérêts supérieurs des Etats-Unis étaient menacés, et insuffisamment souligné qu'elle mettait également l'accent sur le développement de la coopération internationale, la défense des droits de l'Homme et des libertés. Elle poursuivait l'objectif ambitieux d'une refondation du monde arabo-musulman, n'excluant pas, pour y parvenir, les changements de régime. Paradoxalement, comme l'a montré Olivier Roy, « les néoconservateurs ont poussé jusqu'au bout l'idée que les valeurs de l'Occident sont universelles et doivent être promues, au besoin par une intervention directe » 55 ( * ) .Ce faisant cette politique rompait avec la traditionnelle politique occidentale de soutien aux régimes en place, qu'ils fussent ou non autoritaires. Résoudre le conflit israélo-palestinien afin d'éteindre les racines de la haine s'imposait mais n'était qu'un aspect particulier d'un problème plus général : « tant que cette région sera en proie à la tyrannie, au désespoir et à la colère, elle engendrera des hommes et des mouvements qui menacent la sécurité des Américains et de leur alliés. » 56 ( * )
Malheureusement, la guerre globale contre la terreur prendra essentiellement la forme d'actions policières et militaires réalisées sur ordre du Gouvernement des Etats-Unis, appuyées par leurs alliés, membres de l'OTAN, contre des organisations proches du terrorisme islamiste. Elle combine la lutte directe -démantèlement des cellules terroristes et destruction des camps d'entraînement- et l'action indirecte : enquêtes et pressions sur les Gouvernements, organisations et personnes soutenant les mouvements terroristes, gel des avoirs soupçonnés d'appartenir à des groupes terroristes ou d'être utilisés à leur profit. La guerre globale comporte aussi des aides financières aux pays qui participent à la lutte contre le terrorisme ainsi que le développement de la coopération internationale au niveau du renseignement, de la police et de la justice.
Les résultats de cette politique sont peu convaincants. Les Etats-Unis, défenseurs traditionnels de l'Etat de droit et des libertés publiques ont eux-mêmes quelque peu perdu de vue ces valeurs, au premier rang desquelles le « due process of law », en recourant à la torture et à l'emprisonnement sans jugement. Les prisons d'Abou Ghraib en Irak et de Guantanamo à Cuba en sont devenues les symboles malheureux. Dans le sillage des Etats-Unis, le Royaume-Uni a été le seul État européen à mettre en place une procédure dérogatoire à la Convention européenne des droits de l'Homme afin de permettre la détention sans jugement et de façon pratiquement illimitée de « terroristes internationaux présumés » qu'il n'était pas possible d'expulser du pays (chapitre IV de l' Anti-terrorism, Crime and Security Act de 2001). Procédure condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme et depuis abrogée. Quant à Al-Qaïda, qui n'était pas présente en Irak, elle a pu s'y installer, y recruter et s'y entraîner jusqu'à ce que ses attentats aveugles contre la population civile amènent les tribus sunnites à la rejeter.
2. Les mutations d'Al-Qaïda
Al-Qaïda frappe par sa capacité à évoluer et à s'adapter aux circonstances, ce qui explique sa résilience après 2001. Son organisation est décentralisée, sa stratégie opportuniste. Elle consiste à profiter des failles dans les systèmes de sécurité occidentaux ou dans des pays où l'Etat est faible, voire inexistant, d'y installer ses camps d'entrainement et d'organiser à partir d'un havre protégé ses opérations à travers le monde. Elle utilise Internet, ce qui lui permet d'entretenir une impression d'activité supérieure à la réalité et lui procure un rayonnement international.
Elle recrute dans le groupe hétérogène que les spécialistes du renseignement appellent la « communauté du ressentiment ». Dans la plupart des cas il n'y a pas recrutement. Les convertis s'enrôlent d'eux-mêmes soit individuellement, soit par petits groupes, sous la bannière de l'organisation pour acquérir plus de visibilité. Comme le dit un journaliste saoudien, grand connaisseur de Ben Laden, Jamal Khashogi, Al-Qaïda est avant tout un « état d'esprit ». Cet état d'esprit peut être entretenu de multiples façons, aussi bien par une éducation exclusivement religieuse, par des émissions de télévision, par Internet, ainsi que par des prêches enflammés dans les mosquées qui exaltent l'identité islamique. Dans ce contexte de forte allergie à l'Occident et à ses valeurs, la simple présence de touristes en terre musulmane peut provoquer le passage à l'acte.
L'une des spécificités les plus effrayantes d'Al-Qaïda tient au fait qu'elle tend à se positionner sur un registre virtuel afin de devenir une « référence », un « label » et d'entretenir le mythe du conflit de civilisations entre l'Occident, perçu comme chrétien, et le monde musulman, conçu comme essentiellement sunnite. Observons que les chiites sont perçus comme des hérétiques et ravalés au même rang que les juifs et les chrétiens, au travers d'attentats de masse contre les lieux de pèlerinage chiites.
La diffusion du label d'Al-Qaïda tient aussi bien à la volonté de militants extrémistes de se référer à Ben Laden, dans le but d'afficher une force supérieure à celle qu'ils ont, qu'à la volonté de certains Etats d'obtenir des concours pour lutter contre des rébellions locales et justifier leurs propres actions de répression en se prétendant confrontés à Al-Qaïda.
3. Le bilan de la lutte contre Al-Qaïda
Le bilan de la lutte menée contre Al-Qaïda est mitigé, alors même qu'aucun groupe terroriste n'a jamais été combattu avec autant d'énergie. Pour dresser ce bilan, il est nécessaire de préciser à quelle partie d'Al-Qaïda on se réfère. Aujourd'hui, on tend à distinguer trois cercles :
- un premier cercle, que l'on pourrait qualifier d' Al-Qaïda central , est localisé à la frontière afghano-pakistanaise et regroupe la « vieille garde » et la direction de l'organisation ;
- un deuxième cercle comprend les structures « franchisées » comme AQMI -Al-Qaïda au Maghreb Islamique- ou AQPA -Al-Qaïda dans la péninsule arabe- issues de mouvements locaux qui se sont spontanément réclamées d'Al-Qaïda ;
- un troisième cercle constitué de mouvements auto-formés qui cherchent par des actions violentes à acquérir le label Al-Qaïda, celui-ci étant postérieurement accordé ou non par l'état-major central d'Al-Qaïda.
S'agissant du premier cercle, force est d'admettre que le mouvement semble avoir survécu, que sa direction centrale et idéologique est toujours présente et que ses intentions sont inchangées. Oussama Ben Laden et Ayman Al-Zawahiri n'ont pas été capturés, même si de nombreux cadres tels Mohamed Atef ou Khaled Cheikh Mohammed, le cerveau du 11 septembre, sont morts ou ont été emprisonnés. Cette survivance de Ben Laden nourrit le mythe, ce qui est préoccupant dans la mesure où la lutte contre Al-Qaïda est dans une large mesure une affaire de perception.
Contrairement au niveau directionnel, le second cercle, celui du niveau opérationnel, a été sensiblement affaibli. Depuis 2005, l'organisation n'a plus conduit d'attentats en Occident et son implication dans le conflit afghan reste marginale. Par ailleurs, les signes d'affaiblissement semblent se multiplier : dissensions internes, défections, échecs. Al-Qaïda n'a pas su fédérer la lutte islamique et certains théâtres d'opérations stratégiques, comme la Palestine, continuent de lui échapper. Mais le principal échec d'Al-Qaïda réside dans son incapacité à mobiliser un véritable soutien populaire et politique. C'est pourquoi elle paraît confinée à quelques rares sanctuaires territoriaux : la zone frontalière afghano-pakistanaise et le Yémen. D'autres zones offrent de possibles sanctuaires tels que les Etats faillis de la Corne de l'Afrique ou certains Etats au sud du Sahara, tels le Mali ou le Niger, incapables de contrôler leur immense territoire.
S'agissant enfin des cellules totalement autonomes, leur développement est étroitement lié à « la communauté du ressentiment » et à l'état des relations entre occident et monde arabe. C'est en éteignant ces braises qu'on affaiblira Al-Qaïda et les groupes qui s'en réclament.
En conclusion, vos rapporteurs rappellent que la guerre en Afghanistan avait pour but premier d'empêcher Al-Qaïda et ses alliés d'y retrouver une base protégée et non pas d'y instaurer un Etat démocratique. Au lieu de convaincre les dirigeants afghans de demain, quels qu'ils soient, du danger qu'il y aurait à abriter Al-Qaïda sur leur territoire comme les talibans le firent hier, les buts de cette guerre ont évolué. Actuellement, l'objectif est de constituer des forces de sécurité afghanes suffisamment puissantes pour contrer les talibans et rétablir la confiance de la population. Il s'agit in fine de construire un Etat à partir des zones de sécurité. Nous en sommes-nous donnés les moyens ?
Enfin, vos rapporteurs soulignent que le combat mené par Al-Qaïda se situe avant tout sur le plan idéologique. Ils attirent aussi l'attention sur le fait qu'Al-Qaïda utilise les techniques modernes de communication de masse. D'où la nécessité de bien comprendre les ressorts de la haine anti-occidentale, qui est sa raison d'être, pour lutter contre Al-Qaïda avec intelligence.
II. COMMENT SE PASSERA LA SUCCESSION DE MOUBARAK EN EGYPTE ?
Vos rapporteurs sont arrivés au Caire le 22 février 2009, jour de l'attentat du bazar de Khan Khalili où notre jeune compatriote, Cécile Vannier, a été tuée. Ils y ont trouvé une société en proie à des tensions importantes, mais sous contrôle, à l'approche de la succession du Président Hosni Moubarak.
A. UNE SOCIÉTÉ EN PROIE À DES TENSIONS IMPORTANTES
1. Une situation économique dégradée
Avec 80 millions d'habitants, l'Egypte est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient. Son économie fragile offre peu de perspectives d'avenir aux 600 000 jeunes qui, chaque année, entrent sur le marché du travail. Selon le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 58 % de la population vivrait avec un revenu inférieur à deux dollars par jour.
Cette situation est appelée à se dégrader du fait de la crise économique mondiale. En effet, les trois « rentes » de l'économie égyptienne vont se réduire considérablement en 2009. Le tourisme -principale source de revenus avec 11 milliards de dollars par an- devrait diminuer de 40 % ; les exportations de pétrole et de gaz devraient diminuer également de 40 % ; enfin les revenus du Canal de Suez devraient diminuer de 25 % selon le témoignage du ministre des finances lui-même.
Au total, la croissance devrait passer de 7 % en 2008 à 4 %, voire 2 %, en 2009, alors qu'un taux de 5 % est nécessaire pour assurer l'insertion des nouveaux entrants sur le marché du travail.
2. Un horizon politique qui ne laisse pas entrevoir la possibilité de changements
Les Frères Musulmans sont loin de faire l'unanimité dans la population égyptienne et, vraisemblablement, des élections totalement libres ne les amèneraient pas au pouvoir. Eux-mêmes déclarent d'ailleurs qu'ils ne sont pas prêts à y accéder. Vos rapporteurs ont rencontré le leader du bloc parlementaire des Frères Musulmans. L'image qu'il a voulu donner de son propre parti est celle d'un parti d'opposition raisonnable, fondé sur des valeurs enracinées dans la religion, comparable au modèle des démocraties chrétiennes européennes. Il s'est déclaré plus soucieux de conquérir l'opinion par un programme social actif plutôt que de remporter les élections, de crainte de susciter une réaction violente de l'armée et de la communauté internationale, en évoquant le sort du Hamas après sa victoire électorale en Palestine.
Entre le Parti national démocratique (PND), parti unique déguisé, en situation hégémonique, et les Frères Musulmans, l'offre politique des partis du centre est fragmentée. Certaines formations comme Al-Wasat sont interdites d'activité. Les leaders les plus charismatiques, tels Ayman Nour, dirigeant du parti Hizb Al-Ghad (« le parti de demain ») ont été emprisonnés. Le cas de ce dernier est particulièrement révélateur. M. Ayman Nour a été privé de son immunité parlementaire puis condamné à cinq ans de prison ferme le 24 décembre 2005 pour faux et usage de faux dans la procédure de reconnaissance des statuts de son nouveau parti en 2004. En réalité, il a été condamné pour avoir été le principal rival du Président Moubarak aux dernières élections présidentielles de septembre 2005, à l'issue desquelles il a obtenu 7,3 % des voix. C'est un score très élevé dans un pays où, tout étant fait pour assurer une victoire écrasante au candidat du pouvoir, les électeurs se détournent des urnes (la participation électorale est de 10 %). La forte mobilisation en faveur d'Ayman Nour a donc inquiété le régime. Les lois électorales ont été modifiées pour qu'un tel événement ne puisse pas se reproduire. Ayman Nour a été libéré en février 2009 en raison des pressions américaines exercées lors de la venue d'Hillary Clinton au sommet de Charm El Cheikh.
3. Un positionnement diplomatique source de frustrations et de colère populaire.
L'Egypte tient à rester le médiateur incontournable entre les parties au conflit israélo-palestinien : négociations entre Israël et le Hamas pour la libération de Gilad Shalit, entre le Fatah et le Hamas, tout passe par Le Caire. Toutefois l'absence de résultats tangibles révèle les difficultés des dirigeants égyptiens à influer sur le cours des événements. Elle témoigne de la contradiction dont pâtit l'ensemble de la politique étrangère égyptienne en raison du blocage du processus de paix israélo-palestinien depuis la fin des années 1990.
L'Egypte tente de préserver son statut international en jouant un rôle qui la rapproche d'Israël et des Etats-Unis, ce qui hérisse l'opinion publique. « Où est l'armée égyptienne ? » scandaient les manifestants contre l'offensive israélienne à Gaza.
La diplomatie égyptienne était pourtant le dernier aspect de la politique du Président Moubarak resté à l'abri de la critique populaire, exception faite de la relation avec Israël.
B. UNE SOCIÉTÉ BLOQUÉE
1. Un mal-être généralisé
L'Egypte n'est pas le seul pays à connaître des tensions économiques et politiques, mais ces tensions conjuguées à la colère et à la frustration engendrées par la diplomatie égyptienne au moment de l'offensive israélienne contre Gaza ont provoqué un ressentiment général contre le Gouvernement. Les manifestations de rue ont été jugulées par la police, mais la révolte est intériorisée et renforce encore le phénomène de crispation identitaire dont l'Egypte est un des exemples les plus significatifs du Moyen-Orient.
Cette crispation identitaire prend la forme d'un retour du religieux en tant que norme sociale et ciment communautaire de l'agressivité. Jamais les confrontations entre la majorité musulmane et la communauté chrétienne d'Egypte (les coptes représentent environ six millions de personnes) n'ont été aussi violentes qu'au cours de ces dernières années. Ces confrontations se sont traduites par un affichage délibéré des signes d'appartenance religieuse.
Le retour du religieux se traduit également par une délégitimation du mouvement d'émancipation féminine à l'occidentale à laquelle avait adhéré la bourgeoisie citadine dans les années 1920. Les femmes voilées étudient, travaillent et sont très présentes dans l'espace public. Le voile permet ainsi aux jeunes femmes des milieux les plus patriarcaux et conservateurs de quitter l'espace familial et, d'une certaine façon, de s'émanciper. Mais c'est une régression pour les autres.
2. Les risques d'attentats
D'après les informations fournies sur place à vos rapporteurs, l'attentat du 22 février au Caire a probablement été le fait d'un petit groupe de terroristes improvisés. La bombe était artisanale, d'une puissance explosive faible. L'attentat n'a pas été revendiqué. L'Egypte a déjà connu ce type d'attentats, en 2005. Il s'agit d'initiatives groupusculaires qui expriment par la violence un malaise général. Cela n'obéit pas, semble-t-il, à une stratégie d'ensemble de déstabilisation du régime comme dans les années 80. Loin d'affaiblir le régime du Président Moubarak, ce type d'attentats le renforce. La majorité des Égyptiens est en effet scandalisée par ces attentats qui frappent des innocents et qui mettent à mal le tourisme, source principale de revenus pour un million de salariés égyptiens. L'hypothèse d'une action punitive contre la France téléguidée par le Hezbollah libanais a été évoquée, mais n'est pas prouvée.
C. UNE SOCIÉTÉ SOUS CONTRÔLE À L'APPROCHE DE LA SUCCESSION DU PRÉSIDENT HOSNI MOUBARAK
1. Une société sous contrôle
L'Egypte n'a connu que deux révolutions de brève durée en un siècle (1919, 1952). Maints observateurs soulignent que le peuple égyptien est exceptionnellement patient et pacifique. En effet la pauvreté généralisée et la dureté de la vie quotidienne constituent une violence structurelle qui génère peu de criminalité par rapport à ce que connaissent des pays confrontés aux mêmes tensions, en Amérique latine par exemple. Patience infinie d'une société encore très structurée et contrôle policier omniprésent se conjuguent pour maintenir un calme relatif.
Par ailleurs, le pouvoir en place mène une politique habile de tarissement de l'offre politique alternative. Le mouvement des Frères Musulmans est divisé en deux courants principaux : celui dit des « classiques », qui sont en fait des « radicaux », prônant la fusion des autorités religieuses et politiques et le courant dit des « progressistes » ou « libéraux », qui prône au contraire une stricte séparation des autorités politiques et des autorités religieuses. En emprisonnant systématiquement les leaders de l'aile progressiste, les autorités égyptiennes cherchent à laisser le monopole de l'opposition islamique aux radicaux afin de renforcer leur rôle d'épouvantail. C'est une stratégie politique classique consistant à mettre en avant les partisans du « chaos » pour mieux ramener l'opinion vers les tenants de l'ordre.
2. La succession de Hosni Moubarak
Tout a été préparé pour que Gamal Moubarak ait, au sein du PND, un réel pouvoir qui lui assure des chances de succéder à son père. Très occidentalisé, c'est un homme d'affaire entreprenant. Néanmoins, sa candidature se heurte à beaucoup d'obstacles, à commencer par le fait que la désignation du fils par le père n'est pas acceptée par la population et en particulier par les cadres de l'armée. Tous voient dans cette imitation du modèle syrien une décadence de l'esprit républicain. Par ailleurs, le fait que Gamal Moubarak ne soit pas issu de l'armée ne garantit pas à celle-ci la consolidation de ses avantages, ni de sa suprématie. Enfin, en tant que fils du Président, une partie de l'impopularité de ce dernier retombe sur lui.
Toutefois, si les procédures constitutionnelles sont respectées, seul un petit nombre de personnes au sein du PND est éligible à la magistrature suprême. Gamal Moubarak en fait partie. Le choix définitif sera lui-même effectué par un groupe restreint, selon une procédure déjà établie et ce choix ne devra pas entrer en conflit avec les orientations de l'armée.
Mais à vrai dire, la question de savoir qui sera choisi importe peu puisque le nouveau président proviendra nécessairement du sérail et devra offrir des garanties fortes en faveur du statu quo aussi bien vis-à-vis de l'armée que des milieux économiques.
Le choix du moment où sera réglée la succession sera crucial : du vivant du Président Hosni Moubarak, Gamal aurait ses chances ; après son décès, l'armée imposera vraisemblablement son homme.
Or, l'armée est, depuis 1952, la seule organisation dont la légitimité est unanimement reconnue en Egypte. Elle est une puissance politique et économique de tout premier plan. Elle est le premier propriétaire foncier du pays, avec ses usines de production militaires et civiles, ses programmes d'investissements touristiques, ses généraux retraités devenus parlementaires. Elle contrôle la diplomatie, qui n'est pas aux mains d'un diplomate mais d'un militaire, de même que le secteur économique. C'est une société parallèle qui fournit à tous ses membres logements, soins médicaux et centres de vacances. Il est peu probable qu'elle se laisse écarter du centre du pouvoir.
Dans ces conditions, l'hypothèse la plus vraisemblable paraît être celle d'une présidence du ministre de la sûreté intérieure, le général Omar Souleiman. C'est du reste l'option retenue par le responsable des Frères Musulmans que vos rapporteurs ont rencontré.
En conclusion, la société égyptienne ressemble à une marmite sous pression. La liberté d'expression, limitée et réservée à une frange de la population, tient lieu de soupape. L'explosion semble donc exclue. Si une déstabilisation devait se produire, il est probable qu'elle viendrait d'un choc externe, d'une crise régionale majeure.
Or, l'Egypte reste un pays de référence dans le monde arabe non seulement en raison de son poids démographique, mais aussi et surtout en raison de l'excellence de ses élites scientifiques, artistiques, intellectuelles et médicales, ainsi que par la qualité de ses diplomates.
Toutefois sa dépendance envers les Etats-Unis et sa volonté de ne plus entrer en confrontation avec Israël fragilisent sa position au Moyen-Orient. Son influence diplomatique se limite à la question du conflit israélo-palestinien sur lequel elle veut garder la main.
La diplomatie française doit continuer à prendre en compte l'importance de l'Egypte dans la région, en général, et dans la résolution du conflit israélo-palestinien, en particulier, mais ne pas la surestimer. Le fait que l'Egypte ait signé une paix séparée avec Israël a affaibli la position de toutes les autres parties et a réduit ses marges de manoeuvre dans les arbitrages. Le blocage des négociations menées sous son égide entre le Fatah et le Hamas en atteste. La France doit donc respecter l'importance du rôle de l'Egypte, co-leader du monde arabe avec l'Arabie saoudite. Mais elle doit poursuivre la diversification de ses relations avec les pays de la Ligue arabe.
III. VERS QUELLE ALLIANCE ÉVOLUERA LA SYRIE ?
La Syrie est un pays multiconfessionnel à majorité sunnite avec des minorités chrétiennes, alaouites, druzes et kurdes, ce qui ne l'empêche pas d'être très attachée à son unité. Celle-ci est imposée d'une main de fer par une famille, les Assad, issue de la minorité alaouite qui encadre l'armée. Sous son impulsion l'économie s'est peu à peu libéralisée et ouverte.
A. LA STRATÉGIE DE LA SYRIE : RÉFORMER SON ÉCONOMIE, TOUT EN PRÉSERVANT SON UNITÉ
L'évolution économique progresse à petits pas. Bachar el-Assad n'entend pas être un « Gorbatchev » syrien, dont les réformes ébranleraient le pouvoir. De l'ouverture économique la Syrie attend qu'elle attire les investisseurs dont son économie a besoin et qui ne voudraient pas de l'Iran. L'Europe est sollicitée, mais ses grandes sociétés, comme Alsthom, gardent un mauvais souvenir d'expériences passées et hésitent à s'engager à nouveau. La Syrie a plus de succès avec certaines petites et moyennes entreprises, telles que les fromageries BEL qui y ont installé l'une de leurs usines régionales. La Banque Européenne d'Investissement y est active. Les échanges commerciaux de la Syrie se développent, notamment avec la Turquie qui est devenue son principal partenaire économique. Le développement de la Syrie, même s'il est étroitement contrôlé, est porteur d'inégalités sociales. Les beaux quartiers avec leurs luxueuses automobiles côtoient la misère. De plus, le pays compte environ un million de réfugiés palestiniens et irakiens qui ont fui leur pays depuis 2003. L'inflation est élevée et, dans ce contexte, des tensions ethniques apparaissent, notamment entre la majorité arabe et l'importante minorité kurde non arabophone implantée dans le nord du pays où se trouve l'essentiel des modestes réserves pétrolières du pays. Les autorités syriennes prennent très au sérieux les tensions qui pourraient menacer l'unité du pays.
B. LA DIPLOMATIE SYRIENNE : DURE EN APPARENCE, ÉQUILIBRÉE EN RÉALITÉ
La Syrie appartient au groupe de pays qui forment le « front du refus ». Mais son attitude intransigeante à l'égard d'Israël est avant tout à usage intérieur. Elle permet, dans un contexte économique qui s'améliore mais reste difficile, de détourner les frustrations populaires vers un bouc émissaire extérieur.
La diplomatie syrienne est, en réalité, moins univoque qu'il n'y paraît. Elle sait habilement jouer des différents atouts dont elle dispose en fonction des circonstances.
Damas apporte au Hezbollah libanais une aide importante et c'est par son territoire que transitent les armes et l'argent de l'Iran. La Syrie héberge la branche politique du Hamas et notamment son chef, Khaled Mechaal. Enfin, une amitié ancienne l'unit à l'Iran et il faudra des arguments forts pour la convaincre d'y renoncer. La restitution du Golan, annexé par Israël depuis 1967, y contribuerait de façon décisive.
Vue de Damas, la France est une carte qu'elle joue avec beaucoup de réalisme. La Syrie entretient avec notre pays une relation complexe, faite d'attirance pour son modèle républicain et unitaire et de rancoeur due à l'action que notre pays a menée contre sa présence au Liban.
En fonction des circonstances, la Syrie joue de l'une ou de l'autre de ses cartes. Si la situation se détend, elle se rapproche de la France et incite la Turquie à ouvrir des négociations avec Israël sur le Golan. Si la situation se tend, elle se rapproche de l'Iran et joue de son influence sur le Hezbollah et le Hamas. Elle conduit une diplomatie d'équilibre, au mieux de ses intérêts nationaux du moment.
A l'heure actuelle, ses relations avec l'Occident sont marquées par une volonté de détente. Sans doute, la libération des quatre généraux libanais pro-syriens incarcérés en août 2005, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Rafic Hariri, par le tribunal pénal international, a-t-elle joué en faveur de ce réchauffement. La nomination d'un ambassadeur américain et l'éventualité d'une visite à Damas du roi d'Arabie saoudite ne peuvent qu'accentuer cette tendance. Le 20 mai dernier, la Syrie a libéré Michel Kilo et Mahmoud Issa, deux prisonniers politiques importants qui avaient purgé leur peine.
Néanmoins, l'évolution politique interne reste timide. Les militants membres de la Déclaration de Damas, vaste coalition de partis politiques créée en 2005 pour demander un changement démocratique non violent, restent en prison. Ils y sont détenus depuis leur participation en décembre dernier à une assemblée qui souhaitait créer un conseil national représentant les signataires de la déclaration. Les observateurs estiment que la situation des droits de l'Homme en Syrie, non seulement n'a pas connu d'avancée, mais qu'elle a tendance à régresser. Les procès, quand ils ont lieu, ne respectent pas les droits de la défense. Mauvais traitements et torture demeurent d'usage courant. La situation serait pire qu'à la fin de l'ère de Hafez el-Assad, qui avait été marquée par des libérations de prisonniers.
Par ailleurs, Damas a applaudi à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en Iran et les médias officiels n'ont même pas évoqué les protestations ni les accusations de fraude. Ils ont, en revanche, rappelé l'engagement d'Ahmadinejad en faveur des pauvres et pour un programme nucléaire pacifique.
Vos rapporteurs n'en concluent pas moins que la décision du Président de la République de normaliser les relations de la France avec la Syrie était juste et mérite d'être poursuivie, non sans faire pression sur la Syrie en faveur de ses militants des droits de l'Homme emprisonnés.
CHAPITRE V - LES ÉVOLUTIONS PORTEUSES D'AVENIR
La modernisation, prudente en Arabie saoudite, rapide et audacieuse dans les Etats du Golfe ouvre des perspectives porteuses et dessine un visage différent du monde arabe.
I. LA MODERNISATION PRUDENTE DE L'ARABIE SAOUDITE
Secouée depuis 1995 par une série d'attentats meurtriers contre les installations pétrolières, les étrangers, les responsables des forces de sécurité et de la justice, l'Arabie saoudite a retrouvé, ces dernières années, la paix civile. La crise économique mondiale l'affecte mais sans provoquer de déstabilisation majeure. Le roi Abdallah restera dans l'histoire comme un grand roi réformateur. Il a entrepris des réformes économiques, sociales et politiques de nature à moderniser le pays dans l'espoir paradoxal de préserver le système monarchique archaïque dont il est le garant. Depuis son initiative pour la paix au Moyen-Orient, en mars 2002, l'Arabie saoudite a rétabli son leadership sur le monde arabe et est apparue, grâce à elle, comme un authentique partenaire pour la paix aux yeux des Occidentaux.
Le chemin parcouru est considérable. Au cours des quinze années précédentes, le pays avait été affaibli par les conflits au sein de la famille royale et le mécontentement grandissait dans le Hedjaz historique (région de La Mecque et de Djeddah) ainsi que dans la région stratégique du Hassa (Dammam) avec ses champs pétrolifères et sa population en majorité chiite. La jeunesse, alphabétisée mais désoeuvrée et paupérisée, cherchait vainement sa place et son avenir dans une société qui avait connu un progrès social fulgurant en l'espace d'une génération, en dépit d'une pauvreté qui touchait encore les deux cinquièmes des foyers. Le royaume avait perdu beaucoup de sa superbe au début des années 2000 au moment même où il s'avéra que quinze terroristes sur les dix-sept auteurs des attentats du 11 septembre 2001 étaient saoudiens.
Tout à coup, les États-Unis s'avisèrent que les milliards de dollars que l'Arabie saoudite avait déversés sur les mouvements les plus fondamentalistes du monde musulman servaient à financer des actes de terreur dirigés contre le coeur de leurs villes. Sans le réseau d'alliances personnelles tissées entre les dirigeants américains et saoudiens et sans son importance économique sur le marché du pétrole, l'Arabie saoudite aurait été incluse logiquement dans l'« axe du mal » et peut-être envahie et occupée. C'est sans doute ce que souhaitait Ben Laden afin de se débarrasser de la famille Saoud qu'il détestait et de provoquer une guerre sainte contre les Américains.
Pourquoi l'Arabie saoudite était-elle à ce point fragile dans la dernière décennie du XX ème siècle et au début du XXI ème ? Quels ont été les leviers du rétablissement ? La pacification de ces dernières années, obtenue à coup de répression et de réformes, jette-t-elle les bases d'une véritable consolidation du pays ?
A. LES FRAGILITÉS INITIALES
La famille des Saoud, commerçants sédentaires du Nadj, au centre du pays, dépourvue de légitimité religieuse face aux Hachémites de La Mecque descendants du Prophète, privée de la légitimité politique reconnue aux grandes tribus nomades, a néanmoins réussi, après deux tentatives avortées au XVIII ème puis au XIX ème siècle, à établir sa domination sur la majeure partie du territoire qu'elle convoitait. Pour réaliser ce dessein, les Saoud ont tout d'abord fait alliance, à la fin du XVIII ème siècle, avec le pouvoir religieux, en la personne d' Ibn Abd-al-Wahhab, promoteur d'une doctrine qui porte son nom et qui est une version ultra-rigoriste de l'Islam. C'était en quelque sorte « l'alliance du sabre et du turban ».
Les Saoud se sont ensuite appuyés sur les tribus, d'abord en les contraignant à se constituer en armée nationale au service de leurs conquêtes (1913-1929), puis en écrasant leur révolte avec l'aide des Britanniques. Ils ont alors réduit leurs velléités d'indépendance grâce à une habile politique de mariages du roi avec des femmes choisies dans chaque tribu. Fruit de cette alliance, la classe princière, exclusivement constituée de descendants des Saoud, compte aujourd'hui 6 000 hommes et a supplanté les tribus dans la fonction de corps intermédiaire.
Avec la bourgeoisie commerçante et éduquée du Hedjaz, les Saoud ont contracté la troisième alliance fondatrice de leur régime. Ce groupe social a mis à leur service son aptitude à créer des richesses, à gérer et à administrer, qui avait fait sa puissance sous l'Empire ottoman. Bien mal récompensée, cette bourgeoisie a perdu les libertés démocratiques conquises avant que le Hedjaz ne s'intègre au royaume et ne les a toujours pas recouvrées 57 ( * ) .
Enfin, avant même que le pétrole ne devienne la ressource quasi-unique du pays, la famille Saoud avait réussi à constituer l'ébauche d'un Etat moderne grâce à « l'unification administrative, fiscale, monétaire et à une centralisation progressive » 58 ( * ) .
Au terme de cette unification relativement rapide, la société saoudienne s'est retrouvée sans véritables corps intermédiaires, et avec des individus liés par la seule solidarité familiale, l'« açabiyya », mais dégagés des allégeances tribales. Le régime saoudien a pu s'assurer un contrôle complet de la nouvelle société ainsi constituée en exerçant une contrainte morale par l'intermédiaire des Oulémas, autorités religieuses placées sous son contrôle et une contrainte physique grâce à un système judiciaire impitoyable ordonnant plus de cent exécutions capitales par an. En outre, la redistribution de la rente pétrolière permettait de s'assurer de la soumission de la majorité de la population, devenue improductive.
La manne issue du boom pétrolier de 1973 a bouleversé ces équilibres. Un système de corruption généralisée, dont le coeur était constitué par le droit accordé aux membres de la famille royale et à un petit groupe de privilégiés de prélever des commissions sur les contrats commerciaux internationaux, s'est alors mis en place.
Lorsque le prix du pétrole s'est effondré à la fin de cette période de spéculation, la monarchie, dépourvue du levier administratif et fiscal dont elle s'était imprudemment privée, n'a pas pu acheter la paix sociale comme elle le faisait auparavant, provoquant la révolte du peuple et des classes moyennes. Les ressources du pays, concentrées entre les mains des privilégiés qui avaient accès au système de corruption, ont alors fait défaut pour nourrir, soigner, éduquer le peuple et assurer la défense du pays.
Quand l'Arabie entre en crise, au début des années 1980, la famille Saoud est confrontée à un peuple nouveau. Jeune, alphabétisé, urbanisé, le Saoudien de 1980 n'a plus grand chose de commun avec celui de 1950 59 ( * ) . La structure tribale a perdu son pouvoir au profit d'une solidarité familiale restreinte. Les propriétés collectives ont été frappées d'illégalité par des mesures prises de 1957 à 1968 et les tribus nomades, contraintes à la sédentarisation, ont afflué vers les villes. La population urbaine est passée de 16 % en 1950 à 85 % de la population totale en 2000. Les tribus se sont dissoutes dans cet exode, mais les familles qui les constituaient y ont gagné des salaires, des soins médicaux, l'alphabétisation de leurs garçons puis de leurs filles. Le taux d'alphabétisation des adultes a atteint 83 % 60 ( * ) .
Le Saoudien de 1980 lit intégralement le Coran alors que la génération précédente n'en connaissait que quelques sourates, apprises par coeur. Il veut accéder à cette société de consommation dont les princes et la bourgeoisie ont fait une sorte de norme de référence. C'est à ce moment que l'Arabie connaît sa première crise économique. L'instabilité des cours du pétrole entre 1980 et 1990 se répercute directement sur une population dont les ressources quotidiennes sont devenues aléatoires, soumises au rythme irrégulier de rentrée des pétrodollars.
Alors que la transition démographique est entamée, avec un taux de fécondité diminué de moitié en deux décennies, que les moins de vingt ans constituent 60 % de la population, la pauvreté touche près de la moitié des familles, surtout dans les provinces périphériques.
Désorientée, sortie de l'école sans formation professionnelle, privée du bien-être qui lui a été promis, la jeunesse se cherche et se trouve dans le langage et les concepts de l'Islam fondamentaliste enseigné par les instituteurs. Ceux-ci étaient souvent des Frères Musulmans égyptiens en exil dont la doctrine s'intégrait aisément au wahhabisme saoudien. Comme le résume Pascal Ménoret : « l'islamisme est une révolte contre la mauvaise distribution des richesses pétrolières » ; le pouvoir va donc être confronté à une contestation, fondée sur cette même religion qu'il avait instrumentalisée avec l'appui d'oulémas soumis pour asseoir son pouvoir. La religion officielle contrôlée par la monarchie est battue en brèche par des mouvements intellectuels de plus en plus politisés, dont une minorité évoluera vers la lutte armée. C'est dans ce maelström politico-religieux que Ben Laden va trouver son inspiration.
A la veille de cette période de crise, la société saoudienne subit un traumatisme politique qui aggrave la délégitimation de la monarchie. En 1991, incapable d'assurer la défense du territoire face à la menace de Saddam Hussein, le roi fait appel à l'armée américaine. C'est la faillite d'un système de Gouvernement qui se présentait comme le garant du caractère sacré de la terre où l'Islam est né, une terre qui devait être préservée de toute occupation militaire « infidèle ».
En 1995 et 1996, des Saoudiens appartenant à la mouvance d'Al-Qaïda s'en prennent à des soldats américains, d'abord à Ryad, puis sur la base militaire d'Al-Khobar. Les attentats font 25 victimes américaines et 700 blessés. Ils ouvrent une période de dix ans de sédition qui mettent la monarchie en péril. De 2000 à 2002, les assassinats d'étrangers et de notables du régime sont monnaie courante. De 2003 à 2007, c'est une véritable guerre que des Saoudiens liés à Al-Qaïda tentent de mener contre les forces de sécurité. Les combats font des dizaines de morts et des centaines de blessés. L'arsenal des révoltés, découvert en plusieurs régions du pays, se compose de tonnes d'explosifs, de bombes, de produits chimiques, de lance-roquettes RPG7. A partir de 2007, les forces de sécurité reprennent le contrôle du terrain. En 2008, alors que la paix civile est rétablie, le ministre de l'Intérieur saoudien estime encore à 10 000 le nombre des combattants potentiels et à un million les Saoudiens qui pourraient les soutenir. La monarchie a repris le contrôle du pays malgré cette opposition persistante.
B. LA CONSOLIDATION DU RÉGIME SAOUDIEN
Le rétablissement de l'autorité de l'Etat semble acquis. Plusieurs leviers ont été actionnés afin d'obtenir ce résultat.
D'abord les forces de sécurité ont été réorganisées, entraînées et appuyées par des conseillers étrangers. Elles sont désormais capables d'infiltrer les cellules combattantes afin de prévenir les attentats, de livrer combat dans une contre-guérilla urbaine et d'accroître si nécessaire la répression contre les « égarés ».
En second lieu, la remontée générale des cours du pétrole de 2000 à 2007 a permis à la monarchie d'acheter à nouveau la paix sociale. A cela il faut ajouter la multiplication des emplois partiellement fictifs dans le secteur public, la saoudisation de l'emploi imposée à tous les employeurs, saoudiens et investisseurs étrangers, réticents à se priver de la possibilité d'employer sept millions de travailleurs immigrés, compétents, durs à la tâche et privés de tout droit.
Le Gouvernement a su également renouer avec une politique de diversification de l'économie. Il a soutenu l'investissement dans l'industrie pétrochimique, la production d'engrais, de matières plastiques, de verre, d'aluminium, tous secteurs où un pays pourvu d'une énergie à très bon marché dispose d'un avantage comparatif. Cette politique a généré des emplois productifs.
Enfin, le Gouvernement a pris la mesure des risques que lui faisait courir un système d'enseignement qui, du primaire à l'université, nourrit la jeunesse d'idées religieuses archaïques, éloignées des conceptions mesurées des grandes écoles de pensée théologiques et juridiques reconnues dans l'ensemble du monde musulman. Ainsi les nouvelles générations deviennent-elles plus conservatrices que les précédentes ; ainsi la jeunesse devient-elle d'autant plus perméable aux dérives extrémistes que son absence de compétence professionnelle lui interdit toute insertion sociale.
Afin de reprendre en main ces extrémistes, le Gouvernement mène une politique de rééducation des « égarés », terme qui désigne les terroristes arrêtés et les jihadistes revenus d'Irak. Si la rééducation est considérée comme efficace, c'est-à-dire si « le lavage de cerveau » a produit les résultats escomptés et si le repentir est jugé certain, les « égarés » sont libérés, dotés d'une aide financière, d'un emploi, d'une maison, voire d'une épouse. Deux mille « égarés », soit la quasi-totalité des détenus, pour raison de terrorisme, ont été libérés. Cette politique qui emprunte aux méthodes soviétiques ou chinoises, le paternalisme en plus, fait peu de cas des droits de la personne. Elle s'insère dans un système répressif fait d'emprisonnement sans inculpation, de maintien au secret, de torture systématique et de châtiments dégradants, tels que la flagellation. Mais elle permet, semble-t-il, la réinsertion des Saoudiens qui s'étaient tournés vers l'action violente et, par contraste vis-à-vis des autres inculpés en Arabie saoudite, les « égarés » bénéficient d'un régime de faveur.
Dans une perspective plus stratégique, le roi Abdallah tente de réaliser une réforme des programmes et des méthodes d'enseignement, du primaire à l'université, et surtout de développer les enseignements professionnels et techniques. 30 000 étudiants saoudiens sont actuellement en formation à l'étranger. Le roi se heurte, d'une part, à la forte résistance du corps enseignant et des puissantes universités islamistes militantes de Médine et de Riyad et, d'autre part, à un corps social trop récemment urbanisé pour s'adapter aisément aux contraintes de l'emploi salarié.
Cette politique a toutefois porté ses fruits. La pacification est générale et la menace d'une déstabilisation de l'Arabie saoudite est écartée. Cette situation sera-t-elle consolidée dans les années à venir pour que se construise une société qui, tout en gardant son originalité, sache offrir plus de chances d'épanouissement à sa jeune population dans le cadre d'un Etat de droit et préparer son économie à l'après pétrole ?
C. L'AVENIR EN PROJET
L'avenir de l'Arabie saoudite passe par des réformes politiques, un meilleur usage de ses atouts et la capacité à relever des défis dont l'importance ne semble pas toujours perçue.
Les réformes ont commencé par une mesure destinée à préserver la famille royale des risques d'un conflit de succession qui l'affaiblirait. En 2006, le roi Abdallah a mis en place un système de dévolution successorale. Un Conseil d'Allégeance, chargé de la désignation du futur roi et du prince héritier, a été créé.
Après avis d'une commission médicale, le Conseil d'Allégeance pourra constater l'incapacité temporaire ou définitive du roi ou du prince héritier à exercer le pouvoir.
En cas de décès de l'actuel héritier de la couronne, le prince Sultan, le roi soumettrait trois noms pour le remplacer, lesquels pourraient être rejetés par le Conseil d'Allégeance qui, à son tour proposerait son propre candidat. En cas de désaccord avec le souverain, le Conseil d'Allégeance devrait trancher à bulletin secret et à la majorité de ses membres.
A la suite du décès du roi Abdallah, le Conseil d'Allégeance prêtera serment au prince héritier Sultan. Le nouveau souverain proposera à son tour trois candidats susceptibles d'accéder au rang de prince héritier.
Ce système de dévolution reste une affaire de famille dans laquelle le peuple et les instances de conseil (Majlis el Choura) n'interviennent pas. Ce n'est qu'un moyen d'obtenir le consensus dans une famille divisée. Ce montage résistera-t-il, le jour venu, aux appétits de pouvoir et aux règlements de compte inéluctables d'une succession convoitée ?
L'ébauche de réformes institutionnelles s'est dessinée, le 13 février 2009, avec peu d'innovations de structures mais par un grand nombre de nominations qui devraient modifier la politique du royaume dans tous les secteurs clés, hormis les ministères de souveraineté (Affaires étrangères, Défense, Intérieur) qui restent aux mains des frères du roi.
L'éducation est confiée à un gendre du roi, ancien haut responsable des services de renseignement, ce qui témoigne de la volonté de lutter contre les éléments les plus radicaux du corps enseignant, considérés comme responsables de l'engagement de milliers de jeunes Saoudiens dans le jihad. S'y ajoute la nomination de la première femme ministre en charge de l'enseignement féminin, ce qui est un signal donné aux conservateurs misogynes mais aussi, compte tenu des éminentes qualités de l'impétrante, Noura Fayez, la preuve d'une volonté sincère d'élever le niveau scolaire des filles. Le pouvoir ne touche pas au statut personnel des femmes, mais il donne au plus grand nombre des jeunes femmes les moyens de conquérir par elles-mêmes leur émancipation.
L'appareil religieux et judiciaire est purgé de ses éléments les plus radicaux. Le cheikh Ibrahim al-Ghaith, chef de la commission de la vertu et de la prévention du vice, assisté de la redoutée police religieuse (les motawwa ) est limogé et remplacé par le cheikh Abdulaziz al-Humaiyen, réputé modéré. Est également limogé le chef du haut-conseil judiciaire qui avait décrété la licéité de l'assassinat des responsables de chaînes de télévision prétendues immorales.
La diversité de l'Islam saoudien est prise en compte (à l'exception des chiites) dans la composition de la commission des grands Oulémas. Les quatre écoles juridiques du sunnisme y sont représentées et non plus la seule école hanbalite, la plus rigoriste.
La représentation nationale (Majlis el-Choura) reste une chambre nommée. Toutefois, le roi en a radicalement changé la composition. Soixante-dix-neuf de ses membres sur cent cinquante sont remplacés et les septuagénaires cèdent la place aux quadragénaires. La nouvelle assemblée comprend désormais des représentants des provinces, des membres issus des principales tribus et cinq chiites, minorité jusqu'alors écartée des instances de représentation.
A ces remaniements qui concernent aussi le ministère de la Santé et celui de l'Information s'ajoutent la création d'une Haute cour administrative et d'une Cour Suprême. Amélioration du système sanitaire, régulation plus libérale de l'information, contrôle de l'administration de la justice, instauration de possibilités de recours : ces réformes sont porteuses de changement.
Mais l'avenir de l'Arabie saoudite dépend aussi de la mise en valeur de ses atouts naturels et humains . L'Arabie s'étend sur une superficie vaste comme plus de deux fois la France et comprend 27 millions d'habitants. Longtemps fermé sur lui-même, ce pays ne met pas suffisamment ses atouts en valeur. Pourquoi Djeddah ne redeviendrait-elle pas une plaque tournante du commerce mondial, fonction aujourd'hui remplie uniquement par Dubaï ? Pourquoi l'Arabie saoudite renoncerait-elle, après l'échec des immenses fermes dans le désert, à produire au moins une partie de ses denrées alimentaires, dans les régions périphériques propices à l'agriculture et à l'élevage, comme l'Asir ? Et pourquoi les anciennes traditions maritimes de commerce et de pêche seraient-elles condamnées à dépérir ?
Par ailleurs, la monarchie a tenté à plusieurs reprises de transformer l'économie de rente en économie de production. Ces efforts ne doivent pas être abandonnés. Le pays a des avantages comparatifs pour les productions dont la matière première est le pétrole et pour lesquelles celui-ci fournit une énergie à bon marché. Mais quelle que soit la voie retenue, l'Arabie saoudite doit former sa jeunesse aux emplois et multiplier les universités et les instituts universitaires de technologie. Elle doit également modifier le statut social des sept millions d'étrangers qui constituent la main d'oeuvre productive et ne pas les traiter comme une humanité de seconde zone, ni les laisser rétribuer selon le bon vouloir de l'employeur ou maltraiter dans le secret des familles, condamnés à la flagellation et à la décapitation pour des délits mineurs sans avoir rien compris à leur propre procès faute d'interprète les assistant. Les responsables saoudiens doivent également mettre en place un droit du travail attractif pour les Saoudiens. Sans ces préalables, la société saoudienne ne pourra pas se développer.
Enfin l'Arabie saoudite peut et doit accélérer l'émancipation des femmes alors que, pour complaire aux plus réactionnaires des oulémas wahhabites, une nouvelle législation archaïque et misogyne avait fait régresser la situation des femmes pendant la crise des années 1980. En 1964, le roi Fayçal n'avait pas hésité à faire intervenir la Garde nationale pour imposer l'ouverture de la première école de filles. Les mesures prises récemment par le roi Abdallah confortent l'évolution des femmes saoudiennes : pouvoir se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays sans accompagnement d'un tuteur, séjourner seules dans un hôtel ; c'est bien là le minimum de liberté de mouvement nécessaire à des femmes d'affaires qui possèdent vingt mille sociétés et concentrent entre leurs mains 40 % de la richesse du royaume 61 ( * ) .
La richesse pétrolière est beaucoup mieux gérée aujourd'hui qu'hier : les leçons ont été tirées des contre-chocs pétroliers. Le budget de l'Etat est fondé sur un prix-plancher du baril. Les investissements sont privilégiés tant pour les infrastructures que pour le secteur industriel et la formation.
Il reste à relever certains défis que, pour l'instant, le pouvoir ne semble pas vouloir considérer. La place de la famille royale dans le système économique et politique ne manquera pas d'être remise en cause dans l'avenir. L'armée est-elle plus apte à défendre le territoire national qu'en 1990 ou reste-t-elle avant tout un instrument de coercition intérieure ? Face aux dangers de l'environnent régional, le pouvoir semble s'en remettre une fois de plus à son grand protecteur américain. L'Iran nucléaire inquiète. Mais c'est à l'Occident de gérer l'affaire ! Face à l'Irak, on reste d'une méfiance excessive en raison de l'hostilité traditionnelle à l'égard des chiites au lieu de soutenir activement les forces politiques capables de maintenir la cohésion de cet important voisin et d'aider à sa reconstruction. A l'égard du Yémen, la diplomatie du carnet de chèque ayant échoué, le Gouvernement saoudien tente de construire un mur électronique afin de bloquer les migrations et la contrebande. Il serait sans doute plus utile de donner une bouffée d'oxygène aux Yéménites en rétablissant la migration séculaire de main d'oeuvre interrompue en 1991 et reprise avec parcimonie depuis peu. Le régime saoudien est consolidé. Il a recouvré la maîtrise à l'intérieur et son prestige à l'extérieur. Toutefois on peut craindre que le système politique monarchique, faute de s'adapter à l'évolution de la société soit un jour pris de court. L'Arabie saoudite va beaucoup mieux. Ce n'est pas encore le cas de tous les Saoudiens.
II. LE GOLFE, UN AUTRE VISAGE DU MONDE ARABE
Maîtres de leur destin depuis moins de quarante ans, les Etats situés sur le pourtour du Golfe arabo-persique présentent un cas intéressant d'évolution accélérée. Ils sont passés en quelques décennies à une modernité décoiffante dont témoigne l'architecture futuriste et impressionnante de leurs grandes cités, mais aussi et surtout leur insertion dans l'économie mondiale.
Toutefois, la situation sociale et politique de ces pays évolue difficilement. La notion d'égalité entre êtres humains peine à se concevoir et à s'appliquer. Au sein même de la population autochtone, de graves discriminations frappent. Par exemple, la majorité chiite de Bahreïn manifeste violemment son mécontentement chaque semaine contre son exclusion des emplois publics et la pauvreté des infrastructures de ses quartiers. A Koweït, les citadins connaissent des conditions de vie luxueuses sans comparaison avec la pauvreté des bédouins de la périphérie.
Partout, les femmes ont un statut juridique et social inférieur à celui des hommes, même si elles jouissent en pratique d'une liberté, inimaginable dans l'Arabie saoudite voisine.
La situation faite aux travailleurs étrangers est le point focal de ce heurt entre une modernité ardemment désirée et certains archaïsmes hérités. Dans ces pays où la population autochtone ne constitue que 20 % de la population totale, la construction des infrastructures repose sur la force de travail étrangère. A cela s'ajoute que dans les Emirats Arabes Unis, par exemple, 15 % des Émiriens n'ont pas d'emploi. Les cadres supérieurs et moyens constituent une classe qui rappelle celle des métèques dans l'Athènes antique. Les immigrés asiatiques, domestiques ou ouvriers, connaissent, durant le temps limité de leur séjour des conditions de travail et de vie proches du servage. Victimes d'agences de recrutement malhonnêtes, privés de leur passeport, entièrement soumis au bon vouloir de leur employeur qui peut les faire expulser, les ouvriers finissent par se révolter. Dans le bâtiment, en particulier, l'absence de dispositifs de sécurité, génératrice de nombreux accidents meurtriers, les logements insalubres et la mauvaise nourriture ont été à l'origine de manifestations durement réprimées, d'arrestations, de condamnations et d'expulsions. Une telle condition sociale imposée à des hommes qui bâtissent musées et universités symbolise le choc entre les objectifs de l'avenir et les moyens du présent.
On ne passe pas, sans difficultés, d'une société patriarcale et féodale à une démocratie représentative en quelques décennies. Du reste, seul le Koweït a un Parlement doté de réels pouvoirs et élu au suffrage universel. Deux femmes y ont été élues lors du dernier renouvellement. Mais le conflit structurel entre la monarchie qui nomme le Premier ministre et le Parlement qui ne peut le renverser, conjugué à l'interdiction des partis politiques, réduit cette assemblée à n'être qu'un lieu d'affrontement entre des intérêts particuliers. Il en résulte une grande instabilité politique et un immobilisme qui distingue le Koweït des autres Etats du Golfe.
Depuis 2005, les Émirats Arabes Unis ont institué un conseil consultatif de quarante membres dont une moitié est nommée et l'autre élue par 6 689 grands électeurs. Cette représentation, très peu démocratique, est considérée sur place comme une avancée majeure. D'autant que l'exemple du Koweït fait office de repoussoir : la démocratie représentative génèrerait l'immobilisme, dit-on.
La comparaison entre le sort fait aux travailleurs migrants en France ou aux États-Unis et la situation que connaissent aujourd'hui les Pakistanais des Émirats doit inciter l'observateur occidental à mesurer son jugement. Rappelons-nous qu'entre le début de la Révolution française et l'institution d'un suffrage réellement universel dans notre pays, cent cinquante-sept ans se sont écoulés. En moins de deux générations, les Etats du Golfe ont accompli un saut politique et social considérable. Le jugement occidental empreint de condescendance sur ces nouveaux Etats nuit à leur évolution et à des relations mutuellement profitables.
Le modernisme spectaculaire des gratte-ciel, des grands hôtels, des autoroutes, la beauté de certaines tours ne doivent pas nécessairement être considérés comme les marqueurs d'une modernisation authentique. En effet, les choix architecturaux et les non-choix urbanistiques des vingt dernières années ont eu un impact destructeur sur l'écologie de la région. Dubaï en est un des exemples les plus inquiétants. La construction d'îles artificielles dans une mer fermée comme le Golfe persique a détruit les fragiles écosystèmes qui assuraient la régénération des eaux. L'absence d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées approprié à un habitat extrêmement dense conduit à des rejets massifs d'eaux polluées dans la mer. D'autant que les saumures rejetées par les usines de désalinisation ont, elles aussi, des effets dévastateurs sur l'écosystème. Or ces saumures ne feront qu'augmenter tant la demande d'eau potable s'accroît. Pour alimenter des immeubles de centaines de mètres de hauteur, la dépense d'énergie est énorme. Alors que les Etats golfiotes se préparent à l'après-pétrole, ils ont opté pour un mode de développement urbain dont l'empreinte écologique est la pire au monde et à laquelle ils ne pourront remédier que par une dépense énergétique considérable. Or, il faut une quinzaine d'années, selon l'AIEA pour qu'un pays sans expérience accède à un nucléaire civil sécurisé. La modernité architecturale de ces Etats est plus une menace pour leur propre avenir que le témoin d'une adaptation au monde contemporain.
En revanche, la capacité de réaction aux aléas de la finance mondiale, la mise en réserve des pétrodollars dans des fonds souverains, tels l'ADIA des Émirats Arabes Unis, capables d'investir au profit des générations futures, la volonté d'être « le centre d'aviation globale du monde », celle de former les jeunes dans des universités de haut niveau, celle de bâtir des musées prestigieux qui soient autant de phares de la culture mondiale, la décision de diversifier l'économie, celle de développer le secteur de la recherche et des technologies de pointe, tout cela relève d'un état d'esprit visionnaire.
Certes, la crise financière et économique mondiale touche évidemment les Etats du Golfe : baisse des recettes d'exportation d'énergie, chute de la valeur des avoirs bancaires, fort ralentissement du bâtiment, du tourisme. Ces Etats pourraient souffrir d'une récession prolongée. Mais comme le souligne le FMI « si les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient ont la conviction que le prix du pétrole sera à la baisse pour longtemps, ils vont probablement réduire leurs dépenses pour préserver leur viabilité fiscale ». En fait, plus le système bancaire était intégré, avant la crise, au système international, plus ces pays souffriront, comme les pays occidentaux, ce qui est le cas de Dubaï. L'ouverture de leur économie se manifeste ainsi négativement par leur perméabilité à la crise mondiale.
Toutefois, l'exemple d'Abou Dhabi ou celui de Qatar prouve que ces pays ont suffisamment consolidé leur position en moins de quarante ans pour être en état de poursuivre leur politique de modernisation à long terme, malgré la crise. La diversification de l'économie est déjà bien avancée : la part des hydrocarbures est passée de 70 % à 35 % du PIB en vingt ans. La sidérurgie, l'aluminium et la pétrochimie forment le coeur de leur industrialisation. Dubaï lance la création de pôles de recherche à vocation mondiale dans les télécoms, l'informatique, la santé et les biotechnologies. Partout, à Dubaï bien sûr, mais aussi à Qatar ou à Bahreïn, les services financiers contribuent de plus en plus à la production de richesses.
La composante intellectuelle et culturelle des plans de développement de la région doit être considérée, en particulier par notre pays, comme un des aspects les plus prometteurs des évolutions en cours. C'est d'ailleurs sur ces projets qu'Abou Dhabi ou Qatar attendent de la France une coopération marquée par le même dynamisme que pour la coopération de défense et la négociation des grands marchés commerciaux.
Or les universités et grandes écoles françaises n'ont pas une politique suffisamment dynamique et coordonnée d'implantation internationale, contrairement aux universités britanniques ou américaines. Il arrive qu'elles ne répondent même pas aux demandes formulées par les émirs eux-mêmes, comme l'a évoqué l'Emir du Qatar lors de l'audience qu'il a donnée à vos rapporteurs. L'école militaire de Saint-Cyr a bien répondu à la demande qatarienne et devrait se mettre en place. A Abou Dhabi, dont le contrat avec la Sorbonne comporte une clause d'exclusivité pour la région, il faudrait que Paris IV s'investisse vraiment dans la création d'une véritable faculté de Lettres, alors qu'on en reste, semble-t-il, au stade d'un cours de langue. Paris I, qui fait partie de l'ensemble « Sorbonne », n'a pas pu implanter une faculté de droit à Bahreïn en raison de l'exclusivité accordée à Abou Dhabi. Or il faudrait relancer le projet de formation de juristes dans cet émirat et que La Sorbonne, même si elle s'est subdivisée en plusieurs institutions jalouses de leur autonomie, mérite par une attitude universaliste, son beau nom d'université.
L'institution du musée Louvre-Abou Dhabi participe de ce projet d'ouverture sur le monde de l'émirat. Quelle que soit la polémique à laquelle ce projet a donné lieu en France et sans porter de jugement sur ses acteurs et leurs motivations, vos rapporteurs estiment que c'est un honneur pour notre pays d'être présent dans un ensemble de musées qui diffuseront les oeuvres d'art universelles dans une région charnière de l'Orient. Des millions d'Arabes et d'Asiatiques passeront par Abou Dhabi et y séjourneront. Qu'ils puissent découvrir les oeuvres collectionnées par notre pays et celles que l'émirat acquerra avec le concours de France-Muséum ne peut que favoriser la diffusion de la culture et la compréhension entre les peuples.
Toutefois, l'avenir de ces Etats reste incertain. Sept émirats ont su s'unir en une fédération dominée par le plus riche, Abou Dhabi, qui vient de faire la preuve de son sens des responsabilités en soutenant l'imprudent Dubaï dans la crise financière internationale. Bahreïn, Qatar, Oman gardent leur indépendance mais contractent des alliances au sein du CEAG. Tous se sentent menacés par le puissant Iran voisin. La faiblesse de leur assise territoriale et démographique, la présence de minorités chiites (qui ne sont majoritaires qu'à Bahreïn) alors que le pouvoir est détenu par des sunnites, le fait que l'administration de ces pays et la création de leurs richesses dépendent des cadres et des travailleurs étrangers, sont autant de facteurs de fragilité. Les pays occidentaux consommateurs d'énergie ont tout intérêt à participer à leur modernisation par la coopération culturelle et l'aide institutionnelle, ainsi qu'à leur défense militaire.
CHAPITRE VI - LA FRANCE ET L'EUROPE AU MOYEN-ORIENT
I. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE
La politique étrangère de la France depuis la Deuxième Guerre mondiale s'est organisée autour de quelques objectifs prioritaires : la construction de l'Europe, l'alliance avec les Etats-Unis et l'évolution au Moyen-Orient. Celle-ci n'a pas cessé de mobiliser l'attention de nos diplomates tant les intérêts que notre pays possède dans cette région sont importants et divers.
Le conflit israélo-arabe s'impose à la France, comme à l'ensemble de l'Occident, comme point de passage obligé dans leur relation avec tous les pays du Moyen-Orient, à l'exception de l'Iran. Mais si l'attitude de la France à l'égard du conflit façonne son image dans le monde arabe et influe sur les relations qu'elle entretient avec l'ensemble des pays de la région, il est loin d'épuiser les intérêts qu'elle y possède et les objectifs qu'elle y poursuit. Il convient, en dehors du conflit israélo-palestinien, de distinguer trois zones géographiques qui posent des problèmes différents : les pays de vieille présence française : Egypte, Liban, Syrie ; l'Arabie-saoudite et les pays du Golfe : Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Bahreïn ; les pays à majorité chiite : Iran et Irak.
A. LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
Sous la IV ème République, la France, rompant avec une « politique arabe » qui plongeait ses racines dans l'expédition d'Egypte de Bonaparte, avait choisi de soutenir Israël. Au point que notre pays devint le principal fournisseur d'armes de l'Etat hébreux et l'initia au nucléaire militaire.
L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 changea la donne. A la suite de la rapide victoire israélienne en juin 1967, le Gouvernement français considéra qu'« aucun fait accompli sur place » ne serait tenu pour acquis. Cet événement clôtura la période des relations privilégiées entre Tel-Aviv et Paris. Le Gouvernement vota, le 22 novembre 1967, en faveur de la résolution 242 du Conseil de sécurité qui établissait le droit à l'existence de tous les Etats de la région, y compris Israël, mais prescrivait l'évacuation par Israël des territoires occupés. Dans la conférence de presse qu'il tint le 27 novembre 1967, de Gaulle mit en cause Israël, « un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur ». Il justifia le changement de pied de la politique française en soulignant les racines historiques et affirma que le rapprochement avec le monde arabe «doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure ».
Cette politique gaulliste pro-arabe a été poursuivie à travers toutes les alternances politiques.
Valéry Giscard d'Estaing fit voter notre pays en faveur de l'admission de l'OLP aux Nations unies, provoquant l'indignation d'Israël. En 1975, il autorisa l'OLP à ouvrir un bureau à Paris et fit accepter par ses partenaires européens la déclaration de Venise en 1980. Celle-ci proclamait pour la première fois le droit à l'autodétermination du peuple palestinien.
François Mitterrand, jugeant excessive l'orientation pro-arabe de la politique giscardienne, entendit, au début de son septennat, relancer les relations franco-israéliennes. Il fut le premier Président français à se rendre en Israël et à s'exprimer à la Knesset, le 4 mars 1982. Mais il revint vite à la position traditionnelle de notre diplomatie après que le 6 juin 1982, au moment même où il accueillait le G7 à Versailles, l'armée israélienne envahissait le Liban, bousculant au passage la FINUL. Notre pays condamna l'invasion et participa à l'évacuation des Palestiniens de Beyrouth assiégée. La France avec les Etats-Unis et l'Italie participa à la mise en place de la Force Multinationale d'Interposition (FMI) qui permit le transfert de 15 000 combattants palestiniens vers le nord du Liban. C'est après le départ des contingents de la FMI qu'eurent lieu en septembre 1982 les massacres de civils palestiniens par les milices des Chrétiens libanais dans les camps de Sabra et Chatila.
Le piège libanais, avec son lot de prises d'otages et d'attentats terroristes jusque sur le territoire national, conjugué à la première guerre du Golfe, incita François Mitterrand à se désengager du Moyen-Orient et à mettre un terme provisoire à la politique arabe. Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères en imputa la responsabilité au monde arabe lui-même : « évoquer le monde arabe » dit-il « est un mythe en soi. Une politique arabe en est un autre » 62 ( * ) .
L'accession de Jacques Chirac à la présidence de la République en mai 1995, fit revenir la France vers sa politique traditionnelle au Moyen-Orient. Dans un discours prononcé à l'Université Al-Hassam du Caire en août 1996, il déclara que : « la politique arabe de la France doit être une dimension essentielle de sa politique étrangère. Je souhaite lui donner un élan nouveau dans la fidélité aux orientations voulues par son initiateur, le général de Gaulle... ».
Fondés sur la non-ingérence des grandes puissances, l'affirmation de l'indépendance des peuples et le recours aux instances régionales, les principes définis au Caire par Jacques Chirac étaient au service de deux objectifs : faire avancer le processus de paix israélo-arabe et instaurer un partenariat euro-méditerranéen, qui débouchera sur le processus de Barcelone.
Dans le conflit israélo-palestinien, Jacques Chirac fut gêné par la série d'actes antisémites qui survinrent en France à partir de 2000, au moment de la seconde « Intifada ». La France fut durement critiquée par le Gouvernement de Sharon qui n'hésita pas à accuser l'ensemble des Français d'antisémitisme. Jacques Chirac se sentit obligé de se rendre aux Etats-Unis en 2003 pour y rencontrer les grandes associations juives américaines. Il nomma également un ambassadeur itinérant « en charge de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire » ainsi qu'un nouvel ambassadeur de France en Israël.
Tout cela ne servit pas à grand-chose, car depuis les années 1960, c'est de Washington et non pas de Paris ou de Bruxelles que les capitales arabes attendent une solution au conflit qui les opposent à Tel-Aviv. Il en va de même avec les Palestiniens. La France continua jusqu'au bout à reconnaître Yasser Arafat en tant que représentant de la cause palestinienne et ses diplomates lui rendirent visite dans sa résidence de la Muqata'a à Ramallah assiégée par les forces israéliennes. La France l'accueillit et le soigna dans ses derniers jours. Il n'empêche : ce n'est pas de la France que les Palestiniens attendaient une sortie de l'impasse mais bien de Washington. Cela illustre les limites d'une diplomatie trop affective et trop personnelle.
Tirant les enseignements des succès et des échecs de la politique de son prédécesseur, le Président Nicolas Sarkozy a cherché davantage d'équilibre en faveur de l'Etat d'Israël. Ceci afin de trouver une position d'intermédiaire impartial, d' honnest broker, permettant à la diplomatie française d'être écoutée par tous et de jouer un rôle plus important.
Cette inflexion reposait sur le constat que si, en dépit de son capital de sympathie, la France n'était pas considérée comme un possible faiseur de paix, c'était à cause de son peu d'écoute du côté d'Israël. Nicolas Sarkozy s'est donc efforcé de se rapprocher d'Israël. Il a été le second président français à prendre la parole à la Knesset, en juin 2008, et y a prononcé un discours équilibré rappelant les constantes de la politique française : « Je suis venu vous dire que le peuple français sera toujours aux côtés de l'Etat d'Israël quand son existence sera menacée. (...) On doit la vérité à ses amis, sinon on n'est pas un ami. La vérité c'est que la sécurité d'Israël, sur laquelle la France ne transigera jamais, ne sera véritablement assurée que lorsqu'à ses côtés, on verra un Etat palestinien indépendant, moderne, démocratique et viable ».
Le ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner, a joué un rôle actif dans cette politique de rapprochement. La tragédie de Gaza, à la fin de l'année 2008, a mis en lumière la brutalité de l'armée israélienne et le cynisme de ses dirigeants. Les élections en Israël ont amené au pouvoir un Premier ministre se refusant à reconnaître le droit des Palestiniens à avoir un Etat. Depuis, et malgré les protestations d'amitié, la politique française vis-à-vis d'Israël hésite.
B. LA POLITIQUE DE LA FRANCE DANS LES PAYS DE VIEILLE PRÉSENCE FRANÇAISE : LIBAN, SYRIE, EGYPTE
Les liens historiques et affectifs de la France au Liban sont aussi anciens qu'importants et connus de tous.
Rappelons que, dans les années 1990, la France s'était retrouvée « piégée » au Liban devenu un enjeu entre Israël, soutenu par les Etats-Unis, la Syrie qui s'appuyait sur l'URSS et l'Iran qui instrumentalisait la milice Amal avant de miser sur le Hezbollah. Les prises de position de la France en faveur de l'indépendance libanaise l'ont exposée à une vague d'attentats sans précédents : assassinat de l'ambassadeur Louis Delamare à Beyrouth le 4 septembre 1981 par des Libanais du parti chiite Amal, probablement sur instruction de Téhéran ; attentat de la rue des Rosiers le 9 août 1982 ; attentat-suicide contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth qui cause la mort de 58 soldats français (241 soldats américains sont tués le même jour)...
François Mitterrand, conscient que la France faisait face à l'hostilité de la Syrie à cause du Liban, à l'hostilité de l'Iran à cause de son soutien à l'Irak, et à celle de la Libye à cause de sa politique tchadienne, sans parler de la tension qui caractérisait en permanence ses rapports avec Israël, opta alors pour un désengagement du Liban, en particulier, et du Moyen-Orient en général. Notre pays ne joua qu'un rôle limité dans la mise au point des accords de Taëf en 1990, qui mirent fin à la guerre du Liban et consacrèrent la légitimité de la tutelle syrienne sur ce pays.
Sous la présidence de Jacques Chirac, la politique de la France au Liban fut marquée par le gel des relations diplomatiques avec la Syrie, à la suite de l'assassinat du Premier ministre Rafic Hariri.
Aujourd'hui, nos relations avec le Liban sont redevenues excellentes. La France persévère dans son attachement à la légalité internationale et à l'Etat libanais, seul détenteur légitime de l'usage de la force. Mais elle a pris acte de l'importance politique du Hezbollah, qui s'est inséré dans le jeu politique, tout en développant ses capacités militaires.
Avec la Syrie, depuis 1946, les liens sont restés forts, mais le dialogue fut souvent tendu en raison des positions de nos deux pays sur le Liban. Ce fut le cas, en particulier, à partir de 2004 et plus encore en 2005 avec l'assassinat de Rafic Hariri, que les dirigeants syriens furent soupçonnés d'avoir commandité.
Ce fut le Président Nicolas Sarkozy qui décida de renouer le fil du dialogue, ce qui faillit mettre à mal les relations de la France avec l'Arabie saoudite. La venue du Président Bachir el-Assad au défilé du quatorze juillet 2008, puis la visite du Président Nicolas Sarkozy à Damas ont grandement contribué à sortir la Syrie de son isolement diplomatique.
Il semble aujourd'hui que cette stratégie audacieuse était la bonne, comme l'atteste la nomination d'un ambassadeur américain à Damas et la reprise d'un dialogue entre l'Arabie saoudite et la Syrie.
Les relations de la France avec l'Egypte sont moins passionnées qu'avec le Liban ou la Syrie. Toutefois, notre coopération culturelle, scientifique et technique est ancienne et qualitativement significative. Elle est largement orientée vers la promotion du français et la formation des élites. Outre la formation de quelques milliers d'étudiants en France, la coopération universitaire franco-égyptienne repose sur une implantation dans les plus grandes universités égyptiennes et sur l'Université française d'Egypte.
Le rôle actif joué par la diplomatie égyptienne dans le conflit israélo-palestinien, conjugué à la large convergence de vue entre les dirigeants égyptiens et français font du Caire un allié et un partenaire de notre pays dans la région.
C. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE DANS LA PÉNINSULE ARABE ET LE GOLFE
Longtemps absente de la péninsule arabe, la France n'a commencé à y développer sa présence qu'avec Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci y fit une visite d'Etat dans les pays du Golfe en 1980. La création de ces Etats est tout à fait récente : 1961 pour le Koweït, 1971 pour les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Qatar et Oman.
Jacques Chirac, dont la politique fut marquée par une relation personnelle forte avec le Roi Abdallah d'Arabie saoudite, continua dans cette direction.
Depuis 1996, les relations entre la France et l'Arabie saoudite s'inscrivent dans le cadre d'un « partenariat stratégique » et le dialogue est d'autant plus facile entre nos deux pays qu'il repose fréquemment sur une convergence de vues, sur des échanges commerciaux fructueux et une coopération scientifique et technique en développement. L'Arabie saoudite demeure le premier client de la France en matière d'armement et nous sommes son troisième fournisseur.
Nos relations avec les Emirats Arabes Unis (EAU) sont privilégiées car elles se situent dans le cadre d'un « partenariat stratégique global » conclu par Jacques Chirac en 1997 et qui inclut, outre un accord de défense exigeant, une coopération culturelle importante, comme l'atteste la réalisation en cours du grand musée du « Louvre Abou Dhabi ». Nos échanges commerciaux sont considérables et font des EAU, notre principal partenaire dans le Golfe. La récente construction de la base militaire navale d'Abu Dhabi ainsi que la concession d'emprises pour l'armée de terre et l'armée de l'air renforcent encore ce partenariat. Nos relations sont également excellentes avec Bahreïn et le Qatar comme l'atteste le projet de l'école militaire « Saint Cyr-Qatar ». En revanche, nos relations bilatérales ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être avec le Koweït, en dépit des visites officielles, des efforts déployés par notre diplomatie et de la conclusion d'accords de coopération en matière scientifique et technique et dans l'enseignement supérieur (Institut Français du pétrole, HEC, IEP...).
D. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE À L'ÉGARD DE L'IRAN ET DE L'IRAK
L'histoire des relations franco-irakiennes commence sous les frères Aref, présidents de l'Irak dans les années 1960, et non pas, comme on le croit souvent, en 1974, avec les déclarations réciproques d'amitié entre Saddam Hussein et Jacques Chirac. Il est vrai que c'est à cette époque que naît une politique française ouvertement pro-irakienne qui se traduira par la construction du réacteur nucléaire de recherches « Osirak » et la vente de mirages F1. François Mitterrand poursuivit cette politique. Comme tous les Etats occidentaux, la France prit parti en faveur de l'Irak lorsque celui-ci attaqua l'Iran en 1980. En 1983, la France prêtera même à l'Irak cinq avions Super-Étendard armés de missiles Exocet qui iront frapper le terminal pétrolier de Kharg.
En août 1990, la France condamne vivement l'invasion du Koweït et participe activement aux forces de la coalition anti-irakienne pendant la deuxième guerre du Golfe 63 ( * ) , ce qui aboutit à la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays.
Mais, en réalité, la France n'a jamais cessé d'avoir une politique favorable à l'égard de ce pays qui, vu de Paris 64 ( * ) , apparaissait comme laïc et républicain. En 1995, Paris parvient à faire voter une résolution de l'ONU autorisant l'Irak à vendre une quantité limitée de pétrole pour acheter nourriture et médicaments. En 1998, la France joue un rôle important dans la crise opposant Bagdad et l'ONU à propos de l'accès des inspecteurs onusiens aux sites pouvant abriter des armes prohibées. Enfin, tout le monde se souvient des tentatives de notre pays afin d'empêcher la troisième guerre du Golfe engagée sans l'aval des Nations unies.
En mai 2003, Paris vote en faveur de la résolution 1483 mettant fin à treize ans de sanctions et donnant aux forces américano-britanniques le contrôle de l'économie et de l'avenir politique de l'Irak. En juillet 2004, les relations diplomatiques sont rétablies au niveau des ambassadeurs.
En décembre 2005, notre pays signe un accord de réduction de la dette irakienne, qui représente pour la France un effort de quatre milliards d'euros. Enfin, en août 2007, Bernard Kouchner est le premier ministre des affaires étrangères occidental à se rendre en Irak, visite renouvelée en mai 2008 et suivie en février 2009 par celle du Président Nicolas Sarkozy, qui annonce le prochain retour des entreprises françaises en Irak. Notre coopération a adopté un rythme plus soutenu et s'est diversifiée : formation des élites, soutien et valorisation de la culture irakienne, aide humanitaire, etc. L'ouverture d'un bureau de notre ambassade à Erbil complétera la représentation de la France en Irak.
Les relations de la France avec l'Iran furent plus chaotiques.
Avant la Révolution islamique, la France avait de bonnes relations avec le régime du Shah d'Iran. En 1975, Framatome se voit confier la construction de cinq centrales nucléaires et l'Iran se voit attribuer une participation dans Eurodif, une compagnie créée pour produire de l'uranium enrichi. La révocation du contrat par le Gouvernement Bakhtiar en 1979 et l'arrivée de la République islamique mettent en péril les relations franco-iraniennes.
En dépit de la sympathie ressentie par les Iraniens envers la France pour avoir accueilli l'Ayatollah Khomeiny et les opposants de tous bords au régime Pahlavi, aucun privilège particulier n'est accordé à la France par le nouveau régime. Après la victoire de la Révolution, des vagues successives de réfugiés arrivent à Paris et en France, créant une tension entre les deux pays. Shapour Bakhtiar, ancien Premier ministre, est le premier réfugié dont l'extradition est demandée par la République islamique. Les services spéciaux iraniens tentent de l'assassiner une première fois en 1980, sans succès, avant d'y réussir en 1991.
A partir de 1981, le Gouvernement socialiste entretient des relations tendues avec la théocratie iranienne. En 1982, François Mitterrand refuse d'appliquer l'accord Eurodif et de fournir de l'uranium à l'Iran. En représailles celui-ci réclame le remboursement du prêt d'un milliard de dollars accordé par le Shah. Les dirigeants de l'opposition iranienne, particulièrement les moudjahiddines du peuple ainsi que Bani Sadr se réfugient en France à partir de 1981.
La prise de position de la France en faveur de l'Irak pendant la première guerre du Golfe déclenche une réaction violente de l'Iran qui prendra la forme de prises d'otages au Liban et d'attaques terroristes sur le sol français. La France se lance à partir de 1987 dans une action tendant à contrer les attaques terroristes, qui se solde par la rupture des relations diplomatiques. Celles-ci ne seront reprises qu'en 1988.
Après la deuxième guerre du Golfe, les pays de la communauté européenne cherchent à adopter une politique plus indépendante des Etats-Unis. C'est le cas en particulier de la France. Notre pays s'insurge contre la loi d'Amato-Kennedy en 1996 qui vise à sanctionner les sociétés qui commercent avec les « Etats voyous » dont fait partie l'Iran, avec qui Total avait conclu l'année précédente un contrat de forage.
Avec l'élection de Mohammad Khatami à la présidence, les pays européens essayent de rétablir le dialogue avec l'Iran. Hubert Védrine, ministre français des affaires étrangères, se rend à Téhéran en août 1998 et invite formellement Khatami en France, visite qui n'aura pas lieu.
Aujourd'hui, l'Union européenne représente la moitié du commerce extérieur de l'Iran, mais la part de la France reste négligeable par rapport à celle de l'Allemagne. Rappelons qu'un accord protégeant et encourageant les investissements a été signé par la France avec l'Iran en 2003.
L'actuelle crise au sujet du programme nucléaire iranien pourrait détériorer fortement les relations économiques entre l'Europe et l'Iran.
II. LA PRÉSENCE DE L'EUROPE AU MOYEN-ORIENT
On déplore souvent « l'absence de l'Europe » dans les affaires du Moyen-Orient. Formulé en termes aussi généraux, ce regret rend mal compte de la réalité. Celle-ci est, il est vrai, paradoxale. L'Europe est le premier partenaire économique des pays du Moyen-Orient. Plus de 50 % de son approvisionnement pétrolier en provient et 35 % des échanges commerciaux d'Israël se font avec elle. C'est elle aussi qui couvre l'essentiel des besoins financiers des instances palestiniennes. L'Europe fait à tous égards figure de poids lourd économique et financier dans la région. Ceci n'empêche pas son poids politique d'y être d'une surprenante faiblesse. Cette sorte d'asthénie politique a plusieurs origines.
D'une part, l'Europe à mis longtemps à se doter des institutions politiques nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre d'une politique étrangère. Le Traité de Lisbonne, quand il entrera en vigueur, comblera, dans une large mesure, cette lacune. Le Haut Représentant pour la politique étrangère disposera, grâce au poste de Vice-président de la Commission, qu'il cumulera avec sa désignation par le Conseil Européen, de moyens économiques et financiers qui lui permettront de se faire entendre.
Les divisions qui existent entre Européens sont la seconde cause de l'impuissance politique de l'Union. Ces divisions ne se sont jamais plus ouvertement manifestées que lors de l'intervention américaine en Irak. La France, l'Allemagne, la Belgique l'ont vivement condamnée, tandis que les nouvelles démocraties d'Europe centrale l'approuvaient et que la Grande-Bretagne y participait militairement. L'épisode irakien a eu la valeur d'un révélateur : il est apparu que les divisions entre Européens tenaient moins à des analyses divergentes sur les problèmes de la région qu'à l'intensité de leur relation avec les Etats-Unis.
Troisième cause de l'impuissance politique de l'Europe : elle ne dispose, en tant que Communauté, d'aucun moyen militaire lui permettant de s'affirmer sur le terrain. La France, l'Italie, la Grande-Bretagne et, plus récemment, l'Allemagne disposent de tels moyens, même s'ils ne se comparent pas à ceux des Etats-Unis. Mais l'Europe en tant que telle est militairement inexistante.
Il convient enfin de souligner que jamais ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont accepté que l'Europe intervienne dans les négociations entre Tel-Aviv et le mouvement palestinien qui sont au coeur de la problématique politique de la région.
Dans ces conditions, la présence de l'Europe au Moyen-Orient a pris deux formes. D'une part, l'Europe a pris position à plusieurs reprises sur le conflit israélo-palestinien dans des déclarations solennelles, formulées en termes forts qui souvent s'écartaient de la politique conduite par les Etats-Unis.
Elle s'est efforcée, d'autre part, de mettre en place et de faire vivre des structures de coopération entre pays du nord et du sud de la Méditerranée, estimant qu'en tissant des liens économiques on rapprocherait politiquement l'Europe du monde arabe.
A. L'EUROPE FACE AU CONFLIT ISRAÉLO-ARABE
L'idée d'un dialogue euro-arabe est née à la suite de la réaction des Etats arabes à la guerre des Six jours. En utilisant l'arme du pétrole, ils ont amené l'Europe à prendre position sur le conflit israélo-arabe et à ouvrir ce qu'il a été convenu d'appeler le « dialogue euro-arabe ». Dialogue entre « deux groupes » et non entre Etats, ce qui permettra ultérieurement, à Dublin en 1975, de faire droit à l'exigence formulée par la Ligue arabe d'associer l'OLP au dialogue.
Certes, les priorités des deux groupes étaient différentes : les Arabes voulaient amener les Européens à s'engager davantage dans la défense des droits des Palestiniens, tandis que les Européens souhaitaient avant tout s'assurer un approvisionnement régulier en pétrole.
1. La déclaration de Venise
La déclaration de Venise, en 1980, marque une étape essentielle dans la construction d'une position européenne commune sur le conflit israélo-palestinien. Elle affirme, notamment, que « le problème palestinien, qui n'est pas un simple problème de réfugiés, doit enfin trouver une juste solution. Le peuple palestinien, qui a conscience d'exister en tant que tel, doit être mis en mesure, par un processus approprié défini dans le cadre du règlement global de paix, d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination ». Le retentissement de ce texte est considérable. Les responsables américains ne cachent pas leur hostilité. Une véritable fureur s'empare d'Israël : le texte est qualifié d'unilatéral et de pro-arabe. Venise est assimilée à Munich. Le sort d'Israël est comparé à celui de la Tchécoslovaquie et l'Etat juif reproche aux pays européens d'élever une « organisation de meurtriers » -l'OLP- au rang de négociateurs de paix.
A la suite de la Révolution iranienne qui porte au pouvoir l'Ayatollah Khomeiny, le prix du baril flambe une deuxième fois, faisant passer au second plan la déclaration de Venise et mettant en sommeil le dialogue euro-arabe.
Ni l'invasion israélienne du Liban, ni la première Intifada en 1987, ni la proclamation d'un Etat palestinien par le Conseil national palestinien, le 15 novembre 1988, n'entraînent de réactions significatives de la part des pays européens, tandis que la première guerre du Golfe, en 1991, révèle leur impuissance militaire. Seuls les pays européens ont été incapables de restaurer la souveraineté du Koweït. Aussi, l'Europe a-t-elle été écartée par les Etats-Unis du processus de paix israélo-arabe qui s'en suivit.
La conférence de paix s'ouvre à Madrid en 1991 sans participation européenne. Mais les profondes oppositions entre les délégations palestinienne et israélienne font que les négociations se déplacent très vite à Washington. Des rencontres débutent à Oslo, dès septembre 1992, entre proches de Shimon Pérès et responsables de l'OLP. Mais ces rencontres sont à porter au crédit de la diplomatie norvégienne et non à une initiative européenne. En avril 1994 et en juin 1995, la Communauté européenne apporte son soutien au processus de paix, mais elle situe son action sur le plan économique.
En 1996, l'Union nomme un envoyé spécial en Palestine : l'ambassadeur espagnol Miguel-Angel Moratinos. Cette décision est prise dans le cadre de la politique européenne de sécurité commune (PESC).
En février 1997 est signé un accord intérimaire d'association entre l'Union et l'OLP qui concrétise l'engagement financier de l'Union en faveur de l'Autorité palestinienne.
2. La déclaration de Berlin
En mars 1999, la déclaration de Berlin reprend celle de Venise mais adopte un langage plus direct et plus clair. Elle proclame le « droit inconditionnel des Palestiniens à l'autodétermination, comprenant la possibilité d'un Etat » et « espère que ce droit sera concrétisé à bref délai ». L'Union satisfait néanmoins, à la demande d'Israël, de différer la reconnaissance d'un Etat palestinien. Par ailleurs, les Quinze poursuivent leur coopération économique avec la région en approuvant la même année le texte de la dixième convention entre l'Union et l'UNRWA ( United Nations Relief and Work Agency ) chargée de mettre en oeuvre le programme de l'Organisation des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
L'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en mars 2003 oppose les Européens entre eux : Français, Allemands et Belges sont hostiles à l'intervention. Le Premier ministre britannique, au contraire, s'aligne sur Washington, suivi par les nouvelles démocraties de l'Est. La division est d'autant plus vive que l'administration Bush attise les feux en opposant la « vieille Europe » à la « nouvelle ». Pendant ces années, les pays européens se divisent en deux camps en fonction du soutien ou non donné à la politique des Etats-Unis et, par voie de conséquence, à celle d'Israël.
La victoire sans appel du Hamas aux élections législatives de janvier 2006 confronte les Vingt-cinq à un dilemme : soit reconnaître les résultats du scrutin dont ils ont encouragé la tenue et surveillé le déroulement (900 observateurs internationaux ont attesté la régularité du scrutin), c'est-à-dire admettre la victoire du Hamas que les pays européens ont inscrit sur la liste des organisations terroristes en décembre 2001, soit ignorer le résultat des élections en se mettant en contradiction avec les principes démocratiques dont ils se réclament.
Le choix est d'autant plus difficile que la guerre menée par Israël contre le Liban en juillet et août 2006 s'inscrit dans le cadre d'une guerre contre les « organisations terroristes islamistes ». Le 1 er août 2006, les ministres des affaires étrangères des Vingt-cinq sont incapables de cacher leurs divergences et d'appeler à un « cessez-le-feu immédiat » au Liban, ce qui montre l'incapacité des Européens à s'entendre sur une politique étrangère commune.
B. LA COOPÉRATION TRANSMÉDITERRANÉENNE
Au cours des années 1990-2003 plusieurs initiatives sont lancées pour tenter de rassembler les pays des deux rives autour de la Méditerranée.
Un « dialogue 5 + 5 » est organisé en 1990 à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères tenue à Rome. Son but est d'engager un processus de coopération régionale en Méditerranée occidentale entre, d'une part, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et Malte pour la rive nord et, d'autre part, les cinq pays de l'Union du Maghreb Arabe, pour la rive sud. A l'issue des deux premières réunions (Rome en 1990 et Alger en 1991) les pays membres conviennent d'un programme ambitieux d'investissements. Mais les événements liés aux élections législatives en Algérie et les soupçons pesant sur la Libye dans l'attentat de Lockerbie provoquent le gel du dialogue pendant dix ans (1991-2001).
Le projet d'un partenariat euro-méditerranéen est relancé en novembre 1995 à Barcelone. Connu sous le nom de « processus de Barcelone », il associe les quinze États-membres de l'Union européenne de l'époque et les douze partenaires du sud et de l'est de la Méditerranée. Les objectifs poursuivis sont l'établissement d'une zone de libre-échange ainsi qu'une aide financière accrue et une assistance technique et administrative. Il s'agit d'établir une « zone de prospérité partagée ». Le partenariat s'organise autour de trois volets : politique et sécurité ; économique et financier ; social, culturel et humain. Des accords commerciaux bilatéraux et asymétriques entre l'Europe et chacun des pays méditerranéens sont signés d'abord en 1995 avec la Tunisie et Israël, deux pays qui absorbent près de 50 % des exportations communautaires dans le bassin méditerranéen, ensuite avec le Maroc (1995), l'Autorité palestinienne (1996) et les autres pays arabes.
Mais progressivement le processus de Barcelone s'enlise. Dès novembre 2000 la réunion de Marseille avait révélé toutes les difficultés de l'Union européenne à mettre en place des programmes d'aide économique cohérents face à des Gouvernements arabes peu désireux de s'engager dans des transformations économiques difficiles et qui reprochent à l'Union d'esquiver les difficultés politiques en privilégiant la dimension économique de son action. Du côté européen, on s'efforce de rappeler que le processus de Barcelone et le processus de paix au Moyen-Orient sont deux éléments qui ne se concurrencent pas mais, au contraire, se complètent. Pour les partenaires arabes, la solution du problème palestinien reste la condition sine qua non à tout rapprochement politique véritable avec l'Occident.
La Commission européenne propose en 2003 un nouveau concept, le « voisinage », défini de la façon suivante : « l'Union Européenne s'emploie à créer un espace de prospérité et de bon voisinage, un cercle d'amis, caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération ». Officiellement, la politique européenne de voisinage (PEV) ne se substitue pas au processus de Barcelone, mais le renforce.
Nicolas Sarkozy s'est efforcé de redonner vie au dialogue euro-arabe qui s'était essoufflé en créant « l'Union pour la Méditerranée » qui prolonge et rénove le processus de Barcelone.
Des projets structurants sont retenus : dépollution de la Méditerranée, autoroutes de la mer et autoroutes terrestres, protection civile, plan solaire, enseignement supérieur et recherche, développement des entreprises. La difficulté majeure rencontrée dans la mise en place des structures de gestion de ces projets a été celle de la participation de la Ligue arabe à tous les niveaux de concertation et de décision. Les Etats arabes n'entendent pas, en effet, aborder en ordre dispersé l'Union Européenne, ce qui eut déséquilibré le dialogue. Israël de son côté, s'est opposé à la participation de la Ligue arabe.
Le concept initial d'intégration disparaît au profit d'une liste d'actions concrètes à entreprendre. Née dans le contexte de l'élargissement aux nouveaux pays de l'Est, cette politique n'a pas convaincu les pays du sud de la Méditerranée qui attendent de l'Union qu'elle s'engage clairement sur le terrain politique.
Nicolas Sarkozy avait pensé qu'un tel blocage pouvait être évité en mettant l'accent sur des projets concrets. Il se trompait. Il fallut, à la réunion de Marseille, pour surmonter l'impasse, mettre en place des structures inutilement lourdes comportant cinq postes de secrétaires généraux adjoints dont un pour Israël et donner à la Ligue arabe la possibilité de participer à toutes les réunions. En revanche, le poste de secrétaire général n'a pas pu être pourvu. La Tunisie, à laquelle il était destiné, n'ayant pas obtenu le siège de l'Union, qui reste implanté à Barcelone, a décliné ce poste.
Depuis la tragédie de Gaza en 2008, l'Union pour la Méditerranée est en sommeil. Les Gouvernements arabes accusent l'Europe de s'acheter une bonne conscience en proposant des projets de développement faute d'avoir le courage de prendre clairement position sur le conflit israélo-palestinien. Les initiatives prévues ont été gelées. L'UPM n'a pas renoncé et le blocage des réunions ne signifie pas la fin des projets euro-méditerranéens. Mais le malaise est bien là. Le pourrissement de la situation israélo-palestinienne empêche les Gouvernements arabes de persévérer dans la voie de l'UPM, tant cela les mettrait en porte-à-faux avec leur opinion publique.
En marge de la coopération transméditerranéenne, l'Union et Israël ont lancé des négociations sur la libéralisation des services et des liaisons aériennes entre eux, et ont récemment conclu des négociations relatives aux produits agricoles, à la pêche et aux produits agricoles transformés. Fin 2007, le Gouvernement israélien a demandé à l'Union Européenne de lui reconnaître un « statut spécial » dans le cadre de la politique européenne de voisinage. L'Etat d'Israël voudrait participer à plusieurs politiques et programmes communautaires pour renforcer la coopération technologique et commerciale, mais également participer aux réunions du Conseil ayant trait à l'économie, l'environnement, l'énergie ou à la sécurité. Cette demande de « rehaussement » du partenariat israélo-européen a été accueillie favorablement lors du huitième conseil d'association qui s'est tenu le 16 juin 2008 dans le cadre de l'accord d'association conclu en 1995, en dépit de l'opposition du Parlement, mais son entrée en vigueur a été différée par la dramatique invasion de Gaza par Israël.
La politique extérieure de l'Union européenne se ramène, en définitive, à une « diplomatie du chéquier ». L'Union est le principal bailleur de fonds des territoires palestiniens. L'enveloppe globale des aides communautaires pour 2005 s'élevait à 280 millions d'euros, soit plus de 500 millions d'euros si on prend en compte les aides bilatérales des différents Etats européens. Au lendemain du retrait unilatéral israélien de Gaza, la Commission européenne a accordé en septembre 2005 des aides pour un montant de 60 millions d'euros, dont la majeure partie pour la reconstruction d'infrastructures à Gaza, l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que la réfection des axes de communication. En 2007, l'aide communautaire aux territoires palestiniens s'est élevée à 561 millions d'euros, (soit près d'un milliard d'euros si on y ajoute les aides bilatérales) et, en 2008, à 493 millions d'euros. En juin 2009, la Commission a déjà engagé 238 millions d'euros. Sur ces fonds, l'Union finance deux mécanismes importants. Le premier concerne la mission EUBAN-Rafah qui était initialement destinée à assurer la sécurité de la frontière entre l'Egypte et la Bande de Gaza au point de passage de Rafah. Les installations de cette mission ayant été détruites par l'aviation israélienne, son personnel est actuellement replié à Ashkelon. Vos rapporteurs ont pu en rencontrer les responsables qui restent dans l'attente. Le second est la mission EUPOL COPPS, créée à la fin de l'année 2005 pour former la police de l'Autorité palestinienne. Ces deux missions sont placées, depuis 2003, sous la responsabilité de l'envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient, Marc Otte qui a remplacé Miguel Angel Moratinos et que vos rapporteurs ont rencontré.
En conclusion, tant que les Européens limiteront leurs ambitions à de substantielles enveloppes financières, ils trouveront des interlocuteurs prêts à discuter avec eux. Mais s'ils sont plus exigeants sur les contreparties politiques qu'ils attendent, ils se verront opposer une fin de non recevoir. La raison en est simple : pourquoi Arabes, Iraniens ou Israéliens composeraient-ils avec une Union européenne dont la ligne politique n'est pas claire et qui est empêtrée dans les contradictions de ses vingt-sept agendas nationaux ?
CHAPITRE VII.- LES RECOMMANDATIONS
La question se pose pour certains pays européens de savoir s'il convient ou non d'avoir une politique étrangère active au Moyen-Orient et, si oui, dans quel cadre la conduire : celui solidaire mais aujourd'hui inefficace de l'Union Européenne, ou bien celui solitaire mais limité des diplomaties nationales ? Notre pays n'échappe pas à ces questions.
I. QUEL CADRE POUR QUELLE POLITIQUE ?
A. FAUT-IL UNE DIPLOMATIE ACTIVE AU MOYEN-ORIENT ?
La question peut paraître incongrue pour l'Angleterre ou la France qui entretiennent des relations étroites avec le Moyen-Orient depuis au moins deux siècles. Mais elle ne l'est pas pour d'autres pays européens.
L'Italie, par exemple, à travers ses quatre Républiques maritimes, a été le premier et pendant longtemps l'unique point de contact entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Comme l'écrivait Michelet à la fin du XIX ème siècle : « sauf Venise et quelques Français, personne en Europe ne comprit rien à la question d'Orient (...) . 65 ( * ) ». Il serait pourtant aujourd'hui difficile de définir en quelques mots la politique de l'Italie au Moyen-Orient, mis à part sa contribution déterminante à la nouvelle FINUL et sa présence au début de la deuxième guerre d'Irak au sein des forces de la coalition.
L'Allemagne a, jusqu'à présent, été volontairement absente du Moyen-Orient. S'en est-elle portée plus mal que la France pour autant ? Aujourd'hui la diplomatie allemande au Moyen-Orient semble sortir de sa paralysie. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, même si l'Allemagne est plus à l'aise pour négocier avec l'Iran que pour discuter avec Israël.
Les nouveaux pays européens de l'Est n'ont eu pendant toute la période soviétique que peu de contacts diplomatiques avec le Moyen-Orient.
A l'intérieur de la « vieille Europe » les Pays-Bas donnent l'impression de limiter leur politique au Moyen-Orient à leur soutien inconditionnel à Israël.
Mais même si chaque pays a sa propre histoire et ses propres inclinations, l'Europe, en général, et la France, en particulier, ne peuvent rester indifférentes à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce n'est pas une question de prestige sur la scène internationale. Ce n'est pas non plus qu'une question d'intérêts économiques, liés à l'importance de ces pays en matière énergétique ou à la taille de leur marché en matière d'armements et de biens et services.
C'est certes une question de sécurité pour l'Europe qui se veut et se pense comme une puissance pacifique et dont l'intérêt naturel est d'avoir les meilleures relations possibles avec le monde musulman qui vit à ses portes. La France sait, par expérience, que certains choix de politique étrangère au Moyen-Orient peuvent avoir un prix élevé.
Mais s'intéresser au Moyen-Orient, pour nous Européens, c'est tout simplement une question d'intérêt vital car ce qui se passe dans cette région du monde influence la vie quotidienne dans nos pays, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis, au Canada ni dans les autres pays occidentaux. L'harmonie entre les civilisations occidentales et orientales revêt une importance particulière dans la construction permanente de nos nations. C'est vrai pour la France qui compte cinq millions de Musulmans et près de 500 000 Juifs (la plus importante communauté juive d'Europe et la deuxième au monde derrière les Etats-Unis). Mais c'est vrai également pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La politique étrangère de la France au Moyen-Orient commence au Parlement par les lois qui y sont votées. Nul doute qu'une loi sur le port de la burqa influencerait la perception de notre pays dans cette région du monde.
Au-delà de la cohésion des nations européennes, le Moyen-Orient pose la question de la construction d'un ensemble plus vaste euro-méditerranéen, celui que contient en germe l'Union pour la Méditerranée. Il serait dommage que l'UPM devienne une institution inutile ou un « machin », car elle pourrait constituer un grand « dessein » pour l'Europe. Il y a en effet entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient des complémentarités évidentes en termes économiques que nous serions collectivement responsables de ne pas transformer en avantages comparatifs face à l'émergence de grands ensembles tels que l'Inde ou l'Asie. Il est important pour l'avenir de l'Europe comme pour celui de la France d'avoir une politique active au Moyen-Orient.
B. DANS QUEL CADRE CONVIENT-IL DE LA MENER ?
Le concept du Quartet associant les Nations unies, les Etats Unis, la Russie et l'Europe avait toutes les apparences d'une bonne idée. Hélas, dans les faits, ce concept s'est révélé inopérant, voire dangereux. Les conditions posées par le Quartet en 2006 pour dialoguer avec le Hamas constituent, comme on l'a vu dans la partie de ce rapport relative au conflit israélo-palestinien, un obstacle sur le chemin de la paix. Où était M. Tony Blair après la tragédie de Gaza ? Si on veut que le Quartet serve à quelque chose, il faut impérativement le rendre plus opérationnel.
L'Union Européenne offre le cadre idéal d'intervention, parce que potentiellement le plus puissant. Mais c'est malheureusement, pour l'instant, un cadre inefficace. Un double paradoxe marque en effet l'intervention de l'Europe au Moyen-Orient : l'Europe paie le plus, mais influence le moins ; l'Europe a pris des positions sur le Moyen-Orient très en avance sur celles de l'administration américaine d'aujourd'hui mais n'en a tiré aucun crédit.
L'évolution des positions de l'administration américaine rend désormais un rapprochement entre Européens plus facile. En effet, tous les pays européens comme les Pays-Bas ou les nouveaux pays de l'Est qui avaient une position très pro-israélienne du fait de leur soutien à l'administration Bush se trouvent aujourd'hui pris à contre-pied. A rebours, l'évolution de la politique de la France et le rapprochement opéré vis-à-vis d'Israël facilitent les choses. L'idéal serait donc de trouver un consensus au niveau européen. L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, si les Irlandais l'adoptent par referendum, sera sans doute un facteur favorable 66 ( * ) .
Mais même avec le traité de Lisbonne, la définition d'une politique étrangère européenne, dans un cadre qui ne sera toujours pas fédéral, continuera de se heurter aux limites actuelles : l'absence de vision commune entre les pays membres et la coexistence délicate d'une défense européenne embryonnaire avec une Alliance atlantique dominatrice. L'Europe est impuissante à agir au Moyen-Orient, parce que ce n'est pas un Etat et qu'elle ne dispose ni des moyens de définir une politique qui soit autre chose qu'un plus petit commun dénominateur, ni des instruments extérieurs de la puissance : une armée et une diplomatie.
Que faire ? Attendre les Etats-Unis d'Europe pour définir une politique étrangère au Moyen-Orient ?
Evidemment non. Aucun grand pays européen n'a renoncé à ses propres ambitions nationales, lorsqu'il en avait. C'est le cas en particulier pour la France et pour la Grande-Bretagne.
Dans l'attente d'une Europe fédérale qui ne verra peut être jamais le jour, c'est donc en se plaçant dans le cadre d'une coopération étroite entre quelques pays européens, qu'il faut agir et définir une politique pour le Moyen-Orient.
Plutôt que de se rendre de Tel-Aviv à Gaza, du Caire à Washington ou à Bruxelles, c'est à Londres, à Berlin, à Madrid, à Rome et dans quelques autres capitales européennes que nos diplomates devraient chercher à définir les grandes lignes d'une politique commune aux Européens sur le Moyen-Orient.
Certes, ce n'est pas une tâche facile et la non-coïncidence des calendriers électoraux n'y aide pas. Mais la recherche d'une ligne d'action européenne qui ne soit pas un consensus a minima doit être la toute première priorité de notre politique étrangère.
Si nous réussissions à agréger un groupe structuré de pays européens sur une politique clairement définie, il serait indispensable d'y associer la Turquie . La diplomatie habile et efficace que ce pays déploie au Moyen-Orient depuis deux décennies va dans le sens de la paix. Ce n'est pas un hasard. L'Europe et la Turquie ont besoin de cette paix plus que d'autres, car le Moyen-Orient est leur voisin. Dans cette perspective, il serait profitable d'associer la Turquie aux discussions avec l'Iran .
Enfin, bien évidemment, il faudrait que ce groupe euro-turc se concerte avec les Etats-Unis . Cela semble plus à portée que jamais. Il serait fâcheux de ne pas profiter de cette conjonction entre les politiques américaines et européennes. L'efficacité suppose qu'on arrive à y associer la Russie et la Chine qui est de plus en plus présente dans cette région du monde.
II. LES MESURES À PRENDRE
A. LES PRINCIPES STRATÉGIQUES
Une politique commune au Moyen-Orient doit être, à notre avis, guidée par trois grands principes.
1. Donner la priorité au conflit israélo-palestinien
Le conflit israélo-palestinien empoisonne la situation au Moyen-Orient. Mais ne soyons pas dupes. Il est manipulé par les uns et par les autres à des fins de politique extérieure aussi bien qu'intérieure. Peu s'en soucient vraiment. Les Palestiniens et les Israéliens sont les seuls à en pâtir.
Pourtant, tous les tenants et les aboutissants permettant de conclure la paix sont bien connus. Il ne manque que les partenaires pour la signer.
Les puissances occidentales doivent concentrer leurs efforts sur la résolution de ce conflit et s'engager avec la plus grande détermination sans se laisser dévier de cet objectif important pour la survie du peuple palestinien et la sécurité des Israéliens.
Cela ne mettra pas fin à tous les conflits en cours, mais réduira les tensions et apaisera le ressentiment anti-occidental. Il en va de notre propre sécurité.
2. Déconnecter le traitement des conflits
Au Moyen-Orient, plus que dans toute autre région du monde, la politique extérieure est utilisée à des fins de politique intérieure. C'est vrai en Iran. C'est vrai en Israël. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres Etats de la région tels que la Syrie ou l'Irak.
Les préoccupations électorales de Tzipi Livni et de Ehud Barak ont joué un grand rôle dans le déclenchement de l'offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. La dictature au pouvoir en Iran s'efforce par tous les moyens, y compris les faux aveux publics comme du temps de l'Union soviétique, de montrer que les troubles post électoraux ont été fomentés par l'extérieur, en désignant la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. En Syrie, les Assad jouent de leur ligne dure anti-israélienne et anti-occidentale pour museler le peuple qui souffre de la dictature et d'une transition économique contrôlée mais dont les plus grands bénéficiaires sont les membres du clan au pouvoir.
Dans ce contexte, tout semble interconnecté. Les acteurs politiques font du reste tout leur possible pour accroître cette impression de confusion. Le Premier ministre israélien s'est efforcé de lier les progrès sur le dossier palestinien au règlement de la question iranienne, c'est-à-dire à l'arrêt de son programme nucléaire. Quant aux dirigeants iraniens, ils instrumentaliseraient une attaque israélienne pour renforcer la répression interne et se poser comme les seuls vrais résistants à l'Occident dans le monde musulman.
Il est donc impératif de déconnecter les conflits et de refuser de conditionner, par exemple, les avancées sur le dossier palestinien à celles sur le dossier iranien.
3. Cibler les actions diplomatiques
Toute politique étrangère au Moyen-Orient doit prendre garde à éviter ce que le professeur au Collège de France Henry Laurens appelle « le jeu pervers des implications et des ingérences ». Traditionnellement les pays du Moyen-Orient sont enclins à demander l'intervention d'une puissance extérieure capable de les aider dans la résolution de leurs conflits intérieurs. Déjà au XX ème siècle, une bagarre entre chrétiens et druzes dans la montagne libanaise se traduisait par un règlement diplomatique entre Londres et Paris. Mais une fois que les puissances extérieures s'impliquent, les puissances locales dénoncent leur ingérence.
Par ailleurs, toute initiative de l'Occident en direction d'un pays du Moyen-Orient risque d'altérer les relations avec les autres Gouvernements. Il y a encore peu, se rapprocher de la Syrie mécontentait l'Arabie saoudite. Mais faire de l'Arabie saoudite le partenaire de référence dans le conflit israélo-palestinien mettrait en cause le leadership revendiqué par l'Egypte, etc....
Il semble donc souhaitable de limiter les actions diplomatiques au strict nécessaire, c'est-à-dire aux seules questions mettant en jeu notre sécurité, notre économie et la consolidation des relations bilatérales avec les Gouvernements et les sociétés civiles.
Le conflit qui nous oppose sur l'universalité des droits de l'Homme aux pays qui se revendiquent de droits musulmans de l'Homme doit être traité avec fermeté mais sans condescendance, ni agressivité. Mieux vaut apporter une assistance concrète aux militants des droits de l'Homme persécutés, leur accorder largement l'asile politique, soutenir l'action de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, d' Amnesty International , d'Human Right Watch , etc. L'égalité entre tous les êtres humains et le respect de la dignité de chacun doivent être réaffirmés fermement en paroles et surtout en actes.
B. LES ACTIONS À MENER
Vos rapporteurs ont identifié quatre problèmes majeurs appelant des actions rapides : le conflit israélo-palestinien, le programme nucléaire iranien, le Yémen et l'Irak.
1. Assurer un avenir au peuple palestinien tout en confortant l'existence de l'Etat d'Israël et consolider la paix avec la Syrie et le Liban
Nous avons vu dans ce rapport que la situation actuelle se caractérisait par l'absence de partenaires à la table des négociations. Les Palestiniens sont trop divisés et une réconciliation entre le Fatah et le Hamas paraît peu probable. Les Israéliens pensent ne pas avoir besoin de la paix, car leur armée dissuade tous les voisins et leur assure la sécurité. Par ailleurs, l'application du scrutin proportionnel intégral prive leurs dirigeants du poids politique qui leur permettrait de faire les concessions nécessaires dans une véritable négociation. Il faut donc s'attacher en priorité à ce que les Palestiniens puissent avoir un représentant unique et légitime, capable de négocier en leur nom, et convaincre les Israéliens qu'il est de leur intérêt de conclure une paix juste et durable.
Mais cela ne suffira pas. Il faut également un arbitre , car les parties en présence ne se mettront pas d'accord tant le déséquilibre des forces est patent et tant la volonté d'aboutir fait défaut. Déjà en 1948, à la suite de la résolution 181 de l'ONU, la situation avait dégénéré faute d'un suivi des conséquences du plan de partage par le Conseil de sécurité. En l'absence d'une intervention de l'ONU, les Etats-Unis et l'Union européenne, pour peu qu'ils agissent de concert, ont les moyens politiques et financiers d'être cet arbitre.
Convaincre Israël d'accepter la création d'un Etat palestinien dépend d'abord des Etats-Unis. Mais la capacité du Président américain à affronter les lobbies pro-israéliens au Congrès diminue à mesure que sa popularité décroît. L'Europe doit donc prendre le relais et l'aider à trouver les voies et moyens d'un règlement pacifique du conflit.
Jusqu'à présent, l'administration américaine a fait de l'arrêt de la colonisation l'indicateur de la bonne volonté israélienne à conclure la paix. Les pays européens, dont le nôtre, ont appuyé cette orientation avec détermination en exigeant de Benyamin Netanyahou le gel total de la colonisation. Mais paradoxalement, cela place le Premier ministre israélien en position de force. Il peut exercer une forme de chantage à la survie politique de son Gouvernement : si les pressions politiques se faisaient trop fortes, il perdrait sa faible majorité et il faudrait à nouveau attendre de longs mois pour avoir un interlocuteur israélien.
Une issue possible à cette impasse serait de tracer une frontière claire entre Israël et les Palestiniens. Cela ferait passer la question des colonies au second plan et permettrait aux colons de savoir qui d'entre eux peut rester. Cela réduirait d'autant les oppositions. Pour les colons situés dans les territoires appelés à ne plus être sous autorité israélienne, le choix pourrait leur être offert soit de partir moyennant finance, soit de rester en conservant leur citoyenneté israélienne dans le futur Etat palestinien. Des garanties de sécurité apportées par une force multinationale pourraient être envisagées. Les think tanks américains ont beaucoup travaillé sur cette question et de nombreuses solutions sont envisageables.
Cependant, le tracé d'une frontière suppose une négociation et donc un négociateur capable de parler au nom de tous les Palestiniens. C'est pourquoi l'hypothèse d'un retour pur et simple à la frontière de 1967, hypothèse avancée par Henry Siegman et le groupe du US/ Middle East project , présente dans sa radicalité l'avantage majeur de ne pas nécessiter de négociateur palestinien et d'éviter à avoir à évacuer les colons israéliens, puisque ceux-ci resteraient dans les colonies, mais sous souveraineté palestinienne. Une telle hypothèse n'est pas écartée par certains lobbies américains pro-israéliens tels l'Anti diffamation League d'Abraham Foxman. Pourquoi, après tout, le nouvel Etat palestinien ne devrait-il pas comporter en son sein de citoyens juifs ?
Malheureusement, l'attention de toutes les diplomaties se concentre sur l'arrêt de la colonisation. A supposer que ce gel devienne effectif, cela ne créera pas pour autant un Etat palestinien. L'administration américaine devrait peser maintenant de tout son poids sur le Gouvernement israélien pour obtenir la levée du blocus de Gaza.
Cette levée du blocus permettrait à l'Union européenne de jouer son rôle auprès des Palestiniens.
En effet, la désignation d'un Gouvernement palestinien d'Union nationale ne passera pas par la réconciliation entre le Hamas et le Fatah. L'Egypte a tout tenté pour y parvenir, mais après la tragédie de Gaza, c'était une mission impossible. En outre, l'Egypte a peu de moyens d'influence sur le Hamas. Cet échec prive non seulement les Palestiniens de représentants aptes à négocier, mais de surcroît rend la perspective d'élections législatives et présidentielles, en janvier 2010, difficile et, à ce stade, peu probable. Pourtant, à défaut de réconciliation, les élections sont indispensables pour départager les deux factions et désigner les négociateurs.
C'est là que l'Union Européenne peut mettre dans la balance son aide financière aux territoires palestiniens, aussi bien vis-à-vis du Fatah en Cisjordanie que du Hamas à Gaza, en conditionnant cette aide à la tenue des élections .
Cela suppose de mandater l'envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient pour parler au Hamas . En liaison étroite avec son homologue américain, Georges Mitchell, et bien sûr le Gouvernement d'Israël, cet envoyé spécial pourrait négocier la levée du blocus de Gaza contre la mise en place d'une Autorité palestinienne transitoire chargée d'organiser les élections et de choisir le mode de scrutin. Il pourrait également rendre compte aux pays européens du fait que la réforme du Fatah et de l'OLP, décidée au congrès de Bethléem en août 2009, entre bien en vigueur. La Turquie et la Syrie peuvent et doivent être associées à l'ensemble de ces actions.
Ensemble les Etats-Unis et l'Europe doivent exiger des deux parties des signes de paix. Ces signes sont non seulement le gel total des colonies, mais la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël, des prisonniers israéliens et palestiniens que détiennent le Fatah et le Hamas et un échange entre Gilad Shalit et Marwan Barghouti. C'est aussi la fin des expulsions des habitants palestiniens de Jérusalem et la levée complète des barrages en Cisjordanie. Une date limite devrait être envisagée. En effet, le gel des colonies et l'évacuation des colonies sauvages avaient déjà été promis par le Gouvernement israélien à Annapolis en 2007 et on sait ce qu'il en est advenu.
Le règlement du conflit israélo-palestinien est d'autant plus important qu'en dépend la paix entre Israël, la Syrie et le Liban . Vos rapporteurs estiment que rien ne sert de reprendre les négociations directes entre la Syrie et Israël sur la restitution du plateau du Golan, tant que n'existera pas un Etat palestinien viable. De même, il est inutile d'espérer que le Liban renoue avec une stabilité durable sans règlement de la question des réfugiés palestiniens.
2. En Iran, éviter la bombe et le bombardement
Au lendemain d'élections dont l'irrégularité est probable, le régime évolue vers une dictature pure et simple. Le régime iranien vient de montrer son visage le plus détestable : celui d'un régime instable, va-t-en guerre et paranoïaque. Pour autant, la politique étrangère de l'Iran n'est plus, depuis la fin de la guerre avec l'Irak, celle d'une Révolution islamiste prête à gommer sa spécificité chiite pour prendre la tête du monde musulman et des « déshérités ». L'Iran a fait prévaloir ses intérêts nationaux et Mahmoud Ahmadinejad poursuit l'orientation ultranationaliste de ses prédécesseurs. Ses déclarations outrancières et populistes sont destinées à son électorat. L'Iran a besoin de grossir la menace extérieure afin d'échapper à ses difficultés intérieures.
S'agissant du programme nucléaire, si aucune preuve formelle n'existe à ce jour permettant d'affirmer qu'il s'agit d'un programme à vocation militaire, de nombreux indices le laissent supposer. Ce programme d'apparence civile comporte vraisemblablement une option militaire qui n'a pas encore été levée par les dirigeants iraniens. Si elle l'était, l'Iran pourrait disposer d'un premier « engin » nucléaire à la fin de l'année 2010. Mais ce serait un engin unique, non validé expérimentalement et ne pouvant être emporté par un missile. L'acquisition d'un ensemble militaire dissuasif n'aurait pas lieu avant 2015.
Il y a lieu de s'interroger sur les raisons de craindre un Iran doté de l'arme nucléaire. Aussi bien Israël que les puissances occidentales sont dotés de l'arme atomique. En cas de conflit, les mécanismes de la dissuasion joueraient probablement tout autant qu'entre les protagonistes de la guerre froide. Les dirigeants iraniens font assaut de rhétorique anti-occidentale mais ils ont des intérêts rationnels à défendre. Toutefois la réélection de Mahmoud Ahmadinejad ajoute un facteur d'incertitude supplémentaire.
Le véritable danger pour la paix du monde serait l'inévitable nucléarisation du Moyen-Orient consécutive à celle d'Israël et de l'Iran. C'est pourquoi, il faut tout faire pour éviter que le programme nucléaire iranien ne devienne militaire s'il ne l'est pas déjà.
En cultivant l'ambiguïté l'Iran se croit sans doute en position de force. Si les négociations aboutissent, ses dirigeants auront obtenu des avantages économiques et politiques concrets en contrepartie du renoncement à un programme militaire virtuel. Si les négociations échouent, et que l'Iran est attaqué, il endossera la posture de la victime qu'il affectionne tant pour accroître sa popularité et son influence dans le monde musulman.
Or une chose est sûre : ni l'Occident, ni Israël n'arrêteront le programme nucléaire iranien par la force des armes. Ce qui a été construit peut être détruit, mais ce qui a été appris ne peut être désappris.
Eviterons-nous le programme nucléaire militaire par la négociation ? On peut raisonnablement en douter, compte tenu de la longue expérience que nous autres Européens avons en la matière. Il y a à cela une raison fort simple : le régime iranien actuel a besoin d'ennemis pour exister. Survivrait-il à une détente ?
Néanmoins, il faut donner une dernière chance à la négociation et soutenir le Président des Etats-Unis dans sa politique de la main tendue, qui n'est du reste que la position européenne initiale.
L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, mandatés par l'ensemble de l'Union, pourraient entamer une négociation avec l'Iran : en échange d'un arrêt des activités d'enrichissement d'uranium ils offriraient à l'Iran une coopération dans le nucléaire civil ainsi qu'un dialogue sur la sécurité régionale.
Si cette négociation échoue, il faudra envisager en dernier recours un renforcement de sanctions en s'efforçant d'y associer la Chine et la Russie. L'abandon du projet de bouclier anti-missile américain en Pologne et en Tchécoslovaquie va certainement dans ce sens.
Simultanément, il serait souhaitable de promouvoir l'objectif d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, à l'instar de celles qui existent en Amérique latine, en Afrique et en Océanie, dans le cadre d'un traité régional incluant Israël 67 ( * ) . C'est un des aspects de la dénucléarisation du Moyen-Orient dont il faut se préoccuper, faute de quoi les peuples du Moyen-Orient reprocheront une fois de plus à l'Occident de faire « deux poids, deux mesures ».
3. Sauver l'Etat yéménite de la faillite afin qu'il ne devienne pas la prochaine base d'Al-Qaïda
Le Yémen est un Etat dont on parle peu en Occident. Son importance stratégique est pourtant cruciale à la charnière de l'Afrique et du Moyen-Orient. Les Etats arabes de la péninsule, après y avoir beaucoup investi, donnent le sentiment d'avoir abandonné la partie. Un mur électronique pour surveiller la frontière avec l'Arabie saoudite est en construction.
Aujourd'hui, le Yémen n'est pas encore un Etat failli, mais il est en passe de le devenir. L'effondrement de son économie, la particularité de sa géographie avec ses hautes vallées aux contreforts inexpugnables, la faiblesse de son Gouvernement qui n'a vraiment d'autorité que sur la ville de Saana, tout cela peut en faire une nouvelle base pour les disciples de Ben Laden. Des groupes liés à Al-Qaïda y sont actifs et certaines madrasas, dans le nord du pays, accueillent de nombreux jeunes Européens. Rien ne servirait de gagner la guerre contre les talibans en Afghanistan pour devoir la poursuivre au Yémen.
Il faut sauver le Yémen de la faillite et de l'anarchie, dans son intérêt comme dans le nôtre. La réunion d'une conférence internationale sur l'avenir de ce pays devrait être organisée dans les meilleurs délais.
4. Accompagner l'Irak sur la voie de la reconstruction de son Etat
L'amélioration de la sécurité en Irak demeure fragile. L'Etat irakien connaîtra encore bien des troubles avant de reconstituer son unité. Certes les Kurdes n'ont pas renoncé à Kirkouk, qui est pour eux une sorte de Jérusalem. Mais ils n'ont pas l'intention de faire sécession, ne serait-ce qu'en raison des réactions qu'une telle décision susciterait en Turquie. Et puis des solutions pacifiques peuvent être mises en place, telles qu'un statut sui generis .
Le rétablissement d'une vie économique prendra encore plus de temps. Les infrastructures à l'abandon depuis 30 ans sont à construire ou à reconstruire. L'Irak peut les financer si la corruption ne capte pas la manne pétrolière. En outre, il faut que les Irakiens se mettent d'accord sur la répartition des recettes pétrolières et sur un cadre juridique suffisamment attractif pour les sociétés étrangères.
Par ailleurs, l'Europe peut et doit intervenir pour aider l'Irak à trouver des solutions avec ses voisins turcs et iraniens quant au problème de l'eau. Une action diplomatique de l'Union européenne envers la Turquie pourrait être engagée dans des délais assez brefs, si la Commission européenne acceptait de s'en saisir.
Quoiqu'il en soit, afin que l'Irak renaisse, les élections libres ne suffisent pas. Il lui faut également un Etat impartial : des fonctionnaires, des juges, des administrateurs, des enseignants, des universitaires, des militaires et des policiers au service de l'Etat. L'Europe peut l'y aider. La France, en particulier, qui a fait, hier, le choix de ne pas y avoir de présence militaire, doit, aujourd'hui, y développer sa présence civile.
CONCLUSION
Le Moyen-Orient est compliqué. Mais pas plus que l'Europe. Et contrairement à elle, il est en évolution rapide tout à la fois démographique, culturelle, économique et politique.
Certes, il y au Moyen-Orient des zones de fragilité. Le Yémen, l'Irak et le Liban en font partie. Des interrogations subsistent : Al-Qaïda, l'Egypte, la Syrie. Mais des évolutions positives se font jour en Arabie saoudite et presque partout dans le Golfe. La Jordanie comme le sultanat d'Oman font peu parler d'eux, sinon en bien. Hegel prétendait que les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
Nos concitoyens ont de cette région du monde une vision parfois approximative, fondée sur une histoire mal connue et faite de jugements à l'emporte-pièce. Nous voyons ses peuples et leur culture comme irrémédiablement différents de nous, notamment à cause de la religion, dimension à laquelle nous les réduisons trop souvent et qui masque une recherche de leur identité. En Europe aussi, la religion a été identitaire et a façonné l'histoire de notre continent en y laissant des marques de fer et de sang. Les tensions entre les chiites et les sunnites sont-elles si différentes de celles qui existaient entre les catholiques et les protestants ?
Le Moyen-Orient est à la même distance de l'Europe que l'Est la Russie. Son histoire est liée à la nôtre bien plus que celle de l'Asie. Son futur nous concerne plus directement que celui de l'Amérique du Sud ou de l'Océanie. Ce serait une faute de s'en désintéresser.
Car si l'Occident se révèle incapable d'assurer un avenir au peuple palestinien, l'Orient lui en tiendra rigueur, tant il ne voit en lui que le protecteur d'Israël. Si l'Occident se révèle incapable d'éviter que le programme nucléaire iranien ne débouche sur un arsenal militaire, alors la nucléarisation de l'entière région est presque certaine, ce qui ne sera pas un facteur de stabilité.
Au Moyen-Orient, les Etats-Unis incarnent cet Occident. Ils y sont du reste omniprésents, mais leur image est trouble. Détestée sous Georges W. Bush, l'Amérique séduit avec Barack Obama. Ce nouveau Président tient entre ses mains une partie importante de la solution concernant le conflit israélo-palestinien et l'Iran. Mais seul, il n'arrivera pas à imposer la paix. Les Européens peuvent l'aider s'ils se décident enfin à faire jouer à l'Union son rôle de grande puissance.
Les deux problèmes -la Palestine et l'Iran- ne sont pas liés, mais ils se nourrissent l'un l'autre et servent d'alibi à la procrastination. L'intérêt de l'Europe est d'oeuvrer de concert avec les Etats-Unis afin de trouver, dans l'un et l'autre cas, un règlement pacifique.
De la même façon, il importe de ne pas laisser le Yémen tomber dans l'anarchie et d'accompagner l'Irak dans sa difficile renaissance.
Puisse ce rapport contribuer à relever ces défis diplomatiques.
Comptes rendus devant la commission des déplacements effectués au Moyen-Orient
Premier déplacement - Arabie saoudite, Yémen, Abu Dhabi, Dubaï, Qatar du 19 au 30 octobre 2008 - (compte rendu du 12 janvier 2009)
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a tout d'abord rappelé les différentes étapes du déplacement dans la péninsule arabique qui a successivement conduit la délégation en Arabie saoudite, au Yémen, au Qatar et dans les Emirats arabes unis. Elle a précisé que cette mission avait été précédée de 19 auditions de diplomates, de chercheurs ou encore de membres des services de renseignements. La délégation a complété les 46 entretiens effectués au cours de la mission par une série de lectures qui lui ont apporté un éclairage décisif notamment sur les équilibres politiques à l'oeuvre en Arabie saoudite et sur les modes de légitimation de la famille Saoud face aux tribus. Elle a souhaité apporter, en complément des propos de M. Jean François-Poncet, des précisions sociologiques, géographiques et historiques.
Interrogée par M. Didier Boulaud sur les origines d'Oussama ben Laden, elle a indiqué qu'il était issu d'une grande famille de la bourgeoisie commerçante yéménite, alliée avec des familles du Hedjaz et originaire de l'Hadramaout, région frontalière de l'Arabie.
Elle a indiqué que la péninsule arabique était vue comme un grand tout alors qu'elle est marquée par les particularismes et autant de méfiances. Deux Etats de la péninsule sont très peuplés, l'Arabie saoudite, très riche, et le Yémen, très pauvre. Dans les autres Etats, la population est essentiellement étrangère. Il n'y a que 800 000 Dubaïotes à Dubaï, le reste de la population est composé d'une majorité d'Indiens, de Vietnamiens ou encore de Népalais, ce qui pose un vrai problème d'identité et d'existence nationale.
L'autre trait marquant de la région est le manque d'eau. Les principales villes du Yémen ne sont pas approvisionnées en eau. Dubaï est dépourvue de systèmes d'assainissement, ce qui conduit à des situations assez effrayantes.
La réserve démographique de la région est le Yémen, alors que les Saoudiens imaginent de construire un mur sur la frontière.
M. Josselin de Rohan, président, a indiqué que le Yémen semblait une proie pour les islamistes.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a estimé que ce pays, réunifié très récemment, où le pouvoir est usé, pourrait devenir un futur Afghanistan. Le président a tenu le pays, très pauvre, par une politique du « carnet de chèques ». Le voisinage de l'Erythrée et de la Somalie, avec leurs flux de réfugiés, est une source supplémentaire de déstabilisation.
M. Jean François-Poncet a rappelé que la mission confiée par le bureau de la commission avait le double objectif de publier un rapport d'information sur la situation du Moyen-Orient qui serait suivi d'un colloque. Ce rapport devra s'attacher à faire ressortir les caractéristiques principales de la région et à en évoquer les perspectives, en ayant à l'esprit ce que devrait être la politique européenne, la position et les intérêts de la France. Il a indiqué qu'en complément des quatre déplacements dans la région, une mission était prévue aux Etats-Unis, dont la politique constitue une des inconnues pour l'avenir du Moyen-Orient.
Evoquant les nombreuses auditions réalisées par les rapporteurs, il s'est déclaré frappé par la compétence des personnes travaillant en France sur le sujet. Il a indiqué que le déplacement dans la péninsule arabique répondait à deux préoccupations : se faire une idée des problèmes de la péninsule et de la façon dont ses dirigeants voient le Moyen-Orient.
Evoquant l'Arabie saoudite, il a indiqué que bien qu'un des analystes auditionnés ait décrit une situation prérévolutionnaire, ce n'est pas le sentiment qu'en avait retiré la délégation. Après la période de grande incertitude qui a suivi les événements de 2003, l'Arabie reste le pilier de la région, l'Etat le plus peuplé, dont le rôle régional et mondial, notamment comme premier producteur de pétrole de la planète, reste considérable. Le roi Abdallah, qui a exercé la réalité du pouvoir en qualité de prince héritier pendant longtemps, est un homme ferme et prudent, un réformateur déterminé, mais précautionneux. Il a fait adopter en 2006 une loi successorale créant un conseil d'allégeance qui comprend les enfants du roi Abdelaziz Ibn Saoud ou leur descendance, soit 35 membres chargés de désigner le successeur du roi. Il est assisté d'un comité médical qui peut constater une éventuelle incapacité. C'est un organisme stabilisateur alors que le saut de génération que constituera le passage aux petits-enfants du roi Abdelaziz est potentiellement source de déstabilisation.
La sécurité intérieure a été rétablie par une action policière à la fois efficace et intelligente qui s'accompagne d'une politique de réinsertion des personnes impliquées dans les attentats, que la hausse des prix du pétrole a permis d'accompagner financièrement.
Le pays dispose d'énormes ressources financières, 550 milliards de dollars de réserves et mène une politique de développement économique plus intelligente que lors des deux chocs pétroliers, marquée par la diversification et la construction d'infrastructures.
Pour autant, le pays n'est pas sans présenter certaines fragilités.
Il accueille 7 millions de travailleurs étrangers et comporte une minorité chiite installée dans les régions pétrolières et une minorité ismaélienne à la frontière du Yémen.
Les classes moyennes se jugent ignorées face au poids des religieux et une grande partie des jeunes est au chômage. On note cependant une évolution sociale certaine, notamment celle des femmes, dont le rôle dans les entreprises et les administrations est croissant.
Grâce au pétrole, à sa richesse financière, à son rôle de gardien des lieux saints, l'Arabie a un poids régional et mondial considérable. Ses prises de position internationales sont très retenues. Le plan de paix du roi Abdallah proposait ainsi le retour d'Israël dans les frontières de 1967 contre une normalisation des relations avec l'ensemble des Etats arabes. A la demande du président Karzaï, l'Arabie a engagé une entreprise de médiation en direction des Talibans.
Evoquant les Etats du Golfe, M. Jean François-Poncet a indiqué qu'ils étaient marqués par la faiblesse des populations autochtones. Le Qatar est le premier producteur mondial de gaz et dispose de ressources financières en proportion. Son rôle politique et de sécurité est moins lié à des moyens militaires propres qu'à la présence des forces américaines dans la région et à son rôle diplomatique qui contribue aux négociations de crises régionales. La place de la France a crû dans les Emirats où Abu Dhabi est son principal point d'appui. La France a signé avec ce pays un accord de défense en 1996, décision concrétisée par l'ouverture d'une base militaire française.
Evoquant ensuite le Yémen, M. Jean François-Poncet a considéré que s'il était vu en Arabie comme un Etat failli, ce n'est pas encore le cas. Des régions entières échappent certes à l'autorité du pouvoir central. Le nord, zaydite, est marqué par la rébellion houtiste qui a réussi à se maintenir face à l'offensive gouvernementale. Le sud, très longtemps autonome, est en sécession virtuelle. Le reste du pays est constitué de hautes vallées peuplées de tribus très autonomes. Des prises d'otages et des attentats ont lieu dans le pays, l'ambassade des Etats-Unis ayant été attaquée en mars 2008. Il semble qu'il y ait une communication régulière entre l'état-major de Ben Laden et certains groupes yéménites, mais il n'y a pas de traces de relations avec l'Iran.
Marqué par une natalité très élevée, le Yémen est le talon d'Achille sécuritaire de cette région, il faut par conséquent lui accorder de l'attention. L'Arabie saoudite est lasse de soutenir financièrement ce pays où la corruption est très importante. Elle a décidé d'installer une barrière électronique à la frontière.
Le président Saleh a été élu à deux reprises au suffrage universel sans que la sincérité du scrutin ait été mise en cause, mais son pouvoir ne s'étend pas très au-delà de la capitale, ce qui ne donne pas du pays une image très rassurante.
Evoquant enfin la perception par les Etats de la péninsule arabique des grands problèmes du Moyen-Orient, il a observé que si la question palestinienne était mise en avant, la véritable préoccupation de ces Etats était la nucléarisation de l'Iran. L'Arabie saoudite suit de près les événements du Liban avec le sentiment que l'Iran ne renoncera pas à son influence et fera durer les négociations. Questionnés sur ce qu'il convient de faire, les officiels font part de leur opposition à des frappes sur l'Iran, tandis que les think tanks considèrent qu'au-delà des positions officielles de façade elles paraissent à certains comme souhaitables et inéluctables, l'Iran n'étant en aucune façon disposé à renoncer à son programme nucléaire militaire.
Tous ont le sentiment que l'Irak n'éclatera pas et, tout en étant terriblement critique à l'égard de la politique menée par le président Bush, aucun n'envisage sérieusement le départ des Américains.
§ Deuxième déplacement - Syrie, Liban, Israël, Palestine, du 18 au 31 janvier 2009., (compte rendu du 3 février 2009)
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a tout d'abord évoqué la visite de la délégation en Syrie. Ce pays est composé de différentes communautés, avec une majorité sunnite et des minorités chrétienne, alaouite, druze et kurde dont le gouvernement parvient à maintenir l'unité d'une main de fer, tout en cherchant une certaine ouverture économique.
Sur le plan international, la ligne dure d'opposition à Israël permet au régime syrien d'assurer sa cohésion et d'être en phase avec son opinion publique. Mais, en réalité, la diplomatie syrienne s'efforce de maintenir une politique d'équilibre en jouant plusieurs cartes : le Golan, le Liban, le soutien au Hezbollah et au Hamas, mais aussi ses relations avec la Turquie ou la France, avec laquelle elle entretient une histoire complexe, faite d'attirance et de rancune, cristallisée autour de la question libanaise.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a ensuite rendu compte de l'entrevue, à Damas, avec Khaled Mechaal, chef du Hamas, en précisant que l'initiative de cette rencontre incombait aux membres de la mission et qu'elle avait été organisée sans l'assistance de l'ambassade de France. En effet, le Hamas est devenu un acteur incontournable dans la région et, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur cette organisation, il paraissait logique d'entendre son principal responsable.
Au cours de ce long entretien, Khaled Mechaal a présenté le visage d'un homme politique de premier plan, d'un authentique leader, et, à aucun moment, il n'a développé de discours à caractère religieux ou idéologique.
Concernant la récente intervention militaire israélienne à Gaza, il a rappelé que si le Hamas avait su imposer à ses troupes une trêve réelle et respectée d'août à décembre 2008, les habitants de la bande de Gaza n'en avaient tiré aucun bénéfice, puisqu'en échange de cette trêve, Israël n'avait pas levé le blocus de Gaza. Dans ce contexte, selon lui, le Hamas n'avait pas eu d'autre choix que celui de rompre la trêve.
La réaction israélienne a cependant surpris le Hamas par son ampleur et sa brutalité, faisant, d'après les chiffres de l'ONU, environ 1 300 morts palestiniens, dont la moitié de femmes et d'enfants.
Selon Khaled Mechaal, le Hamas, qui n'a eu à déplorer qu'une cinquantaine de combattants tués par l'armée israélienne, est sorti renforcé de l'offensive israélienne. Non seulement le Hamas tient toujours la bande de Gaza et peut toujours lancer des roquettes sur Israël, mais son mouvement a opposé une résistance qualifiée par le chef du Hamas de « légendaire ». Ainsi, à trois reprises, le Hamas a gagné une véritable légitimité : la première fois en devenant un mouvement national palestinien, la deuxième fois en remportant les élections, la troisième fois en résistant à l'offensive israélienne. Pour Khaled Mechaal, le Hamas doit donc être reconnu comme un interlocuteur, et un acteur central dans l'arène palestinienne, le Fatah et l'OLP s'étant déconsidérés aux yeux du peuple palestinien en collaborant avec Israël pendant le conflit.
Au sujet de la Charte du Hamas, qui contient de nombreuses références antisémites, il a laissé entendre qu'elle pourrait être abandonnée le jour où Israël reconnaîtra l'Etat palestinien dans ses frontières de 1967. Pour le présent, il a fait remarquer que ni Yasser Arafat, ni Abbu Mazzen n'ont obtenu quoi que ce soit en échange de la reconnaissance de l'Etat d'Israël.
Selon Khaled Mechaal, le Hamas veut la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien et l'Europe peut avoir un rôle à jouer, les Etats-Unis ayant jusqu'à présent échoué dans leur rôle de médiateur.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a ensuite évoqué la situation au Liban, dont l'ensemble de la classe politique est focalisée sur les élections de juin prochain.
Dans ce pays, les communautés se divisent en trois blocs : un tiers de Sunnites, menés par le fils de Rafic Hariri, Saad Hariri ; un tiers de Chiites, avec la milice Amal, qui ne compte quasiment plus, et le Hezbollah, dont le chef est Nassan Nazrallah ; enfin, un tiers de Chrétiens scindés en deux camps : celui des forces libanaises, avec Samir Geaga et son allié Michel Murr, qui ont fait alliance avec les Sunnites, et le général Aoun, qui, avec l'autre moitié des Chrétiens, a fait alliance avec le Hezbollah et la Syrie. Les Druzes de Walid Jumblatt protègent au mieux leurs intérêts.
Dans ces conditions, il semble que les Chrétiens seront les arbitres des prochaines élections en se ralliant à l'un ou l'autre des courants dominants et en permettant la constitution d'une coalition de gouvernement.
Quant au Hezbollah, le fait qu'il soit resté inactif lors de l'offensive israélienne à Gaza montre qu'il n'est peut-être pas la « marionnette » de l'Iran ou de la Syrie, comme le pensent certains, mais qu'il privilégie ses priorités politiques libanaises.
Enfin, malgré les violations quotidiennes de l'espace aérien libanais par l'armée de l'air israélienne, la FINUL est parvenue à faire respecter un certain ordre au sud Liban.
Abordant ensuite la visite de la délégation en Israël, Mme Monique Cerisier-ben Guiga a précisé que, compte tenu de la rencontre avec Khaled Mechaal à Damas, dont les autorités israéliennes ont eu connaissance, ni le ministère des affaires étrangères israélien, ni aucun responsable politique n'ont accepté de recevoir les membres de la mission, à l'exception de Haïm Oron, leader du Meretz, le parti de la gauche sioniste. La mission a toutefois pu rencontrer des personnalités intéressantes, telles que l'ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne, Avi Primor, et des think tanks .
L'impression générale qui ressort de la visite en Israël est que la sécurité semble n'y avoir jamais été aussi grande, sauf au centre-ouest où la population est durement marquée et traumatisée par les tirs de roquettes du Hamas qui frappent et tuent au hasard. Dans ces conditions, il semble que l'insécurité qui subsiste soit d'autant plus intolérable.
De fait, on ressent une grande frustration au sein de l'opinion publique israélienne, qui a le sentiment que le fait d'avoir rendu Gaza a été payé en retour par des tirs de roquettes sur le sud d'Israël, ayant provoqué la mort de vingt-cinq personnes en huit ans, et que le Hamas méritait une « bonne correction ». Les Franco-israéliens d'Ashkelon, que la délégation a rencontrés, pourtant directement visés par les tirs de roquettes, ont exprimé les difficultés de leur vie quotidienne d'une manière impressionnante.
A l'approche des prochaines élections législatives, il est probable, d'après les sondages, que la droite emmenée par Benyamin Netanyahu remportera ces élections et formera une coalition avec le parti travailliste d'Ehud Barak, le leader d'extrême droite Avigdor Lieberman et le parti ultra orthodoxe Shaas. Le parti de centre droit Kadima et Tipi Livni seront vraisemblablement les perdants de ces élections.
Enfin, le fossé avec les Arabes israéliens, marginalisés sur le plan économique et social, semble encore s'être accentué avec l'intervention de l'armée israélienne à Gaza.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a enfin évoqué le déplacement dans les Territoires palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza.
La mission s'est d'abord rendue à Ramallah, en Cisjordanie, au siège de l'Autorité palestinienne, où elle a eu plusieurs entretiens, notamment avec Salam Fayyad, le Premier ministre palestinien.
Elle s'est ensuite rendue dans la bande de Gaza où elle a pu constater par elle-même les destructions causées par l'intervention militaire israélienne. Certes, il n'y a pas eu à proprement parler de « guerre » à Gaza, puisqu'il n'y a pas eu d'affrontements armés avec les combattants du Hamas qui ont évité le combat, dès le début de l'offensive israélienne, commencée par un bombardement aérien massif et ciblé suivi d'une entrée des chars israéliens.
Il est également vrai que Gaza n'est pas Dresde et que la majorité des bâtiments de la ville sont encore debout. Cependant, compte tenu de l'extrême précision des armes israéliennes, les frappes ont été extrêmement ciblées et, dans cette mesure, il est difficile d'affirmer qu'il y a eu des « dommages collatéraux ». Il semblerait plutôt que les bâtiments pris pour cibles, tels que l'école américaine, l'hôpital du Croissant rouge palestinien, le dépôt de l'UNWRA, l'Agence des Nations unies qui contenait des vivres et des médicaments pour une valeur de sept millions d'euros, la zone industrielle (324 usines) ou encore les mosquées, aient été pris pour cibles délibérément par l'armée israélienne.
Dans deux cas au moins, dont la délégation peut témoigner, des bombes au phosphore ont été utilisées, l'une sur l'hôpital du Croissant rouge, l'autre sur le dépôt des Nations unies. Enfin, plusieurs organisations non gouvernementales ont confirmé le massacre de la famille Samouni à Zeitoun par des soldats israéliens.
En définitive, le bilan de l'opération « plomb durci » s'élève selon l'ONU, à environ 1 300 victimes, dont la moitié de femmes et d'enfants du côté palestinien et, du côté israélien, à trois civils et dix soldats tués.
Quant aux perspectives concernant le processus de paix, il apparaît qu'Israël est politiquement trop faible et militairement trop fort pour faire la paix.
Israël est politiquement trop faible, avec un régime parlementaire qui repose sur un pouvoir législatif monocaméral dont les membres sont élus à la représentation proportionnelle intégrale, ce qui fait que le Premier ministre est constamment l'objet du chantage des petits partis de sa coalition dont dépend la survie du Gouvernement, à l'image de la IV e République en France face à l'Algérie.
La force militaire d'Israël joue aussi en défaveur de la solution politique. L'efficacité du renseignement et du Mossad, reconnue par tous, et l'armée de l'air, dont le format est supérieur à celui de l'armée française, le rendent invincible dans une guerre conventionnelle. Cette stratégie, mise en place par Ben Gourion : du fait de la faible étendue de son territoire et de l'importance démographique des pays qui l'entourent, Israël ne peut pas, ne doit jamais être surpris.
De leur côté, les Palestiniens sont trop isolés et trop divisés pour faire la paix. Aux yeux de l'opinion arabe, les membres de l'Autorité palestinienne apparaissent comme des « collaborateurs » d'Israël et ceux du Hamas comme des « résistants ». Cette situation risque de fragiliser considérablement les Etats arabes partisans d'une ligne modérée, en particulier s'ils sont confrontés à des problèmes de succession à leur tête, comme c'est le cas pour l'Egypte ou l'Arabie saoudite.
Alors qu'avant le conflit de Gaza, certains pensaient que la question iranienne primait dans la problématique moyen-orientale, les événements ont montré la centralité du conflit israélo-palestinien. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza a encore compliqué une reprise du processus de paix. Si tout le monde s'accorde sur le principe de l'existence de deux Etats, dont un État palestinien dans les frontières de 1967, le démantèlement des colonies israéliennes en Cisjordanie risquerait probablement de provoquer une véritable guerre civile. Pourtant, des espoirs subsistent. Ainsi, la libération par Israël de Marwan Barghouti pourrait favoriser une réconciliation interpalestinienne.
La volonté du nouveau Président des Etats-Unis de s'investir sur ce dossier, exprimée par Barack Obama dès le lendemain de son investiture, avec la désignation d'un envoyé spécial, le sénateur George J. Mitchell, constitue également un signe de bon augure.
Enfin, l'Europe, à condition d'être unie et de parler d'une seule voix, devrait aussi peser de tout son poids.
M. Jean François-Poncet a ensuite fait les observations suivantes :
- en ce qui concerne la Syrie, il sera difficile de dissocier ce pays de l'Iran, tant les liens forgés entre les deux pays en opposition à Saddam Hussein hier, aux Kurdes et à Israël aujourd'hui, semblent solides.
Le soutien de l'Iran et de la Syrie au Hezbollah libanais et au Hamas devrait donc perdurer, sauf si la restitution du Golan par Israël devenait une réalité. La Syrie pourrait alors envisager de prendre ses distances vis-à-vis de l'Iran. Mais l'alliance entre les deux pays est pour le moment solide ;
- l'entretien avec Khaled Mechaal laisse le sentiment que le Hamas est prêt aujourd'hui à entrer dans une logique de négociation avec Israël à des conditions qui sont proches de celles des autres parties arabes ;
- concernant le Liban, la division du camp chrétien contribue paradoxalement à sa force électorale, en ce sens que les Chrétiens devraient être les arbitres des prochaines élections. Les Chiites d'un côté, les Sunnites de l'autre, font, paraît-il, le plein des voix dans leurs circonscriptions respectives, et ce sont les Chrétiens qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre ;
- s'agissant d'Israël, le sentiment de la délégation est qu'Israël se débat dans une impasse. Israël refuse un État palestinien viable dans les frontières de 1967, mais refuse également la solution alternative d'un État multiconfessionnel intégrant la population arabe. Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger sur la stratégie à moyen et long terme d'Israël. En l'absence d'une stratégie claire, le double refus d'Israël l'accule à poursuivre sa politique actuelle qui le conduit dans le mur.
L'évolution de la situation politique en Israël, avec la montée en puissance des religieux orthodoxes, y compris dans l'armée et sa haute hiérarchie, et une poussée à droite, voire à l'extrême droite du corps électoral, n'est guère rassurante. De plus, la marginalisation des Arabes israéliens risque de créer de très graves tensions internes qui appelleront tôt ou tard une politique de discrimination positive audacieuse en faveur des Israéliens arabes ;
- si l'offensive militaire israélienne à Gaza a été un succès relatif sur le plan militaire, elle a été, en revanche, à l'image de l'intervention de 2006 au Liban, un échec politique. En effet, le Hamas sort renforcé de l'épreuve. Le véritable perdant politique est l'Autorité palestinienne, de sorte qu'Israël n'a pas de véritable interlocuteur pour faire la paix. La libération par Israël de Marwan Barghouti serait de nature à aider à surmonter cet obstacle, favoriserait la réconciliation interpalestinienne et permettrait de relancer le processus de paix ;
- la volonté exprimée par le nouveau président américain de s'investir sur ce dossier et la désignation d'un représentant spécial qui connaît bien la région constituent des signes positifs, mais obligent les Etats-Unis à faire des progrès dans le processus de paix ;
- le démantèlement des colonies israéliennes en Cisjordanie et la question de Jérusalem seront les principales pierres d'achoppement du processus de paix ;
- enfin, l'Iran est devenu un acteur clef dans la région, dont l'influence sur le Hezbollah et le Hamas dépasse celle de la Syrie.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a ensuite indiqué, en précisant qu'elle s'exprimait ici à titre personnel, qu'elle avait été extrêmement choquée par la brutalité dont avait fait preuve l'armée israélienne à Gaza, qui s'apparentait à une punition collective infligée à un peuple, ce qui lançait un véritable défi à la communauté internationale.
Elle a estimé que l'Europe avait une responsabilité particulière pour enquêter sur ces actes et les condamner le cas échéant et, enfin, qu'elle devait peser de tout son poids pour aider à parvenir à une paix durable dans la région.
Après avoir remercié Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Jean François-Poncet pour leur compte rendu, M. Josselin de Rohan, président, a rappelé que, s'il appartient au Président de la République et au Gouvernement de conduire la politique étrangère de la France, le Parlement était quant à lui libre de prendre tous les contacts qu'il jugeait nécessaire afin de s'informer le plus complètement possible, chacun pouvant ensuite tirer les conclusions politiques qu'il souhaitait dans le respect évident du principe de responsabilité.
Mme Nathalie Goulet ayant regretté la passivité des autorités françaises lors de l'intervention militaire israélienne à Gaza, M. Josselin de Rohan, président, a contesté cette analyse, en rappelant que la France s'était beaucoup investie dans ce dossier, avec plusieurs déplacements dans la région du Président de la République et du ministre des affaires étrangères et européennes, qui ont notamment permis d'aboutir au vote d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies et à un plan de paix élaboré conjointement avec l'Egypte.
Interrogée par Mme Nathalie Goulet sur les suites qu'il conviendrait de donner à cette mission, M. Josselin de Rohan, président, a indiqué qu'elle déboucherait sur un rapport d'information et un colloque consacré à la situation au Moyen-Orient.
M. Josselin de Rohan, président, a également rappelé qu'un débat avait été organisé à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce sujet.
M. Jean-Pierre Chevènement s'étant demandé si la publication d'un rapport d'étape ne serait pas opportune, M. Jean François-Poncet a indiqué qu'un troisième déplacement était envisagé, en Egypte, en Irak et en Iran, ainsi qu'une visite aux Etats-Unis, afin de rencontrer les représentants de la nouvelle administration présidentielle, et qu'ensuite seulement serait établi un rapport d'information global dont l'objectif ambitieux était de faire une synthèse sur les évolutions actuelles et les perspectives au Moyen-Orient.
M. Robert del Picchia a estimé que, compte tenu du système électoral israélien, la victoire de la droite et de Benjamin Netanyahou n'était pas acquise. Il a également indiqué qu'il avait rencontré récemment le directeur adjoint de l'UNWRA, l'agence des Nations unies dans les Territoires palestiniens, qui lui avait affirmé, à propos du bombardement par l'armée israélienne des locaux de l'agence située à Gaza, que le Hamas n'avait jamais utilisé les sous-sols de ce bâtiment. Enfin, il s'est interrogé sur les effets de l'intervention israélienne sur les tunnels entre Gaza et l'Egypte.
En réponse, Mme Monique Cerisier-ben Guiga a fait valoir que tant qu'Israël n'aurait pas levé le blocus de Gaza, les tunnels entre Gaza et l'Egypte subsisteraient, car c'était le seul moyen pour les populations palestiniennes de la bande de Gaza de se procurer des vivres, des médicaments et des marchandises.
Elle a également mentionné les sondages d'opinion israéliens, qui font état de l'avance de la droite, même si le scrutin proportionnel intégral est un facteur d'incertitude.
Enfin, citant les propos de certains représentants de « think tanks » israéliens, d'après lesquels l'intervention militaire israélienne n'avait été qu'une « expérimentation », elle a indiqué que la France, lorsqu'elle a été confrontée au terrorisme, notamment lors de la destruction de l'immeuble Drakkar à Beyrouth, n'avait pas rasé des villages chiites de la Bekaa et que, face au terrorisme irlandais, le Royaume-Uni n'avait jamais bombardé Dublin ou Belfast. Elle a estimé qu'infliger une punition collective au peuple palestinien était inacceptable.
M. Jean François-Poncet a fait remarquer que si l'affrontement à Gaza était une « expérimentation », c'était surtout parce qu'il tirait les conséquences et les leçons de la guerre asymétrique à laquelle Israël avait été confronté, en 2006, au Liban.
M. René Beaumont a indiqué qu'il s'était rendu récemment au Liban, dans le cadre du groupe d'amitié France-Liban du Sénat, qu'il avait retiré de ce déplacement le sentiment que le Hezbollah était devenu un acteur incontournable sur la scène politique libanaise et qu'il s'interrogeait sur la possibilité pour les partis chrétiens, divisés, d'être les arbitres du scrutin à venir.
M. Robert Badinter a fait observer que la plupart des pays de la région étaient ou allaient être prochainement en campagne électorale, à l'exception notable de la Syrie. De plus, la vacance du pouvoir aux Etats-Unis pendant la période de transition entre les deux administrations avait fait de cette période la seule possible pour une intervention armée à Gaza.
Il a rappelé que, depuis sa création en 1948, l'Etat d'Israël s'était senti menacé dans son existence même et que cette angoisse se traduisait, en matière de politique étrangère, par la priorité donnée à la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël, le but ultime de la politique israélienne dans la région. Même s'il a dénoncé à plusieurs reprises par le passé la politique israélienne, notamment en matière de colonisation, il a considéré qu'il fallait tenir compte de cette donnée.
Il a également rappelé que le Hamas figurait sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et que ce mouvement avait toujours refusé de reconnaître le droit à l'existence d'Israël. Compte tenu du perfectionnement toujours plus grand de la portée et de la précision des roquettes dont dispose le Hamas, on peut craindre que ces armes soient bientôt capables d'atteindre Tel Aviv. Il s'est dès lors interrogé sur ce que signifient, pour le Hamas, les droits nationaux des Palestiniens, et si cela implique la reconnaissance de l'Etat d'Israël par ce mouvement.
Enfin, il s'est demandé si l'influence de l'Iran, à la fois sur le Hezbollah et le Hamas, n'était pas déterminante et n'en faisait pas un acteur clef dans cette région. Rappelant que les dirigeants actuels de l'Iran appelaient régulièrement à la destruction d'Israël, il a estimé qu'il y avait un risque qu'Israël cherche à se prémunir seul contre cette menace d'anéantissement.
En réponse, M. Jean François-Poncet a indiqué qu'il ressortait de son entretien, à Damas, avec le chef du Hamas, Khaled Mechaal, qu'il n'y avait pas de grande différence entre les revendications du Hamas et celles du Fatah et de l'OLP concernant les droits nationaux des Palestiniens : tous exigent un Etat palestinien viable dans les frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale et le droit au retour des réfugiés. Il avait eu le sentiment que le Hamas était disposé à entrer dans une logique de négociations, dès lors qu'il serait reconnu comme interlocuteur.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a observé que si le Hamas ne reconnaît pas officiellement l'existence d'Israël, il revendique la création d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967, ce qui implique une reconnaissance de facto d'Israël.
M. Jean François-Poncet a souligné que si la majorité des israéliens souhaitent la paix et sont prêts à accepter le principe de deux Etats, la situation politique intérieure n'incite guère à l'optimisme, de même que les colonies israéliennes en Cisjordanie, dont le démantèlement est aujourd'hui très difficile à envisager compte tenu de leur importance. On peut s'interroger sur l'attitude de l'armée si le gouvernement israélien décidait leur démantèlement.
M. Jean François-Poncet a fait observer que, dès lors que le Hamas entrerait dans la négociation, il reconnaîtrait implicitement Israël. Pour Israël, le meilleur moyen d'assurer sa sécurité et de faire la paix serait d'accepter l'existence d'un État palestinien.
S'agissant de l'Iran, M. Jean François-Poncet a estimé que la question centrale était de savoir si les Etats-Unis, l'Europe, les pays arabes et Israël pouvaient accepter l'idée d'un Iran nucléarisé, disposant de la bombe atomique. Il a considéré que l'Europe et les Etats-Unis pourraient finir par s'accommoder d'une telle situation. Mais en irait-il de même pour Israël, compte tenu du discours des dirigeants actuel de l'Iran ? La question du nucléaire sera centrale dans les négociations à venir entre les Etats-Unis et l'Iran. Il est vraisemblable que l'administration américaine n'acceptera pas éternellement les manoeuvres de retardement d'un Iran qui se rapproche de jour en jour de son objectif nucléaire. En cas d'échec, une tentative de destruction des sites nucléaires iraniens ne peut être totalement exclue.
M. Robert Badinter a estimé qu'il était difficile de savoir ce que voulait réellement Téhéran.
M. Josselin de Rohan, président, s'est interrogé sur la politique de la nouvelle administration présidentielle américaine dans la région et sur la possibilité pour l'Union européenne de s'impliquer davantage sur ce dossier. Quant à l'Iran, son objectif est d'être pleinement reconnu comme une grande puissance.
En réponse, M. Jean François-Poncet a considéré que les premières mesures prises par le Président Barack Obama montraient une réelle volonté des Etats-Unis de s'impliquer dans la région et que l'Europe pouvait lui apporter une aide utile, à condition d'être unie et de parler d'une seule voix.
§ Troisième déplacement - Egypte, du 22 au 27 février 2009. - (compte rendu du 11 mars 2009)
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a fait part de son inquiétude quant à la situation politique en Egypte. Même si le régime tient la situation intérieure d'une main de fer, le fait pour le Gouvernement égyptien d'avoir tenu une ligne diplomatique conciliante envers Israël lors de la guerre menée à Gaza a renforcé l'impopularité du régime, cela au moment où la situation économique s'aggrave et dans un jeu politique interne qui exclut, plus que jamais, toute hypothèse d'alternance.
L'image qui domine est celle d'une société bloquée. En dépit de ces tensions qui se traduisent par un retour important du religieux, d'une part, et des risques terroristes accrus d'autre part, le contrôle du régime sur la société civile reste fort, à l'approche de la succession du Président Hosni Moubarak.
Dans un pays de 80 millions d'habitants, dont 600 000 jeunes prêts à entrer sur le marché du travail chaque année, la situation économique est alarmante. Selon les indications fournies sur place par M. Youssef Boutros Ghali, ministre des Finances, 16 % de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Toutefois, le PNUD indique que 58 % de la population vivrait avec un revenu inférieur à deux dollars par jour.
Cette situation est appelée à se dégrader encore du fait de la crise économique mondiale. Selon le ministre des Finances, les trois « rentes » de l'économie égyptienne vont se réduire considérablement en 2009 :
- le tourisme -principale source de revenus avec 11 milliards de dollars par an- devrait voir ses recettes diminuer de 40 % ;
- les exportations de pétrole et de gaz devraient se réduire également de 40 % ;
- enfin les revenus du Canal de Suez devraient baisser de 25 %.
Au total, la croissance du PIB devrait passer de 7 % en 2008 à 4 %, voire 2 % en 2009, alors qu'un taux de 5 % est nécessaire pour assurer l'insertion des nouveaux entrants sur le marché du travail. Des troubles sociaux se produisent déjà en dépit de la répression : grèves, manifestations de groupes professionnels et le ministre des Finances s'attend à les voir augmenter.
Dans ce contexte, aucune hypothèse d'alternance politique ne semble possible.
Les Frères musulmans ne font pas l'unanimité et déclarent eux mêmes qu'ils ne sont pas prêts à prendre le pouvoir. Le responsable du bloc parlementaire des Frères musulmans, rencontré par la mission, a donné l'image d'un parti « raisonnablement » d'opposition, comparable en beaucoup de points à ce que fut la démocratie chrétienne en France et en Europe. C'est l'image d'un parti soucieux de conquérir l'opinion, par un programme social actif, plutôt que de remporter les élections, de crainte de susciter une réaction de l'armée et de la communauté internationale.
Entre le parti national démocratique, parti du pouvoir d'un côté, et les Frères musulmans de l'autre, les partis du centre sont fragmentés et leurs chefs emprisonnés. De plus, certaines formations centristes, comme Al-Wasat, sont interdites d'activité. Par ailleurs, les responsables charismatiques des partis du centre, tels que M. Ayman Nour, dirigeant du parti Al-Ghad, ont été emprisonnés. M. Ayman Nour a été condamné à cinq ans de prison ferme le 24 décembre 2005 pour faux et usage de faux dans la procédure de reconnaissance des statuts de son nouveau parti, un parti libéral créé en octobre 2004. Chacun comprend en fait qu'il a été condamné pour avoir été le principal rival du Président Moubarak aux dernières élections présidentielles de septembre 2005, où il avait obtenu 7,3 % des voix, ce qui est énorme dans un pays où la participation est très faible (de l'ordre de 10 %). Sa libération récente serait le résultat de pressions américaines fortes à la veille de la venue de Mme Hillary Clinton à Sharm El Cheick.
Enfin, la politique étrangère de l'Egypte suscite l'incompréhension et l'opposition silencieuse des Egyptiens.
Pendant les événements de Gaza, la population égyptienne a vibré en sympathie avec les souffrances des Palestiniens de Gaza. Par contraste, la gestion de cette crise par le Gouvernement Moubarak a été considérée comme très conciliante avec Israël. Sa rencontre avec Mme Tzipi Livni, l'avant-veille du déclenchement du bombardement, a donné le sentiment, à tort ou à raison, que le président Moubarak « était dans le coup ». Les autorités égyptiennes ont limité les manifestations et empêché les grands rassemblements. Le Gouvernement n'a pas laissé entrer à Gaza l'aide qui a été apportée par la population égyptienne (médicaments, nourriture...) ou, quand il l'a fait, c'était trop tard. Enfin, le Gouvernement a paru bloquer le point de passage de Rafah, ce qui a été très mal compris par la population qui ignore le rôle déterminant joué par Israël sur le contrôle de ce point de passage, dans le cadre des accords de 2005.
Par ailleurs, la volonté de l'Occident d'empêcher la réalisation du programme militaire nucléaire iranien aboutit à rendre l'Iran sympathique à la population égyptienne, pour laquelle l'Iran est un pays lointain, et pas nécessairement ami. Néanmoins, le fait qu'il se dresse seul contre l'Occident et l'application par ce dernier d'une politique dite du « double standard » (oui au nucléaire Israélien - non au nucléaire iranien) entraîne un fort sentiment « d'injustice » qui traverse toutes les strates de la population.
La conjugaison de ces trois types de tensions se traduit par un mal-être généralisé dans la population. Les personnes rencontrées, notamment celles issues des milieux artistiques et intellectuels, ont parlé de sentiment de « honte » à cause de leur impuissance individuelle à manifester leur solidarité envers les Gazaouis, en raison de la répression policière. Le peuple égyptien, qui éprouve un vif ressentiment contre le Gouvernement, se sent atteint dans sa fierté nationale... C'est une révolte sourde.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que cela se traduise par une crispation identitaire et des risques accrus d'attentats. Cette crispation prend en particulier la forme d'une religiosité renforcée.
On parle souvent « d'islamisation » pour décrire ce phénomène, mais c'est oublier que cette société a toujours été profondément musulmane. Il serait plus exact de parler de retour du religieux, celui-ci étant compris comme une affirmation identitaire de distanciation par rapport à l'Occident. Les termes de « désoccidentalisation » ou de rejet de l'Occident -entendus comme englobant tout à la fois Israël, les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe- seraient plus exacts. De fait, le port de la barbe islamique, souvent synonyme pour les Occidentaux d'extrémisme, est perçu par la population comme un gage d'honnêteté, de moralité. Ce rejet concerne les valeurs de l'Occident et sa politique au Moyen-Orient, non ses technologies. Les signes extérieurs d'appartenance à l'Islam sont fréquents dans des métiers nécessitant un haut niveau d'études tels que les médecins, les avocats, les ingénieurs ou encore les informaticiens. C'est même dans ces secteurs que les Frères musulmans recrutent leurs cadres et leurs adhérents.
Cette crispation crée des tensions importantes au sein de la société. Les confrontations entre les chrétiens égyptiens et les musulmans ont été particulièrement violentes ces dernières années. Ces confrontations se sont traduites par un affichage délibéré des signes d'appartenance religieuse, en particulier sur les véhicules, ce que le Gouvernement a interdit.
Le retour du religieux se traduit également par une délégitimation du mouvement d'émancipation féminine à l'occidentale à laquelle avait adhéré la bourgeoisie citadine dès les années 1920. Mais les femmes étudient, travaillent, sont très présentes dans l'espace public, voilées, avec beaucoup de coquetterie parfois. Le voile permet aux jeunes femmes des milieux les plus patriarcaux et conservateurs de quitter l'espace familial, d'étudier, de travailler.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a précisé que, d'après les informations fournies sur place, l'attentat du 22 février dernier au Caire a probablement été le fait d'un petit groupe de terroristes improvisés. La bombe était artisanale, d'une puissance explosive faible. L'attentat n'a pas été revendiqué.
L'Egypte a déjà connu ce type d'attentat, en 2005. Il s'agit d'initiatives groupusculaires qui expriment par la violence un malaise général. Cela n'obéit pas, semble-t-il, à une stratégie d'ensemble de déstabilisation du régime comme c'était le cas dans les années 1980.
Les Français étaient-ils visés ? Il paraît probable que la France ait été ciblée, compte tenu de l'amitié proclamée entre le Président Moubarak et le Président Sarkozy et de l'envoi de la frégate Germinal au large de Gaza pour mettre fin à la contrebande par voie de mer. Mais cela ne peut être prouvé, du moins pour l'instant.
La question est de savoir si le régime de M. Moubarak en sort affaibli. La réponse est très certainement négative. Au contraire, la majorité des Égyptiens est ulcérée par ce type d'attentat qui choque l'opinion populaire et met à mal le tourisme, source principale de revenus pour 1 million de salariés égyptiens. Mme Monique Cerisier-ben Guiga a évoqué à cet égard le fait que, même si cela relevait du stéréotype, les Egyptiens étaient des gens gentils, peu enclins à la révolte. Le pays n'a connu que peu de révolutions depuis deux siècles. Celles qui ont eu lieu n'ont duré que quelques jours (1919, 1952). Toutefois, la dureté de la vie quotidienne pourrait induire plus de violence sociale et politique. La répression policière n'explique pas tout. Dans ces conditions, Mme Monique Cerisier-ben Guiga a préféré parler de la résilience du peuple égyptien, c'est-à-dire de sa capacité à résister à des conditions de vie insupportables avec comme seule arme l'exutoire de son humour.
La société égyptienne est une société très contrôlée. Les services de sécurité sont partout présents et le quadrillage de la population est d'autant plus facile à réaliser que le niveau de vie est bas : tout peut s'acheter et surtout l'information. L'armée et les services de renseignement oeuvrent en étroite symbiose avec le Parti national démocratique (PND) au pouvoir.
Le mouvement des Frères musulmans est divisé en deux courants principaux :
- celui dit des « classiques » qu'on peut qualifier de « radicaux » qui prônent la fusion des autorités religieuses et politiques ;
- et le courant dit des « progressistes » ou « libéraux » qui prônent, au contraire, une stricte séparation des autorités politiques et des autorités religieuses.
En emprisonnant systématiquement les chefs de l'aile progressiste, le Gouvernement Moubarak cherche à laisser le monopole de l'opposition islamique aux Frères musulmans les moins fréquentables, et donc à renforcer leur rôle d'épouvantail.
Par ailleurs, en emprisonnant les dirigeants centristes dès lors qu'ils sont charismatiques, le Gouvernement de M. Moubarak arrive à créer une situation politique telle que ce soit « lui ou le chaos ».
Tout a été préparé pour que M. Gamal Moubarak, le fils du président égyptien, ait un réel pouvoir sur le PND. Très occidentalisé, c'est un homme d'affaire entreprenant. Néanmoins, sa candidature présente beaucoup de handicaps, à commencer par le fait que la désignation du fils par le père n'est pas du tout acceptée dans une population qui rejette le modèle syrien - sous entendant que l'Egypte est une vraie République, pas une monarchie déguisée. Par ailleurs, le fait que ce fils ne soit pas issu des rangs de l'armée ne garantit pas à celle-ci la consolidation de ses avantages et de sa suprématie. Enfin, en tant que fils du Président, une partie de l'impopularité présidentielle retombe sur lui.
En revanche, il est certain que celui qui sera choisi le sera au vu des gages de stabilité qu'il aura été capable de donner. Il semble, selon les procédures constitutionnelles, si elles sont respectées, qu'un petit nombre de personnes au sein du PND soient éligibles à la magistrature suprême et que le choix définitif sera lui-même effectué par un groupe restreint. Ce choix ne devra pas entrer en conflit avec les orientations de l'armée.
Mais la question de savoir qui sera choisi importe peu, en réalité. L'essentiel est que le nouveau président offre des garanties fortes de maintien de l'ordre et de suprématie politique et économique pour l'armée. De ce jeu d'hypothèses, on peut retenir que tout dépendra du moment où se réglera la succession :
- du vivant de Moubarak, son fils Gamal aurait ses chances,
- après son décès, l'armée imposerait son homme.
Au total il faut retenir que, depuis 1952, la seule légitimité reconnue en Egypte est militaire. L'armée est une puissance politique et économique de premier plan. C'est le premier propriétaire foncier du pays, avec ses usines de production militaires et civiles, ses programmes d'investissements touristiques, ses généraux retraités présents au Parlement, dans la diplomatie, comme dans le secteur économique. C'est une société parallèle qui fournit à tous les officiers logements, soins médicaux, centres de vacances, etc... Elle ne se laissera pas écarter du centre du pouvoir.
Dans ces conditions, l'hypothèse la plus vraisemblable paraît être actuellement celle d'une présidence du ministre de la sûreté intérieure, le général Omar Souleiman. C'est du reste l'option retenue par le responsable des Frères musulmans.
En conclusion, Mme Monique Cerisier-ben Guiga a dit que si la société égyptienne ressemble fort à une marmite sous pression, celle-ci est bien fermée. Il y a la soupape d'une liberté d'expression limitée à des thèmes, à des médias restreints et à une frange de la population. L'explosion semble exclue. Si une déstabilisation devait se produire, il est probable qu'elle viendrait davantage d'un choc externe, d'une crise régionale majeure. L'Egypte reste un pays de référence dans le monde arabe en raison de son poids démographique et de la qualité de ses élites intellectuelles (scientifiques ou diplomatiques, par exemple). Toutefois sa dépendance des Etats-Unis et sa volonté de ne plus entrer en confrontation avec Israël fragilisent sa position au Moyen-Orient. Son influence diplomatique se limite à la question du conflit israélo-palestinien sur lequel elle veut garder la main.
Pour être efficace, la diplomatie de la France au Moyen-Orient doit tenir compte de la multiplicité des pôles de pouvoir : Egypte, Qatar, Arabie Saoudite. La guerre froide au sein de la Ligue arabe doit inciter à la prudence dans nos alliances et nos prises de position publiques si nous voulons éviter de nous aliéner les uns et les autres.
M. Jean François-Poncet a ensuite formulé trois remarques. En premier lieu, il a déclaré que l'Egypte est un pays où la crise économique va entraîner ou risque d'entraîner un ébranlement profond, même si l'économie égyptienne est peu globalisée. Néanmoins, cette économie a beaucoup progressé. Une décélération très forte est à prévoir et dont l'impact sur la société est inconnu.
En second lieu, il a évoqué la succession de M. Hosni Moubarak, qui est le sujet dont tout le monde parle au Caire. Il a déclaré que la mission n'était pas revenue avec une idée claire sur le sujet. Le fils du président est certes en campagne. Il est bien formé et présente l'image de quelqu'un de moderne mais il n'appartient pas à l'armée. Le sentiment de l'armée vis-à-vis de Gamal est peu clair. Les Frères musulmans disent que le prochain président sera le général Omar Souleiman, ministre de la sécurité, mais âgé de soixante-treize ans. Il est vrai qu'il n'y a pas d'autre leader qui ait son envergure. Son accession au pouvoir pourrait constituer une phase d'intérim entre M. Hosni Moubarak et M. Gamal Moubarak.
Enfin, il a déclaré que, malgré les critiques qu'elle suscite, l'Egypte joue un rôle très important dans le dialogue interpalestinien dont les réunions ont lieu au Caire.
En conclusion, M. Jean François-Poncet a déclaré que l'Egypte était un pays important avec néanmoins deux épées de Damoclès au-dessus de sa tête : la crise économique et la succession de M. Hosni Moubarak.
§ Quatrième déplacement - Iraq, Jordanie, Bahreïn et Koweït du 28 mars au 6 avril 2009 et cinquième déplacement - Kurdistan, Turquie du 6 au 12 mai 2009 (compte rendu du 13 mai 2009)
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a rappelé que sa collègue, Mme Monique Cerisier-ben Guiga et lui étaient allés à Bagdad, un mois auparavant, et qu'ils revenaient de l'Iraq du nord, ou « Kurdistan », et de Turquie. Sur le point de partir aux Etats-Unis, ils achèveraient leur mission sur un déplacement à Bruxelles en juin prochain.
M. Jean-François-Poncet, rapporteur, a ensuite indiqué que, selon lui, trois sujets dominaient la situation au Moyen-Orient : le conflit israélo-palestinien, le programme nucléaire militaire iranien et l'avenir de l'Iraq.
Jusqu'en 2007, l'avenir de ce pays restait obscur. Depuis, un renversement s'est produit dont on peut se demander s'il ne finira pas par transformer « l'erreur historique » des Etats-Unis d'envahir l'Iraq en succès. Trois questions se posent : la pacification est-elle réelle ? Survivra-t-elle au départ des forces américaines ? Comment le nouvel Iraq s'insérera-t-il dans son nouvel environnement régional et international ?
A la première question, que tout le monde se pose, de savoir si la sécurisation est un mythe ou une réalité, M. Jean-François-Poncet, rapporteur, a clairement apporté une réponse positive dans trois domaines : la sécurité, la démocratisation et la question nationale.
A l'appui de sa réponse, il a tout d'abord indiqué que l'amélioration était sensible sur le plan de la sécurité. Cette affirmation résulte des informations convergentes et croisées de l'ambassade de France à Bagdad, des personnalités iraquiennes, ainsi que du général américain Raymond T. Odierno. Quatorze provinces sur dix-huit sont sécurisées. Quatre ne le sont pas encore, mais sont en passe de le devenir, notamment celle de Mossoul et celle de Diyala à la frontière avec l'Iran. Alors qu'on comptait cent morts par mois en 2008, il n'y en a plus aujourd'hui que dix.
En second lieu, Al-Qaïda semble avoir été défait. Certes, des cellules dormantes sont encore présentes ici ou là et conservent une capacité offensive. Mais, globalement, les interlocuteurs rencontrés considèrent qu'Al-Qaïda a perdu la partie en Iraq. Quand on emprunte la route qui va de l'aéroport de Bagdad à l'hôtel Racheed, qui était terriblement dangereuse et que les forces américaines ont eu beaucoup de mal à sécuriser, on traverse une ville en état de siège, mais sans assiégeants. Toute la structure urbaine témoigne de ce combat : les murs, les ralentisseurs, les check points. Des membres du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) assurent en permanence la sécurité de l'ambassade et l'ambassadeur ne peut se déplacer qu'en convoi. La mission a passé la nuit à Bagdad sous la surveillance permanente de ces mêmes membres du GIGN dont M. Jean François-Poncet, rapporteur, a souligné les très grandes qualités de courage, de courtoisie et de professionnalisme. Mais il a précisé que la mission n'avait jamais été menacée, qu'elle n'avait jamais entendu un coup de feu, ni une explosion.
Cette situation s'explique d'abord par les renforts (« surge »). Les forces américaines en Iraq sont passées de 110 000 à 150 000 personnes, ce qui leur a permis d'occuper le terrain et de ne pas laisser les rebelles reprendre possession des lieux après une intervention. Le second élément est le retournement, moyennant finance, des tribus sunnites en faveur des Etats-Unis : 90 000 combattants sunnites rémunérés trois cents dollars par jour ont ainsi été enrôlés dans les « conseils de réveil » ou « sahwa ». Pourquoi ces tribus sunnites se sont-elles retournées contre Al Qaïda ? Sans doute à cause des exactions et des attentats aveugles qui ont fini par devenir insupportables. Les conseils de réveil ont joué un grand rôle dans l'élimination d'Al Qaida et dans la pacification du territoire.
La stabilisation démocratique est une deuxième évolution positive. L'Iraq a connu cinq élections authentiques depuis 2005. Les élections législatives doivent se tenir en décembre prochain. Le régime est parlementaire, avec une assemblée unique. Cette assemblée est vivante. Elle est le théâtre des affrontements entre les uns et les autres, qui auparavant avaient lieu dans la rue. Cela résulte en particulier de la scission des mouvements représentant les Chiites entre le Conseil supérieur de l'Islam de el Hakim, le parti Da'wa, qui est celui du Premier ministre el Maliki, et, enfin, le mouvement sadriste, qui avait sa propre milice, bien connue sous le nom d'« armée du Mahdi ». Cette scission permet des combinaisons parlementaires entre les Chiites et les Sunnites qui ouvrent considérablement le jeu politique au-delà des divisions ethniques ou communautaires.
Enfin, il y a une stabilisation nationale. Une des grandes questions que l'on se posait était de savoir si le pays n'allait pas éclater en trois : un Kurdistan au nord, un Etat chiite au sud et un Etat sunnite au milieu. Il est possible, aujourd'hui, de répondre à cette question par la négative. Cela est dû à un homme, le Premier ministre Nouri el Maliki, que la mission n'a pu rencontrer à Bagdad car il était au sommet de Doha.
M. el Maliki s'est peu à peu imposé comme un homme d'Etat. Son intervention à deux reprises contre ses coreligionnaires chiites lui a conféré cette stature : une première fois à Bassora, dans le Sud, en réprimant une tentative séparatiste, et une deuxième fois dans une banlieue peuplée de Bagdad, Sadr city, en éliminant l'armée du Mahdi. Cette intervention d'un leader chiite contre d'autres Chiites lui a donné une sorte de consécration nationale, même si la stature qu'il a acquise, conjuguée à son goût du pouvoir, fait qu'il a beaucoup d'adversaires. Il a défendu les intérêts de l'Iraq et contribué à l'éveil d'une conscience nationale. En définitive, on peut dresser un bilan globalement positif de son action.
La question majeure est de savoir ce qui se passera après le départ des Américains. Les 150 000 hommes des forces américaines devraient se retirer complètement des villes d'ici à la fin du mois de juin 2009 et complètement du pays à la fin du mois de novembre 2011. Aucune base ne serait laissée en Iraq. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, rencontré par la mission, a confirmé ce schéma mais n'a pas écarté l'hypothèse qu'il soit modifié à la demande du gouvernement iraquien, qui pourrait, le moment venu, demander aux forces américaines de rester plus longtemps.
Quelles sont les incertitudes ? Elles sont au nombre de quatre : politiques, sécuritaires, sur le problème kurde et sur les questions économiques et de développement.
La première d'entre elles est l'incertitude politique. Le Premier ministre Maliki s'est imposé. Mais ses succès comme son autoritarisme ont suscité de fortes oppositions. La mission a discerné un mouvement que l'on pourrait qualifier de « tout sauf Maliki ». En décembre 2009, il y aura des élections générales. M. Maliki devra trouver une majorité pour le soutenir, alors même qu'il risque d'avoir à affronter une convergence de ses ennemis : les Kurdes, les Sunnites, les autres factions chiites.
La deuxième incertitude concerne les forces armées et de sécurité : 600 000 hommes sont répartis entre l'armée, la police nationale et les polices locales. Ces forces, qui n'ont jamais opéré sans le secours des forces américaines, seront-elles capables de maintenir l'ordre après le départ de ceux qui les ont formées ? Selon le général Raymond T. Odierno, 75 % des forces irakiennes sont considérées comme sûres, 20 % comme incertaines et 5 % ne sont pas fiables. Par ailleurs, les conseils de réveil sunnites sont désormais rattachés au gouvernement à majorité chiite. Cette situation perdurera-t-elle ? Il serait catastrophique qu'il n'en soit pas ainsi. Certains attentats récents ont révélé des failles dangereuses.
Troisième incertitude : l'attitude des Kurdes. C'est sans doute le problème le plus sérieux. Les Kurdes sont concentrés dans le nord du pays, qui est une région montagneuse. Ils ont joué un rôle considérable dans l'implantation du régime. Massoud Barzani est un leader charismatique. Il est le président incontesté du Gouvernement régional kurde (GRC), tandis que M. Jalal Talabani, fondateur de l'Union patriotique du Kurdistan, est Président de la République d'Iraq. Le Kurdistan couvre actuellement trois régions et dispose d'importantes ressources pétrolières. Il s'est doté d'une armée depuis 1991, qui ne dispose pas d'armes lourdes, mais qui, avec ses 300 000 hommes (les Peshmergas) assure une sécurité remarquable dans la région ; plusieurs fois les Peshmergas ont été appelés à Bagdad pour assurer la sécurité du Parlement et des hommes politiques, en particulier du Président de la République, car ce sont des hommes sur lesquels on peut compter.
Les dirigeants kurdes s'opposent à une modification de la Constitution qui, en renforçant le centralisme du pouvoir, leur ôterait une partie de leur autonomie. Ils ont des revendications territoriales, en particulier sur Kirkouk, qui conduiraient, si elles étaient acceptées, à doubler la superficie actuelle du Kurdistan, actuellement de l'ordre de 40 000 km², soit autant que la Suisse. Kirkouk, notamment, constitue un abcès de fixation. Cette ville de 700 000 habitants est actuellement peuplée, à parts égales, de Kurdes, d'Arabes chiites implantés par Saddam Hussein dans le cadre d'une politique forcée et brutale d'arabisation, et de Turcomanes. Enfin, le Kurdistan dispose d'un aéroport international à Erbil.
Les revendications des Kurdes se heurtent à un refus de Bagdad et provoquent une grande nervosité chez les Turcs. Les représentants kurdes rencontrés par la mission disent avoir renoncé à l'indépendance, mais pas à Kirkouk. Ils s'opposent à Bagdad et au Premier ministre Maliki. Ils réclament l'application de l'article 140 de la Constitution qui prévoit la « normalisation », c'est-à-dire le retour des Kurdes à Kirkouk, le recensement et un référendum.
Ces affirmations ont conduit la mission à se rendre en Turquie pour sonder la position des autorités de ce pays sur ce sujet. Il faut savoir que les Turcs ont noué d'excellentes relations d'affaires avec les Kurdes, depuis que Massoud Barzani a renoncé à soutenir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Vingt millions de Kurdes vivent en Turquie, six en Iraq, six en Syrie, douze en Iran. Sans aboutir nécessairement à une sécession, le problème kurde fait peser une menace sur l'avenir du pays.
Enfin, se pose le problème de la reconstruction, jusqu'alors éludé par la prévalence des préoccupations sécuritaires. Il faudra soixante milliards de dollars pour remettre en état les infrastructures. La production de pétrole, actuellement à peine supérieure à deux millions de barils par jour, pourrait passer à six millions si l'outil pétrolier est rénové, ce qui suppose également des investissements considérables de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Or la loi sur le pétrole n'est pas toujours votée. Restent la modernisation et l'équipement de l'armée, dépourvue d'aviation et qui dispose de peu d'armes lourdes. La cession ou la récupération d'équipements que laisseraient les forces américaines sur place, à leur départ, ne répond pas au problème puisque ces matériels sont très usagés. Il existe donc un énorme marché potentiel d'équipements militaires.
Tout cela n'annule pas les aspects positifs, mais il est prématuré de dire que l'Iraq « s'en est sorti ».
En dernier lieu, M. Jean-François-Poncet, rapporteur, a abordé la question de l'avenir de l'Iraq dans son environnement régional et international.
A cet égard, il a indiqué que l'Iran était partout présent en Iraq. Les services secrets iraniens y ont des agents qui ont largement contribué à l'insécurité. Les dirigeants iraniens étaient hostiles à l'accord de désengagement (SOFA), signé en décembre 2008 par le gouvernement irakien et les Etats-Unis. L'Iran aurait souhaité que les Etats-Unis soient paralysés, qu'ils s'épuisent en Iraq et qu'ils ne puissent quitter le pays la tête haute.
Est-ce à dire que l'Iran va « tirer toutes les ficelles » ? Probablement pas. Les iraquiens ne le souhaitent pas, même si c'est un grand voisin avec lequel il faut compter. Néanmoins, l'influence de l'Iran en Iraq est très forte. Les deux pays sont liés par la religion chiite. Les lieux saints du Chiisme sont en Iraq : Nadjaf et Kerbala. Il est difficile de dire comment les choses évolueront.
La France a un rôle important à jouer en Iraq. La visite du Président de la République a été très appréciée en dépit de sa brièveté. La France a une bonne image, même si celle-ci a été troublée par le fait que les Français étaient opposés à l'intervention des Etats-Unis, qui a quand même permis d'éliminer Saddam Hussein, persécuteur de la majorité chiite. L'Iraq est un pays important qui a des ressources considérables.
M. Jean-François-Poncet, rapporteur, a souhaité rendre hommage à l'équipe de l'ambassade, fort motivée, avec un ambassadeur remarquable, qui vit depuis plusieurs années dans des conditions très précaires.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a rappelé l'historique de la création de l'Iraq au travers des découpages successifs résultant des traités de Sèvres, de San Remo puis de Lausanne. De ce fait, et en fonction des intérêts pétroliers des puissances coloniales de l'époque, l'Iraq est une entité géographique qui ne repose pas sur une réalité nationale. Elle a observé que le système politique n'est pas un régime parlementaire tel qu'on peut l'envisager normalement et que tous les postes, tous les ministères, sont distribués exclusivement sur des critères confessionnels. M. el Maliki, en agissant contre d'autres Chiites, a probablement pensé affaiblir des rivaux de sa confession, plutôt qu'il n'a été guidé par le sens de l'Etat. Les solidarités vont d'abord à la famille, au village à la tribu, à la région.
M. Didier Boulaud s'est interrogé sur l'importance des réserves pétrolières de l'Iraq.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, lui a répondu que, moyennant une très importante modernisation, l'industrie pétrolière iraquienne, actuellement défaillante, serait tout à fait capable, à terme, de produire six millions de barils par jour, puisque, à titre de comparaison, sur des zones de production contiguës, la production saoudienne est de l'ordre de dix millions de barils par jour.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a précisé que le pétrole était aussi la malédiction de l'Iraq, puisque c'est à sa découverte dans les champs de Kirkouk que l'on devait la création même de l'Iraq et la non-création d'un Kurdistan, pourtant prévu par le traité de Sèvres.
M. Didier Boulaud s'est enquis des motivations de l'intervention américaine en Iraq, notamment pour savoir si le pétrole en était la raison.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a considéré que seuls les historiens pourraient trancher la question de savoir pourquoi les Etats-Unis ont décidé cette intervention, qui s'est soldée par la mort de 4 000 soldats américains et des dépenses de centaines de milliards de dollars, avec pour résultat une issue favorable sept ans plus tard. Il a déclaré ne pas croire personnellement que le pétrole en soit la cause principale. Selon lui, les Américains ont pensé qu'ils seraient accueillis en libérateurs et que l'Iraq serait, grâce à son pétrole, en mesure de payer les coûts de l'intervention. Ils se sont trompés sur ces deux points. Mais la faute majeure, que plus personne ne conteste, a été commise, après l'intervention, par l'administrateur Bremmer, qui, en licenciant les militaires iraquiens sans solde, a « nourri le marché de l'insurrection ». A cela s'est ajoutée la dissolution du parti Baas qui structurait l'administration et faisait fonctionner le pays. Il est très probable que, sans ces deux décisions malheureuses, l'histoire de l'intervention américaine en Iraq aurait été tout autre.
M. Daniel Reiner a interrogé les deux rapporteurs sur la perception sur place de l'élection du Président Obama et d'un éventuel changement de direction dans la politique suivie. Il les a également questionnés sur la présence de civils dans ce conflit.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a rappelé que le SOFA avait été signé par l'administration Bush et que Barack Obama n'avait pas changé de direction, les dispositions du SOFA correspondant, du reste, à son souhait de calendrier pour un retrait. Sur le second point, il a rappelé que des conseillers civils américains étaient très présents dans les ministères.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a précisé que les sociétés militaires privées, employant presque exclusivement des non-Américains, étaient omniprésentes dans le pays. Lorsqu'on arrivera au stade des crimes de guerre, il sera très difficile de déterminer les responsabilités respectives du commanditaire ou des sous-traitants.
Elle a également précisé, à propos du rôle de la Turquie dans la région, qu'il s'agissait du seul pays à pouvoir parler à tout le monde, au Hamas, comme à Israël, sans subir l'opprobre de ce dernier. La Turquie a une diplomatie stabilisatrice dans la région. Elle est en contact avec la Syrie et tente de la séparer de son alliance avec l'Iran.
A une question de M. Christian Cambon sur les relations de la Syrie avec l'Iraq, M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que la Syrie ne s'était pas mêlée des affaires de l'Iraq, mais qu'en revanche les Jihadistes d'Al Qaïda s'étaient infiltrés par la Syrie, et qu'il n'avait pas le sentiment que ce pays ait tout fait pour les en empêcher. Il a souligné qu'aucun des pays limitrophes de l'Iraq n'avait intérêt à sa déstabilisation, ni la Syrie ni les autres.
Présentation des conclusions des rapporteurs
(compte rendu du 7 juillet 2009)
M. Jean François-Poncet, rapporteur, après avoir rappelé que les différentes étapes de la mission avaient fait l'objet de comptes rendus détaillés devant la commission, a indiqué que Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, et lui même présenteraient les principales conclusions de leur rapport en distinguant, d'une part, les problèmes communs à l'ensemble de la région et, d'autre part, les problèmes particuliers à chaque pays ou groupe de pays.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, présentant la première partie du rapport relative aux problèmes communs, a rappelé que les pays du Moyen-Orient étaient aussi différents entre eux que les pays européens et que, globalement, nous les connaissions mal. Elle a évoqué comme causes possibles le fait que nous avons oublié l'histoire de ces pays, que nous ne retenons d'eux que des images de violence, même si leur population n'a jamais été aussi éduquée et développée, ou encore que notre vision de l'Islam soit celle d'une religion conservatrice et archaïque. A cet égard, elle a rappelé que l'Islam n'était pas réductible aux taliban, pas plus que le catholicisme à l'Inquisition ou le protestantisme aux sorcières de Salem.
A l'inverse, il est important de comprendre que l'opinion publique arabe et les gouvernements n'ont pas oublié l'époque coloniale et ses séquelles qui subsistent encore aujourd'hui dans la politique et les interventions occidentales.
Elle a ajouté que les sociétés du Moyen-Orient étaient en pleine mutation. La première de ces évolutions concerne la transition démographique. Cette phase de l'histoire d'une société où les couples commencent à contrôler leur fécondité est partout commencée au Moyen-Orient, même si elle est n'est nulle part achevée. Le taux de fécondité des femmes au Moyen-Orient est passé de 6,8 %o, en 1975 à 3,7 %o en 2005, la Tunisie, par exemple, ayant un taux de fécondité inférieur à celui de la France. Cet accès de plain-pied à la modernité provoque une désorientation des sociétés qui deviennent tumultueuses et convulsives.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a ensuite évoqué la question du statut des femmes. Elle a noté que le développement du port du voile avait permis un accroissement de la scolarisation des filles dans les classes populaires, soulignant par là-même que le port du voile était un indicateur ambivalent, facteur paradoxal de progrès, mais également le témoin d'un retour à une norme religieuse traditionaliste. Elle a d'ailleurs souligné que les termes de « réislamisation » et de « retour du religieux » étaient trompeurs, cette région du monde n'ayant jamais cessé d'être profondément musulmane. Se référant à l'ouvrage d'Amin Maalouf « les identités meurtrières » et au fait que les croyances religieuses, parce qu'elles sont plus durables que les idéologies, offrent un ancrage identitaire aux populations, elle a ajouté que l'Islam était redevenu la norme sociale, en réaction à l'occidentalisation.
Le rapporteur a enfin évoqué rapidement le fossé existant entre les peuples et les gouvernants, la relation tourmentée que ces mêmes peuples ont avec l'Occident et, enfin, l'attente partout manifestée de « plus d'Europe et moins d'Amérique ». Elle a conclu son propos en évoquant l'abondance des ressources énergétiques et la menace vitale de la pénurie généralisée d'eau.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a présenté les problèmes particuliers de la région, évoquant tout d'abord les trois défis auxquels elle est confrontée.
Le premier défi, qui se pose depuis 1948, est celui du conflit israélo-palestinien. A l'origine israélo-palestinien et israélo-arabe, ce défi comporte désormais une composante israélo-occidentale. Le rapporteur s'est étonné que les Israéliens n'aient pas tranché entre la proposition de l'Etat unique, binational, qui ne peut aboutir qu'à une dilution, voire une disparition de son identité juive, et la solution des deux Etats, que l'Occident pourtant privilégiait depuis longtemps et dont on connaissait tous les paramètres depuis la négociation de Taba et les propositions du Président Clinton. La seule chose qui fasse défaut, a-t-il ajouté, est la décision politique. Selon lui, les raisons pour lesquelles Israël ne parvient pas à trancher ce dilemme s'expliquent par le fait que sa sécurité est assurée et que son armée est supérieure à toute autre dans la région. Ces deux éléments conjugués incitent les dirigeants israéliens à la procrastination. Mais la raison principale de l'absence de choix tient au système politique israélien lui-même et aux effets de la représentation proportionnelle intégrale. Celle-ci aboutit à un grand nombre de partis politiques et à l'absence de majorités cohérentes. Politiquement trop faible pour faire la paix, militairement trop fort pour en avoir besoin, le gouvernement israélien ne pourra changer d'orientation que sous la pression des Etats-Unis. De ce point de vue, le Président Obama, contrairement au Président Bush qui n'avait jamais osé le dire au cours de ses deux mandats, a affirmé qu'il était en faveur de la solution des deux Etats et a demandé l'arrêt complet de la colonisation. La question est de savoir de quelle détermination il fera preuve à long terme et quelle capacité il aura à affronter le lobby pro-israélien. A cet égard, M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que la mission avait eu l'occasion de rencontrer les principaux lobbies pro israéliens, tant à Washington qu'à New York, et que ceux-ci disposaient de ressources humaines et financières importantes. Pour l'instant le Président Obama a une grande marge de manoeuvre, qu'il n'est cependant pas sûr de conserver longtemps.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a ensuite évoqué le dossier du programme nucléaire iranien, deuxième défi dans la région, dont l'enjeu était la nucléarisation de toute la région. Il a rappelé qu'on pouvait s'interroger sur la nature militaire du programme, que les autorités iraniennes démentaient avec la plus grande fermeté. Selon lui, même s'il n'existe pas de preuve formelle du caractère militaire de ce programme, il y a un faisceau d'indices plaidant en ce sens : l'absence de réponses aux questions de l'AIEA, la rationalité économique discutable du développement du nucléaire civil, enfin la mise au point d'un programme de missiles balistiques sophistiqués. Il a ajouté que, si les installations nécessaires aux premiers cycles d'enrichissement de l'uranium, du type de Natanz, occupaient une grande superficie au sol et étaient difficiles à dissimuler, en revanche, les usines impliquées dans les phases finales de l'enrichissement étaient de bien plus petite taille et pouvaient très bien faire l'objet d'une dissimulation. Il en a conclu que ce programme, qui n'avait pas pour l'instant de rationalité économique et technique, pouvait avoir une finalité militaire. Si tel est le cas, est-il possible d'arrêter le programme nucléaire iranien ? M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que le régime iranien n'était pas menacé, mais qu'il était impopulaire et que des dissensions commençaient à apparaître au sein de l'élite religieuse du pays. Malgré des élections vraisemblablement truquées, le régime repose, selon lui, sur des piliers solides tels que les pasdarans et les basidj. Les sanctions adoptées sont efficaces alors que les négociations entreprises dans le cadre 5 + 1 sont un échec. Ces sanctions peuvent encore être renforcées afin de faire évoluer le régime. A la question de savoir si les troubles actuels étaient susceptibles de pousser à l'ouverture ou à l'intransigeance, il a avoué pencher plutôt pour l'intransigeance tant, a-t-il estimé, ce régime avait besoin d'ennemis pour se maintenir.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a ensuite évoqué le cas du Yémen, troisième et dernier défi. Cet Etat n'est pas encore un Etat failli mais semble sur le point de le devenir. Il a rappelé l'attentat contre l'ambassade des Etats-Unis, en septembre 2008, qui a causé la mort de seize personnes, et le fait que le Président Ali Abdullah Saleh n'ait en réalité plus d'autorité que sur le territoire de sa propre capitale. Il a évoqué la rébellion houtiste au nord du pays, les tentations irrédentistes du sud et l'insécurité régnant dans la région de l'Hadramaout, berceau natal de la famille Ben Laden. Il a déclaré que la situation était d'autant plus préoccupante que ce pays était en train de devenir une nouvelle base pour Al-Qaïda.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a ensuite évoqué les raisons d'espérer une amélioration de la situation au Moyen-Orient, au premier rang desquelles figurait, selon lui, le changement de la politique américaine. Il a également évoqué, d'une part, la renaissance de l'Irak du fait de l'amélioration de la sécurité, des progrès de la démocratie et d'une vie parlementaire active et, d'autre part, en contrepoint, l'extrême dégradation des infrastructures, entièrement à reconstruire, ainsi que la nécessité, pour les Irakiens, d'établir des règles de partage de la rente pétrolière.
Toujours au titre des raisons d'espérer, M. Jean François-Poncet a évoqué la consolidation du régime saoudien, un moment ébranlé par le problème dit des « égarés ». Il a rendu hommage au roi Abdallah, grand roi réformateur, prudent mais déterminé, populaire dans son pays et influent dans la région. Les réserves financières tirées de la rente pétrolière ont été placées avec beaucoup de sagesse et la crise économique affectera moins ce pays que d'autres. Il a indiqué que ce pays était à la veille d'un changement de génération dans la classe dirigeante, la loi successorale devant permettre de trouver un modus vivendi entre les différents prétendants.
S'agissant des autres Etats du Golfe, principalement les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Bahreïn, il a indiqué qu'ils présentaient un visage nouveau de la modernité arabe, comme en témoignent certains développements architecturaux ainsi que l'intérêt porté à l'éducation au Qatar ou à la culture à Abu Dhabi. Il a regretté que ces régimes restent conservateurs dans leurs conceptions sociales.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, s'est par ailleurs réjoui du repli d'Al-Qaïda, quasiment disparu d'Irak.
Le rapporteur a ensuite abordé les problèmes récurrents du Moyen-Orient, au premier rang desquels la question de la succession du Président Hosni Moubarak. Entre son fils Gamal et Omar Souleiman, le choix n'a pas été fait, ce qui préoccupe les observateurs de la région, d'autant que cette succession s'ouvrira dans un climat économique très dégradé.
Il a ensuite évoqué le cas de la Syrie, déclarant que le Président de la République française avait eu raison en renouant les contacts avec M. Béchir El Assad, et s'est interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable de détourner ce pays de son alliance traditionnelle avec l'Iran. Il a répondu par la négative sauf si un accord permettait à la Syrie de récupérer le Golan, ce dont pour l'instant les dirigeants israéliens ne voulaient pas entendre parler.
Enfin s'agissant du Liban, il a évoqué le problème du confessionnalisme et l'importance du Hezbollah chiite, qui a établi un Etat dans l'Etat, et qui est en relation très directe avec Téhéran.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a ensuite présenté les recommandations de la mission à la commission.
En premier lieu, il a indiqué qu'il ne serait pas possible de progresser dans le conflit israélo-palestinien sans contact direct avec le Hamas. Les membres de la mission ont rencontré M. Khaled Mechaal à Damas, ce qui leur a valu l'anathème des dirigeants politiques israéliens. Il a également indiqué qu'il fallait que la France et les Européens appuient la politique du Président des Etats-Unis afin d'exercer le maximum de pression sur les dirigeants israéliens, en particulier pour qu'ils lèvent le blocus de Gaza et acceptent l'arrêt de la colonisation.
Concernant l'Iran, il a considéré comme une litote le fait de dire que les relations entre nos deux pays n'étaient pas bonnes et a relaté un déjeuner, à l'invitation de l'ambassadeur d'Iran en France, au cours duquel l'ambassadeur avait porté des jugements inacceptables sur notre propre pays. Il convient de soutenir la politique d'ouverture des Etats-Unis, mais, en cas d'échec, il lui a semblé clair que les occidentaux auront à choisir entre la bombe et le bombardement, ce qui n'empêche pas, dans l'immédiat, de poursuivre les efforts et pressions afin que l'Iran accepte l'intégralité des inspections de l'AIEA dans le cadre du TNP.
S'agissant du Yémen, il a indiqué qu'il fallait absolument s'en préoccuper et, concernant la Syrie, il a considéré, une nouvelle fois, que cela avait été une bonne chose de s'en rapprocher, le rétablissement des relations diplomatiques permettant d'exercer une pression utile bien que limitée.
M. Josselin de Rohan, président, après avoir rappelé les positions très fermes en faveur de la solution des deux Etats qu'avait prises le Président des Etats-Unis, s'est interrogé sur l'importance à donner à la déclaration du vice-président Joe Biden disant que les Etats-Unis ne pourraient pas empêcher Israël de mener une attaque sur les sites nucléaires iraniens. Il s'est étonné que cette déclaration ait été faite sans concertation aucune avec les pays de l'Alliance atlantique et s'est demandé si cela ne signifiait pas que le lobby pro israélien était devenu beaucoup plus actif aux Etats-Unis. M. Benyamin Netannyahou a déclaré qu'il avait bien compris le message du Président des Etats-Unis mais n'a rien fait depuis.
Le président Josselin de Rohan s'est interrogé sur le fait de savoir si, compte tenu des positions de la Chine et de la Russie, qui opposeraient vraisemblablement un veto à une aggravation des sanctions, on ne s'acheminait pas vers un Iran nucléaire. Cela entraînerait vraisemblablement la nucléarisation de la région et l'éclatement du TNP. Dans ces conditions, la dissuasion ne jouerait-elle pas un rôle ?
Enfin, M. Josselin de Rohan, président, a indiqué que, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, il était possible d'envisager un rôle pour l'Union européenne. Se déclarant choqué par la fermeté du gouvernement israélien dans la poursuite des colonisations, le maintien des check points et du blocus, il a souhaité que l'Union européenne soit aux côtés des Etats-Unis pour soutenir la politique du Président Obama.
En réponse au président de Rohan, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a déclaré que tout le jeu israélien visait à détourner l'attention des Occidentaux vers la question iranienne afin d'éviter d'avoir à résoudre le problème palestinien. M. Joe Biden était vraisemblablement influencé par le lobby pro israélien. Ce n'est qu'à partir du moment où les intérêts vitaux des Etats-Unis seront mis en danger par la politique israélienne, que les Américains feront preuve de fermeté. Les Israéliens dépendent fortement des Etats-Unis et ces derniers peuvent exercer des pressions facilement.
S'agissant de la politique de l'Union européenne dans le conflit israélo-palestinien, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a indiqué que le fait que la Suède vienne de prendre la présidence de l'Union aiderait beaucoup sans doute à la définition d'une politique claire et plus cohérente vis-à-vis d'Israël. Dans ces conditions, elle a indiqué qu'il était probable que les recommandations du texte émanant d'anciens ministres européens des affaires étrangères et de personnalités, signé par son collègue et co-rapporteur M. Jean François-Poncet, en faveur d'un contact avec toutes les parties au conflit, y compris le Hamas, soient enfin suivies par les pouvoirs européens actuels.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, en réponse à la question du président Josselin de Rohan sur l'Iran, a indiqué qu'il considérait qu'il était de bonne politique que le Président des Etats-Unis d'Amérique laisse son vice-président avertir les Iraniens que les Etats-Unis ne seraient pas en mesure d'arrêter Israël si celui-ci venait à attaquer les sites nucléaires iraniens. Si les Etats-Unis et l'Europe peuvent s'accommoder d'un Iran nucléaire, il s'est déclaré en revanche inquiet quant à la possibilité d'une nucléarisation de la région. Le rôle stabilisateur qu'a joué l'atome entre l'Inde et le Pakistan n'est pas nécessairement transposable au Moyen-Orient.
M. Josselin de Rohan, président, a indiqué que chaque fois que l'Iran prenait la parole, Israël en profitait pour détourner l'attention de la Palestine et que personne n'était dupe de ce jeu.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que la presse israélienne se faisait l'écho des pressions américaines et préparait l'opinion au fait qu'il faudrait évacuer les colonies illégales, en imaginant des solutions palliatives (repli sur les colonies légales, construction en hauteur). En outre, les Etats-Unis ont dépêché dans la région le sénateur Georges Mitchell, qui s'est chargé de rappeler aux Israéliens les demandes du Président Obama et le fait que ces demandes ne pouvaient rester sans réponse. Or si rien n'avance, le Président américain sera confronté à l'échec de sa politique. Concernant les Palestiniens, le problème est bien de savoir avec qui on négocie. Si le Hamas n'est pas associé à cette négociation, il est clair qu'il la fera échouer en contestant ses décisions.
M. Didier Boulaud a déclaré qu'il était de ceux qui pensaient que la certitude d'une annihilation devait suffire à dissuader un Iran nucléaire d'utiliser ses armes. Du point de vue iranien, tous les pays voisins ont la bombe nucléaire -l'Inde, le Pakistan, Israël, la Russie et les Etats-Unis, ce qui justifie sa volonté de la posséder. Si le président Obama renonce au bouclier anti-missile, en Pologne et en République tchèque, cela veut-il dire alors que la dissuasion reprend toute sa place ? Il a évoqué le fait que le Premier ministre israélien avait été contrarié par la déclaration du chef du Mossad, le service de renseignement israélien, selon laquelle le programme nucléaire iranien ne déboucherait pas avant 2015, au lieu de 2010, et a demandé aux rapporteurs si ces informations étaient exactes.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga a indiqué que, s'agissant de la bombe, le débat se poursuit, car, si l'on comprend bien les raisons qui poussent l'Iran dans ce sens, en revanche, on peut redouter la nucléarisation de cette région du monde.
M. Jean-Pierre Chevènement a rappelé que l'Iran avait déclaré ne pas vouloir acquérir l'arme nucléaire et que, même si tous les indices laissent penser que les dirigeants iraniens poursuivent en fait un objectif militaire, pour l'instant, ce programme est encore conforme au TNP. Il a évoqué la possibilité que l'Iran cherche uniquement à se placer sous le seuil et à acquérir une industrie nucléaire civile. Concernant les chances d'aboutir à un gouvernement d'union entre le Hamas et l'Autorité palestinienne, il s'est déclaré moins pessimiste que les rapporteurs. En revanche, il s'est déclaré moins optimiste sur l'évolution démocratique de l'Irak. Il a rappelé que la construction d'une nation supposait une certaine homogénéité de ses composantes, ce qui n'est pas le cas de ce pays. Elle nécessite un processus de très longue durée à l'échelle historique. Le retrait des forces américaines constituera sans doute l'heure de vérité et il apparaît prématuré de le célébrer. L'Irak est devenu un grand Liban.
En réponse à la question sur le délai nécessaire à l'Iran pour posséder l'arme nucléaire, M. Jean François-Poncet a indiqué que, d'après les informations communiquées aux rapporteurs, s'il s'agissait bien d'un programme nucléaire militaire, l'Iran serait en mesure d'avoir un tout premier « engin » nucléaire vers la fin de l'année 2010. Mais ce n'est qu'en 2015 que l'Iran pourrait disposer d'un ensemble militaire dissuasif. S'agissant de l'Irak, il a confessé être optimiste. Bagdad est toujours en état de siège, mais il n'y a plus d'assiégeants. Il a ajouté que la reprise des attentats, très meurtriers, n'avait pas remis en cause l'amélioration globale de la sécurité. Puis, il a indiqué que pour le moment le danger venait moins des divisions entre les chiites et les sunnites que du fait que les Kurdes réclamaient avec insistance la ville de Kirkouk ainsi que le rattachement de territoires qui, s'il était accepté, conduirait au doublement de la superficie de leur région autonome.
Concernant les chances de succès du dialogue interpalestinien, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a indiqué que celui-ci était au point mort. Les dirigeants égyptiens avaient fixé comme date limite à ce dialogue le 7 juillet, mais viennent d'annoncer qu'ils repoussaient cette date au 25 juillet. Les discussions achoppent sur le programme du gouvernement, le système électoral, les forces de sécurité et l'intégration du Hamas à l'OLP. En réalité, ce dialogue est bloqué du fait de l'exigence posée par le Quartette d'une reconnaissance préalable d'Israël. Toutefois, la véritable date butoir est le 25 septembre, date limite de convocation des élections prévues en janvier 2010. Une médiation européenne pourrait contribuer au déblocage des négociations, mais cela suppose au préalable la reconnaissance des résultats des élections palestiniennes de 2005 et celle du Hamas.
M. Daniel Reiner a interrogé les rapporteurs sur le nucléaire iranien, reconnaissant que le régime était impopulaire depuis une quinzaine d'années. Il a considéré que la tentation serait forte de penser que ce ne sont que les extrémistes qui souhaitent le développement d'un tel programme, alors que celui-ci fait l'objet d'un consensus national. Il a posé la question de savoir quelles garanties la Chine, la Russie et l'Occident pourraient apporter à cette région du monde au cas où l'Iran deviendrait une puissance nucléaire militaire. L'Occident a-t-il accompagné le mouvement d'évolution du Moyen-Orient vers la modernité dans un sens positif ou, au contraire, l'a-t-il compliqué ? Enfin, il s'est déclaré indigné que l'Europe accepte sans rien dire que tous ses investissements en Palestine, et notamment à Gaza, soient régulièrement détruits par l'armée israélienne et que l'on s'apprête à recommencer comme si de rien n'était.
En réponse, M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que, certes, l'impopularité du régime n'était pas un fait nouveau et que cela s'était manifesté par l'abstention dans les précédentes élections, mais qu'elle n'avait jamais été aussi forte. S'agissant du programme nucléaire, il est effectivement soutenu par la totalité de l'opinion car ce peuple est profondément nationaliste, en raison de son passé glorieux et millénaire.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a estimé qu'effectivement si on laissait ces pays trouver leur propre voie vers la modernité, cela serait beaucoup plus simple pour eux.
S'agissant de la position commune des Européens, M. Jean François-Poncet, rapporteur, a indiqué que les principaux pays étaient d'accord entre eux, même si l'Allemagne ne s'exprimait guère sur le sujet pour des raisons historiques évidentes et que, pour des raisons similaires, les Pays-Bas avaient une attitude systématiquement pro-israélienne. Il s'est déclaré en accord avec M. Daniel Reiner sur le fait que les destructions infligées à Gaza sur les immeubles construits par l'Europe étaient intolérables, et que cette absence de protestation était encore plus intolérable.
Rappelant un déplacement effectué au Moyen-Orient, M. Marcel-Pierre Cléach a indiqué que l'ensemble des interlocuteurs rencontrés s'étaient montrés convaincus que l'Iran irait jusqu'au bout de ses ambitions nucléaires et qu'Israël, qui n'attend rien des négociations internationales, interviendrait pour détruire les sites de production d'uranium de ce pays.
M. Jean François-Poncet, rapporteur, a rappelé la conviction de M Denis Ross, chargé par le Président Obama de suivre cette question, qu'Israël allait attaquer l'Iran. Cependant, il est tout aussi évident que les militaires israéliens n'entreprendront une opération que si les intérêts existentiels d'Israël sont mis en cause.
ANNEXE 1 - Liste des personnes rencontrées
I.- AUDITIONS A PARIS
- M. Henry Laurens , professeur au Collège de France ( 10 septembre 2008 )
- M. Gérard Araud , secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères, directeur général des affaires politiques et de la sécurité ( 10 septembre 2008 )
- M. Yves Aubin de la Messuzière , chercheur associé à la chaire Moyen-Orient Méditerranée de Sciences-Po, vice-président de l'Institut du Monde Arabe ( 23 septembre 2008 )
- M . Jean-Claude Cousseran , ancien ambassadeur, ancien directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) ( 23 septembre 2008 )
- M. Gilles Kepel , titulaire de la chaire Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po ( 24 septembre 2008 )
- M. Alain Chouet , chercheur associé à l' European Security Intelligence and Strategy Center , chargé de conférence au diplôme universitaire d'études des menaces criminelles contemporaines, Université de Paris II. ( 25 septembre 2008 )
- M. Olivier Appert , directeur de l'Institut français du pétrole ( 25 septembre 2008 )
- M. Antoine Sfeir , journaliste, directeur des Cahiers de l'Orient ( 30 septembre 2008 )
- M. François Thual , professeur de géostratégie à l'Ecole de guerre ( 30 septembre 2008 )
- M. Olivier Caron , directeur du pôle stratégie et relations extérieures et directeur des relations internationales du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ( 7 octobre 2008 )
- M. Patrice Paoli , directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ministère des affaires étrangères et européennes ( 7 octobre 2008 et 10 avril 2009 )
- M. François Burgat , directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Damas ( 8 octobre 2008 )
- S. Exc. M. Mohamed Al-Sheikh , ambassadeur d'Arabie saoudite ( 15 octobre 2008 )
- M. Christian Nakhlé , consul général de France à Djeddah ( 16 octobre 2008 )
- M. Mohamed Hilal, chargé d'affaires pour les Emirats Arabes Unis (16 octobre 2008)
- M. Jean-François Girault , ambassadeur de France en Irak
- S. Exc. M. Hatem Seil El Nasr , ambassadeur d'Egypte en France ( 17 novembre 2008 )
- M. Alexis le Cour Grandmaison , centre d'analyse et de prévision du ministère des affaires étrangères, en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (26 novembre 2008)
- M. Dominique Woloch , ancien premier secrétaire à l'ambassade de France au Yémen ( 27 novembre 2008 )
- M. Emmanuel Todd , historien, démographe ( 27 novembre 2008 )
- Mme Khalidja al Salami , écrivain et réalisatrice yéménite ( 4 décembre 2008 )
- M. Jean-Pierre Filiu , chercheur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ( 15 décembre 2008 )
- S. Exc. M. Daniel Shek , ambassadeur d'Israël en France ( 17 décembre 2008 )
- M. Ludovic Pouille , sous-directeur Egypte-Levant, ministère des affaires étrangères et européennes ( 18 décembre 2008 )
- Mme Hind Khoury , déléguée générale de Palestine en France
- M. Henry Siegman , directeur du US/Middle East Project ( 9 février 2009 et 5 mai 2009 )
- M. Cédric Parisot - CNRS - Institut français de Jérusalem ( 3 mars 2009 )
- M. Laurent Bonnefoy - CNRS - Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Saana (3 mars 2009)
- S. Exc. M. Nasser Mohamed Youssef Al Belooshi , ambassadeur du Bahreïn en France (16 mars 2009)
- M. François Heisbourg , directeur de la Fondation pour la recherche stratégique ( 17 mars 2009 )
- S. Exc. M. Seyed Mahdi Miraboutalebi , ambassadeur d'Iran (24 mars 2009)
- M. Pierre-Jean Luizard , chercheur au CNRS ( 26 mars 2009 )
- M. Yves Oudin , ambassadeur de France à Bahreïn (27 mars 2009)
- M. Hosham Dawod , chercheur au CNRS : EHESS, spécialiste de l'Iraq et du chiisme ( 9 avril 2009 )
- M. Steffen Hertog , universitaire, chaire Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po ( 9 avril 2009 )
- M. Michel Guérin , sous-directeur du contre-terrorisme à la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) ( 5 mai 2009 )
- M. Thierry Coville , chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'économie iranienne ( 5 mai 2009 )
- M. Bernard Hourcade , directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran ( 5 mai 2009 )
- M. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (2 juin 2009)
- M. Jean-François Legrain , chercheur au CNRS/GREMMO (6 juillet 2009)
II.- DEPLACEMENTS EN FRANCE
- Ambassade des Etats-Unis , conseiller politique du général Petraeus (10 février 2009)
- D.R.M. - général Benoît Puga, (11 février 2009)
- S.G.D.N. - général Jean Coulloumme-Labarthe - M. Jean-Philippe Bouyer (11 février 2009)
- D.G.S.E. - M. Erard Corbin de Mangoux (13 février 2009)
- EADS - Astrium - Alain Charmeau, François Deneu, Bruno Duthoit (27 mars 2009)
- CEA - DAM - M. Daniel Verwaerde (3 juin 2009)
III.- VISITES EN ARABIE SAOUDITE - YÉMEN - ABU DHABI - DUBAI - QATAR
Samedi 18 octobre - Venise
- Colloque Eurogolfe : Preconditions for a stability framework in the region
- SAR Prince Turki Al-Fayçal
- M. Mounib Al-Masri , président du Forum palestinien
- M. Henri Siegma n - président du US/Middle East project
- M. Gilles Kepel - président d'Eurogolfe
Lundi 20 octobre - Riyad
- M. Bertrand Besancenot , ambassadeur de France en Arabie saoudite, et les chefs de service
- M. Abdullah Ahmed Youssef Zeinal Ali Reeza , ministre du commerce et de l'industrie
- Dr Saleh Abdulah Bin Hemaid , président du conseil consultatif Majliss al Choura
- Dr Sadaqa bin Yehya bin Hamza Fadel , président de la commission des affaires étrangères
- Dr Abdulaziz bin Ibrahim Al-Manee , président du groupe d'amitié France-Arabie saoudite
- M. Rihab Massoud , conseiller spécial du Prince Bandar bin Sultan - conseil national de sécurité
- Col. Jean-Philippe Bonnet , attaché de défense
- Amiral Oudot de Dainville , (Président ODAS)
Mardi 21 octobre - Riyad
- M. Andrew Hammonds , journaliste de l'Agence Reuters
- M. Turki bin Khaled Al-Sudairy , président de la Commission des droits de l'homme
- SAR prince Saoud Al-Faysal , ministre des affaires étrangères
- SAR prince Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saoud - homme d'affaires
- le prince Mohamed Bin Nayef - vice-ministre de l'intérieur
- M. Kamel S. Al-Munajjed , conseil d'affaires franco-saoudien,
Mercredi 22 octobre - Riyad
- SAR le prince Salman bin Abdul-Aziz al Saoud - gouverneur de la région de Riyad
- Dr Assad Al-Shamlan , assistant professor, du Centre for European Studies ( Diplomatic institute )
- Femmes d'affaires saoudiennes
Mercredi 22 octobre - Djeddah
- M. Jamal Khashoggi , rédacteur en chef du quotidien Al-Watan
- Entretien avec le maire de Djeddah et quatre hommes d'affaires du groupe Bin Laden
- entretien avec les représentants de la société Aéroports de Paris
Jeudi 23 octobre - Sanaa
- M. Gilles Gauthier , ambassadeur de France au Yémen, et les chefs de service
- M. Martin Deffontaines , directeur de Total - Yemen
Vendredi 24 octobre - Sanaa
- Entretien avec les ambassadeurs européens
Samedi 25 octobre - Sanaa
- Dr Abdelmalek Al-Mekhlafi , sénateur, vice-président de la Commission de la Shoura
- Sheikh Abdulaziz Abdulghani , sénateur
- M. Ali Mohamed Mujawar , Premier ministre
- M. Rashed Al-Alimi , vice-Premier ministre en charge des affaires de Défense et de Sécurité
- M. Abou Bakr Al-Qirbi , ministre des Affaires étrangères
- Rencontre avec les chercheurs du CEFAS
- M. Stephen A. Seche , ambassadeur des Etats-Unis au Yémen
- Rencontre avec les conseillers du commerce extérieur (Total, Yemen-LNG, Accord, Calyon, Spie, France-Télécom, EDF)
Dimanche 26 octobre - Abu Dhabi
- M. Alain Azouaou , ambassadeur de France aux Emirats Arabes Unis, et les chefs de services
Lundi 27 octobre - Abu Dhabi
- M. H.E. Edward Oakden , ambassadeur de Grande Bretagne aux Emirats Arabes Unis
- M. Ahmad Bin Chebib Al Dhahiri , premier vice-président du Conseil Fédéral National
- Dr Anwar Gargash , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de la fédération des Emirats Arabes Unis
- Colonel Hervé Cherel : visite de la base militaire française - emprise Marine
- M. Ashraf Hamdi Fouad et M. Emile Hokayem journalistes
Mardi 28 octobre - Dubaï
- Mme Nadia Yafi , consul de France à Dubaï
- M. Shebab Gargash , directeur de Daman Investments PSC
- M. Henry Soleyn , avocat et conseiller du commerce extérieur français
- M. Abdul Rahman Al Rashed , directeur général d'Al Arabiya News Channel
- M. Abdulaziz O. Sager , directeur du Gulf research center , spécialisé dans les affaires stratégiques de la région et M. Christian Koch , directeur
Mercredi 29 octobre - Doha
- Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani , Emir du Qatar
- M. Satnam Matharu - Head international and Media Relations d'Al Jazeera et M. Jamil Azar , rédacteur-présentateur
- M. Joseph Evan LeBaron , ambassadeur des Etats-Unis
Jeudi 30 octobre - Doha
- Université de Georgetown : intervention, dans le cadre du cours de civilisation française, de M. Patrick Laude - questions réponses avec les étudiants
- Dr Mohamed Fathy Saoud , président de la Fondation du Qatar
- H.E.Ahmad bin Abdullah Al Mahmoud , ministre des affaires étrangères du Qatar
IV.- VISITES EN SYRIE, LIBAN, ISRAËL, PALESTINE
Dimanche 18 Janvier - Damas
- M. Michel Duclos , ambassadeur de France en Syrie, et les chefs de service
- M. Peter Harling , International Crisis Group,
- M. Philippe de Fontaine-Vives , vice-président de la BEI
Lundi 19 janvier - Damas
- Lieutenant-colonel Marc de Block , attaché de défense à la Mission militaire
- Mme Sylvie Sturel , chef de la mission économique
- M. Mahmoud El-Abrache , Président de l'Assemblée du Peuple
- Mme Houda Homsy-Ajlani , présidente du groupe d'amitié France-Syrie de l'Assemblée du Peuple
- M. Hatem Nuseibeh , PDG de Total
Mardi 20 janvier - Damas
- M. Haytham Maleh , avocat, défenseur des droits de l'homme,
- Mme Souheir Atassi , membre de la Déclaration de Damas
- M. Khaled Mechaal , leader politique du Hamas
- Séance de travail au Orient Studies center , dirigé par M. Samir Al Taqi , en compagnie de Mme Hala Barbera , avocate, M. Zyad Arbash , économiste, M. Samir Seifan , économiste et M. Tawfik Sawaf , spécialiste du dossier Israël-Palestine
Mercredi 21 janvier - Damas
- M. Christophe Audic , premier secrétaire
- M. Frédéric Alegre , officier de liaison
- M. Simon Collis , ambassadeur de Grande-Bretagne en Syrie
- MM. Francois Burgat , Hassan Abbas , Bruno Paoli , chercheurs à l'Institut Français du Proche Orient
- Mme Maura Connelly , chargée d'affaires a.i. des Etats-Unis
- M. Waddah Abd Rabbo , rédacteur en chef du quotidien Al-Watan
Jeudi 22 janvier - Damas
- M. Walid Al Mouallem , ministre des affaires étrangères de la République arabe syrienne
- M. Pradeilles , proviseur du Lycée Charles de Gaulle
Jeudi 22 janvier - Beyrouth
- M. André Parant , ambassadeur de France au Liban, et les chefs de service
- Général Michel Sleiman , Président de la République libanaise
- M. Hussein Hajj Hassan , député du Hezbollah
- Entretien avec M. Abdel Latif Zein , député de Nabatieh, Président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés
- M. Nasser Nasrallah , député de la Bekaa-Ouest et Rachaya, représentant le Président de la Chambre des députés
Vendredi 23 janvier - Beyrouth
- M. Fouad Siniora , Président du Conseil des ministres
- M. Samir Geagea , Chef des Forces libanaises
- Rencontre avec les journalistes : Mme Rosanna Bou Monsef (Annahar) - M. Nicolas Nassif (Al Akhbar), M. Mahmoud Harb (L'Orient le jour) - Mme Valérie Debahy (al Balad) - Mme Hala Saghbini (Al Moustaqbal) - M. Georges Alam (Assafir)
- M. Amin Gemayel , ancien Président de la République
- Général Michel Aoun , député, chef du Courant Patriotique Libre
- M. Saad Hariri , député, chef du Courant du futur
- M. Walid Joumblatt , député, chef du Parti socialiste progressiste
Samedi 24 janvier - Beyrouth
- M. Gabriele Checchia , ambassadeur d'Italie au Liban
- M. Michael Williams , coordonnateur spécial du SGNU pour le Liban
- Déjeuner avec M. Marwan Hamade , ancien ministre et député du Chouf, M. Issa Ghoraieb , éditorialiste de l'Orient le Jour, M. Talal Salman , directeur du journal As Safir, M. Ahmed Beydoun , sociologue et historien, professeur à l'Université libanaise, M. Walid Charara , chercheur et chroniqueur d'opposition, M. Charles Ayoub , directeur du journal Addyar, Mme Michele J. Sison , ambassadeur des Etats-Unis, M. Michel Murr , député, Président du groupe d'amitié Liban-France pour le Sénat
- M. Elias Murr , ministre de la Défense
Dimanche 25 janvier - base de Naquoura
- Présentation de la base et briefing sur les activités de la nouvelle FINUL
- Général Claudio Graziano , commandant la FINUL
- Général Olivier de Bavinchove , commandant en second de la FINUL
Dimanche 25 janvier - Tel Aviv
- Rencontre avec des journalistes israéliens spécialistes des questions israélo-palestiniennes ( Amos Harel et Akiva Eldar du Haaretz et Smadar Péri du Yédiot Aharonot)
Lundi 26 janvier - Tel Aviv
- M. Haïm Oron , Président du Meretz
- M. Jean-Michel Casa , ambassadeur de France en Israël, et les chefs de service
- M. Avi Primor , ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne et auprès de l'Union européenne, directeur du centre d'études européennes à l'Université IDC de Herzliya.
- Gen. Shlomo Brom , Senior Research Associate à l' Institute for National Security Studies
Mardi 27 janvier - Tel Aviv
- M. David Zonshein , officier de réserve, fondateur du mouvement des refuznik, « le courage de refuser »
- M. Gidi Grinstein , directeur de l'Institut Reut, conseiller du gouvernement sur les décisions stratégiques à long terme
- Entretien avec des représentants des ONG israéliennes ( Yariv Oppenheimer , La Paix maintenant ; Jessica MONTELL , Betselem ; Hadass ZIV , Physicians for Human rights; et Ruth KEDAR , Yesh Din)
- M. James Gunnangham , ambassadeur des Etats-Unis en Israël
- M. Tom Philips , ambassadeur de Grande Bretagne en Israël
Mardi 27 janvier - Jérusalem
- Rencontre avec des chercheurs français du Centre de Recherche Français de Jérusalem
Mercredi 28 janvier - Abou dis et Ramallah
- M. Ahmed Qorei (Abou Ala), ancien président du Parlement, ancien Premier ministre
- Entretien avec les responsables du Croissant rouge palestinien
- M. Ahmed Soboh , vice-ministre des Affaires étrangères
- M. Salam Fayyad , Premier ministre
- Déjeuner avec des membres du Conseil législatif palestinien : Khaleda Jarrar (PFLP) ; Bernard Sabella (Fatah) ; Abdarahim Barham (Fatah) ; Intisar Al Wazir (Fatah)
- Mme Fadwa Barghouti , épouse de Marwan Barghouti
- M. Saeb Erekat , chef de l'équipe de négociations de l'OLP
Jeudi 29 janvier - Gaza
- M. Shaar Habil , membre du conseil d'administration de l'école américaine (détruite pendant les opérations militaires)
- Rencontre avec les docteurs de l'hôpital d'Al Qods ;
- Entretien avec le représentant de l'UNWRA
Jeudi 29 janvier - Ashqelon
- Entretien avec des membres de la communauté française d'Ashqelon
- Colonel Alain Faugeras , chef de la mission EU BAM - Rafah
Vendredi 30 janvier
- M. Philippe Lazzarini , responsable de l'OCHA pour les Territoires palestiniens
- M. Bernard Sabella , député au CLP (Fatah), directeur de l'hôpital Saint-Joseph (Jérusalem Est)
- M. Robert Danin , chef de l'OQR (Office of the Quartet Representative, Mr Tony Blair)
- Rencontre avec les correspondants de la presse française : M. Charles Enderlin (France2) ; M. Michel Bôle-Richard (Le Monde) ; M. François Clauss (Europe 1) ; M. Guillaume Auda (RTL, France 24) ; M. Christophe Boltanski (Nouvel Obs) ; M. Frédéric Barreyre (Radio France)
IV.- EGYPTE
Lundi 23 février
- M. Jean-Félix Paganon , ambassadeur de France en Egypte, et les chefs de service
- M. Sayyed Mechaal , Ministre de la production militaire
- M. Saad Katatni , Chef du bloc parlementaire des Frères Musulmans
- M. Mustafa Al-Fiqqi , Président de la commission Affaires étrangères à l'Assemblée du Peuple
- M. Mohamed Abdellah , secrétaire aux relations extérieures du PND et Président du comité chargé des études politiques du PND, et M. Ali Maher (ex-ambassadeur d'Egypte à Paris, membre du même comité)
- Dîner avec des chercheurs du centre de recherches et d'études stratégiques d'Al-Ahram : Amr Chubaki, Dia Rechouane, Hala Mustafa et des chercheurs du CEDEJ : Marc Lavergne, Hadjar Aourdi, Khaled Al-Khamissi
Mardi 24 février
- M. Ahmed Aboul Gheit , Ministre des Affaires étrangères
- M. Abou Ela Madi , dissident des Frères musulmans et fondateur du parti Wassat (non reconnu)
- M. Youssef Boutros-Ghali , Ministre des Finances
- M. Olivier Ordas , attaché de police
- M. Omar Souleiman , Chef des services de renseignements
- Dîner avec des membres des partis d'opposition : Rifaat Saïd (Tagammu) et Ahmed Hassan (parti nassérien) et des journalistes Fahmi Houweidi (journaliste) et Mahmoud Abaza (Al-Wafd)
Mercredi 25 février
- M. Mohamed Bassiouni , président de la Commission des Affaires arabes, étrangères et de sécurité nationale, au Conseil consultatif, ancien ambassadeur d'Egypte en Israël
- Cheikh Sayyed Tantawi grand imam de l'Université islamique d'Al-Azhar
- Mme Margaret Scobey , ambassadrice des Etats-Unis
- Colonel Christian Herrou , attaché de défense
- Mme Françoise Meley , chef de la mission économique
Jeudi 26 février
- Mme Naela Gabr , directrice des affaires multilatérales (non prolifération) au ministère des Affaires étrangères
- M. Ahmed Salama - Le nouvel Orient
- M. Gérard Peytrignet , chef de délégation du CICR au Caire
- Rencontre avec un bloggeur appartenant à la mouvance des Frères Musulmans
- Dîner avec M. Jean-Pierre Debaere , conseiller culturel, et des représentants de la société civile
VI.- VISITES EN JORDANIE, IRAK, BAHREIN, KOWEIT
Dimanche 29 mars - Amman
- M. Denys GAUER, ambassadeur de France en Jordanie, et les chefs de service
- M. Zeid Rifai , président du Sénat
- M. Abdul Hadi Majali , président de la Chambre des Représentants
- M. Nabil Sharif , ministre des médias et de la communication, porte-parole du Gouvernement, ministre des Affaires étrangères ad interim
- M. Faysal Al Fayez , président de la commission des affaires étrangères, ancien Premier ministre
- M. Zaki Ben Irchid , secrétaire général du Front d'Action Islamique
- Association « Jerusalem Forum »
- M. Adnan Abu Odeh , ancien chef de la Cour Royale
- SAR le Prince Hassan
Lundi 30 mars - Bagdad
- M. Jean-François Girault, ambassadeur de France, et les chefs de service
- M. Jawad Al-Bolani, ministre de l'Intérieur
- Rencontre avec des professeurs et des étudiants irakiens au centre culturel français de Bagdad
- M. Barhem Saleh , vice-Premier ministre
Mardi 31 mars - Bagdad
- M. Khaled Al-Attiya , vice-président du Parlement
- Cheikh Houmam Hamoudi, président de la commission des Affaires étrangères du Parlement irakien et M. Abdel Bari Zebari et Mme Tania Talahat Gilly , membres du groupe d'amitié franco-iraquien :
- M. Tarek Al-Hachémi, vice-président de la République d'Irak
- Dr Hachem Mostapha, vice-ministre des affaires étrangères
- Général Raymond T. ODIERNO - Commandant en chef des forces de la coalition en Irak - Camp Victory
- Panel de la société civile : Père Youcef , Dominicain, Dr Balkis Jawad, professeur de Sciences politiques à l'Université de Bagdad, Avocat et Amid Nasser, thésard
- M. Adel Abdel-Mehdi , vice-président de la République d'Irak
Mercredi 1 er avril - Bagdad
- Général Abdel Kader Al-Obaidi, ministre de la défense
- M. Barham Saleh , vice-premier ministre
- Entretien avec des journalistes : M. Sammy Ketz , directeur de l'AFP à Bagdad, M. Ned Parker , Los Angeles Times, Mme Alissa Rubin , New York Times
- M. Christopher Prentice, ambassadeur de Grande Bretagne
- Entretien avec des journalistes irakiens : M. Youssef Selman , directeur de rédaction ; Najah Al-Rikabi , secrétaire de rédaction du journal Machreq ; M. Ali Khusbak , rédacteur en chef du journal Bagdad ; M. Kazem Al-Moqdadi , de la chaîne privée Bagdadiya ; M. Abdel Latif Al-Moussa wi, du journal Zaman
Jeudi 2 avril - Manama- Bahreïn
- M. Yves Oudin, ambassadeur de France, et les chefs de service
Vendredi 3 avril - Manama- Bahreïn
- M. Jamal Fakhro , vice-président de la Choura et divers autres membres de la Choura
Samedi 4 avril - Manama - - Bahreïn
- M. Nizar Bahrana , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
- M. Alain Lechevallier , ancien cadre de Total
Dimanche 5 avril - Koweit - City
- M. Jean-René Gehan, ambassadeur de France, et les chefs de service
- Capitaine de Vaisseau Pierre Leterme , commandant du groupe de guerre des mines
- Cheikh Dr Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah , vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït
- M. Khaled Sulaiman Al-Jarallah , sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
- Cheikh Thamer Al-Sabah , vice-président du bureau national de Sécurité
- Mme Deborah K. Jones , ambassadeur des Etats-Unis
- M. Khorafi, président du Parlement du Koweït
- M. Hussein Afshar , homme d'affaire iranien
VI.- KURDISTAN, TURQUIE
Mercredi 6 mai - Erbil
- M. Falah Moustafa , responsable du département des relations extérieures du GRK
Jeudi 7 mai - Erbil
- M. Jaafar Moustafa , ministre des Peshmergas
- M. Massoud Barzani , président de la Région
- M. Adnan Mufti , président du Parlement
- M. Karim Sinjari , ministre de l'Intérieur
- M. Masrour Barzani , Chef des services de renseignements
- M. Claude Poulet , COCAC à l'ambassade de France à Bagdad
Vendredi 8 mai - Erbil
- M. le consul général de Grande-Bretagne et le journaliste français Hedi Aouidj
- Louis Sako, archevèque d'Erbil
Dimanche 10 mai - Istanbul
- Universitaires français et turcs à l' Institut français d'études anatoliennes et à l' université Galatasaray )
- Professeur Alexandre Toumarkine , Institut français d'études anatoliennes
Lundi 11 mai - Ankara
- M. Bernard Emié , ambassadeur de France en Turquie, et les chefs de service
- M. Þükrü Elekdað , vice-président du Groupe d'amitié France-Turquie à la Grande Assemblée nationale de Turquie
- M. Douglas Silliman , chargé d'affaires a.i. américain
- M. Ertuðrul Apakan , sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
- M. Abdullah Gül, Président de la République de Turquie
Mardi 12 mai - Istanbul
- M. Murat Özçelik , représentant spécial pour l'Iraq
- M. Tahsin Burcuoðlu , secrétaire général du Conseil de Sécurité Nationale
VIII- VISITES AUX ETATS-UNIS
Jeudi 19 mai - Washington
- M. Pierre Vimont, ambassadeur de France aux Etats-Unis, et les chefs de service
- M. Dennis Ross, conseiller spécial du Secrétaire d'Etat pour le Golfe et l'Asie du Sud-Ouest
- M. John Kerry's , directeur de la commission des affaires étrangères du Sénat
- M. Jeffrey Feltman , secrétaire-adjoint pour le Proche-Orient
- M. David Makovsky , Senior Fellow et directeur au Washington Institute's Project on the Middle East Peace Process
- Dr Zbigniew Brzezinski , ancien conseiller à la sécurité nationale du Président Jimmy Carter
- M. Meaghen McDermott , directeur pour la Syrie, le Liban, et l'Afrique du Nord Conseil national de Sécurité
- AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) :
- Dr Marvin Feuer et Ambassador Brad Gordon , co-directeurs,
-
Mme Ester Kurz
, directeur de la
stratégie législative,
Mme Leah Odinec
,
M. Raphael Danziger
- Mme Marina Ottaway , directeur du programme du Moyen-Orient à la fondation Carnegie Endowment
Mercredi 20 mai
- Général Bent Scowcroft (The Scowcroft Group)
Jeudi 21 mai - New-York
- American Jewish Committee :
- M. Aaron Jacob , directeur associé aux affaires internationales
- Mme Linda Senat , directeur des relations internationales
- M. Abraham Foxman, directeur national Anti Deformation League
- M. Terje Roed Larsen , coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Proche-Orient
- M. Malcolm Hoenleim , président exécutif adjoint de la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations
IX- VISITES A BRUXELLES
Mercredi 17 juin
- M. Javier Solana , secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, Haut-représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
- M. Eneko Landaburu , directeur général de la DG RELEX de la Commission européenne
- M. Marc Otte , représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
- M. Philippe Etienne , représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne
ANNEXE 2 - La Charte du mouvement de la résistance islamique palestinienne (Hamas)
Document consultable au format pdf
ANNEXE 3 - Carte de La Bande de Gaza
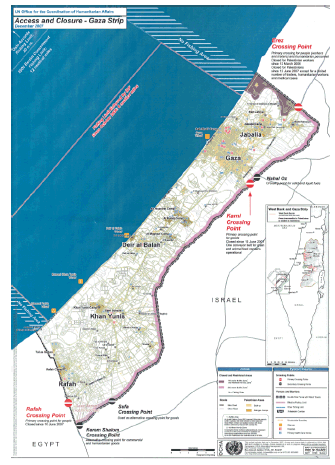
ANNEXE 4 - Compte rendu d'entretien entre la mission sénatoriale française et Khaled Mechaal - chef du bureau politique du Hamas À Damas le 20 janvier 2009 - (traduction des notes prises par M. Peter Harling - international Crisis Group)
Nous espérons que la position officielle de la France reflètera ces sentiments de la population mais aussi le passé de résistance de la France [Il faisait référence à la seconde guerre mondiale].
[Interrogé pour savoir si l'attaque israélienne, et plus particulièrement ses proportions, avaient surpris le Hamas, il a, avant de commencer à répondre, encouragé ses visiteurs à se rendre à Gaza pour constater la destruction et exprimé son mécontentement face aux déclarations occidentales.] Nous sommes mécontents des déclarations de Ban Ki Moon à Charm el-Cheik. Nous sommes aussi en colère contre les dirigeants européens, qui ont fait de vagues promesses aux Palestiniens alors qu'ils ont pris des engagements fermes devant les Israéliens.
Pourquoi la guerre a-t-elle commencé ? Ce n'était pas une guerre au sens classique du terme ; c'était une offensive unilatérale. Israël devait respecter un cessez-le-feu sans aucune ambigüité concernant la levée du siège et l'ouverture des frontières. L'opinion populaire s'y oppose. C'était une erreur de la part des Egyptiens et des Israéliens. Lorsque le cessez-le-feu a expiré, aucune des deux parties ne nous a offert de le prolonger. Notre position était que nous ne le prolongerions pas sans ouverture des frontières. Malheureusement, certaines forces régionales ont couvert cette agression, comme s'il était dans l'intérêt de ces parties, les Etats-Unis et Israël, de liquider le Hamas. Nous pensons que cette collusion visait à offrir le Hamas en cadeau à la nouvelle administration. L'autorité palestinienne, en particulier, avait compris qu'elle ne pourrait pas écarter le Hamas en entretenant l'insécurité ou en imposant le siège, avec pour seul recours les tanks israéliens.
Nous n'avons pas été surpris par l'attaque elle-même, Israël n'avait pas fait mystère de ses intentions. Nous étions bien préparés. De plus, la terre nous appartient et nous défendons une cause juste. Nous sommes les victimes ; nous n'avons pas choisi cette guerre. Pour toutes ces raisons, nous avons tenu bon. Mais, bien sûr, nous avons été choqués par l'ampleur des crimes commis par Israël contre les civils. Sur les 1 300 victimes, la moitié étaient des femmes et des enfants. Ils ont détruit plus de 20 mosquées, ainsi que des écoles, des hôpitaux, des ambulances, etc. Les responsables israéliens méritent d'être soumis à la même justice que les Serbes.
Il est clair que le Hamas est sorti vainqueur de cette guerre. Nous avons subi de lourdes pertes humaines mais perdu seulement 48 combattants. Ces chiffres peuvent surprendre, mais c'est un fait. Nous n'avons pas mené une guerre conventionnelle contre Israël mais une guérilla. Nous étions bien préparés et avons utilisé des abris souterrains. La presse israélienne elle-même a dit que le Hamas était une armée de fantômes. Est-ce que Israël a fait des prisonniers ? Non. [Il a aussi rappelé l'histoire selon laquelle l'armée israélienne n'aurait pas hésité à bombarder trois de ses soldats capturés par le Hamas, afin de le priver d'une victoire et d'avoir de nouveaux prisonniers.] La résistance a combattu de manière légendaire. Israël n'a atteint aucun des objectifs annoncés : il n'a pas déposé le Hamas ni affaibli la résistance ni fait cesser les tirs de roquettes. Suivez le débat chez les israéliens et vous comprendrez qui a gagné cette guerre.
La guerre a abouti à deux résultats majeurs. Toutes les parties, qu'elles soient régionales ou internationales, ont tout fait pour chasser le Hamas. Elles ont essayé toutes les options et elles ont échoué. Le premier résultat important est que la façon de traiter avec le Hamas doit désormais changer, être fondée sur le respect et la reconnaissance de son rôle et de sa légitimité. Le Hamas a gagné sa légitimité, d'abord en tant que mouvement national, puis par des élections et, enfin, en résistant à la dernière agression israélienne. Sans cette nouvelle approche, il n'y aura pas la paix dans la région.
La deuxième leçon est qu'Israël ne peut tout simplement pas vaincre le peuple palestinien. En dépit de toute sa puissance, il ne peut pas imposer ses conditions aux Palestiniens. La paix passera inévitablement par la reconnaissance des droits des Palestiniens à avoir un État. La force n'assurera pas la sécurité d'Israël.
C'est donc ce rôle que nous demandons à l'Europe d'assumer. Les États-Unis ont échoué et l'Europe peut combler le vide qui s'est créé et faire pression sur la prochaine administration. L'Europe et les États-Unis peuvent, ensemble, faire pression sur Israël. Il faut dire à Israël : « la seule option qui vous reste est la paix via la reconnaissance des droits nationaux des Palestiniens. »
[En réponse à une question sur le silence embarrassant en Cisjordanie.] Vous avez raison d'être surpris, mais c'est à Abu Mazen et Salam Fayyad de répondre à cette question. Ils ont interdit toutes les manifestations. Ils ont arrêté des centaines de responsables du Hamas en Cisjordanie. Depuis un an et demi, l'Autorité palestinienne et Israël collaborent étroitement pour étouffer la Cisjordanie. Les gens sont épuisés. 11 000 prisonniers originaires de Cisjordanie sont détenus dans les prisons israéliennes, dont beaucoup sont des leaders du Hamas et d'autres personnalités, c'est-à-dire l'élite nécessaire pour mobiliser les gens. C'est la raison de la faiblesse de leur position.
[Sur le Hezbollah] Le Hezbollah a fait du bon travail en termes de relations publiques. Mais ses options militaires étaient limitées. Les forces internationales sont déployées dans le sud et il est donc difficile au Hezbollah d'ouvrir un autre front.
[En réponse à une remarque sur les nombreuses questions que les invités souhaitaient poser] Vous avez beaucoup de questions et nous avons beaucoup de réponses !
[Sur les raisons du cessez-le-feu et les informations concernant la pression de la Syrie/Turquie.] Ces informations sont fausses. Avant la fin de l'assaut, des conversations intenses étaient en cours, auxquelles participaient les Egyptiens, les Syriens, les Turcs et même les Français. Nous avons envoyé notre délégation au Caire quatre fois. Malheureusement, aucun accord indirect n'a été trouvé entre le Hamas et Israël. Pourquoi ? Les Égyptiens imposaient trois conditions, même s'ils les attribuaient à Israël. L'une était un cessez-le-feu permanent et non plus provisoire. Cela supposait l'arrêt des combats pendant 10 ou 15 ans ! Nous avons refusé, parce que cela signifiait mettre fin à la résistance. Lorsque Israël se retirera de tous les territoires occupés, reconnaîtra nos droits et autorisera la création d'un État palestinien, alors nous pourrons parler d'un cessez-le-feu permanent. La deuxième condition était un engagement écrit du Hamas de ne plus faire entrer d'armes en contrebande. Nous considérons que la contrebande d'armes est la responsabilité des Etats, principalement l'Égypte et Israël. Nous sommes un mouvement de résistance. La troisième condition était l'ouverture de Rafah sur la base de l'accord de 2005. Nous avons refusé. Cet accord est caduc. Il a été signé avant l'arrivée au pouvoir du Hamas ; les conditions dans la zone de Gaza ont changé. En réponse, nous avons envoyé une proposition aux Égyptiens, indiquant ce sur quoi les quatre parties peuvent se mettre d'accord (l'Égypte, le gouvernement du Hamas, la présidence palestinienne et les observateurs européens). L'Égypte a rejeté cette proposition parce qu'elle refuse de donner un quelconque rôle au Hamas aux points de passage.
En fait, l'attitude de l'Égypte envers le Hamas ne fait qu'ajouter à l'agression israélienne.
L'Égypte faisait pression sur nous au Caire ; Israël faisait pression sur nous militairement à Gaza. Lorsque la situation s'est bloquée au Caire, Israël a intensifié la pression à Gaza. Par conséquent, une pression syrienne ou turque n'était pas nécessaire.
[Répondant à une question sur ce que ferait le Hamas si les Israéliens ne se retiraient pas à la date prévue] Ils sont déjà partis. Ils ont commencé ce matin et ont achevé de se retirer. Ils n'avaient pas d'autre choix.
[Répondant à une question sur ce qui se passerait si le blocus était maintenu et que les points de passage n'étaient pas rouverts] Pendant la guerre, nous avons exprimé quatre exigences : 1. Le cessez-le-feu. 2. Le retrait. 3. La levée du siège. 4. L'ouverture des points de passage. Nous avons atteint deux objectifs. Il en reste deux. De ce point de vue, nous sommes toujours en guerre. Je pense que le monde a entendu le message et compris que le siège avait conduit à la guerre et qu'il doit maintenant être levé. Sinon, le peuple palestinien restera sur ses positions et aucune stabilisation ne sera possible dans la région.
Toutes les chaînes arabes affirment que la population de Gaza blâme Israël d'abord puis les Arabes et enfin la communauté internationale.
[Répondant à une question sur ce que le sommet du Koweït change]. Nous avons tous été surpris par le discours du roi Abdallah. Nous l'avons accueilli avec plaisir et j'ai appelé Saud al-Faiçal et Migrin Ibn Abdul Aziz pour exprimer notre satisfaction. Hier, c'est vrai, il y a eu un certain degré de réconciliation. Mais d'après ce que j'entends aujourd'hui, cette réconciliation ne se reflète pas dans les positions respectives des différentes parties. La déclaration finale n'a pas fait mention des questions litigieuses. Certains responsables n'ont même pas assisté à la dernière réunion.
[Répondant à une question sur qui pourrait être un bon partenaire en termes de réconciliation des Palestiniens]. L'agenda proposé par ceux qui prennent les décisions au sein du Fatah et de l'OLP n'est pas bon. Nous considérons qu'il y a eu collusion entre l'OLP et Israël pendant cette guerre. Leur attitude peut changer. Mais le Hamas doit être respecté comme un acteur central dans la question palestinienne et les règles de la démocratie palestinienne doivent être appliquées.
[Sur le cadeau que leur charte et le rejet d'Israël font à leurs détracteurs.] C'est une bonne question et je vais vous donner une bonne réponse.
L'une des façons de présenter le débat consiste à dire : « qu'est-ce que Mahmoud Abbas et, avant lui, Yasser Arafat ont obtenu en échange de la reconnaissance d'Israël et en renonçant à la Charte de l'OLP ? Rien. »
Les Arabes ont fait une offre généreuse de paix en 2002 (« l'initiative arabe de paix » du Prince Abdallah d'Arabie saoudite). Israël a-t-il répondu ? Non. Le Hamas lui-même a fait une offre généreuse en 2006, lorsque nous sommes parvenus à un consensus entre les factions palestiniennes après la réconciliation.
Nous avons implicitement accepté de reconnaître Israël dans ses frontières de 1967, à condition évidemment que les droits des Palestiniens soient reconnus et qu'ils jouissent d'une authentique souveraineté. Le document indiquait que nous acceptons Israël avec les frontières de 1967, bien évidemment à la condition que les droits nationaux palestiniens soient reconnus et que les Palestiniens jouissent d'une réelle souveraineté. Tout le monde adhérait à cette position et elle représentait quelque chose de nouveau pour le Hamas.
En conséquence, la reconnaissance d'Israël n'est pas un problème. Mais on ne peut pas demander à ceux qui vivent sous le joug de l'occupation de reconnaître le geôlier. La solution est de rendre possible un Etat palestinien, puis de demander à cet Etat de reconnaître Israël.
[Répondant à une question sur le rôle que l'on peut attendre des Français et des Européens] Israël est comme une personne qui est habituée à obtenir d'une autre personne ce qu'elle veut par la force. Cela peut changer seulement si cette autre personne refuse de céder ou si une tierce partie intervient. En raison de la faiblesse des Arabes et des Palestiniens et parce que les États-Unis n'ont pas rempli leur rôle, rien ne se passe.
Nous croyons que les Européens peuvent jouer un rôle, parce qu'ils ont une meilleure connaissance des causes du conflit ; parce que les politiques américaines ont échoué et laissé un vide qui doit être comblé ; enfin, à cause du dernier échec subi par Israël en utilisant la force et la force seule. La France, avec d'autres pays européens, peut aider à recadrer les politiques occidentales à l'égard de la région. Depuis 20 ans, les États-Unis ont suivi une certaine démarche dans le processus de paix et elle a échoué ; poursuivre dans la même voie aboutira aux mêmes résultats.
[Répondant à une question de savoir si le cadre de référence négocié à la fin de l'administration Clinton et qui semble à tous être la seule manière pratique de résoudre le conflit, est acceptable par le Hamas] Non. Et il n'est pas seulement inacceptable pour le Hamas, il l'est aussi pour le Fatah. Ce cadre ne tient pas compte des droits nationaux des Palestiniens. Je dirais plutôt que le cadre de référence, dans ces négociations, était les résolutions internationales concernant le conflit. Maintenant, lorsqu'on négocie sur la base de ce cadre, pourquoi essayer de le manipuler ou de le transformer ? Lorsque vous acceptez d'altérer le cadre de référence, vous ouvrez la porte à toute sorte de problèmes, simplement parce que Israël est la partie la plus puissante. Vous vous retrouvez avec des échanges de terres à la seule discrétion d'Israël, une situation insoluble à Jérusalem, des questions sur la possession de la souveraineté du sol et du sous-sol à proximité du Dôme du Rocher. En pratique, il n'y a pas de cadre de référence ferme et à cause de ça, c'est le plus fort qui impose ses conditions. Israël ne renoncera jamais à rien sauf sous la pression soit de la communauté internationale soit du Hamas.
ANNEXE 5 - Le partage de la Palestine
Document consultable au format pdf
ANNEXE 6 - Ce qui reste de la Cisjordanie
Document consultable au format pdf
(Carte de Julien Bousac, Atlas du Monde diplomatique , "Un monde à l'envers", Paris, 2009 (c)®.)
ANNEXE 7 - Le système politique d'Israël et la proclamation d'indépendance
L'Etat d'Israël n'a pas de constitution formelle. En 1948, et malgré la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 (voir infra) qui annonce qu'« une Constitution devra être adoptée par une Assemblée constituante d'ici le 1er octobre 1948 », les dissensions entre les religieux et les laïcs empêchèrent la rédaction d'un texte constitutionnel unique. Une partie des Juifs religieux rejetait l'idée d'un document qui aurait pour l'État une autorité supérieure aux textes religieux comme la Torah.
La création de l'Etat d'Israël a été proclamée le 14 mai 1948, à quatre heures de l'après-midi, par le Conseil provisoire de l'Etat réuni au musée de Tel Aviv. Elle a été lue par David Ben Gourion et signée par les 37 membres du Conseil. En voici le texte :
|
« ERETZ-ISRAEL (le Pays d'Israël) est le lieu où naquit le Peuple Juif. C'est là que se modela sa forme spirituelle, religieuse et politique. C'est là qu'il vécut sa vie indépendante. C'est là qu'il créa ses valeurs tant nationales qu'universelles et qu'il donna au monde le Livre des Livres Eternels. Exilé de Terre Sainte, le peuple juif lui demeura fidèle tout au long de sa Dispersion et il n'a jamais cessé de prier pour son retour pour y restaurer son indépendance nationale. « Mus par ce lien historique et traditionnel, les Juifs s'efforcèrent au long des siècles de revenir dans le pays de leurs ancêtres. Au cours de ces dernières décennies ils rentrèrent en masse dans leur pays. Pionniers, réfugiés, combattants, ils ont défriché les déserts, ressuscité la langue hébraïque, construit des villes et des villages, créé une communauté évoluant sans cesse, maîtresse de son économie et de sa culture, recherchant la paix mais sachant se défendre, apportant à tous les habitants du pays les bienfaits du progrès et aspirant à l'indépendance nationale. « En l'an 5657 (1897) le Premier Congrès Sioniste convoqué par le père spirituel de l'Etat Juif, Théodore Herzl, proclama le droit du Peuple juif à sa renaissance nationale sur le sol de sa patrie. Ce droit fut reconnu par la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et ratifié par un Mandat de la Société des Nations, donnant ainsi une sanction internationale aux liens historiques entre le Peuple juif et le Pays d'Israël et reconnaissant le droit du Peuple juif d'y réédifier son Foyer national. La catastrophe nationale qui s'est abattue sur le peuple juif, le massacre de six millions de Juifs en Europe, a montré l'urgence d'une solution au problème de ce peuple sans patrie par le rétablissement d'un Etat juif qui ouvrirait ses portes à tous les Juifs et referait du peuple juif un membre à part entière de la famille des Nations. « Les survivants des massacres nazis en Europe, ainsi que les Juifs d'autres pays, ont cherché, sans relâche, à immigrer en Palestine sans se laisser rebuter par les difficultés ou les dangers et n'ont cessé de proclamer leur droit à une vie de dignité, de liberté et de labeur dans la patrie nationale. « Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de ce pays a pris sa part de la lutte pour la liberté aux côtés des nations éprises de paix, afin d'abattre le fléau nazi, et elle s'est acquis, par le sang de ses combattants comme par son effort de guerre, le droit de compter parmi les peuples qui fondèrent les Nations-Unies. « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté une résolution demandant la création d'un État juif en Palestine et invité les habitants de la Palestine à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cette résolution. Cette reconnaissance, par les Nations-Unies, du droit du Peuple juif à créer son État est irrévocable. « C'est là le droit naturel du Peuple juif d'être, comme toutes les autres nations, maître de son destin sur le sol de son propre État souverain. « En conséquence, nous, membres du conseil représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste, nous nous sommes rassemblés ici, en ce jour ou prend fin le mandat britannique et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif et conformément à la résolution de l'assemblée générale des Nations Unies, NOUS PROCLAMONS LA CRÉATION D'UN ÉTAT JUIF EN TERRE D'ISRAËL QUI PORTERA LE NOM D'ÉTAT D'ISRAËL. « NOUS DÉCLARONS que, dès l'expiration du Mandat, en cette veille de Sabbath, 6 Iyar -5708 (I4 mai 1948) et jusqu'à l'installation des autorités régulières de l'État, dûment élues, conformément à la Constitution qui sera adoptée par l'Assemblée Constituante convoquée avant le 1er octobre 1948, le Conseil National remplira les fonctions de Conseil Provisoire de l'État et son organisme exécutif, le Directoire national, fera fonction de Gouvernement provisoire de l'État juif qui sera appelé "Israël ". « L'état d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de leur Dispersion; il veillera au développement du pays pour le bénéfice de tous ses habitants; il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l'idéal des prophètes d'Israël; il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants sans distinction de religion, de race ou de sexe; il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d'éducation et de culture; il assurera la protection des Lieux Saints de toutes les religions et sera fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies. « L'état d'Israël se montrera prêt à coopérer avec les institutions et les représentants des Nations Unies pour l'exécution de la résolution du 29 novembre 1947 et s'efforcera de réaliser l'union économique dans tout le pays d'Israël. Nous demandons aux Nations Unies d'aider le Peuple juif à édifier son État et de recevoir l'État d'Israël dans la famille des Nations. « NOUS DEMANDONS - face à l'agression dont nous sommes l'objet depuis quelques mois - aux fils du peuple Arabe de l'État d'Israël de préserver la paix et de prendre leur part dans l'édification de l'État sur la base d'une égalité complète des droits et devoirs et d'une juste représentation dans tous les organismes provisoires et permanents de l'État. « NOUS TENDONS LA MAIN, en signe de paix et de bon voisinage, à tous les pays voisins et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec le Peuple juif rétabli dans sa souveraineté nationale. L'État d'Israël est prêt à contribuer à l'effort commun de développement du Moyen-Orient tout entier. « NOUS DEMANDONS au peuple juif dans sa Dispersion de se rassembler autour des Juifs d'Israël, de les assister dans la tâche d'immigration et de reconstruction et d'être à leurs côtés dans la grande lutte pour la réalisation du rêve des générations passées : la rédemption d'Israël. « Confiants en I'Éternel Tout-puissant, nous signons cette Déclaration en cette séance du Conseil Provisoire de I'État, sur le sol de la Patrie, dans la ville de Tel-Aviv, cette veille de Sabbath, 5 Iyar 5708, 14 mai 1948 ». |
Le 13 juin 1950, la première assemblée élue - la Knesset trouva un compromis en chargeant son comité de la constitution, des lois et de la justice d'élaborer une constitution chapitre par chapitre, chacun entrant en vigueur avec le caractère de loi fondamentale. Ces chapitres seraient in fine assemblés en une constitution après l'adoption du dernier.
De 1958 à 1988, neuf lois fondamentales furent adoptées qui disposaient de l'organisation des institutions politiques. En 1992, la Knesset adopta les deux premières relatives aux droits fondamentaux, ce qui permit par la suite à la Cour suprême d'Israël de se déclarer compétente en matière de contrôle de constitutionnalité.
Le comité de la constitution, des lois et de la justice de la Knesset s'est remis à sa tâche de rédaction d'une constitution complète. Il a présenté une série de propositions le 13 février 2006, qui pourraient permettre de mettre fin au système des lois fondamentales. Les chefs des trois principaux partis politiques - Ehud Olmert pour Kadima, Amir Peretz pour le Parti travailliste et Benyamin Netanyahou pour le Likoud - ont accepté ce travail et ont déclaré que la 17ème Knesset devrait examiner le projet d'un texte complet en séance plénière.
ANNEXE 8 - Le « document des prisonniers » (signé par des leaders emprisonnés du Fatah, du Hamas, du Jihad islamique, du FPLP et du FDLP)
MANIFESTE DE RÉCONCILIATION NATIONALE PALESTINIENNE
Au nom de Dieu compatissant et miséricordieux
« Soumets-toi au jugement de Dieu et ne te disperse pas » (verset du Coran)
Guidés par un sens profond de la responsabilité nationale et historique et devant les dangers qu'affronte notre peuple ; pour renforcer et consolider le front interne palestinien ainsi que la protection de l'unité nationale et de l'unité de notre peuple dans le pays et la Diaspora ; pour lutter contre le plan d'Israël qui vise à imposer la solution israélienne qui brise le rêve de notre peuple et son droit à créer un État palestinien indépendant pleinement souverain, plan que le gouvernement israélien compte mettre en oeuvre dans la prochaine phase avec la construction et l'achèvement du mur de l'apartheid et la judaïsation de Jérusalem, l'expansion des colonies juives, l'occupation de la vallée du Jourdain, l'annexion de vastes zones de la Rive occidentale et le blocage du chemin afin d'empêcher notre peuple d'exercer son droit au retour.
Soucieux de conforter ce que notre peuple a accompli dans son long combat, en mémoire des martyrs de notre grand peuple, de la douleur de ses prisonniers et la souffrance de ses blessés ; et sachant que nous nous trouvons encore dans une phase de libération dont le sentiment national et la démocratie sont les fondements principaux, qui nous imposent une stratégie de combat politique conforme à ces fondements et afin que le dialogue national palestinien soit un succès, sur la base de la déclaration du Caire et de l'urgent besoin d'unité et de solidarité, nous présentons ce manifeste (le manifeste de réconciliation nationale) à notre grand peuple et au président Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ainsi qu'à la direction de l'OLP, au Premier ministre Ismail Haniyeh, au conseil des ministres, au président du CNP, aux membres du CNP, au président et aux membres du PLC, à toutes les forces et factions palestiniennes, à toutes les organisations et institutions non gouvernementales, populaires et au leaders de l'opinion publique palestinienne dans le pays et au sein de la Diaspora.
Notre espoir est que ce manifeste soit considéré comme un tout, qu'il recueille le soutien et l'approbation de tous et qu'il puisse contribuer à l'élaboration d'un accord palestinien de réconciliation nationale.
Les Palestiniens des territoires et de la Diaspora veulent libérer leur terre et exercer leur droit à la liberté, au retour et à l'indépendance, à faire valoir leur droit à l'auto-détermination et notamment à créer sur tous les territoires occupés en 1967 leur propre État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Ils veulent aussi obtenir le droit pour les réfugiés de rentrer chez eux et la libération de tous les prisonniers et détenus, en se fondant sur les droits historiques de notre peuple sur la terre de nos ancêtres, sur la Charte des Nations-Unies, sur le droit international et sur la légitimité internationale.
Travailler rapidement à concrétiser ce qui a été convenu au Caire en mars 2005 concernant le développement et le rôle que doit jouer l'OLP joint au Hamas et au mouvement du jihad islamique, seul représentant légitime du peuple palestinien, où qu'il soit, de manière à répondre aux changements sur la scène palestinienne selon les principes démocratiques et à renforcer la situation de l'OLP en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien, afin de l'aider à assumer ses responsabilités à l'égard de notre peuple dans le pays mais aussi dans la Diaspora, ainsi qu'à mobiliser le peuple dans la défense de ses droits nationaux, politiques et humanitaires au sein des différents forums et cercles régionaux et internationaux. Conduire cette action en tenant compte du fait que l'intérêt national appelle la formation d'un nouveau Conseil national palestinien avant la fin de 2006, en veillant à garantir la représentation de toutes les forces, factions et parties nationales et islamiques palestiniennes et des communautés de notre peuple partout dans le monde, des différents secteurs et personnalités publiques, proportionnellement à la représentativité, à la présence et au rôle dans le combat et la vie politique. Maintenir l'OLP comme un large front, une coalition nationale et un point de rassemblement pour tous les Palestiniens de Palestine et de la Diaspora, comme la plus haute référence politique.
Affirmer le droit du peuple palestinien à résister par tous les moyens et focaliser la résistance dans les territoires occupés de 1967 en l'associant à l'action politique, aux négociations, à l'action diplomatique et à la poursuite de la résistance populaire et massive contre l'occupation sous ses diverses formes. Garantir une large participation de tous les secteurs de la population à la résistance.
Créer un plan d'action politique exhaustif, unifier la rhétorique politique palestinienne sur la base du programme de consensus national, de la légitimité arabe et des résolutions internationales accordant justice au peuple palestinien, représenté par l'OLP et l'Autorité nationale palestinienne en tant que président et gouvernement, ainsi que les mouvances nationales et islamiques, les organisations de la société civile et les personnalités publiques, afin de mobiliser un soutien et une solidarité politiques, financiers, économiques et humanitaires auprès des instances arabes, islamiques et internationales en faveur de notre peuple et de l'Autorité nationale palestinienne. Promouvoir le droit de notre peuple à l'auto-détermination, à la liberté, au retour sur sa terre et à l'indépendance, s'opposer à la volonté d'Israël d'imposer à notre peuple une solution israélienne et lutter pour faire cesser le siège qui opprime le peuple palestinien.
Protéger et renforcer l'Autorité nationale palestinienne car elle est le noyau du futur État, et a été installée au prix du combat et des sacrifices, du sang et de la souffrance du peuple palestinien. Insister sur le fait que les intérêts supérieurs de la nation imposent de respecter le caractère temporaire de l'Autorité nationale palestinienne, les lois, les responsabilités et les pouvoirs du président élu par la volonté du peuple palestinien dans le cadre d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Respecter les responsabilités et les pouvoirs du gouvernement qui a reçu le vote de confiance du Conseil législatif palestinien (PLC), promouvoir l'importance et la nécessité d'une coopération constructive entre la présidence et le gouvernement, qui doivent travailler de concert et se réunir régulièrement pour régler les différends qui peuvent survenir, au travers d'un dialogue fraternel fondé sur la constitution provisoire et dans l'intérêt supérieur de la nation. Engager une réforme complète des institutions de l'Autorité nationale palestinienne, en particulier de l'appareil juridique et garantir le respect de l'autorité judiciaire à tous les niveaux pour mettre en oeuvre ses décisions et renforcer l'état de droit.
Former un gouvernement d'unité nationale sur des bases qui garantissent la participation de tous les blocs représentés au Parlement, en particulier le Fatah et le Hamas ainsi que les forces politiques désireuses de participer sur la base du présent manifeste et du programme commun, afin d'améliorer la situation palestinienne aux niveaux local, arabe, régional et international et de relever les défis grâce à un gouvernement national fort, bénéficiant du soutien populaire et politique de toutes les forces palestiniennes, mais aussi pour offrir les meilleures conditions possibles aux secteurs qui ont supporté avec ténacité le fardeau de la résistance et de l'Intifada et qui ont été les victimes de l'agression criminelle israélienne, en particulier les familles des martyrs, les prisonniers et les blessés, ainsi que les propriétaires des maisons et des biens détruits par l'occupation, sans oublier l'aide aux chômeurs et aux diplômés.
La gestion des négociations relève de la juridiction de l'OLP et du président de l'Autorité palestinienne, guidés par les objectifs nationaux et la volonté de les réaliser, en sachant que tout accord final doit être soit présenté au nouveau Conseil national palestinien pour ratification soit soumis à un référendum, dans la mesure du possible.
La libération des prisonniers et des détenus est un devoir sacré national qui doit être assumé par toutes les forces et factions palestiniennes nationales et islamiques, mais aussi par l'OLP et l'Autorité palestinienne en tant que président et gouvernement, par le Conseil législatif palestinien et toutes les forces de la résistance.
Redoubler d'efforts pour soutenir et aider les réfugiés et défendre leurs droits. Travailler à organiser une assemblée populaire représentative des réfugiés, qui créerait des commissions pour remplir ses obligations en mettant l'accent sur le droit au retour, en s'accrochant à ce droit et en en appelant à la communauté internationale pour faire appliquer la Résolution 194 qui stipule le droit pour les réfugiés de rentrer chez eux et de recevoir des réparations.
Former un front unifié de résistance sous le nom de « Front palestinien de résistance » pour diriger la résistance contre l'occupation. Unifier et coordonner l'action et la résistance pour donner une référence politique unifiée à ce front.
Protéger le mouvement démocratique et tenir régulièrement des élections générales libres et honnêtes, respectant la loi, pour la présidence, le Conseil national palestinien, les conseils locaux et municipaux. Respecter le principe d'une passation de pouvoir dans le calme et sans heurts, promettre de protéger l'expérience démocratique palestinienne, respecter le choix démocratique et ses résultats ainsi que l'état de droit, le peuple, les libertés fondamentales, la liberté de la presse et l'égalité des citoyens en droits et en devoirs sans aucune discrimination, protéger, développer et renforcer les acquis des femmes.
Rejeter et dénoncer le siège qui opprime le peuple palestinien, piloté par les États-Unis et Israël. Faire appel aux Arabes, aux niveaux populaire et officiel, pour soutenir le peuple palestinien, l'OLP et l'Autorité palestinienne. Demander aux gouvernements arabes de mettre en oeuvre les décisions politiques, financières, économiques et d'information prises aux sommets arabes en faveur du peuple palestinien et de sa cause nationale. Mettre en évidence l'engagement de l'Autorité palestinienne à l'égard d'un consensus arabe et d'une action commune.
Appeler le peuple palestinien à l'unité et à la solidarité, unifier les rangs, soutenir l'OLP et l'Autorité palestinienne en tant que président et gouvernement, renforcer la détermination et la résistance face à l'agression et au siège, rejeter toute intervention dans les affaires intérieures palestiniennes.
Dénoncer toute forme de division qui peut conduire à des conflits internes, condamner l'usage des armes, pour quelque raison que ce soit, dans le règlement des conflits internes, bannir l'usage des armes au sein du peuple palestinien, mettre l'accent sur la sainteté du sang palestinien, recourir au dialogue comme seul moyen de surmonter les désaccords, respecter la liberté d'expression dans tous les médias, y compris en ce qui concerne l'opposition à l'autorité et à ses décisions, ainsi que le droit à la protestation pacifique. Organiser des défilés, des manifestations et des sit-in à la condition que ce soit dans le calme, sans arme et en respectant les biens publics et ceux des citoyens.
L'intérêt national passe par l'obligation de rechercher les meilleurs moyens possibles de pérenniser l'implication du peuple palestinien et de ses forces politiques dans la bande de Gaza, avec leur nouveau statut dans leur combat pour la liberté, le retour et l'indépendance. Libérer la Rive occidentale et Jérusalem de manière à faire de la bande de Gaza une force de soutien réelle à la résistance de notre peuple sur la Rive occidentale et à Jérusalem. L'intérêt national demande aussi une révision des méthodes de lutte afin de trouver les moyens les plus efficaces pour résister à l'occupation.
Réformer l'institution de sécurité palestinienne et toutes ses branches afin de les moderniser et de leur donner les moyens d'assumer leurs missions pour la défense du pays et des citoyens, de répondre à l'agression et à l'occupation, d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, de faire appliquer les lois, de mettre fin au chaos et à l'insécurité, de faire cesser toutes formes de parades publiques armées, de confisquer les armes qui font du tort à la résistance, déforment son image et menacent l'unité de la société palestinienne. Coordonner et organiser la relation avec les forces de la résistance, organiser et protéger son armement.
Appeler le Conseil législatif palestinien à poursuivre la promulgation de lois destinées à organiser le travail de l'institution et des organes de sécurité avec leurs différentes branches, mais également à promulguer une loi qui interdise toute action politique et partisane de la part des membres des services de sécurité et qui les soumette à l'autorité politique élue, telle que définie par la loi.
OEuvrer pour étendre le rôle et la présence des comités internationaux de solidarité et des groupes pacifistes qui soutiennent politiquement et localement notre peuple dans leur juste combat contre l'occupation, l'installation de colonies, le mur de l'apartheid et oeuvrer pour la mise en application de la décision de la cour internationale de justice de la Haye concernant la suppression du mur et des colonies, dont la présence est illégale.
Signé par :
Fatah : Marwan Barghouti, membre du Conseil législatif palestinien (PLC), Secrétaire du Fatah.
Hamas : Sheikh Abdul Khaleq al-Natsheh, Haut Comité de direction
Jihad islamique : Sheikh Bassam al-Sa'di.
FPLP : Abdul Rahim Mallouh, membre du Comité exécutif de l'OLP et Secrétaire général adjoint du FPLP.
DFLP : Mustafa Badarneh
ANNEXE 9 - Lettre de Son Exc. M. Seyed Mahdi Miraboutalebi, relative à la position officielle de l'Iran sur son programme nucléaire
Document consultable au format pdf
* 1 Pascal Ménoret - L'énigme saoudienne - La Découverte 2003
* 2 Henry Laurens - L'Orient arabe à l'heure américaine - Pluriel
* 3 Voir Youssef Courbage et Emmanuel Todd - Le rendez-vous des civilisations - Seuil 2007
* 4 Voir notamment le livre remarquable de Hélé Béji - « Une force qui demeure ». Arléa - janvier 2006.
* 5 Voir Amin Maalouf - Les identités meurtrières - Grasset 1998.
* 6 Voir Amin Maalouf - Le dérèglement du monde - Grasset 2009.
* 7 Voir sur ce point le livre très éclairant de Jean-Pierre Filiu : « Les frontières du Jihad ». Fayard 2006.
* 8 Voir Amin Maalouf - Le dérèglement du monde - Grasset 2009
* 9 Voir François Thual, Géopolitique du Chiisme - Arléa 1995 - Olivier Roy : le croissant et le chaos - Hachette 2007 p. 127 et suiv. ainsi que du même auteur interview dans la revue « Moyen-Orient » n° 1 août-septembre 2009 p. 6.
* 10 Pour mémoire, les quatre premiers califes qui ont succédé à Mahomet (ou « califes bien guidés ») sont : Abû Bakr (632-634) qui était son beau-père, Omar ibn al-Khattab (634-644), l'un de ses plus fidèles lieutenants, Uthman ben Affan (644-656) et Ali Ibn Abi Talib (656-661) gendre et cousin du prophète. Leur succession n'est pas héréditaire et ils sont élus.
Pour les chiites duodécimains (majoritaires) après Mohammed et sa fille Fatima, la ligne de succession compte douze « imams » issus de la famille de Ali Ibn Abi Talib à Muhammad Al-Mahdi, plus connu sous le nom d'imam caché, car il ne serait pas mort, mais se serait « occulté » en 868 et son retour marquerait la fin des temps. Chaque Imam est le fils du précédent (sauf le troisième Hussayn qui était le frère du deuxième, Hasan, tous deux étant fils d'Ali). Les chiites ismaéliens d'Inde et d'Asie centrale ne reconnaissent que sept imams et les zaydites du Yémen, cinq. Les Alevis de Turquie, les Alaouites de Syrie et les Druzes du Liban, d'Israël et de Syrie se rattachent à la famille chiite, mais se distinguent par des croyances et des usages particuliers. La lignée des imams successeurs du prophète et guides spirituels de la communauté islamique s'arrête ainsi au IX ème siècle. Il faut distinguer ces imans des simples im a ms qui, dans la religion sunnite, dirigent la prière et sont, à l'instar des pasteurs protestants, désignés par la communauté des croyants. Chez les chiites duodécimains, ces directeurs de prières portent le nom de mollahs ou d'ayatollahs et font partie d'un clergé.
Les sunnites reconnaissent non pas l'imamat, mais le califat, qui lui aussi est héréditaire. Plusieurs califats ont existé depuis la fondation de l'Islam, à la suite des luttes que se livrèrent les différents prétendants au titre de successeur de Mahomet, après les quatre premiers califes. Les plus importants sont les califats Omeyyades de Damas (661-750), les Abbassides (750-1517), le califat ottoman (1517-1924). Mustafa Kamal Atatürk abolit officiellement l'institution du califat en 1924, deux ans après celle du sultanat. Le dernier et 101 eme calife en partant d'Abû Bakr s'appelait Abdul Mejiid. Il est mort à Paris en 1944 et fut enterré à Médine.
* 11 François Thual, op. citée p. 101
* 12 Voir Vali Nasr : « le renouveau chiite » - Demopolis 2008
* 13 Le « grand Moyen-Orient » est un terme utilisé par le Président Georges W. Bush et son administration pour désigner un espace s'étendant du Maghreb à la Mauritanie, au Pakistan et à l'Afghanistan, en passant par la Turquie, le Machrek et l'ensemble de la péninsule arabe.
* 14 Voir sur ce point Amin Maalouf in : « Le dérèglement du Monde » - Ed. Grasset, février 2009 et en particulier le chapitre intitulé : « les légitimités égarées ».
* 15 Voir, notamment, sur cette question Charles Enderlin : « Quand Israël favorisait le Hamas » : Le Monde du 4 février 2009.
* 16 Voir annexe 2
* 17 V. Henry Laurens - interview donné au JDD, le 09 janvier 2009 intitulé : « Abbas n'a rien apporté. »
* 18 Interview précitée
* 19 Voir annexe 2
* 20 L'article 121 de la Constitution palestinienne du 26 mars 2003 dispose que « Le chef de l'Etat nomme le Premier ministre sur proposition du parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement et après concertation avec les chefs des groupes parlementaires »
* 21 Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories - Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza conflict - Human Rights Council - Twelfth session - Agenda item 7 - advance edited version p. 525 item 1690.
* 22 Rapport précité p. 521 item 1675 et p. 523 item 1680
* 23 Voir entretien complet en annexe 4.
* 24 Voir en annexe 6 : le système politique d'Israël et la proclamation d'indépendance.
* 25 Voir carte en annexe
* 26 Le mot utilisé en anglais est celui de « settlements » qui désigne des « hameaux » ou petits ensembles d'habitations.
* 27 Voir carte en annexe 5
* 28 « Israel and Palestine : Public Opinion, Public Diplomacy and Peace Making » ; disponible sur Internet : http://www.onevoicemovement.org/programs/polling_contents.php
* 29 Ce paramètre n'a plus aucune pertinence en 2009 du fait de la réduction des quartiers arabes par la colonisation, l'implantation de familles juives et la destruction de nombreuses maisons palestiniennes.
* 30 Ce développement nous a été présenté par M. Gridi Grinstein, directeur de l'Institut Reut, think tank indépendant, conseiller du Gouvernement sur les décisions stratégiques.
* 31 Selon une étude récente du Center for Strategic & International studies - study on a Possible Israeli Strike on Iran's Nuclear Development Facilities - Washington - Abdullah Toukan & Anthony H. Cordesman - March 14, 2009, Israël pourrait disposer de deux cents têtes nucléaires, voire plus.
* 32 Source : ministère israélien des affaires étrangères.
* 33 Le Figaro.fr du 29 juillet 2007
* 34 Voir sur ce point le livre de J. Mearsheimer et Stephen M. Walt - « le lobby israélien et la politique étrangère américaine » Ed. La découverte 2007 et sa critique par Abraham Foxman, que vos rapporteurs ont rencontré à New-York leader de l'Anti-Defamation League : « The Deadliest lies - the Israel Lobby and the myth of Jewish control ».
* 35 Les membres du Gouvernement israélien ainsi que Benyamin Netanyahu, alors simple candidat, ont refusé de recevoir vos rapporteurs lors de leur visite en Israël, au motif que ceux-ci avaient rencontré Khaled Mechaal à Damas Seul Haïm Oron, leader du Meretz, a accepté de les recevoir.
* 36 House of Commons - Foreign Affairs Committee - Global Security ; the Middle East - Eighth Report of Sessions 2006-07 ; citations p. 2 (item 3) et p. 28 (item 50).
* 37 House of Commons - Foreign Affairs Committee - Global Security : Israël and the Occupied Palestinian Territories - Fifth Report of Sessions 2008-09 ; p. 5 (item 12) policy towards Hamas.
* 38 V. notamment Paul Delmotte : « Le Hamas et la reconnaissance d'Israël - impasse politique en Palestine » Le Monde diplomatique de janvier 2007.
* 39 International Herald Tribune - 21 mai 2009 : « Fatah struggle with a new guard's call for change ».
* 40 Voir la tribune « Ahmadinejad et les conservateurs : les raisons de la colère » par Hossein Bastani ancien secrétaire général du syndicat des journalistes iraniens exilé en France. Rédacteur en chef du site d'information Roozonline.com - Voir également le dossier spécial sur l'Iran de la revue « Moyen-Orient » numéro un - août-septembre 2009.
* 41 Les développements ci-dessous doivent beaucoup à M. Thierry Coville - Iran la Révolution invisible - Paris Ed. La Découverte - avril 2007 et à M. Bernard Hourcade, ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran, tous deux auditionnés par la mission.
* 42 Op. citée p. 197
* 43 Littéralement : « le Gouvernement du jurisconsulte » - ensemble de principes qui fondent le fait que le guide suprême soit un religieux.
* 44 Voir la lettre officielle adressée par l'ambassadeur d'Iran en France au Président du Sénat le 26 mai 2009 -en annexe 9-.
* 45 Rapport du Directeur général de l'AIEA au Conseil des gouverneurs 28 août 2009.
* 46 Selon Bruno Tertrais cité in Norman Podohoretz ; « the case for bombing Iran », Commentary, juin 2007. Il convient de noter que la véracité de cette citation, produite originellement par l'expert Amir Taheri dans son ouvrage Nest of Spies est discutée («Is Iran suicidal or deterrable ?» Economist.com, 14 novembre 2007).
* 47 Cité in Amir Taheri : « Recipe for disaster » - The National Review, 14 novembre 2003
* 48 Study on a Possible Israeli Strike on Iran's Nuclear Development Facilities - Abdullah Toukan, Senior Associate and Anthony H. Cordesman 14 mars 2009
* 49 Il s'agit en l'occurrence des bombes américaines dites perce-bunker ( bunker blasting bombs ) de type GBU 28.
* 50 Voir Rapport de Bruno Tertrais sur « les conséquences stratégiques de l'éventuel accès de l'Iran à l'arme nucléaire » Paris, le 23 octobre 2003 Fondation pour la recherche stratégique.
* 51 Voir notamment Georges Malbrunot, « Le Yémen, nouvelle base arrière d'Al-Qaïda » -le Figaro.fr du 01/06/2009
* 52 Voir au sein d'une littérature abondante : Gilles Kepel, « Jihad, expansion et déclin de l'islamisme» Gallimard 2000, Olivier Roy, « l'Islam mondialisé » Le Seuil 2002, Jean-Pierre Filiu, « Les frontières du Jihad », Fayard 2006 ; Ian Hamel « L'énigme Oussama Ben Laden » Payot 2008, François Heisbourg « Après Al-Qaïda » Stock 2009, Michel Guérin et Jean-Luc Marret, « Histoires de Djihad » Éditions des équateurs 2009.
* 53 Jean-Pierre Filiu, op. citée, p. 132
* 54 Olivier Roy : « Le Croissant et le Chaos » p 169.
* 55 Olivier Roy, op. citée p. 10
* 56 Discours du Président Georges W. Bush le 4 février 2004
* 57 Pascal Ménoret : L'énigme saoudienne Paris -Gallimard 2003
* 58 Pascal Ménoret : op cit.
* 59 Cf. La Ceinture, roman d'Ahmed Abodehman - Paris, Gallimard 2000.
* 60 Pourcentage cité par Amnesty international dans son rapport de 2009.
* 61 Chiffres cités par Mona El Mounajeed, sociologue saoudienne
* 62 Roland Dumas, Le Monde, 12 mars 1991.
* 63 On considère généralement la guerre entre l'Irak et l'Iran comme étant la « première » guerre du Golfe.
* 64 Voir en ce sens Jean-Pierre Chevènement : « Le vert et le noir » - Paris Grasset 1995
* 65 Jules Michelet, Histoire de France, le XVI ème siècle, tome II . Cité par Paul Balta in La politique arabe et musulmane de la France, Confluences Méditerranée, n° 22, été 1997.
* 66 Voir le rapport sur le Traité de Lisbonne de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, n° 188 du 30 janvier 2008 - Jean François-Poncet.
* 67Il y a actuellement quatre zones exemptes d'armes nucléaires instituées par quatre traités régionaux : le (traité de Tlatelolco signé en 1967 pour l'Amérique latine et Caraïbes : le traité de Rarotonga signé en 1985 pour le Pacifique Sud : le traité de Bangkok signé en 1995 pour l'Asie du Sud-est et le traité de Pelindaba signé en 1996 pour l'Afrique.