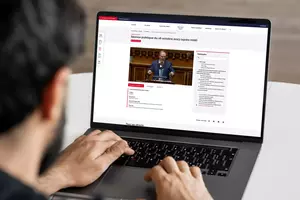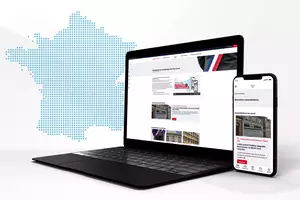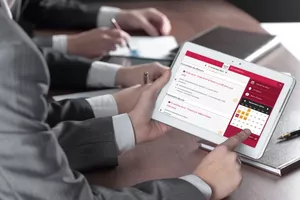B. CERTAINS OBSTACLES DEVRONT ÊTRE LEVÉS POUR GARANTIR L'EFFICACITÉ DU BBNJ
1. Les obstacles pour son entrée en vigueur
L'article 68 prévoit que le BBNJ entrera en vigueur 120 jours après la date de dépôt du 60e instrument de ratification. Olivier Poivre d'Arvor a précisé que fin mars 2024, seuls les Palaos et le Chili ont ratifié l'accord.
La procédure est particulière pour les États membres de l'Union européenne, dans la mesure où l'accord relève à la fois des compétences de l'Union et de celles des États membres. Olivier Poivre d'Arvor a expliqué qu'il est nécessaire qu'aussi bien l'Union que les États membres ratifient l'accord, par la procédure qui leur est propre. S'agissant du dépôt des instruments de ratification de chacun, la pratique dite « du commun accord » implique un effort de la part des États membres et de l'Union pour un dépôt simultané des instruments de ratification auprès des Nations Unies. L'objectif retenu par l'Union et les 27 États membres est que ce dépôt intervienne avant la Conférence des Nations Unies sur les océans de juin 2025. Si la France envisage la ratification de l'accord avant l'été 2024, les autres États membres n'en ont pas tous fait une priorité. En ce qui concerne sa ratification par le Parlement européen, il paraît difficile qu'elle intervienne avant les élections de juin 2024 en raison de la brièveté des délais. Il n'est pas certain non plus qu'elle fasse partie des priorités de l'assemblée nouvellement élue.
Par conséquent, sans une volonté politique forte de la part de la communauté internationale, le BBNJ pourrait n'entrer en vigueur que dans plusieurs années.
En outre, seuls 87 États l'ont signé jusqu'à présent, ce qui reste largement insuffisant pour qu'il ait une réelle portée au sein de la communauté internationale.
2. Les obstacles pour sa mise en oeuvre rapide : la lourdeur et le coût des procédures
Denis Bailly a insisté sur le fait que la mise en place des outils prévus par le BBNJ pour garantir la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine s'accompagne de procédures lourdes et coûteuses.
Les dossiers à constituer pour proposer la création d'aires marines protégées doivent comporter un grand nombre d'éléments tels que la description géographique de l'aire proposée, les critères pour la détermination des aires à protéger, les informations sur les activités humaines menées dans l'aire, la description de l'état du milieu marin et de la diversité biologique, la description des objectifs de conservation, le plan de gestion comprenant les mesures qu'il est proposé d'adopter et décrivant les activités de suivi, de recherche et d'examen à mener pour atteindre les objectifs retenus, les informations sur les consultations menées, les contributions scientifiques pertinentes. L'organe scientifique et technique peut demander d'autres éléments de contenu. Les propositions d'aires marines protégées constituent donc des dossiers particulièrement lourds à monter, qui nécessitent des compétences scientifiques et techniques poussées et un soutien financier non négligeable.
Il en va de même pour l'évaluation de l'impact environnemental des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cette évaluation comporte des obligations de consultation, de prise en compte des observations du comité scientifique et technique, de publication de l'étude d'impact et de rédaction périodique de rapports sur les impacts de l'activité autorisée.
Denis Duclos a estimé que les activités de recherche relatives aux ressources génétiques marines s'accompagnent également d'une procédure de notification relativement contraignante (cf. supra) qui exige des moyens humains et financiers importants. Il faudra donc s'assurer que cette charge administrative qui pèsera sur les chercheurs restera raisonnable. Un autre point de vigilance concerne le centre d'échange qui doit centraliser les déclarations préalables aux campagnes de collecte. S'il devenait un lieu où l'opportunité de la campagne était évaluée et, éventuellement, débattue, le principe même de la liberté de la recherche serait remis en cause.
Enfin, le BBNJ crée pas moins de quatre comités, sans compter l'organe scientifique et technique : le comité sur l'accès et le partage des avantages, le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, le comité des finances et le comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions.
Ces instances devront disposer de ressources humaines, techniques et financières pour accomplir leurs missions. En outre, leur mise en place risque de prendre du temps puisque les États devront s'entendre sur la composition desdits comités. Or, la nomination de leurs membres revêt un caractère éminemment sensible compte tenu des missions qu'ils auront à exercer.
3. Les obstacles spécifiques auxquels risquent de se heurter certains outils prévus par le BBNJ
(a) Les obstacles à la création d'aires marines protégées efficaces
Rodolphe Devillers a expliqué que les aires marines protégées doivent remplir un certain nombre de conditions pour garantir réellement la conservation de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Il a insisté sur le fait que l'efficacité des aires marines protégées dépend de leur niveau de protection. Il a présenté plusieurs études scientifiques montrant que les aires marines protégées qui interdisent presque toute activité humaine sont les plus efficaces. À l'inverse, les aires marines protégées bénéficiant seulement d'une protection minimale ou légère (notamment en autorisant la pêche industrielle) n'ont aucun impact en pratique.
Or, selon lui, en matière d'aires marines protégées, les États ont tendance à privilégier la quantité (afin de respecter l'objectif de 30 % des mers et océans protégés) au détriment de la qualité. Il a estimé que la question du niveau de protection des aires marines protégées en haute mer se posera de manière encore plus cruciale compte tenu du poids de la pêche industrielle dans ces zones et de la fragmentation de la gouvernance en matière de conservation de la biodiversité entre les organisations sectorielles et régionales.
Klaudija Cremers a expliqué que le suivi et la surveillance des futures aires marines protégées sont indispensables pour garantir la mise en oeuvre effective des mesures adoptées. Or, ce contrôle dépend actuellement de la capacité et de la volonté politique des États de contrôler les activités des navires qu'ils ont immatriculés.
Denis Bailly a insisté sur la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des connaissances scientifiques ex ante et sur l'observation in situ pour la mise en place d'aires marines protégées. Par exemple, l'analyse de la variation de la biomasse de zooplancton dans le dôme thermal a des implications sur la détermination de l'aire protégée. De même, la collecte de données sur les activités humaines et leur intensité (pêche, trafic maritime) permet d'objectiver la nature des pressions humaines et d'adopter les mesures les plus appropriées. Selon Klaudija Cremers, cette collecte des données peut être facilitée par l'accès aux données satellitaires, mais également par la mise en place de collaborations avec des instances mondiales et régionales qui disposent déjà de nombreuses données (telles que l'Organisation maritime internationale ou encore les organisations régionales de gestion de pêche).
Enfin, la coopération avec les États côtiers dont les ZEE seront mitoyennes des aires marines protégées envisagées devra également être privilégiée dans la mesure où la biodiversité comme la pollution ne connaît pas de frontière.
(b) Les obstacles à l'élaboration d'études d'impact environnemental
Sophie Arnaud-Haond a rappelé que la communauté scientifique dispose actuellement d'une connaissance très parcellaire de la diversité marine en milieu profond. Même sur la zone de Clarion Clipperton20(*) qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études à ce jour, les états de référence permettant d'analyser et de quantifier l'impact de certaines activités sur les écosystèmes restent très incomplets. De même, le niveau actuel des connaissances scientifiques sur les écosystèmes de cette zone ne permet pas de prendre des décisions validées scientifiquement sur la pertinence et les conséquences potentielles de l'exploitation minière.
Aussi, en dépit de la procédure très formalisée mise en place par le BBNJ pour la réalisation d'études d'impact environnemental, Sophie Arnaud-Haond comme Pierre-Marie Sarradin ont souligné les limites desdites études pour garantir l'utilisation durable des ressources tant que les lacunes scientifiques liées à l'exploitation minière des grands fonds ne seront pas levées.
* 20 Zone de fracture géologique sous-marine de l'océan Pacifique.