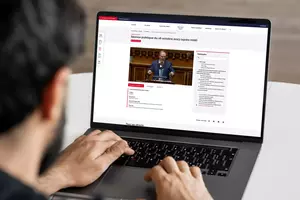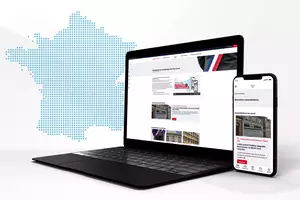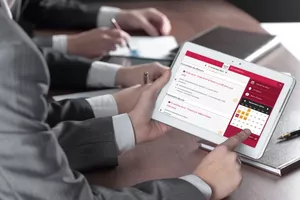OUVERTURE
Gérard
Larcher,
président du Sénat
Madame la présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, chère Micheline Jacques,
Messieurs les vice-présidents du Sénat, cher Mathieu Darnaud, cher Dominique Théophile,
Chers collègues députés et sénateurs,
Mesdames et messieurs les présidents d'associations de maires,
Mes chers collègues maires, maires adjoints, élus municipaux,
Chers amis,
Je suis heureux de vous souhaiter, au nom de l'ensemble des sénateurs, la bienvenue au Palais du Luxembourg pour notre désormais traditionnelle rencontre organisée par la délégation sénatoriale aux outre-mer dans le cadre du Congrès des maires de France.
Cette prise de parole me permet tout d'abord de vous renouveler, chère Micheline Jacques, mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de notre délégation aux outre-mer, et de vous adresser mes voeux les plus sincères pour le succès de votre mission. Elle me permet également de souligner l'importance de l'action de votre prédécesseur, notre ancien collègue Stéphane Artano à la présidence de cette délégation. La qualité, le sérieux du travail qu'il a accompli en fédérant les énergies de l'ensemble des membres de la délégation ont largement contribué à donner une visibilité à vos travaux. Je pense en particulier au rapport relatif à l'avenir institutionnel outre-mer.
Cette prise de parole me permet d'avoir une pensée émue pour notre ancienne collègue Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe, qui nous a quittés voilà quelques semaines. Nous conserverons d'elle le souvenir d'une parlementaire assidue, active tant à la délégation aux outre-mer que dans l'hémicycle, ou encore au Bureau du Sénat où elle siégeait à mes côtés.
Cet après-midi d'échanges constitue un moment privilégié pour mes collègues et moi-même qui partageons ce même attachement à la proximité, au territoire et en particulier aux 212 communes ultramarines disséminées à travers le monde qui contribuent au rayonnement de notre pays. Mais peut-il en être autrement alors que le Sénat incarne votre voix, la voix des élus locaux qui assurent la cohésion de notre République ?
Votre présence nombreuse est source de satisfaction. Je voudrais saluer les présidents d'associations de maires qui jouent tout au long de l'année un rôle important dans leur territoire à travers les conseils qu'ils apportent aux communes, les temps d'échange qu'ils organisent et leur fonction indispensable de relais auprès des parlementaires. En outre, grâce à l'heureuse initiative du président David Lisnard, ils peuvent désormais, au sein de la délégation aux outre-mer de l'Association des maires de France, oeuvrer en faveur de leur territoire auprès des décideurs nationaux.
Les thèmes retenus pour cet après-midi d'échanges sont l'avenir de la commune et du maire, et l'enjeu de l'eau. Ces sujets sont particulièrement d'actualité tant dans l'Hexagone que dans vos territoires. Ils ont fait l'objet d'un travail approfondi du Sénat et de préconisations concrètes issues des rapports de deux missions d'information. Leurs auteurs, Maryse Carrère et Mathieu Darnaud pour le premier, ainsi que Rémy Pointereau et Hervé Gillé pour le second, ne manqueront pas de vous faire part de leurs réflexions, analyses et propositions.
S'interroger sur l'avenir de la commune et du maire apparaît comme une exigence, je le dis devant la présidente de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, Françoise Gatel, particulièrement engagée elle aussi sur ce sujet. Depuis plus de 15 ans, nous vivons une recentralisation et par là même un affaiblissement de la liberté d'action des élus. Durant cette période, nos communes ont perdu une grande part de leur autonomie financière, depuis la suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d'habitation ou encore de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour certaines d'entre elles, en particulier les communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, la situation est encore plus complexe pour ce qui est de la liberté d'action, puisqu'elles dépendent de par leur statut du financement de l'État et du transfert du budget du territoire. Je souhaite que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, actuellement en discussion, conforte les communes calédoniennes, notamment en matière budgétaire, car elles représentent un échelon de proximité indispensable au développement harmonieux de la société calédonienne et à la consolidation du vivre ensemble, sujet essentiel du débat. En Polynésie française, les délégations de compétence du pays aux communes, et le rôle de ces dernières mériteraient d'être revus afin de les renforcer. Je n'oublie pas le souhait des élus des îles Marquises de profiter d'une prochaine révision constitutionnelle pour permettre la création d'une communauté d'archipel.
Aux pertes d'autonomie évoquées s'ajoutent de nouvelles craintes suscitées notamment par l'annonce d'une prochaine refonte en profondeur de l'octroi de mer, important pour les collectivités qui le perçoivent. Une telle annonce doit nous inciter à la plus grande vigilance lorsque l'on sait que cet impôt rapporte plus de 1,5 milliard d'euros aux collectivités concernées. J'ai donc demandé au rapporteur général du budget de constituer un groupe de travail avec nos collègues de la commission des Finances, très au fait de ces questions, en lien avec notre délégation aux outre-mer.
Nous avons pleinement conscience de l'importance des conséquences éventuelles de cette réforme pour vos territoires car l'octroi de mer, en plus d'être une ressource majeure, constitue un outil important pour l'accompagnement de la production locale. Le Sénat a toujours été présent sur ce dossier comme le montrent les travaux de la délégation en 2020, notamment en faveur de son maintien. Je pense qu'il sera tout autant attentif aujourd'hui et demain.
Outre ces difficultés et ces craintes, l'État et le Parlement doivent tenir compte des situations financières assez dégradées de beaucoup de vos collectivités qui ne permettent ni l'investissement local ni le plein emploi des crédits budgétaires qui vous sont alloués. Le dispositif des contrats de redressement outre-mer (COROM) des communes dont nous avons toujours soutenu le principe au Sénat constitue un bon outil pour créer dans les collectivités en difficulté une dynamique qui conduise à la vertu. Il convient donc d'élargir ce dispositif et d'augmenter les crédits qui y sont alloués, même si ces derniers ont progressé, afin que plus de communes puissent en bénéficier. Il est regrettable que l'enveloppe ne permette pas d'accompagner davantage de communes dans cette trajectoire progressive de retour à l'équilibre. J'ai constaté par exemple qu'à Mayotte, une seule commune, Sada, en est bénéficiaire aujourd'hui. Cette situation ne peut que m'interroger, d'autant que j'ai le souvenir de ma rencontre avec les maires de Mayotte et de leurs difficultés.
Le bloc communal dispose de moins en moins de marges de manoeuvre dans un contexte de plus en plus tendu, lié à une augmentation de charges sans précédent. Il est donc indispensable d'instaurer une véritable autonomie financière et fiscale des collectivités, avec un panier de recettes clair, en cohérence avec les compétences et les charges des collectivités. C'est d'ailleurs l'une des propositions du groupe de travail sur la décentralisation mis en place l'an dernier avec les représentants de tous les groupes politiques du Sénat pour redonner aux élus locaux le pouvoir d'agir. Je le dis devant les deux rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, sous l'autorité du président de la commission des Lois.
Aux problèmes financiers que je viens d'évoquer s'ajoutent des faiblesses en termes de formation du personnel, tant en administration de gestion qu'en management ou en conduite de projet. Ce sujet a été fortement porté par les élus lors de ma dernière visite en Guadeloupe et en Martinique. Françoise Gatel le montre dans un rapport sur l'intercommunalité en Polynésie française, mais cette problématique se retrouve dans les communes des trois bassins géographiques. Il convient dès lors de développer les compétences au service de l'action locale, mais aussi d'améliorer les dispositifs de soutien en matière d'ingénierie, notamment d'ingénierie de l'État.
Je trouve intéressante la proposition de nos collègues de la commission des Lois qui, après s'être rendus dans quatre des territoires de l'arc antillais (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), ont souhaité que l'assistance technique de l'État, notamment par l'entremise de l'Agence française de développement, puisse être utilisée pour former dans les collectivités bénéficiaires les personnels à l'expertise technique nécessaire au plein exercice de leur mission. Judicieuse également la proposition de généraliser au sein des collectivités des plateformes d'appui en ingénierie sur le modèle de celle mise en place en Guyane avec les moyens humains et financiers nécessaires.
Face à ces constats, nous voulons un État local accompagnateur et facilitateur, et non pas simplement censeur. Pour cela, il faut renforcer les services de l'État dans les préfectures, leur redonner les moyens financiers et humains justifiés par la situation de vos territoires et finalement rétablir ce binôme maire-préfet ou maire-haut-commissaire.
Aux difficultés liées à la perte d'autonomie financière et à la faiblesse des compétences s'ajoute une autre contrainte que nous connaissons tous, l'inflation normative. Face à celle-ci, les élus se sentent de plus en plus paralysés dans leurs capacités d'action, d'autant qu'elle a un impact financier important sur nos collectivités. Le président Alain Lambert estime le coût des nouvelles normes en 2022 à 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble de nos collectivités territoriales. De plus, ces normes nationales ne sont pas toujours adaptées aux contraintes particulières de vos territoires. Je pense spécialement aux normes en matière de construction et de logement. Ce constat d'une adaptation insuffisante des politiques publiques aux spécificités de chaque territoire ultramarin me paraît faire consensus. Du consensus il faut désormais passer à l'action. L'inadaptation concerne aussi bien la conduite des politiques publiques que le cadre normatif. Stéphane Artano l'avait rappelé avec Micheline Jacques dans leur rapport sur l'avenir institutionnel des outre-mer. Le besoin de différenciation renforcée est affirmé par tous les élus. Exemple parmi tant d'autres, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) requiert un avis conforme en outre-mer, mais seulement un avis simple dans l'Hexagone. Cette question, que nous avions posée l'an dernier, mérite de l'être encore cette année.
À la suite d'échanges avec les exécutifs locaux et des recommandations formulées au cours des différents travaux de la délégation aux outre-mer, je souhaite que soit déposée et inscrite à l'ordre du jour du Sénat, une fois par an, une proposition de loi d'adaptation du droit des outre-mer. Cette proposition fait partie du programme pour le triennat qui vient de s'ouvrir. Ce rendez-vous annuel, en plus de renforcer les liens entre le Sénat et les collectivités ultramarines, permettrait de mieux associer les élus de ces territoires à l'élaboration de la loi et obligerait les administrations des différents ministères à être plus réactives en raison de son institutionnalisation. Cette manière de fabriquer la loi aurait en outre le mérite de limiter le recours aux ordonnances dont nous pensons qu'il est abusif aujourd'hui.
Je souhaite que le Sénat joue aussi un rôle central dans le processus de contrôle du Gouvernement sur la mise en place des décisions du Comité interministériel des outre-mer (CIOM) en vue duquel chaque territoire avait pu transmettre en amont les difficultés - qu'elles soient normatives, budgétaires ou organisationnelles - qu'il rencontre.
Dans le même esprit, en réponse à l'appel de Fort-de-France, la délégation aux outre-mer a préconisé trois pistes de réflexion. La première piste résiderait dans le statu quo constitutionnel, mais celui-ci ne saurait être synonyme d'immobilisme, puisqu'il serait accompagné d'une révolution des méthodes. La deuxième piste consisterait en une modification des articles 73 et 74 de la Constitution afin de mettre à la disposition des outre-mer de nouveaux outils, en particulier pour les collectivités demandeuses. Enfin, la troisième piste viserait à créer un cadre constitutionnel entièrement rénové, assimilable à une boîte à outils au sein de laquelle chaque outre-mer pourrait choisir ce qui lui convient le mieux dans le cadre d'une loi organique sur-mesure.
Nous traiterons ces scénarios lors d'une réunion spécifique du groupe de travail « Institutions » le 13 décembre prochain. En février, le Sénat rendra son rapport sur les questions institutionnelles. Ce sujet, abordé par le président de la République dans sa campagne électorale n'a pas donné lieu à des réunions inter-groupes politiques, mais nous y travaillons au Sénat depuis maintenant un an.
Dans cette période de défis multiples, votre rôle d'élu est fondamental, car vous incarnez le pouvoir d'agir. Le Sénat a voulu repositionner les maires au coeur de nos institutions en leur consacrant par exemple un véritable statut de l'élu permettant de mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle et mandat, et surtout en vous protégeant davantage. Je pense à Blaise Mornal, maire de Petit-Canal en Guadeloupe, victime d'une agression voilà peu. La proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires a été votée le mois dernier à l'unanimité de notre assemblée, signe que nous souhaitons vraiment protéger les élus.
Le deuxième temps fort de cet après-midi concerne l'enjeu de l'eau. Dans plusieurs territoires ultramarins, les coupures d'eau, les infrastructures défectueuses, les sous-investissements, les problèmes de gouvernance, les inégalités d'accès à l'eau, la dépendance aux pluies génèrent à la fois la montée d'un sentiment d'injustice au sein de la population et de forts mécontentements face à des situations qui durent malgré les moyens significatifs mis en oeuvre. Ces situations sont d'autant plus difficiles à tolérer que les prix de l'eau varient du simple au triple entre La Réunion où elle est la moins chère et la Guadeloupe où elle est la plus chère, selon les conclusions du rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Toujours selon ce rapport, l'eau peut également représenter jusqu'à un tiers du budget pour un ménage modeste à Mayotte.
Ces difficultés concernant la distribution de l'eau ne doivent pas obérer un autre objectif prioritaire qui doit nous mobiliser, la mise en conformité des installations d'assainissement qui, par leur vétusté, mettent en danger la santé humaine et l'environnement. La solidarité nationale doit jouer. Je soutiens la proposition de notre mission d'information qui préconise, pour davantage de justice territoriale, un soutien financier spécifique aux offices de l'eau ultramarins et la relance de la réflexion sur la solidarité interbassin.
Comme vous pourrez le constater au cours des échanges à venir, le Sénat se veut à votre écoute. Il a particulièrement à coeur de représenter vos collectivités dans le respect de vos diversités et de votre histoire. Je vous souhaite de fructueux débats. Je suis convaincu que cette journée doit pouvoir répondre à vos attentes. À l'issue de vos travaux, je vous propose de nous retrouver pour un moment de convivialité. Ici, les communes des outre-mer ne sont pas 212 communes parmi 35 000. Le modèle communal peut être un modèle de vivre ensemble, de proximité, de relations avec les citoyens. C'est ce dont nous avons le plus besoin dans notre pays aujourd'hui.