Rapport d'information n° 91 (2008-2009) de M. Joël BOURDIN , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 12 novembre 2008
Synthèse du rapport (1,2 Moctet)
Disponible au format Acrobat (1,4 Moctet)
-
INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE : REFONDER LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
-
CHAPITRE I : LE MOYEN TERME AU DÉFI DE
LA CRISE ÉCONOMIQUE
-
CHAPITRE II : LA QUÊTE D'UN CHEMIN DE
CROISSANCE SOUTENABLE
-
DEUXIÈME PARTIE : LES INTERVENTIONS
PUBLIQUES AU DÉFI DE LA CROISSANCE
-
CHAPITRE I : L'AMÉLIORATION
STRUCTURELLE DU SOLDE PUBLIC AU SERVICE DU DÉSENDETTEMENT PUBLIC :
QUELLE SOUTENABILITÉ ?
-
I. LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE :
QUELLE COHÉRENCE DANS LE COURT TERME ?
-
II. UN OBJECTIF SUSPENDU À UNE REPRISE
ÉCONOMIQUE HYPOTHÉTIQUE
-
III. VERS UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA
DETTE PUBLIQUE ?
-
I. LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE :
QUELLE COHÉRENCE DANS LE COURT TERME ?
-
CHAPITRE II : LES COMPOSANTES DE
L'AJUSTEMENT STRUCTUREL DES COMPTES PUBLICS, UNE STRATÉGIE À
AFFINER
-
I. UNE STRATÉGIE FISCALE À
PRÉCISER
-
II. PESER LE VOLONTARISME DU PROGRAMME DE BAISSE
STRUCTURELLE DES DÉPENSES PUBLIQUES
-
A. UNE NORME DE DÉPENSES PUBLIQUES
TRÈS EXIGEANTE, EN PARTICULIER POUR L'ÉTAT
-
1. Vers un fort repli structurel des coûts
de production des services publics et une légère réduction
du taux de redistribution publique associé aux dépenses
sociales
-
2. La programmation d'un décrochage des
salaires publics
-
3. Des économies nettes devront s'appliquer
aux autres dépenses
-
4. Vers un léger repli du taux de la
redistribution sociale publique qui exigera une maîtrise des
dépenses
-
1. Vers un fort repli structurel des coûts
de production des services publics et une légère réduction
du taux de redistribution publique associé aux dépenses
sociales
-
B. UN OBJECTIF QUI SUPPOSE UNE RUPTURE PAR RAPPORT
AUX TENDANCES OBSERVÉES ET AUX ANTICIPATIONS DE DÉPENSES
-
A. UNE NORME DE DÉPENSES PUBLIQUES
TRÈS EXIGEANTE, EN PARTICULIER POUR L'ÉTAT
-
III. UNE PROGRAMMATION À APPRÉCIER
AU REGARD DE QUELQUES PROBLÉMATIQUES CONCERNANT L'INTERVEN-TION
PUBLIQUE
-
I. UNE STRATÉGIE FISCALE À
PRÉCISER
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
ANNEXE : ÉTUDE DE L'OFCE
N° 91
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 2008 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la Planification (1) sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme ( 2009 2013 ),
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
|
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; MM. Bernard Angels, Pierre André, Joseph Kergueris, Mme Evelyne Didier, vice-présidents ; M. Yvon Collin, Mme Sylvie Goy-Chavent, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Gérard Bailly, Mme Bernadette Bourzai, MM. Jean-Luc Fichet, Philippe Leroy, Jean-Jacques Lozach, Jean-François Mayet, Philippe Paul |
INTRODUCTION
Dans les circonstances actuelles, tout exercice de projection des finances publiques a un aspect irréel. L'effondrement de nombreux piliers du secteur bancaire et financier, la dévalorisation des actifs monétaires, immobiliers et financiers, la remise en cause probable de l'équilibre des systèmes de protection sociale par capitalisation, les nationalisations en cours, les projets de cantonnement avec appel aux contribuables des créances compromises des acteurs de la finance..., tout cela engagera les finances publiques en Europe et dans le Monde dans des conditions ultimes qu'il est impossible de déterminer. Nulle projection de la dette publique, nulle projection des dépenses publiques, nulle projection des prélèvements obligatoires ne peuvent être soutenues par des certitudes absolues sur l'impact de la crise financière en cours, et de la crise de l'économie réelle qui s'en suivra.
Et, il est évident que les projections réalisées en ce domaine, sans tenir compte des perspectives ouvertes par l'engagement des États pour résoudre la crise, n'ont qu'une faible portée d'autant qu'elles sont entourées de doutes sur l'ampleur de la dépression que cette crise exerce sur l'économie réelle.
Ces incertitudes majeures, et historiques, traduisent une crise dont il serait dangereux de croire qu'elle n'est qu'accidentelle. Il faut élucider pourquoi le monde développé fut, dans les dernières décennies, tant tributaire de l'endettement pour « boucler » une croissance qui semblait ne pas buter sur les capacités d'offre des économies concernées. En tout cas, contrairement à la très classique « loi de Say », « l'offre ne créa pas sa propre demande au cours de cette période ».
Quelques-unes de ces incertitudes sont aussi particulièrement regrettables. Ce sont celles qui montrent que les États, pourtant prêts à exercer leur mission de régulateurs de la crise, en sollicitant les contribuables, n'ont pas réuni toutes les conditions permettant d'identifier les pertes résultant d'un accident - car accident il y eut malgré tout - qui, pour avoir dès l'origine paru représenter un défi important, ne semblait pas, alors, impossible à circonscrire. Peut-être faut-il voir dans cette inertie le prolongement des croyances qui ont donné à l'économie financière son cadre et son influence. A tout le moins, les inconnues quant aux prolongements de la crise en cours témoignent que les pilotes de la crise n'étant pas en mesure (ou n'ayant pas souhaité) fournir les informations et prendre les décisions qui s'imposent, ont aggravé les événements en cours.
Plus fondamentalement, c'est qu'un certain aveuglement quant à la soutenabilité du sentier de croissance se soit produit qu'il faut déplorer.
Dans ces conditions, demandera-t-on, pourquoi présenter au Sénat, malgré tout, une réflexion sur les perspectives macroéconomiques et des finances publiques à moyen terme ?
La réponse est simple : si la crise de l'instant brouille les perspectives, elle conduira, du moins faut-il le souhaiter, à réestimer un certain nombre de paradigmes et elle invite ainsi à deux exercices complémentaires :
- l'élucidation autant que possible de ses impacts ;
- et la définition des politiques qu'il faudrait conduire pour la surmonter, voir pour en éviter les répétitions.
Ajoutons que les difficultés du moment ne signent pas la disparition du futur et que votre délégation a le devoir - sans doute encore plus que jamais - de remplir sa mission d'évaluation et de prospective au service du Sénat.
C'est d'ailleurs tout le rôle d'une délégation parlementaire comme la vôtre de contribuer à résorber la « crise de l'avenir », c'est-à-dire, face à la tyrannie du présent, synonyme d'anomie face au futur, de dessiner les termes d'un projet.
Sachons gré à notre Assemblée d'avoir dès 1982, c'est-à-dire à peu près au moment où la considération de l'avenir sombrait dans l'obsession du court terme, senti que la nécessité de repères structurels allait devenir de plus en plus impérieuse. Au moment où le Sénat se dote d'un nouveau Président, saluons la clairvoyance de ses prédécesseurs, qui ont constamment, malgré les modes, soutenu votre délégation et souhaitons qu'à l'avenir celle-ci, à la place modeste mais solide qui est la sienne, poursuivra et amplifiera son travail dans la complète liberté d'esprit qui inspire ses travaux et le pluralisme des points de vue qu'elle cultive.
Que dit ce rapport du moyen terme ?
La crise en cours augmente les incertitudes habituelles aux exercices de prévision et de prospective économique. Mais, au-delà de cet effet, elle conduit à réexaminer la viabilité du sentier de croissance économique emprunté depuis des années , ainsi que les principes sur lesquels il reposait.
Quant aux incertitudes, elles concernent l'ampleur et la durée du choc que représente la crise pour l'économie réelle. De l'idée qu'on peut s'en faire dépendent à la fois les perspectives économiques de court et de moyen terme et les recommandations de politique économique à formuler.
Dans ses rapports annuels consacrés aux perspectives à moyen terme de l'économie et des finances publiques, votre délégation vous propose systématiquement une évaluation des conditions économiques nécessaires à la réussite des stratégies présentées par les gouvernements successifs en matière de finances publiques. Il s'agit d'évaluer les perspectives proposées dont on sait que depuis l'entrée dans le projet monétaire européen elles sont liées aux « disciplines budgétaires » censées assurer la pérennité de l'euro.
Moyennant les quelques adaptations du cadre européen, qui sont restées malheureusement de façade, les gouvernements sont astreints à présenter des trajectoires budgétaires, toujours à peu près identiques, dont les incidences économiques et financières ne sont pas suffisamment exposées ou explorées.
L'un des objets du présent rapport, comme chaque année, consiste à élucider les présupposés économiques de la programmation des finances publiques à moyen terme proposée par le gouvernement, désormais dans le cadre d'un projet de loi.
Mais, la crise en cours invite à accentuer l'éclairage porté sur deux interrogations dont elle renforce l'intérêt :
• la première consiste à
questionner un futur alternatif
par rapport au
«
scénario central
» de reprise
très franche de la croissance économique qui fonde la
programmation du Gouvernement : quelle est la cohérence du
scénario, qu'attendre et que faire si la crise devait être plus
ample et durable ?
Aux fins d'explorer ces questions, un « scénario de crise » est présenté, avec des indications sur les moyens de le juguler.
• la seconde porte sur la
pertinence
même des orientations qu'imprime à la politique budgétaire
le cadre doctrinal et juridique européen
.
Sur ce dernier point, votre délégation a continûment insisté dans le passé 1 ( * ) sur les graves lacunes de ce cadre et mis en garde contre ses effets pervers.
Elle a, en particulier, relevé les dangers d'une coordination des politiques économiques, doublement de façade parce que, d'une part, aboutissant à la négation des politiques économiques et, d'autre part, conduisant à la confrontation des économies européennes bien plus qu'à leur coordination. Ces dangers, sur lesquels votre délégation avait attiré l'attention, avaient pour noms : la paralysie des politiques économiques , la fuite dans l'endettement privé et la confrontation insoutenable des différents espaces économiques européens .
A l'heure où ces dangers s'incarnent, il semble à votre délégation plus que jamais nécessaire que l'Europe apporte sa contribution à la refondation de l' ordre économique mondial en montrant l'exemple dans son propre espace.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, votre rapporteur souhaite adresser ses remerciements aux équipes de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), qui ont apporté le concours très précieux de leur expertise aux réflexions exposées dans le présent rapport.
PREMIÈRE PARTIE : REFONDER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
AVANT-PROPOS
Nous vivons une crise de l'endettement, mais, derrière cette crise, c'est l'équilibre de la croissance économique qui est en cause.
Dans les interprétations de la crise en cours, le projecteur est souvent braqué sur le seul monde de la finance. On se désespère d'avoir poussé trop loin la dérégulation (anglicisme étonnant qu'il faudrait remplacer par ce qu'il recouvre, c'est-à-dire la déréglementation et le recul pris par l'Etat par rapport à la gestion privée) et l'on dénonce une crise morale, d'avidité.
Aux correctifs techniques - qu'il faut prendre garde de mesurer finement car le crédit est nécessaire à la croissance économique - et spirituels, il est pourtant nécessaire d'ajouter une réflexion de fond sur les équilibres macroéconomiques internes aux différents pays et internationaux.
Dans les deux chapitres qui suivent, c'est à l'équilibre domestique des sentiers de croissance suivi ces dernières années qu'on consacre les principaux développements.
Votre délégation a abordé dans un récent rapport sur la coordination des politiques économiques en Europe, les problèmes y résultant de la confrontation des « modèles économiques ». La coexistence antagonique de trois modèles - celui de l'endettement privé, celui de l'hyper-concurrence, celui de la préservation d'un modèle social - n'est pas viable.
Hors l'Europe, le jeu est aussi des plus périlleux. Des Etats-Unis en déficit, des émergents en excédents créent une configuration instable. Le Reste du Monde « tire » les émergents, comme le Reste de l'Europe « tire » l'Allemagne, et le Reste du Monde ne tire les émergents qu'au prix d'un endettement croissant auprès de ces pays.
Les situations des pays du Reste du Monde ne sont pas homogènes et les Etats-Unis occupent une place à part. Pôle incomparable d'attraction de l'épargne mondiale, ses ménages, ses entreprises et son Etat financent leurs consommations, leurs investissements, leurs projets en captant les richesses des pays tiers, ce qui, par parenthèse, crée des situations géopolitiques des plus cocasses.
Certains prétendent qu'au fond tout cet équilibre est optimal et que le Monde ne saurait se passer de distribuer ainsi ses richesses. L'attractivité des Etats-Unis ne serait que l'autre face de leur singulier dynamisme économique. A la réserve près qui, convenons-en, n'est pas mineure, de la soutenabilité de l'endettement des Etats-Unis, on pourrait répondre à ce point de vue que s'il décrit possiblement la réalité, rien n'oblige l'Europe à s'en satisfaire.
Plus que jamais celle-ci, pour reprendre le titre du précédent rapport consacré par votre délégation au moyen terme, se doit de cibler la croissance plutôt que ses dettes publiques.
CHAPITRE I : LE MOYEN TERME AU DÉFI DE LA CRISE ÉCONOMIQUE
Les prévisions à court terme sont, plus que jamais, marquées par une forte incertitude due à l'ampleur des effets sur l'économie réelle de la crise financière en cours depuis l'été 2007. En conséquence, les prévisions des principaux instituts de conjoncture, ainsi que les estimations présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009, sont déjà dépassées.
A court terme, l'impact réel de la crise financière dépendra, en premier lieu, de ses effets sur le crédit et de l'ampleur des effets de richesse négatifs subis par les ménages et par les entreprises. Il dépendra également de la crédibilité de l'action des banques centrales et de la capacité des Etats à rétablir la confiance dans le système financier et à limiter l'ampleur du « credit crunch », ce qui suppose de restaurer rapidement des conditions normales de financement de l'économie mais aussi de contrecarrer les enchaînements dépressifs à l'oeuvre dans l'économie réelle.
Pour la fin 2008 et pour 2009, les conjoncturistes tablent, non sans nuances, sur un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis et en Europe, tandis que la croissance des plus grands pays émergents résisterait mieux. Pour la France, ils s'attendaient encore, en septembre 2008, à une croissance de 1 % en 2008 et de 0,8 % en 2009.
Toutefois, les prévisions infra-annuelles de l'INSEE 2 ( * ) tablaient sur une récession au cours des trois derniers trimestres de l'année 2008 , si bien que l'acquis de croissance pourrait être négatif en fin d'année.
Dans ce contexte, la prévision de croissance du gouvernement associée au projet de loi de finances pour 2009 (1 % à 1,5 %), déjà plus optimiste que la moyenne, se révélait plus volontariste qu'elle ne pouvait le paraître. Le gouvernement a, au moment du bouclage du présent rapport (le 6 novembre 2008), annoncé une révision de cette prévision. Il juge désormais plus vraisemblable que la croissance française soit située entre 0,2 % et 0,5 % en 2009.
Ces nouvelles estimations du gouvernement s'inscrivent dans un contexte où les prévisions les plus récentes ont accru le pessimisme :
- le Fonds monétaire international 3 ( * ) prévoit une croissance à - 0,5 % en France en 2009, après 0,8 % en 2008 ;
- la Commission européenne 4 ( * ) anticipe une croissance nulle en France en 2009, après 0,9 % en 2008.
Elles sont assez proches du « scénario de crise » que votre délégation a demandé à l'OFCE de simuler pour mesurer les effets d'un dynamisme économique moins favorable que celui escompté par le gouvernement à court et moyen termes.
I. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL : RALENTISSEMENT OU RÉCESSION ?
L'environnement international s'est considérablement assombri au cours des six derniers mois, du fait de la crise en cours.
D'ailleurs, tous les enchaînements négatifs de cette crise ne sont pas encore pris en compte dans les prévisions disponibles .
A. RETOUR SUR LA CRISE FINANCIÈRE
La crise s'est manifestée par de multiples défaillances d'institutions financières, avant de toucher les marchés boursiers. Elle a déclenché la mise en oeuvre tardive de mesures d'urgence.
1. Le déroulement de la crise
L'incertitude sur l'ampleur des pertes liées à la crise du crédit hypothécaire américain a créé un climat de défiance qui s'est traduit par des difficultés de financement pour les banques. Celles-ci ont eu raison de plusieurs établissements : chute de la banque britannique Northern Rock, puis de Bear Sterns, faillite de Lehman Brothers.
|
Institutions financières : une déroute sans précédent depuis 1929 - Septembre 2007 : faillite puis nationalisation (en février 2008) de la banque britannique Northern Rock ; - Mars 2008 : sauvetage par la Fed, puis rachat par JP. Morgan Chase, de la banque américaine Bear Sterns ; - Septembre 2008 : faillite des banques Lehman Brothers et Washington Mutual, rachat de Merrill Lynch par Bank of America et de Wachovia par Wells Fargo, sauvetage par l'Etat américain de l'assureur AIG (American International Group) et des organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac ; en Europe, Dexia est sauvée grâce à l'intervention des pouvoirs publics français et belges, Fortis est reprise par BNP-Paribas et les pouvoirs publics nationaux interviennent en faveur de plusieurs institutions notamment en Allemagne (Hypo Real Estate) et en Angleterre (RBS, HBOS, Lloyds TSB). |
La crise bancaire s'est doublée d'une crise des marchés boursiers , particulièrement aiguë au cours du mois d'octobre 2008. En raison de la dégradation des perspectives macroéconomique, ce krach boursier s'est poursuivi, en dépit de la mise en oeuvre de mesures de sauvetage du système bancaire .


2. Les mesures d'urgence
La BCE et la Fed sont intervenues, à de multiples reprises, pour améliorer la liquidité du marché interbancaire. Le 8 octobre 2008, elles ont abaissé d'un demi-point leurs taux directeurs, dans le cadre d'une action concertée avec cinq autres banques centrales. Le 6 novembre 2008, la BCE a confirmé cette orientation en abaissant à nouveau ses taux directeurs d'un demi-point. Mais, les interventions de politique monétaire s'étant révélées insuffisantes, les pouvoirs publics ont dû réagir, après plusieurs semaines d'hésitations.
Dans un premier temps, les interventions publiques pour juguler la crise ont été rares en dehors des Etats-Unis. Après une première phase caractérisée par des annonces désordonnées, la coordination internationale a toutefois été renforcée. Des plans de sauvetage, comportant des mécanismes de refinancement et de recapitalisation des banques, ont été mis en oeuvre dans les principaux pays industrialisés.
|
LE PLAN D'ACTION ADOPTÉ PAR LE G7 LE 10 OCTOBRE 2008 La coordination internationale s'est progressivement intensifiée, en vue de rassurer les marchés. Elle s'est traduite par un plan en cinq points, adopté par le G7 à Washington en octobre, qui a notamment incité les Etats-Unis à procéder à des nationalisations partielles, selon une approche différente de celle initialement envisagée par le plan Paulson. Elle doit être poursuivie lors d'un sommet mondial du G20 à la mi-novembre 2008. Les pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon) se sont engagés à : - soutenir les institutions financières d'importance systémique ; - débloquer le crédit et les marchés monétaires ; - permettre aux établissements financiers de lever des capitaux publics comme privés ; - se doter de programmes de garanties des dépôts robustes et cohérents ; - relancer les marchés titrisés, grâce à des évaluations précises et à une information transparente. |
Aux Etats-Unis , après un plan fiscal et plusieurs sauvetages ponctuels, un plan global a été adopté par le Congrès en octobre 2008. Initié par le secrétaire au Trésor américain Henry Paulson, il vise à racheter aux banques 700 milliards de dollars d'actifs « toxiques » invendables. Il a été complété par un plan de recapitalisation, sans précédent depuis 1932, par investissement en actions préférentielles 5 ( * ) à hauteur de 250 milliards de dollars, dont la moitié pour les 9 principales banques américaines.
En Europe , les gouvernements de la zone Euro se sont engagés à empêcher toute faillite susceptible de mettre en danger le système financier dans son ensemble. L'idée de création d'un fonds commun a été rejetée, mais un plan d'action concerté pour la zone euro a été adopté le 12 octobre 2008. Les initiatives nationales se sont dès lors multipliées. Elles peuvent poser problème au regard de la réglementation européenne de la concurrence. En Irlande par exemple, une garantie totale des dépôts a été instituée. Au Royaume-Uni, un plan complet de financement et de recapitalisation des banques a été adopté.
En France , Dexia a nécessité une intervention de l'Etat, au moyen d'une recapitalisation, à hauteur de trois milliards d'euros (pour la part française), et d'une garantie de financement, traduisant, dans le cadre d'un accord international, la volonté des pouvoirs publics de ne pas laisser un établissement faire faillite. La loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificatives pour le financement de l'économie a mis en place un cadre juridique d'ensemble, destiné à garantir le bon fonctionnement du système bancaire et financier. Elle institue notamment deux structures juridiques destinées respectivement au refinancement et à la recapitalisation des institutions financières. L'Etat pourra apporter, à titre onéreux, sa garantie à ses deux sociétés, dans la limite globale de 360 milliards d'euros .
La solution d'urgence adoptée en France suscite de multiples interrogations. Elle se fonde sur le mécanisme du « prêteur en dernier ressort » qui soulève des problèmes théoriques quant à ses effets de long terme : dans quelle mesure l'intervention publique n'incite-t-elle pas à des prises de risques excessives ?
Les modalités du plan français incitent par ailleurs à une interrogation sur les rôles respectifs de l'Etat et des banques centrales nationales . La création par l'Etat d'une société de refinancement, nouvel instrument de politique économique, ne vient-elle pas souligner l'insuffisante souplesse des instruments de politique monétaire existant en zone euro ou bien répond-elle à la vulnérabilisation de la Banque centrale ? Les conditions posées pour le refinancement, qui comportent des garanties substantielles pour l'Etat, en feront-elles un instrument efficace, c'est-à-dire une base de relance du crédit à l'économie ?
En tout état de cause, ce dispositif, conçu comme temporaire, constitue une solution d'urgence qui ne résout aucune des questions fondamentales que pose la crise actuellement en cours.
B. LA TRANSMISSION A L'ÉCONOMIE RÉELLE
1. Un choc de demande susceptible d'affecter la croissance potentielle
Le travail d'inventaire des pertes liées aux « subprimes » n'ayant pas été commencé suffisamment tôt 6 ( * ) , les problèmes d'ajustement des passifs bancaires à un niveau de risques accru ont été considérablement aggravés.
La qualité des dettes privées par rapport aux dettes publiques s'est progressivement dégradée au cours des derniers mois. Cette évolution a suscité un « repli vers la qualité » qui s'est traduit par une accentuation généralisée des écarts de taux d'intérêt.
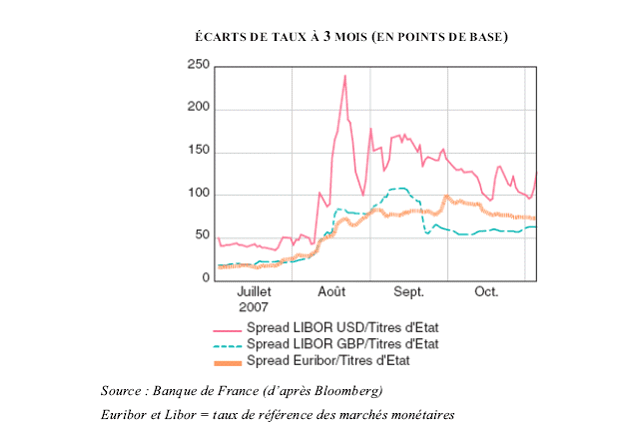
Il faut maintenant considérer les implications de la crise financière sur l'économie réelle.
A court terme, le problème le plus urgent est la reconstitution de la capacité de banques exsangues à reprendre leurs activités de financement de l'économie, ce qui suppose de restaurer leur capacité à couvrir leurs besoins de financement à court terme et d'augmenter leurs capitaux propres.
Mais, il faudra aussi compter avec les « effets de richesse négatifs » liés aux pertes patrimoniales (financières, immobilières) considérables subies par les agents économiques. Celles-ci ouvrent la voie à une baisse de la demande des agents pour restaurer leurs actifs (donc, à une forte hausse des taux d'épargne). Face à cette perspective, les administrations publiques peuvent agir avec vigueur dans un sens « contra-récessif ». La capacité des politiques budgétaires à aller dans ce sens dans les grands pays européens demeure incertaine, même si une application souple du pacte de stabilité et de croissance est envisagée, compte tenu des circonstances actuelles. En l'état, la coordination des politiques budgétaires est informelle ce qui est susceptible d'en réduire l'efficacité.
|
L'IMPACT DES BAISSES BOURSIÈRES SUR L'ÉCONOMIE Des simulations réalisées pour COE-Rexecode ont tendu à évaluer l'impact d'une correction boursière de 20 % à partir du troisième trimestre 2008 dans les principaux pays développés (Etats-Unis, Japon, zone euro, Royaume-Uni), grâce au modèle Oxford Economics d'après lequel les principaux canaux de transmission d'un choc boursier à l'économie réelle passent par l'effet de richesse pour les ménages, l'investissement des entreprises (Q de Tobin 7 ( * ) ) et le bouclage international. La politique monétaire n'est pas prise en compte dans le modèle, car sa transmission aux marchés est jugé problématique, dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés interbancaires. Dans ces conditions, le PIB américain est amputé de 0,9 point en 2009, celui de la zone euro de 0,7 point et celui de la France de 0,5 point. Les effets récessifs se prolongeraient en 2010, suite à l'enclenchement d'une dynamique négative sur l'activité, notamment à travers la détérioration du marché du travail. La même étude évalue l'impact d'une baisse de 20 % du cours du Brent à partir du second semestre 2008. Elle se traduirait par un surcroît de 0,3 point de PIB aux Etats-Unis , 0,1 point en zone euro et en France. En neutralisant la politique monétaire, l'impact sur le PIB des chocs boursier et pétrolier serait donc de l'ordre de 0,6 point de PIB en 2009 aux Etats-Unis et dans la zone Euro et de 0,4 point en France. Ces calculs donnent un aperçu de l'ampleur de l'impact des évolutions en cours , qui n'ont pas toutes été intégrées dans les prévisions disponibles à ce jour. Source : Henriot (COE-Rexecode, octobre 2008) |
La hausse du taux d'épargne est une perspective d'autant plus probable qu'à long terme les problèmes structurels qui ont rendu possible mais aussi nécessaire l'expansion excessive d'une économie d'endettement ne seront pas réglés. A cet égard, il faut souligner que, sans l'adjuvant de la dette, la demande n'aurait pas été suffisante pour nourrir une croissance qui, généralement, n'a pas buté sur des limites du côté de l'offre. La question des conditions du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits est posée , question à laquelle il faut ajouter celle de savoir comment, le cas échéant, mettre en oeuvre de nouveaux équilibres. En tout état de cause, si le niveau des dettes privées devait baisser, il faudrait bien leur trouver un substitut pour alimenter la demande.
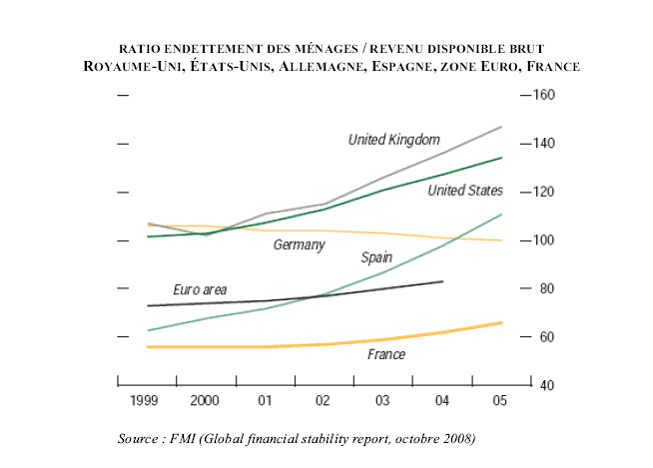
2. Économie mondiale : un ralentissement prévisible
En l'état, les perspectives de ralentissement de l'économie mondiale reposent principalement sur les effets directs de la crise financière. Elles n'intègrent pas la totalité des enchaînements récessifs de « second tour » qui justifient de nouvelles révisions.
Outre la crise financière, l'économie mondiale a été affectée par la très forte hausse, jusqu'à cet été, des prix des matières premières . Le prix du pétrole a atteint un niveau record de 147 $ le baril de brent début juillet ce qui, conjointement à la hausse des prix des produits alimentaires, a entraîné une inflation élevée qui a amputé le pouvoir d'achat.
Cette tendance devrait toutefois s'inverser compte tenu du ralentissement économique et d'une pause spéculative, seule nouvelle encourageante au plan conjoncturel avec la dépréciation de l'euro (pour les pays de la zone euro). De fait, les instituts de conjoncture - qui ont fondé leurs prévisions sur un prix du pétrole à 110 $ le baril de brent en moyenne, tant en 2008 qu'en 2009 - semblent envisager une baisse plus importante qui offrirait un soutien à l'activité.
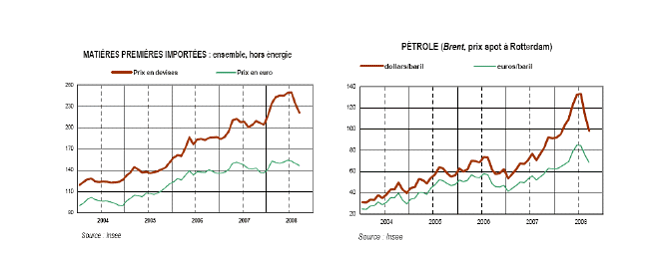
Aux Etats-Unis , la croissance aurait mieux résisté que prévu en début d'année, grâce à la dépréciation du dollar qui a fortement soutenu le commerce extérieur 8 ( * ) . Les prévisions disponibles tablent sur un ralentissement mais sur une croissance au total positive. Les instituts revoient néanmoins leur prévision de croissance à la baisse pour 2008 et pour 2009 et évoquent de plus en plus l'hypothèse d'une récession liée au déclin de la consommation et de l'investissement dans un contexte de dégradation de la situation financière et de l'emploi. Le FMI estime notamment que les Etats-Unis pourraient connaître une contraction de leur activité l'année prochaine, avec un taux de croissance de - 0,7 % en 2009 , après 1,4 % en 2008 .
Au Royaume-Uni , la crise immobilière et financière est particulièrement aiguë. La baisse des prix de l'immobilier crée des effets de richesse négatifs d'autant plus importants que les mécanismes de crédit hypothécaire existants ont permis aux ménages de s'endetter à hauteur de leur richesse patrimoniale et que des pratiques équivalentes aux crédits « subprimes » se sont développées (à hauteur de 8 % des prêts consentis aux ménages en 2006, contre 20 % aux Etats-Unis). Le repli de la consommation et de l'investissement devrait orienter le PIB à la baisse au second semestre 2008, malgré l'effet positif du commerce extérieur en raison de la dépréciation passée de la livre. Toutefois, la Banque d'Angleterre dispose de quelques marges pour une réduction des taux d'intérêt qui, sous la réserve de la santé financière des établissements de crédit, pourrait être d'autant plus efficace que les crédits sont souvent à taux variable outre-Manche.
Le Japon connaîtrait également une croissance atone (0,8 % en 2008 et en 2009), malgré une faible exposition à la crise financière et à la crise immobilière. Ce pays a été fortement affecté par la hausse des prix des matières premières et son évolution dépendra beaucoup de l'ampleur du ralentissement de la demande des pays émergents fin 2008 et en 2009. La volatilité du yen est un handicap supplémentaire dans cette perspective.
3. Pays émergents : une résistance incertaine
Bien qu'affectée par le ralentissement de l'activité mondiale, la croissance de la Chine et des autres grands pays émergents ne devrait fléchir que légèrement en 2008 et en 2009 du moins selon les prévisionnistes. Dans la plupart de ces pays, la croissance trouve un certain soutien dans l'investissement domestique. Par ailleurs, des capacités de relance peuvent être mobilisées.
Le ralentissement mondial pèsera néanmoins sur le commerce international, qui est un puissant moteur de leur croissance. Les excédents extérieurs accumulés par ces pays montrent, en effet, que le Reste du Monde tire leur croissance. Par ailleurs, même s'il semble que les banques de ces pays aient privilégié les placements sûrs de la dette publique, leur degré d'exposition au risque est particulièrement mal connu.
Enfin, c'est pour les pays les plus dépendants des capitaux étrangers que le ralentissement risque d'être plus brutal, d'autant que leurs devises sont vulnérables.
L'hypothèse d'un découplage entre pays développés et pays émergents est donc des plus incertaines.
4. Zone Euro : des perspectives orientées à la baisse
Pour les prévisionnistes, le ralentissement en zone euro serait très net : en septembre, les instituts prévoyaient encore en moyenne une croissance de 1,2 % en 2008 et de 0,8 % en 2009.
Les prévisions de la Commission européenne, en date du 3 novembre 2008, ont traduit une nette dégradation des perspectives , puisqu'elles tablent sur une quasi-stagnation dans l'Union européenne (+ 0,2 %) et dans la zone euro (+ 0,1 %) en 2009. La crise entraînerait une croissance inférieure à son potentiel pendant trois ans , de 2008 à 2010.
Les prévisions du FMI sont plus pessimistes encore puisqu'elles anticipent une récession en zone euro en 2009 (- 0,5 %).
L'Allemagne est particulièrement affectée par le ralentissement de la demande extérieure, principal moteur de sa croissance. La Commission européenne y prévoit une croissance nulle en 2009. L'activité se replierait également en Italie (0,0 %) et en Espagne (-0,2 %), ce dernier pays subissant brutalement la crise immobilière (le nombre de mises en chantier reculerait de 300 000, avec un fort impact sur l'emploi, si l'on veut se souvenir qu'une mise en chantier équivaut à 2 emplois).
En période de ralentissement prononcé, il existe traditionnellement une différence entre les Etats-Unis et l'Europe avec les interrogations que suscite, chez les conjoncturistes, la capacité de l'Europe à mobiliser ses politiques économiques.
Les prévisions pour la zone euro n'intègrent pas encore la totalité des enchaînements internes qui pourraient conduire à une récession (dégradation du marché du travail, du pouvoir d'achat, de la demande des ménages et des entreprises).
D'un autre côté, elles n'intègrent pas non plus les soutiens que la zone pourrait trouver dans le contre-choc pétrolier qui se dessine, la baisse des prix des matières premières et une meilleure compétitivité extérieure en lien avec la dépréciation de l'euro.
Elles ne tiennent pas non plus complètement compte de l'utilisation des marges de manoeuvre qu'offrent les politiques économiques , les conjoncturistes s'inquiétant d'une éventuelle inertie de l'Europe en ce domaine.
La politique monétaire - dont l'efficacité pourrait être restaurée si les marchés interbancaires revenaient à la normale - paraît mobilisable. Mais, il faudrait pour cela que la Banque centrale européenne se forge une appréciation de la situation économique différente de celle qui l'a conduite à augmenter son principal taux directeur d'un quart de point en juillet 2008 (après l'avoir maintenu inchangé pendant 13 mois) quand la Fed abaissait régulièrement le sien depuis septembre 2007 .
Sans doute la BCE a-t-elle changé d'orientation en abaissant ses taux en octobre 2008 (à 3,75 %) puis à nouveau en novembre 2008 (à 3,25 %) . Il plane néanmoins un doute sur sa capacité à être aussi réactive que la banque centrale américaine pour faire face à un choc négatif sur la croissance, dans la mesure où l'inflation demeure sa principale préoccupation.
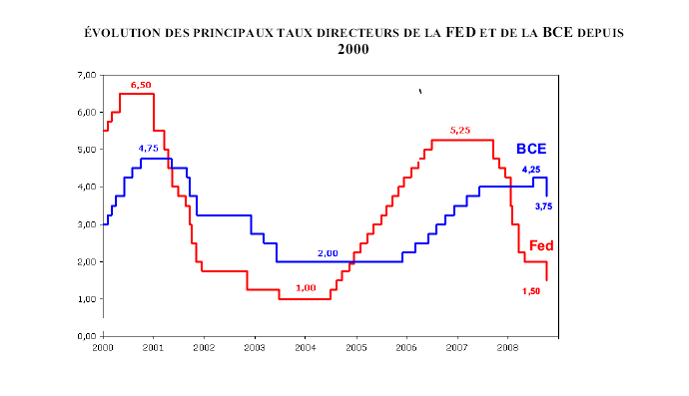
Quant à la politique budgétaire , dont il est admis que l'activation serait permise - le déficit de la zone euro étant assez modeste (0,6 point de PIB) - et rendue particulièrement nécessaire par les perspectives de fléchissement de l'activité, il est jugé assez probable qu'elle sera sollicitée.
Mais les conjoncturistes n'inscrivaient pas, jusqu'en octobre, de plan de relance. A leurs yeux, des inconnues demeurent : ils insistent sur l'utilité de clarifier le statut de la discipline budgétaire européenne (le Pacte de stabilité et de croissance) en ces temps de crise et de coordonner les actions budgétaires plutôt que laisser les agents dans l'incertitude et agir en ordre dispersé.
II. FRANCE : LA MENACE D'UNE RÉCESSION
Les dernières prévisions économiques disponibles ici commentées sont en voie de révision à la baisse.
A. DES PRÉVISIONS CONJONCTURELLES REVUES À LA BAISSE
En moyenne, en septembre 2008, les prévisionnistes estimaient que la croissance française devrait s'élever à 1 % en 2008 et à 0,8 % en 2009 . Le gouvernement était plus optimiste pour 2009 , puisqu'il situait la croissance dans une fourchette allant de 1 à 1,5 %. Cette prévision a été revue très fortement à la baisse, puisque le gouvernement juge désormais plus vraisemblable que la croissance se situe entre 0,2 % et 0,5 % l'année prochaine.
Récemment, l' INSEE a baissé sa prévision de croissance à 0,9 % pour 2008 , performance médiocre compte tenu d'un acquis de croissance de 0,75 % en début d'année qui signifie qu'après une croissance positive au premier trimestre (0,4 % au 1 er trimestre), le PIB reculerait aux deuxième (- 0,3 %), troisième (- 0,1 %) et quatrième (- 0,1 %) trimestres.
Dans ce scénario, l' acquis de croissance pour 2009 serait négatif (- 0,2 %). La prévision gouvernementale initiale pour l'année prochaine était donc, en tout état de cause, plus volontariste qu'il n'y paraissait : il aurait fallu un net redémarrage en 2009 pour parvenir à une croissance de 1 %, qui supposait une croissance en glissement de l'ordre de 2,5 % du 4ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009 9 ( * ) .
L'exercice de prévision se heurte à la difficulté d'évaluer l'amplification usuelle des enchaînements négatifs en période de brusque ralentissement.
Malgré la détérioration de l'environnement international, le scénario initialement retenu par le gouvernement posait l'hypothèse d'une contribution neutre du commerce extérieur à la croissance . Cette hypothèse semblait conventionnelle, même si le repli des matières premières et la dépréciation de l'euro peuvent représenter des facteurs favorables.
Quant à la demande domestique , le scénario du gouvernement se distinguait par une reprise de la consommation des ménages sans que soit posée une hypothèse de réduction de leur taux d'épargne, et par un certain dynamisme de l'investissement des entreprises.
La prévision prenait par ailleurs en compte la dégradation en cours de la dynamique du marché du travail et des gains salariaux totaux, après l'embellie retracée dans le graphique ci-dessous, mais sans prévoir de destructions nettes d'emplois. Les gains salariaux individuels s'amélioreraient, ce qui semble traduire l'effet des incitations à pratiquer des heures supplémentaires.
Mais, ceci ne suffisait pas pour expliquer la prévision d'une consommation robuste, qui est tributaire d'un soutien par les autres composantes du revenu disponible brut des ménages qui renvoie à la gestion des finances publiques (voir ci-dessous).
Sur tous ces éléments, les instituts de conjoncture étaient plus circonspects, avant que le gouvernement ne révise lui-même ses prévisions.
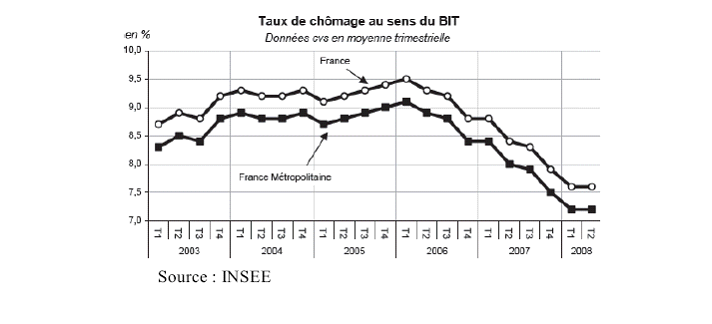
B. INCERTITUDES SUR LES FINANCES PUBLIQUES
C'est dans le domaine des finances publiques qu'existe le plus de divergences entre les prévisions, reflet des interrogations que suscitent notamment les événements en cours.
ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES : LE SCÉNARIO INITIAL DU GOUVERNEMENT
|
En points de PIB |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Déficit public |
-2,7 |
-2,7 |
-2,7 |
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
66,0 |
Source : Projet de loi de finances pour 2009
Le projet de loi de finances pour 2009 prévoyait un déficit public stable à 2,7 points de PIB en 2008 et en 2009 en dépit de l'effet de la conjoncture qui dégraderait mécaniquement le solde de 0,5 point de PIB. Autrement dit, la politique budgétaire serait rigoureuse, orientée vers un ajustement structurel de 0,5 point de PIB reposant sur :
- une décélération de la dépense publique , qui ne progresserait en volume que de 0,9 % et 1,2 % respectivement en 2008 et 2009 ;
- une résistance des recettes face au ralentissement économique, grâce à une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB élevée en 2008 (1,3 dont 1,5 pour l'Etat). Cette élasticité redeviendrait toutefois unitaire pour les administrations publiques dans leur ensemble, et inférieure à 1 pour l'Etat (0,8) en 2009 si bien qu'au total le taux de prélèvement obligatoire resterait stable à 43,2 % du PIB.
Il est, dans ces conditions, à remarquer que les prévisions du Gouvernement décrivent une contribution favorable de la politique budgétaire à la formation du revenu des ménages dont dépend, en prévision, leur consommation.
La politique budgétaire programmée correspond, en effet, à une impulsion budgétaire qui ne ferait rien pour contrer le ralentissement économique . Toutefois, à l'inverse du gouvernement, le point de vue moyen des instituts retient, au contraire, une politique budgétaire plus active : leurs prévisions de croissance, pourtant moins optimistes que celles du gouvernement, dépendent d'une impulsion budgétaire expansionniste.
Le 6 novembre 2008, le gouvernement a annoncé une révision de ses prévisions de déficit public, prenant en compte la dégradation des perspectives de croissance. L'objectif de retour à l'équilibre des finances publiques en 2012 est abandonné. Un déficit de 1,2 % du PIB est jugé plausible à cette date. Pour 2008 et 2009, la diminution anticipée des recettes fiscales se traduit par une révision des prévisions de déficit budgétaire. Celui-ci s'établirait désormais à 2,9 % du PIB en 2008, et 3,1 % du PIB en 2009. La Commission européenne craint, quant à elle, que le plafond de 3 % du PIB ne soit plus largement dépassé par la France, avec un déficit qui pourrait s'élever à 3,5 % en 2009.
III. CRISE FINANCIÈRE : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
A. SUBPRIME, TITRISATION, MARCHÉ INTERBANCAIRE, SOLVABILITÉ
La crise financière en cours est une crise du surendettement privé . Occasionnée par la crise de soutenabilité du crédit hypothécaire à risques (« subprime mortgage ») aux Etats-Unis, elle est née des déséquilibres engendrés par les excès du « levier d'endettement 10 ( * ) » et de la nécessité où le système financier s'est trouvé de rétablir sa solidité en inversant ce mécanisme.
Depuis les années quatre-vingt-dix, des ménages américains peu solvables peuvent bénéficier d'un crédit immobilier hypothécaire. La valeur de marché du bien emprunté vient en garantie de l'emprunt, dont une partie est libellée à taux variable. Ce crédit immobilier à risques est dit « subprime », c'est-à-dire de moindre qualité. L'équilibre de ces créances dépendait d'une hausse sans fin du prix de l'immobilier qui était illusoire.
Les banques prêteuses, afin de minimiser leur exposition au risque, ont revendu leurs créances à des structures financières émettant en contrepartie des titres (technique de « titrisation ») adossés au portefeuille d'actifs immobiliers (mortgage backed securities - MBS). Les années 2004-2007 ont été marquées par l'essor de la titrisation, qui a eu pour avantage (il ne faut pas l'oublier) d'élargir l'accès au financement et d'en diminuer les coûts.
Le développement des produits dits « structurés » (« collateralized debt obligations », CDO) a consisté à rassembler au sein d'un même véhicule des produits hétérogènes, aux risques a priori non corrélés. Dans ce système, où le volume des prêts compte davantage que leur qualité, l'incitation à contrôler la solvabilité de l'emprunteur est affaiblie , ce qui n'est pas anormal puisque ce mécanisme s'apparente à un système de mutualisation 11 ( * ) .
La perte brutale de valeur de ces titres engendrée par la montée des défauts a été amplifiée par la défiance qu'ils ont inspirée si bien que l'ensemble du refinancement interbancaire s'est trouvé « grippé » . La crise de liquidité a dégénéré en crise de solvabilité puisqu'il a fallu inverser le « levier d'endettement » , la perte des valeurs d'actifs amplifiant les besoins en fonds propres.
Cette inversion du levier a un impact d'autant plus fort que les portefeuilles sont évalués en « mark to market » , c'est-à-dire à leur valeur de marché. Les bilans ne sont donc pas seulement affectés par les pertes directement liées à la crise du crédit « subprime ». I ls subissent l'ensemble des baisses de prix d'actifs. La restructuration de ces bilans (« deleveraging ») implique, au passif, de lever de nouveaux capitaux et de trouver des sources de financement plus diversifiées et plus durables. A l'actif, elle suppose un amoindrissement du risque qui aura nécessairement des effets sur la distribution du crédit.
|
LES MÉCANISMES DE LA CONTAGION FINANCIÈRE La détérioration du marché hypothécaire américain ne suffit pas à expliquer totalement la crise. En effet, l'encours total des crédits hypothécaires à risque à taux variable est inférieur à 1.000 milliards de dollars et l'évaluation initiale des pertes était comprise dans une fourchette entre 100 et 200 milliards de dollars. La technique de la titrisation a permis de répartir le risque, en sorte, qu'à première vue le capital des institutions financières pourrait paraître en mesure d'absorber le choc. La crise ne résulte donc pas simplement d'un « effet de domino » engendré par les défauts de paiement. Elle a d'autres ressorts, liés à la modernisation financière. Outre les défauts de paiement, il faut en effet prendre en compte l'effet des variations des prix et des risques sur les bilans . Or l a valeur nette des bilans est d'autant plus sensible à ces variations que l'effet de levier a été utilisé. Les ajustements opérés par les acteurs aggravent le processus : les intermédiaires ajustent leur bilan de manière à ce que le levier soit important en période de croissance et faible en période de récession, ce qui en fait un instrument procyclique, amplifiant les cycles financiers. Source : Adrian et Shin (Bulletin de la Banque de France, février 2008) |
B. QUELQUES ENSEIGNEMENTS
Crise des bilans du secteur financier privé, la crise témoigne aussi d' échecs en cascade des réglementations et des systèmes de régulation , parmi lesquels il faut relever :
- les défaillances des agences de notation : face à des produits, complexes il est vrai, usant d'échelles de notation identiques pour les produits structurés et pour les produits obligataires classiques, elles ont attribué les meilleures notes à des produits abritant des créances médiocres. Ces notes n'ont pas pris en compte le risque spécifique de liquidité. Depuis juin 2007, le déclassement en chaîne des produits adossés aux subprimes a engendré un effet de panique. De façon générale, les agences de notation, qui constituent un oligopole, sont rémunérées directement par les émetteurs, ce qui crée un conflit d'intérêts 12 ( * ) ;
- les insuffisances des normes prudentielles , supposées renforcer la stabilité du système bancaire ( Bâle I et II ) : elles n'ont en rien limité l'effet de levier excessif et ont favorisé le développement de la désintermédiation. Ainsi, la réglementation de la solvabilité, d'une application déjà trop étroite, a engendré des effets de contournement , qui n'ont pas été combattus, en incitant les banques à créer des structures hors bilan sous forme de véhicules d'investissement structurés (SIV). Or la défaillance des SIV se répercute in fine sur les bilans des banques qui doivent, d'une part, conserver des prêts qu'elles prévoyaient de céder et, d'autre part, honorer les lignes de crédit dont bénéficient les SIV et décider éventuellement de les intégrer à leur bilan ;
|
LES NORMES PRUDENTIELLES DANS LE SECTEUR BANCAIRE Le comité de Bâle fut créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10 au sein de la Banque des règlements internationaux, à Bâle. Il se réunit quatre fois par an et se compose actuellement de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles de 13 pays 13 ( * ) . En 1988, le comité a mis en place le ratio Cooke, dans l'objectif de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire international et de promouvoir des conditions d'égalité de concurrence entre les banques de dimension internationale. Le ratio Cooke est une norme de solvabilité : le niveau des fonds propres doit être égal à au moins 8 % des risques pondérés. Les pondérations sont fonction de la nature juridique du débiteur, de la localisation du risque et de la durée des engagements. Cette norme fut par la suite étendue non seulement aux banques des pays membres du comité de Bâle mais également à toutes les banques d'envergure internationale. Au fil des années, la méthode retenue s'est avérée incomplète. L'évolution des marchés et notamment le développement de la titrisation ont rendu le contrôle obsolète. Pour remédier à ces défauts, la réforme de Bâle II, engagée en 1999, à abouti à un nouvel accord en juin 2004, fondé sur une approche non seulement quantitative mais aussi qualitative, s'appuyant sur les trois piliers suivants : - une exigence minimale en fonds propres rénovée (ratio dit McDonough) : l'appréciation des risques est modifiée notamment par une meilleure prise en compte de la qualité de l'emprunteur et des techniques de réduction des risques ; le risque de marché et le risque opérationnel 14 ( * ) sont pris en compte, en plus du risque de crédit. - un processus d'examen des procédures internes mises en place par les banques pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres au risque ; - un développement du rôle de la discipline de marché et de règles en matière d'information publiée. |
- les risques des normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standards), qui, en obligeant les banques à évaluer leurs actifs à des prix de marché (« marked to market » ), après avoir contribué à favoriser l'effet de levier, ont accru la panique une fois les actifs en phase de dépréciation ;
- un management des incitations microéconomiques (système de rémunérations, parachutes dorés...) axé sur une conception étroite de la « performance » , sans contrôle de la soutenabilité à terme des orientations mises en oeuvre.
Plus fondamentalement, les caractéristiques du système financier le rendent essentiellement instable (sujet à des crises d'insoutenabilité à répétition) et procyclique (c'est-à-dire qu'il accentue les fluctuations conjoncturelles dans un sens ou l'autre).
Ce sont ces deux propriétés qui représentent les deux problèmes fondamentaux que la réforme annoncée du système financier international devra régler, tout en maintenant les conditions d'un financement efficace de l'économie.
Mais, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion plus fondamentale sur les problèmes concernant l'équilibre du sentier de croissance emprunté depuis les années de déréglementation et de dérégulation, problèmes que le chapitre suivant s'efforce d'exposer .
CHAPITRE II : LA QUÊTE D'UN CHEMIN DE CROISSANCE SOUTENABLE
Pour concilier croissance (2,5 % dans le scénario central de 2010 à 2013) et ajustement budgétaire (impulsion budgétaire négative oscillant entre 0,2 point et 0,7 point sur la croissance) , il faudrait que la « réépargne » publique réalisée par la baisse du déficit public, qui doit décroitre de 2,7 % du PIB en 2008 à 0,5 % du PIB en 2012, soit assortie d'une « désépargne » privée, aussi bien de la part des ménages que des entreprises.
Or, l'évolution du contexte financier laisse plutôt augurer d'un reflux du taux d'endettement des ménages, et donc d'une augmentation de leur taux d'épargne 15 ( * ) . Parallèlement, un resserrement de l'accès au crédit des entreprises ne saurait être exclu.
Plus fondamentalement, la crise en cours agit comme un révélateur des vrais défis qu'il faut relever pour que les perspectives de moyen terme ne soient pas la répétition d'un passé qu'elle remet en cause.
Un rééquilibrage du sentier de croissance apparaît nécessaire à sa soutenabilité et indispensable à la résolution des problèmes d'endettement auxquels le gouvernement entend apporter une solution.
I. UNE BAISSE DE L'ÉPARGNE DES MÉNAGES
L'hypothèse d'une nouvelle baisse de l'épargne des ménages, nécessaire pour réaliser le scénario de croissance et de désendettement public du gouvernement, semble non seulement difficile à concrétiser, mais se trouve encore en contradiction avec les leçons qu'il est possible de tirer de la crise financière actuelle, dont un des moteurs est l'endettement excessif des ménages.
A. LA NÉCESSITÉ D'UN ENDETTEMENT ACCRU DES MÉNAGES POUR SOUTENIR LA CROISSANCE...
1. Une hypothèse forte...
Malgré un contexte défavorable au pouvoir d'achat (remontée du chômage, évolution contrainte de la dépense publique dont la croissance s'établirait à environ 1,1 % en volume de 2009 à 2013), la demande des ménages doit se montrer très dynamique (consommation en hausse de 2,7 % de 2010 à 2012) afin d'entretenir la croissance à un niveau permettant et justifiant l'ajustement budgétaire. Ce dynamisme ne saurait provenir des seuls gains de pouvoir d'achat des ménages (+ 2,2 % en moyenne de 2009 à 2013) : il est conditionné à une baisse prononcée de leur taux d'épargne (de 16 % à 14,2 % entre 2008 et 2013).
a) Des perspectives de gains de pouvoir d'achat soutenus...
A partir de 2009, le pouvoir d'achat ne souffrirait pas de l'inflation qui, dépassant 2,5 % en 2008 sous l'impact du pic des prix de l'énergie et des matières premières au premier semestre, se stabiliserait ensuite à un niveau proche de 1,9 % jusqu'à l'horizon de 2013. En effet, dans le contexte d'une croissance mondiale ralentie, le reflux des prix observé au début du second semestre 2008 initierait une période marquée par une évolution moins spéculative des cours des produits de base.
Par ailleurs, les gains salariaux du secteur marchand, alignés sur des gains de productivité par tête progressant de 1,7 % en 2010 à 1,9 % en 2013, en cohérence avec un investissement par ailleurs dynamique ( infra ), connaitraient la même évolution de 2010 à 2013, sachant que les termes du partage de la valeur ajoutée demeurent inchangé.
Sur la période, la masse des salaires réels progresserait cependant plus rapidement, de 2,2 % en moyenne annuelle sur la période 2009-2013, sous l'impact de l' augmentation des effectifs salariés (+ 0,7 % en moyenne), après un passage « à vide » au cours de l'année 2009, au titre de laquelle les effectifs salariés stagneraient en volume et diminueraient même de 0,2 % en glissement.
b) ...mais insuffisants pour alimenter une demande d'équilibre
Cette hausse est cependant insuffisante pour que la consommation des ménages participe au soutien de la demande dans des conditions de croissance permettant l'ajustement budgétaire.
Pour cela, il faut que la consommation des ménages progresse , en moyenne, de 2,7 % par an de 2010 à 2013. Aussi, le taux d'épargne doit-il reculer de 1,8 point entre 2008 et 2013 , pour se situer alors à 14,2 points de leur revenu. Si ce processus ne se déclenchait pas, la demande et, par conséquent, la croissance s'en trouveraient freinées .
Le graphique suivant montre comment, après une année 2008 marquée par une augmentation du taux d'épargne des ménages dans un contexte économique déprimé, la croissance de la consommation demeure toujours supérieure à la croissance du revenu, ce que permet une diminution continue du taux d'épargne à compter de 2009.

2. ...et au réalisme discutable
a) Ajustement des effectifs et conséquences incertaines de la réforme « heures supplémentaires »
En application du « volet social » de la loi TEPA 16 ( * ) , la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires est en premier lieu majorée de 25 % (au lieu de 10 %) quelque soit la taille de l'entreprise. En second lieu, pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés via une augmentation de la durée du travail tout en contenant son coût marginal, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales salariées, tandis qu'elles procurent une réduction de cotisations employeurs. Ces dispositions ont été appliquées à compter du 1 er octobre 2007.
L'impact sur l'emploi de la loi TEPA est ambigu , car il est la somme de deux effets. Le premier résulte de la baisse marginale du coût du travail et de la hausse du pouvoir d'achat des salariés, susceptible d'irriguer l'ensemble de l'économie avec un effet positif sur l'emploi . Le deuxième effet est, au contraire, directement négatif pour l'emploi : l'abaissement du coût d'une heure supplémentaire incite les entrepreneurs à allonger la durée du travail, ce qui est positif pour la croissance potentielle de l'économie française mais défavorable à court terme pour l'emploi 17 ( * ) .
Pour sa part, le Gouvernement a relevé une forte montée en puissance du dispositif 18 ( * ) : « Depuis l'entrée en vigueur de l'exonération des heures supplémentaires, le taux d'utilisation du dispositif n'a cessé de croitre : 38% des entreprises mensualisées avaient utilisé ce dispositif dès le mois d'octobre 2007 ; ce taux a constamment progressé pour atteindre 55% en juin 2008. (...). D'après les premières données disponibles, environ 6 millions de salariés (près de 4 millions de foyers) ont déclaré des heures supplémentaires exonérées, pour un montant total d'environ 1 540 M€, soit près de 400 euros par foyer. Le coût de cette mesure est évalué à 4 milliards d'euros pour l'année 2008 ».
La mesure d'exonération n'a pas qu'un effet d'aubaine. Au second trimestre 2008, dans les entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels, on peut constater que le nombre moyen d'heures supplémentaires par salarié à temps complet a progressé de 34,5 % sur un an. Ce ressaut intervient après une hausse de 40,3 % sur un an au 1 er trimestre 2008 19 ( * ) .
Toujours au second trimestre 2008, le nombre moyen d'heures supplémentaires marque encore une progression de 5,5 % par rapport au premier trimestre. Or, au cours du deuxième trimestre 2008, 28.800 emplois ont été détruits dans les secteurs principalement marchands en France métropolitaine 20 ( * ) . Comment interpréter ce mouvement divergent ?
Il ne saurait être exclu qu'en cas d'accélération de l'activité, le dispositif « heures supplémentaires » de la loi TEPA ne freine la création d'emplois à court terme (arbitrage recrutement / heures supplémentaires en faveur de ces dernières). Mais réciproquement, en cas de ralentissement économique, il serait logique d'espérer qu'un volant accru d'heures supplémentaires puisse servir d'« amortisseur » en permettant aux employeurs de diminuer le volume d'heures supplémentaires avant d'être contraints de licencier.
En réalité, il se peut qu'au second trimestre 2008, les entreprises dont subsistent des besoins en main d'oeuvre aient, dans le contexte d'un horizon économique assombri, renforcé l'arbitrage en faveur des heures supplémentaires, tandis que les entreprises en mauvaise santé, disposant d'un faible volant d'heures supplémentaires, aient été classiquement poussées à licencier. Il semble donc que la mesure « heures supplémentaires » ne soit pas de nature à soutenir l'emploi à court terme, y compris lors d'un retournement de conjoncture .
Ces réflexions sont à mettre en perspective avec l'effet des diverses mesures et évolutions de la période récente, tendant à amoindrir les rigidités du marché de l'emploi, notamment l'expansion des contrats d'intérim et des contrats de très courte durée. Si une flexibilité accrue permet de réduire les délais d'ajustement entre emploi et activité en période de reprise économique, un phénomène symétrique peut être observé en période de ralentissement.
Le scénario central de l'OFCE prévoit cependant une forte inflexion de la productivité pendant la période actuelle de ralentissement du PIB, partie liée à une diminution du nombre d'heures travaillées par individus (la productivité par tête s'écrase davantage, en 2008, que la productivité horaire), si bien que les destructions d'emploi sont évitées (du moins, dans le cadre d'une mesure en moyenne annuelle) :
ÉVOLUTIONS DIFFÉRENTIÉES DE LA PRODUCTION, DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE L'EMPLOI (TAUX DE CROISSANCE)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Croissance du PIB |
2,1% |
1,0% |
1,0% |
2,5% |
|
Productivité horaire* |
0,8% |
0,2% |
1,5% |
1,7% |
|
Productivité par tête* |
0,8% |
0,1% |
1,5% |
1,7% |
|
Emploi salarié marchand |
1,6% |
0,8% |
0,0% |
1,3% |
* Secteur marchand Source : d'après chiffres OFCE
Cette baisse de la productivité, qui repose sur l'hypothèse d'un cycle de productivité 21 ( * ) marqué, est favorable à l'emploi.
Quand bien même l'ajustement des effectifs de 2008 à 2010, et donc ses conséquences sur le revenu des ménages, se trouverait limité, la baisse du taux d'épargne requise pour la réalisation du scénario central n'en demeure pas moins incertaine.
b) Une baisse du taux d'épargne hypothétique
La baisse du taux d'épargne requise de la part des ménages a-t-elle des chances de se produire ?
En premier lieu , on observera que, d'une part, le taux d'épargne des ménages français a déjà connu, par le passé, de fortes et durables inflexions (de 21,2 % en 1975 à 11,2 % en 1987), suggérant qu'une telle évolution est possible. D'autre part, dans la période récente, une diminution sensible du taux d'épargne a pu être constatée au sein de la plupart des grands pays de l'OCDE, mouvement dont la France est un des rares pays à s'être tenu à l'écart (cf. graphe suivant, retraçant le taux d'épargne net 22 ( * ) des ménages). Enfin, en application du théorème d'équivalence ricardien 23 ( * ) , l'assainissement programmé des finances publiques pourrait être de nature à encourager les ménages à diminuer la part de leur revenu destiné à l'épargne.
Aujourd'hui, avec un taux d'épargne net de 12,3 % en 2008, la France se situe devant l'Allemagne (10,9 %) et loin devant l'Espagne (3,1 % en 2006), les Etats-Unis (1,8 %) et le Royaume-Uni (épargne nette légèrement négative en 2005). Une composante importante de l'explication de ces écarts tient aux dynamiques contrastées de l'endettement des ménages.

En second lieu , bien que l' endettement des ménages français atteigne aujourd'hui son record en dépassant 70 % de leurs revenus 24 ( * ) , ce taux demeure, ici encore, nettement inférieur à celui observé dans de nombreux autres pays industrialisés . Par exemple, l'endettement des ménages atteint ou dépasse 140 % en Espagne, en Grande Bretagne ou aux Etats-Unis.
Cependant, les inquiétudes sur l'emploi et des anticipations pessimistes quant à l'évolution des déficits publics pourraient aujourd'hui inciter les ménages à épargner davantage, sous la forme d'une épargne de précaution , la baisse de l'immobilier et des actifs boursiers engendreraient des effets de richesse négatifs tandis que la poursuite du resserrement du crédit constitue, au moins à court terme, une hypothèse crédible .
Dans une perspective de moyen terme, l'équilibre de l'épargne pourrait être influencé par une élévation structurelle des taux d'intérêt. Celle-ci pourrait provenir d'une réestimation des risques financiers et monétaires, ainsi que d'une volonté accrue de réduire l'endettement des agents économiques. Enfin, les perspectives du risque inflationniste doivent être prises en compte. Pour l'avenir, l'augmentation tendancielle de la demande mondiale d'énergie et de matières premières, dans le contexte d'une offre de plus en plus contrainte par des limites naturelles, est susceptible de tirer les cours à la hausse. On a vu que, dans cette hypothèse, les banques centrales se trouvaient encouragées à adopter des politiques de taux d'intérêts moins accommodantes afin de juguler les risques d'effets de « second tour » qu'entraîne l'inflation importée.
Pour l'ensemble de ces raisons, le « scénario de crise » élaboré par l'OFCE n'envisage pas de diminution de l'épargne des ménages, mais table sur un taux d'épargne globalement constant de 2009 à 2013 , après la hausse initiale induite par la crise en cours, ce qui constitue, au demeurant, une hypothèse modérément pessimiste. Le graphe ci-après montre les conséquences d'une stagnation de l'épargne sur l'évolution de la consommation, qui se rapproche alors de celle du revenu (à comparer avec graphe supra , intitulé « L'effort des ménages requis dans le scénario central »).
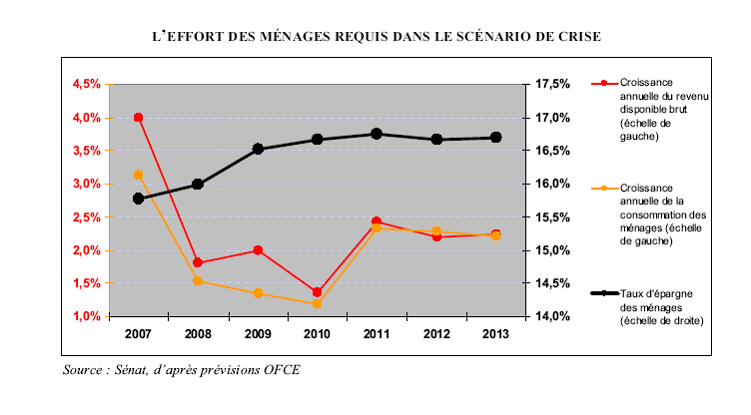
En envisageant, parallèlement, une stabilité de l'investissement ( infra ), les conséquences sur la croissance et la trajectoire de la dette publique ne sont pas négligeables.
B. ... SUGGÈRE UN PROBLÈME STRUCTUREL DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
En dehors du recours à l'endettement, trois leviers peuvent être actionnés pour soutenir la demande des ménages : une augmentation de la productivité propre à faciliter l'augmentation des salaires (cf. infra) , la dépense publique via un ajustement moins rigoureux des dépenses publiques (cf. scénario de crise) et, enfin, un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés.
La crise financière et économique actuelle, qui succède à une période de croissance fondamentalement déséquilibrée car fondée sur un endettement croissant des agents économiques, donne toute son acuité à l'exploration de cette dernière piste.
1. L'endettement a soutenu la demande...
La voie d'une évolution du partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salaires est parfois évoquée pour lever les contraintes pesant sur la progression du pouvoir d'achat.
Stabilisée en France autour de 65 % de la valeur ajoutée depuis le début des années quatre-vingt dix - niveau historiquement faible ( cf. graphique suivant ) -, l'évolution de la part des salaires y a cependant suivi une tendance conforme à celles observées en Europe ces dernières années.
Dans le contexte d'une croissance dont le régime a imposé, dans la plupart des grands pays industrialisés, un endettement croissant des ménages, il est éclairant d'effectuer, pour la France, un parallèle entre la diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée et la baisse du taux d'épargne des ménages .

Bien que le phénomène soit plus spectaculaire dans les pays anglo-saxons, l'endettement accru des ménages , passé de 49 % du revenu disponible brut des ménages en 1996 à près de 72 % en 2007, a apporté une incontestable contribution à la croissance économique française , soit via l'investissement immobilier des ménages, soit via leur consommation.
Les crédits à l'habitat représentent plus de 70 % de l'encours total des crédits aux ménages (73 % à fin 2007). Ces crédits contribuent directement, non pas à la consommation, mais à la formation brute de capital fixe (FBCF) 25 ( * ) des ménages, qui est une composante du PIB. A cet égard, avec la crise immobilière, la FBCF des ménages, après avoir contribué à la croissance annuelle du PIB à hauteur d'environ 0,3 point de 2004 à 2007, devrait au contraire peser sur la croissance à hauteur de 0,2 point en 2008 et 2009 puis apporter à nouveau une contribution positive annuelle, contenue, de 0,1 point de PIB jusqu'en 2013.
Mais, indirectement , par les effets de richesse qu'ils entraînent, ces crédits contribuent aussi au soutien de la consommation -certes, dans une moindre proportion que dans les pays anglo-saxons, où l'encours des prêts à la consommation est directement conditionné par la valeur des actifs immobiliers des ménages.
2. ...dans des conditions permettant simplement de réaliser le potentiel de croissance
Depuis la fin des années quatre-vingt, l'inflation 26 ( * ) est résorbée en France et, depuis la monnaie unique, dans la zone euro 27 ( * ) . De ce fait, on déduit que la croissance économique effective n'y excède guère, à moyen terme, la croissance potentielle .
|
CROISSANCE POTENTIELLE ET INFLATION La croissance du PIB donne lieu à une déclinaison théorique dénommée « croissance potentielle », définie comme la croissance maximale à moyen terme d'une économie sans tension inflationniste. En amont du calcul de la croissance potentielle, la production potentielle désigne le niveau de PIB maximal « soutenable » à moyen terme, c'est à dire sans susciter de tensions inflationnistes , compte tenu du taux d'utilisation des facteurs de production (capital ou travail) et des progrès technologiques ou organisationnels réalisés par ailleurs. L'écart de production (« output gap ») est la différence entre la production effective et le niveau de la production potentielle. Au-dessus de sa production potentielle (« output gap » positif), une économie atteint ses limites en termes d'utilisation des facteurs de production. Dès lors, la rémunération d'un des facteurs augmente au-delà des revenus qu'il engendre, entraînant une hausse de la demande et donc des tensions inflationnistes. Si la situation perdure, une telle économie est alors réputée souffrir d'un problème d'« offre ». Inversement, une économie dont la production est inférieure à sa production potentielle (« output gap » négatif) suggère volontiers un problème de « demande ». Ainsi, le diagnostic global résultant de la comparaison entre croissance potentielle et croissance effective (problème d'offre ou de demande) n'appelle pas les mêmes profils d'interventions macroéconomiques (par exemple, renforcer le soutien à l'investissement des entreprises ou au pouvoir d'achat des ménages). Le taux de croissance potentielle est le taux de croissance de la production potentielle. A un horizon de moyen terme, la croissance effective tend normalement à rejoindre la croissance potentielle, sauf si la politique économique pèse durablement sur la croissance (par exemple, pour respecter une contrainte d'assainissement budgétaire). Sur la base de l'identité comptable [PIB = productivité du travail x emploi], la croissance potentielle à moyen terme de l'économie française, correspondant à l'évolution tendancielle de la productivité et de l'emploi, avoisinait, ces dernières années , 2 % , dont 1,7 % résulte des gains de productivité et 0,3 % de l' augmentation de la main d'oeuvre disponible 28 ( * ) . |
Par ailleurs, aux États-Unis, une étude récente montre que la croissance moyenne du PIB de 2002 à 2007 (2,7 %) n'y aurait guère excédé celle de la croissance potentielle moyenne (2,6 % sur la période) 29 ( * ) , malgré un endettement en forte croissance qui a nourri la demande ( infra ).
Ainsi, sans le recours accru à l'endettement constaté au cours des dix dernières années, la croissance, aurait suivi un chemin moins favorable, situé en dessous de son potentiel .
Le graphe suivant montre qu'en France, la croissance déséquilibrée du milieu des années soixante-dix au début des années quatre-vingt, caractérisée par un partage de la valeur ajoutée se déformant au profit des salariés et nettement inflationniste, a depuis laissé la place à un régime de croissance non inflationniste.

En premier lieu, le constat d'une croissance non inflationniste alimentée par un endettement accru pose la question du caractère soutenable, à long terme, des termes actuels du partage de la valeur ajoutée .
Si un endettement croissant des ménages conditionne la poursuite de la croissance économique à un rythme proche de son potentiel, il ne peut, à terme, que s'ensuivre des difficultés liées à la solvabilité des ménages, dont la crise des subprimes américaine a fourni une parfaite illustration :
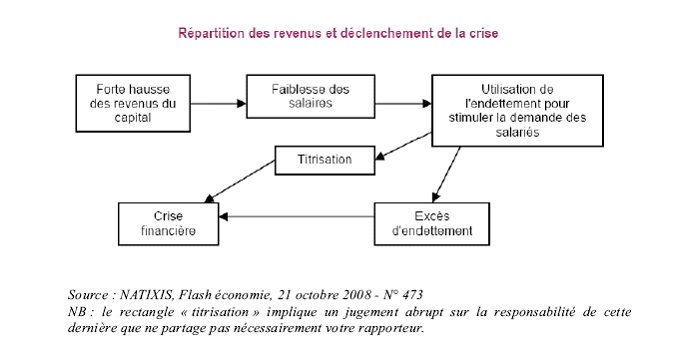
A contrario , une décrue de l'endettement déboucherait sur une croissance sous-optimale, c'est-à-dire inférieure à la croissance potentielle.
En second lieu, il se peut qu'au sein même de la part de la valeur ajoutée consacrée à la rémunération du travail, des inégalités salariales croissantes se soient accompagnées (pour partie en la suscitant, pour partie en y étant conditionnée) d'une accélération de l'endettement des ménages les moins aisés . Ce constat peut, sans conteste possible, être dressé aux Etats-Unis.
|
Aux Etats-Unis, la hausse des revenus réels s'est interrompue pour 95 % d'américains malgré une part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée peu évolutive « Historiquement, le partage de la valeur ajoutée aux Etats-Unis oscillant autour d'une ligne horizontale, on ne peut mettre en évidence une dérive tendancielle au détriment de la part des salaires. Celle-ci, de 64 % au milieu des années 1990, a atteint 66,2 % en 2001, avant de revenir à 65 % l'an dernier. Les gains de productivité ont été très substantiels, près de 3 % l'an en moyenne depuis cinq ans. Le marché du travail a renoué avec le plein emploi. Pour autant, l'Américain moyen n'a pas vu sa rémunération réelle vraiment s'améliorer. « Le «Current Population Report» publié par le Census Bureau le mois dernier a fait état d'une hausse du revenu du ménage médian de 1,1 % en volume en 2005, la première depuis 1999. Pour reprendre la question posée par I. Dew-Becker et R. Gordon : «Où sont passés les gains de productivité ?» Pour reconstituer ce puzzle, il faut se pencher sur l'évolution des disparités de revenus. Le creusement des inégalités de rémunération n'est pas un phénomène récent. La part du revenu national qui échoit au quintile supérieur de la distribution des rémunérations est passée de 43,6 % en 1975 à 48,7 % en 2000, et à 50,4 % en 2005. Le ratio du 90 ème centile au 10 ème , de 8,5 il y a trente ans, atteignait 10,1 en 1995 et 11,1 l'an dernier. Ce constat ne donne, toutefois, qu'une vue très partielle de la dynamique des disparités de revenus. « Pour la majorité, la hausse des revenus réels, autrefois observée pour l'ensemble des catégories de revenus, est quasi interrompue. Il faut aller vers le milieu du décile supérieur pour trouver une hausse des revenus réels dans les cinq dernières années (+ 0,2 % l'an au niveau du 95 ème centile, mais des baisses de respectivement 0,15 %, pour le 90 ème , de 0,5 % pour le revenu médian et de 1,1 % pour le 20 ème centile) ». Source : BNP Paribas, Etudes économiques, Conjoncture, mars 2007, lien : http://economic-research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/ConjonctureByDateFR/38E8C591F8EAE420C12572A3004357F9/$File/C0703_F1.pdf?OpenElement |
La nécessité d'un endettement accru des ménages ne doit pas ici davantage étonner : la propension moyenne à consommer des ménages diminuant avec le revenu, un accroissement des inégalités se solde logiquement, pour une masse salariale globale inchangée et sans recours supplémentaire à l'emprunt, par une diminution relative de la consommation. Un recours croissant à l'emprunt autorise ainsi la préservation du rythme de croissance dans un contexte d'accroissement des inégalités de revenus .
Il est remarquable que les pays dans lesquels les dépenses publiques soutiennent le moins les revenus (ou ceux dans lesquels ce soutien a été, un moment, drastiquement diminué) sont aussi les pays dans lesquels l'endettement privé est le plus élevé et va jusqu'à concerner les personnes les moins favorisées.
En résumé, le régime de croissance mondiale de ces dix dernières années a reposé sur un endettement croissant des ménages ( voir graphe ci-après ), que leur part dans la valeur ajoutée se soit globalement rétractée ou que les inégalités salariales se soient accentuées, afin de permettre une progression continue de la consommation de masse.
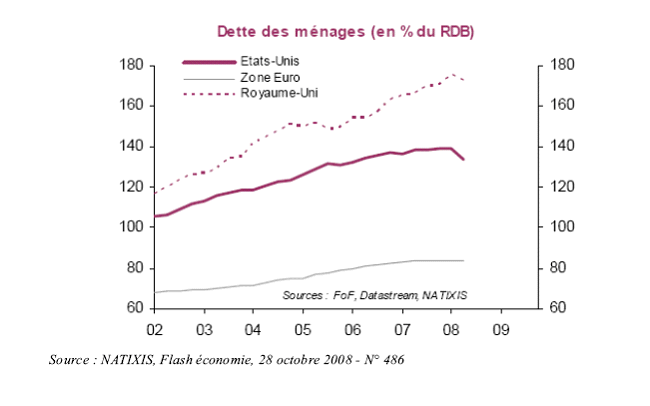
II. UN INVESTISSEMENT PLUS DYNAMIQUE
Le niveau des taux d'intérêt constitue un déterminant fondamental de l' investissement , dont la réalisation du scénario gouvernemental de croissance nécessite une légère hausse qui participerait directement à l'augmentation de la demande. Cette augmentation, dont la probabilité de réalisation suscite des interrogations, renforcerait quelque peu à moyen terme, par ses effets d'offre, la croissance potentielle .
A. DES PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT FRAGILISÉES...
1. Un scénario volontaire...
Malgré un contexte plutôt défavorable (resserrement de l'accès au crédit, dégradation des perspectives de débouchés), l'investissement demeurerait dynamique dans le scénario central (le taux d'investissement progresserait de 19,7 % en 2008 à 21,7 % en 2013) afin de contribuer, avec la consommation des ménages, à un niveau de croissance permettant l'ajustement budgétaire. Ce dynamisme serait conditionné par une légère baisse du taux d'autofinancement (de 66,3 % à 64,8 % entre 2009 et 2013) des entreprises.
*
Depuis la fin des années quatre-vingt dix, les taux d'intérêts réels ne se situent plus à un niveau intrinsèquement problématique pour l'investissement et, au sein des entreprises, le maillon le plus faible se situerait plutôt du côté de l'anticipation de la demande.
Le graphe suivant montre que l'augmentation récente de l'investissement des sociétés non financières a pu avoir lieu moyennant une diminution substantielle la part de l'autofinancement , donc via un recours accru à l'emprunt.
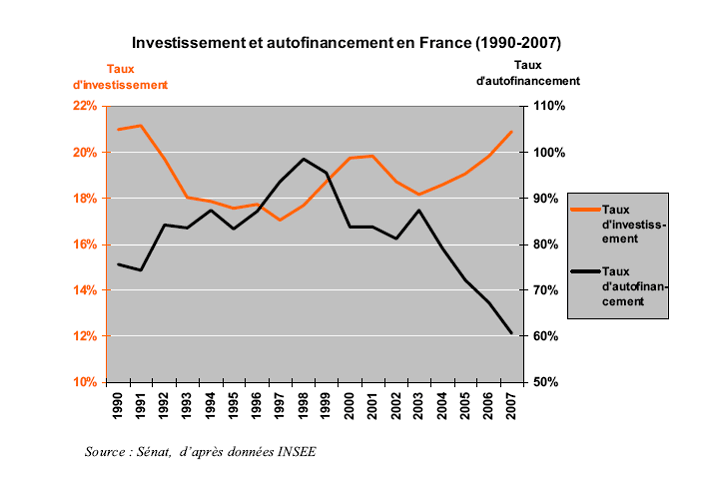
Le scénario central de l'OFCE qui illustre les conditions de réalisation du programme de croissance et de désendettement du Gouvernement montre la nécessité d'une accélération continue de l'investissement, moyennant une réduction continue de l'autofinancement et donc un endettement encore accru des entreprises 30 ( * ) , dont le besoin de financement, qui ressortait en moyenne à 0,6 point de PIB de 1989 à 1999, puis à 2,5 points de PIB de 1999 à 2009, devrait s'établir en moyenne à 4,8 points de PIB de 2009 à 2013.
En revanche, dans le « scénario de crise », l'investissement est stabilisé à un niveau modeste et l'autofinancement augmente dans le cadre d'un moindre recours à l'emprunt, avec un besoin de financement limité à 3,6 points de PIB de 2009 à 2013. Le graphe suivant rend compte de ces évolutions différentiées :
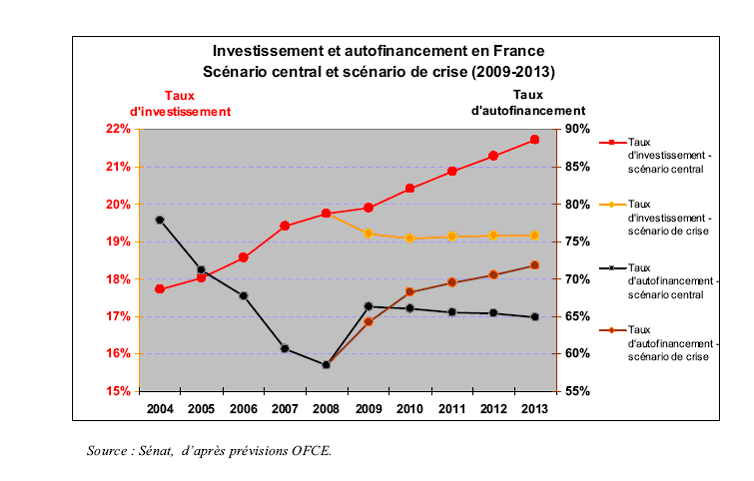
2. ... mais des perspectives dégradées
Aujourd'hui, les perspectives d'investissement paraissent dégradées, à un double égard.
En premier lieu, la rentabilité économique de l'investissement dépendra, à moyen terme, des perspectives des entreprises en matière de demande effective . En effet, l'évolution de l'investissement est fortement corrélée au niveau de la demande anticipée et au taux d'utilisation des capacités de production .
En vertu du mécanisme de l'« accélérateur» 31 ( * ) , toute variation de la demande entraîne mécaniquement une variation de la FBCF qui lui est supérieure, à condition qu'il n'existe pas de capacité de production inemployée. Cette modélisation permet d'expliquer la « nervosité » de l'investissement en réaction aux variations de l'activité. Or, ces dernières sont nettement assombries par la contamination de la crise financière à la sphère réelle, et l'hypothèse d'un brusque ralentissement de l'investissement ne doit pas être écartée.
En second lieu, au moins à court terme, la probabilité d'un resserrement des conditions financières demeure forte , même si son ampleur est très difficile à évaluer, notamment en raison des initiatives gouvernementales destinées à soutenir l'offre de crédit bancaire en direction des entreprises.
A la faveur des mesures exceptionnelles prises ces derniers mois par les grandes Banques centrales et les principaux Etats, la confiance pourrait revenir sur les marchés interbancaires ainsi que pour l'octroi de crédit, avec des taux d'intérêt réels stabilisés -hypothèse que le reflux de l'inflation et les politiques de taux directeurs désormais accommodantes des principales banques centrales peut accréditer.
En revanche, il est certain qu'une hausse des taux d'intérêts appliqués aux emprunts des entreprises, dans le contexte d'une demande affaiblie, peut entraîner les entreprises dans une séquence de « deleveraging », c'est-à-dire une phase de désendettement liée à une rentabilité économique du capital devenue inférieure aux taux d'intérêt réels, configuration qui inverse l'effet de levier de l'endettement pour les actionnaires (cf. encadré ci-après).
Pour ces raisons, le « scénario de crise » de votre délégation table, non pas sur une augmentation, mais, avec un pessimisme mesuré, sur une stabilité de l'investissement de 2009 à 2013 (ainsi que sur un taux d'épargne des ménages constant) et en évalue les conséquences sur la croissance et la trajectoire de la dette publique (voir la deuxième partie du présent rapport et son chapitre I).
B. ... DANS LE CONTEXTE D'UNE RÉMUNÉRATION EXCESSIVE DES CAPITAUX...
Le raisonnement suivi supra pour l'endettement des ménages peut être étendu à l'endettement des entreprises : si la poursuite de la croissance économique à un rythme proche de son potentiel est conditionnée par un endettement accru des agents économiques, dont les entreprises, il ne peut qu'en résulter, à plus ou moins brève échéance, des difficultés liées à leur solvabilité , sauf à ce que l'endettement privé débouche sur une élévation du rythme de la croissance potentielle. De 2000 à 2007, en France, l'endettement des entreprises est passé de 62,7% à 74,1 % du PIB et, dans la zone euro, de 73,2 % à 88,7 % du PIB.
Pourtant, un rythme d'investissement soutenu n'est pas inconciliable avec un partage de la valeur ajoutée plus favorable au travail ( supra ).
En effet, la part dévolue aux profits peut elle-même se subdiviser entre dividendes et autofinancement 32 ( * ) , et il se trouve que seule la part réservée aux dividendes est en constante augmentation ces dix dernières années .
De nombreux économistes 33 ( * ) dénoncent ici le « court termisme » qui s'est emparé d'investisseurs attachés à la « norme des 15 % de ROE » (return on equity, cf. encadré infra ), devenue emblématique d'une économie financière déconnectée de ses fondamentaux et signant la suprématie de la « corporate governance 34 ( * ) » sur la « public governance ».
|
EFFET DE LEVIER ET PROFIT DES ACTIONNAIRES (ROE)
Dans une autre formulation, la rentabilité économique du capital fixe est égale au rapport de l'excédent brut d'exploitation (EBE) 36 ( * ) au stock de capital fixe (K). Elle est une fonction croissante du taux de marge (EBE / VA) qui, dépendant du taux de salaire réel et de la productivité du travail, rend compte du partage de la valeur ajoutée allant aux profits de l'entreprise.
Réciproquement, lorsque le taux d'intérêt réel devient supérieur à la rentabilité économique, la rentabilité financière diminue d'autant plus vite que le taux d'endettement est élevé et la priorité revient alors au désendettement : l'effet de levier est devenu négatif. Quelques définitions :
|
Le graphe suivant montre qu'en Europe occidentale, dans la période récente, le ROE tend à se rapprocher des standards américains , eux-mêmes d'une exigence croissante depuis le début des années quatre-vingt-dix 37 ( * ) .
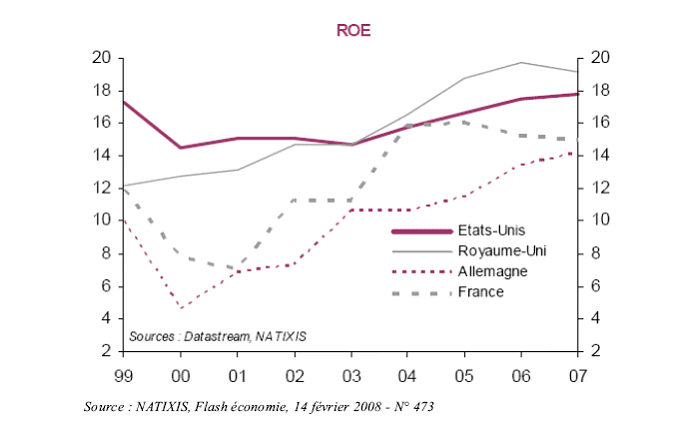
En conséquence, les dividendes versés représentent une part croissante du PIB : dans le contexte d'une croissance limitée à 2 % ou 3 %, une rentabilité financière supérieure à 15 % ne peut qu'aboutir à attraire une part croissante de la valeur ajoutée vers les détenteurs de capitaux. En France, la part des dividendes dans la valeur ajoutée des sociétés non financières est ainsi passée de 2,9 % à 7 % entre 1981 et 2000.
Or, des performances accrues en matière de ROE supposent non seulement, indirectement, une augmentation de l'endettement des ménages en raison des déformations du partage de la valeur ajoutée qu'elles impliquent, mais encore, directement, un endettement accru des entités économiques dont le capital social est détenu sous forme de titres , qu'il s'agisse d'entreprises ou des fonds d'investissement 38 ( * ) , afin d'engendrer les effets de levier. A titre d'illustration, pour renforcer le ROE 39 ( * ) , de nombreuses entreprises ont, depuis les années quatre-vingt-dix, emprunté pour racheter leurs propres actions (substituant ainsi de la dette à des capitaux propres). Par ailleurs, le secteur financier (banques et véhicules financiers divers) s'est manifesté par une grande créativité dans la recherche d'effets de levier.
En complément du graphe supra concernant l'endettement des ménages, les graphes suivants rendent compte de ces tendances dans le monde occidental (voir également le graphe 11 p. 42 du rapport de l'OFCE annexé) :

Ajoutons que l' endettement public peut, dans des proportions variables, se substituer à l'endettement privé. En effet, tout déficit public 40 ( * ) est la conséquence d'un transfert net vis-à-vis des agents économiques, ménages et entreprises, dont les revenus et la dépense peuvent ainsi se trouver majorés, sans recours supplémentaire à l'emprunt pour ce qui les concerne.
En France, l'endettement relativement limité des ménages peut être rapproché d'un endettement public comparativement plus fort, alors que le constat inverse peut être dressé, notamment, en Espagne ou en Grande Bretagne 41 ( * ) .
Au total, une norme élevée de ROE constitue un accélérateur d'endettement pour l'ensemble des agents économiques (ménages, entreprises, Etat), ce qui pose un problème de soutenabilité concernant notre modèle de croissance, dont la crise financière souligne aujourd'hui assez l'acuité. Il est donc nécessaire de mener une réflexion économique approfondie sur les termes d'une rentabilité financière qui serait soutenable à long terme dans le contexte d'une croissance proche de son potentiel.
*
Parvenu à ce stade, deux considérations peuvent être formulées.
En premier lieu, si les salariés sont un coût pour l'entreprise -ici, maintenant-, ils constituent aussi un débouché -mais peut-être ailleurs, ou demain 42 ( * ) . Ce paradoxe, au coeur de la théorie keynésienne, ne peut trouver une traduction efficace en termes de politique économique, dans un contexte de mondialisation des échanges, dès lors que les règles susceptibles d'être instaurées pour soutenir la demande ne seraient pas coordonnées. Aujourd'hui, le problème est donc celui du gouvernement mondial de l'économie, afin que la rationalité à l'oeuvre au sein des différents conseils d'administration (favoriser le ROE) n'aboutisse pas, au niveau global, à un « jeu à somme négative » : une demande globale pénalisant la croissance, ou une demande suffisante mais conditionnée, en certains points de la planète, par un endettement non soutenable.
En second lieu, tant que des règles aboutissant à un partage soutenable de la valeur ajoutée entre le travail, l'investissement et les actionnaires ne seront pas édictées, le mouvement de désendettement des agents économiques (« deleveraging ») pèsera directement, pour une durée difficile à déterminer, sur la demande, avec une croissance économique devenue inférieure à son potentiel . En outre, la croissance pourrait souffrir, elle-même, d'un reflux de l'investissement...
C. ... AU RISQUE DE COMPROMETTRE LE POTENTIEL DE CROISSANCE À MOYEN TERME
A l'appui de la perspective d'un retour à une croissance de 2,5 % à compter de 2010, le Gouvernement relève, outre la perspective d'un « rattrapage » avec une croissance effective repassant au dessus de son potentiel, que « la croissance potentielle continuerait à tirer profit des réformes structurelles mises en oeuvre par le Gouvernement depuis 2007 . En particulier, la mise en place de la loi de modernisation de l'économie - qui favorisera la concurrence - et du crédit d'impôt recherche - qui soutiendra la recherche et développement - renforceront les gains de productivité liés au progrès technique » tout en reconnaissant que « les effets décalés de l'envolée des prix du pétrole pourraient cependant peser un peu sur le potentiel de moyen terme » 43 ( * ) .
On rappelle que l'augmentation du potentiel de croissance d'une économie s'effectue par deux canaux : l'augmentation de la main-d'oeuvre disponible et l'augmentation de la productivité du travail. Ainsi, l'augmentation de la richesse par habitant est essentiellement permise par les gains de productivité .
|
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET PGF Trois facteurs sont susceptibles de concourir à l'augmentation de la productivité du travail : la durée du travail , l'intensité capitalistique et la productivité globale des facteurs (PGF) . La PGF représente l'augmentation de la production qui ne peut pas s'expliquer par l'évolution quantitative des deux facteurs de production apparents que sont le capital et le travail. L'intensité capitalistique et la PGF déterminent la productivité horaire du travail qui, combinée à la durée du travail, détermine la productivité du travail . La PGF, parfois qualifiée de « résidu inexpliqué » (ou « résidu de Solow »), ne peut s'expliquer que par le « progrès technique » au sens large , dont les déterminants sont essentiellement l'innovation 44 ( * ) et les progrès organisationnels . |
Sur quel facteur de production « miser » pour augmenter la croissance potentielle d'une économie, et particulièrement celle de l'économie française ?
Une plus grande mobilisation de la population en âge de travailler élèverait le niveau de PIB potentiel de la France, mais cet impact ne saurait qu'être transitoire . En effet, le taux d'emploi 45 ( * ) ne peut augmenter indéfiniment, de même que la durée du travail. Concrètement, le tassement de l'augmentation de la population active pèse aujourd'hui sur l'évolution de la croissance potentielle, malgré les réformes structurelles tendant, notamment, à l'allongement de la durée d'activité :
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Variation de population active |
0,54% |
0,44% |
0,45% |
0,32% |
0,23% |
0,19% |
0,11% |
0,11% |
0,08% |
0,06% |
Source : données OFCE annexées
Par ailleurs, il apparaît qu'une simple accumulation du capital , fondée sur l'imitation et sans le secours de l'innovation, ne peut soutenir la croissance à long terme que pour les pays en phase de « rattrapage » , les moins avancés technologiquement 46 ( * ) . D'une façon générale, sans innovation, la croissance à long terme se heurte au mur de la loi des rendements décroissants des facteurs de production, capital ou travail 47 ( * ) .
Au total, ainsi que le rappelle le rapport du Conseil d'analyse économique intitulé « Les leviers de la croissance française » 48 ( * ) , « à long terme, le ressort principal de la progression du PIB par habitant , autrement dit du niveau de vie économique moyen, est la croissance de la productivité des facteurs de production (capital et travail) via le progrès technique et l'innovation ».
Un investissement soutenu est donc indispensable pour préparer la croissance de demain , aussi bien en termes de capacités de production que de gains de productivité dans le contexte stratégique d'une économie de la connaissance. En particulier, l'investissement en recherche et développement permettrait de réaliser durablement « le point de croissance » (celui qui rapprocherait notre croissance à moyen terme de 3 % au lieu de 2 %) qui a manqué ces dernières années à la France pour concilier le reflux du chômage avec celui de la dette publique et du déficit extérieur.
Sans une accélération de l'investissement, particulièrement en recherche et développement, il ne faudrait pas attendre une accélération durable de la productivité et de la croissance effective. Même à moyen terme, la plausibilité du scénario du Gouvernement (scénario central de l'OFCE dans le graphe ci-dessous) repose, entre autres hypothèses, sur une augmentation de la productivité :

Plus fondamentalement , il se peut que, dans une perspective « schumpétérienne » 49 ( * ) , la survenance d'une vague d'innovations conditionne pour partie le terme de la crise économique actuelle , avec de nouvelles productions qui succèderaient ou s'ajouteraient aux anciennes. Au demeurant, les exigences du développement durable et, en particulier, le défi environnemental poussent à développer de nouveaux secteurs ou modes de production ainsi que de nouvelles approches du bien-être.
En conclusion de leur rapport « Recherche et innovation en France » 50 ( * ) , MM. Joseph Kergueris et Claude Saunier notaient : « la recherche constitue une activité déterminante pour l'avenir de l'humanité et son ambition ne peut qu'excéder largement une préoccupation de valorisation à l'échelle de nos territoires. La santé, l'environnement, la sécurité physique et alimentaire, l'énergie sont des biens publics mondiaux et il apparaît clairement que seule la recherche permettra de les fournir durablement. Osons le dire, la recherche est elle-même un bien public mondial . Dans cette perspective, les diverses formes de collaboration internationale et leurs relances périodiques, notamment dans le cadre européen, devraient prendre toute leur dimension (...) ».
Dans la mesure où la recherche et l'innovation pourraient aussi conditionner, pour l'avenir, de nouvelles productions susceptibles d'aider le monde à sortir de l'ornière économique et environnementale dans laquelle il semble aujourd'hui s'enfoncer, la qualification de « bien public mondial » apparaît d'une singulière pertinence.
On rappellera, à ce propos, que la dépense française de R&D 51 ( * ) n'y représente guère plus de 2 % du PIB , bien en deçà de l'objectif de 3 % en 2010 fixé au début de la décennie par la stratégie de Lisbonne, qui s'avère, sous cet angle, un échec : aujourd'hui, cette dépense stagne en Europe autour de 1,8 % du PIB .
Dans le contexte économique actuel, votre Délégation insiste pour que la quête de l'équilibre des comptes publics à moyen terme ne soit pas de nature à obérer les capacités de recherche, aussi bien publiques (dépenses budgétaires) que privées ( via la dépenses fiscales et sociales), sans préjudice, naturellement, de la nécessaire évaluation de l'efficacité de ces dépenses afin de tendre vers une allocation optimale des ressources. Elle ne doit davantage conduire à faire l'impasse sur le développement des investissements sans lesquels l'avenir serait sacrifié au présent et les générations futures dotées d'un legs invivable. Ainsi, elle estime ici indispensable que la gouvernance budgétaire, particulièrement en France et dans la zone euro, ancre sa stratégie non pas à court et moyen terme, mais à moyen et long terme .
DEUXIÈME PARTIE : LES INTERVENTIONS PUBLIQUES
AU DÉFI DE LA CROISSANCE
AVANT-PROPOS
Dans ses rapports sur les perspectives à moyen terme des finances publiques, votre délégation a constamment appelé à prendre très au sérieux la situation de l'endettement public. Cela suppose, en particulier, de considérer la soutenabilité des stratégies de désendettement public autant sous l'angle de leurs effets de court terme que sous celui de leur impact sur la croissance potentielle de l'économie française.
Les politiques de consolidation budgétaire exercent a priori un effet déprimant sur l'activité économique.
Les arguments théoriques qui fondent l'opinion contraire ne sont pas validés, sauf circonstances exceptionnelles, par les constats empiriques. Ainsi, lorsque l'environnement économique appelle des politiques économiques de soutien de l'activité, il n'est pas recommandable de privilégier des orientations restrictives. On ne fait alors qu'aggraver les problèmes, et le coût économique de la « guérison budgétaire » en excède les bénéfices.
En cette période de crise économique, l'urgence est de mettre en oeuvre une politique économique « contra-récessive ».
Ce constat n'équivaut pas à une recommandation de négliger la situation financière de l'Etat. Comme pour tout autre agent économique, même si c'est dans des conditions bien différentes, il existe pour l'Etat une contrainte de soutenabilité financière. Et ce n'est pas parce que l'actualité montre que celle-ci est, par nature, infiniment moins rigoureuse que celle supportée par les agents privés qu'il faut la mésestimer. Mais, on entre dans une impasse regrettable quand on réfléchit à la situation financière de l'Etat en omettant la question essentielle, de son rôle économique et social. C'est cette tendance qui serait à l'oeuvre si l'on appliquait aux finances publiques les instruments purement financiers dont la situation des agents privés est justiciable.
Cette banalisation de l'Etat obéit sans doute à la crainte que peuvent à bon droit inspirer ses possibles abus. Pourtant, elle peut entraîner des erreurs stratégiques si elle repose sur l'idée, fausse, que l'Etat est un agent économique comme les autres 52 ( * ) . S'il manque à nos savoirs une doctrine vraiment élaborée de la place de l'Etat dans l'économie et des moyens de s'assurer que celle-ci ne sera ni désertée, ni le socle d'excès, les progrès considérables apportés par les économistes de la seconde moitié du XX ème siècle autour de la théorie des externalités et des biens publics, le renouveau des approches empiriques sur la rentabilité des différentes catégories de dépenses publiques - qui appellent des développements, des approfondissements - doivent inspirer notre gestion publique.
C'est pourquoi votre délégation a toujours abordé avec nuances le problème de la soutenabilité financière de l'Etat. Qu'il lui soit permis de poursuivre son travail dans cet esprit.
La coexistence d'une surveillance de la position financière des Etats extrêmement rigoureuse puisque le niveau d'endettement toléré est plafonné en données brutes - donc indépendamment de la considération des actifs détenus par les Etats que leur endettement a pu financer - à 60 points de PIB et d' une « supervision » du système financier privé , qu'on peut juger, à l'aune de la montée de l'endettement privé, plus que « défaillante » , représente une composante structurelle de l'organisation économique de l'Europe dont la justification repose sur des présupposés contestables et dont la cohérence est, en conséquence, pour le moins douteuse.
Cette supervision financière partielle conduit à des erreurs de diagnostic sur la situation réelle des Etats et, surtout, à des recommandations de politique économique qui pénalisent une action publique dont la conception doit être assez libre pour offrir les conditions d'une croissance structurellement supérieure et promouvoir l'objectif d'égalité choisi.
CHAPITRE I : L'AMÉLIORATION STRUCTURELLE DU SOLDE PUBLIC AU SERVICE DU DÉSENDETTEMENT PUBLIC : QUELLE SOUTENABILITÉ ?
La programmation pluriannuelle des finances publiques à l'horizon 2012 projette une forte réduction du poids de la dette publique dans le PIB, au terme d'une réduction structurelle continue du déficit public.
On peut fonder un tel objectif sur plusieurs sortes de justifications.
Des motivations de prudence financière peuvent intervenir, de même que des objectifs budgétaires ou encore des considérations économiques .
Une très grande circonspection doit être observée quand on analyse la contribution du désendettement public à ces différents objectifs et on doit être attentif à leurs interdépendances.
Les gains d'une réduction de la dette publique doivent être considérés au regard des risques qu'entraîne une stratégie budgétaire tournée vers cet objectif .
Le point de vue sur son bilan coûts-avantages ne peut être entièrement scientifique . Il comporte ainsi une dose non négligeable d'incertitudes, notamment parce que, sous l'angle de leur efficacité économique, les emplois correspondant aux dettes des différents agents économiques ne sont pas facilement mesurables. Il faut ajouter à cette réserve une question qui lui est liée, à laquelle l'actualité confère une grande importance : celle de la soutenabilité des dettes des agents économiques privés.
Ce point de vue ne peut pas non plus être univoque : la dette publique est une composante majeure d'équilibres économiques complexes . Votre délégation a systématiquement posé dans ses rapports le problème de la substituabilité, et de la complémentarité des dettes privées et publiques, estimant que c'était une composante essentielle de l'endettement public que d'être une dette assumée par l'Etat au profit, et en leur lieu et place, des agents privés. Elle a également toujours indiqué que toute réduction du niveau de la dette publique supposait, toutes choses égales par ailleurs, que la sphère privée compense l'impact a priori défavorable de la « réépargne publique » en quoi elle consiste.
Ce dernier processus nécessite que des conditions particulières soient réunies qu'on peut résumer en invoquant la nécessité d'un changement des préférences des agents privés : ceux-ci doivent accepter de diminuer leur épargne ou (et) de réduire, au moins transitoirement, les gains attendus de leurs investissements. Réduire structurellement la dette publique c'est apporter un changement fondamental au régime de croissance et, comme tout changement, celui-ci ouvre des perspectives en partie indéterminées.
Pour certains théoriciens de la réduction de l'endettement public, ces enchaînements se produisent mécaniquement sous l'effet propre de sa diminution. Votre délégation a exposé maintes fois son scepticisme devant une telle approche et ce scepticisme a contribué à ce qui peut être vu comme une sorte de doctrine basée sur l'idée que l'ensemble des dimensions, financière, budgétaire et économique, d'une stratégie de désendettement public doivent être prises en compte simultanément, compte tenu de leurs interdépendances.
Sur le plan financier , la soutenabilité de la dette publique doit évidemment être une préoccupation. Mais, outre que cette notion est en mal d'un indicateur simple, sa portée opératoire est médiocre et peut receler certains dangers si elle conduit à négliger la question de la soutenabilité du désendettement public .
Les marges de manoeuvre budgétaires , que la réduction du niveau de la dette publique programmée à 2012 permettrait de regagner, illustrent certains de ces problèmes. Elles n'apparaissent supérieures aux coûts qu'elle peut impliquer que sous certaines conditions financières ou économiques particulières.
Sur le plan macroéconomique , enfin, la programmation des finances publiques conduit à examiner l' impact de court terme d'une stratégie de désendettement public mais aussi à s'interroger, plus structurellement , sur les enjeux économiques d'un renoncement de l'Etat à l'emprunt.
A ce propos, votre délégation peut rappeler avoir, dans le passé, constamment insisté sur la nécessité d'un accompagnement macroéconomique du désendettement de l'Etat , sauf à courir des risques économiques ou financiers élevés.
Pour être durable, une stratégie de réduction de la dette publique ne saurait être indifférente aux performances économiques qui en constituent à la fois le contexte et l'enjeu .
I. LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE : QUELLE COHÉRENCE DANS LE COURT TERME ?
La « stratégie » du gouvernement portant sur l'évolution des finances publiques à moyen terme traduit une volonté de consolidation budgétaire structurelle .
Le projet de loi de finances pour 2009 accentue dans cette direction les options choisies en 2008 . En outre, le projet de loi de programmation des finances publiques présenté conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 va dans ce sens » 53 ( * ) jusqu'à l'horizon 2012 .
La philosophie de la « stratégie nationale de finances publiques » est tout entière dans cette phrase empruntée à son dossier de présentation : « la crise économique mondiale affecte profondément l'évolution de nos finances publiques, en pesant sur les recettes. Mais l'objectif d'assainissement de nos comptes publics n'est pas remis en cause. Pour y parvenir, le Gouvernement exclut l'augmentation des prélèvements obligatoires. C'est sur la dépense que doit porter l'effort : le rythme de progression de l'ensemble de la dépense publique sera divisé dès 2008 par deux ».
Au total, le déficit de 2,7 points de PIB en 2008 et 2009, serait ramené à 0,5 point en 2012 .
|
PRINCIPAUX AGRÉGATS DE FINANCES PUBLIQUES DANS LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (en points de PIB) |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Capacité de financement des administrations publiques |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 1,2 |
- 0,5 |
|
État |
- 2,1 |
- 2,4 |
- 2,4 |
- 2,0 |
- 1,6 |
- 1,2 |
|
Organismes d'administration centrale |
- 0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Collectivités locales |
- 0,4 |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,1 |
0,0 |
|
Administrations de sécurité sociale |
- 0,1 |
0,0 |
- 0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
|
Taux de PO |
43,3 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
Taux de croissance de la dépense publique (*) |
2,5 % |
0,9 % |
- |
1,1 % |
-1,2% |
- |
* Déflaté par l'indice des prix à la consommation hors tabac. Le solde des administrations publiques peut différer de la somme des soldes des sous-secteurs du fait des arrondis (au plus 0,1 point).
Source : PLF 2009 - Les grandes orientations des finances publiques
Or, le choix d'un ajustement structurel continu ne saurait être recommandé que sous la condition que le contexte économique s'y prête et sous la réserve qu'il n'obère pas le projet d'une croissance potentielle structurellement plus élevée.
A. LE CHOIX D'UN AJUSTEMENT STRUCTUREL CONTINU...
L'objectif affiché est de réduire structurellement le déficit public . Le besoin de financement des administrations publiques resterait stable en début de période (- 2,7 points de PIB en 2009 comme en 2008) pour diminuer sensiblement chaque année après 2009, le poids dans le PIB du déficit public étant nominalement réduit de l'ordre de 0,7 point de PIB par an.
Ces objectifs traduisent la perspective d'un « effort structurel » amorcé dès 2008 qui s'amplifierait après pour représenter « plus de ½ point de PIB par an sur le quinquennat et ce dès 2008 » .
La séquence d'évolution des composantes structurelle et conjoncturelle du déficit public prévue par le Gouvernement serait la suivante :
|
DÉCOMPOSITION DE LA VARIANTE DU SOLDE PUBLIC ENTRE 2008 ET 2012 |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Solde public nominal |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 1,2 |
- 0,5 |
|
Variation du solde public nominal |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
|
Variation du solde conjoncturel |
- 0,5 |
- 0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
|
Variation du solde structurel |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Source : Rapport sur la programmation des finances publiques pour la période 2009 à 2012. MINEFE.
La programmation des finances publiques, présentée par le gouvernement pour la période 2008-2012, privilégie une politique budgétaire orientée vers la contraction du déficit public au détriment des choix alternatifs que représente, ou une politique budgétaire neutre, ou une politique budgétaire expansionniste .
L'encadré ci-après vise à rappeler les quelques notions à partir desquelles la politique budgétaire d'un pays est analysée.
|
MÉTHODES D'ANALYSE DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE L' analyse de la politique budgétaire consiste à distinguer les orientations choisies . A cette fin, différentes notions sont mobilisées :
Le critère d'appréciation de la composante discrétionnaire de la politique budgétaire est l'évolution de la partie structurelle du solde public dont la méthode d'estimation est explicitée ci-après. Les méthodes d'estimation du solde structurel et de l'effort structurel qui sont un peu différentes peuvent être résumées comme suit. I- Détermination du solde structurel Le solde des administrations publiques est affecté par la position de l'économie dans le cycle. On observe ainsi un déficit de recettes et un surplus de dépenses (notamment celles qui sont liées à l'indemnisation du chômage), qu'on peut juger transitoire, lorsque le PIB est inférieur à son niveau potentiel et, à l'inverse, un surplus de recettes et une diminution des dépenses, qu'on peut aussi qualifier de transitoire, lorsqu'il lui est supérieur. L'indicateur usuel de solde structurel vise à corriger le solde public effectif de ces fluctuations liées au cycle. La méthode d'évaluation du solde structurel consiste à calculer, en premier lieu, la partie conjoncturelle du solde public, c'est-à-dire celle qui s'explique par les écarts entre la conjoncture observée et les tendances « normales » de la croissance (celles qu'offre la croissance potentielle du pays 54 ( * ) ), selon une méthodologie largement commune aux organisations internationales. En pratique, ce calcul repose notamment sur l'hypothèse que les recettes conjoncturelles évoluent au même rythme que le PIB, et que les dépenses - à l'exception notable des allocations chômage - ne sont pas sensibles à la conjoncture. Le solde structurel est ensuite calculé comme un « résidu », par différence entre le solde effectif et sa partie conjoncturelle. Cet indicateur constitue une référence internationale pour l'appréciation de l'orientation des politiques budgétaires. Une fois les effets de la conjoncture éliminés, on retrouve dans les évolutions du solde structurel : - l'effet des variations de la dépense publique, mesuré par l'écart entre la progression de la dépense et la croissance potentielle : lorsque la dépense publique croît moins vite que la croissance potentielle, cela correspond bien, si les prélèvements obligatoires ne sont pas diminués d'autant, à une amélioration structurelle des comptes publics ; à l'inverse, si l'augmentation des dépenses publiques est plus rapide que la croissance potentielle, il y a toutes choses égales par ailleurs du côté des prélèvements obligatoires, une dégradation de la situation structurelle des comptes publics ; - les mesures nouvelles concernant les prélèvements obligatoires, pour lesquelles les mêmes appréciations peuvent être portées mutatis mutandis . II- L'effort structurel Cependant, à côté de ces facteurs effectivement représentatifs de l'orientation de la politique budgétaire, le solde structurel, tel qu'il est défini par les organisations internationales, en recouvre d'autres, sans doute moins pertinents : - Le solde structurel est affecté par des « effets d'élasticité » des recettes publiques. L'hypothèse, en pratique, d'élasticité unitaire des recettes au PIB 55 ( * ) , retenue dans le calcul du solde conjoncturel, n'est en effet valable qu'à moyen-long terme. À court terme en revanche, on observe des fluctuations importantes de cette élasticité. Pour l'Etat par exemple, l'amplitude de l'élasticité apparente des recettes fiscales est forte, du fait notamment de la variabilité de l'impôt sur les sociétés : l'élasticité des recettes fiscales nettes peut ainsi varier entre zéro et deux. Retenir l'hypothèse d'une élasticité unitaire, comme le font les organisations internationales, revient donc à répercuter entièrement en variations du solde structurel les fluctuations de l'élasticité des recettes, alors même que ces fluctuations s'expliquent largement par la position dans le cycle économique. L'interprétation des variations du solde structurel s'en trouve donc sensiblement brouillée. - D'autres facteurs peuvent également intervenir comme les variations des recettes hors prélèvements obligatoires (les recettes non fiscales de l'Etat, par exemple). Par construction, ces évolutions n'étant pas tenues pour conjoncturelles viennent affecter le solde structurel, ce qui n'est pas toujours fidèle à l'esprit qui préside à la distinction entre situations conjoncturelle et structurelle des comptes publics. Afin de s'en tenir aux facteurs dont la nature structurelle est le mieux établie, on peut donc retirer du solde structurel les effets d'élasticité et, par souci de simplicité, la variation des recettes hors prélèvements obligatoires. L'indicateur qui en résulte, que l'on peut qualifier d'« effort structurel » ou de « variation discrétionnaire du solde structurel » retrace les seuls effets combinés des variations des dépenses publiques et des mesures nouvelles de prélèvements obligatoires décidées par les pouvoirs publics. L'écart entre l'indicateur de variation du solde structurel et celui de l'effort structurel peut être important. Si l'évolution de la partie structurelle du solde public révèle les orientations de la politique budgétaire choisie par les autorités en charge de la politique budgétaire, l'évolution du solde total , qui peut en différer puisqu'elle est également tributaire de réactions spontanées des masses budgétaires, est déterminante pour identifier le sens de l'impulsion budgétaire sur la croissance économique. Elle peut être divisée en deux composantes :
Ces deux composantes correspondent à deux canaux différents de transmission budgétaire :
Les stabilisateurs automatiques sont, par nature, contracycliques . Par exemple, en cas de ralentissement économique, l'augmentation du déficit public, qui traduit un équilibre des relations entre l'Etat et les agents privés plus favorable à ceux-ci, leur apporte un revenu supplémentaire qui favorise théoriquement la constitution d'une demande plus forte de nature à compenser le ralentissement initial.
Pour apprécier l'impulsion budgétaire , qui représente l'effet sur les agents économiques des évolutions du solde public, il faut additionner ces deux composantes. Il existe alors trois configurations théoriquement possibles :
On observe que le sens de l'impulsion budgétaire peut différer de celui de la politique budgétaire discrétionnaire, comme le montre la programmation des finances publiques à l'horizon 2012 présentée par le gouvernement en septembre 2008. |
B. ... MANIFESTANT, MALGRÉ LES APPARENCES, UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE CHANGEANTE
La programmation décrit un effort continu d'ajustement structurel du déficit public avec une baisse du déficit structurel allant un peu au-delà des exigences du pacte de stabilité et de croissance européen (- 0,5 point de déficit structurel contre - 0,6 point dans la programmation).
Sous les apparences de la constance de l'effort budgétaire se cache une évolution de la composante économique de la politique budgétaire.
Les prévisions économiques servant de calage à la programmation des finances publiques décrivent une croissance de 1 % en 2008 et entre 1et 1,5 % en 2009, ce qui suppose une nette accélération de l'activité économique, mais situe les perspectives de croissance à court terme au-dessous du rythme de la croissance potentielle.
En conséquence, le déficit se creuserait, dans sa partie conjoncturelle, à hauteur de 0,5 point chaque année.
Les mesures prises pour contraindre l'évolution des dépenses publiques produiraient un effet inverse sur la composante structurelle du déficit public. Celle-ci se redresserait à 0,5 point en 2008 et même de 0,6 point en 2009.
Autrement dit, la politique budgétaire programmée pour 2008 et 2009 consisterait à effacer l'impact des stabilisateurs automatiques , donnant ainsi aux orientations choisies une tournure restrictive . Au total, l' impulsion économique donnée par la politique budgétaire serait presque neutre .
Au-delà de 2009, la politique budgétaire poursuivrait dans la voie de la réduction structurelle du déficit public : le déficit structurel serait réduit de 0,6 point par an entre 2010 et 2012. Mais, comme le scénario de croissance repose, à partir de 2010, sur l'hypothèse d'un rythme de croissance de 2,5 % l'an, supérieur à la croissance potentielle de l'économie française, le sens de la politique budgétaire et son interprétation économique changent alors .
A partir de 2010, la composante conjoncturelle du déficit public, allant dans le même sens que la politique budgétaire discrétionnaire, entraînerait une réduction du déficit nominal de 0,1 point (en 2010 et 2012) et de 0,2 point en 2011.
Dans la partie proprement prospective de la programmation à moyen terme (entre 2010 et 2012), il est ainsi prévu d'accentuer l'effet des stabilisateurs automatiques , qui joueraient alors dans un sens restrictif, par une politique budgétaire discrétionnaire franchement contracyclique .
Le fait que la politique budgétaire discrétionnaire prévue soit continûment orientée vers un objectif d'équilibre structurel des comptes publics, indique qu'elle serait définie indépendamment de toute considération des évolutions de la conjoncture économique .
Ainsi, pour les années 2008 et 2009 , la politique budgétaire discrétionnaire renforcerait le ralentissement économique en compensant le soutien résultant du creusement spontané du déficit en lien avec celui-ci. En bref, la politique budgétaire serait alors utilisée dans un sens procyclique .
Au-delà, sous l'importante réserve que les performances économiques réelles soient conformes aux prévisions, la politique budgétaire, qui suivrait les mêmes principes, deviendrait contracyclique .
II. UN OBJECTIF SUSPENDU À UNE REPRISE ÉCONOMIQUE HYPOTHÉTIQUE
Le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques décrit une trajectoire dont la cohérence avec son contexte économique doit être envisagée .
Le cadrage économique de la programmation pour la période 2010-2012 repose sur l'hypothèse d'une croissance économique spontanée qu'on peut juger particulièrement forte :
• elle serait
supérieure au rythme de
croissance
potentielle de l'économie française,
même si on accepte l'hypothèse favorable
posée
en ce domaine
;
• surtout, elle se déroulerait malgré
la
consolidation budgétaire programmée
.
La programmation des finances publiques est ainsi tributaire de conditions économiques dont il est difficile de mesurer la probabilité. Relevons toutefois que celle-ci est évidemment susceptible d'être affectée par les prolongements de la crise économique actuelle .
En outre, elle traduit une vision où une politique budgétaire de contraction des dépenses publiques et du déficit ne pose problème, ni pour la croissance effective, ni pour la croissance potentielle :
• l'élévation de la croissance
potentielle dépendrait de conditions structurelles et non des politiques
macroéconomiques. Celle-ci représente pour elles une contrainte
subie plus qu'une cible à atteindre.
• les contractions budgétaires n'affecteraient
pas la croissance observée.
A. UNE PROGRAMMATION REMISE EN CAUSE PAR LES INCIDENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE EN COURS
Le « scénario de crise » imaginé par votre délégation présente des enchaînements assez proches de ceux désormais envisagés en prolongeant, en outre, la réflexion jusqu'à 2013.
La crise financière pourrait aboutir à une croissance moins favorable que celle qui est escomptée pour 2008 et, surtout, pour 2009 57 ( * ) , dont les conditions de réalisation apparaissent déjà très tendues (voir le chapitre I du présent rapport et le document de travail des Études économiques n° 2, d'octobre 2008, intitulé « La croissance du PIB : une mesure à déchiffrer »).
Il n'est pas exclu que la croissance économique connaisse un creux marqué en 2009 et ne se redresse que progressivement au-delà. Dans une telle perspective, l'évolution spontanée des déficits publics serait modifiée. En outre, un contexte économique moins favorable que celui décrit dans la programmation à l'horizon 2012, imposerait une réflexion sur le sens à imprimer à la politique budgétaire.
1. La révision de croissance de la Commission européenne
Dans ses récentes prévisions pour les années 2008 à 2010, la Commission européenne imagine pour la France une croissance beaucoup moins forte que dans la programmation ainsi que ses incidences sur la position budgétaire.
COMPARAISON ENTRE LES PRÉVISIONS DE CROISSANCE
ET DE SITUATION BUDGÉTAIRE
DE LA COMMISSION ET DE LA PROGRAMMATION
FRANÇAISE (2007-2010)
(en points de PIB)
|
A - Programmation |
B - Commission |
Écart A-B |
||||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Croissance |
2,2 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,2 |
0,9 |
0 |
0,8 |
0 |
+ 0,1 |
+ 1,0 |
+ 1,7 |
|
Déficit public |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 2,7 |
- 3,0 |
- 3,5 |
- 3,8 |
0 |
- 0,3 |
- 0,8 |
- 1,8 |
|
Variation du déficit structurel |
NS |
- 0,5 |
- 0,6 |
- 0,6 |
NS |
+ 0,1 |
- 0,3 |
0 |
NS |
+ 0,6 |
+ 0,3 |
+ 0,6 |
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
65,4 |
67,7 |
69,9 |
0 |
- 0,1 |
- 1,7 |
- 4,6 |
Le scénario macroéconomique de la Commission retrace une crise économique plus forte et plus durable que celle imaginée jusqu'à présent par le Gouvernement. La croissance serait nulle en moyenne en 2009 et repartirait en 2010 mais progressivement.
Encore cette prévision est-elle tributaire d'une politique budgétaire plus active et contracyclique que dans la programmation gouvernementale . Le solde public se dégraderait pour atteindre - 3,8 points de PIB en 2010. L'impulsion budgétaire soutiendrait la croissance à hauteur de 0,5 point de PIB en 2009 et 0,3 point de PIB en 2010. Autrement dit, la croissance spontanée, c'est-à-dire celle qui serait atteinte dans l'hypothèse d'un strict maintien du solde un niveau de départ, ne serait que de 0,5 % en 2010 alors qu'en 2009, une décroissance interviendrait (- 0,5 %).
Il faut relever que le soutien budgétaire de l'activité économique résulterait pour la Commission du seul jeu des stabilisateurs automatiques. La politique budgétaire discrétionnaire serait à peu près neutre au cours de la période. Le solde structurel ne serait amélioré que de 0,2 point de PIB entre 2008 et 2010.
Cette stabilité du solde structurel contraste avec l'amélioration programmée par le Gouvernement qui atteint 1,7 point de PIB. Les prévisions de la Commission indiquent implicitement que si la politique budgétaire décrite par la programmation devait être mise en oeuvre, la croissance économique suivrait en France approximativement le cheminement suivant : + 0,3 % en 2008, - 0,3 % en 2009 et + 0,2 % en 2010, soit un rythme nettement plus faible que celui décrit dans la programmation.
On peut à ce propos rappeler que les orientations budgétaires retenues dans le projet de loi de programmation s'inspirent étroitement des obligations imposées aux Etats par le pacte de stabilité et de croissance.
Ce diagnostic de la Commission européenne , qui est, pourtant, l'un des gardiens les plus vigilants de la « discipline budgétaire » en Europe, comporte ainsi une condamnation implicite de ses règles, sauf à imaginer que la Commission préfère l'ajustement des finances publiques à la croissance économique .
2. Un « scénario de crise »
Pour sa part, votre délégation a demandé à l'OFCE de construire un scénario assez analogue à celui de la Commission européenne mais prolongé à l'horizon 2013. Dans ce « scénario de crise », la France ne rejoindrait une trajectoire de croissance proche de son potentiel qu'à partir de 2011 . Au début de la période de projection (2008-2010), la croissance économique serait faible (1 %, 0,5 % et 1 % en 2008, 2009 et 2010 respectivement).
PROJECTIONS 2008-2013
(en points de PIB)
|
SCÉNARIO HAUT |
SCÉNARIO DE CRISE |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Croissance |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Dépenses publiques |
52,5 |
52,7 |
52,0 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
|
Taux des prélève-ments obligatoires |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
Déficit public |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 1,2 |
- 0,5 |
+ 0,1 |
- 2,7 |
- 3,5 |
- 4,0 |
- 3,5 |
- 3,0 |
- 2,5 |
|
Dette publique |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
Source : OFCE pour la délégation du Sénat pour la planification.
Dans l'hypothèse d'une reprise différée et moins forte de la croissance économique, et sous la condition d'une dynamique seulement légèrement plus forte des dépenses publiques, le déficit public se creuserait en 2009 et 2010 pour se réduire au-delà, mais dans une plus faible proportion .
Le déficit public atteindrait 3 points de PIB en 2012 et 2,5 points de PIB en 2013 contre 0,5 point de PIB et un excédent de 0,1 point de PIB dans le scénario haut.
L' augmentation du déficit public constaté en début de période serait la principale responsable du niveau de déficit observé en fin de projection .
Dans le « scénario de crise », entre le point haut du déficit public de 2010 (- 4 points de PIB) et 2013, le déficit rétrograderait de 1,5 point de PIB soit une variation à comparer à la réduction des 2,1 points de PIB observée dans le « scénario haut » au cours de la même période.
Il correspondrait à la combinaison des effets d'une croissance plus lente et d'une politique budgétaire structurelle moins rigoureuse. Dans le « scénario de crise », l'impulsion budgétaire est deux fois moins forte que dans la programmation décrite dans le « scénario haut ». La politique budgétaire représente ainsi un risque pour la croissance qui est atténué (ce qui est justifié par les circonstances économiques).
Mais, cette politique budgétaire plus accommodante et le choc de croissance subi en début de période n'empêcheraient pas de retrouver une trajectoire de réduction du déficit public. Ils ne feraient que retarder l'ajustement budgétaire .
De son côté, le creusement initial du déficit public permettrait d'éviter un choc de croissance plus important et les déficits, récurrents, qui en résulteraient .
B. VERS UNE CROISSANCE POTENTIELLE PLUS FORTE ?
Le scénario macroéconomique associé à la stratégie des finances publiques s'inscrit dans un contexte d'élévation du rythme de la croissance potentielle de l'économie française.
Il s'agit d'une hypothèse qui rompt avec les perspectives jusqu'à présent disponibles et les plus couramment partagées.
Cette hypothèse est, en outre, posée dans le cadre d'une politique budgétaire de consolidation . Elle ne repose nullement sur les effets d'entraînements qu'une politique budgétaire expansionniste peut produire sur la croissance effective et, partant sur la croissance potentielle.
Au contraire, la programmation budgétaire suppose une impulsion budgétaire négative pour la croissance à court terme.
On rappelle que la croissance potentielle d'une économie représente la limite supérieure du rythme de croissance qu'elle peut atteindre sans inflation compte tenu des perspectives de sa population active et des gains de productivité qu'elle réalise.
Le concept de croissance potentielle a de multiples usages mais celui qui nous occupe ici renvoie à sa fonction de contrôle de vraisemblance des perspectives de croissance effective associées au projet de loi de programmation des finances publiques 58 ( * ) . Quant aux effets des politiques de consolidation budgétaire sur la croissance potentielle, ils seront abordés dans le titre III du présent chapitre.
Dans celui-ci, la croissance évoluerait au rythme de 2,5 % par an en moyenne entre 2010 et 2012.
La crédibilité de la prévision de croissance servant de base à la programmation des finances publiques dépend de l'exactitude du pronostic effectué quant à la croissance potentielle.
Si, en effet, la croissance potentielle devait s'élever au rythme anticipé, la croissance effective attendue en projection gagnerait en vraisemblance d'autant qu'un retard de croissance, accumulé en 2008 et 2009 devrait être rattrapé.
Si, en revanche, l'estimation de la croissance potentielle devait être sensiblement inférieure au rythme de croissance prévue (et donc plus basse que la toute dernière prévision de la DGTPE), le scénario macroéconomique servant de toile de fond à la programmation des finances publiques témoignerait d'attentes pour les moins optimistes.
Dans l'argumentaire du projet de loi, la croissance potentielle atteindrait un rythme annuel de l'ordre de 2,3 % entre 2008 et 2012. Cette dernière estimation, qui table sur une élévation régulière du potentiel de croissance économique jusqu'à 2,5 % en 2012, excède les estimations généralement produites , y compris celles émanant jusque là de la Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) du MINEFE.
Or, celles-ci étaient déjà sensiblement supérieures aux estimations précédentes , réalisées avant les nouvelles projections démographiques de l'INSEE de juillet 2006 que votre délégation vous avait exposées en détail 59 ( * ) .
Avant celles-ci, la croissance potentielle pour 2008-2012 était estimée à 1,7 %.
LA CROISSANCE POTENTIELLE 2008-2015
|
Nouvelle projection |
Ancienne projection 1 |
|
|
Croissance potentielle |
2,1 |
1,7 |
|
Contribution du travail |
0,1 |
- 0,1 |
|
Contribution du capital |
0,8 |
0,6 |
|
Productivité globale des facteurs |
1,2 |
1,2 |
1 Antérieure à l'actualisation des projections démographiques par l'INSEE.
Source : DGTPE
La révision intervenue alors aboutit à réestimer de 0,4 point par an la croissance économique potentielle pour la situer à 2,1 % . Dans un contexte où les perspectives de gains de productivité étaient inchangées (+ 1,2 % l'an), cette révision était venue d'hypothèses concernant la démographie.
Elles tenaient principalement à l'évolution de la population active, se référant aux effets de la réforme des retraites de 2003 sur le taux d'activité des seniors et à une augmentation du solde migratoire net (projeté à 100.000 par an au lieu de 50.000 60 ( * ) ).
Il existe une incertitude sur ces deux variables notamment attachée à l'employabilité réelle des cohortes démographiques en question et aux incidences de leur insertion dans le marché du travail sur les gains de productivité.
Pour certains, l'augmentation du taux d'emploi de personnes jusqu'alors exclues du marché du travail devrait se traduire par une baisse des gains de productivité. Il est pour eux contestable de cumuler les effets démographiques et le maintien de gains de productivité inchangés, comme ce fut le cas lors de la révision des estimations de croissance potentielle de 2006.
Pour d'autres, l'augmentation du taux d'emploi devrait, au contraire, pousser les gains de productivité à la hausse. Elle suppose, en effet, qu'un meilleur appariement entre qualifications et emplois intervienne. L'argument consiste à estimer que, dans une conjoncture de chômage élevé, des emplois peu qualifiés sont occupés par des individus disposant d'une formation supérieure aux postes qu'ils occupent. Une sorte de gaspillage du capital humain se produit que la résorption du chômage tend à réduire. Il faudrait alors réviser les gains de productivité du travail à la hausse à mesure que le chômage diminue.
Cette controverse, qui porte sur les effets d'entraînement d'une croissance effective forte sur la croissance potentielle , n'est pas un débat mineur ou purement académique. D'autres processus que celui ici décrit, qui porte sur l'équilibre du marché du travail, peuvent conduire à imaginer qu'un lien positif existe entre le rythme de la croissance et le niveau du taux de croissance potentielle. Qu'on songe, en particulier, aux effets associés à une croissance effective forte sur l'investissement. Ce lien conduit à considérer avec sérieux les effets des politiques macroéconomiques sur la croissance effective et sur la croissance potentielle. Il suggère de considérer que celle-ci n'est pas uniquement une contrainte pour les politiques économiques - qui, alors, devraient se limiter à en prendre acte - mais aussi un objectif possible de celles-ci (voir le III du présent chapitre).
Alors que la précédente révision de la croissance potentielle provenait de facteurs démographiques, celle qui soutient la programmation est attribuée à d'autres facteurs structurels. Une incertitude existe quant à cette nouvelle révision dont la justification repose sur les effets de la loi de modernisation de l'économie et du crédit d'impôt-recherche, invoqués pour expliquer pourquoi la croissance potentielle rejoindrait un rythme proche de 2,5 % en 2012 (contre 2,1 %).
Ces mesures, par leur nature même, ont des incidences un peu aléatoires et surtout retardées.
Mais, quoi qu'il en soit, il faut relever l'ampleur particulière des révisions de croissance potentielle effectuées ces dernières années.
*
* *
Au total , par rapport à 2006 , les prévisions de croissance potentielle auront été relevées de 0,6 point soit près d'un tiers de plus que leur état initial (1,7 %) .
Sans doute faut-il observer que ces révisions ne viennent que très marginalement d'une hypothèse sur l'accélération des gains de productivité ce qui réduit les aléas. Mais il faut également souligner qu'elles ne prennent pas en considération les perspectives, pourtant fondamentales pour l'avenir, d'une hausse structurelle du coût des matières premières dans un contexte de croissance mondiale soutenue, et qu'elles s'inscrivent dans un contexte de réduction structurelle de l'intervention publique qui pourrait avoir des effets défavorables, du moins selon certains points de vue.
En toute hypothèse, il vaut d'être souligné que l'accélération de la croissance économique potentielle est une condition forte de plausibilité du scénario économique ici évalué .
C. VERS UNE NETTE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SPONTANÉE ?
La croissance économique effective décrite dépasserait encore le rythme de la croissance potentielle, et ce en dépit d'une politique budgétaire qui exercerait des effets restrictifs sur l'activité économique .
L'impulsion économique donnée par la politique budgétaire , orientée vers un effort de réépargne des administrations publiques , freinerait a priori la croissance, de 0,6 point de PIB, par an .
Autrement dit, compte tenu de la politique budgétaire programmée, il faudrait pour suivre les rythmes de croissance annoncés que la croissance économique spontanée se redresse par rapport à l'existant et tende vers une croissance en volume de l'ordre de 3,1 %.
Il faudrait donc que les comportements spontanés des agents privés soient particulièrement dynamiques pour compenser l'impulsion budgétaire qui serait, quant à elle, défavorable à la croissance 61 ( * ) .
La probabilité que de tels scénarios se produisent peut sembler assez faible.
• Les statistiques montrent que depuis 1979, soit sur
29 ans, le taux de croissance effectif n'a excédé 3 % que
six années, et 4 % que deux années. Encore s'agissait-il
d'
épisodes où la politique budgétaire avait
été plutôt neutre
.
• D'un point de vue plus
économique
, u
ne telle perspective n'est envisageable,
toutes choses égales par ailleurs
62
(
*
)
, que si la réépargne publique devait
être compensée par un processus de désépargne
privée
(voir le chapitre II de la première partie
du présent rapport).
Or, le moins qu'on puisse dire est que cette perspective, évidemment très improbable à court terme compte tenu de la crise en cours, n'a qu'une faible vraisemblance à moyen terme et n'est sans doute pas un objectif souhaitable de politique économique comme les quelques propos, qui vont désormais être consacrés à la problématique de l'endettement public, s'efforcent de le montrer.
III. VERS UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA DETTE PUBLIQUE ?
La programmation financière pour 2012 dessine une trajectoire de baisse continue et prononcée de la dette publique, au moyen d'une élévation structurelle du taux d'autofinancement des administrations publiques .
Cette orientation manifeste un choix financier , dont l'équilibre est incertain.
Ses effets économiques peuvent être appréciés diversement selon les enchaînements qui pourraient l'accompagner, enchaînements qui ne sont pas indifférents aux mesures économiques qui pourraient accompagner la stratégie de désendettement public.
A. UNE RÉDUCTION DU POIDS DE L'ENDETTEMENT PUBLIC RÉSULTANT D'UNE HAUSSE DE L'AUTOFINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
1. La perspective d'une réduction structurelle de la dette publique
Dans la programmation pluriannuelle des finances publiques , le poids de la dette publique dans le PIB recule continûment sous l'effet d'une « amélioration » structurelle du solde public. C'est la réduction des dépenses publiques, qui en constitue le support principal. Elle est entièrement consacrée au désendettement des administrations publiques , qui est donc l'objectif essentiel de la politique budgétaire .
Le ratio dette publique/PIB, qui, avec 65,3 % prévu en 2008, excède le plafond européen de 60 %, diminue de 3,5 points de PIB pour rejoindre 61,8 % du PIB en 2012 63 ( * ) .
Après une augmentation en 2009 (+ 0,7 point de PIB), le recul s'amorce et s'amplifie.
Le niveau relatif de la dette publique est ainsi allégé de 5,4 %, soit un objectif moins ambitieux que dans la programmation précédente où le recul s'élevait, même dans le « scénario bas » de croissance économique, alors imaginé à 10 % .

Ces résultats proviennent de ce que le solde public atteint un niveau stabilisant la dette publique à partir de 2010 et « s'améliore » continûment pour, combiné avec une hausse en accélération du PIB (dénominateur du ratio), provoquer une diminution du rapport de la dette publique au PIB allant en s'amplifiant.
En revanche, le rapport économique, social et financier relève que la trajectoire qu'il décrit n'est pas dépendante de cessions nettes d'actifs publics qui n'interviendraient que si les conditions de marché le permettaient .
La réduction du poids de la dette publique dans le PIB décrite dans la programmation proviendrait, principalement, d'un ajustement structurel du déficit public, la composante conjoncturelle de la variation du besoin de financement public étant présentée comme marginale et d'effet contraire (+ 0,1 point de dette supplémentaire de 2009 à 2012, en cumulé). Elle pourrait donc être vue comme structurelle.
2. Une trajectoire entourée d'incertitudes dès son départ
Outre les questions de fond que pose le déroulement du scénario de dette publique dans la phase de la programmation correspondant à sa période de projection (2010-2012), des incertitudes entourent son point de départ. Elles sont liées aux effets de la crise en cours et à la cohérence formelle de l'évolution des comptes publics anticipée.
Sur les effets de la crise en cours, deux enchaînements pourraient conduire à une dégradation plus prononcée de la dette publique en début de période.
a) Les interventions anti-crise financière
Il s'agit, tout d'abord, de l' effet des garanties publiques mises en oeuvre pour piloter la crise des établissements de crédit.
On a indiqué que le rapport économique, social et financier décrivait une trajectoire de la dette sans prise en compte d'éventuelles cessions d'actifs publics. On doit, aussi, relever que le rapport n'évoquait pas la perspective d'acquisitions nettes d'actifs .
Or, depuis, une loi de finances rectificative pour le financement de l'économie a été adoptée qui prévoit des interventions (garanties des apports en capital) susceptibles 64 ( * ) d'impacter la dette publique dans des proportions considérables, même si quelques doutes existent encore sur le traitement comptable des opérations financières prévues par cette loi.
Deux sociétés destinées, l'une - la société de prises de participation de l'Etat (SPPE) - à recapitaliser les banques , dans la limite d'un plafond de 40 milliards d'euros, l'autre - la société de refinancement - à apporter des ressources temporaires aux établissements de crédit dans la limite de 320 milliards d'euros, ont été créées.
Au total, les garanties publiques mises en place représentent une dette potentielle de 360 milliards d'euros, soit environ 18 points de PIB de dette publique supplémentaire, en puissance.
b) Quelles évolutions budgétaires à court terme ?
Le second enchaînement associé à la crise en cours et susceptible d'alourdir le poids de la dette publique au début de la programmation réside dans les effets de la crise sur les déficits publics , entre 2008 et 2009 du moins. Le ralentissement économique, plus prononcé que prévu, ainsi que d'éventuelles révisions à la baisse des recettes non fiscales pourraient conduire à un creusement du déficit. Celui-ci, combiné avec une croissance du PIB inférieure aux prévisions, se traduirait par une augmentation du ratio dette publique/PIB plus importante que celle prévue.
Ces incertitudes peuvent être illustrées par la confrontation des résultats associés à deux scénarios macroéconomiques, le premier conforme à la programmation à 2012, le second, « de crise », où la croissance économique subirait plus durablement le contrecoup de la crise en cours.
|
ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE DANS DEUX SCÉNARIOS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE À L'HORIZON 2013 (en points de PIB) |
|||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Variation
|
|
|
Scénario haut |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
- 6,2 |
|
« Scénario de crise » |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
+ 5,4 |
|
Écart |
0 |
+ 1,2 |
+ 4,1 |
+ 6,5 |
+ 9,0 |
+ 11,6 |
- |
Dans le « scénario de crise », le ressaut subi par le déficit public en début de période entraîne un supplément de dette publique de 4,1 points de PIB en 2010. Au-delà, le niveau de l'endettement public continue à croître mais à un rythme qui se ralentit de plus en plus à mesure que le déficit public se rapproche du niveau qui stabilise le poids de la dette publique dans le PIB.
Dans le scénario de sortie de crise plus lente, la dette publique est plus élevée de 5,4 points au terme de la projection qu'à son début et de 11,6 points par rapport à la programmation présentée par le gouvernement.
c) Un ajustement vraiment structurel ?
S'agissant de la cohérence formelle de la programmation de la dette publique, deux questions doivent être posées :
•
la première concerne le
caractère structurel de l'ajustement
. Celui-ci dépend du
point de vue adopté sur la croissance potentielle de l'économie
française. Plus la croissance décrite dans une programmation est
proche de l'estimation de croissance potentielle, plus l'écart entre la
croissance des dépenses publiques et la croissance économique est
attribuable à un effort structurel (et non à ces circonstances
conjoncturelles).
Autrement dit, si l'on suppose que la croissance potentielle de l'économie française - que la programmation estime à 2,3 % en moyenne annuelle, entre 2010 et 2012 - n'était que de 1,8 %, on devrait réviser à la baisse la composante structurelle de la réduction du déficit public et ainsi de la dette publique. En effet, dans ce cas, le différentiel d'évolution entre les dépenses publiques (+ 1,1 %) et la croissance (+ 2,5 %) serait attribuable moitié-moitié à des circonstances conjoncturelles et à un effort structurel.
•
la seconde question
concerne le
profil temporel de la trajectoire de la dette publique
. S'il
est vraisemblable que celle-ci subisse une augmentation plus prononcée
que prévu en début de période, il serait aussi plus
cohérent avec les perspectives de croissance retenues dans la
programmation (soit une croissance de 2,5 % en moyenne annuelle entre 2010
et 2012) qu'elle décline davantage que ce qui est décrit en fin
de période
65
(
*
)
. Il
faut cependant réserver l'hypothèse qui n'est pas
écartée par le rapport joint au projet de loi de programmation
des finances publiques que les éventuelles plus-values fiscales alors
constatées soient « rendues » aux contribuables et
non affectées à la réduction de la dette publique.
B. UNE RÉDUCTION DE LA DETTE PUBLIQUE À L'IMPACT BUDGÉTAIRE INCERTAIN
Un peu en marge des approches les plus optimistes qu'inspire l'objectif d'une réduction drastique de la dette publique, votre Délégation a constamment alerté sur quelques limites des raisonnements à la base de cet objectif.
La politique financière de l'Etat ne peut être conduite sans considération de son contexte économique et financier.
Les risques macroéconomiques d'une réduction de la dette publique à marche forcée, sans réaménagement des conditions du partage de la valeur ajoutée, déjà importants en temps normal, ressortent comme encore plus forts dans le contexte ouvert par la crise économique en cours.
La réduction de la dette publique que décrit la programmation dégage des marges de manoeuvre financières qui, au regard des conditions présentes de financement de la dette publique et des risques macroéconomiques associés à une augmentation de l'épargne des administrations publiques, n'établissent pas clairement l'intérêt de poursuivre un tel objectif.
Le bilan coût-avantages de la stratégie de désendettement est cependant susceptible de varier considérablement en cas de tensions sur les conditions financières et selon les enchaînements macroéconomiques qu'on lui associe.
Sa justification principale semble provenir d'une volonté de provisionnement destinée à assurer la soutenabilité à long terme des comptes publics conformément aux recommandations européennes résultant de la prise en compte des perspectives à long terme de la dette publique.
Les marges de manoeuvre financière résultant de la réduction de la dette publique apparaissent faibles au regard des risques financiers encourus à court terme .
La réduction de la dette publique décrite dans la programmation pluriannuelle s'élèverait à 5,4 % du niveau initial de la dette. Un tel allègement est susceptible de procurer une économie de charges d'intérêt de 0,12 point de PIB par an au terme de la projection, mais pourrait coûter a priori 2,2 points de croissance (qui correspondent au cumul des effets négatifs sur l'activité économique que pourrait receler l'impulsion budgétaire liée à la réduction du déficit public) soit, compte tenu du taux de prélèvements obligatoires de 43,3 %, 0,95 point de PIB de recettes fiscales.
Cette arithmétique déplaisante n'apparaît pas dans la programmation des finances publiques puisque, dans le scénario macroéconomique qui lui est associé, la baisse du déficit public ne pèse pas sur l'activité. Les agents privés l'absorbent et seul est affiché le gain de la réduction du besoin de financement public.
Il faut toutefois observer en toute rigueur que le gain ainsi décrit serait réservé aux administrations publiques, puisque, dans une telle hypothèse, sauf modification des conditions du partage de la valeur ajoutée, les agents privés prennent le relais de l'endettement, ce qui alourdit leurs charges financières (ou diminue leurs gains financiers) .
Au total, l'équilibre financier d'une réduction de la dette publique de 5,4 %, aux conditions actuelles du coût de la dette et de prélèvements obligatoires, suppose que l'ajustement budgétaire n'obère pas la croissance économique de plus de 0,25 point de PIB. Or, un objectif de réduction de la dette publique de l'ordre de 5,4 % nécessite, s'il est recherché via une augmentation structurelle de la capacité de financement des administrations publiques, une impulsion budgétaire négative qui est susceptible de peser sur la croissance économique bien au-delà de ce seuil .
C. CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES SUR L'OBJECTIF DE RÉDUCTION DE DETTE PUBLIQUE
Les ordres de grandeur précédemment exposés pourraient différer si une tension sur le coût de la dette se produisait . Elle rendrait plus « rentable » la réduction de la dette. Mais, comme elle n'épargnerait pas les agents privés, elle compliquerait aussi les conditions d'un ajustement budgétaire économiquement indolore.
En outre, les effets du désendettement public sont susceptibles d'appréciations nettement contrastées selon les enchaînements macroéconomiques qu'on lui associe .
Le bilan coûts-avantages de la stratégie de désendettement public ne dépend évidemment pas que du contexte monétaire et financier. Des variables économiques conditionnent ses prolongements.
Si le secteur privé prend le relais de l'endettement public, les risques sur la croissance à court terme sont conjurés.
Reste posée la question de la justification économique d'une politique programmant le renoncement, au moins partiel, des administrations publiques à l'appel public à l'épargne.
La question de l'impact à court terme des politiques de désendettement public peut être traitée séparément de celle de la justification plus structurelle d'un plus faible niveau de dette publique.
1. Éviter d'aggraver le ralentissement économique
S'agissant de l' effet économique de court terme d'une réduction de la dette publique , on a maintes fois indiqué qu'en dépit des théories qui veulent en démontrer l'innocuité, les exemples concrets de réussite sont en ce domaine peu nombreux et peu probants.
Ainsi, dans les études les plus systématiques consacrées à la vérification empirique de ces théories, on ne relève, sur 496 observations, que 86 épisodes de consolidation budgétaire pour 37 réussites seulement.
En outre, les épisodes où après une consolidation budgétaire la dette publique a durablement reculé semblent avoir été accompagnés de circonstances économiques comportant des facteurs favorables indépendants de l'ajustement budgétaire et non reproductibles.
Ainsi, les théories où la diminution de la dette publique produit ipso facto une amélioration de la demande des agents privés (théorème d'équivalence de Ricardo-Barro), du fait d'une réduction de l'épargne constituée par eux dans la perspective des futurs prélèvements nécessaires à la baisse de l'endettement public ne semblent que très occasionnellement validés empiriquement.
Dans les faits, la réépargne publique à quoi il faut assimiler la réduction de la dette publique entraîne toujours une contraction du revenu des agents sans que la perspective d'une éventuelle réduction des prélèvements obligatoires destinés à financer la dette ne produise, en soi, une baisse de leur épargne suffisante pour compenser les effets de la contraction de leur revenu sur leur demande et, finalement, sur la croissance économique 66 ( * ) .
On ne peut imaginer qu'une façon d'échapper à cette perspective : qu'intervienne une réduction exogène de l'épargne nette des agents privés . Un tel enchaînement ne pourrait intervenir que si se produisait une modification des préférences des agents.
Mais, outre qu'un tel changement devrait être assez immédiat pour contrecarrer l'effet récessif de la contraction budgétaire, du moins dans une perspective de court-moyen terme, ses conditions sont difficilement maîtrisables.
Il faudrait, en effet :
• soit que les agents acceptent de s'endetter
à la place de l'Etat ;
• soit qu'un autre partage de la valeur
ajoutée se mette en place offrant un équilibre de l'offre et de
la demande plus dynamique que le précédent.
La première condition apparaît pour le moins peu réaliste dans le contexte de crise probablement durable de l'endettement privé.
La seconde condition est au coeur des enjeux de la refondation du système financier international puisqu'elle suppose que les entreprises acceptent de distribuer des salaires supérieurs, concédant ainsi, transitoirement au moins, une baisse du taux de profit . Encore faut-il s'assurer que cette autre configuration ne produise pas d'effets défavorables sur la croissance économique à moyen terme, ce qui serait le cas si elle devait s'accompagner d'une baisse du taux d'investissement.
D' autres arguments, plus concrets, sont fournis à l'appui d'une réduction du niveau de la dette publique , sans entraîner davantage une adhésion systématique :
• son impact favorable en termes
d'
assouplissement des conditions de financement
(baisses des
taux d'intérêt) ;
• l'atténuation d'un effet d'éviction
qu'engendreraient les emprunteurs souverains à l'encontre des agents
privés
Comme votre délégation l'avait rappelé dans son rapport consacré au moyen terme, ces points de vue semblent manquer un peu de réalisme ou, du moins, de nuances :
- la sensibilité des conditions financières aux variations de la dette publique n'a nullement le sens automatique décrit par la théorie ; l'augmentation de la dette publique peut être sans effet sur les conditions financières, voire même (v. infra ) s'accompagner de conditions financières à la fois plus accommodantes et plus stables ;
- par ailleurs, le contexte économique actuel ne semble pas caractérisé par une quelconque insuffisance d'épargne . A ce propos, votre délégation observait que : « l'augmentation des dettes publiques n'a pas tari la très (trop) forte progression des dettes privées observée ces dernières années ; en particulier, elle n'a pas entraîné de tensions sur les taux d'intérêt. Au contraire, quand de telles tensions sont intervenues sur les marchés, une réorientation de l'épargne vers les titres publics est intervenue avec pour effet une détente des conditions de financement de l'endettement public . » ;
- enfin, à ce propos, comment ne pas souligner le rôle joué par les titres de la dette publique dans la stabilisation des conditions de financement des économies au cours de la crise actuelle ?
2. Ne pas sacrifier l'objectif d'élévation du rythme de la croissance potentielle
Un risque de court terme de réduction de l'activité est associé à la réduction de la dette publique. Ce risque en entraîne un second : que la contraction de la croissance à court terme se répercute sur la croissance potentielle .
L'inflexion de l'investissement, la montée du chômage sont autant d'occasions perdues de croissance susceptibles de peser durablement sur les performances économiques d'un pays. La baisse du taux d'investissement a des effets durables sur l'activité. La montée du chômage risque de s'accompagner de pertes irrémédiables de « capital humain ».
C'est l'un des fondements essentiels des politiques budgétaires contracycliques que d'éviter ces effets baptisés « d'effets d'hystérèse » par les économistes.
Ces conditions de court terme de succès d'une stratégie de désendettement public sont aussi des conditions plus structurelles . Mais, on doit ajouter une réflexion de fond sur la justification d'un objectif de renoncement de l'Etat à la dette , ou du moins d'une réduction très forte du niveau de celle-ci.
Les consolidations budgétaires empruntant la voie d'une réduction des dépenses publiques pour baisser le niveau relatif de la dette publique supposent que les dépenses publiques concernées ne conditionnent ni la croissance effective ni le potentiel de croissance économique ou soient moins efficaces que d'éventuelles dépenses privées qu'elles évinceraient.
On a indiqué précédemment que l'effet d'éviction exercé par les dépenses publiques était incertain, surtout d'ailleurs quand les dépenses publiques sont financées par la dette.
Les risques de court terme d'une réduction de la dette publique pour la croissance ont également été évoqués.
S'agissant des effets d'une consolidation budgétaire par réduction des dépenses publiques sur la croissance potentielle , il faut distinguer deux hypothèses.
Si l'on imagine que la réduction des dépenses publiques réduit la croissance potentielle, il faut alors en conclure que la baisse de la dette publique, constatée à l'instant où elle se produit, sera « rongée » structurellement parce que le sentier de croissance est affecté à la baisse pour la stratégie budgétaire. La question est de savoir dans quelles proportions la croissance potentielle est réduite.
Au contraire, si on considère que les dépenses publiques peuvent être réduites sans effets défavorables sur la croissance potentielle, il faut diminuer structurellement la dette publique. Dans cette hypothèse, la dette est, en effet, insoutenable.
On pourrait être tenté de tirer argument de l'augmentation de la dette publique intervenue depuis le début des années 80 pour conclure que la dette publique a financé des emplois à l'efficacité économique insuffisante.
Mais, même si l'efficacité économique des dépenses publiques doit être un critère essentiel de l'intervention publique, plusieurs considérations s'opposent à ce que cet argument soit adopté sans réserves et en dehors d'un examen plus sérieux :
- l'augmentation du ratio de dette publique pourrait être la résultante d'une croissance économique limitée par des facteurs sans rapport avec l'efficacité des dépenses publiques ;
- la rentabilité économique des dépenses publiques pourrait être différée, hypothèse assez vraisemblable si l'on se réfère à la nature de dépenses telles que les dépenses d'éducation ou d'équipement ;
- la contribution des dépenses publiques à la production telle qu'elle est calculée pourrait être considérée comme insusceptible de rendre compte de leur apport en termes de niveau de vie et ainsi conduire à exagérer l'image d'une augmentation de la dette publique plus rapide que celle des richesses économiques.
On peut aussi se référer à des modèles d'explication de la croissance économique dans lesquels la productivité globale des facteurs - élément essentiel de la croissance - dépend directement du financement de biens publics (la santé, l'éducation...) et qui justifient le recours à l'endettement public.
Quoi qu'il en soit, il semble impossible de faire autrement que de constater que tous les éléments nécessaires à l'adoption d'une position tranchée sur les relations entre la dette publique et la croissance économique structurelle ne sont pas disponibles. La résolution de ce problème passe par un approfondissement des savoirs sur la rentabilité économique des dépenses publiques. En pratique, il est encore possible de réduire les dépenses publiques inefficaces et de chercher à accroître celles considérées comme favorables à une augmentation de la croissance potentielle.
*
* *
Il est finalement quelques convictions :
• La
première
est que la
poursuite d'un objectif prioritaire et absolu de réduction de la
dette
publique présente des risques économiques de
court terme
qu'il serait
imprudent de courir
dans le contexte économique actuel ;
• La
seconde
est que
l'
endettement public n'a pas la responsabilité première
dans la crise de la dette en cours
, qui est venue de l'explosion des
dettes privées.
La dette publique a reculé dans l' Union européenne à 15 et dans la zone euro à 12 depuis 1996, de 11,3 points de PIB et 7,8 points de PIB respectivement.
C'est dans les pays les plus endettés au départ que le recul a été le plus important (Belgique, Italie, Grèce), mais d'autres pays ont connu des replis sensibles de la dette publique : les pays scandinaves (Danemark, Suède, Finlande) ainsi que l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni.
En revanche, l'Allemagne, la France et le Portugal ont enregistré une augmentation, assez modérée (de quelques points), de leur dette publique.
La dette publique a également rétrogradé aux États-Unis (jusqu'en 2002) et au Canada alors qu'elle a considérablement augmenté au Japon (de plus de 80 points de PIB).
DETTE PUBLIQUE - DETTE BRUTE CONSOLIDÉE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN POURCENTAGE DU PIB
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
UE (15 pays) |
71,7 |
69,9 |
68,1 |
67,2 |
63,2 |
62,2 |
61,6 |
63,0 |
63,2 |
64,1 |
62,8 |
60,4 |
|
Zone euro (12 pays) |
74,3 |
73,7 |
73,4 |
72,1 |
69,4 |
68,4 |
68,2 |
69,3 |
69,7 |
70,3 |
68,6 |
66,5 |
|
Belgique |
127,0 |
122,3 |
117,1 |
113,6 |
107,8 |
106,5 |
103,4 |
98,6 |
94,3 |
92,1 |
87,8 |
83,9 |
|
Danemark |
69,2 |
65,2 |
60,8 |
57,4 |
51,5 |
48,7 |
48,3 |
45,8 |
43,8 |
36,4 |
30,5 |
26,2 |
|
Allemagne |
58,4 |
59,7 |
60,3 |
60,9 |
59,7 |
58,8 |
60,3 |
63,8 |
65,6 |
67,8 |
67,6 |
65,1 |
|
Irlande |
73,4 |
64,2 |
53,5 |
48,4 |
37,9 |
35,6 |
32,2 |
31,1 |
29,4 |
27,3 |
24,7 |
24,8 |
|
Grèce |
111,3 |
108,2 |
105,8 |
105,2 |
103,2 |
103,6 |
100,6 |
97,9 |
98,6 |
98,8 |
95,9 |
94,8 |
|
Espagne |
67,4 |
66,1 |
64,1 |
62,3 |
59,3 |
55,5 |
52,5 |
48,7 |
46,2 |
43,0 |
39,6 |
36,2 |
|
France |
58,0 |
59,2 |
59,4 |
58,9 |
57,3 |
56,9 |
58,8 |
62,9 |
64,9 |
66,4 |
63,6 |
63,9 |
|
Italie |
120,9 |
118,1 |
114,9 |
113,7 |
109,2 |
108,8 |
105,7 |
104,4 |
103,8 |
105,9 |
106,9 |
104,1 |
|
Luxembourg |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
6,4 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,1 |
6,3 |
6,1 |
6,6 |
7,0 |
|
Pays-Bas |
74,1 |
68,2 |
65,7 |
61,1 |
53,8 |
50,7 |
50,5 |
52,0 |
52,4 |
51,8 |
47,4 |
45,7 |
|
Autriche |
67,6 |
63,8 |
64,3 |
66,5 |
65,6 |
66,1 |
65,9 |
64,7 |
64,8 |
63,7 |
62,0 |
59,5 |
|
Portugal |
59,9 |
56,1 |
52,1 |
51,4 |
50,5 |
52,9 |
55,6 |
56,9 |
58,3 |
63,6 |
64,7 |
63,6 |
|
Finlande |
56,9 |
53,8 |
48,2 |
45,5 |
43,8 |
42,3 |
41,3 |
44,3 |
44,1 |
41,3 |
39,2 |
35,1 |
|
Suède |
73,9 |
71,8 |
70,0 |
65,6 |
54,4 |
55,3 |
53,7 |
53,5 |
51,2 |
50,9 |
45,9 |
40,4 |
|
Royaume-Uni |
51,3 |
49,8 |
46,7 |
43,7 |
41,0 |
37,7 |
37,5 |
38,7 |
40,6 |
42,3 |
43,4 |
44,2 |
|
États-Unis |
73,4 |
70,9 |
67,7 |
64,1 |
58,2 |
57,9 |
60,2 |
62,5 |
63,4 |
- |
- |
- |
|
Japon |
93,9 |
100,3 |
112,2 |
125,7 |
134,1 |
142,3 |
149,5 |
157,6 |
164,0 |
- |
- |
- |
|
Canada |
100,3 |
96,2 |
93,9 |
89,5 |
81,9 |
81,0 |
77,9 |
73,4 |
70,7 |
- |
- |
- |
Source : Eurostat
Le recul de la dette publique dans la zone euro s'est accompagné d'une forte augmentation de l'endettement privé.
Pour les ménages , l'endettement est passé de l'ordre de 70 % de leur revenu disponible en 2000 à près de 95 % de celui-ci en 2007 (+ 25 points de revenu disponible, soit environ + 14 points de PIB).
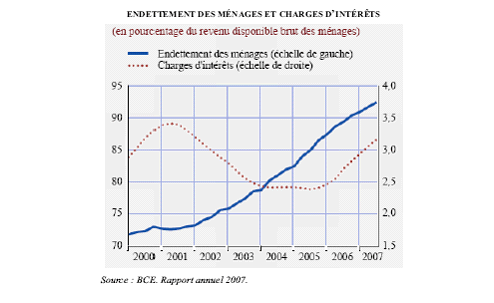
Pour les entreprises non financières , la dette est passée d'un équivalent de 60 points de PIB en 1999 à près de 80 points de PIB en 2007.
Ces 20 points de PIB supplémentaires peuvent être confrontés à la diminution de la dette publique de 5,6 points entre 1999 et 2007.

Celle-ci est, elle-même, à comparer avec l' augmentation agrégée des dettes des ménages et des entreprises (environ 34 points de PIB) au cours de la période considérée.
Autrement dit, si la dette publique dans la zone euro a rétrogradé de 5,6 points de PIB, les dettes privées ont augmenté, avec + 34 points de PIB, dans des proportions telles que l'endettement supplémentaire agrégé des ménages, des entreprises et des administrations publiques s'est accru entre 1999 et 2007 de près de 30 points de PIB .
L'augmentation considérable des dettes privées ne représente pas en soi un processus condamnable. La dette est un facteur de croissance dès qu'elle finance des emplois productifs.
Cependant, le propre du fonctionnement d'une économie libre est de reposer sur le risque. Chacun comprend que l'endettement finance des emplois risqués.
La question que pose la dette n'est donc rien d'autre qu'une question de soutenabilité . C'est tout le rôle d'une supervision financière de gérer cette question en prenant en compte une diversité de scénarios (les « stress tests »).
Il est manifeste que cette supervision, extrêmement serrée pour les dettes publiques dans l'Union européenne (le pacte de stabilité et de croissance) mais exercée sur des bases simplistes (les ratios de Maastricht de 3 % du PIB pour le déficit public et de 60 % du PIB pour la dette publique sont cohérents avec le maintien du niveau de la dette à 60 % du PIB dans l'hypothèse d'une croissance économique nominale de 5 %) et désormais excessives (dans la logique du pacte de stabilité tel qu'appliqué la dette publique doit disparaître), a échoué s'agissant des dettes privées . Or, comme la position budgétaire des Etats est d'autant meilleure que les dettes privées augmentent (du moins jusqu'à ce que la crise survienne), la surveillance des dettes publiques échoue elle-même à enseigner sur la situation économique et financière des Etats.
La crise économique a le mérite de montrer que la sphère privée peut receler des dynamiques d'endettement systémiquement dangereuses et que la division des risques, qui en réduit a priori les dangers macroéconomiques fait parfois place à des risques globaux quand l'excès de risques provient du fonctionnement même du système.
Elle montre aussi que les Etats disposent d'une assurance de leur crédit incomparablement plus satisfaisante que les agents privés - l'assurance des Etats repose sur l'ensemble de l'économie - et que ce qui est considéré comme un risque supplémentaire pour la stabilité économique et financière peut, au contraire, jouer un rôle stabilisateur.
Mais, la crise montre aussi que l'endettement, qu'il soit privé ou public, ne peut être considéré avec légèreté.
Dans ce contexte, il conviendrait de refonder la supervision financière en Europe :
- en s'accordant sur des niveaux de dette publique jugés soutenables sur la base de critères économiques et financiers moins simplistes que le ratio du pacte de stabilité et de croissance 67 ( * ) ;
- et en élargissant l'appréciation de la stabilité financière au domaine des dettes privées.
• La
troisième
est que
la dette publique a permis de contenir l'augmentation des dettes
privées
et qu'elle est aujourd'hui un instrument de lutte
contre les conséquences de la crise de la dette privée. Autrement
dit, les liens entre dettes souveraines et stabilité financière
méritent un examen sérieux.
• La
quatrième
est que la
dette publique, tout comme la dette privée, ne doit pas être une
réponse à un sentier de croissance économique
déséquilibré par les pressions exercées par les
épargnants.
Autrement dit, c'est à un examen de l'équilibre de la croissance économique qu'il faut procéder prioritairement pour régler les problèmes de dettes, publiques ou privées.
A ce propos, dans la lignée du rapport que votre délégation avait consacré à la coordination des politiques économiques en Europe, votre rapporteur insiste sur la nécessité impérieuse de refonder la politique économique européenne. Dans cette perspective, le schéma d'hyper-concurrence entre les espaces européens ne doit pas être relayé par les Etats sauf à ce qu'à l'avenir l'Europe connaisse des crises financières, sociales et économiques d'une extrême gravité.
• Sans doute,
cinquième
conviction
, est-il indispensable de surveiller la stabilité
financière des Etats mais, outre que cette surveillance devrait
être entièrement renouvelée, le pacte de stabilité
et de croissance constituant un mécanisme contreproductif, il appartient
à l'Europe de définir enfin des politiques économiques
propres à assurer une croissance forte et durable.
C'est l'effort auquel contribuera votre délégation dans un prochain et second rapport consacré à la coordination des politiques en Europe.
CHAPITRE II : LES COMPOSANTES DE L'AJUSTEMENT STRUCTUREL DES COMPTES PUBLICS, UNE STRATÉGIE À AFFINER
La programmation des finances publiques repose d'abord sur un choix fiscal de maintien du taux de pression des prélèvements obligatoires qui appelle quelques observations liminaires .
Celles-ci ne porteront pas sur l'option globale que ce choix traduit.
Elle procède d'une volonté de diminuer la part des ressources économiques mobilisées par les différentes catégories d'interventions publiques. Cette orientation, qui peut être discutée sur le fond, est ici envisagée au regard de ses conditions de mise en oeuvre. Selon qu'on la considère comme correspondant à de simples gains d'efficacité ou qu'on la juge comme conditionnée à un changement du périmètre de l'action publique, l'appréciation qu'on est conduit à s'en former diffère sensiblement.
I. UNE STRATÉGIE FISCALE À PRÉCISER
L'ajustement structurel des comptes publics ne devrait rien à une mise à niveau des prélèvements obligatoires pour les rapprocher des dépenses publiques. C'est le choix inverse qui prévaut, celui de baisser les dépenses publiques pour les rapprocher du taux des prélèvements obligatoires.
Entre 2008 et 2012, le niveau relatif au PIB des prélèvements obligatoires resterait stable , autour de 43,3 points de PIB : il ne serait pas relevé, mais il ne baisserait pas davantage.
SCÉNARIO CENTRAL ET BAS : ÉVOLUTION DES RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(% de croissance annuelle en volume)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
TVA |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,5 |
7,3 |
7,2 |
|
Autres impôts sur les produits |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,2 |
3,9 |
|
Impôts sur la production |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
3,8 |
4,2 |
4,2 |
|
Impôt sur le revenu des
|
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
5,1 |
7,9 |
7,4 |
|
Impôt sur les sociétés |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,0 |
2,6 |
2,9 |
|
Autres impôts sur le revenu
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
|
Cotisations employeurs |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,5 |
11,1 |
11,0 |
|
Cotisations salariées
|
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
7,0 |
5,1 |
5,1 |
|
Impôts en capital |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
Prélèvements obligatoires |
43,3 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
42,7 |
43,7 |
43,2 |
Source : INSEE, Rapport économique, social et financier 2009.
Cette orientation générale, décrite dans la programmation des finances publiques à 2012, appelle des précisions 68 ( * ) que celle-ci ne donne pas complètement et conduit à poser quelques questions.
A. UNE STRATÉGIE QUI, INDIFFÉRENTE AUX DYNAMIQUES DES DÉPENSES PROPRES À CHAQUE INTERVENANT PUBLIC, ABOUTIT À DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES DISCUTABLES
La première interrogation concerne la répartition future des prélèvements obligatoire appréciée selon leurs bénéficiaires (Etat, sécurité sociale, collectivités locales) et ses impacts financiers.
La programmation des dépenses publiques (avec une croissance de 1,1 % en volume entre 2010 et 2012) ouvre la perspective d' augmentations différenciées par sous-secteurs des administrations publiques. Les dépenses de l'Etat seraient indexées sur l'inflation, celles liées à la protection sociale s'accroîtraient en volume de 1,75 %, celles des collectivités locales de 1,25 %.
A cette diversité des rythmes d'évolution des dépenses, ne correspond pas dans la programmation une même variété des rythmes d'augmentation des prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires de chaque sous-secteur croissent à un rythme uniforme , avec, pour première conséquence, des perspectives d'évolution différenciées des soldes de chacune des composantes des administrations publiques.
CAPACITÉ (+) OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT PAR SOUS-SECTEURS EN % DU PIB
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Administrations publiques |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 1,2 |
- 0,5 |
|
Etat |
- 2,4 |
- 2,4 |
- 2,0 |
- 1,6 |
- 1,2 |
|
Organismes divers d'administration centrale |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Administrations publiques locales |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,1 |
0,0 |
|
Administrations de sécurité sociale |
0,0 |
- 0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
Source : MINEFE
Ainsi, sur les 2,5 points de réduction du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques imaginés en projection, 1,2 point (soit près de la moitié) « bénéficierait » directement à l'Etat, le reste se partageant par tiers entre les organismes d'administration centrale (qui sont des démembrements de l'Etat), les régimes de sécurité sociale et les collectivités locales.
Cette perspective, qui peut être jugée contestable, implique des gains financiers asymétriques entre des agents qui, pour entrer dans la catégorie comptable unifiante d'administrations publiques, ont des réalités financières autonomes.
Ces gains financiers ne sont pas abstraits puisqu'ils représentent des économies de charges d'intérêts.
Il ne serait pas illogique que l'Etat, qui a la responsabilité d'ensemble du système, ce dont témoigne la programmation qu'il prétend entreprendre de dépenses d'entités extérieures à lui, promeuve un meilleur équilibre des gains financiers de la stratégie globale des finances publiques qu'il entend mettre en oeuvre en distribuant autrement des recettes fiscales .
D'ailleurs, l'actualité montre que des reclassements de prélèvements obligatoires peuvent être mis en oeuvre.
ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LA PÉRIODE 2007-2009
(en points de PIB)
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Etat |
14,4 % |
14,0 % |
13,8 % |
|
Organismes divers d'administration centrale |
1,0 % |
0,9 % |
1,1 % |
|
Administrations publiques locales |
5,7 % |
5,7 % |
5,8 % |
|
Administrations de Sécurité sociale |
22,0 % |
22,2 % |
22,3 % |
|
Union européenne |
0,3 % |
0,3 % |
0,3 % |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
43,3 % |
43,2 % |
43,2 % |
Source : Direction générale du Trésor et de la Politique économique
Ainsi, il est prévu qu'entre 2007 et 2009, les prélèvements obligatoires évoluent différemment selon les sous-secteurs des administrations publiques avec, principalement, une baisse de 0,6 point de PIB des prélèvements de l'Etat, et une hausse de 0,3 point de PIB des prélèvements alimentant la sécurité sociale.
On est fondé à estimer que la programmation par l'Etat des dépenses relavant des différents intervenants publics reflète son point de vue sur les équilibres économiques et sociaux qu'il convient d'atteindre. Il serait souhaitable que la programmation des recettes fiscales soit harmonisée avec cette vision. Cela suppose que, soit par une réorganisation du système fiscal, soit par le versement des recettes perçues par l'Etat aux autres acteurs de la sphère publique, des ressources suffisantes pour financer leurs missions leur soient attribuées.
Or, en l'état, la stratégie fiscale ne le prévoit pas. Au contraire, les prélèvements sur recettes destinés aux collectivités locales sont indexés sur les prix de sorte que leur contribution au financement des missions qu'elles pilotent se réduise à moyen terme.
L'arbitrage sous-jacent à la programmation est financièrement problématique . Il aboutit à concentrer le bénéfice financier de l'effort d'ajustement structurel sur l'Etat, alors que les perspectives financières des régimes de sécurité sociale liées au vieillissement démographique, mais aussi les responsabilités exercées par les collectivités locales dans le domaine des investissements, pourraient conduire à recommander le choix inverse .
B. UNE STRATÉGIE QUI FAIT L'IMPASSE SUR L'ADÉQUATION ÉCONOMIQUE DES RECETTES FISCALES AUX DÉPENSES
Asymétrique dans ses effets financiers, la stratégie fiscale dessinée dans le projet de loi de programmation des finances publiques ne présente pas d'évolutions quant à la la structure des prélèvements entre les trois grands acteurs des interventions publiques . De son côté, la structure des dépenses publiques évoluerait dans le sens d'une réduction de la part des dépenses de l'Etat par rapport à celles des assurances sociales et des collectivités locales dans le total des interventions publiques .
Or, on peut, d'un point de vue économique , estimer que la nature des prélèvements ne devrait pas être indifférente à celles des dépenses publiques qu'ils sont appelés à financer .
Cette question se pose principalement à l'égard de la Sécurité sociale dont la logique assurantielle, qui ne recouvre pas la totalité des dépenses sociales mais toutefois la très grande majorité d'entre elles, pourrait inviter à une mise à niveau plus nette de ses recettes propres.
Cette remarque rejoint, sur un plan plus qualitatif, l'observation précédemment formulée d'un problème d'adéquation quantitative entre la stratégie fiscale à moyen terme et celle des dépenses publiques.
Une clarification des modalités de financement de la protection sociale et des collectivités territoriales reste à programmer.
*
* *
Étant admis qu'un projet de loi de programmation comporte de simples orientations susceptibles de bien des compromis dans leur mise en oeuvre, il faut encore examiner la crédibilité de la programmation des prélèvements obligatoires sous l'angle prospectif de la trajectoire quantitative qu'elle décrit, en ajoutant quelques considérations sur certains enjeux fiscaux pour l'avenir.
C. QUELLE CRÉDIBILITÉ ?
La programmation des prélèvements obligatoires décrit une trajectoire linéaire qui romprait si elle était constatée avec les variations habituelles du rendement fiscal. Elle semble ainsi optimiste pour le début de période et conservatrice pour la fin. Peut-être faut-il attribuer les prévisions réalisées au-delà de 2010 à la perspective ménagée par le projet de loi de programmation d'une redistribution des plus-values fiscales aux contribuables.
En outre, il est un peu regrettable que la révision des prélèvements obligatoires ne trouve pas de prolongements significatifs dans la programmation à l'horizon 2012.
1. Une trajectoire quantitative conventionnelle ?
La programmation des prélèvements obligatoires prévoit que leur évolution serait parallèle au PIB entre 2008 et 2012 , dans un contexte où le rythme de croissance de celui-ci serait particulièrement contrasté selon la sous-période envisagée. Cette trajectoire apparaît comme assez conventionnelle , ce qui conduit à appeler l'attention sur la perspective ouverte par la programmation d'une redistribution conditionnelle des « fruits » de la croissance.
Comme le rappelle le rapport annexé au projet de loi, « les recettes sont très sensibles à la conjoncture ».
Techniquement, on dit que l'élasticité des prélèvements obligatoires (rapport de la variation du niveau des prélèvements/la variation du niveau du PIB, en pourcentages) est variable . Lorsque la croissance du PIB décélère, l'élasticité est inférieure à l'unité, ce qui signifie que les recettes fiscales et sociales augmentent moins que le PIB (c'est le contraire, lorsque la croissance du PIB accélère). Même si à long terme l'élasticité des prélèvements obligatoires serait proche de l'unité, ce que rend plausible l'hypothèse implicite retenue dans la programmation, le scénario de croissance qui lui est sous-jacent semble ne pas permettre de choisir cette hypothèse avec la complète garantie qu'elle décrira exactement le cours des choses.
En particulier, s'agissant de l'année 2009, le quasi-maintien du taux de prélèvements obligatoires au niveau de 2008 dans le cadre d'une croissance en volume de 1 point du PIB (et d'une modération de l'inflation) serait tributaire de mesures nouvelles d'augmentation des prélèvements. En effet, le taux des prélèvements obligatoires pour l'année 2008 (lui-même à peu près stable par rapport à 2007) est dépendant d'un effet de ciseau au terme duquel, malgré le ralentissement économique, les rentrées fiscales resteraient bien orientées puisque résultant pour partie d'assiettes remontant à 2007, alors dynamiques. Relevons, par ailleurs, l'effet de l'inflation en 2008 qui, s'agissant des recettes de TVA, a probablement masqué les effets du ralentissement du volume de la consommation.
Autrement dit, l'élasticité des prélèvements obligatoires en 2008 devrait être significativement supérieure à l'unité (1,5).
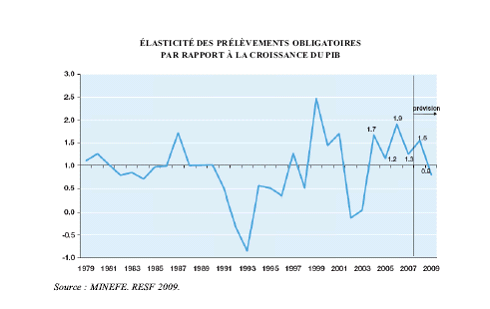
En revanche, il est sans doute un peu optimiste d'imaginer que les prélèvements obligatoires pourraient, spontanément, suivre le PIB en 2009. C'est d'ailleurs ce que suggère le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2009. Selon lui, les recettes fiscales ralentiraient, et connaîtraient un rythme de progression inférieur à la croissance économique, mais finalement d'assez peu.
CONTRIBUTIONS DES PRINCIPAUX IMPÔTS À L'ÉVOLUTION SPONTANÉE DES RECETTES
|
Niveau 2007
|
Contribution
|
Contribution
|
|
|
Impôt sur le revenu |
49,1 |
1,4 % |
0,8 % |
|
Impôt sur les sociétés |
50,8 |
1,4 % |
0,1 % |
|
TVA |
131,5 |
1,8 % |
1,7 % |
|
TIPP |
17,3 |
0,0 % |
0,0 % |
|
Autres recettes fiscales |
18,0 |
0,8 % |
- 0,1 % |
|
Recettes fiscales nettes |
266,7 |
5,4 % |
2,4 % |
Source : MINEFE
Ainsi, selon le RESF, le rythme de croissance des principales recettes fiscales serait divisé par plus de 2 entre 2008 et 2009, passant de + 5,4 % à + 2,4 %.
Il serait ainsi inférieur au rythme de croissance du PIB, l'élasticité des prélèvements obligatoires déclinant de 1,5 à 0,8.
Le graphique, ci-dessus, qui représente les variations de l'élasticité des recettes fiscales par rapport à la croissance montre que celles-ci peuvent atteindre une amplitude considérable dans les phases de ralentissement économique.
La prévision pour 2009 est très éloignée des points bas de 1993 et 2003, ce qui ne suffit pas à l'invalider mais, du moins, conduit à lui reconnaître un caractère plutôt volontariste.
A l'inverse , les perspectives d'évolution des prélèvements fiscaux dans la deuxième partie de la programmation , quand la croissance économique excède le potentiel, sont « prudentes » . Il est, en effet, vraisemblable qu'alors l'élasticité fiscale soit supérieure à l'unité.
Il est évidemment difficile d'apprécier si, au total, l'hypothèse de croissance des prélèvements parallèle au PIB se vérifiera.
En revanche, il est probable qu'elle n'aura pas la constance que la projection retrace. Ainsi, le solde public devrait être nettement plus heurté, en ses évolutions, que dans la trajectoire proposée.
Cette perspective, qui correspond au mécanisme de stabilisation automatique de la conjoncture économique par l'impôt (voir infra ), aura des incidences sur la variation de la dette publique, qui devrait augmenter davantage en début de période pour se replier plus nettement par la suite, à supposer que la croissance économique soit effectivement celle qui est anticipée dans la programmation.
Ces incertitudes conduisent à porter l'attention qu'il convient à la perspective implicite contenue dans l'article 9 du projet de loi de programmation d'une baisse des prélèvements obligatoires si leur produit venait à excéder le seuil fixé dans la programmation .
Dans l'hypothèse où le taux de pression fiscale serait dépassé, des mesures nouvelles pourraient intervenir pour le reconduire au niveau projeté.
Étant rappelé que cette hypothèse est envisageable au vu des élasticités fiscales constatées dans le passé, il faut voir cette éventualité comme un point d'indétermination de la programmation .
Si les recettes fiscales excédentaires devaient être « rendues » aux contribuables, cela signifierait que les fruits conjoncturels d'une activité « riche en produits fiscaux » ne seraient pas utilisés pour réduire le besoin de financement public.
A ce propos, il faut rappeler que la programmation n'envisage pas de compenser les moins-values fiscales afin de laisser jouer les stabilisateurs automatiques, de sens contraire, en cas de ralentissement économique.
Tel n'est pas le choix retenu dans l'hypothèse inverse, la programmation laissant ouverte la possibilité de ne pas laisser jouer les stabilisateurs automatiques, de sens contraire, résultant alors d'un surcroît de croissance.
2. Quelle trajectoire fiscale dans la perspective d'un nouveau régime de croissance ?
Des questions plus structurelles devraient être posées pour le futur en lien avec les perspectives de recomposition du régime de croissance et dans la perspective d'une clarification des objectifs économiques et sociaux des prélèvements obligatoires.
La programmation des prélèvements obligatoires semble ne pas tenir compte d'une éventuelle modification du régime de croissance - ce qui compte tenu des incertitudes en ce domaine peut sembler dans une certaine mesure compréhensible - pas plus que - ce qui est plus hasardeux - des choix que comporte la programmation en matière d'intervention publique.
Le renforcement de la volatilité des prélèvements obligatoires dans les années 90 paraît avoir reflété en les amplifiant les oscillations des cycles économiques et les incidences d'une série de phénomènes : l'augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée, qui a rendu les recettes fiscales très sensibles à l'impôt sur les sociétés notamment, les variations des prix d'actifs financiers et immobiliers.
D'un autre côté, le maintien d'une consommation plutôt robuste, phénomène auquel la contribution des transferts publics au revenu et au niveau de vie des ménages n'a pas été étrangère, a agi dans le sens d'une limitation des à-coups fiscaux.
Or, ces phénomènes contradictoires quant à la volatilité des recettes fiscales semblent remis en cause :
• un nouveau partage de la valeur ajoutée
entre profits et salaires pourrait s'avérer nécessaire pour
équilibrer le sentier de croissance dans un contexte de limitation de
l'endettement ;
• les oscillations des prix d'actifs pourraient
être d'une ampleur moindre à l'avenir si une plus grande
surveillance de leur volatilité devait être
instaurée ;
• la contribution des administrations publiques
à la formation du revenu, et, plus largement, du niveau de vie des
ménages pourrait ressortir amoindrie d'une programmation
financière axée autour de la recherche d'un ajustement structurel
des finances publiques.
Ces perspectives conduisent à poser une question qui dépasse de loin celle de leurs effets sur la volatilité des recettes fiscales.
Il conviendrait de mieux réfléchir aux impacts fiscaux d'un éventuel nouveau régime de croissance , de modalités différentes de répartition de ses fruits et de la réduction du soutien apporté par les finances publiques au revenu et au niveau de vie des agents économiques .
II. PESER LE VOLONTARISME DU PROGRAMME DE BAISSE STRUCTURELLE DES DÉPENSES PUBLIQUES
L'ajustement structurel des comptes publics proviendrait d'une réduction de la part des ressources économiques mobilisées par les différentes catégories d'interventions publiques, elle-même structurelle.
C'est le sens de la programmation de la baisse du niveau relatif au PIB des dépenses publiques.
Elle suppose le respect d'une norme de progression des dépenses publiques globalement exigeante, mais qui l'est particulièrement pour l'Etat.
Cette norme manifeste un volontarisme dont la crédibilité semble reposer sur la capacité des administrations publiques à dégager des gains de productivité et d'efficacité ce qui nécessite des conditions qui ne sont pas toutes explicitées dans la programmation.
Est posée ainsi la question de la cohérence de la programmation.
A. UNE NORME DE DÉPENSES PUBLIQUES TRÈS EXIGEANTE, EN PARTICULIER POUR L'ÉTAT
La norme de progression des dépenses publiques implique un reflux des moyens mobilisés par les interventions collectives particulièrement marqué pour celles prises en charge par l'Etat.
1. Vers un fort repli structurel des coûts de production des services publics et une légère réduction du taux de redistribution publique associé aux dépenses sociales
La norme de croissance des dépenses publiques, entre 2008 et 2013, est de 1,2 % en volume , soit un rythme inférieur à la croissance économique projetée.
Votre délégation a demandé à l'OFCE d'illustrer les incidences de la norme de dépenses publiques jusqu'en 2013.
COMPTE SCÉNARIO CENTRAL : ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
52,6 |
51,9 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
52,3 |
52,6 |
51,5 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,2 |
17,8 |
17,4 |
17,1 |
16,8 |
19,0 |
18,9 |
17,6 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,2 |
28,1 |
27,8 |
27,6 |
27,4 |
26,8 |
27,6 |
27,9 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,5 |
3,2 |
3,2 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
2,9 |
2,0 |
1,2 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
2,6 |
1,6 |
0,5 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
2,2 |
0,6 |
0,3 |
-0,9 |
-2,0 |
5,8 |
0,0 |
0,9 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
3,0 |
2,3 |
1,7 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,4 |
Source : OFCE pour la délégation du Sénat pour la planification.
Elle se décline différemment selon les composantes des administrations publiques .
|
ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR SOUS-SECTEURS 2008-2012 (EN %) |
|
|
Administrations publiques centrales (APUC) |
0 |
|
Administrations publiques locales (APUL) |
1 ¼ |
|
Administrations de Sécurité sociale (ASSO) |
1 ¾ |
Note de lecture : les administrations publiques centrales (APUC) regroupent l'Etat et les organismes divers d'administration centrale.
Source : MINEFE
La croissance des dépenses de l'Etat serait nulle en volume ce qui signifie qu'elle suivrait le rythme de l'inflation . Pour les collectivités locales (APUL), la croissance des dépenses serait de 1,25 % tandis que pour les administrations de sécurité sociale , elle s'élèverait à 1,75 % 69 ( * ) .
Ainsi, s'il est prévu que toutes les composantes des dépenses publiques connaissent un repli structurel , celui-ci serait particulièrement accusé pour l' Etat et les collectivités locales . Comparativement, les dépenses publiques sociales seraient moins affectées.
Cette option revêt une signification qui dépasse le constat d'une norme de dépenses à géométrie variable .
Même si les dépenses de l'Etat et des collectivités locales contribuent aussi pour une partie d'entre elles à une fonction de transferts, ce sont principalement les interventions publiques correspondant à la production de biens et services publics qui seraient concernées par des économies structurelles.
En effet, les dépenses de l'Etat et des collectivités locales sont principalement consacrées à de telles finalités, alors que, par ailleurs, plusieurs catégories de dépenses de transferts à la charge de ces deux niveaux d'administration devraient connaître une dynamique assez forte due notamment à l'alourdissement des charges de la dette et des pensions .
Cette dernière circonstance renforce encore la rigueur de la norme des dépenses pour celles consacrées aux coûts de production des services publics. En effet, pour l'Etat, en moyenne pour la période 2008 à 2011, 71 % du supplément de dépenses autorisé par cette norme seraient absorbés par la hausse de ces deux catégories de dépenses.
Toutefois, après 2011, le reflux de la dette publique décrit dans la programmation permettrait de gagner 0,1 point de PIB d'économies sur les charges de la dette.
Compte tenu des perspectives d'accroissement des charges liées aux prélèvements sur recettes (au profit de l'Union européenne et des collectivités territoriales), les moyens disponibles pour financer la production par l'Etat de services publics devront décroître en volume (ils seraient stables en valeur et subiraient ainsi l'érosion due à l'inflation).
2. La programmation d'un décrochage des salaires publics
Une contrainte aussi forte suppose de limiter très fortement les rémunérations versées aux agents publics . De fait, il est prévu que la masse salariale publique n'augmenterait que de 0,3 % en valeur par an jusqu'à 2011 (sur la base des crédits de la loi de finance initiale pour 2008), soit un repli considérable en volume (excédant finalement les 4,6 % affichés dans le rapport associé au projet de loi de programmation du fait de la forte inflation prévue qui se traduira par un ressaut des dépenses salariales en début de période).
Ce processus, explique-t-on, résulterait de la combinaison d'une réduction du nombre des agents publics et de l'application d'une politique salariale rigoureuse . Mais, c'est plutôt celle-ci qui est en cause .
La réduction du nombre des agents publics s'appuie sur l'objectif de non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux, ce qui pour 2009 entraîne la suppression de 30.600 équivalents temps plein.
La politique salariale serait par ailleurs rigoureuse, reposant sur les mesures générales suivantes :
• une hausse du point fonction publique de
0,5 % par an au 1er juillet chaque année
de la
période de programmation ;
• une
hausse de 0,3 % au 1er octobre
2009
;
• le
versement en 2009 d'une garantie
individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) exceptionnelle
, visant à
couvrir le pic d'inflation 2008 et un dispositif similaire de garantie
individuelle de pouvoir d'achat pour 2011.
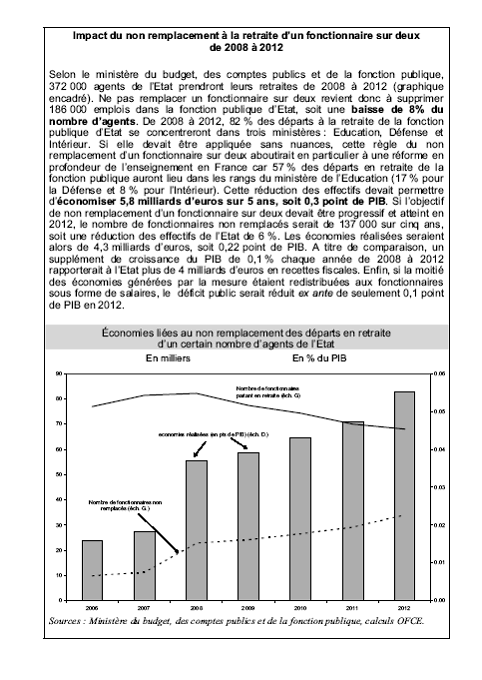
La programmation d'une perte du pouvoir d'achat des rémunérations du barème indiciaire est certes suspendue aux conditions de mise en oeuvre de la clause de rendez-vous imaginée pour 2011 mais, en l'état, elle ressort comme d'autant plus rigoureuse qu'elle semble inclure l'engagement de redistribuer la moitié des économies dégagées des efforts de productivité par tête résultant de la réduction des emplois .
Il est vrai que ces économies sont modestes à court terme (v. l'encadré ci-dessus) ce qui conduit à souligner que l'essentiel du repli de la masse salariale prévue dans la programmation proviendrait d'une perte du pouvoir d'achat des rémunérations individuelles , en lien avec les perspectives d'une revalorisation indiciaire sous le niveau de l'inflation.
3. Des économies nettes devront s'appliquer aux autres dépenses
Les économies projetées sur les rémunérations devront être secondées par des économies encore plus importantes sur les autres postes des dépenses de l'Etat puisqu'elles ne permettront pas d'atteindre l'objectif d'une progression nulle en valeur des dépenses de l'Etat autres que celles frappées par une croissance spontanée.
Autrement dit, des dépenses de transferts (autres que celles liées aux charges d'intérêt et aux pensions publiques) ou/et d'investissements devront être réduites, non seulement en volume mais encore en valeur absolue dans de fortes proportions .
Les indications précises manquent sur ce point mais la description des orientations relatives aux différentes mesures budgétaires permet de projeter que les crédits baisseraient au titre des interventions relatives à la Ville et Logement, au Travail et Emploi, à l'Enseignement scolaire (hors pensions), etc.
Les efforts d'économie concerneraient ainsi de nombreux domaines d'intervention de l'Etat et se nicheraient dans une multiplicité de leurs modalités, en lien avec les résultats de la revue générale des politiques publiques (RGPP).
4. Vers un léger repli du taux de la redistribution sociale publique qui exigera une maîtrise des dépenses
Il faut distinguer dans les dépenses publiques entre celles qui contribuent à la production de biens et services publics et les dépenses de protection sociale. Celles-ci sont, elles-mêmes, soit des dépenses d'assurance sociale soit des dépenses de solidarité sociale.
La programmation des finances publiques ne détaille pas ces deux dernières catégories de dépenses quand elle aborde la question de la protection sociale. Une norme globale est fixée pour celle-ci.
En effet, pour la protection sociale , l'objectif de croissance des dépenses est plafonné à 1,75 % l'an (en volume). Il vise à en faire décroître le niveau relatif au PIB. De fait, entre 2007 et 2013, les dépenses de prestations et autres transferts rétrograderaient de 0,5 point de PIB.
A cet effet, les dépenses publiques de protection sociale évolueraient inégalement selon leur domaine. Le détail des variations n'est pas donné dans la programmation, mais on peut le décrire ainsi que l'a fait l'OFCE pour votre délégation.
COMPTE SCÉNARIO CENTRAL : ÉVOLUTION DES PRESTATIONS SOCIALES (EN VALEUR)
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
1,9 |
-4,1 |
-3,8 |
-4,0 |
-3,7 |
2,7 |
1,5 |
-2,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté
|
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,7 |
4,1 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,4 |
4,1 |
3,8 |
Source : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE pour la délégation du Sénat pour la planification.
• La progression de l'objectif national de
dépenses d'
assurance-maladie
(l'ONDAM) serait de
3,3 % en valeur.
• Les dépenses
d'
assurance-chômage
connaîtraient une
décrue en valeur, sous l'effet notamment de la baisse du nombre des
allocataires, tandis que les dépenses pour la
famille
,
le logement et l'exclusion
augmenteraient de 2,6 %.
• Les dépenses de
retraite
progresseraient sur un rythme supérieur à celui de la croissance
économique (+ 5,3 % l'an).
B. UN OBJECTIF QUI SUPPOSE UNE RUPTURE PAR RAPPORT AUX TENDANCES OBSERVÉES ET AUX ANTICIPATIONS DE DÉPENSES
La norme de progression des dépenses publiques implique une rupture par rapport aux tendances observées, non tant parce que les dépenses publiques auraient « dérapé » dans le passé, que parce qu'elle en suppose une nette réduction.
Par ailleurs, les effets de la programmation des dépenses publiques pourraient être remis en cause par la crise économique en cours.
1. Une programmation qui suppose une rupture par rapport aux tendances
• La
norme d'évolution des
dépenses publiques
suppose qu'une
rupture
intervienne par rapport aux évolutions moyennes de longue période
(v. graphique ci-après). Elles n'ont jamais connu une si faible
progression sur cinq ans consécutifs que celle qui est
programmée.

Entre 1987 et 2007 , la croissance moyenne des dépenses publiques s'est élevée à 2,25 % par an , soit une progression un peu plus rapide que la croissance économique, ce différentiel expliquant la légère augmentation du poids des dépenses publiques dans le PIB.
Au terme de ses évolutions, le niveau des dépenses publiques (exprimé en points de PIB) est supérieur de 2,1 points en 2007 par rapport à 1987 .
ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ENTRE 1987 ET 2007 (EN POINTS DE PIB)
|
Année |
Total des dépenses |
Consommations intermédiaires
|
Rémunérations (D1) |
Prestations (D62 + D63 partie) |
Intérêts (D41) |
FCBF (P51) |
|
En milliards d'euros |
||||||
|
2005 |
921,5 |
89,5 |
228,2 |
402,2 |
46,1 |
57,0 |
|
2006 |
952,5 |
92,7 |
234,7 |
420,2 |
46,1 |
58,2 |
|
2007 |
991,0 |
95,8 |
243,3 |
436,9 |
51,8 |
61,8 |
|
En points de PIB |
||||||
|
1987 |
50,3 |
5,6 |
13,0 |
21,1 |
2,5 |
3,2 |
|
1988 |
49,8 |
5,6 |
12,5 |
20,9 |
2,4 |
3,4 |
|
1989 |
48,7 |
5,4 |
12,2 |
20,6 |
2,5 |
3,4 |
|
1990 |
49,5 |
5,4 |
12,3 |
20,7 |
2,7 |
3,4 |
|
1991 |
50,6 |
5,5 |
12,5 |
21,3 |
2,8 |
3,6 |
|
1992 |
51,9 |
5,6 |
12,8 |
21,8 |
3,0 |
3,6 |
|
1993 |
54,9 |
6,1 |
13,4 |
22,9 |
3,3 |
3,5 |
|
1994 |
54,2 |
5,6 |
13,4 |
22,8 |
3,3 |
3,4 |
|
1995 |
54,4 |
5,5 |
13,6 |
22,8 |
3,5 |
3,2 |
|
1996 |
54,5 |
5,6 |
13,8 |
22,9 |
3,6 |
3,2 |
|
1997 |
54,1 |
5,7 |
13,6 |
23,0 |
3,5 |
2,9 |
|
1998 |
52,7 |
5,2 |
13,5 |
22,6 |
3,3 |
2,8 |
|
1999 |
52,6 |
5,1 |
13,5 |
22,6 |
3,0 |
2,9 |
|
2000 |
51,6 |
5,2 |
13,3 |
22,1 |
2,9 |
3,1 |
|
2001 |
51,6 |
4,9 |
13,3 |
22,1 |
3,1 |
3,0 |
|
2002 |
52,6 |
5,1 |
13,5 |
22,6 |
3,0 |
2,9 |
|
2003 |
53,3 |
5,1 |
13,5 |
23,1 |
2,8 |
3,1 |
|
2004 |
53,2 |
5,2 |
13,3 |
23,2 |
2,8 |
3,1 |
|
2005 |
53,4 |
5,2 |
13,2 |
23,3 |
2,7 |
3,3 |
|
2006 |
52,7 |
5,1 |
13,0 |
23,3 |
2,6 |
3,2 |
|
2007 |
52,4 |
5,1 |
12,9 |
23,1 |
2,7 |
3,3 |
Source : INSEE, base 2000 des Comptes nationaux, calculs DGTPE.
La programmation des dépenses publiques vise à faire rétrograder ce ratio de 1,8 point de PIB entre 2007 et 2012.
Mais cet objectif passerait par un effort concentré sur la fin de période puisqu' en 2009 , le niveau des dépenses publiques exprimé en points de PIB serait supérieur de 0,2 point par rapport à 2007 , malgré le ralentissement de la croissance en volume des dépenses nécessité par l'enclenchement d'une réduction structurelle de leur niveau relatif dans le PIB.
PROGRAMMATION DES DÉPENSES PUBLIQUES (EN POINTS DE PIB)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Évolution 2007/2012 |
|
52,4 |
52,5 |
52,6 |
51,9 |
51,3 |
50,6 |
- 1,8 |
Votre délégation a prolongé cet effort jusqu'en 2013. Dans l'hypothèse d'une croissance économique de 2,5 %, le ratio dépenses publiques/PIB atteindrait 49,9 %.
Au début de la période, la divergence entre l'évolution des prix à la consommation - qui sert de référence pour appliquer la norme de progression des dépenses publiques - et celle des prix du produit intérieur brut qui influence la progression du PIB en valeur, dénominateur du ratio dépenses publiques/PIB, et le rattrapage des prestations sociales indexées sur l'inflation en 2009 pour compenser le supplément de prix de 2008, perturbent l'application de la norme de dépenses.
Par ailleurs, il faut souligner que les données du compte central ne retracent pas les effets des dernières révisions à la baisse de la croissance économique sur la trajectoire des dépenses publiques (v. infra ).
Ce n'est qu'à partir de 2010 que la valeur du ratio dépenses publiques/PIB ne serait plus dépendante que du différentiel de croissance en volume de ses deux composantes.
Il est alors prévu de faire plus que d'effacer en trois ans l'augmentation du poids relatif des dépenses publiques dans le PIB résultant de vingt ans d'évolutions, le ratio dépenses publiques/PIB devant reculer de 2,0 points de PIB entre 2009 et 2012 70 ( * ) .
Ce sont les dépenses de l'Etat qui reculeraient proportionnellement le plus puisqu'elles devraient reculer de l'ordre de 1,5 point de PIB. En cela, elles poursuivraient une tendance longue d'économies réalisées par l'Etat, qui a vu passer ses dépenses de 23,9 points de PIB en 1995 à 19,9 points de PIB en 2007 (soit 4 points de richesse rendus à l'économie).
La norme de progression des dépenses publiques sociales, bien que moins rigoureuse que pour l'Etat, est elle aussi très serrée. Elle implique une rupture par rapport aux évolutions constatées dans le passé puisqu'au contraire des dépenses de l'Etat, les dépenses publiques sociales ont accru leur place dans le PIB (+ 0,4 point de PIB entre 1995 et 2007).
Le constat d'une progression des dépenses sociales, notamment de santé, supérieure à celle du PIB, s'impose en effet . Il résulte en particulier du dynamisme des dépenses du champ de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).

Finalement, ce sont les dépenses des collectivités locales qui devraient connaître la plus forte inflexion . Elles ont augmenté de 1,2 point de PIB depuis 1995 et devraient diminuer d'environ 0,5 point de PIB à l'horizon 2014.
2. Les effets de la crise sur la trajectoire d'évolution des dépenses publiques
Pour rendre compte des incidences d'une telle révision en baisse des perspectives de croissance, à court terme mais aussi à moyen terme, votre délégation a demandé à l'OFCE de simuler un « scénario de crise » dont les résultats en termes de trajectoire de dépenses publiques sont produits dans le tableau ci-dessous.
COMPTE SCÉNARIO BAS : ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
52,3 |
52,6 |
53,0 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,4 |
18,4 |
18,1 |
17,8 |
17,5 |
19,0 |
18,9 |
18,1 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,5 |
28,9 |
28,7 |
28,7 |
28,6 |
26,8 |
27,6 |
28,6 |
|
Acqu. nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2,9 |
2,0 |
1,4 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2,6 |
1,6 |
0,6 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
4,4 |
3,8 |
2,4 |
2,5 |
1,8 |
5,8 |
0,0 |
3,4 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
2,2 |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,0 |
2,3 |
1,9 |
|
Acqu. nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,6 |
Source : OFCE pour la délégation du Sénat pour la planification.
Dans ce scénario, la croissance économique n'atteint que 1,5 % en moyenne entre 2009 et 2013 contre 2,2 % dans le scénario du gouvernement. En outre, on fait l'hypothèse que la politique budgétaire n'est pas indifférente à l'atonie de la croissance économique. La réduction du déficit structurel est, en moyenne, deux fois moindre que dans le scénario de reprise économique (- 0,35 point contre un peu plus de 0,6 point).
Au total, le niveau des dépenses publiques est stable entre 2008 et 2013 (52,5 points de PIB) mais il diminue de 0,8 point entre le point haut de 2010 et 2013.
Dans ce scénario, les dépenses publiques sont plus dynamiques (1,4 % en volume contre 1,1 % dans le scénario central) notamment en 2009 et 2010. En raison d'un profil d'évolution du chômage moins favorable, les prestations chômage progressent sur la période 2009-2013 (écart en moyenne de plus de 3 points par rapport au scénario central). Elles contribueraient à une progression des dépenses de protection sociale un peu plus rapide (+ 1,9 % en volume) que les 1,75 % décrites dans la programmation. En outre, dans ce scénario, le gonflement de la dette publique entraînerait une augmentation des intérêts versés, la charge de la dette (les intérêts) représentant en moyenne 3 points de PIB de 2008 à 2013 contre seulement 2,8 points de PIB dans le scénario central.
COMPTE SCÉNARIO BAS : ÉVOLUTION DES PRESTATIONS SOCIALES (EN VALEUR)
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
4,2 |
5,0 |
-1,4 |
-1,2 |
-1,3 |
2,7 |
1,5 |
0,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté
|
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,5 |
4,3 |
4,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,1 |
4,0 |
Source : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE pour la délégation du Sénat pour la planification.
III. UNE PROGRAMMATION À APPRÉCIER AU REGARD DE QUELQUES PROBLÉMATIQUES CONCERNANT L'INTERVEN-TION PUBLIQUE
La programmation fait le choix d'une réduction structurelle importante des coûts de production des biens et services publics et, malgré les dynamiques spontanées qui devraient résulter notamment du vieillissement de la population, de contenir la croissance des dépenses publiques de protection sociale.
Avant que de s'interroger sur les conditions de succès de ces choix, il peut être utile de rappeler quelques faits stylisés relatifs aux dépenses publiques 71 ( * ) qui méritent d'être considérés dans le cadre de toute stratégie partant sur celles-ci.
A. RAPPELS DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
1. Données quantitatives
Le premier constat est que le niveau des dépenses publiques relativement au PIB est comparativement élevé en France .
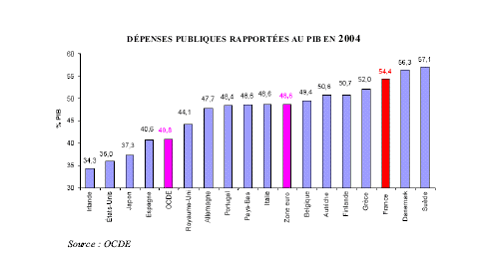
Le deuxième constat est que cette situation ne vient pas principalement d'un niveau des coûts de la production publique important relativement à la moyenne, mais d'un niveau plus élevé du taux de la protection sociale publique .

De fait, troisième constat , la production des administrations publiques - dont l'estimation est construite à partir de ses coûts de production et permet donc de rendre compte des dépenses publiques qui sont consacrées aux services publics - n'est que très légèrement supérieure à la moyenne arithmétique observée dans les principaux pays de l'OCDE .
LA PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en points de PIB)
|
2001 |
2006 |
Évolution 2006/2001 |
|
|
Autriche |
15,2 |
15,0 |
- 0,2 |
|
Belgique |
16,7 |
17,1 |
+ 0,4 |
|
Canada |
22,2 |
22,4 |
+ 0,2 |
|
Danemark |
27,4 |
27,1 |
- 0,3 |
|
France |
20,9 |
21,1 |
+ 0,2 |
|
Irlande |
14,3 |
15,6 |
+ 1,3 |
|
Italie |
17,9 |
18,7 |
+ 0,8 |
|
Japon |
13,6 |
12,6 |
- 1,0 |
|
Pays-Bas |
18,9 |
19,1 |
+ 0,2 |
|
Portugal |
20,2 |
19,5 |
- 0,7 |
|
Espagne |
15,9 |
16,8 |
+ 0,9 |
|
Suède |
28,5 |
27,6 |
- 0,9 |
|
Royaume-Uni |
21,2 |
24,0 |
+ 2,8 |
|
États-Unis |
18,5 |
19,8 |
+ 1,3 |
|
Moyenne arithmétique simple |
19,0 |
19,3 |
+ 0,3 |
Source : Délégation pour la planification
L'écart de 0,8 point de PIB est compatible avec des différences de périmètre des services publics et ne permet pas d'incriminer a priori un niveau de coûts de production comparativement élevé.
Cette dernière observation doit cependant être associée à la remarque qu'il existe une forte dispersion des coûts de la production publique, particulièrement au sein de la zone euro.
Cependant, quatrième constat , le niveau relatif de l'emploi public paraît singulariser la situation française .
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
SELON LE
POIDS DE L'EMPLOI PUBLIC
(en % de l'emploi total)
|
Classement en 2002 |
Pays |
% Emploi public
|
Classement
|
Classement
|
Tendance
|
|
1 |
Suède |
30,0 |
1 |
1 |
diminution |
|
2 |
Danemark |
29,0 |
2 |
2 |
augmentation |
|
3 |
Finlande |
22,4 |
3 |
4 |
constant |
|
4 |
France |
21,2 |
4 |
5 |
constant |
|
5 |
Royaume-Uni |
17,8 |
5 |
3 |
diminution |
|
6 |
Portugal |
17,0 |
7 |
14 |
augmentation |
|
7 |
Belgique |
16,8 |
6 |
6 |
constant |
|
8 |
Luxembourg |
14,9 |
10 |
10 |
constant |
|
9 |
République Tchèque |
14,8 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
10 |
États-Unis |
14,7 |
9 |
8 |
constant |
|
11 |
Italie |
14,4 |
8 |
7 |
diminution |
|
12 |
Espagne |
13,0 |
13 |
15 |
augmentation |
|
13 |
Autriche |
12,2 |
11 |
13 |
diminution |
|
14 |
Pologne |
12,1 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
15 |
Grèce |
11,4 |
16 |
16 |
constant |
|
16 |
Irlande |
11,0 |
14 |
11 |
diminution |
|
17 |
Pays-Bas |
10,7 |
15 |
12 |
diminution |
|
18 |
Allemagne |
10,2 |
12 |
9 |
diminution |
|
19 |
Japon |
8,1 |
17 |
17 |
constant |
|
Moyenne (arithmétique simple) |
15,9 |
NS |
NS |
NS |
|
Source : OCDE (2003)
Pour une production publique, à peu près au niveau moyen de l'OCDE, la France mobilise des moyens en personnels sensiblement supérieurs aux autres pays de l'OCDE, du moins au regard de l'indicateur du pourcentage de l'emploi public dans le total de l'emploi 72 ( * ) .
Mais, ainsi que le souligne notre collègue Bernard Angels, cinquième constat , si la France se caractérise par un niveau d'emplois publics relativement élevé , cette caractéristique ne trouve pas de prolongements à due proportion quand on observe les salaires publics .
Le poids de l'emploi public dans l'emploi total, qui a été constant entre 1993 et 2002, est supérieur en France de 5,3 points à ce qu'il est dans des pays comparables. Mais, le poids des salaires publics n'est, en France, supérieur que de 1,7 points de PIB par rapport à la moyenne de 17 grands pays de l'OCDE.
SITUATION DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE AU REGARD DES SALAIRES PUBLICS EN 2006
(en points de PIB)
|
Écart à la moyenne |
|
|
Autriche |
- 2,1 |
|
Belgique |
+ 0,4 |
|
Canada |
+ 0,2 |
|
Danemark |
+ 5,5 |
|
Finlande |
+ 2,0 |
|
France |
+ 1,7 |
|
Allemagne |
- 4,2 |
|
Irlande |
- 1,7 |
|
Italie |
- 0,3 |
|
Luxembourg |
- 4,0 |
|
Pays-Bas |
- 2,0 |
|
Norvège |
+ 0,5 |
|
Portugal |
+ 2,2 |
|
Espagne |
- 1,4 |
|
Suède |
+ 3,9 |
|
Royaume-Uni |
0 |
|
États-Unis |
- 1,3 |
|
Écart moyen à la moyenne |
1,95 |
Source : Délégation pour la planification
La rémunération par tête, sixième constat , est donc inférieure à la moyenne observée dans les pays développés.
2. Données qualitatives
D'un point de vue qualitatif , il peut être utile de rappeler quelques repères.
• Les dépenses publiques représentent
une modalité particulière d'allocation de ressources
économiques mais qui se substitue, ou à laquelle peuvent se
substituer, des dépenses privées
73
(
*
)
. Par exemple, dans le domaine de la protection
sociale, les dépenses publiques atteignent en France un niveau tel que
les dépenses privées y sont marginales ; à l'inverse,
dans les pays où les dépenses publiques de protection sociale
sont faibles, les dépenses privées sont souvent importantes.
DÉPENSES SOCIALES PUBLIQUES ET PRIVÉES BRUTES DE PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ - 2003* (EN % DU PIB)
|
Pays |
Dépenses publiques |
(dont dépenses fiscales) |
Dépenses privées |
Total |
|
Suède |
31,3 |
0 |
3 |
34,3 |
|
France |
29,7 |
1 |
2,7 |
32,4 |
|
Allemagne |
29,4 |
2,1 |
3 |
32,4 |
|
Danemark |
27,6 |
0 |
2,5 |
30,1 |
|
Belgique |
27,1 |
0,6 |
3,9 |
31 |
|
Autriche |
26,1 |
0 |
2,1 |
28,2 |
|
Norvège |
25,2 |
0,1 |
2,6 |
27,8 |
|
Italie |
24,6 |
0,2 |
2,3 |
26,9 |
|
Finlande |
22,5 |
0 |
4,7 |
27,2 |
|
Pays-Bas |
21,6 |
0,7 |
7,7 |
29,3 |
|
OCDE-24 |
21,4 |
0,7 |
3,2 |
24,6 |
|
Royaume-Uni |
21,1 |
0,5 |
6,8 |
27,9 |
|
Espagne |
20,7 |
0,4 |
0,3 |
21 |
|
Islande |
18,7 |
2,1 |
5,1 |
23,8 |
|
Canada |
18,6 |
1,3 |
5,4 |
24 |
|
Japon |
18,5 |
0,8 |
3,3 |
21,8 |
|
États-Unis |
18,4 |
0,5 |
10,1 |
28,5 |
|
Australie |
18,2 |
0,3 |
4,4 |
22,6 |
|
Nouvelle Zélande |
18,1 |
0,1 |
7,7 |
25,8 |
|
Irlande |
16,3 |
0,4 |
0,5 |
16,8 |
|
Mexique |
7,7 |
0,9 |
0,2 |
7,9 |
|
Corée |
6,3 |
0,6 |
2,4 |
8,7 |
* Hors dépenses fiscales pour retraites, y compris les services de santé.
Source : Délégation pour la planification, à partir de données OCDE (2005)
• Il n'en reste pas moins que,
généralement, les pays à niveau élevé de
dépenses publiques consacrent plus de ressources que les autres aux
différentes fonctions (protection sociale, santé,
éducation, environnement, sûreté, défense...) que
les autres. Mais, les écarts entre pays développés sont
beaucoup plus modestes quand on considère
l'ensemble
des ressources (publiques et privées) consacrées à telle
ou telle fonction que lorsqu'on considère chaque catégorie de
dépenses isolément.
• Ces écarts résiduels semblent
témoigner que l'intervention publique s'accompagne d'un niveau global
des ressources consacrées aux différentes fonctions couvertes par
elle, légèrement supérieur à ce qu'il est quand
elle est moins développée.
Mais, la question fondamentale est de savoir à quoi correspond ce supplément de ressources .
S'agit-il de coûts unitaires plus élevés ? S'agit-il d'un volume de services plus fort ?
Et, dans cette hypothèse, celui-ci est-il justifié, ce qui suppose d'en identifier les avantages, ou est-il superflu ?
Telles sont les questions qu'il faut poser et sur lesquelles il conviendrait que nos connaissances progressent.
• A ce propos, ainsi que le relève le rapport
précité, il est probable qu'un lien existe entre le niveau des
dépenses publiques et la situation des inégalités des
niveaux de vie. Globalement, il semble que le niveau des
inégalités, et en particulier, le taux de pauvreté soit
d'autant plus faible que les dépenses publiques sont plus
élevées. Mais, comme le suggère aussi le rapport de la
délégation, il serait utile de préciser ce lien, ainsi que
l'objectif souhaitable qu'on peut assigner aux dépenses publiques dans
la réduction des inégalités, et d'optimiser la
portée redistributive des dépenses publiques.
B. QUELQUES INTERROGATIONS
Hormis les problèmes majeurs qu'une politique de réduction structurelle des dépenses publiques pose au regard d'objectifs immédiats ou plus structurels de soutien de la croissance économique abordés dans le présent rapport, il faut considérer quelques questions de méthode :
• la possibilité des respecter la norme
décrite par la programmation sans modifications majeures du
périmètre des interventions publiques ;
• les choix de priorité que suggère la
contrainte d'optimalité économique de la réduction des
dépenses publiques.
1. Une cible de dépenses atteignable sans changements majeurs du périmètre des interventions publiques ?
Tout programme de réduction du poids des dépenses publiques conduit à envisager la méthode suivie.
La programmation ici examinée ne semble pas remettre en question le périmètre de l'intervention publique . Ni le champ qu'elle couvre, ni les moyens quantitatifs qu'elle mobilise ne seraient significativement modifiés.
Il est possible que l'objectif de réduction des dépenses publiques poursuivi à l'horizon 2012 ne soit pas d'une telle ampleur que de telles modifications doivent intervenir, mais il est permis de s'interroger sur la conciliation entre la stratégie relative aux dépenses de l'Etat et la méthode « gestionnaire » empruntée pour la mettre en oeuvre.
Il y a probablement des limites au maintien de missions dont les moyens seraient durablement réduits . Les perspectives indemnitaires afférentes aux agents de l'Etat peuvent-elles s'écarter des conditions salariales du secteur privé dans un contexte de raréfaction de l'emploi, sans qu'une grave « crise des vocations » n'intervienne ? La flexion des rémunérations individuelles mérite-t-elle de passer au premier plan ou ne faut-il pas plutôt réduire d'éventuels sur-effectifs ?
Il est de ce point de vue dommage que la RGPP n'ait pas vraiment débouché sur une estimation de l'efficacité des politiques publiques qu'aurait pu permettre un processus véritable d'évaluation des politiques publiques.
Votre rapporteur ne doute pas que les progrès de productivité puissent intervenir dans la sphère publique qui serait la plus concernée par les ambitions de la programmation à moyen terme des dépenses publiques, à savoir le champ des services publics.
Dans ce domaine, l'approche est nécessairement complexe puisque les systèmes en cause le sont aussi. Elle implique des considérations qui ne peuvent pas toujours être quantifiées et, de ce fait, une clarification des points de vue qualitatifs de chacun que seul un processus totalement transparent et participatif d'évaluation peut produire.
2. Pour un ajustement sélectif des dépenses publiques
La réduction du poids des dépenses publiques devrait s'inspirer d'un objectif d'optimisation des interventions publiques . Celui-ci ne peut être réduit à des formules simples mais, pour l'approcher, on peut, malgré cela, se référer aux principaux objectifs auxquels concourent les dépenses publiques :
• le
financement de biens publics
que l'initiative privée ne produit pas spontanément ou, alors, en
quantité insuffisante ;
• l'
élévation du niveau du
rythme de la croissance potentielle
;
• une
cible d'élimination
d'inégalités jugées non supportables
au regard de
la cohésion sociale ou (et) du dynamisme économique.
Sous ces différents angles, la plupart des études disponibles, qui se sont intéressées aux effets économiques des processus de réduction des dépenses publiques, montrent que leur « rendement » dépend d'un bon ciblage des efforts d'économies .
Ceci suggère un choix de priorités consistant à préserver les dépenses favorables à l'élévation du niveau de la croissance potentielle (investissements matériels et immatériels, comme l'éducation et la formation) et à réduire plutôt les dépenses de transferts sociaux ou les coûts de production des services publics qui concourent le moins à ces objectifs.
La programmation proposée met plutôt l'accent sur ces derniers coûts, dans des conditions qui, pour être en partie problématiques, peuvent être considérées, pour certaines, avec la réduction programmée des sur-effectifs, comme structurellement bénéfiques. Elle est moins audacieuse s'agissant des transferts sociaux, même si les objectifs fixés sont rigoureux 74 ( * ) . C'est pourtant sans doute ce champ, où la situation française est la plus singulière, qui offre à un objectif de réduction des dépenses publiques le plus de marges de manoeuvre.
Il semble possible de concilier dans ce domaine le maintien d'une ambition redistributive et un repli de l'intervention collective .
Mais les implications d'un tel processus, qui suppose d'accepter les délais inhérents à toute transition, ne doivent pas être mésestimées : une réduction des protections sociales collectives ne rime pas avec une réduction de la préférence pour l'assurance contre les risques sociaux si bien que le niveau général des ressources économiques allouées à celle-ci pourrait être finalement indifférent au choix de son cadre de gestion 75 ( * ) .
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa réunion du mercredi 12 novembre 2008 , tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin, président, la délégation pour la planification a procédé à l'examen du rapport d'information de M. Joël Bourdin, président, rapporteur, sur les perspectives macroéconomiques et des finances publiques à moyen terme (2009-2013) .
M. Joël Bourdin, rapporteur , a d'abord rappelé qu'avec ce travail, la délégation était le seul organisme public en France à apporter au débat, chaque année, à travers une simulation quantitative, une évaluation de la stratégie des finances publiques définie par les gouvernements successifs, conformément aux obligations européennes.
En effet, le Pacte de stabilité et de croissance oblige chaque Etat à notifier des programmes de stabilité pluriannuels. Ils comportent, d'une part, un ou des scénarios macroéconomiques, souvent très peu détaillés, et, d'autre part, une projection des finances publiques.
Dans cette perspective, un exercice de programmation pluriannuel figure en annexe de la loi de finances initiale. Depuis cette année, la vision pluriannuelle des finances publiques s'est enrichie d'une loi de programmation des finances publiques, qui porte sur les quatre années civiles à venir.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a indiqué que, dans ce contexte, le rapport avait pour ambition d'envisager le programme du Gouvernement dans sa globalité en le resituant dans le contexte économique international et en élucidant ses conditions de réalisation.
Il a ensuite admis qu'avec la crise actuelle, tout exercice de projection économique prenait un tour quelque peu irréel. Le contexte mondial est en effet très défavorable, et les aléas, très importants. La récente révision par le Fonds monétaire international (FMI) de ses prévisions économiques a encore assombri l'horizon. En 2009, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays développés subiraient une contraction de leur production.
Ce contexte récessif trouve son origine dans la crise financière qui a démarré au cours de l'été 2007.
L'attentisme des pouvoirs publics, pendant toute la première phase de la crise, a été particulièrement préjudiciable. La mise en oeuvre tardive de mesures de sauvetage du système bancaire n'a pas suffi pour juguler la crise boursière, qui s'est aggravée en raison de perspectives macroéconomiques qui ne cessent de se dégrader. La contagion à l'économie réelle semble inéluctable :
- d'une part, un rationnement du crédit est prévisible : résultant du réajustement des bilans bancaires, il sera d'autant plus violent que la perte des valeurs d'actifs amplifie les besoins en fonds propres, selon un mécanisme d'inversion du levier d'endettement, et que les agents économiques apparaissent comme très endettés ;
- d'autre part, la diminution de la valeur des actifs produit des effets de richesse négatifs pour les ménages et les entreprises.
L'ampleur du ralentissement de l'économie réelle est difficilement prévisible, mais elle ne sera pas indépendante du volontarisme des politiques économiques, et notamment des politiques budgétaires contra-récessives qui, selon le rapporteur, devraient intervenir.
Malgré ce contexte, l'exercice de prévision n'en demeure pas moins riche d'enseignements pour analyser la situation et dégager des principes d'action.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ensuite précisé que les perspectives de moyen terme étaient envisagées, dans le rapport, selon deux scénarios réalisés grâce au modèle macroéconomique de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Le premier scénario - scénario central - est décalqué de la programmation des finances publiques initiale du gouvernement. La réduction du déficit public structurel y atteint 0,6 point de PIB par an, la croissance s'élève pourtant à 2,5 % à partir de 2010 et le déficit public est ramené à 0,5 point de produit intérieur brut (PIB) en 2012. Ce scénario suppose, toutes choses égales par ailleurs, une demande soutenue par l'endettement des ménages et des entreprises.
Le 6 novembre dernier, le gouvernement a amendé sa programmation, qui s'inscrit désormais entre le scénario central et le second scénario, dit « scénario de crise ». Construit en collaboration avec l'OFCE, ce dernier est fondé sur des hypothèses délibérément prudentes. La demande y est plus modérée, avec un taux d'épargne des ménages et un investissement stabilisés. La correction budgétaire est retardée et moins ambitieuse (deux fois moins que dans la programmation gouvernementale). La croissance plafonne alors à 1 % en 2010, puis se stabilise à 2 % à partir de 2011. Le déficit public se dégrade dans un premier temps, culminant à 4 % du PIB en 2010, pour revenir à 3 % en 2012.
Si le Gouvernement a, depuis, modifié sa programmation, elle reste proche du scénario central et n'invalide pas les enseignements qu'on en peut tirer.
A ce sujet, M. Joël Bourdin, rapporteur, a précisé que, pour qu'un scénario conjuguant un fort ajustement budgétaire avec une croissance soutenue se réalise, il fallait, toutes choses égales par ailleurs, que la réépargne publique soit compensée par une désépargne privée. Tout déficit public peut en effet être considéré comme une forme d'intermédiation financière réalisée par l'Etat, qui s'endette en lieu et place des entreprises et des ménages pour leur distribuer du revenu. Réduire le déficit public revient à limiter cette intermédiation.
Pour que ce processus ne freine pas la demande, il faut qu'avec moins de ressources, ménages et entreprises consomment et investissent au moins autant, donc que leur épargne diminue.
Selon M. Joël Bourdin, rapporteur, les ménages sont la clé du désendettement de l'Etat. Dans le scénario central, la réduction du déficit budgétaire et le coup d'arrêt que porte la crise à l'augmentation des effectifs salariés pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages, alors que la consommation doit se révéler dynamique pour entretenir la croissance et permettre l'ajustement budgétaire. Le différentiel ne peut résulter que d'une baisse prononcée de leur taux d'épargne, de 16 % à 14,2 % entre 2008 et 2013.
Si ce processus ne se déclenchait pas, demande et croissance s'en trouveraient pénalisées.
Or la crise ne favorise pas la perspective d'une baisse de l'épargne des ménages français, même si leur taux d'endettement est comparativement faible. Les inquiétudes sur l'emploi, un resserrement du crédit qui constitue une hypothèse très crédible à court terme, les effets de richesse négatifs qui deviennent sensibles, avec la baisse de valeur des actifs immobiliers et financiers, s'ajoutent aux incertitudes sur les retraites et incitent à reconstituer les patrimoines et à développer l'épargne de précaution.
La désépargne privée qui conditionne la réalisation du scénario de désendettement public porte non seulement sur les ménages, mais aussi sur les entreprises.
Précisant que l'investissement, en constante progression depuis 2004, resterait dynamique dans le scénario central, le taux d'investissement passant de 19,7 % en 2008 à 21,7 % en 2013, M. Joël Bourdin, rapporteur, a constaté que ce dynamisme impliquait une nouvelle baisse du taux d'autofinancement des entreprises, de 66,3 % à 64,8 % entre 2009 et 2013.
Dans ce contexte difficile, aussi bien en termes d'accès au crédit que de perspectives de débouchés, une remontée du taux d'autofinancement et un ralentissement de l'investissement ne sauraient être exclus.
Le scénario d'un endettement croissant des agents économiques n'est donc pas le plus probable à court terme, bien qu'il conditionne les scénarios de désendettement public. Dans ces conditions, M. Joël Bourdin, rapporteur, s'est interrogé sur les moyens de soutenir la demande sans endettement supplémentaire, ce qui devenait crucial dans le contexte d'une crise économique liée au surendettement.
Pour les ménages, outre l'endettement, trois leviers peuvent relancer la consommation : une augmentation de la productivité suscitant la croissance économique et celle des salaires, un ajustement moins rigoureux des dépenses publiques nettes des prélèvements obligatoires et enfin, un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés.
Il a indiqué que la crise financière et économique actuelle, qui succédait à une période de croissance fondamentalement déséquilibrée, car fondée sur un endettement croissant des agents économiques, donnait toute son acuité à l'exploration de cette dernière piste.
En France, au cours des années quatre-vingt, la part des salaires dans la valeur ajoutée a fortement décru, avec une baisse simultanée et durable du taux d'épargne des ménages. L'endettement des ménages, passé de 49 % du revenu disponible brut des ménages en 1996 à près de 72 % en 2007, a apporté une incontestable contribution à la croissance économique française.
Depuis la fin des années quatre-vingt, l'inflation est globalement résorbée en France et, depuis la monnaie unique, dans la zone euro, ce qui signifie que la croissance économique n'y a pas excédé la croissance potentielle. Si la demande avait dépassé la capacité de production des économies, une inflation en aurait résulté.
Ainsi, sans la forte progression de l'endettement constatée au cours des dix dernières années, la croissance aurait suivi un chemin moins favorable, situé en dessous de son potentiel.
Selon M. Joël Bourdin, rapporteur, ce constat d'une croissance non inflationniste, alimentée par un endettement accru, pose la question du caractère soutenable des termes actuels du partage de la valeur ajoutée.
Mais une politique d'augmentation de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée ne peut être le fait d'un pays isolé, ce qui renvoie à la question, devenue récurrente, de la coordination des politiques économiques en Europe.
Le modèle des Etats-Unis livre quelques enseignements supplémentaires. Le pouvoir d'achat de la plupart des revenus y a diminué dans la période récente, sauf pour les ménages les plus aisés. Comme la propension moyenne à consommer des ménages diminue quand le revenu augmente, le recours à un endettement massif a évité que l'accroissement des inégalités ne se solde par une diminution de la consommation pour la plupart des ménages. L'endettement fut ainsi une réponse à la montée des inégalités.
Au total, le régime de croissance mondiale de ces dix dernières années a reposé sur un endettement croissant des ménages occidentaux qui a permis une progression continue de la consommation de masse à l'appui d'une croissance pourtant non inflationniste.
Cette question se pose également pour les entreprises, dont l'endettement est passé de 63 % à 74 % du PIB entre 2000 et 2007.
Il faudrait conforter la part de la valeur ajoutée dévolue à l'investissement, afin d'éviter un recours accru des entreprises à l'emprunt. M. Joël Bourdin, rapporteur, a jugé que cela n'était pas incompatible avec une majoration de la part des rémunérations du travail dans la valeur ajoutée. En effet, la part des profits peut elle-même se subdiviser entre autofinancement et dividendes, et ces derniers ont beaucoup augmenté.
La « norme » des 15 % de ROE (« return on equity », c'est-à-dire rentabilité financière), d'origine américaine, a essaimé dans toute l'Europe occidentale, où les dividendes versés représentent une part croissante du PIB.
Ainsi, en France, la part des dividendes dans la valeur ajoutée des sociétés non financières est passée de 2,9 % à 7 % entre 1981 et 2000.
Un ROE élevé implique, indirectement, un endettement accru des ménages en raison des déformations du partage de la valeur ajoutée qu'il entraîne. En outre, il suscite directement un endettement accru des entités économiques dont le capital social est détenu sous forme de titres, entreprises ou fonds d'investissement, pour engendrer des effets de levier liés à une rentabilité financière excédant la rentabilité économique. Le secteur financier s'est manifesté par une grande créativité dans la recherche de ces effets de levier.
Etant donné que, dans le bouclage économique d'ensemble, l'endettement public peut, dans une certaine mesure, se substituer à l'endettement privé, une norme élevée de ROE constitue, par conséquent, un accélérateur d'endettement pour l'ensemble des agents économiques : ménages, entreprises, banques, Etat.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a considéré que la crise financière actuelle appelait donc à une réflexion économique approfondie sur les termes d'une rentabilité financière soutenable à long terme dans le cadre d'une croissance proche de son potentiel. Compte tenu de la mobilité des capitaux, il a estimé qu'une surveillance efficace ne pourrait qu'être coordonnée au niveau mondial. Le premier grand défi pour l'avenir devrait, par conséquent, consister à définir et piloter un partage de la valeur ajoutée et une rentabilité financière conduisant à un sentier de croissance mondiale dynamique et stable.
Dans l'attente d'une telle politique, il a jugé que la contraction des dettes privées, malgré l'assouplissement des politiques monétaires, appelait une réaction immédiate : celle de politiques budgétaires « contra-récessives ».
M. Joël Bourdin, rapporteur , a alors évoqué la stratégie à moyen terme des finances publiques. L'objectif est de parvenir à un équilibre budgétaire en 2012 en appliquant une norme d'augmentation de la dépense publique très serrée. La politique budgétaire décrite serait cohérente si la croissance dépassait son potentiel, afin d'atténuer une surchauffe.
Elle suppose une nette inflexion des dépenses publiques, dont le principe est moins discutable que les modalités. La question est de savoir si la baisse programmée des moyens est compatible avec le maintien des missions, tant pour les collectivités territoriales que pour l'Etat. Concernant les modalités de réduction des dépenses publiques, une autre question fondamentale est à clarifier : la baisse des dépenses publiques ne doit pas réduire les opportunités de croissance potentielle et elle ne doit pas davantage creuser les inégalités, ce qui invite à une sélectivité fine des efforts d'économie.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a donc estimé que la programmation pluriannuelle des finances publiques appelait un « discours de la méthode » pour la compléter.
Une autre question se pose : celle du réalisme de la politique budgétaire. Dans la programmation des finances publiques, le déficit public est structurellement réduit de 0,6 point de PIB ; la croissance atteint cependant 2,5 % par an à partir de 2010.
Pour suivre les rythmes de croissance annoncés, il faudrait que la croissance économique spontanée se redresse par rapport à l'existant et tende vers une croissance en volume de 3,1 % à compter de 2010. Or avec une politique budgétaire neutre, c'est-à-dire sans baisse du déficit public, le rythme de croissance qui égaliserait le rythme de croissance potentiel serait de l'ordre de 2,1 %, sauf à estimer que la croissance potentielle puisse s'établir à un niveau sensiblement plus élevé.
Dans l'hypothèse où les agents privés ne prendraient pas le relais de l'endettement, la réduction programmée de la dépense publique obèrerait donc la croissance. Elle limiterait les rentrées fiscales, entraînant ex post une neutralisation partielle du désendettement escompté.
En toute hypothèse, le risque macroéconomique associé à la programmation est de ralentir la croissance de l'ordre de 2 points de PIB entre 2010 et 2012, pour un gain budgétaire en termes de charges d'intérêts de l'ordre de 0,2 point de PIB au terme de la projection.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ensuite indiqué que le rapport comportait aussi quelques réflexions sur la dette publique, qui ne conduisaient pas à en négliger la soutenabilité, mais qui nuançaient la question de l'opportunité de faire de l'objectif de réduction de la dette publique un objectif prioritaire à atteindre à marches forcées. Il a rappelé que c'était, à ce jour, la position constante de la délégation que d'insister sur la nécessaire articulation de la politique budgétaire et du contexte économique. Il a jugé assez probable que les faits en valideraient la pertinence dans les cinq ans à venir.
Pour terminer, il a rappelé que les différents sujets abordés impliquaient systématiquement une refondation du modèle économique européen.
Un large débat s'est alors ouvert.
M. Bernard Angels a observé que les réactions des agents économiques face à la crise demeuraient incertaines. Constatant que la confiance ne saurait être décrétée, il a ajouté que le changement d'orientation actuel des politiques publiques pouvait même être déstabilisant. L'Etat devient en effet de plus en plus interventionniste alors que les caisses étaient encore jugées vides il y a peu. Les pouvoirs publics ont décidé de sauver les banques, mais pourront-ils en faire autant au profit d'autres entreprises qui connaîtraient des difficultés dans les prochains mois ?
Pour rétablir la confiance, il a préconisé une impulsion forte sur l'investissement à l'échelon européen, par le lancement d'un emprunt européen et par la mise en oeuvre d'une politique de relance. Il a jugé qu'une Europe unie et conquérante était la seule voie possible pour résoudre les problèmes financiers, mais aussi économiques et sociaux auxquels était confronté le continent.
M. Jean-François Mayet a estimé que la confiance des agents économiques n'était pas tant dépendante de l'évolution de la dette publique que de celle du chômage. Il a jugé que le déblocage de l'épargne ne serait possible que si celui-ci n'augmentait pas trop fortement, alors que dans la situation inverse, les effets en chaîne seraient inquiétants.
M. Joseph Kergueris a salué la démarche du rapporteur qui consistait à réfléchir à l'imbrication des faits économiques entre eux, dans un cadre systémique. Il a préconisé un pacte économique et social national et européen afin de relancer la confiance en agissant sur la question du partage de la valeur ajoutée. Un débat économique de fond est en effet nécessaire. Ce débat permettrait par exemple de mettre en relation le développement de l'endettement et l'augmentation de la part des dividendes dans la valeur ajoutée, comme le fait le rapport. La dimension politique de ces questions est essentielle.
M. Joël Bourdin, rapporteur , s'est félicité de la très forte convergence de vues qui se dégageait dans l'analyse de la crise.
M. Bernard Angels a également jugé qu'il existait désormais beaucoup de points de convergence dans l'analyse de la crise et les conclusions qui en étaient tirées, pour refonder le système économique et financier.
Selon M. Joël Bourdin, rapporteur , le projet de politique économique européenne est beaucoup trop en retard. L'augmentation du ROE à 15 % et la déformation du partage de la valeur ajoutée appellent une action coordonnée au niveau européen. Le ralentissement de la dépense publique doit éviter l'écueil d'un ralentissement supplémentaire de la croissance économique qui pourrait dégénérer en un enchaînement déflationniste.
M. Bernard Angels a craint que la crise économique et financière ne devienne également une crise sociale.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme (2009-2013), de M. Joël Bourdin, rapporteur .
ANNEXE : ÉTUDE DE L'OFCE
Observatoire français des conjonctures économiques
|
Perspectives de l'économie
française
et Les finances publiques à moyen terme 2008-2013 |
Novembre 2008
Perspectives de l'économie française à l'horizon 2013 76 ( * )
I. Conception générale de l'exercice
Cette projection de l'économie française à l'horizon de six ans - de 2008 à 2013 - a été réalisée par l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) à l'aide de son modèle de simulation de l'économie française ( e-mod.fr ). Son approche est essentiellement macro-économique.
Le but de cet exercice est d'obtenir des indications quant aux scénarios possibles d'évolution des finances publiques. Si les simulations affichées pour les années 2008 et 2009 reprennent dans les grandes lignes les perspectives de prévision pour l'économie française élaborée par le gouvernement en octobre 2008, les quatre années suivantes représentent davantage une extrapolation dans le cadre de la politique économique définie dans le programme pluriannuel du gouvernement. Il s'agit donc d'une illustration des questions, hypothèses et choix devant lesquels se trouvent aujourd'hui les responsables de la politique économique.
Afin de mettre à la disposition des membres du Sénat une telle « illustration », les évolutions macro-économiques suivent délibérément une vision tendancielle reposant sur des hypothèses généralement admises :
• Le scénario d'environnement international à moyen terme, qui sert de cadre à la projection de l'économie française a été élaboré à partir d'une hypothèse médiane suivant les estimations de croissance potentielle réalisée par l'OCDE ou par le FMI pour les zones hors OCDE pour les années 2010-2013.
• Le taux de change euro-dollar monte jusqu'à mi 2008 (1,60 dollar pour un euro) et se stabilise ensuite à 1,45 dollar pour un euro. De son côté, le cours du pétrole serait stabilisé à 100 dollars le baril à partir du 4 e trimestre 2008.
• Les prix des partenaires commerciaux de la France évolueraient de façon à stabiliser la compétitivité française à partir de 2010. La demande extérieure adressée à la France demeurerait dynamique sur l'ensemble de la période.
• Les scénarios reposent sur l'hypothèse d'une contribution nulle des variations de stocks.
• En ce qui concerne la durée du travail, nous l'avons supposé inchangée à l'horizon de notre étude. Nous supposons que la défiscalisation des heures supplémentaires n'entraînera pas d'augmentation de la durée du travail mais une hausse du pouvoir d'achat des salariés qui faisaient déjà des heures supplémentaires. La stabilisation des heures supplémentaires dans un contexte de ralentissement de l'activité est atypique. Il semblerait que les entreprises aient ajusté leur volume horaire par de fortes destructions d'emplois précaires (intérim, CDD de moins d'1 mois).
• Comme l'OFCE l'a déjà exploré dans des travaux antérieurs, une croissance supérieure à la croissance potentielle suppose deux types de conditions. D'une part, une demande et une offre soutenues sont nécessaires tant du côté des ménages (au travers de leur revenu disponible brut) que des entreprises (au travers de leur investissement qui est une partie de la demande et qui permet d'augmenter les capacités de production afin de pouvoir satisfaire la demande). D'autre part, une évolution structurelle dans la formation de prix et des salaires est nécessaire. Le NAIRU doit se réduire afin de permettre une baisse du chômage observé sans que des tensions inflationnistes ne se déclenchent et compromettent le processus de croissance.
Deux scénarios pour l'économie française ont été envisagés à l'horizon 2013.
Le premier est bâti sur les hypothèses retenues dans la programmation pluriannuelle des finances publiques 77 ( * ) . Plus précisément, cette programmation s'appuie, pour le court terme (2008-2009), sur les prévisions de croissance présentées en octobre 2008 lors du Projet de loi de Finance, et pour le moyen terme (2010-2013) sur une hypothèse de croissance de 2,5 % et d'un retour à l'équilibre des finances publiques.
Le second illustre un scénario de crise plus profond et durable que celui présenté dans le PPFP. Dans un tel contexte, la politique budgétaire est plus active de façon à éviter un ralentissement encore plus marqué de l'activité, sans toutefois renoncer à l'assainissement des finances publiques.
I.1. Le compte central : scénario gouvernemental
C'est sur la base du premier scénario que nous avons élaboré notre compte central. Après deux années prévues en dessous de son potentiel (1 % pour 2008 et 2009), la croissance de l'économie s'établirait à 2,5 %, supérieure à son potentiel de long terme (qui se situe en moyenne à 1,9 % sur la période). La progression du PIB serait contrainte par une forte impulsion négative de la politique budgétaire (en moyenne -0,6 % du PIB par an). Cette hypothèse se fonde sur les projections gouvernementales de réduction du déficit public (qui passerait dans ce scénario de -2,7 % en 2009 à 0,1 % en 2013) afin de satisfaire aux engagements européens de la France. La politique budgétaire nécessite de ce fait un contrôle strict des dépenses publiques qui progresseraient de 1,1 % en moyenne annuelle au cours de la période 2010-2013 contre plus de 2,5 % observés au cours des 10 dernières années. Cette contraction suppose une baisse de l'emploi public et un blocage des salaires du secteur non marchand. Ce « compte central » repose donc sur une croissance sous-jacente (i.e. hors impulsion) de 3,0-3,1 % qui nécessite une baisse du taux d'épargne des ménages (de 16,0 % en 2008 à 14,2 % en 2013), une hausse du taux d'investissement des entreprises (19,7 % en 2008 à 21,7 % en 2013) et entraîne une baisse du taux de chômage (de 7,3 % en 2008 à 5,3 % en 2013).
1- Evolution de la capacité de financement...
|
En % du PIB |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
...dans le scénario « central » |
-2,7 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,0 |
-1,2 |
-0,5 |
0,1 |
-3,7 |
-2,8 |
-1,3 |
|
...dans le scénario de « bas » |
-2,7 |
-2,7 |
-3,5 |
-4,0 |
-3,5 |
-3,0 |
-2,5 |
-3,7 |
-2,8 |
-3,3 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
1. Capacité de financement des administrations publiques...
En % du PIB
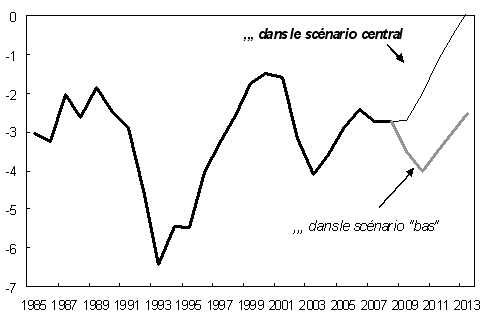
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
I.2. Un scénario de crise : scénario bas
Dans le second scénario, nous supposons que la crise sera plus prononcée et durable qu'envisagée par le gouvernement. Dans ce contexte, les agents privés se désendetteraient contrairement au scénario central : le taux d'épargne des ménages et le taux d'investissement des entreprises se stabiliseraient à compter de 2010. Le taux d'épargne se stabiliserait à 16,7 % du revenu disponible brut (RdB) alors que le taux d'investissement se maintiendrait à 19,1 % de la valeur ajoutée (VA). La croissance de l'économie française serait de 1,8 % en moyenne sur la période 2010-2013, soit un niveau stabilisant le taux de chômage (8,3 %). La trajectoire d'assainissement des finances publiques serait retardée : le déficit atteindrait un pic en 2010 (-4 % du PIB) pour revenir à -2,5 % du PIB en 2013.
II. Principaux résultats pour les années 2008-2009
Le scénario central prolonge, par convention, à l'horizon du moyen terme les prévisions à court terme (2008-2009) du gouvernement. Ces prévisions sont détaillées dans le Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2009.
Le scénario « bas » en revanche se différencie dès le court terme en intégrant un effet plus prononcé de la crise actuelle. Ce scénario est plus proche de celui que l'OFCE vient de présenter.
II.1. Le scénario international 78 ( * )
La crise financière entraîne le monde dans une spirale infernale. Elle a démarré par l'apparition de défauts de paiement sur des emprunts immobiliers à risque, contractés par des ménages américains peu solvables. Evalués à 300 milliards de dollars, les montants en jeu paraissent désormais bien dérisoires au vu de la déstabilisation générale du système financier dont ils sont responsables. Partie des subprime , la crise a atteint les banques, d'abord américaines puis européennes. Des banques, elle s'est transmise à toutes les institutions financières. Elle s'est aujourd'hui étendue à l'ensemble des actifs financiers qui subissent de lourdes dépréciations. Demain, c'est l'économie non financière qui sera touchée par les difficultés d'accès au financement, amplifiées par le traumatisme du système bancaire, par les effets richesse ou par la chute de l'activité dans le secteur immobilier.
Stupéfié, le monde développé est passé tout près d'un effondrement de son système bancaire et financier. La faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, a déclenché une panique destructrice. Des plans proposés en urgence ont évité des faillites en série de grandes institutions financières et de grandes banques. Ces faillites auraient eu des conséquences incommensurables sur les économies développées, paralysant les systèmes de paiement et provoquant la faillite d'une majorité d'entreprises. Le risque systémique, que la fragilité du système financier a fait courir à l'ensemble de l'économie, s'est confirmé à cette occasion. La nécessité d'un contrôle de l'économie mondiale par l'ensemble des parties prenantes s'impose, mais sa faisabilité reste à démontrer. Le capitalisme actuel en sera modifié en profondeur. On peut espérer qu'il le soit en mieux.
Le risque systémique n'est pas écarté pour autant. D'autres sources de dépréciation peuvent atteindre les bilans des institutions financières. Une hausse des défauts sur des prêts moins risqués que les subprime (Alt-A, cartes de crédit ) , la mécanique des valeurs nettes négatives résiduelles des ménages américains 79 ( * ) , la menace de faillites de Hedge Funds ou d'opérateurs de LBO 80 ( * ) qui retomberaient sur les banques, l'effondrement de l'échafaudage des CDS 81 ( * ) ou la fragilisation jusqu'à la rupture de petits pays ou de pays émergents sont autant de véhicules possibles de la prochaine grande peur. Le coup de frein à la croissance en renforce la possibilité. Les défauts à venir peuvent détériorer à nouveau le bilan d'institutions financières qui auraient déjoué les règles de la régulation pour prendre des risques interdits. Et à nouveau, la transformation de ces risques en pertes pour les institutions financières impliquera l'ensemble du système. Ayant aujourd'hui des bilans fragilisés par la première vague de la crise, les institutions financières seront encore plus sensibles aux prochaines. Leur capacité à absorber les mauvaises nouvelles est profondément entamée.
La transmission de ces désordres à l'économie non financière est enclenchée et le risque de récession est important. La chute des cours du pétrole et des autres matières premières soulagera un peu les économies développées, mais le prix des matières premières ne restera bas que tant que la demande sera déprimée.
Le scénario de croissance de court terme (2008-2009) part du ralentissement américain et de sa transmission au reste du monde. Les marchés de l'immobilier se retourneraient dans de nombreux pays, parfois de façon violente comme en Espagne ou au Royaume-Uni. Cela induirait une remontée du taux d'épargne des ménages, une réduction de l'investissement en logement ainsi qu'une remontée du chômage. L'investissement productif ralentirait, anticipant le freinage de la demande. Les entreprises les plus fragiles, celles dont les ratios de bilan sont préoccupants, verraient leurs crédits de trésorerie progressivement supprimés et seraient contraintes au dépôt de bilan ; les ménages les plus exposés au risque de chômage peineraient à accéder au crédit. Le ralentissement de l'économie se nourrirait de ces trajectoires individuelles. Le ralentissement serait plus marqué pour les Etats-Unis que pour la zone Euro. Dans les deux zones, la croissance par tête deviendrait négative au premier trimestre 2009 (voir le tableau 2 et le graphique 2). Aux Etats-Unis, le retournement de l'activité dans le secteur immobilier, la fin des possibilités d'extraction hypothécaire 82 ( * ) et l'effacement de la stimulation budgétaire du début de l'année se combineront pour prolonger la phase de croissance négative du PIB par tête jusqu'à la fin de l'année 2009.
A moyen terme, les agents privés seraient engagés dans un processus de désendettement. Un taux d'autofinancement plus élevé, des fonds de roulement plus importants, la nécessité d'un apport personnel plus conséquent dans le cas d'un achat immobilier, une plus grande sélection dans les demandes de crédit concrétiseraient les penchants vers une plus grande sécurité par un niveau de dette plus bas des agents privés.
2. Croissance du PIB par tête dans la zone euro et aux Etats-Unis

Sources : Comptes nationaux, prévisions OFCE, octobre 2008.
2. Perspectives de croissance mondiale
Taux de croissance annuels, en %
|
Poids 1 |
PIB en volume |
|||
|
dans le total |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Allemagne |
4,4 |
2,6 |
1,7 |
1,3 |
|
Italie |
2,8 |
1,4 |
0,0 |
0,4 |
|
Espagne |
2,1 |
3,7 |
1,3 |
0,1 |
|
Pays-Bas |
1,0 |
3,5 |
2,1 |
1,0 |
|
Belgique |
0,6 |
2,8 |
1,6 |
1,2 |
|
Autriche |
0,5 |
3,1 |
2,0 |
1,1 |
|
Finlande |
0,6 |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
|
Portugal |
0,4 |
1,8 |
0,7 |
0,8 |
|
Grèce |
0,3 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
|
Irlande |
0,3 |
6,0 |
-0,7 |
0,1 |
|
Zone euro |
16,4 |
2,6 |
1,1 |
0,8 |
|
Royaume-Uni |
3,4 |
3,0 |
1,0 |
0,2 |
|
Suède |
0,5 |
2,9 |
1,7 |
1,6 |
|
Danemark |
0,3 |
1,7 |
0,9 |
0,8 |
|
Union européenne à 15 |
20,5 |
2,7 |
1,2 |
0,8 |
|
12 nouveaux pays membres |
2,7 |
6,1 |
3,9 |
2,6 |
|
Union européenne à 27 |
23,3 |
3,0 |
1,5 |
1,0 |
|
Suisse |
0,5 |
3,3 |
2,0 |
1,3 |
|
Norvège |
0,4 |
6,3 |
2,9 |
2,0 |
|
Europe |
24,1 |
3,2 |
1,5 |
1,0 |
|
États-Unis |
21,8 |
2,0 |
1,4 |
0,4 |
|
Japon |
6,7 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Canada |
2,0 |
2,7 |
0,7 |
0,9 |
|
Pays industriels |
56,3 |
2,5 |
1,3 |
0,7 |
|
Pays candidats à l'UE 2 |
1,2 |
4,6 |
3,1 |
3,5 |
|
Russie |
3,2 |
8,1 |
6,7 |
5,5 |
|
Autres CEI 3 |
1,3 |
8,8 |
6,0 |
5,0 |
|
Chine |
11,0 |
11,9 |
9,9 |
9,2 |
|
Autres pays d'Asie |
13,2 |
7,3 |
5.4 |
5.5 |
|
Amérique latine |
7,9 |
5,6 |
4,3 |
2,6 |
|
Afrique |
3,4 |
6,2 |
6,0 |
6,2 |
|
Moyen-Orient |
2,5 |
5,8 |
6,2 |
6,0 |
|
Monde |
100 |
4,9 |
3,7 |
3,1 |
1. Pondération selon le PIB et les PPA de 2007 estimés par le FMI.
2. Croatie et Turquie.
3. Communauté des États indépendants.
Sources : FMI, OCDE, sources nationales, calculs et prévision OFCE, octobre 2008.
Selon ce scénario, la croissance mondiale ralentirait, passant de près de 5 % en 2007 à 3,1 % en 2009. Au-delà de 2009, l'inclination pour le désendettement pèserait plus sur l'Europe que sur les Etats-Unis, parce que les banques exercent sur le Vieux continent une emprise plus forte qu'ailleurs. Touchant davantage les petites entreprises que les grandes ou les ménages confrontés à l'insécurité économique plutôt que les ménages aisés, ce processus de désendettement aurait des conséquences négatives sur les capacités d'innovation et induirait des distorsions de concurrence.
Le rêve de certains, un cauchemar pour tous
La crise est partie d'un petit segment du crédit immobilier aux Etats-Unis, les subprime . N'ayant pu accéder au crédit immobilier qu'en recourant à des montages financiers spéculatifs, qui faisaient reposer la viabilité des dossiers sur le pari d'une poursuite de la hausse des prix des logements, les ménages concernés se sont trouvés pris dans l'étau quand ils n'ont pu faire face à l'augmentation de leurs échéances de remboursement et que la baisse des prix des logements ne permettait plus de refinancer ou d'extraire du nouveau crédit hypothécaire.
Les subprime représentent un montant limité, 1 500 milliards de dollars d'encours. On peut y ajouter les Alt-A (environ 800 milliards d'encours) pour un total de 2 300 milliards de dollars. C'est environ 20 % du montant de l'encours de crédit immobilier accordé aux ménages américains. C'est une goutte d'eau (3,8 %) face aux 60 000 milliards de dollars d'actifs physiques et financiers détenus par les ménages américains. En supposant un taux de défaut de 30 % sur ces crédits, c'est une perte de moins de 700 milliards que le système financier mondial doit absorber. Or, la dépréciation des actifs financiers côtés est aujourd'hui de l'ordre de 17 000 milliards de dollars 83 ( * ) , soit 25 fois le choc initial !
Croissez et titrisez
La régulation prudentielle des banques aux Etats-Unis aurait dû limiter l'exposition au risque subprime à ce que les fonds propres - donc les actionnaires - de ces établissements financiers pouvaient soutenir. Mais ces prêts ont été au coeur d'une série d'innovations financières qui ont décuplé les effets du choc initial. Le principe en est la titrisation. En isolant contractuellement différents risques pris lors d'une opération de prêt immobilier (risque de taux, risque de défaut) de la propriété de la créance, l'émetteur initial du crédit immobilier peut s'assurer contre les risques. Il consent pour cela une rémunération du risque et des commissions aux intermédiaires qui établissent et structurent l'opération. Les risques sont standardisés, agrégés et réunis dans des véhicules juridiques ad hoc . A l'actif de ces véhicules, on trouve donc les flux de primes d'assurance payés par les initiateurs du prêt. Le passif de ces véhicules est alors structuré de façon à hiérarchiser les pertes potentielles. Une tranche senior est prioritaire quant au versement des primes. Une tranche mezzanine est de priorité inférieure et une tranche equity absorbe les premières pertes. La rémunération de ces différentes tranches est liée au risque théorique pris. En cas de défaut sur un prêt immobilier, ce sont les fonds de la tranche equity qui sont mobilisés. Lorsque celle-ci est épuisée, la tranche mezzanine est entamée . Ainsi structurée, la tranche senior est supposée à l'abri de tout défaut. Il faut en effet des taux de défauts très supérieurs à l'historique pour ponctionner les fonds de la tranche senior. Elle est alors noté AAA par les agences de notations (qui ont également un rôle de conseil dans l'élaboration de ces montages et qui manifestent ici un conflit d'intérêt). Actif sans risque, la tranche senior peut être placée facilement d'autant qu'elle offre une rémunération supérieure à des actifs sans risque de référence comme les bons du Trésor. En concentrant le risque sur les tranches equity et mezzanine , en associant une rémunération qui est déterminée par un marché supposé liquide, la titrisation constitue un outil de gestion des risques qui donne l'illusion de l'efficacité. Les banques peuvent contrôler leur exposition, le risque reçoit une valorisation, reflétant l'ensemble de l'information disponible, et tous les agents peuvent prendre du risque dans leur bilan, à la hauteur de ce qu'ils peuvent supporter. En disséminant le risque, les conséquences d'une contingence défavorable sont minimisées et sont supposées correctement rémunérées en moyenne et dans le temps.
Trois failles dans le projet de titrisation
Cette belle mécanique a plusieurs failles. Premièrement, les banques n'ont pas coupé tous les liens avec les véhicules juridiques. Elles détiennent les tranches equity , ce qui les met en première ligne en cas de défaut et justifie qu'elles continuent à exercer les due diligence 84 ( * ) . Mais leur engagement va parfois au-delà. Elles accordent en effet des lignes de crédit utilisables en cas de besoin par les véhicules, éventuellement pour des périodes de temps limitées. Ces engagements sont hors bilan et ne sont donc pas inclus dans le calcul des ratios prudentiels. Lors de la multiplication des taux de défaut, ces engagements ont pesé lourdement sur les banques, contraintes d'accorder des crédits à des véhicules en défaut. La réputation des banques émettrices ou intermédiaires est également un motif pour soutenir au-delà du raisonnable des véhicules en difficulté, même lorsqu'il n'y a aucune garantie contractuelle. En ayant assuré à leurs clients que les titres senior sont sans risque, elles se sont engagées à absorber plus que leur part des pertes.
Deuxièmement, les banques ont été friandes de ces produits. Permettant de bâtir des produits peu risqués puisqu'assurés, elles ont pu, moyennant quelques commissions, proposer à leurs clients des solutions attractives. Grâce à un rendement supérieur à ce que le risque pris pouvait laisser estimer, il est alors possible de déplacer des encours importants de produits traditionnels vers ces nouveaux produits. Consommateurs et producteurs de ces échafaudages, les banques de détail, les banques d'investissement et les assureurs avaient devant eux des gisements d'activité et de profits qu'ils ont largement exploités. Le résultat de cette frénésie a été une inflation de ces produits. Il s'est ainsi créé un réseau complexe de risques et de couvertures, où une banque européenne vend à ses clients des produits basés sur une assurance d'un crédit accordé à un ménage américain, en passant par des titres émis par une banque d'affaire américaine. La mise en place de ce réseau complexe et son fonctionnement quotidien ont créé artificiellement une liquidité élevée de ces titres.
Cette liquidité est à l'origine de la troisième faille. Liquides, basés sur un scénario favorable de l'évolution des prix de l'immobilier, portés par le transfert de masse d'épargne vers ces produits, les marchés d'échange de ces titres ont abouti rapidement à un prix. Mais ce prix n'était pas celui qui intégrait toutes les contingences envisageables. Il était au contraire formidablement optimiste, minimisant l'exposition au risque contenu dans les titres échangés. La croyance que les marchés financiers sont parfaits lorsqu'ils sont liquides et que le prix résume toute l'information rationnellement disponible a servi, à beaucoup, d'alibi à toute prise de position.
La crise peut commencer
De ces trois failles découle l'allumage du premier étage de la crise. Lorsque les défauts sur les subprime ont commencé à croître 85 ( * ) au-delà des maximums atteints dans l'historique qui avait servi de référence à l'évaluation des risques, les dominos se sont effondrés. Les véhicules de titrisation ont alors pesé directement sur le bilan des banques, par le jeu des engagements hors bilan. Les risques qui avaient été externalisés avaient pour contrepartie des assurances faites à d'autres banques. Macro-économiquement, les risques assurés par les banques américaines et européennes se répondaient. Toutes les banques se pensaient couvertes, aucune ne l'était. Guidées par des ratios prudentiels qui ne prenaient pas la mesure d'un risque global et corrélé entre agents, elles ont accordé plus de prêts que ce que leurs fonds propres permettaient et elles ont pris plus de risques que ce qu'elles pouvaient supporter.
Le grand incendie prend
Le deuxième étage de la crise s'est alors enclenché. La menace de faillite de plusieurs établissements prenant corps, le marché interbancaire s'est gelé. Servant à équilibrer quotidiennement les positions des institutions financières, le marché interbancaire voit pour la seule zone euro circuler chaque jour plus de 200 milliards d'euros. Le gel de ce marché interbancaire signifie que les banques qui ont une position négative ne trouvent plus de banques en position positive pour leur prêter à court terme ; le prêteur craint qu'un défaut de sa contrepartie ne le mette lui-même en défaut. Les banques doivent alors se tourner vers la liquidité fournie par la Banque centrale (abondante dès l'été 2007), accroître leur fond de roulement, accepter la hausse du coût de refinancement. Mais, tout changement de stratégie de refinancement est interprété comme un signal de défaut prochain et la rumeur de la faillite accroît encore les difficultés de financement à court comme à long terme. La hausse du coût de refinancement pèse sur les résultats courants et sur les bilans, accentuant la pression initiale.
Lorsque la rumeur de faillite sort du milieu étroit de la profession bancaire, la difficulté de refinancement se double d'un bank run , c'est-à-dire d'un épisode de retrait des dépôts bancaires. Ce retrait condamne l'établissement à la faillite, matérialisant la rumeur. C'est ce qui a frappé Northern Rock en janvier 2007 par exemple. Justifiée par des bilans globalement dégradés, la crainte de faillite accroît les difficultés. Les tentatives pour restaurer la liquidité sur les marchés interbancaires n'ont pu que limiter l'extension de la crise ; injecter des liquidités ou baisser les taux ne résolvent pas la question des bilans bancaires. Les propos rassurants ne font qu'accroître les inquiétudes.
L'effondrement des bourses
Confrontées à la nécessité de rétablir leurs bilans, les institutions financières, et en particulier les banques, disposent de trois options :
1. Se recapitaliser, fusionner ou être absorbées, comme certaines banques l'ont fait, contraintes par des pertes considérables.
2. Réduire leur encours de crédit, ce qu'elles ont commencé à faire mais qui demande du temps. En réduisant leur encours de crédit, elles réduisent leur exposition au risque associé au crédit, et en particulier le risque macroéconomique d'un ralentissement économique et d'une hausse des défauts consécutifs à une moindre activité. Sans être un credit crunch , il s'agit d'un durcissement considérable du crédit.
3. Réduire la taille de leur bilan en liquidant leurs actifs et en réduisant leur passif. En liquidant leurs actifs, les institutions financières réduisent leur exposition au risque de marché, c'est-à-dire l'impact sur leur bilan d'une dépréciation des actifs.
En recourant aux options 2 et 3, les institutions financières déclenchent le risque qu'elles cherchent à fuir 86 ( * ) . Face aux mêmes conditions initiales après l'allumage des deux premiers étages de la crise, les institutions financières font la même analyse de la situation et prennent les mêmes décisions.
Le troisième étage s'amorce alors par la liquidation des actifs exposés au risque de marché détenus par les institutions financières. L'afflux d'ordres de ventes, illustré par l'accélération des transactions dès le début de l'année 2008, tout au moins pour les marchés américains, induit une dépréciation des actifs boursiers, restés jusque là assez haut. A la fin de l'été 2008, les transactions s'accélèrent, probablement renforcées par des anticipations convergentes et la baisse antérieure de l'indice. Le décrochage s'enclenche, encore appuyé par l'annonce de la faillite de Lehman Brothers.
3. Chronologie de la crise et principaux indicateurs financiers
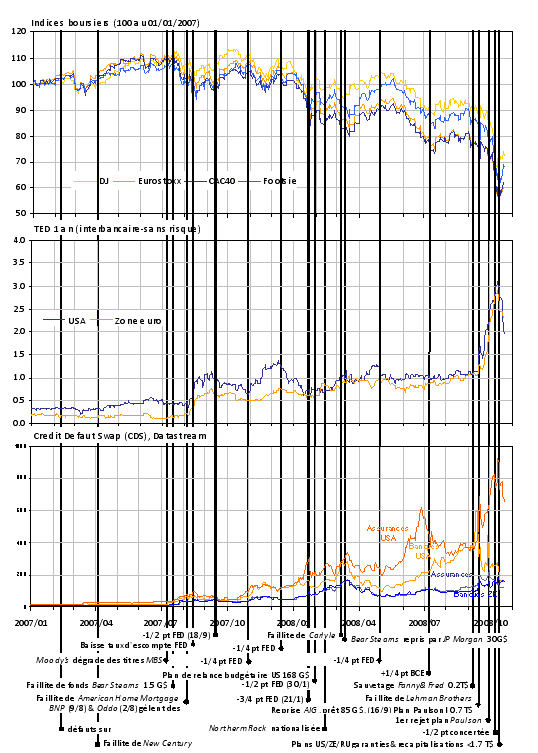
Sources : Datastream, Global Insight, calculs OFCE.
4. Capitalisation boursière et transactions sur les marchés d'actions
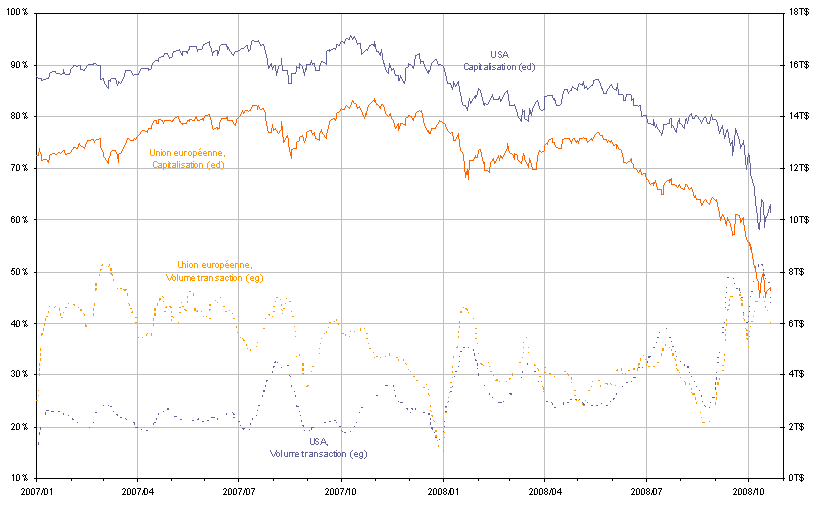
Source : Datastream . Les transactions sont divisées par la capitalisation boursière des 12 mois précédents.
Les institutions financières réalisent des stress tests à des scénarios de risques macroéconomiques et en réfèrent aux autorités de régulation. A la suite des fortes dépréciations d'actifs lors de l'éclatement de la bulle Internet, le scénario d'une baisse rapide des cours boursiers a été étudié par toutes les grandes institutions financières. Même si l'exposition est assez contenue établissement par établissement, elle n'est pas négligeable. Une baisse de 20 ou 30 % des cours boursiers a un impact significatif sur le résultat. Il ne projette pas l'institution dans la zone rouge des ratios prudentiels, mais, appliqué à une situation déjà dégradée, il peut faire basculer dans la zone dangereuse. Fortes de ces analyses, les institutions financières se sont couvertes contre ce risque dès la prise de conscience des pertes liées aux subprime.
En se dégageant du risque de marché, les institutions financières ont probablement consenti une moins-value. En vendant avant tout le monde, elles l'ont néanmoins minimisée. La moins-value totale est portée par d'autres acteurs, des épargnants individuels aux fonds de pensions. Les effets richesse s'en feront sentir dans les trimestres qui viennent.
La chute de la maison Lehman Brothers et les CDS
Le 15 septembre 2008, la banque d'affaires Lehman Brothers (LB) s'est placée sous la protection de la loi des faillites américaine, le chapter 11. Il s'en est suivi un emballement de la crise. Une des raisons en est probablement que LB était un acteur central du marché des CDS .
Les CDS permettent de s'assurer 87 ( * ) du défaut sur une dette privée, qu'elle soit bancaire ou obligataire. Le marché des CDS a rencontré un succès considérable parce qu'il permet (ou procure l'illusion) de déterminer un prix pour le risque pris en prêtant à une entreprise privée. C'est un marché en pleine expansion, actif et liquide. L'encours notionnel, c'est-à-dire la somme de toutes les dettes sous-jacentes assurées, est supérieur à 50 000 milliards de dollars, selon la Banque des règlements internationaux ( BRI ).
Le risque pris sur les CDS n'est pas de même nature que celui pris sur les subprime 88 ( * ) . L'historique de défaut est plus fiable et la corrélation des défauts beaucoup moins probable et forte que celle induite par un retournement du marché immobilier. Même en cas de récession grave, les défauts sur les obligations privées devraient rester contenus en moyenne dans les intervalles observés par exemple de 2000 à 2003 89 ( * ) . Par ailleurs, contrairement aux subprime, la valeur d'un titre en défaut peut être non nulle 90 ( * ) . La liquidation de l'entreprise en défaut peut aboutir à pouvoir rembourser en partie l'obligation défaillante. Le produit en revient alors au détenteur du CDS .
Jusqu'à aujourd'hui, les CDS étaient principalement échangés de gré à gré ( Over The Counter , OTC ), les chambres de compensation étant embryonnaires (CCorp et DTCC sont les principales). Banque d'investissement, LB émettait de la dette pour financer des activités d'investissement de toute nature. Son métier était d'assurer le rendement le plus élevé à l'utilisation des fonds levés. En 2007, le passif de LB était de plus de 650 milliards de dollars, en hausse de 200 milliards de dollars par rapport à 2006. L'utilisation des CDS sur la dette de LB présentait l'avantage de pouvoir séparer le risque de défaut du rendement de la dette de LB . Les banques d'investissement sont d'ailleurs des candidats rêvés pour la titrisation des risques. L'acheteur de CDS sur la dette d'une banque d'investissement parie sur la capacité de cette banque à réaliser au mieux son activité : entreprendre de nombreux projets risqués en incitant à la rentabilité la plus forte possible. Le jour du défaut de LB , le montant des CDS était estimé à près de 400 milliards de dollars. Ceci signifie que la faillite de LB devait se traduire par des transferts de 400 milliards de dollars vers ceux qui avaient souscrit une assurance contre le risque de défaut de LB. Un des arguments avancés pour n'avoir pas soutenu LB était la mauvaise qualité de ses actifs, ce qui laissait supposer que la valeur nette de LB au moment de sa faillite était largement négative, privant les créanciers d'une bonne part de leur dû. Les institutions couvrant les CDS sur LB aurait eu à les inscrire à une valeur fortement dépréciée (et négative) dans leurs bilans et à en comptabiliser les pertes correspondantes dans leurs résultats. Cette nouvelle dégradation de leurs bilans pouvait les faire basculer dans la zone rouge. Le mouvement de recherche de sécurité a pris un nouveau tour avec la faillite de LB . Nouvelles rumeurs, nouvelles liquidations d'actifs, nouvelles restrictions de crédits, la spirale infernale s'est alors emballée.
Dans la semaine du 13 au 17 octobre 2008, la poussière de l'effondrement de LB est retombée. Le montant qui devait être transféré a été estimé par DTCC à 5,2 milliards de dollars, en tenant compte de la valeur de liquidation de LB et du jeu des couvertures et des contre-couvertures (une institution peut détenir un CDS sur LB couvrant son exposition dans un CDS qu'elle a vendu à une autre institution). Soit 60 fois moins que l'estimation initiale. Un montant que le système bancaire et financier, même affaibli, peut absorber.
Entre le 16 septembre et le 16 octobre 2008, c'est plus de 8.600 milliards de dollars qui se sont évaporés sur les marchés d'actions. L'effondrement des places boursières pendant ce mois a laissé des traces bien plus profondes que les 5,2 milliards de dollars qui ont changé de mains après le défaut de LB .
Recapitaliser un capitalisme en capilotade ?
La référence à la crise de 1929 s'impose. C'est dans la crise de 1929 que l'on trouve la démonstration de la nécessité d'éviter à tout prix la panique bancaire (le bank run ). C'est dans l'analyse de la crise de 1929 que l'on a compris l'importance des anticipations récessives quant les actifs se déprécient et que la déflation s'installe. C'est de l'expérience de 1929 que l'on tire la leçon de l'obligation de réponses coordonnées internationalement. C'est depuis la crise de 1929 que l'on sait le soutien nécessaire de la politique monétaire à l'économie. C'est également de l'impuissance des politiques mises en oeuvre pour juguler la dépression à l'époque que l'on sait l'importance de la politique budgétaire pour stimuler l'économie face à la trappe à liquidités.
Les leçons de 1929 ont été tirées et inspirent les politiques mises en place. L'interventionnisme public est depuis plus d'un an maximal et prend des formes conventionnelles, comme les instruments habituels de la politique monétaire ou le recours aux politiques budgétaires, et des mesures moins conventionnelles, pour rétablir l'ordre sur les marchés financiers.
Les grandes banques centrales ont amorcé des mouvements de baisse de taux. Le reflux des cours du pétrole et des matières premières, induit par les anticipations de ralentissement de la croissance mondiale, a fait oublier les craintes d'une inflation rampante. La Réserve fédérale a baissé depuis août 2007 ses taux directeurs de 3,75 points. Après une hausse d'un quart de point en juillet 2008, la Banque centrale européenne a initié une baisse de taux, portant son taux directeur à 3,75 points. D'autres mouvements de baisse devraient suivre. La Banque d'Angleterre a également renoncé à ses préoccupations inflationnistes et s'est jointe à la baisse de taux concertée du 8 octobre 2008.
L 'Emergency Economic stabilization Act de 2008 ou plan Paulson
Pour stopper la nouvelle panique financière qui s'est emparée des marchés depuis le 15 septembre, et contrer la menace d'une rupture du système, un plan de sauvetage a été proposé au Congrès par le Secrétaire du Trésor, Henry Paulson, et le Président Georges W. Bush le 29 septembre. Présenté d'abord sous la forme d'un amendement au projet de loi H.R.3997 et refusé à la Chambre des représentants le 28 septembre, il sera finalement adopté le 1 er octobre comme amendement au projet de loi H.R.1424 et sous le nom de ` Emergency Economic Stabilization Act de 2008'. La Chambre des représentants est restée malgré tout hésitante avant d'adopter ce plan : 262 pour, dont 171 démocrates, et 171 non, dont 108 républicains. Le projet a pris forme de loi le 3 octobre. Le 14 octobre, à la suite des décisions d'interventions européennes, le gouvernement américain a introduit de nouvelles propositions qui modifient ou approfondissent l'orientation d'origine.
La mesure la plus importante de ce plan de sauvetage porte sur l'ampleur des fonds mis à la disposition du Trésor : 700 milliards de dollars (5 point de PIB) pour assainir le système et rétablir la confiance, sachant que les autorités peuvent immédiatement disposer de 250 milliards de dollars, augmentés de 100 milliards sous notification écrite du Président et présentée au Congrès. Les 350 milliards de dollars doivent faire l'objet d'un vote du Congrès. Par ailleurs, l'Etat étend sa garantie sur différents types d'actifs. Dans ce cas, les sommes ne seront déboursées qu'en cas de défaut de paiements. Elles ne sont pas comptabilisées dans les 700 milliards de dollars.
Principal objectif : assainir le système financier. Pour cela, le plan prévoit de recapitaliser les banques et de sortir du bilan des banques les actifs dits toxiques, par un programme de rachat.
Concernant le plan de recapitalisation des banques, le Trésor dispose d'au moins 250 milliards dont 125 sont déjà alloués aux neuf principales grandes banques (25 pour Citigroup, autant pour JPMorgan et 20 pour Bank of America). Les autres banques ont jusqu'au 14 novembre pour se manifester, avant de savoir si elles seront ou non éligibles. La recapitalisation prend la forme d'achats d'actions préférentielles ou privilégiées. Ces titres ne portent pas de droit de vote mais garantissent à l'Etat le versement d'un dividende de 5 %, puis de 9 % au-delà des cinq ans. Visant à rétablir les investissements privés, l'Etat peut les revendre après 3 ans (voire plus tôt s'il trouve un acquéreur pour le même montant). Ces achats ne pourront pas dépasser 25 milliards de dollars, ou 3 % des actifs des institutions concernées. En contrepartie, les dividendes payés aux actionnaires ne peuvent être augmentés, les indemnités des dirigeants sont limitées et les parachutes dorés interdits.
Le reste de l'enveloppement devrait être destiné à l'achat d'actifs toxiques par le Trésor ( Troubled Assets Relief Program-TARP ). Le programme autorise le Trésor à acheter, garantir, détenir et vendre une large variété d'actifs financiers, notamment basés ou liés à des crédits hypothécaires ou commerciaux ( Whole loans and mortgage backed securities ) émis avant le 14 mars 2008. Pour faire face à la complexité des dossiers et superviser les montages, le Trésor a fait appel à PricewaterhouseCoopers LLP and Ernst & Young. Une des questions centrales est le prix d'achat de ces titres à leurs actuels détenteurs, sachant qu'à terme, ils peuvent augmenter ou baisser et donc avoir un impact sur le coût final à supporter par le contribuable.
Le deuxième grand volet du plan porte sur la garantie du Federal Deposit Insurance Corportion (FDIC) offerte aux nouveaux emprunts interbancaires émis d'ici au 30 juin 2009, et ce sur une période de 3 ans. Parallèlement, le plafond de garantie par le FDIC des dépôts bancaires des particuliers est relevé de 100 000 dollars à 250 000 dollars. L'engagement supplémentaire de cette dernière mesure coûterait, selon le Congressional Budget Office (CBO), 700 milliards de dollars.
Troisième grand volet du plan, la Réserve fédérale va mettre en place à partir du 27 octobre un mécanisme de rachat temporaire de billets de trésorerie des entreprises, y compris les non financières ( Commercial Paper ) afin de faciliter les opérations quotidiennes de financement à court terme.
L 'Emergency Economic Stabilisation Act de 2008, dans sa forme du 3 octobre, prévoit également un certain nombre d'incitations pour la production et la conservation d'énergie. Selon le CBO, le coût serait de 7 milliards de dollars sur la période 2009-2013.
De même, la loi prévoit le renouvellement des mesures fiscales, une extension de l'allègement de l'Alternative Minimum Tax Relief pour 2008, et des allègements fiscaux pour les régions dévastées par les catastrophes naturelles du début de l'année. Le coût est estimé par le CBO à 112,3 milliards de dollars sur la période 2009-2013 qui viendrait s'ajouter aux 700 milliards de dollars du plan de sauvetage des banques.
La politique budgétaire aux Etats-Unis a été également mise à contribution pour soutenir l'économie. L'Etat américain a injecté 168 milliards de dollars, avec une vitesse qui contredit tous les manuels d'économie. Les chèques sont arrivés au printemps 2008, quelques mois après le vote du Congrès américain. Les sommes ont été dépensées et ont participé à la croissance de l'économie américaine du deuxième trimestre 2008. En Europe, la réaction budgétaire est bien moindre. Les circonstances exceptionnelles ont été invoquées lors du sommet du G4, à Paris le 4 octobre 2008. Elles affranchissent les pays de la zone euro des valeurs de référence du Pacte de stabilité et de croissance et autorisent des dépassements temporaires. Il n'y aura pas de politiques budgétaires restrictives en 2009 en zone euro. En revanche, un plan de relance européen peine à émerger alors qu'aux Etats-Unis un plan de relance supplémentaire pourrait prendre le relais de celui de janvier 2008, dès le début 2009, Le renforcement des anticipations de ralentissement, les craintes d'une récession forte en Europe et la nécessité politique de compléter le soutien apporté aux banques par un plan pour l'économie non financière peuvent déclencher une relance budgétaire en zone euro. Elle sera probablement tardive, mais les conséquences de la crise financière sur l'économie mondiale peuvent se prolonger au-delà de l'année 2009.
L'activisme conventionnel a donc été largement initié par les Etats-Unis et finalement suivi par l'Europe. L'activisme non conventionnel s'est imposé devant la crise financière.
Les banques centrales se sont substituées aux banques créditrices pour assurer la liquidité du marché interbancaire. Les opérations d' open market ont été renforcées par des prises en garantie élargies à des titres dont la valeur est contestée par les marchés. Les banques centrales ont accru leur exposition à l'économie également par des financements à plus long terme du système bancaire. Mais pour autant, elles n'ont pas réussi à ce stade à restaurer la confiance sur le marché interbancaire. Les banques sont toujours contraintes de prendre un risque de taux (et de réputation) important en se présentant au guichet des banques centrales. L'alternative est de restructurer leur financement, acceptant au passage une sérieuse hausse de leur coût de refinancement et en augmentant la pression sur leurs bilans et leurs ratios prudentiels. Les gouvernements de la plupart des grands pays développés ont proposé de garantir les emprunts sur les marchés interbancaires. Les solutions connaissent des déclinaisons locales mais reposent sur le même principe : donner aux banques la certitude que lorsqu'elles prêtent à 24 heures, à 1 mois ou à 1 an à une autre banque, sans exiger de collatéral, elles récupèrent immédiatement leur créance en cas de défaut (improbable) de la contrepartie. Et cette garantie offerte aux établissements bancaires s'ajoute aux déclarations convergentes des gouvernements sur la protection contre les faillites. La Réserve fédérale américaine a amorcé un programme de financement direct à l'économie, en se portant acheteuse de certificats de dépôt émis par des entreprises non financières.
Le Trésor américain a mis en place une structure de défaisance ( Toxic Assets Relief Program, TARP ) pour racheter à un prix qui reste à définir les actifs à risque (et en lien avec les subprime) aux institutions financières opérant sur le territoire américain. Des fonds de recapitalisation publics sont mis en place dans les différents pays pour apporter aux banques des soutiens directs, alors que les sources de capitaux se tarissent. Les conditions exactes de ces recapitalisations sont mal définies et l'équilibre entre les intérêts des actionnaires, des clients des banques ou des contribuables est loin d'être trouvé, mais le schéma de recapitalisation prend la forme d'un prêt non exigible, via des titres subordonnés ou « capital hybride » selon la terminologie de Bâle, qui renforce les fonds propres des banques sans modifier le pouvoir des actionnaires sur la conduite des affaires. Enfin, les banques ou les institutions financières en difficulté sont sous la surveillance des autorités économiques qui tâchent d'organiser les recapitalisations ou les reprises en cas de menace de faillite. Northern Rock a été nationalisée par le gouvernement anglais, Bear Stearns a été absorbée par JP Morgan Chase avec la garantie du Trésor américain pour 30 milliards de dollars, AIG a été nationalisée et a obtenu une ligne de crédit de 85 milliards de dollars garantie par le Trésor américain, Freddy Mac et Fanny Mae ont été mis sous tutelle et leur bilan a été garanti publiquement à hauteur de 200 milliards de dollars. En Europe continentale, UBS, Dexia, Fortis ou Hypo Real Estate ont bénéficié de soutiens publics pour échapper à la faillite.
Plans de sauvetage bancaire en Europe
Faisant suite au Plan Paulson voté aux Etats-Unis et face aux problèmes rencontrés par plusieurs banques européennes fin septembre et début octobre (Fortis, Dexia et Bradford and Bingley), les dirigeants européens ont à leur tour décidé de se concerter début octobre pour calmer les marchés financiers et les épargnants. Le premier accord est intervenu le 6 octobre 2008 entre les ministres des Finances de l'Union européenne sur un relèvement à 50 000 euros, contre 20 000 actuellement, du plafond de garantie des dépôts bancaires au niveau européen. Par la suite, de nombreux Etats membres ont porté ce minimum à 100 000 euros, voire annoncé la garantie illimitée des dépôts (tableau E1). Un accord de principe a été trouvé le 12 octobre 2008 entre les pays de la zone euro afin d'aider les banques à continuer de financer l'économie. La mise en place de ce plan européen, qui s'appuie sur celui présenté quelques jours plus tôt par Gordon Brown pour les banques britanniques, en plus de soutenir des banques européennes qu'on a longtemps crû à l'abri, a influé en retour sur les modalités d'action du plan Paulson.
Le plan européen du 12 octobre fixe six objectifs qui devront être ensuite déclinés au niveau de chaque Etat.
• assurer des liquidités suffisantes aux institutions financières (1),
• faciliter le financement des banques (2),
• apporter aux institutions financières les ressources en capital nécessaires pour qu'elles continuent à financer l'économie (3),
• recapitaliser les banques en difficulté (4),
• assurer plus de flexibilité dans les circonstances actuelles au regard des règles comptables (5),
• renforcer les procédures de coopération entre pays européens (6).
(1) Le premier point concerne les interventions de la Banque centrale européenne : la baisse des taux directeurs, l'amélioration des conditions de refinancement et la hausse des financements à long terme des banques. Ces actions ont été jugées positives par les pays qui encouragent aussi l'introduction de nouvelles règles en matière de collatéral (éligibilité des billets de trésorerie en particulier).
(2) En plus des mesures de refinancement de court terme de la BCE, les pays européens veulent faciliter le financement à moyen terme des banques, via l'achat d'actifs de qualité ou à travers l'échange de titres d'Etat. Les Etats pourront aussi fournir pour une période définie leur garantie ou une assurance sur les nouvelles émissions des banques (avant fin 2009) pour des durées allant jusqu'à 5 ans. Ils pourront aussi acquérir directement ces émissions. Ces critères s'appliquent aux banques opérant sur chacun des territoires.
(3) Les Etats peuvent allouer des fonds propres aux établissements financiers, via des actions de préférence ou des obligations émises par ces établissements, sans que leur capital ne se trouve dilué (c'est-à-dire sans diminution du droit de vote pour les actionnaires actuels). Ces mesures visent à renforcer les ratios de solvabilité des banques, via l'apport de fonds propres supplémentaires.
(4) Les Etats s'engagent à ne pas laisser d'institution financière faire faillite. Pour cela, des recapitalisations sont possibles.
(5) Concernant les titres pour lesquels le marché ne fonctionne plus et donc pour lesquels il n'y a plus de valorisation possible dans le bilan bancaire, l'utilisation par les banques de leurs modèles tenant compte des risques de défaut pour évaluer leur prix devrait être rendue autorisée à court terme dans les différents pays.
Le tableau E2 résume les garanties accordées par les différents Etats à leurs banques sur les nouvelles créances émises. Le tableau E3 indique les montants maximaux qui devraient être déboursés à court terme par les différents pays soit pour recapitaliser leurs banques, soit pour leur acheter des titres de dette qu'elles émettent, soit pour leur acheter des actifs.
Au final, seules les mesures de recapitalisation et de rachat d'actifs devraient à court terme entraîner une hausse de la dette publique brute des administrations publiques. Cet effet est pour l'instant estimé à 2 points de PIB au maximum en France si tous les fonds mis à disposition sont utilisés, à 4 points de PIB en Allemagne, à 3,4 points au Royaume-Uni comme aux Pays-Bas, à 4,5 points en Espagne et à 1,3 point en Belgique. Sur ces 7 pays, ces mesures coûteront donc 3,3 points de PIB en moyenne. Pour mémoire, aux Etats-Unis, le plan de 700 milliards de dollars correspond à 5 points du PIB américain. Les sommes en jeu sont donc moins élevées en Europe pour le moment. L'impact final pour le contribuable ne sera connu que quand les marchés fonctionneront à nouveau normalement et que les Etats pourront se défaire de leurs actifs, être remboursés de leurs prêts ou sortiront du capital des banques. Quant aux garanties tant des dépôts des ménages que des crédits interbancaires ou des obligations émises par les banques, elles seront indolores sur les finances publiques, sauf si des faillites ont lieu, ce que justement les mesures actuelles visent à éviter.
Le paradoxe du désendettement
La leçon de 1929 a été tirée. La réaction à la crise est rapide et déterminée. Cela ne suffit cependant pas à enrayer les enchaînements dépressifs qui sont en cours. Les solutions héritées de 1929 sont le fruit d'une analyse a posteriori qui reste débattue. Le poids du secteur public, que l'on imagine plus facilement à l'abri de la mécanique infernale des bilans, est plus grand qu'il y a 79 ans, mais la financiarisation et la dépendance au système de paiement dématérialisé est plus importante qu'en 1929. Les interdépendances des systèmes financiers sont plus profondes, les pôles de pouvoir sont plus nombreux. Et comme en 1929, les solutions proposées ont toujours un temps de retard sur l'avancée de la crise.
Supposons que les plans de sauvetage des systèmes bancaires et financiers fonctionnent. Le marché interbancaire fonctionnerait à nouveau, permettant aux banques de refinancer leurs activités. Les recapitalisations acceptées par toutes les banques en même temps résoudraient le dilemme de la stigmatisation de l'institution qui signalerait ses difficultés en se présentant au guichet de la honte . Les recapitalisations présentes et éventuellement à venir écarteraient le risque de faillite des institutions financières.
Pour autant, l'économie des pays développés ne serait pas relancée. La dette privée fait peur, qu'elle soit due par des agents risqués (les ménages subprime) ou moins risqués (toute entreprise qui fait face à des difficultés temporaires). Les banques échaudées seraient plus regardantes. Plus contrôlées et régulées, elles se feraient moins concurrence et chercheraient en même temps à réduire leur exposition au risque. Les agents qui détiennent de l'épargne chercheraient des placements sûrs, qu'ils soient des particuliers ou des fonds de pension. La pression de désendettement est forte, elle contraint les investissements et la consommation. Elle implique un ralentissement macroéconomique.
E1. Interventions de sauvetage du système financier : Garanties sur les dépôts
|
FRANCE |
ALLEMAGNE |
ITALIE |
ROYAUME-UNI |
ESPAGNE |
PAYS-BAS |
IRLANDE |
BELGIQUE |
|
|
AVANT |
70 000 euros |
70 000 euros |
103 000 euros par fonds interbancaire |
43 000 euros |
20 000 euros |
20 000 euros |
20 000 euros |
20 000 euros |
|
APRÈS |
70 000 euros |
Garantie illimitée Coût potentiel 1600 milliards |
Garantie complémentaire de l'Etat pendant 36 mois |
62 000 euros |
100 000 euros |
100 000 euros |
Garantie illimitée |
100 000 euros |
E2. Interventions de sauvetage du système financier : Garanties au fonctionnement du système bancaire
|
FRANCE |
ALLEMAGNE |
ITALIE |
ROYAUME-UNI |
ESPAGNE |
PAYS-BAS |
PORTUGAL |
IRLANDE |
|
320 milliards garantie sur créances émises par les banques |
400 milliards garantie sur prêt interbancaires à court terme (20 milliards provisionnés dans budget de l'Etat) |
20 milliards de garantie du Trésor sur créances émises avant 2009 par les banques Banque d'Italie fournit 40 milliards pour ligne de financement spécial auprès BCE |
312,5 milliards pour nouvelles créances de court-moyen terme émises par les banques + 125 milliards pour permettre échange d'actifs non liquides contre bons du Trésor |
100 milliards garantie sur nouvelles créances émises par les banques |
200 milliards garantie sur prêt interbancaire |
20 milliards garantie sur prêt interbancaire |
400 milliards garantie sur dettes des 6 principales banques nationales ainsi que des banques étrangères avec présence « significative » sur territoire |
E3. Interventions de sauvetage du système financier : Recapitalisation des banques et rachat d'actifs (milliards d'euros et points de PIB)
|
FRANCE |
Allemagne |
ITALIE |
ROYAUME-UNI |
ESPAGNE |
PAYS-BAS |
BELGIQUE |
|
40 milliards pour recapitalisation par titres de la dette subordonnée (dont 10,5 milliards pour les 6 principales banques) |
100 Fonds d'état dont 20 milliards pour Rachat d'actifs risqués |
Possible pour banques en crise avec actions de préférence |
62,5 milliards pour améliorer ratios des banques (Tier-One) dont 46 pour sauver 3 banques (RBS, HBOS, Lloyds) |
50 milliards pour rachat d'actifs |
20 milliards |
4,7 milliards |
|
2 points de PIB |
4 points de PIB |
Pas de chiffrage |
3,4 points de PIB |
4,5 points de PIB |
3,4 points de PIB |
1,3 point de PIB |
C'est là le paradoxe du désendettement. En cherchant à réduire leurs ratios d'endettement en même temps, les agents pèsent sur l'activité. Et le freinage de l'activité atténue ou annule la réduction recherchée initialement. La recherche de cet objectif, qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on essaye de s'en rapprocher, peut installer les économies développées sur une trajectoire de croissance faible pendant plusieurs années. Elle peut se doubler d'une déflation qui renforcera encore le processus dépressif.
Face à la contraction des dettes privées, la seule solution est un plan de relance budgétaire. Macro-économiquement, il s'agit simplement de substituer à la dette privée que personne ne veut détenir une dette publique que tout le monde recherche. Micro-économiquement, ce qui a été fait par le développement de l'Etat-providence dans les années d'après-guerre reste à inventer aujourd'hui.
Le tour de l'économie non financière
Selon notre scénario, l'économie mondiale s'engagerait dans un ralentissement prononcé, entraîné par une récession aux Etats-Unis. S'y ajouteront un tassement de la croissance des pays émergents - touchés à des degrés divers par la crise financière mais surtout impactés par le fort ralentissement de la demande adressée par les pays riches, moteur de leur croissance passée devenu frein de leur croissance future - et le retour de l'atonie de la zone euro, après la rémission de 2006-2007.
Les Etats-Unis profiteront du plan de relance mis en place par l'administration Bush, mais ses effets positifs avérés au premier semestre 2008 n'empêcheront pas la survenue de deux trimestres consécutifs de recul du PIB dans la seconde moitié de l'année. En dégradant l'acquis de croissance, cette récession se traduira par une croissance en moyenne annuelle en 2009 de 0,4 %. Avec une croissance de 1,1 % en 2008 contre 1,4 % pour les Etats-Unis, la zone euro perdra l'avantage de l'écart de croissance positif avec les Etats-Unis apparu en 2007, respectivement 2,6 contre 2 %. La réactivité de la politique économique aux Etats-Unis, dont la zone euro est dépourvue, sera à l'origine de cette meilleure performance en 2008. Mais les tendances dépressives outre-Atlantique, plus accentuées qu'en Europe car conduites par une crise immobilière plus aiguë, retrouveront leur plein effet une fois dissipées les impulsions du plan de relance. L'économie américaine stagnerait quasiment en 2009, quand la zone euro bénéficiera d'une croissance un peu meilleure, 0,8 %.
Le ralentissement des grandes économies industrialisées pèsera sur la croissance des pays émergents, entraîné par les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), d'abord par le canal traditionnel du commerce extérieur. Ensuite, même si la crise financière y est moins virulente que dans les pays développés, il est peu probable que ces pays passent complètement au travers de turbulences qui revêtent un caractère mondial. Mais les économies émergentes resteront nettement plus dynamiques que les économies développées, profitant notamment de réformes mises en place pour soutenir la demande intérieure. Au total, la croissance dans les pays émergents passerait de 8 % en 2007 à 6,5 % en 2008 et à 5,9 % en 2009, un rythme d'expansion sensiblement plus élevé que dans les pays développés, 1,3 en 2008 et 0,7 % en 2009.
Les Etats-Unis : le coeur de la crise
Epicentre du tremblement de terre financier mondial, l'économie américaine n'a résisté qu'en apparence au premier semestre 2008, et sera rattrapée par la crise dans les mois à venir.
Les bonnes performances du premier semestre (+0.2 % et +0.8 % aux premier et deuxième trimestres) ont été artificiellement entretenues par le plan de relance appliqué à partir du 28 avril 2008. La distribution de presque 90 milliards de dollars aux ménages américains a ainsi tiré la consommation tout en permettant un léger redressement du taux d'épargne. Mais dans le même temps, la dégradation du marché du travail (le taux de chômage est passé de 4,8 % en février à 6,1 % en août, et les revenus du travail ont baissé de 0,3 % au deuxième trimestre) et la poursuite de la crise immobilière annoncent un net ralentissement pour les 3 prochains trimestres, qui se traduira par une croissance de 1,6 % en 2008 et de 0,8 % en 2009.
Une fois les effets du plan de relance épuisés, les ménages seront handicapés par un revenu disponible réel amoindri, une inflation en forte hausse, et seront contraints de se désendetter par le gel des emprunts hypothécaires. La crise immobilière, qui a conduit à une baisse de 15 % des prix immobiliers en un an, devrait perdurer jusqu'à la fin de l'année, avant un rétablissement progressif courant 2009. La consommation des ménages ne devrait donc progresser que de 0,9 et 0,3 % en 2008 et 2009, après 2,8 % en 2007. Dans ces conditions, les entreprises adapteront leurs capacités productives à la contraction des débouchés, et devront trouver une alternative au crédit bancaire si les tensions sur le marché interbancaire perduraient. Elles seront donc amenées à réduire leur investissement à l'horizon de notre prévision (+1,5 % en 2008 et -6,5 % en 2009). L'amélioration du commerce extérieure due à la forte dépréciation du dollar au cours des dernières années devrait pourtant tenir les Etats-Unis à l'abri de la récession, avec l'appui, à partir de la mi-2009, de la reprise de la demande intérieure et du marché immobilier.
L'Europe n'amortit pas le choc
La plupart des pays de la zone euro n'échapperont pas non plus au ralentissement, la zone ne croissant que de 1,2 % en 2008 et 1 % en 2009.
Parmi les grands pays, l'Allemagne se distingue pourtant. Avec une croissance de 1,7 % en 2008 et de 1,3 % en 2009, elle devrait jouer le rôle de stabilisateur au sein de la zone. Comme tous les pays de la zone euro, l'Allemagne a été affectée par le ralentissement de la consommation des ménages consécutif à la poussée d'inflation enregistrée au premier semestre 2008. Championne européenne du commerce extérieur, elle pâtit également du ralentissement de la demande mondiale, comme le montrent déjà les indicateurs de commandes étrangères. Cependant, elle devrait mieux résister aux turbulences internationales que ses partenaires européens : d'abord grâce à la solidité de la situation de ses entreprises, que le redressement du taux de marge depuis 2000 et la politique de désendettement mettent à l'abri du durcissement des conditions de financement externe. Ensuite, l'inertie du cycle immobilier allemand durant la phase d'exubérance qui a marqué les autres pays européens devrait en contrepartie la protéger du retournement attendu ailleurs. En outre, le redémarrage des salaires, après presque une décennie de contraction, contribuera à assurer à l'Allemagne l'une des meilleures performances de la zone.
Le retournement conjoncturel sera en revanche beaucoup plus brutal dans les autres grands pays de la zone. Outre le ralentissement de la consommation des ménages consécutif à l'accélération de l'inflation, le retournement des anticipations d'évolution de la demande et le durcissement des conditions d'emprunt ont fortement pesé sur l'investissement productif, qui s'est infléchi au deuxième trimestre 2008 et devrait poursuivre sa dégradation à l'horizon de la prévision. En effet, la baisse du taux d'autofinancement des entreprises européennes - à l'exception de celui des entreprises allemandes - les exposera à une contrainte de désendettement en cas de concurrence accrue sur les sources de financement et de retournement des rentabilités relatives des actifs ayant permis l'effet de levier. Si l'Allemagne voit son taux d'investissement augmenter à l'horizon de la prévision, l'ajustement à la baisse de l'accumulation du capital en France et en Espagne et sa stabilisation en Italie conduiront à une légère contraction dans la zone euro.
Par ailleurs, les pays dont la croissance avait été tirée par le dynamisme immobilier depuis la fin des années 1990, comme la France, l'Italie, ou plus encore l'Espagne et l'Irlande, devraient subir durement les conséquences de la crise financière. Le resserrement de la politique monétaire entamé à la fin de 2005, conjugué aux effets de la crise financière sur la distribution du crédit par les banques, a provoqué un retournement du marché immobilier dans ces pays, qui devrait avoir de lourdes conséquences. D'abord, il pèsera sur l'investissement en logement. Ensuite, il aura des conséquences sur le marché du travail de ces pays, par le biais de destructions d'emplois dans le secteur de la construction, et pèsera donc sur la consommation des ménages, déjà handicapée par l'inflation du premier semestre.
Même constat au Royaume-Uni, dont la croissance ralentirait très fortement à l'horizon de notre prévision (+1 % et +0,2 % en 2008 et 2009). A la hausse mondiale des prix s'est ajoutée en Grande-Bretagne la dépréciation de la livre sterling, poussant l'inflation à 4,7 % au mois d'août 2008, ce qui a pesé sur la consommation, contrainte en outre par le fort endettement des ménages. Le pays a été particulièrement touché par le retournement immobilier (avec une baisse de 12 % sur un an en août 2008 des prix immobiliers), et la contraction de l'investissement en logement devrait se poursuivre à l'horizon de la prévision. Comme en zone euro, le retournement des perspectives économiques ainsi que le resserrement du crédit mettront un frein à l'investissement productif, mais la réaction des autorités britanniques à la crise bancaire que connaît le pays depuis la nationalisation de Northern Rock va dans le sens d'un retour progressif à la normale dans le secteur financier.
Les pays émergents
Forts de fondamentaux beaucoup plus solides que lors du ralentissement de la fin des années 1990, les pays émergents ont à ce jour bien résisté à la crise financière internationale. Pour autant, la thèse du découplage semble aujourd'hui mise à mal par les signes de ralentissement économique, et par l'extrême volatilité des bourses dans ces pays. Via la dégradation de la demande mondiale et le resserrement des conditions de crédits, leurs économies devraient être affaiblies à l'horizon de notre prévision.
Tirant les leçons des crises précédentes, nombre de pays émergents ont largement réduit leur dépendance aux capitaux étrangers au cours des années 1990, et les pays d'Amérique latine, comme ceux de la CEI, conjuguent aujourd'hui excédents courants, investissements directs étrangers massifs et accumulation d'importantes réserves de change.
Les pays détenteurs de ressources naturelles, tels que la Russie ou le Brésil, ont ainsi profité du prix des matières premières pour rétablir leur balance courante et se constituer d'importantes réserves de change. Fortes de systèmes bancaires assainis, ces économies ont eu les moyens pour l'instant de prendre les mesures qui s'imposaient pour parer à la tornade financière et aux rapatriements massifs de capitaux étrangers : la Banque centrale brésilienne a ainsi irrigué le marché interbancaire et soutenu les banques en difficulté. Tandis que le gouvernement russe a décidé de faciliter l'accès aux crédits des banques et des entreprises russes, fortement endettées à l'étranger. Néanmoins, la dégringolade depuis juillet 2008 des bourses russe, -60 %, et brésilienne, -40 %, et les importantes sorties de capitaux pèseront sur les économies de ces pays émergents. Surtout, le principal risque qui pèse sur ces pays exportateurs réside dans la baisse des prix des matières premières, qui devrait être accentuée par le ralentissement mondial. Les produits primaires représentent ainsi plus de 70 % des exportations du Venezuela, de la Bolivie et de l'Equateur. Dernière source de ralentissement, le dynamisme de la demande intérieure dans ces pays a renforcé la hausse des prix alimentaires et énergétiques, et l'inflation y dépasse partout les 15 %. Si le ralentissement des prix des matières premières devait contribuer à apaiser les tensions sur les prix, la plupart des pays d'Amérique latine devraient cependant être contraints à procéder à des resserrements monétaires.
Les pays d'Europe centrale, en revanche, semblent globalement plus sensibles que les précédents aux aléas des économies occidentales et demeurent très exposés à la fois à un ralentissement de la demande mondiale et aux désordres bancaire et financier internationaux. Les nouveaux pays membres (NPM) de l'Union européenne ne bénéficient pas d'importantes ressources naturelles, et présentent souvent de très forts déficits courants, les exposant aux mouvements de capitaux étrangers et les rendant vulnérables au durcissement des conditions de crédit. Les pays baltes sont ainsi d'ores et déjà entrés en récession, à la suite du retournement immobilier engendré par les difficultés d'accès au crédit. Si les principaux NPM bénéficient aujourd'hui de fondamentaux solides, la Roumanie, la Bulgarie ou encore la Hongrie présentent encore des déséquilibres externes importants, financés par de l'endettement externe. Si nous ne retenons pas le scénario de fuites massives de capitaux et d'attaques sur le marché des changes, ces pays restent cependant vulnérables à l'évolution de la crise financière et devraient ralentir nettement, à 3,9 et 2,6 % en 2008 et 2009 (contre 6,1 % en 2007).
Riches en main-d'oeuvre plus qu'en matières premières, les pays asiatiques, au premier rang desquels la Chine, ont eux aussi fondé leur croissance sur des excédents commerciaux massifs. Comme les pays exportateurs de matières premières, ils ont souffert au premier semestre de l'accélération de l'inflation, renforcée par une demande intérieure extrêmement dynamique. En revanche, ces pays semblent moins exposés à la crise financière mondiale, leur secteur bancaire étant encore très peu développé. C'est donc essentiellement le ralentissement de la demande mondiale et l'appréciation de leurs monnaies à la suite du ralentissement américain qui pèseront sur les économies asiatiques. Elles conserveront néanmoins les taux de croissance les plus élevés du monde à l'horizon de notre prévision (en 2008 et 2009,+9,9 et +9,2 % pour la Chine, +7,6 % et +7,3 % pour l'ensemble de la zone).
II.2. En France
La conjonction de chocs économiques violents qui se sont succédé depuis l'été 2007 (crise financière internationale initiée par l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, envolée du prix des matières premières, nouveau recul du dollar par rapport à l'euro) a cassé l'élan de croissance amorcé en 2006 en zone euro et hypothèque tout espoir de reprise en France en 2008 et 2009.
Après un recul du PIB de 0,3 % au deuxième trimestre, les enquêtes de conjoncture confirment pour le second semestre la poursuite du repli de l'activité. Si contrairement à celui des ménages, le niveau de confiance des industriels a longtemps résisté aux événements de 2007, laissant espérer une sortie rapide de ce ralentissement, celui-ci a lâché prise depuis six mois. La crise financière et ses répercussions sur l'environnement économique international affectent désormais de façon très concrète les entreprises industrielles et les ménages français (graphique 5).
5. Evolution de la confiance...
Solde d'opinion, Centré réduit

Source : INSEE.
Quelles sont les raisons de ce ralentissement ?
Les raisons de ce ralentissement sont connues et ne sont pas propres à la France. Elles sont au nombre de quatre :
• L'envolée du prix des matières premières, avec notamment un pétrole qui a renchéri de moitié au premier semestre 2008, se traduisant par un regain d'inflation qui vient rogner le pouvoir d'achat des ménages et par là leurs dépenses ;
• La crise financière internationale initiée par l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis ;
• Une nouvelle appréciation de l'euro, qui en prenant plus de 10 % face au dollar au cours du premier semestre 2008, a mis à bas une compétitivité des entreprises européennes déjà mal en point ;
• La baisse des prix de l'immobilier aux États-Unis mais aussi en Espagne, au Royaume-Uni et dans une moindre mesure en France. Cette contraction de l'immobilier se répercute sur l'ensemble de l'économie à travers celle de l'activité dans le bâtiment, le ralentissement de l'investissement en logement et de la consommation des ménages par le canal de l'effet de richesse ;
3. Les causes du ralentissement en 2008 et 2009
En point de %
|
2008 |
2009 |
|
|
Impact sur le PIB dû... |
||
|
... à l'envolée des prix des matières premières |
-1.1 |
-0.3 |
|
Effet direct sur l'économie française |
-0.6 |
-0.1 |
|
Effet via la demande adressée |
-0.5 |
-0.1 |
|
... à l'appréciation de l'euro |
-0.3 |
-0.2 |
|
Effet direct sur l'économie française |
-0.1 |
-0.1 |
|
Effet via la demande adressée |
-0.1 |
-0.1 |
|
... à la baisse des prix de l'immobilier |
-0.2 |
-0.9 |
|
Effet direct sur l'économie française |
-0.1 |
-0.4 |
|
Effet via la demande adressée |
-0.1 |
-0.5 |
|
... à la répercussion de la crise financière |
-0.6 |
-1.2 |
|
Effet direct sur l'économie française |
-0.2 |
-0.5 |
|
Effet via la demande adressée |
-0.4 |
-0.7 |
|
Impact total sur la croissance |
-2.2 |
-2.6 |
Note : Ces calculs d'impacts doivent se lire en référence à la production potentielle
Sources : INSEE ; calculs OFCE e-mod.fr.
Ces différents chocs ont tous un double impact sur l'économie française : le premier est direct, touchant le pouvoir d'achat, le recours au crédit des agents privés français ou leur compétitivité. Le second passe par le canal du commerce extérieur : ces chocs étant communs à l'ensemble de l'économie mondiale, son ralentissement provoque un tassement de la demande étrangère adressée à la France (graphique 6).
6. Environnement international
En %, glissement annuel

Sources : Comptabilités nationales, calculs et prévisions OFCE.
D'un choc sur le pouvoir d'achat en 2008...
L'économie française souffrirait principalement en 2008 de l'envolée du prix des matières premières (tableau 3). Celle-ci est la principale responsable du regain d'inflation qu'ont connu les économies occidentales. En France comme en Europe, l'indice des prix à la consommation a connu son point haut en juillet, s'établissant à 3,6 %, rythme jamais atteint depuis les années 1980 alors que dans le même temps l'inflation sous-jacente se maintenait en deçà de la barre des 2 % (graphique 7).
7 Forte augmentation des prix et taux d'épargne en France
En %, glissement annuel En % du RDB
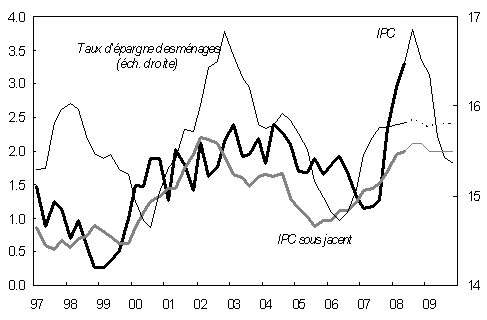
Sources : INSEE, calculs et prévisions OFCE.
Absorbé principalement par les ménages, ce choc inflationniste contractera leur pouvoir d'achat. Son impact sera maximal au troisième trimestre 2008, conduisant à un recul d'environ 1,6 point de la croissance du RDB réel en glissement annuel.
En limitant la dépense des ménages, ce regain d'inflation amputera de plus d'un demi-point la croissance dans l'hexagone. Ce mécanisme est également à l'oeuvre dans les autres pays occidentaux et notamment européens, provoquant de la même manière un ralentissement de leur économie et donc de leur demande adressée à la France. Au total, le choc inflationniste coûtera plus d'un point de croissance à l'économie française en 2008, soit plus de la moitié du ralentissement de l'activité (tableau 3). À titre de comparaison, les retombées économiques de la crise financière pour la France en 2008 seraient deux fois moindres que celles liées à l'accélération des prix, et finalement d'une ampleur comparable à celles résultant de l'appréciation de l'euro ou de l'amorce de la contraction des prix de l'immobilier (tableau 3).
En 2008, ce choc inflationniste sera couplé à une détérioration sur le front de l'emploi avec notamment de très fortes suppressions d'emplois aidés dans le secteur non marchand.
... à un choc de désendettement en 2009
Si l'année 2009 devait souffrir des mêmes maux, leur hiérarchie pourrait changer, modifiant alors la perspective d'analyse et les remèdes.
C'est ainsi que l'envolée des prix du pétrole et des matières premières alimentaires, qui a donné à l'inflation un profil spectaculaire, était en grande partie due à des mouvements de rattrapage ou spéculatifs et serait donc la résultante d'effets ponctuels. Sous l'hypothèse que le prix du pétrole se stabilise autour de 100 dollars le baril, soit 69 euros, et que les produits alimentaires rejoignent progressivement un rythme de hausse plus conforme à leur évolution de long terme, l'inflation devrait avoir atteint un pic en juillet 2008 pour ensuite entamer une décrue toute aussi spectaculaire que la hausse précédente, aidée en cela par l'apparition d'une base de calcul des évolutions annuelles plus favorable à partir du quatrième trimestre 2008 (graphique 7). Cette inversion de tendance ne compensera certes pas les pertes passées du pouvoir d'achat mais limitera son effet asphyxiant pour les ménages français et européens.
Par ailleurs, l'appréciation récente du dollar face à l'euro ne devrait pas se démentir et le taux de change devrait se stabiliser à 1,45 dollar pour un euro. Compte tenu du délai de transmission du taux de change à l'économie réelle, les bénéfices de cette baisse de l'euro se matérialiseront au cours de l'année 2009, desserrant également la contrainte de change sur l'activité au cours de l'année prochaine.
En revanche, les répercussions des crises financière et immobilière sur l'économie française devraient s'amplifier en 2009.
Le retournement de l'immobilier aux États-Unis, qui a débuté il y a 18 mois, n'est toujours pas achevé actuellement et devrait perdurer au cours de l'année 2009. Pire, alors que les économies européennes étaient jusqu'alors épargnées par le retournement, l'immobilier européen donne à son tour des signes inquiétants. C'est le cas bien sûr en Espagne et au Royaume-Uni mais aussi, dans une moindre mesure, en France.
Le prix de l'immobilier dans l'hexagone devrait connaître une correction significative d'ici à la fin 2009 (-15 %, graphique 8), permettant aux rendements locatifs de combler l'écart enregistré depuis 2006 avec les rendements obligataires 91 ( * ) .
8. Evolution des prix de l'immobilier en France
En glissement annuel

Sources : Notaires, INSEE, calculs et prévisions OFCE.
Enfin, si dans notre scénario central la crise financière ne dégénère pas en crise systémique ni même en « crédit crunch », son impact sur l'activité française sera important en 2009, comparable à celui du choc inflationniste pour 2008 (plus d'1 point de PIB, tableau 3).
Ainsi, si la restriction des crédits bancaires accordés aux agents économiques, affichée dans les enquêtes effectuées auprès des banques, ne se matérialise pas encore dans les données d'endettement bancaire - l'encours de crédit total accordé aux entreprises a progressé en glissement annuel de près de 15 % en avril dernier (graphique 9) -, certains éléments laissent entrevoir un ralentissement dans les mois à venir, déjà perceptible pour les ménages (graphique 10).
9 Financement des SNF en France
En %, glissement annuel
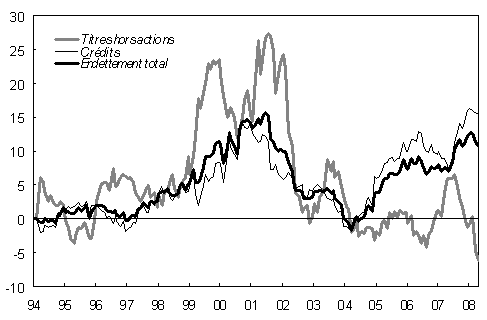
Sources : BdF, calculs OFCE.
10 Crédit aux ménages français
En %, glissement annuel

Sources : BdF, calculs OFCE.
Parmi ceux-ci, la grande lenteur de la normalisation du marché interbancaire rend plus difficile le financement des banques qui devraient durcir à nouveau les conditions d'accès au crédit. Ce nouveau durcissement, dans un contexte de dégradation des profits et d'un fort endettement des entreprises (graphique 11), devrait inciter ces dernières à freiner leurs investissements (effet d'accélérateur financier et de demande).
11 Comparaison et évolution des taux d'endettements bruts
En point de PIB

Note : La dette des APU est une dette brute qui tient compte de l'ensemble du passif des APU contrairement à la définition plus restreinte retenue pas les critères de Maastricht. Cela permet de comparer les pays européens aux États-Unis.
Sources : Comptes nationaux, calculs OFCE.
En ne parvenant pas à croître au-delà de son potentiel, l'activité ne permettra pas la poursuite de la décrue du chômage engagée à la mi-2005. La progression modérée de la population active limitera toutefois la hausse du taux de chômage qui devrait s'établir à 7,9 % de la population active en 2009. De son côté, le déficit public devrait dépasser la barre des 3 % du PIB en s'établissant à 3,5 % en 2009.
III. Présentation des résultats macro-économiques à moyen terme (2010-2013)
III.1. Le scénario central
L'évolution du PIB et de ses principales composantes est décrite dans le tableau 4 ci-dessous :
4 - Evolution du PIB et de ses principales composantes 2007-2013
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
PIB en volume |
2,1 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,7 |
1,8 |
2,5 |
|
Importations |
6,2 |
2,2 |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
4,5 |
5,1 |
2,3 |
|
Consommation des ménages |
3,1 |
1,5 |
1,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
1,4 |
2,6 |
2,7 |
|
FBCF des SNF-EI |
7,2 |
2,3 |
2,3 |
5,8 |
5,3 |
4,9 |
4,9 |
1,6 |
3,3 |
5,2 |
|
Exportations |
3,1 |
2,0 |
2,2 |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,4 |
5,8 |
3,5 |
2,5 |
|
Contributions |
||||||||||
|
Demande intérieure hors stocks |
3,2 |
1,3 |
1,2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,6 |
2,5 |
2,5 |
|
Solde extérieur |
-1,0 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
|
Variations de stocks |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A moyen terme (2010-2013) et compte tenu des contraintes portant sur les finances publiques, il est supposé que la croissance se stabilise à un niveau supérieur à son potentiel, passant de 1,8 % à 2 % avec l'accélération supposée de la productivité du travail induite de l'augmentation du taux d'investissement.
Le tableau 4 reprend pour référence les moyennes constatées sur les cycles précédents : 1989-99 et 1999-2009. On constate que, en l'absence d'impulsion positive de la politique économique et à croissance de l'activité identique, ce scénario implique un comportement des agents privés nettement plus dynamique que dans l'histoire récente.
Dans ce scénario, la FBCF des sociétés non financières (SNF) devrait fortement s'accélérer (5,2 % en moyenne annuelle contre 1,6 % dans les années 90 et 3,3 % au cours des dix dernières années). Dans le même temps la consommation des ménages devrait retrouver un rythme soutenu, deux fois supérieur à celui enregistré au cours de la décennie 90 (2,7 % en moyenne contre 1,4 % dans les années 90).
Le tableau 5 décrit l'évolution des contributions à la croissance du PIB en projection :
5 - Contribution à la croissance 2007-2013
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
PIB en volume |
2,1 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,7 |
1,8 |
2,5 |
|
Importations |
-2,0 |
-0,7 |
-0,9 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,7 |
-1,1 |
-1,6 |
-0,8 |
|
Dépenses des ménages |
2,0 |
0,7 |
0,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
0,8 |
1,7 |
1,7 |
|
Dépenses des administrations |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
|
Investissement des entreprises |
0,8 |
0,3 |
0,2 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
0,7 |
|
Exportations |
0,9 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
1,3 |
1,1 |
0,8 |
|
Variations de stocks |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
|
Demande intérieure |
3,2 |
1,1 |
1,2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,4 |
2,4 |
2,5 |
|
Solde extérieur |
-1,0 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
III.2. Le scénario « bas »
Dans ce scénario, la croissance est plus faible. Le PIB croît de 1,8 % en volume par an au cours de la période 2010-2013, rythme comparable à celui enregistré au cours des dix dernières années. Nous supposons ici que les partenaires de la France connaissent également le même supplément de croissance, impliquant une contribution toujours neutre du commerce l'extérieur.
4bis - Evolution du PIB et de ses principales composantes 2007-2013
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
PIB en volume |
2,1 |
1,0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
|
Importations |
6,2 |
2,2 |
1,5 |
1,5 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
4,5 |
5,0 |
1,8 |
|
Consommation des ménages |
3,1 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
1,4 |
2,5 |
2,0 |
|
FBCF des SNF-EI |
7,2 |
2,3 |
-2,2 |
-0,1 |
2,5 |
2,0 |
1,7 |
1,6 |
2,9 |
1,5 |
|
Exportations |
3,1 |
2,0 |
1,7 |
1,7 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
5,8 |
3,5 |
2,0 |
|
Contributions |
||||||||||
|
Demande intérieure hors stocks |
3,2 |
1,3 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,6 |
2,4 |
1,8 |
|
Solde extérieur |
-1,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
|
Variations de stocks |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
12. Taux de croissance du PIB ...
En %, moyenne annuelle

Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Le tableau 5bis décrit l'évolution des contributions à la croissance du PIB en projection. La plus faible contribution à la croissance des dépenses des agents privés (0,2 point de l'investissement des entreprises contre 0,7 dans le compte central et 1,2 % de la consommation des ménages contre 1,7 % dans le compte central), explique l'écart de croissance avec le compte central.
5bis - Contribution à la croissance 2007-2013
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
PIB en volume |
2,1 |
1,0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
|
Importations |
-2,0 |
-0,7 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,6 |
-1,1 |
-1,6 |
-0,6 |
|
Dépenses des ménages |
2,0 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,8 |
1,6 |
1,2 |
|
Dépenses des administrations |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
Investissement des entreprises |
0,8 |
0,3 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
|
Exportations |
0,9 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
1,3 |
1,1 |
0,6 |
|
Variations de stocks |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
|
Demande intérieure |
3,2 |
1,1 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
2,3 |
1,8 |
|
Solde extérieur |
-1,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A. Les ménages
Face aux soubresauts des prix de l'énergie et de l'alimentation, les ménages ont réduit leur consommation au premier semestre 2008, d'abord en amputant leur consommation de carburants, puis en reportant sur d'autres postes le surcoût de la consommation énergétique incompressible. De près de 5 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2007, la progression de la consommation de produits manufacturés est tombé à 1,5 % au deuxième trimestre 2008, son rythme le plus faible de ces dix dernières années. Sur un champ exhaustif, c'est-à-dire incluant tous les postes de consommation des ménages et non plus les seuls produits manufacturés, les comptes nationaux décrivent un recul de la consommation dans la première moitié de 2008, -0,1 % chaque trimestre.
13. Consommation des ménages
En %, t/t-4
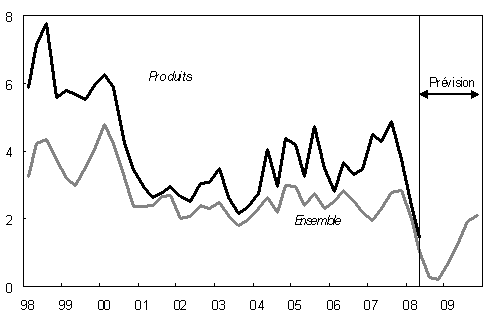
Source : INSEE, prévisions OFCE.
La croissance française a ainsi perdu un de ses moteurs les plus actifs durant la décennie 2000. S'il n'était que ponctuel, car lié au pic d'inflation, ce ralentissement ne nourrirait pas d'inquiétude au-delà du troisième trimestre 2008. Mais même si elles se redressent en 2009, les dépenses pourraient être durablement affectées par les chocs immobilier et financier, et ne retrouveraient pas leur dynamisme antérieur. Le taux d'épargne, sur la baisse duquel s'est appuyée la solidité de la consommation depuis 2002, devrait interrompre sa décrue, sous l'influence notamment de l'inversion du cycle immobilier et de la montée de l'incertitude.
A.1. Scénario central
Le RDB porte, dans ce scénario, la marque de la faiblesse des prestations sociales inscrite dans la programmation pluriannuelle des finances publiques.
Dans ce scénario, la plus forte croissance de la productivité du travail se transmet aux salaires ce qui soutient le revenu des ménages. Cette progression du revenu permet à la consommation des ménages de croître à un rythme supérieur à celui anticipé dans le scénario central. L'effort demandé aux ménages est toutefois fort : le taux d'épargne baisse de près de 2 points entre 2009 et 2013.
6 - Principales caractéristiques de l'évolution du compte des ménages
|
En volume, en % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Revenu disponible brut |
4,0 |
1,8 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
2,3 |
2,0 |
1,8 |
2,6 |
2,2 |
|
Salaire réel |
3,1 |
1,4 |
0,8 |
2,2 |
2,6 |
2,4 |
2,3 |
2,1 |
2,3 |
2,4 |
|
Prestations sociales |
2,3 |
1,7 |
2,9 |
2,5 |
1,9 |
2,1 |
1,6 |
2,6 |
2,4 |
2,0 |
|
Consommation des ménages |
3,1 |
1,5 |
1,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
1,4 |
2,6 |
2,7 |
|
Taux d'épargne des ménages |
15,8 |
16,0 |
15,8 |
15,3 |
15,1 |
14,7 |
14,2 |
14,8 |
15,7 |
15,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A.2. Scénario « bas »
Dans un contexte d'incertitude et de hausse du chômage, la forte baisse du taux d'épargne des ménages inscrite dans le compte central apparaît peu probable. C'est pourquoi nous l'avons stabilisé dans le second scénario : à l'horizon de notre analyse, l'écart est de 2,5 point de RDB par rapport au scénario précédent.
14. Taux d'épargne des ménages...
En % du RdB
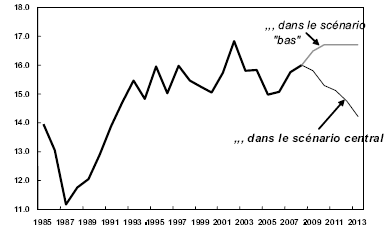
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Cela se traduit par une consommation des ménages certes moins dynamique que dans le scénario central (2,0 % en moyenne annuelle dans le scénario « bas » contre 2,7 % dans le scénario central) mais qui permet toutefois à la consommation de rester le principal moteur de la croissance française.
6bis - Principales caractéristiques de l'évolution du compte des ménages
|
En volume, en % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Revenu disponible brut |
4,0 |
1,8 |
2,0 |
1,4 |
2,4 |
2,2 |
2,2 |
1,8 |
2,7 |
2,1 |
|
Salaire réel |
3,1 |
1,4 |
1,0 |
1,0 |
2,2 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,3 |
1,9 |
|
Prestations sociales |
2,3 |
1,7 |
3,1 |
3,6 |
1,9 |
1,5 |
1,4 |
2,6 |
2,4 |
2,1 |
|
Consommation des ménages |
3,1 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
1,4 |
2,5 |
2,0 |
|
Taux d'épargne des ménages |
15,8 |
16,0 |
16,5 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
14,8 |
15,7 |
16,7 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
B. Les entreprises, l'emploi et le chômage
Après quatre années de croissance dynamique (5 % en moyenne en volume de 2004 à 2007 dont 7,3 % pour la seule année 2007), l'investissement des sociétés non financières (SNF) a atteint son point haut au premier trimestre 2008. Cette progression de l'investissement est allée de pair avec une hausse de l'endettement des entreprises. Cette dernière est entièrement imputable à l'expansion du crédit bancaire qui s'est accru de 25 points de VA alors même que les encours des titres de créance ont diminué de 6 points de VA. La part des titres de créance (obligations, billets de trésorerie...) qui représentait au début de l'année 2004, 36 % de la dette brute intérieure des SNF, n'était plus que de 22 % en avril 2008. La faiblesse des taux d'intérêts pratiqués par les banques entre 2004 et 2008 a conduit les entreprises à recourir massivement au crédit bancaire au détriment des autres types de financement, accentuant la part du crédit bancaire dans leur passif. Le retour à une intermédiation plus forte du système de financement des entreprises a donc créé une plus grande dépendance des entreprises vis-à-vis du comportement d'offre de crédit des banques. Paradoxalement, avec la naissance des turbulences financières, cette intermédiation du financement des SNF s'est même accentuée depuis l'été 2007. Contrairement aux résultats des enquêtes menées auprès des banques qui indiquaient un net resserrement des conditions de crédit, la crise financière n'a pas eu pour conséquence immédiate un ralentissement du recours au crédit mais, au contraire, une accélération de celui-ci en France (graphique 15).
15. Flux de financement de l'endettement des SNF
En milliards d'euros, cumulé sur quatre trimestres

Sources : Banque de France, calculs OFCE.
Un argument avancé pour justifier cette dynamique du crédit serait que les banques ont ouvert des lignes de crédit aux entreprises avant la crise et que ces dernières y ont eu largement recours, anticipant un durcissement futur des conditions de financement. Selon une étude de la Banque de France 92 ( * ) , deux phénomènes contribueraient également à accentuer ponctuellement la croissance du crédit depuis le début de la crise. Premièrement, les durées moyennes des emprunts bancaires des SNF ont diminué depuis l'été 2007. En effet, si les crédits à long terme sont la principale source du financement par endettement des SNF, l'accélération des crédits est en grande partie due aux crédits à court et moyen terme. Deuxièmement, le regain de dynamisme des crédits de moins de cinq ans peut s'expliquer en grande partie par le fait qu'ils se sont substitués aux émissions d'obligations (graphique 15). Selon la Banque de France, « la remontée du coût des émissions des titres de créance et les contraintes de financement rencontrées par les émetteurs sur des marchés toujours peu liquides et marqués par une forte volatilité des spreads 93 ( * ) ont contribué à soutenir temporairement le dynamisme du crédit ». L'écart entre le rendement des obligations privées notées BBB et le taux moyen des crédits nouveaux au SNF est en effet passé de moins de 0,5 point en août 2007 à plus de 1,5 point en avril 2008.
Depuis avril 2008, un début de ralentissement du marché du crédit semble s'amorcer. Le flux net de nouveaux crédits aux SNF (cumulé sur trois mois corrigé des variations saisonnières) qui représentait 24 milliards d'euros en mars 2008 a progressivement diminué les mois suivants pour atteindre moins de 15 milliards d'euros en juin 2008. Le ralentissement du crédit devrait s'accentuer dans les mois à venir pour deux raisons : avec le durcissement de la crise financière, les tensions sur le marché interbancaire vont amplifier la raréfaction des ressources pour les banques, ce qui va se traduire par une plus grande sélectivité dans l'offre de crédit. Couplée à un environnement macroéconomique très dégradé et à une hausse du coût du financement pour les entreprises, la demande de crédits des SNF devrait diminuer au second semestre 2008 et en 2009. Cette pression au désendettement des entreprises aura pour contrepartie une contraction de l'investissement et une remontée des taux d'autofinancement, ces derniers s'étant très nettement dégradés depuis 2003 (graphique 16). Le taux d'autofinancement a en effet chuté de 32 points depuis le premier trimestre 2003, pour s'établir à 57,6 au premier trimestre 2008, soit un niveau que l'on n'avait pas atteint depuis 1985.
16. Taux de marge et d'autofinancement des SNF
En % En % de la VA des SNF
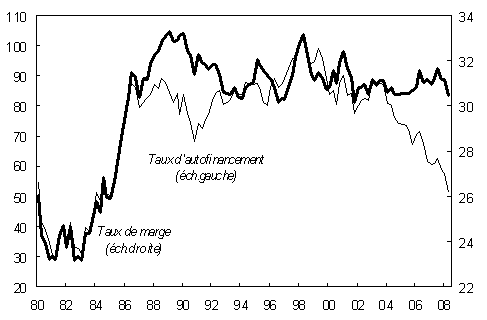
Sources : INSEE, comptes nationaux annuels.
Pourquoi le taux d'autofinancement a-t-il tant baissé depuis 2003 ?
Le taux d'autofinancement, calculé comme la part de l'investissement financée par les ressources internes de l'entreprise, a atteint un point haut en 1998. Depuis, ce dernier a baissé de façon tendancielle et cette baisse s'est accélérée à partir de 2003 en raison à la fois de la hausse du taux d'investissement et de la baisse simultanée du taux d'épargne des SNF. Tout d'abord, la baisse du taux d'épargne de 3,2 points de VA entre 2003 et 2007 ne s'explique pas par une baisse du taux de marge (graphique 16 et tableau 7). En effet durant cette période, celui-ci s'est même légèrement amélioré (0,2 point de VA). Les trois quarts de la baisse du taux d'épargne entre 2003 et 2007 s'expliquent par la hausse des revenus distribués, principalement les dividendes versées aux actionnaires, et par la hausse de l'impôt sur les bénéfices payé par les entreprises (tableau 7). La faiblesse du coût du capital durant cette période, en levant la contrainte d'une épargne élevée pour financer l'investissement, a permis aux entreprises de jouer sur le levier de l'endettement pour accroître la profitabilité de leur capital et pratiquer une politique généreuse de distribution de dividendes (hausse de 1,2 point de VA entre 2003 et 2007), ce qui a également permis d'accroître considérablement la valorisation boursière des entreprises. Deuxièmement, en raison de la hausse des profits, l'assiette fiscale des SNF a fortement accéléré, venant augmenter de 1,2 point de VA entre 2003 et 2007 la charge fiscale pesant sur les entreprises. En revanche, malgré une dette financière nette qui s'est accrue de 13 points de VA entre 2003 et 2007, les intérêts nets versés n'ont augmenté que de 0,5 point de VA grâce à des taux très bas sur toute la période.
La hausse de la FBCF de 2,7 points de VA entre 2003 et 2007 a également contribué à hauteur de 46 % à la chute du taux d'autofinancement.
En 2008 et 2009, le taux d'autofinancement devrait augmenter. Le resserrement du crédit va en effet freiner l'investissement et obliger les entreprises à accroître leurs ressources internes et donc à augmenter leur taux d'épargne. Pour accroître leur épargne sans modifier le taux de marge, les SNF peuvent compter sur deux composantes de leur revenu : premièrement, les dividendes versés en 2008 et 2009 devraient diminuer avec la baisse des profits des entreprises. De même, la réduction de l'assiette fiscale entraînerait un allègement de la charge fiscale pour les SNF.
7. Décomposition du taux d'autofinancement
En % de la VA des SNF
|
1998 |
2003 |
2007 |
Variation 2007-2003 |
|
|
Excédent brut d'exploitation |
32,4 |
31,0 |
31,2 |
0,2 |
|
Intérêts nets versés (-) |
3,4 |
2,6 |
3,1 |
0,5 |
|
Revenus nets distribués (-) |
6,0 |
6,8 |
8,0 |
1,2 |
|
Impôt sur le revenu (-) |
3,4 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
|
Autres (-) |
2,1 |
2,5 |
3,0 |
0,5 |
|
Epargne brute |
17,4 |
15,9 |
12,7 |
-3,2 |
|
Formation brute de capital fixe (FBCF) |
17,7 |
18,2 |
20,9 |
2,7 |
|
Taux d'autofinancement (épargne / fbcf) (%) |
98,6 |
87,4 |
60,7 |
-26,4 |
Sources : INSEE, calculs OFCE.
Les entreprises sont-elles surendettées ?
Depuis 2003, les SNF ont recouru massivement au crédit, augmentant ainsi leur taux d'endettement brut (au sens de la comptabilité nationale) de 28 points entre 2003 et 2007, le portant ainsi à 198 % de la VA en 2006 (graphique 17). La dette financière nette (une fois déduit du passif les crédits et titres hors actions à l'actif du bilan), qui sert d'assiette de calcul aux intérêts nets versés par les entreprises, n'a augmenté que de 13 points de VA dans le même temps, atteignant 106 % de la VA des SNF en 2007. La faiblesse des taux d'intérêt a donc permis aux entreprises d'utiliser le levier de l'endettement pour servir des dividendes mais aussi pour accumuler des actifs, notamment financiers.
La situation patrimoniale des entreprises nous apporte un éclairage différent quant à la capacité des entreprises à traverser la crise. En effet, entre 2003 et 2007, en raison des fortes réévaluations des terrains (plus de 60 %) ainsi que des logements et bâtiments (plus de 20 %), les actifs fixes ont augmenté plus vite que la dette financière nette. La dette financière nette rapportée aux actifs non financiers est en effet passée de 29 % en 2003 à 27 % en 2007, soit un niveau bas au regard de ces 13 dernières années 94 ( * ) (la moyenne étant à 31 %) (graphique 17). Cependant, la baisse de ce ratio durant cette période est en grande partie liée au fait que certains actifs non financiers ont connu une forte valorisation : l'augmentation de près de 50 % de la valeur des actifs non financiers entre 2003 et 2007 est imputable à plus de 70 % à la hausse des prix des terrains et de l'immobilier. En supposant que la seule valeur des terrains, logements et bâtiments avait augmenté entre 2003 et 2007 comme l'inflation, la dette financière nette rapportée aux actifs non financiers serait en 2007 de plus de 33 %, soit un niveau équivalent à celui de 2001 et supérieur à la moyenne de ces treize dernières années.
Jusqu'à présent, la bonne situation des entreprises reposait en grande partie sur la forte valorisation ces dernières années de certains actifs non financiers (terrains, bâtiments). Si le recours à l'endettement est d'autant plus facile lorsque les collatéraux s'apprécient rapidement, la chute de ces mêmes actifs peut révéler des situations d'endettement inquiétantes. Dans ces conditions, la seule façon d'assainir les bilans consiste à pratiquer une politique de désendettement visant à alléger le passif. Sans aucun doute, la première victime à court terme de ce rééquilibrage financier sera l'investissement.
17. Ratios d'endettement
En % de la VA des SNF En %
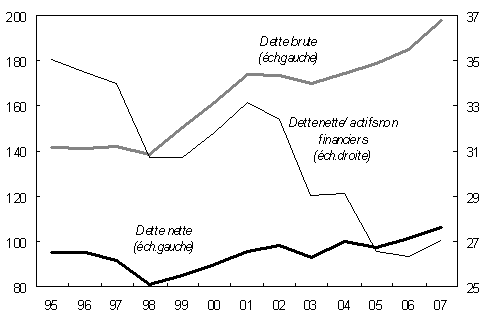
Sources : INSEE, calcul OFCE.
Le marché du travail
Du côté du marché du travail, au premier semestre 2008, la situation s'est dégradée, après une très bonne année 2007. L'emploi a d'une part été touché par les restrictions budgétaires sur les contrats aidés non marchands, qui se sont traduites par la destruction de 45 500 emplois en l'espace d'un semestre. Et d'autre part, l'emploi marchand s'est infléchi au cours du semestre, en raison du retournement de la conjoncture : après le ralentissement des créations d'emplois au premier trimestre, le marché du travail s'est retourné extrêmement rapidement, avec la destruction de 34 700 emplois au deuxième trimestre. Sur l'ensemble de l'économie, l'ampleur des destructions d'emploi atteint 18 000 emplois sur le semestre (contre 127 400 créations au second semestre 2007), avec un profil trimestriel très marqué (+31 900 au T1 et -50 000 au T2).
En conséquence, le taux de chômage en métropole, en baisse en début d'année, s'est stabilisé au deuxième trimestre à 7,2 %, contre 7,5 % fin 2007.
Le profil des créations d'emplois et du chômage met en évidence deux phénomènes :
1- L'économie française est aujourd'hui plus flexible que par le passé. En effet, alors que les modélisations usuelles indiquent un ajustement progressif de l'emploi à la conjoncture, les destructions d'emploi marchand ont eu lieu cette fois-ci quasi-instantanément.
2- Au premier semestre, l'emploi et le chômage ont baissé simultanément, ce qui impliquerait une baisse de la population active. Comment expliquer cette baisse de la population active observée alors que les projections de population active de l'INSEE prévoient une hausse de la population active en 2008 ?
Un ajustement plus rapide de l'emploi marchand
À la différence des phases de ralentissement précédentes, l'ajustement de l'emploi au retournement conjoncturel du deuxième trimestre a été important et quasi-instantané. À très court terme, les entreprises préfèrent en effet attendre la confirmation du ralentissement de l'activité avant de procéder à des réductions d'effectifs, et elles choisissent généralement d'ajuster les volumes horaires à l'évolution de la demande, via les heures supplémentaires notamment. L'ajustement du cycle de productivité à un choc de valeur ajoutée nécessite donc un délai de deux trimestres 95 ( * ) , comme l'illustre le graphique 18.
Dans le cas présent, l'ajustement opéré habituellement via les heures supplémentaires n'a pas eu lieu. Les chiffres de recours aux heures supplémentaires fournis par l'ACOSS montrent en effet que le volume d'heures supplémentaires s'est maintenu, et que l'ajustement des entreprises a été directement effectué sur l'emploi.
18- Croissances de l'emploi salarié marchand et du PIB
En %, t/t-4
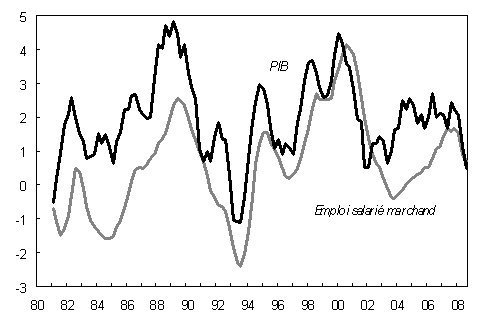
Source : Ministère du Travail, Comptes nationaux trimestriels.
Deux phénomènes permettent d'expliquer cette réactivité : la flexibilisation du marché du travail liée à l'expansion des contrats d'intérim et aux contrats de très courte durée d'une part, et d'autre part une bonne anticipation du retournement conjoncturel de la part des entreprises.
Première explication : la flexibilisation du marché du travail. Depuis la fin des années 1990, la part des emplois de courte durée a énormément augmenté. Le nombre d'intérimaires a plus que doublé en l'espace de 5 ans, et ils représentent aujourd'hui plus de 4 % de l'emploi total du secteur principalement marchand (contre 2 % en 1995, cf. graphique 19). De même, l'évolution des intentions d'embauches publiées par l'ACOSS montre que la part des CDD de moins d'un mois dans le total des intentions d'embauche est passée de 35 à 57 % entre 2000 et 2008, tandis que celle des CDI chutait de moitié. Cette flexibilisation du marché du travail a donc sans doute augmenté la réactivité de l'emploi à la conjoncture, en témoignent les chiffres détaillés de l'emploi : au T2, la baisse de l'emploi marchand est principalement due à de fortes destructions d'emplois intérimaires (-48 500, contre +12 100 au T1), alors que les autres emplois marchands ont continué leur progression (+ 29 400 emplois au T2, contre +49 000 au T1).
19 - Part de l'intérim dans l'emploi marchand et part des CDD de moins d'un mois dans le total des intentions d'embauche
En %
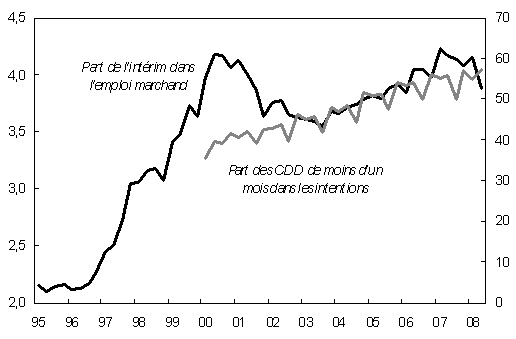
Source : Ministère du Travail, ACOSS.
Seconde explication : les employeurs ont vraisemblablement mieux anticipé le retournement conjoncturel qu'ils ne l'avaient fait par le passé, et ont ajusté l'emploi en conséquence, plus rapidement qu'ils ne le font habituellement. Le graphique 26 montre bien la forte coïncidence de la croissance du PIB et des perspectives d'emploi prévu par les employeurs lors des enquêtes de conjoncture dans l'industrie en 2008, contrairement à ce qu'on observait lors des cycles précédents.
L'anticipation du retournement conjoncturel conjuguée à un marché du travail plus flexible a donc conduit à un ajustement de l'emploi plus rapide qu'à l'accoutumée, ce qui permet d'affirmer qu'une part importante des destructions d'emploi liées à la chute du PIB au T2 ont déjà eu lieu. La reprise de la productivité marchande devrait donc être plus mesurée fin 2008 que ce que nous indiquerait une équation reproduisant les cycles de productivité antérieurs.
B.1. Scénario central
Les principales caractéristiques du compte des entreprises et de l'évolution de l'investissement sont reprises dans le tableau ci-dessous :
8 - Principales caractéristiques du compte des entreprises
|
En volume, en % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Taux d'investissement |
19,4 |
19,7 |
19,9 |
20,4 |
20,9 |
21,3 |
21,7 |
17,4 |
18,5 |
20,9 |
|
Investissement |
7,2 |
2,3 |
2,3 |
5,8 |
5,3 |
4,9 |
4,9 |
1,6 |
3,3 |
5,2 |
|
Taux d'autofinancement |
60,6 |
58,5 |
66,3 |
66,0 |
65,5 |
65,4 |
64,8 |
85,9 |
74,1 |
65,6 |
|
Taux de marge |
38,1 |
37,7 |
38,1 |
38,1 |
38,4 |
38,7 |
39,0 |
38,9 |
37,9 |
38,5 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Dans le scénario central, une croissance de l'activité de 2,5 % annuelle nécessite également un soutien de la part des entreprises. La croissance de l'investissement devrait être soutenue notamment au cours des deux premières années (2010-2011). Cela se traduit par une hausse sensible du taux d'investissement (0,5 point chaque année), qui atteindrait 21,7 % de la valeur ajoutée en 2013, niveau encore jamais atteint.
9 - Emploi et Chômage
|
Variations |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Emploi total (milliers) |
342 |
141 |
8 |
194 |
183 |
182 |
164 |
101 |
215 |
181 |
|
Emploi salarié (en %) |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
1,3 |
1,1 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,1 |
1,0 |
|
Population active (en %) |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
|
Taux de chômage (BIT) |
7,9 |
7,3 |
7,6 |
7,0 |
6,4 |
5,9 |
5,3 |
9,6 |
8,4 |
6,4 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Retenant 1,8 % comme hypothèse de progression annuelle de la productivité du travail et une progression de la population active de 0,1% par an, la croissance permettrait de créer suffisamment d'emplois (181 000 en moyenne annuelle) pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail et donc faire baisser le taux de chômage. Ce dernier s'établirait à 5,3 % en 2013.
20. Taux de chômage au sens du BIT ...
En % de la population active
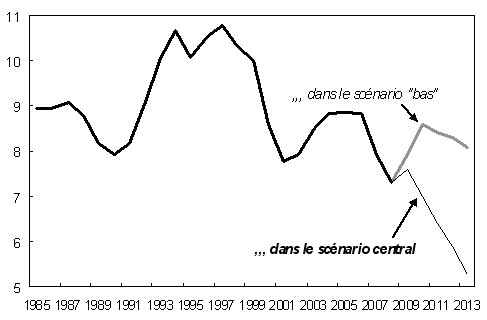
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
B.2. Scénario « bas »
Contrairement au comportement sous jacent dans le scénario central, il nous semble que la faiblesse des perspectives de croissance, conjuguée à l'assèchement progressif des sources de financement, notamment celle du crédit bancaire, conduirait les entreprises à poursuivre la réduction de leurs capacités de production au second semestre 2008 et en 2009. En lien avec la fin du cycle de l'endettement qui a largement alimenté l'investissement et « boosté » la rentabilité du capital des entreprises ces dernières années, la FBCF des sociétés non financière (SNF) devrait donc connaître un coup d'arrêt pour les trimestres à venir. Grâce à un acquis de croissance de 3,2 % au premier trimestre 2008, le taux de croissance de la FBCF resterait positif en 2008 (2,3 %). En 2009, l'investissement des entreprises devrait décroître de 2,2 %. Sous les effets négatifs de la déprime de la demande et des tensions sur le financement des entreprises, l'ajustement sur l'investissement serait donc brutal. Contraintes sur leur possibilité de recours au crédit bancaire ainsi que sur les débouchés de leur production, les entreprises devraient se désendetter, mettant ainsi fin à une ère de prospérité, la forte profitabilité des capitaux ayant été, par le passé, largement tirée par le levier de l'endettement. La baisse des profits pourrait permettre au price earning ratio (PER) (10,5 en moyenne en septembre 2008) de converger vers sa valeur d'équilibre (environ 15) sans pour autant accroître la valorisation des cours boursiers. Avec pour contrepartie au désendettement une réduction de l'investissement, le taux d'autofinancement des entreprises se redresserait de 13 points par rapport à 2008 pour atteindre près de 72 % en 2013, soit un niveau proche de celui de la mi-2005.
A l'instar des ménages, nous avons supposé une stabilisation du taux d'investissement à un niveau légèrement supérieur à 19 % de la VA, soit 2,6 points inférieur à celui retenu dans le compte central.
8bis - Principales caractéristiques du compte des entreprises
|
En volume, en % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Taux d'investissement |
19,4 |
19,7 |
19,2 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
17,4 |
18,4 |
19,1 |
|
Investissement |
7,2 |
2,3 |
-2,2 |
-0,1 |
2,5 |
2,0 |
1,7 |
1,6 |
2,9 |
1,5 |
|
Taux d'autofinancement |
60,6 |
58,5 |
64,2 |
68,3 |
69,4 |
70,6 |
71,8 |
85,9 |
73,9 |
68,9 |
|
Taux de marge |
38,1 |
37,7 |
37,7 |
37,8 |
37,9 |
38,0 |
38,0 |
38,9 |
37,9 |
37,9 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
21. Taux d'investissement des entreprises ...
En % de la VA

Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Cela permettrait aux entreprises de rétablir quelque peu leur taux d'autofinancement qui s'est fortement dégradé depuis 2000.
22. Taux d'autofinancement des entreprises ...
En % de la FBCF
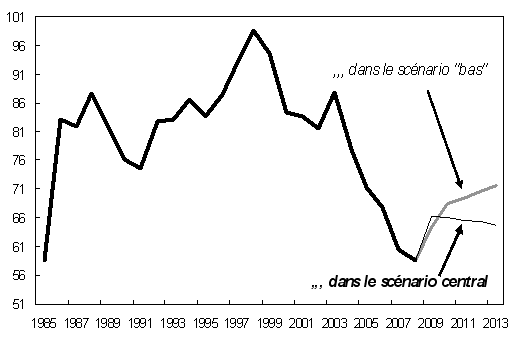
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
L'écart de croissance n'étant pas identique à celui de la productivité - qui se stabilise à 1,7 %, les créations d'emplois seraient bien inférieures que dans le compte central. Le taux de chômage finirait également à 8,1 % en 2013.
9bis - Emploi et Chômage
|
Variations |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Emploi total (milliers) |
342 |
141 |
-87 |
-169 |
84 |
68 |
68 |
101 |
206 |
13 |
|
Emploi salarié marchand (en %) |
1,6 |
0,8 |
-0,8 |
-1,0 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
1,0 |
-0,1 |
|
Population active (en %) |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
|
Taux de chômage (BIT) |
7,9 |
7,3 |
7,9 |
8,6 |
8,4 |
8,3 |
8,1 |
9,6 |
8,4 |
8,3 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
C. Les prix
L'inflation a effectué un retour remarqué depuis un an, passant de 1,2 % en août 2007 à 3,6 % en juillet 2008, niveau inégalé depuis le début des années 1990. Au-delà d'un effet technique lié au mode de calcul des évolutions d'une année sur l'autre qui amplifie le phénomène 96 ( * ) , la résurgence de l'inflation tient à la flambée du prix des matières premières énergétiques et alimentaires (graphique 23).
À la reprise du prix du pétrole en janvier 2007, s'est en effet ajouté un choc sur les produits alimentaires. À l'été 2008, la hausse du pétrole sur un an culminait à plus de 60 %, celle des matières premières alimentaires à près de 40 %. L'effet direct de cette poussée des prix sur les marchés internationaux a été un renchérissement des prix de vente au détail en France.
L'indice des prix énergétiques à la consommation s'est ainsi élevé de plus de 18 % sur un an à l'été 2007, celui des prix alimentaires de plus de 6 % sur la même période. Compte tenu du poids de ces deux composantes dans l'indice d'ensemble, 7,9 % pour l'énergie et 16,4 % pour les produits alimentaires, leur contribution à l'inflation atteinte à la mi-2008 - 3,6 % en juillet - s'élève respectivement à 1,5 et 1 point, soit au total 2,5 points.
23. Prix du pétrole et des matières premières alimentaires en euros
Janvier 2006 = 100
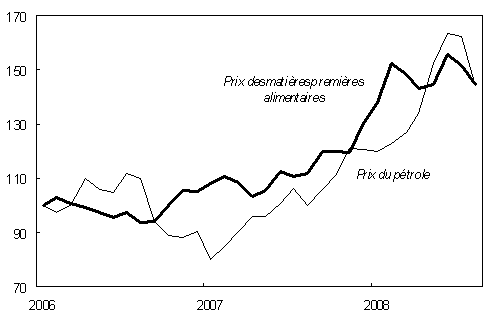
Source : Thomson Financial.
Les autres composantes de l'indice des prix ont, sur la même période, enregistré des évolutions qui dénotent l'absence de tensions inflationnistes majeures au sein de l'économie française. Elles n'ont réagi qu'aux effets dits de « premier tour », c'est-à-dire la répercussion de la hausse des coûts intermédiaires en énergie dans les prix de vente. Les produits manufacturés du secteur privé n'ont pas accéléré, maintenant une évolution à peine positive. Au sein des services, seul l'indice du prix des transports a nettement accéléré, sous l'effet de la hausse du prix du pétrole. Cette accélération a toutefois été compensée par un ralentissement de la hausse des loyers et du prix des services de santé. Ces mouvements contraires n'ont donc pas infirmé la régularité de la trajectoire de l'indice du prix des services, au rythme moyen de 2,5 % l'an, qui s'est instauré depuis 5 ans.
Le choc inflationniste lié aux matières premières n'a pas dégénéré en inflation de « second tour » où la poussée initiale des prix favorise des revendications salariales qui en retour alimentent l'inflation. En accélérant de moins de 0,5 point en deux ans, l'indice des prix hors énergie et alimentation est resté sage, ne répercutant même qu'une partie de la hausse des coûts intermédiaires jusqu'à l'utilisateur final. Les branches productives les plus proches de la consommation finale ont en effet concédé des réductions de leurs marges dans un contexte de renchérissement des coûts de production (graphique 13). Les marges dans les branches industrielles situées en aval du système productif ont retrouvé des niveaux voisins de ceux enregistrés après le deuxième choc pétrolier, et même nettement inférieurs dans l'automobile. Bien que dans une moindre mesure, l'érosion des marges dans les services aux particuliers témoigne aussi de la difficulté qu'éprouvent les entreprises de ces secteurs à répercuter les hausses de coûts sur les prix à la production 97 ( * ) . Greffée sur une tendance générale négative depuis le début de la décennie 2000 qui trouve son origine dans l'internationalisation accrue de la concurrence, la baisse des marges s'est accélérée ces deux dernières années avec les chocs de matières premières auxquels les entreprises ont dû faire face.
Ce constat modèle les perspectives d'inflation à l'horizon de la prévision dans les services et les produits manufacturés : après les pertes subies, on tablera sur la nécessité pour les entreprises de redresser leurs marges par une accélération de leurs prix de production qui se transmettra aux prix à la consommation. On se gardera de voir dans un tel processus l'enclenchement d'un mécanisme type « effets de second tour » des chocs de matières premières, la marge de manoeuvre des entreprises restant limitée par la concurrence des pays émergents et celle des salariés par la précarisation du marché du travail et l'arrêt de la baisse du chômage. Les tensions issues du conflit de répartition resteront modérées et vraisemblablement bien moins virulentes que lors des chocs pétroliers de 1974 ou 1979 où la maîtrise des marges par celle des coûts salariaux était mission quasi impossible.
L'assagissement des prix des matières premières, au premier rang desquelles le pétrole, facilitera la restauration des marges des entreprises sans emballement des prix. Elle aura aussi un effet direct sur l'indice des prix à la consommation. Sous l'hypothèse que les prix des matières premières alimentaires retrouvent un rythme de progression plus conforme à leur trajectoire de long terme, après leur accélération de ces derniers trimestres, et que le prix du pétrole se stabilise au alentours de 100 dollars le baril, le pic d'inflation aura été atteint au deuxième et au troisième trimestres 2008 au-dessus de 3,0 %. Le retournement devrait se produire à partir du quatrième trimestre 2008, avec un recul de l'inflation à 2,4 %, puis une décrue jusque vers 2 % à l'horizon 2009, aidée en cela par un effet de base de calcul des évolutions annuelles plus favorable à partir de la fin 2008.
C.1. Scénario central et scénario « bas »
Les progressions du salaire horaire réel et de la productivité par tête se suivraient, atteignant progressivement leur croissance de moyen terme de 1,8 % par an dans le compte central et 1,7 dans le scénario « bas ».
10 - Prix et salaire
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Prix à la consommation |
1,4 |
2,6 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
|
Salaire horaire réel |
1,7 |
0,9 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,5 |
2,0 |
1,8 |
|
Productivité par tête |
0,8 |
0,5 |
0,9 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,4 |
0,9 |
1,8 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
11 - Prix et salaire
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Prix à la consommation |
1,4 |
2,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
|
Salaire horaire réel |
1,7 |
0,9 |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
2,0 |
1,7 |
|
Productivité par tête |
0,8 |
0,5 |
0,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
0,9 |
1,7 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Dans le scénario central, l'inflation resterait au-dessous de la cible de la BCE alors que le taux de chômage termine à 5,3 % de la population active. Ce résultat, dans notre analyse modélisée, suppose une baisse du taux de chômage d'équilibre. Ce concept, issu de la théorie du « chômage naturel » de Milton Friedman (1968), a connu des appellations diverses : NAIRU, NAWRU, chômage de long terme ou chômage structurel. Elle repose sur l'idée selon laquelle au-dessous de ce niveau « naturel », toute baisse du chômage observé a, dans un premier temps, pour contrepartie une accélération de l'inflation ; puis dans un deuxième temps, du fait de la spirale prix-salaires qui découle de cette inflation, le taux de chômage revient à son niveau structurel initial. Au total, la baisse du chômage, n'aura donc été que transitoire, tandis que ses conséquences inflationnistes seraient définitives. Selon cette théorie, les politiques actives de la demande d'inspiration keynésienne sont inadéquates pour combattre le chômage d'équilibre ; seules des réformes structurelles permettraient de diminuer ce niveau « naturel ».
Cette analyse a fait l'objet d'abondantes controverses quant à ses soubassements théoriques mais également sur sa validité empirique. Par ailleurs, certains éléments théoriques permettent d'entrevoir une baisse de ce chômage non inflationniste. Les théories de l'hystérèse montrent comment ce chômage a augmenté avec le taux de chômage observé, du fait de son impact sur le capital humain. A l'inverse, une baisse du taux de chômage devrait amener une baisse du taux de chômage d'équilibre. Avec l'expérience d'une longue période d'absence d'inflation et le renforcement de la crédibilité de la banque centrale européenne, les anticipations sur les prix se modifient, permettant une baisse du chômage d'équilibre. Les baisses de taux d'intérêt passées permettent une augmentation progressive du taux d'investissement, ce qui limite les tensions potentielles sur l'appareil productif. Le NAIRU peut baisser graduellement en réaction aux politiques structurelles sur le marché du travail (réforme de l'indemnisation du chômage en 1993, abaissement de charges patronales, prime à l'emploi, PARE,...). Les politiques structurelles sur le marché des biens (politique de concurrence, dérégulation) et sur les marchés financiers (dérégulation) peuvent aussi diminuer le NAIRU.
En l'absence de baisse du taux de chômage d'équilibre et dans l'hypothèse où il n'y a pas de réponse de la banque centrale qui viserait à ralentir fortement l'évolution des prix, l'inflation augmenterait, entraînant une perte de compétitivité et amputerait alors la croissance. A terme, le taux de chômage reviendrait alors à son niveau d'équilibre, proche du scénario central.
D. Les échanges extérieurs
Les résultats du commerce extérieur français pour le deuxième trimestre se sont à nouveau avérés décevants avec un déficit record, pour les échanges en valeur, de 13,5 milliards d'euros (graphique 33), soit 2,8 % du PIB, chiffre qui n'avait pas été observé depuis le quatrième trimestre 1982. Sur les six premiers mois de l'année, le déficit cumulé pour l'ensemble des biens et services s'élève à 23 milliards, en augmentation par rapport au dernier semestre de l'année 2007 (21,5 milliards). Hors énergie, l'excédent se réduit à 1,8 milliard d'euros au deuxième trimestre, contre 3,4 milliards au premier trimestre. La dégradation du solde global ne résulte donc pas seulement de l'augmentation des prix de l'énergie mais illustre également l'insuffisance de la croissance des exportations en volume par rapport à celle des importations. Les exportations ont bien enregistré un rebond au premier trimestre 2008, avec une croissance en volume de 2,6 %, mais il a été en partie effacé dès le trimestre suivant avec un recul de 1,7 %. Du côté des importations, le deuxième trimestre est également marqué par une baisse (-0,3 % de croissance trimestrielle), reflétant notamment le recul de la demande intérieure. L'évolution du commerce a de fait nettement contribué (-0,4 point) à la mauvaise performance de l'économie française au deuxième trimestre.
24- Commerce extérieur français
En milliards d'euros
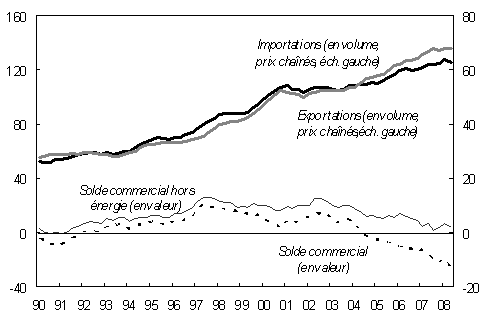
Source : INSEE, Comptes trimestriels
Le recul conjoint de l'euro et du pétrole, observé depuis l'été 2008, pourrait enfin annoncer la fin de la dégradation de l'environnement extérieur. De fait, nous anticipons une légère dépréciation de l'euro qui se stabiliserait ensuite à 1,45 dollar jusqu'en 2013. Pour le pétrole, l'effet conjoint de la baisse de l'euro et de celle du pétrole permettrait de stabiliser les prix. Ces éléments s'ajouteraient à la fin progressive des conséquences de la politique désinflationniste allemande et amélioraient légèrement la compétitivité des entreprises françaises à l'exportation. Dans ce contexte, la France continuerait à perdre des parts de marché à l'exportation, mais à un degré moindre que celui observé les dernières années. La contribution du commerce à la croissance serait néanmoins toujours négative en 2009 : de -0,2 point contre -0,8 point en 2007.
D.1. Scénario central
En l'absence de décalage conjoncturel et en supposant une stabilisation de la compétitivité-prix française, la contribution du commerce extérieur serait nulle dans nos deux scénarios sur l'horizon de l'analyse.
12 - Principales caractéristiques de l'évolution des échanges extérieurs
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Importations (volume) |
6,2 |
2,2 |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
4,5 |
5,1 |
2,3 |
|
Exportations (volume) |
3,1 |
2,0 |
2,2 |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,4 |
5,8 |
3,5 |
2,5 |
|
Demande étrangère |
6,5 |
6,0 |
4,9 |
6,0 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
6,3 |
6,1 |
|
Contribution extérieure |
-1,0 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
12bis - Principales caractéristiques de l'évolution des échanges extérieurs
|
En % |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
89-99 |
99-09 |
09-13 |
|
Importations (volume) |
6,2 |
2,2 |
1,5 |
1,5 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
4,5 |
5,0 |
1,8 |
|
Exportations (volume) |
3,1 |
2,0 |
1,7 |
1,7 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
5,8 |
3,5 |
2,0 |
|
Demande étrangère |
6,5 |
6,0 |
4,9 |
6,0 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
6,3 |
6,1 |
|
Contribution extérieure |
-1,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
-0,5 |
0,0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
IV. Tendances des finances publiques
Conformément à la programmation pluriannuelle des finances publiques 2010-2012 fournie par le gouvernement au moment de la présentation du PLF 2009, le rythme de croissance des dépenses publiques connaîtrait un infléchissement durable de 2009 à 2013. Ces dernières augmenteraient en moyenne de 1,2 % en volume sur la période 2009-2013 engendrant une diminution de 2,6 points de la part des dépenses publiques dans le PIB en l'espace de 5 ans (tableau 13). A titre de comparaison, le rythme moyen de la dépense publique en volume était de 2,4 % sur les vingt dernières années, de 2,0 % sur les dix dernières et de 1,9 % sur les cinq dernières. Avec des taux de prélèvements obligatoires (PO) constants (43,2 % du PIB), l'évolution des dépenses publiques permet une amélioration du solde structurel d'un demi-point de PIB par an de 2009 à 2013. Avec une croissance de l'activité soutenue à partir de 2010 (2,5 % en moyenne), le déficit public baisserait régulièrement à moyen terme pour atteindre l'équilibre en 2013. Après avoir atteint un pic en 2009 (66 % du PIB), la dette publique baisserait de 7 points de PIB en 4 ans pour atteindre 59,1 % du PIB en 2013.
Dans le scénario bas, la croissance du PIB est moins favorable (1,5 % en moyenne de 2009 à 2013 contre 2,2 % dans le scénario du gouvernement) et l'impulsion budgétaire est pratiquement neutre 98 ( * ) en 2009 et 2010 en raison d'une croissance des dépenses publiques plus dynamique. Dans ce scénario, la part des dépenses publiques dans le PIB ne diminue que de 0,8 point sur la période 2009-2013 et l'impulsion budgétaire moyenne n'est que de -0,35 point de PIB par an. Dans ce scénario, le déficit public atteindrait un point haut en 2010 à 4 % du PIB et diminuerait progressivement à 2,5 % en 2013. La dette publique dépasserait 70 % du PIB dès 2011 et atteindrait 70,7 % du PIB en 2013.
13. Principaux agrégats des finances publiques 2010-2013
|
En points de PIB |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Scénario central |
Capacité de financement des APU |
-2,7 |
-2.7 |
-2,0 |
-1,2 |
-0,5 |
0,1 |
|
Taux de prélèvement obligatoire |
43.2 |
43.2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
|
Dépenses publiques (DP) |
52,5 |
52,7 |
52,0 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
|
|
Taux de croissance DP* (en %, en volume) |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
|
|
Dette publique |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
|
|
Scénario bas |
Capacité de financement des APU |
-2,7 |
-3.5 |
-4.0 |
-3.5 |
-3.0 |
-2.5 |
|
Taux de prélèvement obligatoire |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
|
Dépenses publiques (DP) |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
|
|
Taux de croissance DP* (en %, en volume) |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Dette publique |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
* déflatées par le prix du PIB
Source : Rapport économique, social et financier 2009,
V.I. Les prélèvements obligatoires de 2008 à 2013
Après avoir diminué de 0,1 point de PIB entre 2007 et 2008, les prélèvements obligatoires devraient se stabiliser de 2009 à 2013 (tableau 14). Les différentes mesures votées représentent un allègement de prélèvements d'environ 6,5 milliards d'euros en 2008 qui profitera essentiellement aux ménages (4 milliards). Avec une élasticité des recettes fiscales des APU au PIB supérieure à l'unité, le taux de PO devrait baisser de seulement 0,1 point de PIB en 2008. Les mesures liées au paquet fiscal représentent une diminution des PO de 6 milliards d'euros en 2008, dont 3 milliards liés aux allègements de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires. Les autres grandes mesures sont celles concernant la réforme des droits de successions et donations (1,6 milliard) et celles relatives à l'ISF et au bouclier fiscal (1,2 milliard). Enfin, les mesures décidées dans la PLFSS 2008 visant à trouver de nouvelles sources de financement pour la Sécurité sociale vont représenter une hausse des prélèvements obligatoires de 3 milliards d'euros, les principales mesures concernant la mise en place d'un prélèvement à la source sur les contributions sociales et fiscales sur les dividendes pour 1,9 milliard d'euros et la création d'une taxe et d'une cotisation employeur de 2,5 % sur les stocks options pour 400 millions d'euros. Enfin, le dégrèvement de la taxe professionnelle représente pour les entreprises une baisse des PO de 2 milliards.
En 2009, les mesures fiscales devraient conduire à une relative stabilité des prélèvements (hausse de 0,2 milliard d'euros). Les ménages verraient leur fiscalité diminuer de 2 milliards d'euros en raison de la montée en charge du paquet fiscal (1,8 milliard d'euros) et du contrecoup des mesures de prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes décidées en 2008 (2,1 milliards). En revanche, la création d'une taxe sur les revenus du patrimoine pour financer le RSA et la réduction des avantages fiscaux sur les biocarburants augmentent les PO des ménages de 1,9 milliard. Enfin, il est prévu que la hausse des cotisations retraite soit compensée par une baisse des cotisations chômage, ce qui n'aurait pas d'impact sur les PO. Cependant, avec le retournement du marché du travail, la dégradation probable des comptes de l'Unedic pourrait remettre en cause la diminution des cotisations chômage. Pour les entreprises, les mesures fiscales entraîneraient une hausse de PO de près de 1,3 milliard d'euros, en raison notamment des mesures prises dans le cadre du PLFSS 2009 pour redresser les comptes de l'assurance maladie : augmentation de la contribution des complémentaires santé pour 1 milliard d'euros et instauration d'une cotisation patronale de 2 % sur l'épargne salariale (400 millions). Afin de financer la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision du service public, le gouvernement prévoit également de créer une taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet qui rapporterait 460 millions. En revanche, les mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2008 vont réduire les PO des entreprises de 900 millions d'euros en 2009, dont 600 millions en raison de la modification du crédit impôt recherche et 340 millions avec la suppression progressive de l'impôt forfaitaire annuel.
La programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur l'hypothèse prudente d'une stabilité des PO de 2010 à 2012. Dans nos 2 scénarios, nous avons donc retenu une stabilisation des taux de PO à 43,2 % sur la période 2010-2013. Cependant, les mesures déjà décidées représentent un allègement net de la fiscalité de 4,3 milliards d'euros de 2010 à 2012 (2,4 milliards en 2010, 0,9 en 2011 et 1 en 2012). Les mesures de baisse de PO (5,8 milliards) sont liées à la montée en charge de la loi TEPA (2,4 milliards), au crédit d'impôt en faveur de l'intéressement (1,2 milliard), à la hausse du crédit d'impôt recherche (1 milliard) et à la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle (0,9 milliard). En revanche, certaines mesures déjà décidées augmenteront les PO de 1,5 milliard d'euros dont plus de la moitié sont liés à la fiscalité environnementale (0,8 milliard).
14. Scénario central et bas : Evolution des recettes des administrations publiques
|
% de croissance annuelle en volume |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
TVA |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,5 |
7,3 |
7,2 |
|
Autres impôts sur les produits |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,2 |
3,9 |
|
Impôts sur la production |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
3,8 |
4,2 |
4,2 |
|
Impôt sur le revenu des ménages (dont CSG) |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
5,1 |
7,9 |
7,4 |
|
Impôt sur les sociétés |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,0 |
2,6 |
2,9 |
|
Autres impôts sur le revenu et le patrimoine |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
|
Cotisations employeurs |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,5 |
11,1 |
11,0 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
7,0 |
5,1 |
5,1 |
|
Impôts en capital |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
Prélèvements obligatoires |
43,3 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
42,7 |
43,7 |
43,2 |
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2009, prévisions OFCE,
V.II. Les dépenses publiques de 2008 à 2013
L'hypothèse d'une croissance des dépenses publiques de 1,2 % par an en moyenne en volume de 2008 à 2013 suppose un ajustement fort, compte tenu de l'évolution rapide des dépenses liées au vieillissement de la population (retraites et santé principalement). Le ralentissement des dépenses publiques serait tiré par l'ensemble des sous-secteurs de l'administration publique (tableau 15).
En 2008 et 2009, afin d'éviter une dérive des déficits publics, le gouvernement prévoit que le ralentissement conjoncturel sera compensé par l'effort structurel du côté de la dépense publique. Dans le PLF 2009, le gouvernement table sur une hausse de la dépense publique en euros constants de 1,3 % en 2008 et de 1,2 % en 2009, contribuant ainsi à réduire le déficit structurel de 1 point de PIB en 2 ans. Pour atteindre cet objectif en 2008, le gouvernement prévoit une stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat malgré l'augmentation de 4 milliards d'euros des intérêts versés sur les obligations assimilables au Trésor indexées sur l'inflation. Cependant, avec un PLF 2008 construit sur un objectif d'inflation de 1,6 %, soit 1,3 point de moins que l'inflation réalisée en 2008, les dépenses votées hors charge de la dette diminueraient en euros constants. La croissance des prestations sociales, qui représentent 44 % de la dépense publique, ralentirait en 2008 (3,7 % en valeur) (tableau 16) malgré la croissance toujours soutenue des prestations « vieillesse » (supérieure à 5 % de 2007 à 2009). La principale raison à ce ralentissement serait le moindre dynamisme de l'ONDAM en 2008 (3,3 % en valeur après 4,2 % en 2007) grâce notamment à l'instauration des franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. De plus, les prestations familiales ne progresseraient que de 2,1 % en 2008 contre 2,9 % en 2007 avec l'arrivée à maturité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). En 2009, pour contrôler la croissance de la dépense publique, le gouvernement prévoit une légère diminution en euros constants des dépenses de l'Etat (-0,3 %) malgré une croissance encore dynamique de la charge de la dette. Cela nécessite donc un ajustement très fort sur les dépenses de fonctionnement, d'intervention et d'investissement. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte sur la mise en oeuvre des préconisations issues de la révision générale des politiques publiques (RGPP), notamment la montée en charge du non remplacement d'un certain nombre de fonctionnaires partant en retraite (33 600 en 2009 contre 22 900 en 2008). Les dépenses sociales accélèreraient en 2009 en raison des règles d'indexation de certaines prestations et de l'effet du contrecoup de la hausse non anticipée de l'inflation en 2008. Les mécanismes de revalorisation en vigueur qui permettent de compenser le surcroît d'inflation non anticipé en 2008 (2,9 % en 2008 contre 1,6 % prévu) devrait entraîner une revalorisation des allocations familiales de 3,5 % et des pensions de retraite de 2,6 % en moyenne annuelle en 2009. Au final, les prestations « vieillesse » augmenteraient de 5,5 % en 2009 et les prestations « familiales » de 3,7 %. Cependant, selon le PLFSS 2009, les dépenses de l'ONDAM continueraient à croître de seulement 3,3 % en valeur en 2009, ce qui suppose une maîtrise forte des dépenses de soins de ville et d'hôpital.
Le programme pluriannuel des finances publiques prévoit une maitrise importante des dépenses publiques. D'après le scénario du gouvernement et nos projections, elles augmenteraient en moyenne de 1,1 % en volume entre 2010 et 2013. Cela passe par une stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat, ce qui se traduit par une baisse significative des dépenses de fonctionnement dont la part en point de PIB diminue de 1,4 point de PIB en 4 ans. A partir de 2010, la baisse de la dette publique permet d'avoir une diminution en point de PIB des charges d'intérêts. Enfin, malgré le vieillissement de la population, la maîtrise des dépenses sociales serait maintenue entre 2010 et 2013 avec une croissance moyenne de 1,75 % en volume sur la période. Cela passe notamment par une progression des dépenses de l'ONDAM limitée à 3,3 % en valeur et une décrue significative du chômage à partir de 2010 permettant une baisse des prestations chômage (tableau 16).
Dans le scénario bas, la croissance est en moyenne plus faible et les dépenses publiques plus dynamiques (1,4 % en volume contre 1,1 % dans le scénario central), notamment en 2009 et 2010 (tableau 15 bis). En raison d'un profil d'évolution du chômage moins favorable dans ce scénario, les prestations chômage seraient plus dynamiques sur la période 2009-2013 (écart en moyenne de plus de 3 points par rapport au scénario central) (tableau 16 bis) et contribueraient à avoir des dépenses de protection sociale plus fortes en prévision (1,9 % en volume). Dans ce scénario moins favorable, le gonflement de la dette publique entraînerait une augmentation des intérêts versés, la charge de le dette représentant en moyenne 3 points de PIB de 2008 à 2013 contre seulement 2,8 points de PIB dans le scénario central.
15. Compte scénario central: Evolution des dépenses des administrations publiques
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
52,6 |
51,9 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
52,3 |
52,6 |
51,5 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,2 |
17,8 |
17,4 |
17,1 |
16,8 |
19,0 |
18,9 |
17,6 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,2 |
28,1 |
27,8 |
27,6 |
27,4 |
26,8 |
27,6 |
27,9 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,5 |
3,2 |
3,2 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
2,9 |
2,0 |
1,2 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
2,6 |
1,6 |
0,5 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
2,2 |
0,6 |
0,3 |
-0,9 |
-2,0 |
5,8 |
0,0 |
0,9 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
3,0 |
2,3 |
1,7 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,4 |
* déflatés par le prix du PIB
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
15 bis. Compte scénario bas : Evolution des dépenses des administrations publiques
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
52,3 |
52,6 |
53,0 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,4 |
18,4 |
18,1 |
17,8 |
17,5 |
19,0 |
18,9 |
18,1 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,5 |
28,9 |
28,7 |
28,7 |
28,6 |
26,8 |
27,6 |
28,6 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2,9 |
2,0 |
1,4 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2,6 |
1,6 |
0,6 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
4,4 |
3,8 |
2,4 |
2,5 |
1,8 |
5,8 |
0,0 |
3,4 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
2,2 |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,0 |
2,3 |
1,9 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,6 |
* déflatés par le prix du PIB
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
16. Compte scénario central : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
1,9 |
-4,1 |
-3,8 |
-4,0 |
-3,7 |
2,7 |
1,5 |
-2,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,7 |
4,1 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,4 |
4,1 |
3,8 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
16bis. Compte scénario bas : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
4,2 |
5,0 |
-1,4 |
-1,2 |
-1,3 |
2,7 |
1,5 |
0,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,5 |
4,3 |
4,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,1 |
4,0 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
V.III. Evolutions du déficit et de la dette publics de 2009 à 2013
Le ralentissement significatif de la dépense publique permet de ramener le solde public à l'équilibre en 2013 dans le cas du scénario central alors que celui-ci est de 2,5 % du PIB à l'horizon de la prévision dans le scénario bas (tableau 17). Cet écart s'explique par un différentiel de croissance du PIB entre les deux scénarios en moyenne de 0,7 % sur la période 2009-2013 et une impulsion budgétaire en moyenne de 0,15 point de PIB plus restrictive dans le scénario central que dans le scénario bas. Cela se traduit par un écart sur la dette publique de près de 12 points en 2013 entre les deux scénarios et une différence sur la charge d'intérêt de 0,5 point de PIB (à taux d'intérêt apparent identique).
17. Evolution de la capacité de financement et de la dette des administrations publiques
|
En % du PIB |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
Scénario central |
||||||||||
|
Solde public |
-2,4 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,0 |
-1,2 |
-0,5 |
0,1 |
-3,9 |
-2,6 |
-1,5 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-3,0 |
-2,3 |
-2,0 |
-2,8 |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
|||
|
Impulsion budgétaire* |
0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,5 |
-0,6 |
|||
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
44,6 |
61,3 |
63,6 |
|
Scénario bas |
||||||||||
|
Solde public |
-2,4 |
-2,7 |
-3,5 |
-4,0 |
-3,5 |
-3,0 |
-2,5 |
-3,9 |
-2,6 |
-3.2 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-3,0 |
-2,3 |
-1,7 |
-1,9 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,7 |
|||
|
Impulsion budgétaire** |
0,3 |
-0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|||
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
44,6 |
61,3 |
63,6 |
* calculée à partir de la variation du solde structurel (y compris charges d'intérêts) avec une hypothèse de croissance du PIB potentiel de 2,2 % par an sur l'ensemble de la période.
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
*
* *
*
I. Les finances publiques
de 2008 à 2013
Conformément à la programmation pluriannuelle des finances publiques 2010-2012 fourni par le gouvernement au moment de la présentation du PLF 2009, le rythme de croissance des dépenses publiques connaîtrait un infléchissement durable de 2009 à 2013. Ces dernières augmenteraient en moyenne de 1,2 % en volume sur la période 2009-2013 engendrant une diminution de 2,6 points de la part des dépenses publiques dans le PIB en l'espace de 5 ans (tableau 1). A titre de comparaison, le rythme moyen de la dépense publique en volume était de 2,4 % sur les vingt dernières années, de 2,0 % sur les dix dernières et de 1,9 % sur les cinq dernières. Avec des taux de prélèvements obligatoires (PO) constants (43,2 % du PIB), l'évolution des dépenses publiques permet une amélioration du solde structurel d'un demi-point de PIB par an de 2009 à 2013. Avec une croissance de l'activité soutenue à partir de 2010 (2,5 % en moyenne), le déficit public baisserait régulièrement à moyen terme pour atteindre l'équilibre en 2013. Après avoir atteint un pic en 2009 (66 % du PIB), la dette publique baisserait de 7 points de PIB en 4 ans pour atteindre 59,1 % du PIB en 2013.
Dans le scénario bas, la croissance du PIB est moins favorable (1,5 % en moyenne de 2009 à 2013 contre 2,2 % dans le scénario du gouvernement) et l'impulsion budgétaire est pratiquement neutre 99 ( * ) en 2009 et 2010 en raison d'une croissance des dépenses publiques plus dynamique. Dans ce scénario, la part des dépenses publiques dans le PIB ne diminue que de 0,8 point sur la période 2009-2013 et l'impulsion budgétaire moyenne n'est que de -0,35 point de PIB par an. Dans ce scénario, le déficit public atteindrait un point haut en 2010 à 4 % du PIB et diminuerait progressivement à 2,5 % en 2013. La dette publique dépasserait 70 % du PIB dès 2011 et atteindrait 70,7 % du PIB en 2013.
1. Principaux agrégats des finances publiques 2010-2013
|
En points de PIB |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Scénario gouvernement |
Capacité de financement des APU |
-2,7 |
-2.7 |
-2,0 |
-1,2 |
-0,5 |
0,1 |
|
Taux de prélèvement obligatoire |
43.2 |
43.2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
|
Dépenses publiques (DP) |
52,5 |
52,7 |
52,0 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
|
|
Taux de croissance DP* (en %, en volume) |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
|
|
Dette publique |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
|
|
Scénario bas |
Capacité de financement des APU |
-2,7 |
-3.5 |
-4.0 |
-3.5 |
-3.0 |
-2.5 |
|
Taux de prélèvement obligatoire |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
|
|
Dépenses publiques (DP) |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
|
|
Taux de croissance DP* (en %, en volume) |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Dette publique |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
* déflatées par le prix du PIB
Source : Rapport économique, social et financier 2009,
I.I. Les prélèvements obligatoires de 2008 à 2013
Après avoir diminué de 0,1 point de PIB entre 2007 et 2008, les prélèvements obligatoires devraient se stabiliser de 2009 à 2013 (tableau 2). Les différentes mesures votées représentent un allègement de prélèvements d'environ 6,5 milliards d'euros en 2008 qui profiteront essentiellement aux ménages (4 milliards). Avec une élasticité des recettes fiscales des APU au PIB supérieur à l'unité, le taux de PO devrait baisser de seulement 0,1 point de PIB en 2008. Les mesures liées au paquet fiscal représentent une diminution des PO de 6 milliards d'euros en 2008, dont 3 milliards liés aux allègements de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires. Les autres grandes mesures sont celles concernant la réforme des droits de successions et donations (1,6 milliard) et celles relatives à l'ISF et au bouclier fiscal (1,2 milliard). Enfin, les mesures décidées dans la PLFSS 2008 visant à trouver de nouvelles sources de financement pour la Sécurité sociale vont représenter une hausse des prélèvements obligatoires de 3 milliards d'euros, les principales mesures concernant la mise en place d'un prélèvement à la source sur les contributions sociales et fiscales sur les dividendes pour 1,9 milliard d'euros et la création d'une taxe et d'une cotisation employeur de 2,5 % sur les stocks options pour 400 millions d'euros. Enfin, le dégrèvement de la taxe professionnelle représente pour les entreprises une baisse des PO de 2 milliards.
En 2009, les mesures fiscales devraient conduire à une relative stabilité des prélèvements (hausse de 0,2 milliard d'euros). Les ménages verraient leur fiscalité diminuer de 2 milliards d'euros en raison de la montée en charge du paquet fiscal (1,8 milliard d'euros) et du contrecoup des mesures de prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes décidées en 2008 (2,1 milliards). En revanche, la création d'une taxe sur les revenus du patrimoine pour financer le RSA et la réduction des avantages fiscaux sur les biocarburants augmentent les PO des ménages de 1,9 milliard. Enfin, il est prévu que la hausse des cotisations retraite soit compensée par une baisse des cotisations chômage, ce qui n'aurait pas d'impact sur les PO. Cependant, avec le retournement du marché du travail, la dégradation probable des comptes de l'Unedic pourrait remettre en cause la diminution des cotisations chômage. Pour les entreprises, les mesures fiscales entraîneraient une hausse de PO de près de 1,3 milliard d'euros, en raison notamment des mesures prises dans le cadre du PLFSS 2009 pour redresser les comptes de l'assurance maladie : augmentation de la contribution des complémentaires santé pour 1 milliard d'euros et instauration d'une cotisation patronale de 2 % sur l'épargne salariale (400 millions). Afin de financer la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision du service public, le gouvernement prévoit également de créer une taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet qui rapporterait 460 millions. En revanche, les mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2008 vont réduire les PO des entreprises de 900 millions d'euros en 2009, dont 600 millions en raison de la modification du crédit impôt recherche et 340 millions avec la suppression progressive de l'impôt forfaitaire annuel.
La programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur l'hypothèse prudente d'une stabilité des PO de 2010 à 2012. Dans nos 2 scénarios, nous avons donc retenu une stabilisation des taux de PO à 43,2 % sur la période 2010-2013. Cependant, les mesures déjà décidées représentent un allègement net de la fiscalité de 4,3 milliards d'euros de 2010 à 2012 (2,4 milliards en 2010, 0,9 en 2011 et 1 en 2012). Les mesures de baisse de PO (5,8 milliards) sont liées à la montée en charge de la loi TEPA (2,4 milliards), au crédit d'impôt en faveur de l'intéressement (1,2 milliard) et à la hausse du crédit d'impôt recherche (1 milliard) et à la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle (0,9 milliard). En revanche, certaines mesures déjà décidées augmenteront les PO de 1,5 milliard d'euros dont plus de la moitié sont liés à la fiscalité environnementale (0,8 milliard).
2. Scénario central et bas : Evolution des recettes des administrations publiques
|
% de croissance annuelle en volume |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
TVA |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,5 |
7,3 |
7,2 |
|
Autres impôts sur les produits |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,2 |
3,9 |
|
Impôts sur la production |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
3,8 |
4,2 |
4,2 |
|
Impôt sur le revenu des ménages (dont CSG) |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
5,1 |
7,9 |
7,4 |
|
Impôt sur les sociétés |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,0 |
2,6 |
2,9 |
|
Autres impôts sur le revenu et le patrimoine |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
|
Cotisations employeurs |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,5 |
11,1 |
11,0 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
7,0 |
5,1 |
5,1 |
|
Impôts en capital |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
Prélèvements obligatoires |
43,3 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
42,7 |
43,7 |
43,2 |
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2009, prévisions OFCE,
I.II. Les dépenses publiques de 2008 à 2013
L'hypothèse d'une croissance des dépenses publiques de 1,2 % par an en moyenne en volume de 2008 à 2013 suppose un ajustement fort, compte tenu de l'évolution rapide des dépenses liées au vieillissement de la population (retraites et santé principalement). Le ralentissement des dépenses publiques serait tiré par l'ensemble des sous-secteurs de l'administration publique (tableau 3).
En 2008 et 2009, afin d'éviter une dérive des déficits publics, le gouvernement prévoit que le ralentissement conjoncturel sera compensé par l'effort structurel du côté de la dépense publique. Dans le PLF 2009, le gouvernement table sur une hausse de la dépense publique en euros constants de 1,3 % en 2008 et de 1,2 % en 2009, contribuant ainsi à réduire le déficit structurel de 1 point de PIB en 2 ans. Pour atteindre cet objectif en 2008, le gouvernement prévoit une stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat malgré l'augmentation de 4 milliards d'euros des intérêts versés sur les obligations assimilables au Trésor indexées sur l'inflation. Cependant, avec un PLF 2008 construit sur un objectif d'inflation de 1,6 %, soit 1,3 point de moins que l'inflation réalisée en 2008, les dépenses votées hors charge de la dette diminueraient en euros constants. La croissance des prestations sociales, qui représentent 44 % de la dépense publique, ralentirait en 2008 (3,7 % en valeur) (tableau 4) malgré la croissance toujours soutenue des prestations « vieillesse » (supérieure à 5 % de 2007 à 2009). La principale raison à ce ralentissement serait le moindre dynamisme de l'ONDAM en 2008 (3,3 % en valeur après 4,2 % en 2007) grâce notamment à l'instauration des franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. De plus, les prestations familiales ne progresseraient que de 2,1 % en 2008 contre 2,9 % en 2007 avec l'arrivée à maturité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). En 2009, pour contrôler la croissance de la dépense publique, le gouvernement prévoit une légère diminution euros constants des dépenses de l'Etat (-0,3 %) malgré une croissance encore dynamique de la charge de la dette. Cela nécessite donc un ajustement très fort sur les dépenses de fonctionnement, d'intervention et d'investissement. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte sur la mise en oeuvre des préconisations issues de la révision générale des politiques publiques (RGPP), notamment la montée en charge du non remplacement d'un certain nombre de fonctionnaires partant en retraite (33 600 en 2009 contre 22 900 en 2008). Les dépenses sociales accéléreraient en 2009 en raison des règles d'indexation de certaines prestations et de l'effet du contrecoup de la hausse non anticipée de l'inflation en 2008. Les mécanismes de revalorisation en vigueur qui permettent de compenser le surcroît d'inflation non anticipé en 2008 (2,9 % en 2008 contre 1,6 % prévu) devrait entraîner une revalorisation des allocations familiales de 3,5 % et des pensions de retraite de 2,6 % en moyenne annuelle en 2009. Au final, les prestations « vieillesse » augmenteraient de 5,5 % en 2009 et les prestations « familiales » de 3,7 %. Cependant, selon le PLFSS 2009, les dépenses de l'ONDAM continueraient à croître de seulement 3,3 % en valeur en 2009, ce qui suppose une maîtrise forte des dépenses de soins de ville et d'hôpital.
Le programme pluriannuel des finances publiques prévoit une maitrise important des dépenses publiques. D'après le scénario du gouvernement et nos projections, elles augmenteraient en moyenne de 1,1 % en volume entre 2010 et 2013. Cela passe par une stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat, ce qui se traduit par une baisse significative des dépenses de fonctionnement dont la part en point de PIB diminue de 1,4 point de PIB en 4 ans. A partir de 2010, la baisse de la dette publique permet d'avoir une diminution en point de PIB des charges d'intérêts. Enfin, malgré le vieillissement de la population, la maîtrise des dépenses sociales serait maintenue entre 2010 et 2013 avec une croissance moyenne de 1,75 % en volume sur la période. Cela passe notamment par une progression des dépenses de l'ONDAM limitée à 3,3 % en valeur et une décrue significative du chômage à partir de 2010 permettant une baisse des prestations chômage (tableau 4).
Dans le scénario bas, la croissance est en moyenne plus faible et les dépenses publiques plus dynamiques (1,4 % en volume contre 1,1 % dans le scénario central), notamment en 2009 et 2010 (tableau 3 bis). En raison d'un profil d'évolution du chômage moins favorable dans ce scénario, les prestations chômage seraient plus dynamiques sur la période 2009-2013 (écart en moyenne de plus de 3 points par rapport au scénario central) (tableau 4 bis) et contribueraient à avoir des dépenses de protection sociales plus fortes en prévision (1,9 % en volume). Dans ce scénario moins favorable, le gonflement de la dette publique entraînerait une augmentation des intérêts versés, la charge de représentant en moyenne 3 points de PIB de 2008 à 2013 contre seulement 2,8 points de PIB dans le scénario central.
3. Compte scénario central: Evolution des dépenses des administrations publiques
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
52,6 |
51,9 |
51,3 |
50,6 |
49,9 |
52,3 |
52,6 |
51,5 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,2 |
17,8 |
17,4 |
17,1 |
16,8 |
19,0 |
18,9 |
17,6 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,2 |
28,1 |
27,8 |
27,6 |
27,4 |
26,8 |
27,6 |
27,9 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,5 |
3,2 |
3,2 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
2,9 |
2,0 |
1,2 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
2,6 |
1,6 |
0,5 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
2,2 |
0,6 |
0,3 |
-0,9 |
-2,0 |
5,8 |
0,0 |
0,9 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
3,0 |
2,3 |
1,7 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,4 |
* déflatés par le prix du PIB
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
3 bis. Compte scénario bas : Evolution des dépenses des administrations publiques
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
52,4 |
52,5 |
53,2 |
53,7 |
53,3 |
52,9 |
52,5 |
52,3 |
52,6 |
53,0 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18,4 |
18,3 |
18,4 |
18,4 |
18,1 |
17,8 |
17,5 |
19,0 |
18,9 |
18,1 |
|
Intérêts versés |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
|
Prestations et autres transferts versés |
27,9 |
28,0 |
28,5 |
28,9 |
28,7 |
28,7 |
28,6 |
26,8 |
27,6 |
28,6 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1,6 |
1,3 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2,9 |
2,0 |
1,4 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1,2 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2,6 |
1,6 |
0,6 |
|
Intérêts versés |
9,8 |
5,2 |
4,4 |
3,8 |
2,4 |
2,5 |
1,8 |
5,8 |
0,0 |
3,4 |
|
Prestations et autres transferts versés |
0,9 |
1,5 |
2,2 |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,0 |
2,3 |
1,9 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3,7 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
4,2 |
0,6 |
* déflatés par le prix du PIB
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
4. Compte scénario central : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
1,9 |
-4,1 |
-3,8 |
-4,0 |
-3,7 |
2,7 |
1,5 |
-2,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,7 |
4,1 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,4 |
4,1 |
3,8 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
4bis. Compte scénario bas : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
91--98 |
99--07 |
08--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
5,3 |
|
Santé |
36 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
|
Emploi |
6 |
-6,3 |
-1,6 |
4,2 |
5,0 |
-1,4 |
-1,2 |
-1,3 |
2,7 |
1,5 |
0,6 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2,5 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Total des prestations |
100 |
3,9 |
3,5 |
4,3 |
4,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,4 |
4,1 |
4,0 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
I.III. Évolutions du déficit et de la dette
publics
de 2009 à 2013
Le ralentissement significatif de la dépense publique permet de ramener le solde public à l'équilibre en 2013 dans le cas du scénario central alors que celui-ci est -2,5 % du PIB à l'horizon de la prévision dans le scénario bas (tableau 5). Cet écart s'explique par un différentiel de croissance du PIB entre les deux scénarios en moyenne de 0,7 % sur la période 2009-2013 et une impulsion budgétaire en moyenne de 0,15 point de PIB plus restrictive dans le scénario central que dans le scénario bas. Cela se traduit par un écart sur la dette publique de près de 12 points en 2013 entre les deux scénarios et une différence sur la charge d'intérêt de 0,5 point de PIB (à taux d'intérêt apparent identique).
5. Evolution de la capacité de financement et de la dette des administrations publiques
|
En % du PIB |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
88--97 |
98--07 |
08--13 |
|
Scénario central |
||||||||||
|
Solde public |
-2,4 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,0 |
-1,2 |
-0,5 |
0,1 |
-3,9 |
-2,6 |
-1,5 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-3,0 |
-2,3 |
-2,0 |
-2,8 |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
|||
|
Impulsion budgétaire* |
0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,5 |
-0,6 |
|||
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
66,0 |
65,3 |
63,9 |
61,8 |
59,1 |
44,6 |
61,3 |
63,6 |
|
Scénario bas |
||||||||||
|
Solde public |
-2,4 |
-2,7 |
-3,5 |
-4,0 |
-3,5 |
-3,0 |
-2,5 |
-3,9 |
-2,6 |
-3.2 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-3,0 |
-2,3 |
-1,7 |
-1,9 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,7 |
|||
|
Impulsion budgétaire** |
0,3 |
-0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|||
|
Dette publique |
63,9 |
65,3 |
67,2 |
69,4 |
70,4 |
70,8 |
70,7 |
44,6 |
61,3 |
63,6 |
* calculée à partir de la variation du solde structurel (y compris charges d'intérêts) avec une hypothèse de croissance du PIB potentiel de 2,2 % par an sur l'ensemble de la période.
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE,
* 1 Notamment dans son rapport au titre, malheureusement, un peu prémonitoire : « La coordination des politiques économiques en Europe : le malaise avant la crise ? ». MM. Joël Bourdin et Yvon Collin. Délégation pour la planification. Rapport Sénat n° 113. 5 décembre 2007.
* 2 Point de conjoncture : « La croissance cale en zone euro » (INSEE, 3 octobre 2008).
* 3 Prévision en date du 6 novembre 2008 (mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale d'octobre 2008).
* 4 Prévision en date du 3 novembre 2008.
* 5 Les actions préférentielles acquises par le Trésor seront rémunérées par un dividende spécial de 5 % pendant cinq ans, qui sera relevé à 9 % par la suite. Cette mesure vise à inciter les institutions concernées à racheter leurs actions après cinq ans en vue d'éviter de prolonger l'intervention publique dans le secteur bancaire. En outre, en vue de protéger les intérêts des contribuables, le Trésor recevra des warrants représentant 15 % de la valeur faciale des actions préférentielles, exerçables pendant une durée de dix ans à un prix prédéterminé. En contrepartie, les banques bénéficiaires ne pourront augmenter leurs dividendes liés au capital ordinaire pendant cette période que sur autorisation spéciale du Trésor. Elles devront restituer les bonus en cas de révision des résultats et ne pourront pas inclure de « parachutes dorés » dans de nouveaux contrats.
* 6 Cf. Note de conjoncture du service des études économiques et de la prospective (Sénat, octobre 2007).
* 7 Le Q de Tobin est une théorie des choix d'investissement élaborée en 1969 par l'économiste James Tobin. Elle définit un ratio Q = valeur boursière de l'entreprise / valeur de remplacement du capital fixe. Si Q > 1, l'entreprise a intérêt à investir. En pratique, les équations d'investissement du modèle comparent la productivité marginale du capital après impôt au taux d'intérêt à long terme.
* 8 Il existe toutefois quelques doutes sur la fiabilité des chiffres trimestriels de la croissance aux Etats-Unis du fait d'autres informations statistiques laissant entrevoir qu'une récession y serait déjà en cours.
* 9 Ce point est développé dans « La croissance du PIB : une mesure à déchiffrer », Documents de travail du Sénat, série études économiques (n° 2, octobre 2008).
* 10 Mécanisme qui aboutit à ce que les engagements des opérateurs excèdent de beaucoup leurs fonds propres.
* 11 Mais une mutualisation très incomplète puisque, au niveau individuel, les emprunteurs finaux (les ménages) n'en bénéficiaient pas s'ils se trouvaient en défaut.
* 12 Une diversification de l'offre - préconisée dès 2000 dans le rapport de M. Philippe Marini sur la régulation financière et monétaire internationale - et une centralisation des relations de la profession avec les agences de notation pourraient être recommandées.
* 13 Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
* 14 Le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes résultant de carences attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs.
* 15 L'épargne des ménages se définit comme la partie non consommée du revenu disponible. Il existe une corrélation négative assez marquée entre taux d'épargne et taux de recours au crédit (cf. rapport d'information n° 261 fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur l'accès des ménages au crédit en France, du 16 mars 2006, par M. Joël BOURDIN ).
* 16 La Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA, ou « paquet fiscal ») a été adoptée le 1 er août 2007.
* 17 « La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macro-économiques », monographie rédigée par l'OFCE, annexée au rapport d'information « Perspectives économiques 2008-2012 » du Sénat n° 81 (2007-2008) fait par M. Joël BOURDIN au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification.
* 18 Communication en Conseil des ministres de Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de industrie et de l'emploi, sur la loi TEPA du 21 aout 2008.
* 19 DARES, Premières Informations Premières Synthèses, 3 octobre 2008, lien : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/etudes-recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2008-40.4-heures-supplementaires-au-2eme-trimestre-2008-.html
* 20 INSEE, Informations Rapides, 11 septembre 2008 - n° 243.
* 21 Le « cycle de productivité » consiste en ceci : en période d'accélération de l'activité, les entreprises n'ajustent leurs effectifs à la hausse qu'avec retard, ce qui se traduit par une hausse transitoire de la productivité, tandis qu'en phase de ralentissement, le retard dans l'ajustement des effectifs à la baisse entraîne une baisse transitoire de la productivité.
* 22 Épargne nette de la consommation de capital fixe (amortissement) des ménages.
* 23 Selon ce théorème, une augmentation de la dette publique ne manque pas de se traduire par une augmentation ultérieure des impôts, destinée au remboursement. Dès lors, les agents économiques ont d'abord tendance à épargner davantage en prévision de futures hausses d'impôts. Inversement, une baisse du déficit public entraîne celle du taux d'épargne. Votre délégation a régulièrement exposé les raisons de son scepticisme quant à cet enchaînement théorique.
* 24 71,8 % au 1 er trimestre 2008 (donnée INSEE).
* 25 C'est-à-dire à l'investissement.
* 26 Il s'agit de l'inflation au sens de la variation des prix à la consommation et non de l'inflation des prix d'actifs immobiliers ou financiers. L'inflation des prix à la consommation traduit l'existence de déséquilibres entre la demande et l'offre dans l'ensemble de l'économie.
* 27 A l'exception notable de l'Espagne.
* 28 Cf. p 53 et s. du rapport d'information du Sénat n° 81 (2007-2008) intitulé « Perspectives économiques 2008-2012 » de M. Joël BOURDIN, au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification. Il est possible que les gains de productivité aient un peu ralenti ces dernières années (ils pourraient tendre vers 1,4 %), mais cela demande confirmation.
* 29 NATIXIS, Flash économie, 28 octobre 2008 - n° 486.
* 30 Entreprises non financières.
* 31 Albert Aftalion (1874-1956) a montré que si la technique de production est fixe (pour produire N fois plus, il faut N fois plus d'équipements), toute variation de la demande entraîne mécaniquement une variation de la FBCF plus forte que les variations initiales de la demande de produits.
* 32 Profits bruts = dividendes nets + autofinancement.
* 33 Notamment Patrick Artus ou Dominique Plihon, dont certaines des observations se rejoignent pour constater la propagation mondiale d'un modèle « anglo-saxon » de capitalisme dont les caractéristiques sont les suivantes : 1°) financement davantage en actions que par dette ; 2°) détention du capital des entreprises majoritairement par des investisseurs institutionnels (fonds de pension...) ; 3°) gestion des entreprises dans l'intérêt des actionnaires et non des autres partenaires de l'entreprise (salariés, clients, sous-traitants, prêteurs...), d'où un niveau élevé de rentabilité financière et des distributions importantes de dividendes.
* 34 Système de gestion des entreprises d'origine américaine ayant pour objectif de redonner le pouvoir aux actionnaires, par rapport aux conseils d'administration et aux dirigeants (public governance).
* 35 Il existe d'autres définitions du taux de profit.
* 36 L'excédent brut d'exploitation correspond au profit, c'est-à-dire à la valeur ajoutée moins les salaires (et cotisations) et les impôts sur la production. Il correspond donc au résultat du processus d'exploitation, et diffère du résultat d'exploitation stricto sensu dans la mesure où il ne prend pas en compte les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation d'actif.
* 37 Au cours des années quatre-vingt-dix, le ROE est passé de 12 % en moyenne à 17 % au États-Unis grâce à l'endettement, la rentabilité économique n'ayant que faiblement augmenté.
* 38 Ces derniers pratiquent des opérations de LBO (leveraged buyout) qui consistent dans le rachat d'entreprises en recourant massivement à l'emprunt pour les revendre plus cher une fois restructurées. Il est à noter que la recherche du rendement à court terme pour les actionnaires peut aussi s'effectuer au détriment de l'investissement.
* 39 Tout en se prémunissant, le cas échéant, contre les risques de rachat.
* 40 Et de façon incontestable, tout déficit primaire (il s'agit du déficit avant paiement des intérêts de la dette, dont les titres sont largement acquis par des agents économiques non résidents).
* 41 Il faut ajouter que les positions budgétaires apparentes des Etats sont favorablement influencées par le recours à l'endettement privé, du moins jusqu'à ce qu'une crise intervienne, si bien que toute appréciation nominale de ces positions budgétaires indépendante d'un jugement sur la soutenabilité de l'endettement privé recèle potentiellement des erreurs aux conséquences dramatiques.
* 42 La mondialisation de l'économie réduit à rien le théorème selon lequel la production crée sa propre demande dans un espace économique donné. C'est désormais à l'échelle économique mondiale que ce théorème doit être apprécié.
* 43 Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 déposé à l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008.
* 44 On distingue généralement les innovations de produit des innovations de procédé , ces dernières ayant trait au mode de production ou de distribution . Dans une autre approche, intégrant les progrès organisationnels, il est alors distingué quatre types d'innovation : innovation de produit, innovation de procédé (stricto sensu), innovation de commercialisation et innovation d'organisation.
* 45 Le « taux d'emploi » est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler (15 ans à 64 ans). Le taux d'emploi reflète ainsi la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'oeuvre (il convient de distinguer cette grandeur du taux d'activité, qui rapporte la « population active », regroupant la population ayant un emploi et les chômeurs, c'est-à-dire les individus présents sur le marché du travail, à la population en âge de travailler).
* 46 Cf. travaux de Gerschenkron (1965) puis de Acemoglu, Aghion et Zilibotti (2006).
* 47 La loi des rendements décroissants peut se formuler ainsi : lorsque l'entreprise augmente un facteur de production, capital ou travail, en maintenant l'autre fixe, la production marginale devient forcément décroissante à partir d'un certain seuil.
* 48 « Les leviers de la croissance française » par Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen et Jean Pisani-Ferry, novembre 2007.
* 49 Dans cette approche, la dépression correspond à une période de remise en cause de structures productives devenues surdimensionnées, de désendettement et de gestation de nouvelles innovations. La durée de chaque cycle dépend de l'importance des innovations et de leurs effets d'entraînement.
* 50 Rapport d'information n° 392 du 11 juin 2008, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification.
* 51 Recherche et développement.
* 52 Le rapport de notre collègue Bernard Angels consacré à l'économie des dépenses publiques l'a utilement rappelé. Rapport n° 441 « Retour sur l'économie des dépenses publiques ». Délégation pour la planification. 2 juillet 2008.
* 53 Il s'agit de définir « les orientations pluriannuelles des finances publiques ». Le projet de loi reprend le précédent exercice consistant à inscrire le projet de loi de finances de l'année dans la perspective pluriannuelle telle que la LOLF l'avait prévu mais en le solennisant puisque le Parlement sera appelé à se prononcer par un vote sur son adoption.
* 54 Voir infra.
* 55 Cela signifie qu'une hausse nominale de 1 % de l'activité se traduit par une hausse de 1 % des recettes publiques.
* 56 Quand on veut estimer le niveau de la variation conjoncturelle du solde public correspondant à des stabilisateurs automatiques purement conjoncturels, il faut poser l'hypothèse que les dépenses publiques évoluent au rythme de la croissance potentielle.
* 57 Ce rapport a été rédigé avant que n'intervienne la révision de croissance du gouvernement, le 6 novembre, et celle de la trajectoire des comptes publics à l'horizon 2010.
* 58 Un autre usage est explicité dans le présent rapport : celui qui conduit à faire de la croissance potentielle une variable d'appréciation de la nature de la politique budgétaire et, plus largement, de la position budgétaire d'un pays.
* 59 « Perspectives macroéconomiques et des finances publiques à moyen terme (2007-2011). 2011, au rendez-vous de la croissance et du désendettement ? Dix questions pour le moyen terme ». Rapport d'information n° 89 (2006-2007) du 23 novembre 2006, par M. Joël Bourdin .
* 60 Un relèvement du taux de fécondité est attendu mais n'exerce pleinement ses effets qu'au-delà.
* 61 Il y a là, à la fois, une condition de compatibilité entre la politique budgétaire décrite et le scénario économique qui l'accompagne et une justification implicite d'une politique budgétaire, qui sans ce ressaut de croissance, apparaîtrait excessivement restrictive.
* 62 C'est-à-dire sans modification du partage de la valeur ajoutée.
* 63 Et 59,1 % en 2013.
* 64 « Susceptibles » seulement car les structures créées par la loi pourraient avoir à engager moins de fonds que ce que le plafond d'intervention prévu par la loi ne suggère.
* 65 Comme on en évoque les raisons dans le chapitre suivant consacré à la stratégie fiscale associée à la programmation.
* 66 Il va de soi que le risque de contraction de la demande n'est pas exclusif d'un risque de contraction de l'offre, l'investissement des entreprises et la mobilisation du facteur travail étant en interrelation étroite avec le niveau de la production.
* 67 Qui, au demeurant, sont des références de plus en plus incertaines depuis que les Etats sont astreints à des positions de moyen terme d'équilibre voire d'excédents structurels de leurs comptes publics.
* 68 En dehors des aléas qu'appellent les remarques mentionnées en annexe sur l'allègement net de la fiscalité de 4,3 milliards d'euros que semble comporter en l'état la législation.
* 69 On rappelle que ces chiffres ne représentent plus de simples indications mais des objectifs que le Gouvernement demande au Parlement de sanctionner par un vote positif du projet de loi sur la programmation des finances publiques pour la période 2009-2012. Pour autant, l'autonomie des collectivités locales devrait être préservée et les objectifs de dépenses sociales ne se transformerait pas en des crédits limitatifs comme les lois de finances en comportent pour les dépenses de l'Etat.
* 70 Et de 2,7 points de PIB entre 2009 et 2013.
* 71 En s'inspirant notamment de la précieuse contribution du récent rapport de notre collègue Bernard Angels sur les dépenses publiques : rapport n° 441 (2007-2008) du 2 juillet 2008 « Retour sur l'économie des dépenses publiques ». Délégation pour la planification.
* 72 Indicateur dont l'interprétation doit être conduite avec une grande prudence mais qui tend à accréditer l'idée d'une très forte productivité du travail dans le secteur privé en France accompagnée d'une faible productivité du travail dans le secteur public.
* 73 Cette observation est importante car elle signifie qu'une réduction des dépenses publiques peut ne pas s'accompagner d'une réduction à due proportion des ressources consacrées au domaine dans lequel ces dépenses interviennent.
* 74 C'est d'ailleurs parce que la programmation est plus tendancielle dans le champ des transferts sociaux qu'on peut en juger la composante quantitative comme volontariste.
* 75 Il reste le risque qu'il ne le soit pas, soit que, supérieur, il résulte de coûts individuels de protection plus élevés, soit qu'inférieur il provienne de l'exclusion subie par certains du système de protection.
* 76 Cette note a été rédigée par Eric Heyer et Mathieu Plane, département analyse et prévision, OFCE.
* 77 Pour plus de détails, se référer au Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2009 (2008).
* 78 Cette partie reprend la synthèse rédigée sous la direction de Xavier Timbeau (2008), « Les promesses de l'ombre », Revue de l'OFCE , n°107, octobre.
* 79 Un ménage américain peut remettre les clefs de sa maison à la banque auprès de laquelle il a contracté un crédit immobilier. Il s'affranchit alors de sa dette et perd sa propriété. Lorsque le capital restant dû par le ménage est supérieur à la valeur de son habitation, il peut ainsi reporter la valeur nette négative résiduelle sur la banque.
* 80 Leveraged Buy Out, voir plus loin pour une description.
* 81 Credit Defaut Swap , voir plus loin pour une description.
* 82 L'extraction hypothécaire consiste à emprunter en garantissant l'emprunt par un collatéral comme une hypothèque. Un bien déjà gagé par ailleurs peut être mobilisé si la valeur nécessaire pour couvrir le premier emprunt est partiellement libérée par un remboursement partiel du premier emprunt ou un accroissement de la valeur du bien hypothéqué.
* 83 Différence entre la capitalisation boursière totale (source Datastream ) au 20 octobre 2008 et la capitalisation boursière totale moyenne de l'année 2007. La perte est de 5 800 milliards de dollars pour les Etats-Unis, 6 000 milliards de dollars pour l'Union européenne et de 9 220 milliards de dollar pour les places financières du reste du monde. Par rapport au point le plus haut (entre octobre et novembre 2007 pour les différentes zones), la perte de capitalisation est de 23 500 milliards de dollars.
* 84 C'est-à-dire s'assurer que le bénéficiaire du prêt s'acquitte de ses obligations et exercer la surveillance de l'emprunteur.
* 85 Les raisons de la hausse des défauts sont multiples. Premièrement, les montages subprime ont besoin de la hausse des prix pour être viables (ils sont spéculatifs ou procèdent de la finance à la Ponzi pour employer la terminologie de Minsky). Lorsque les prix ralentissent, les premiers défauts apparaissent, provoquant des ventes forcées et alimentant les baisses de prix. Le schéma est instable et doit nécessairement se retourner au bout d'un moment, même si ce moment n'est pas déterminé. Les subprime comportaient fréquemment des conditions de reset , qui induisaient une hausse des mensualités considérable au bout de deux années ; le défaut est alors provoqué par l'entrée dans le régime à mensualités élevées, sauf si l'on peut se refinancer grâce à des prix de l'immobilier qui ont crû. Ce mécanisme est analogue aux appels de marge dans le cas d'achat à découvert. Deuxièmement, le marché immobilier connaît des cycles de prix parce que l'offre est inélastique dans le court terme. L'élasticité de l'offre aux prix n'est pas nulle au bout de quelques trimestres et des vagues de construction viennent inonder le marché. Troisièmement, le marché immobilier, comme tous les marchés d'actifs, est sensible aux taux d'intérêt. La hausse des taux amorcée en juin 2004 a pu peser sur les prix . Cependant, le pic d'émission des subprime a eu lieu au cours de l'année 2006, puisqu'au troisième trimestre 2006, 21,2 % des crédits immobiliers produits l'étaient au titre des subprime. Avec les Alt-A , c'est un tiers des crédits immobiliers qui présentaient un risque important. Au cours de cette période, le taux directeur de la FED était de 5,25 %.
* 86 L'option 2 induit une restriction du crédit qui se traduit par un ralentissement économique ; le ralentissement économique accroît les défauts et donc le risque de crédit. L'option 3 induit un mouvement de ventes de titres d'actifs et une fuite vers la sécurité des titres publics, surtout américains. Cette fuite se traduit par une chute des marchés qui dégrade les bilans qui n'auraient pas encore été mis à l'abri de ce risque.
* 87 Il ne s'agit pas juridiquement d'une assurance. En effet, on peut détenir un CDS sans être pour autant exposé au risque de défaut, c'est-à-dire sans posséder l'obligation sous-jacente. Il s'agit alors d'un pari sur le défaut en échange d'une rémunération pendant la période du pari. En conséquence les CDS ne sont pas assujettis au code des assurances.
* 88 La raison est que les subprime ont donné lieu à une bulle. Lorsque la bulle éclate, et en particulier si elle a crû assez longtemps, des corrections de valeurs très importantes apparaissent. Les valeurs des collatéraux peuvent alors être divisées par deux ou trois pour tous les crédits subprime en même temps. La contrepartie de cette valeur évaporée, la dette des ménages endettés, n'est quant à elle pas réduite. Les défauts sont alors inévitables et très nombreux pour un montant du même ordre de grandeur que la dévalorisation totale des collatéraux. Dans le cas de dettes sur des entreprises privées, la corrélation entre les dévalorisations est beaucoup plus faible et le montant total de dévalorisation que l'on peut attendre en cas de ralentissement ou de récession reste largement inférieur à celui que l'on a vu sur les subprime.
* 89 Il faudrait, pour sortir des valeurs de référence, une récession très profonde qui de plus compromettrait la valeur de liquidation. Dans ce cas, les CDS emprunteraient le même chemin que les subprime , à une échelle abyssale. Ce qui transformerait une récession très profonde en cataclysme.
* 90 Lorsqu'on réalise la valeur du collatéral d'un subprime , on fait face à la perte de valeur suite à la baisse des prix immobiliers, les coûts de transaction et de saisie et les éventuelles dégradations ou pillages que le bien a subi. Au total, ces trois facteurs peuvent amener la valeur résiduelle nette près de 0. Dans le cas d'une obligation sur la dette d'une entreprise privée, les coûts de liquidation sont moindres relativement à l'actif liquidé.
* 91 Pour plus de détails, se référer à la partie « immobilier »
* 92 A. Duquerroy, J. Demuynck et P. Rousseaux (2008) : «Les crédits aux sociétés non financières en France : évolutions récentes », Bulletin de la Banque de France , n°174, juillet-août.
* 93 Ecarts entre les taux des dettes des entreprises et des meilleurs titres de la dette publique.
* 94 Nous ne disposons des comptes financiers des SNF que depuis 1995.
* 95 Pour l'évaluation du délai moyen d'ajustement de l'emploi à un choc de valeur ajoutée, voir Cueva, Heyer et Taddéï (1998) : « Fondements microéconomiques de la durée du travail et politiques de réduction », Revue de l'OFCE, n°64.
* 96 Voir sur ce point « Une base de comparaison des évolutions annuelles défavorable », Perspectives 2008-2009 pour l'économie française, Revue de l'OFCE, n° 105, pp. 130-131. Selon nos calculs, l'effet de base induit par le calcul des évolutions de prix en glissement annuel est à l'origine d'un supplément d'inflation d'environ 0,5 point dans la première moitié de 2008. Il répercute en accélération le ralentissement des prix un an plus tôt sous l'effet de la baisse - temporaire - du prix du pétrole initiée dans la seconde moitié de 2006.
* 97 Ce constat sectoriel tranche avec la meilleure tenue du taux de marge à l'échelon agrégé, ce qui montre que les branches de production situées en amont parviennent à mieux répercuter les hausses de coûts intermédiaires que les secteurs situés en aval.
* 98 Selon nos estimations, la croissance potentielle moyenne serait de 1,8 % sur la période 2008-2013. Or, le gouvernement retient une croissance potentielle de 2,2 % pour ses calculs d'impulsion budgétaire. Dans un souci de comparaison, nous retiendrons l'hypothèse du gouvernement pour nos calculs d'impulsion budgétaire.
* 99 Selon nos estimations, la croissance potentielle moyenne serait de 1,8 % sur la période 2008-2013. Or, le gouvernement retient une croissance potentielle de 2,2 % pour ses calculs d'impulsion budgétaire. Dans un souci de comparaison, nous retiendrons l'hypothèse du gouvernement pour nos calculs d'impulsion budgétaire.







