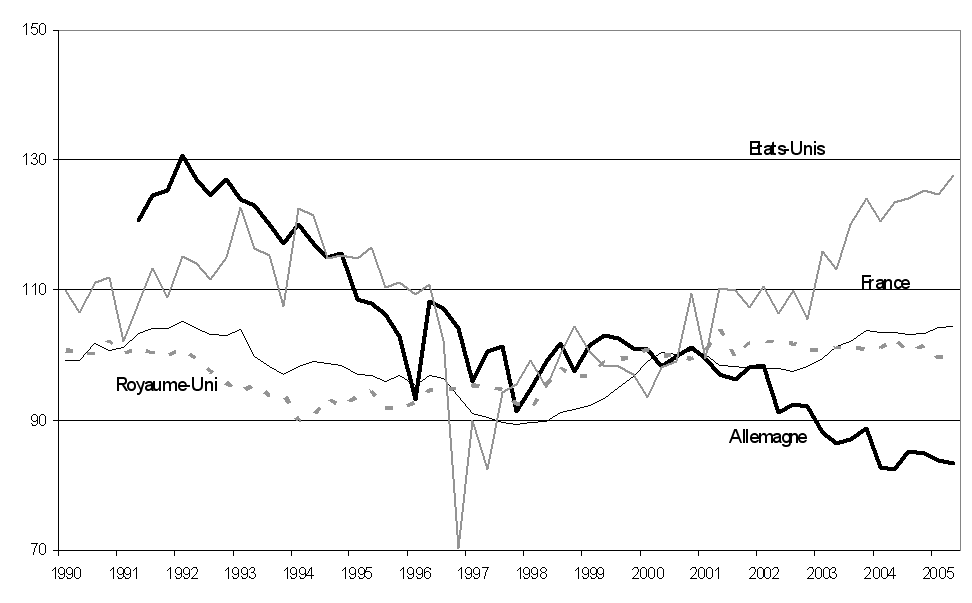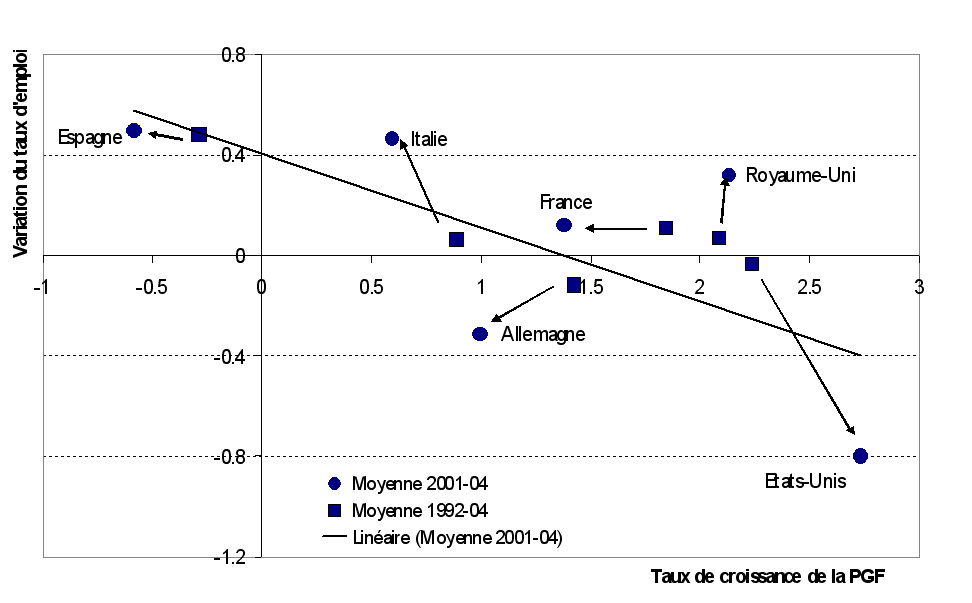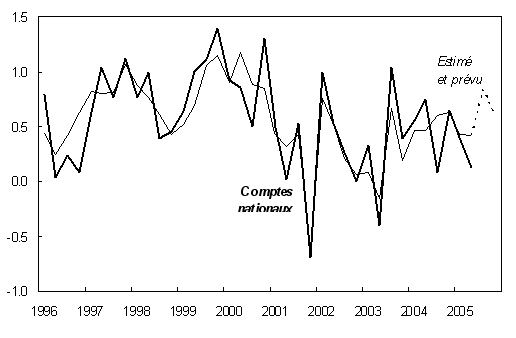Rapport d'information n° 97 (2005-2006) de M. Joël BOURDIN , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 23 novembre 2005
Disponible au format Acrobat (1,2 Moctet)
-
PRÉSENTATION - À PROPOS DES
PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES EXPOSÉES DANS LE PRÉSENT
RAPPORT
-
CHAPITRE I - LES PERSPECTIVES À COURT TERME
ILLUSTRENT QUELQUES HYPOTHÈQUES PESANT SUR LA CROISSANCE
FRANÇAISE
-
CHAPITRE II - LES VOIES ÉTROITES D'UNE
CROISSANCE AUTONOME SOUTENUE
-
I. UN CONTEXTE DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE
D'AJUSTEMENT STRUCTUREL QUI FREINE LA CROISSANCE
-
II. LES HYPOTHÈQUES INTERNATIONALES :
QUELLE RÉSORPTION DES ÉQUILIBRES MONÉTAIRES
INTERNA-TIONAUX ET QUELS RISQUES D'INFLATION ?
-
III. UNE HYPOTHÈQUE INTÉRIEURE
: Y A-T-IL DES RÉSERVES POUR LA CONSOMMATION DES
MÉNAGES ?
-
A. DES SCÉNARIOS CONDITIONNÉS
À UNE FORTE DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION DANS UN CONTEXTE DE PROGRESSION
MODÉRÉE DU REVENU DES MÉNAGES
-
1. La consommation doit être
particulièrement dynamique dans le scénario central...
-
2. ... mais aussi dans des scénarios
alternatifs où les autres agents contribuent davantage à la
croissance
-
a) un scénario de forte croissance de
l'investissement
-
b) L'impact d'une contribution positive du
commerce extérieur
-
(1) Une plus forte contribution des
échanges extérieurs à la croissance favoriserait la
réalisation des scénarios envisagés.
-
(2) La probabilité d'une forte contribution
du commerce extérieur à la croissance est faible et suspendue
à des conditions d'environnement international plus ou moins
maîtrisables.
-
(1) Une plus forte contribution des
échanges extérieurs à la croissance favoriserait la
réalisation des scénarios envisagés.
-
a) un scénario de forte croissance de
l'investissement
-
1. La consommation doit être
particulièrement dynamique dans le scénario central...
-
B. RETOUR SUR LES CONDITIONS D'UNE
RÉDUCTION DU TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES
-
A. DES SCÉNARIOS CONDITIONNÉS
À UNE FORTE DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION DANS UN CONTEXTE DE PROGRESSION
MODÉRÉE DU REVENU DES MÉNAGES
-
IV. PRÉCISIONS SUR QUELQUES ASPECTS DU
DÉBAT SUR LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
-
I. UN CONTEXTE DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE
D'AJUSTEMENT STRUCTUREL QUI FREINE LA CROISSANCE
-
CHAPITRE III - FINANCES PUBLIQUES : LES
ENSEIGNEMENTS DES PROJECTIONS ET DES TENDANCES RÉCENTES
-
I. LES PROJECTIONS METTENT EN ÉVIDENCE LES
CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA TRAJECTOIRE D'AJUSTEMENT DES COMPTES
PUBLICS
-
A. LES RÉSULTATS DES PROJECTIONS SONT EN
LIGNE AVEC LE PROGRAMME DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE DU
GOUVERNEMENT.
-
B. DES RÉSULTATS DONT LES CONDITIONS DE
RÉALISATION SONT CLAIREMENT IDENTIFIÉES PAR LES
PROJECTIONS
-
A. LES RÉSULTATS DES PROJECTIONS SONT EN
LIGNE AVEC LE PROGRAMME DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE DU
GOUVERNEMENT.
-
II. POUR UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE ACTIVE ET
SOUTENABLE ET DES INTERVENTIONS PUBLIQUES EFFICACES
-
A. PRÉCISIONS SUR LES CRITÈRES DE
JUGEMENT DE L'ORIENTATION DONNÉE À LA POLITIQUE
BUDGÉTAIRE
-
B. BREF RETOUR SUR LES ENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
-
1. La politique budgétaire est d'autant
plus maniable qu'elle n'est pas bridée par des règles
-
2. La politique budgétaire peut être
franchement contra-cyclique, avec succès
-
3. La politique budgétaire est d'autant
plus efficace que certaines conditions sont réunies
-
4. Toutes les politiques budgétaires de
soutien conjoncturel recourant au déficit peuvent être
qualifiées d'insoutenables, ce qui ne suffit pas à les
discréditer...
-
5. ...à la condition que les politiques
budgétaires soient symétriques.
-
6. Il n'existe pas de justification
économique à un solde budgétaire structurel à
l'équilibre
-
1. La politique budgétaire est d'autant
plus maniable qu'elle n'est pas bridée par des règles
-
C. PROMOUVOIR ENFIN L'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES AU SERVICE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
-
A. PRÉCISIONS SUR LES CRITÈRES DE
JUGEMENT DE L'ORIENTATION DONNÉE À LA POLITIQUE
BUDGÉTAIRE
-
I. LES PROJECTIONS METTENT EN ÉVIDENCE LES
CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA TRAJECTOIRE D'AJUSTEMENT DES COMPTES
PUBLICS
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
ANNEXE OFCE
-
ANNEXE I : PROJECTION DE LA
PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL EN FRANCE AU NIVEAU SECTORIEL À
L'HORIZON 2015
-
I.I.1 PARTAGE DE LA VAB ENTRE LA VA MARCHANDE ET
LA VA NON MARCHANDE À PARTIR DU COMPTE CENTRAL
-
I.1.2. RÉPARTITION DE LA VA MARCHANDE NON
CORRIGÉE DES INTÉRIMS ENTRE LES 4 GRANDS SECTEURS
MARCHANDS
-
I.1.3. RÉPARTITION SOUS SECTORIELLE DANS
L'INDUSTRIE ET LES SERVICES MARCHANDS
-
I.2.1. PART DE CHAQUE SECTEUR DANS LE PIB
-
I.2.2. PART DE CHAQUE SOUS-SECTEUR DANS LE
PIB
-
I.I.1 PARTAGE DE LA VAB ENTRE LA VA MARCHANDE ET
LA VA NON MARCHANDE À PARTIR DU COMPTE CENTRAL
-
ANNEXE II : TABLEAUX FINANCES
PUBLIQUES
N° 97
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2005 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme (2006-2010),
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; M. Pierre André, Mme Évelyne Didier, MM. Joseph Kergueris, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Yvon Collin, Claude Saunier, secrétaires ; MM. Bernard Angels, Gérard Bailly, Yves Fréville, Yves Krattinger, Philippe Leroy, Marcel Lesbros, Jean-Luc Miraux, Daniel Soulage .
|
Finances publiques. |
PRÉSENTATION - À PROPOS DES PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES EXPOSÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT
Considérant qu'une assemblée parlementaire ne saurait négliger les moyens modernes d'analyse et de prévision - par ailleurs largement utilisés par le Gouvernement - le Sénat a souhaité, dès le début des années 1980, compléter son information par l'utilisation de modèles macroéconomiques 1 ( * ) .
Pour ce faire, il a confié à son Service des Études économiques et de la Prospective la tâche de commander des projections, réalisées à partir de modèles, à des organismes publics - Direction de la Prévision et Institut national de la statistique et des Études économiques (INSEE) - dans un premier temps ; puis, prenant acte des difficultés croissantes de collaboration avec ceux-ci, à des instituts « indépendants » tels que le Centre d'Observation Économique (COE) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, ou l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Le choix de passer commande à un organisme extérieur, de préférence à l'utilisation et l'exploitation directes d'un modèle par le Sénat, obéit à la fois à des considérations de bonne gestion des deniers publics et au souci de garantir l' indépendance scientifique de ces travaux.
Depuis qu'elle a été créée par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il est revenu à la Délégation pour la Planification, eu égard à sa vocation prospective, de présenter la synthèse de ces travaux de projection et de simulation et de les soumettre chaque année au Sénat, au moment de la discussion budgétaire. Cela fait donc plus de vingt ans qu'elle remplit cette mission qui au-delà des évolutions qui ont marqué la « planification à la française », a toujours été considérée dans notre Haute Assemblée comme un apport précieux à la vocation du Sénat de se tourner vers l'avenir.
Il convient de souligner que, ce faisant, le Sénat a contribué de manière remarquée à l'animation du débat public en macroéconomie.
Certes, l'utilisation de modèles macroéconomiques ne fournit qu'un éclairage parcellaire des discussions de politique économique auxquelles donne lieu le vote d'une loi de finances. De même, l'instabilité croissante des comportements économiques, accentuée par la globalisation financière, altère profondément la probabilité de réalisation des scénarios décrits par des projections macroéconomiques.
Ainsi la Délégation pour la Planification ne prétend-elle pas, en présentant ces travaux, fournir une prévision et, encore moins, une évolution probable de l'économie française.
Une projection ne constitue souvent qu'une prolongation du passé et, de ce fait, qu'une extrapolation des tendances en cours.
Mais c'est précisément dans l'analyse de ces tendances que réside l'intérêt d'une projection, car elle permet ainsi de mettre en lumière les questions et les choix de politique économique. Par exemple, deux questions fondamentales se posent, aujourd'hui, à l'économie française : le redressement de la demande interne est-il solide et traduit-il une réelle inflexion de la tendance à l'oeuvre depuis deux ans, marquée par l'atonie de la demande interne ? Les engagements financiers de la France l'obligent à une politique budgétaire restrictive , choix majeur d'orientation de la politique économique doit il faut analyser les conséquences complexes.
Par ailleurs, une projection décrit un scénario dont la cohérence globale est garantie. Par exemple, l'évolution de l'emploi et du chômage affichée en projection, ou encore celle des comptes publics, est cohérente avec le rythme de la croissance. Cela permet ainsi d'apporter des éléments de réponse à des questions qui sont fréquemment posées aujourd'hui : l'accélération en cours de l'activité, si elle est durable, garantit-elle le retour au « plein-emploi » ? Ou encore, permet-elle de relâcher les contraintes budgétaires et de dégager des « marges de manoeuvre budgétaires » ?
Enfin, l'utilisation des modèles en « variante » permet d'apprécier les effets de scénarios alternatifs et de mesurer l'impact de chocs économiques.
En favorisant ainsi la diffusion de travaux, dont le degré de technicité ne facilite guère l'utilisation, votre Délégation souhaite contribuer à la compréhension des mécanismes économiques et mettre en lumière les enjeux de politique économique pour le moyen terme.
Votre rapporteur tient ici à remercier les équipes de l'OFCE pour la qualité de leurs travaux et leur apport décisif au débat public sur les questions économiques où le Parlement, c'est un impératif pour la démocratie, doit jouer tout son rôle .
CHAPITRE I - LES PERSPECTIVES À COURT TERME ILLUSTRENT QUELQUES HYPOTHÈQUES PESANT SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE
Par convention, les exercices de projection et de simulation à moyen terme présentés par votre Délégation sont « calés » pour ce qui concerne les deux premières années - ici 2005 et 2006 - sur les hypothèses macroéconomiques associées au projet de loi de Finances.
Ceci permet en effet d'éviter de perturber l'analyse des perspectives d'évolution à moyen terme des finances publiques et de la programmation pluriannuelle présentée par le Gouvernement, par une divergence éventuelle d'évolution macroéconomique qui résulterait d'un « point d'entrée différent ».
On peut d'ailleurs observer que le scénario de reprise retardée de l'économie française que décrivent les derniers « budgets économiques » présentés par le gouvernement est également celui que privilégie, pour l'essentiel, l'OFCE 2 ( * ) .
Ce scénario se déroulerait en deux temps : la reprise différée de 2005 ferait place à un retour de la croissance à son rythme potentiel.
I. UNE REPRISE DIFFÉRÉE EN 2005 OU LE POIDS DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
A. LE POIDS DES CHOCS EXTÉRIEURS SUR LA CROISSANCE
Le Ministère de l'Économie et des Finances (MINEFI) a révisé sa prévision de croissance de l'économie française en 2005 par rapport à l'exercice de prévision de l'année dernière à la même époque : de 2,5 % en octobre 2004 (prévision associée au PLF 2005) à 2,25 % 3 ( * ) en avril 2005 et 1,75 % 2 aujourd'hui .
Ainsi, après une année 2004 où l'économie française a connu une reprise sur un rythme comparable à celui des épisodes précédents (1994 et 1997), soit + 2,3 %, l'activité a nettement fléchi en 2005.
La reprise , dont les prévisionnistes anticipaient logiquement le prolongement en 2005, s'est ainsi enrayée en raison de trois chocs extérieurs négatifs :
la hausse progressive de l'euro entre 2001 et 2005 a pesé sur la compétitivité, amputant la croissance française à hauteur de 0,7 point en 2004 et 0,6 point en 2005 (selon les estimations réalisées à l'aide du modèle e-mod de l'OFCE) ;
la hausse du prix du pétrole a freiné la croissance à hauteur de 0,2 point en 2004 et 0,5 point en 2005 (mêmes estimations OFCE) ;
la politique de contraction des coûts salariaux conduite par l'Allemagne, que l'on peut qualifier de politique de « désinflation compétitive », a non seulement accentué les pertes de parts de marché de la France mais a également entraîné une contraction de la demande interne et donc des importations de notre principal partenaire. L'impact négatif de la « stratégie allemande » sur l'économie française est évalué à 0,3 point de PIB en 2005 (source OFCE).
Ces trois éléments cumulés amputeraient donc la croissance française à hauteur de 1,4 point de PIB en 2005. Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, sans ces chocs extérieurs négatifs, la croissance française aurait été supérieure à 3 % en 2005 (1,75 % + 1,4 %).
La France n'est pas la seule concernée en Europe par ce ralentissement. L'ensemble des pays de la zone euro, mais aussi le Royaume-Uni subiraient en 2005 une nette décélération.
Au demeurant, celle-ci n'épargnerait pas les États-Unis ou le Japon où, néanmoins, le rythme de la croissance continuerait d'être nettement plus rapide.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SCÉNARIO
INTERNATIONAL ET DANS LA ZONE EURO
CROISSANCE EN % (POIDS DANS LE PIB
MONDIAL EN %)*
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
Monde |
2,5 |
3,6 |
4,8 |
4,0 |
|
États-Unis (25 %) |
1,6 |
2,7 |
4,2 |
3,4 |
|
Japon (8 %) |
- 0,3 |
1,4 |
2,7 |
2,3 |
|
Royaume-Uni (4 %) |
2,0 |
2,5 |
3,2 |
1,9 |
|
Asie hors Japon (28 %) |
6,2 |
7,6 |
7,8 |
7,0 |
|
PECO et Russie (4 %) |
3,7 |
5,9 |
6,3 |
4,6 |
|
Amérique Latine (7 %) |
- 1,2 |
2,5 |
6,1 |
4,2 |
|
Zone euro |
0,9 |
0,7 |
2,1 |
1,4 |
|
dont Allemagne |
0,1 |
- 0,2 |
1,6 |
0,9 |
|
dont Italie |
0,4 |
0,3 |
1,2 |
0,0 |
|
dont Espagne |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
3,2 |
(*) Les poids sont calculés d'après les PIB
à parité de pouvoir d'achat de la Banque
Mondiale.
Source
: Rapport économique, social et
financier. PLF 2006.
B. FRANCE, ALLEMAGNE, ITALIE : LE TEMPS DES INTERFÉRENCES NÉGATIVES
Dans la zone euro , le ralentissement en Allemagne et en Italie serait particulièrement prononcé , même si ces deux pays connaissent depuis plusieurs années une croissance déjà très lente, qui, compte tenu de leur poids relatif dans l'économie de la zone pèse sur l'ensemble.
Les situations de nos deux grands partenaires ne sont pas identiques mais leurs effets sur la France et sur sa croissance ne diffèrent que par leur ampleur et non dans leur nature .
1. L'Italie ou la folle tentation
En Italie , l' activité connaît une langueur persistante avec une croissance annuelle moyenne de 0,05 % l'an , depuis 2001 .
La demande intérieure est en progression de plus en plus lente tandis que la contribution du commerce extérieur italien est devenue fortement négative .
Les problèmes rencontrés par l'Italie apparaissent de nature essentiellement structurelle même s'ils ont été aggravés par une gestion des finances publiques sous contraintes .
Un débat a été ouvert en Italie sur la responsabilité de l'euro pour la dégradation de la position internationale du pays à telle enseigne que la participation de l'Italie à la zone euro a pu être remise en cause .
Dans un premier temps du raisonnement, l'appréciation de l'euro face aux autres monnaies a été jugée responsable du recul des performances commerciale italiennes. Mais, on peut observer que l'appréciation de l'euro qui a touché tous les membres de la zone euro ne s'est pas répercutée chez les partenaires de l'Italie avec la même ampleur : les pertes de parts de marché de l'Italie atteignent 1 point entre 1994 et 2003 (de 4,2 à 3,2 % de l'ensemble des exportations mondiales contre -0,2 point en France ; par exemple). D'autre part, au sein de la zone euro, l'effet du taux de change n'existant plus par hypothèse, c'est le niveau d'inflation relatif qui a entraîné une appréciation du prix des produits italiens.
Ce constat nourrit le deuxième aspect de l'argumentaire « anti-euro » : les pertes de marge de manoeuvre que l'Italie pouvait retirer des dévaluations d'avant l'euro seraient insupportables.
Sur ce plan également, le plaidoyer pour un abandon de l'euro n'est pas convaincant.
Les nombreuses conditions de succès d'une dévaluation compétitive sont liées à l'absence de problèmes structurels dans l'économie qui y a recours . Notamment, parmi les conditions d'une dévaluation réussie figure une stricte modération salariale dont la probabilité d'occurrence est d'autant plus faible que les problèmes structurels d'un pays ne sont pas résolus.
Or, les problèmes de l'Italie sont essentiellement de nature structurelle, sa mauvaise spécialisation productive et ses très faibles gains de productivité. Ainsi, si l'augmentation des prix observée en Italie n'est pas le résultat d'une grande dynamique salariale autonome absolue (le pouvoir d'achat des salaires directs dans le secteur manufacturier a peu de ressort ces dernières années), le rythme des gains de productivité aurait dû entraîner une modération plus nette encore des salaires dans l'industrie afin de prévenir l'apparition d'une hausse des coûts salariaux unitaires qui pèse sur la compétitivité italienne. Dans le secteur abrité, en revanche, les salaires augmentent davantage même si, c'est heureusement sans réelle contagion sur le secteur exposé jusqu'à présent 4 ( * ) .
En bref, les gains de productivité sont insuffisants en Italie pour nourrir une demande interne robuste si l'on veut respecter la contrainte de compétitivité qui s'impose à tout pays.
De fait, une croissance des salaires plus en ligne avec les gains de productivité se serait traduite non seulement par un ralentissement de la consommation des personnes concernées encore plus important, mais aussi, sans doute, par une perte de confiance de l'ensemble des ménages encore plus accusée.
Nulle dévaluation ne permet en soi de régler des problèmes structurels, parmi lesquels il faut attacher une attention particulière au fonctionnement du marché du travail. L'Italie cumule les handicaps de ce point de vue avec une segmentation importante du marché du travail et la perspective d'une contagion salariale du secteur abrité vers le secteur exposé, et de très faibles gains de productivité dans ce secteur.
La modération salariale observée dans l'industrie , même insuffisante, s'est déjà traduite du fait de la gestion des finances publiques et du fait de l'enrichissement du contenu en emplois de la croissance, par une perte du pouvoir d'achat du salaire par tête. Sans hausse des gains de productivité, un durcissement de la modération salariale s'imposera en Italie. En pratique, une dévaluation amplifierait encore cette exigence.
Les vraies questions que la situation italienne devrait conduire à explorer sont celles de la capacité de la péninsule à résoudre ces problèmes structurels et de la pertinence de politiques financières publiques, qui, en affichage du moins, visent un ajustement structurel des comptes publics.
Les mesures structurelles qui sont intervenues pour compenser partiellement la dégradation du solde conjoncturel, ont eu des effets défavorables sur la croissance sans parvenir à enrayer le déficit public.
2. L'Allemagne doit-elle être une « économie de bazar » ?
Une configuration analogue touche l'Allemagne, à la grande différence près que ce pays remporte des succès indéniables sur le front du commerce international .
La stratégie économique allemande est fondée sur une analyse des effets de la mondialisation qui, pour certains , conduirait l'Allemagne à opter pour le modèle de l'économie de bazar .
Une telle écon omie, qui se caractérise par la priorité donnée aux exportations de biens auxquels on n'apporte sur place qu'une valeur ajoutée minime (les biens transformés sur place sont importés), est sans doute assez loin de représenter fidèlement un pays où le « made in Germany » reste en tant que savoir-faire un acquis considérable .
Il n'empêche que l' Allemagne semble avoir pour priorité quasi-exclusive de satisfaire la demande extérieure à travers sa capacité d'exportation .
Cette orientation rencontre un succès indéniable puisque le pays est redevenu le premier exportateur mondial.
|
LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ALLEMAGNE
D'APRÈS LE RAPPORT
Comme en France, la question de l'attractivité et de la compétitivité de l'Allemagne soulève de vifs débats chez nos voisins outre-Rhin. Les entreprises sont accusées de délocaliser leur production vers les pays de l'Est et la Chine aux dépens de l'emploi local. En outre, certains s'interrogent sur la pertinence des exportations comme indicateur de la compétitivité allemande dans la mesure où une part croissante des produits exportés ne sont pas fabriqués en Allemagne, mais sont simplement « réexportées ».
Afin de contribuer au débat, le conseil des experts en
économie
5
(
*
)
s'est
donc intéressé à la compétitivité et
à l'attractivité de l'Allemagne à travers deux
notions : les investissements directs à l'étranger et les
exportations.
1. Les exportations allemandes a. L'Allemagne premier exportateur mondial En 2003, l'Allemagne est redevenu le premier exportateur mondial 6 ( * ) de marchandises devant les États-Unis, ses exportations représentant 10 % des exportations mondiales. La répartition géographique des exportations allemandes a évolué depuis 1996 et se caractérise aujourd'hui par une augmentation des exportations en direction des pays de l'Est (6 % des exportations en 1996 contre 8,4 % en 2003) et de la Chine (1,4 % des exportations en 1996, 2,8 % en 2003), au détriment de l'Union européenne (57,4 % des exportations en 1996, 55,5 % des exportations en 2003) et des autres pays asiatiques -y compris le Japon- (7,1 % en 1996, 4,2 % en 2003). b. Une compétitivité prix renforcée Le conseil des experts lie ces bonnes performances à la compétitivité prix 7 ( * ) renforcée de l'Allemagne dont l'indice se situe actuellement trois points au-dessous de sa moyenne à long terme. En ce qui concerne les coûts du travail, les statistiques de l'OCDE révèlent que depuis 1995, la compétitivité des entreprises allemandes s'est également améliorée dans la mesure où les coûts salariaux unitaires ont évolué moins rapidement qu'en Hollande, aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni. c. Des exportations de moins en moins « made in Germany » Pourtant, le contenu des exportations allemandes peut faire planer des doutes sur la véritable compétitivité de l'Allemagne. D'une part, la part dans les exportations totales allemandes des biens importés en Allemagne puis réexportés sans avoir subi de véritable transformation est passée de 7,1% en 1991 à 15,2 % en 2002. D'autre part, la part des produits manufacturés en Allemagne puis exportés qui contiennent des produits semi-finis importés est passée sur la même période de 20% à 23 %. En conséquence, entre 1991 et 2002, la part de la valeur ajoutée créée en Allemagne pour chaque euro résultant d'une exportation a diminué, passant de 74,3% à 62,2%. Pour les auteurs de l'étude, ces chiffres doivent être interprétés non pas comme un signe de la transformation de l'Allemagne en simple plaque tournante commerciale, mais comme la preuve d'une adaptation efficace des entreprises allemandes exportatrices à la division internationale du travail , avec notamment l'ouverture des pays de l'Est et de la Chine. Ils sont en ce sens très symboliques de la « mondialisation » à l'oeuvre. Certes, l'augmentation des consommations intermédiaires importées entraîne une diminution de la valeur ajoutée créée en Allemagne par unité de produit exporté. Mais la hausse du volume des exportations fait plus que compenser ce phénomène. d. Solde commercial et marché du travail Selon le conseil des experts, le commerce extérieur aurait eu un impact positif sur l'emploi. Une analyse input-output montre qu'entre 1995 et 2000, les exportations ont généré 300.000 emplois nets 8 ( * ) . En effet, bien que la production de biens à l'exportation entraîne une substitution d'emplois étrangers aux emplois nationaux en raison du mécanisme évoqué ci-dessus, l'augmentation des exportations contrebalancerait ce phénomène et permettrait le maintien et la création d'emplois en Allemagne : l'effet volume ferait plus que compenser l'effet valeur 9 ( * ) . Le conseil des experts constate toutefois que sur l'ensemble des années 90, les exportations n'ont pas suffi à jouer un rôle stabilisateur au niveau de l'emploi dans la mesure où la réunification allemande puis la récession de 1993 ont entraîné une perte de près de 2 millions d'emplois. L'étude s'intéresse également aux éventuelles conséquences négatives de la libéralisation des échanges en matière d'emploi des personnes peu qualifiées : dans la mesure où les pays du Sud-Est asiatique et les pays de l'Est bénéficient d'énormes avantages en matière du coût du travail par rapport à l'Allemagne et disposent en outre d'un réservoir de main d'oeuvre bien formée, une délocalisation des activités riches en main d'oeuvre est aisément concevable. La forte augmentation des importations allemandes en provenance de ces pays et leur diversification semblent renforcer ces craintes. Ainsi, entre 1996 et 2003, les importations de matières plastiques des pays de l'Est ont triplé, passant de 6 à 16 % des importations totales allemandes dans ce secteur, celles de machines ont plus que doublé (7 à 16 %), celle de machines de bureau et d'ordinateurs ont été multipliées par 7 (1 % à 7 %) tandis que celle des voitures et pièces détachées ont quadruplé (6 % à 24 %). Les importations en provenance de la Chine ont également fortement augmenté, notamment dans le domaine des textiles (3,4 % à 14,4 %) et de l'habillement (10,9 % à 15,8 %), mais aussi dans les secteurs des machines (2,5 % à 4,2 %), des machines de bureau et des ordinateurs (10,9 % à 15,8 %) ainsi que des appareils électroniques (4,1 % à 10,6 %). Pour autant, selon les auteurs de l'étude, les importations en provenance de ces pays ne peuvent pas être considérées comme les principales responsables de la diminution de l'emploi dans l'industrie en Allemagne dans la mesure où elles ne représentent que 15 % des importations totales allemandes. 2. Les investissements directs à l'étranger L'attrait croissant des entreprises allemandes pour les investissements à l'étranger depuis le milieu des années 90 a fait craindre un transfert des centres de production de l'Allemagne vers l'étranger et des licenciements massifs. Ces craintes ont été renforcées lors de la publication en 2003 d'un sondage de la chambre de commerce et d'industrie allemande auprès de 10.000 entreprises selon lequel 18% d'entre elles avaient investi les trois dernières années à l'étranger en raison de la faible « attractivité » de l'Allemagne, ce qui représentait un manque à gagner de 50.000 emplois domestiques par an. Le conseil des sages a donc analysé si les investissements allemands directs à l'étranger témoignaient d'une moindre attractivité de l'Allemagne. Selon la littérature économique, deux raisons expliquent les investissements directs à l'étranger : - la volonté de conquérir un marché (investissements directs « horizontaux ») ; - la recherche d'économies sur les coûts de production (investissements directs « verticaux »). a. La destination des investissements directs allemands Une analyse approfondie des investissements directs allemands montre qu'ils relèvent essentiellement d'une stratégie de conquête de marché. En effet, la structure géographique des investissements allemands révèle la prédominance des pays développés comme pays destinataires desdits investissements. En 2002 , le montant cumulé des investissements effectués dans les pays développés représentait 85,7 % des investissements allemands. En revanche, le montant cumulé des investissements allemands dans les pays dits « en restructuration 10 ( * ) » s'élevait à seulement 6,7%. Les 7,6% restants étaient investis dans d'autres pays en développement (Amérique latine et Asie). En valeur absolue, le montant cumulé des investissements directs allemands dans les pays industrialisés s'élève en 2002 à 651,5 milliards d'euros contre 43,9 milliards d'euros investis dans les pays dits « en restructuration » (dont 28 milliards d'euros au total pour la Pologne, la République tchèque et la Hongrie et 6 milliards d'euros pour la Chine). En flux, toutefois, le poids des pays de l'Est a considérablement augmenté entre 1990 et 2002 puisque sur cette période, le volume d'investissement a crû de 50 % par an contre seulement 15% vers les pays industrialisés. En outre, le fait que les investissements allemands soient prépondérants dans les pays développés n'empêche pas que les investissements dans les pays dits « en restructuration » soient motivés par des différentiels de coûts. b. Des investissements plus riches en emplois dans les pays où la main d'oeuvre est moins chère Il apparaît ainsi que la part des PECO dans le nombre d'emplois totaux créés à l'étranger par les multinationales allemandes (15,9 % en 2001) est proportionnellement plus importante que leur part dans les investissements directs allemands (4,2 %), ce qui laisserait penser que les investissements directs allemands dans ces pays ont été motivés par des différentiels de coût . Une étude empirique 11 ( * ) a d'ailleurs démontré que 45 % des investissements allemands dans cette région sont motivés par des salaires moins élevés 12 ( * ) . Ce critère jouerait à 70% pour les investissements en république tchèque, en Bulgarie, en Slovaquie et en Roumanie, mais serait beaucoup moins important pour les investissements en Pologne (14 %) et en Slovénie (12 %). c. Les conséquences des investissements directs à l'étranger sur le marché du travail en Allemagne Entre 1990 et 2002, les entreprises détenues par des investisseurs allemands à l'étranger 13 ( * ) ont créé 2,1 millions d'emplois. Ce chiffre est souvent comparé à la perte, sur la même période, de 2,6 millions d'emplois en Allemagne dans l'industrie. Les conséquences des délocalisations vers les PECO sur le marché du travail allemand ont fait l'objet de plusieurs études dont les résultats ne sont pas toujours concordants. Toutefois, on peut en tirer les enseignements suivants : - les délocalisations s'accompagnent d'une perte d'emplois en Allemagne, mais cette dernière est relativement faible en raison de la différence de productivité entre l'Allemagne et les PECO. Une étude estime que la création de 463.550 emplois dans les pays de l'Est a conduit à la suppression de 89.106 emplois en Allemagne, soit 0,3 % du nombre d'emplois total ; - la diminution des salaires dans les pays de l'Est a des effets contradictoires sur le nombre d'emplois en Allemagne . Selon une étude, une baisse des salaires de 1% dans la filiale installée les PECO entraînerait une diminution du nombre d'emplois de 0,5% dans la mère allemande. Mais dans une autre étude, une diminution des salaires de 10 % dans les pays de l'Est conduirait à une augmentation de 1,6 % du nombre d'emplois en Allemagne. Ce résultat surprenant s'expliquerait par le fait qu'en délocalisant une partie de leurs activités de production, les entreprises allemandes arriveraient à économiser entre 65 et 80 % de leurs coûts salariaux, ce qui leur permettrait de rester fortement compétitives et de voir leurs carnets de commande gonfler. L a stratégie des entreprises allemandes ne serait donc pas de faire jouer la concurrence entre les entreprises mères et leurs filiales à l'étranger pour produire les mêmes biens finis, mais de profiter des avantages comparatifs de la division internationale du travail en faisant produire à chaque filiale différents composants pour le même produit fini ; - les entreprises allemandes tendraient à délocaliser les activités les plus qualifiées dans les pays de l'Est . Ce résultat s'appuie sur une étude montrant que les filiales allemandes en Russie emploient 2,9 fois plus de personnel qualifié que les mères allemandes, la République tchèque et la Croatie 1,7 fois plus et l'Ukraine 1,4 fois plus. Selon la théorie économique, un pays délocalise le type d'activités pour lesquelles il est relativement moins bien doté en main-d'oeuvre. Or, les statistiques de l'Organisation Internationale du Travail (1998) révèlent que la part des salariés avec un niveau d'éducation universitaire en Allemagne est plus faible que celle des pays l'OCDE, mais aussi que celle de certains pays dits « en transition » tels que les pays baltes, la Hongrie et la Russie. Une autre étude montre également que les multinationales allemandes investissent principalement dans les pays dont la main d'oeuvre est qualifiée. |
Toutefois, ces performances sont réalisées aux dépens de la population nationale dont le pouvoir d'achat et la consommation se replient et, finalement, de la croissance. Les objectifs d'ajustement structurel des finances publiques allemandes sont ambitieux. Mais, la politique des finances publiques aggrave les résultats récessifs des autres volets de la politique économique allemande, qu'on peut qualifier de politique de désinflation compétitive , de sorte que les cibles de déficit ne sont jamais atteintes .
A partir de 2001, l'Allemagne est entrée dans une phase de croissance très faible, de 0,4 % par an en moyenne contre 1,2 % dans la zone euro. Le ralentissement allemand a été plus accusé que dans les autres grands pays de la zone euro excepté les Pays-Bas.
En outre, une stratégie économique fondée sur la compétitivité prix est fortement dépendante de la conjoncture internationale et des politiques des gouvernements étrangers . Ainsi, il suffit que l'euro s'apprécie face au dollar ou que le coût d'un facteur de production augmente fortement (le pétrole par exemple) pour mettre à mal la compétitivité prix de l'Allemagne.
Il s'agit d'une stratégie non coopérative qui s'avère contreproductive dans une économie régionale fortement intégrée telle l'Union européenne : si l'ensemble des pays se lancent dans une course à la compétitivité prix, les niveaux de compétitivité entre pays ne bougent pas mais les autres composantes de la demande globale tels que la demande des ménages, l'investissement privé et l'investissement publics sont affectées durablement. Un cercle vicieux peut s'instaurer avec, d'une part des tensions sur les salaires et un chômage élevé qui freinent la consommation intérieure et, d'autre part, une croissance faible qui limite fortement les capacités de financement des administrations publiques. Il apparaît donc qu'un pays dont la croissance repose uniquement sur le dynamisme des exportations est voué à une croissance faible, peu créatrice d'emplois.
En conséquence, on peut s'interroger sur les liens de cause à effet entre l'augmentation du solde de la balance commerciale de l'Allemagne et la compétitivité de ce pays . La bonne tenue du solde commercial allemand emprunte à une conjoncture morose due à la faiblesse de la demande intérieure.
La situation économique allemande actuelle témoigne en partie et peut-être surtout, de l'incapacité de ce pays à relancer sa demande intérieure .
Cette politique n'est pas sans incidence sur les finances publiques allemandes . Une activité tirée par l'exportation sans transmission aux agents domestiques est peu productrice de recettes fiscales.
En 2003, le déficit public allemand a atteint 3,8 % du PIB contre un excédent de 1,3 point de PIB en 2000 . Après une très nette dégradation des comptes publics en 2001 (le solde public s'est détérioré à hauteur de 4,1 point de PIB entre 2000 et 2001), l' Allemagne s'est efforcée de limiter le creusement de son déficit public sans pouvoir éviter d'enfreindre le pacte de stabilité et de croissance en 2002 avec un déficit de 3,6 points de PIB supérieur à la limite de 3 % du PIB.
Alors qu'une partie importante du déficit apparu en 2001 peut être attribuée à une orientation discrétionnaire donnée à la politique financière publique allemande, les décisions ultérieures prises en Allemagne reflètent une politique structurelle de réduction du déficit public.
Cette politique rencontre d'importantes difficultés, sous l'angle de ses effets économiques et de ses résultats financiers.
S' agissant de l'impact économique de la politique allemande de réduction du déficit, il y a lieu de souligner que la diminution de la composante structurelle du besoin de financement public allemand entre 2002 et 2003 (0,3 point de PIB) est intervenue à contre temps. En effet, la situation conjoncturelle se dégradait alors nettement en zone euro et tout particulièrement en Allemagne où le PIB s'est même légèrement replié (-0,1 point) par rapport à l'année précédente. Ainsi, au lieu de jouer un rôle contra-cyclique , la politique budgétaire allemande , du moins dans sa dimension discrétionnaire, a exercé un effet restrictif qui n'était alors pas souhaitable.
Cela n'a pas empêché le solde public de se détériorer passant de 3,6 à 3,8 points de PIB sous l'effet de la dégradation de la conjoncture.
Cet enchaînement traduit la principale difficulté que rencontre la politique des finances publiques en Allemagne . Vouée à un redressement structurel, de l'ordre de 0,4 à 0,5 point de PIB chaque année 14 ( * ) , elle se déploie dans un contexte économique plus que morose, qu'elle contribue à aggraver alors que le succès d'une telle politique est conditionné à un contexte de croissance économique favorable.
Une deuxième difficulté mérite d'être signalée . L' Allemagne a fait le choix d'une politique fiscale de réduction assez rapide des prélèvements obligatoires.
ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES EN
ALLEMAGNE
DE 2003 À 2006
(en points de PIB)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
Solde public |
-3,8 |
-3,7 |
-3,3 |
-2,8 |
|
Recettes totales |
45,0 |
43,8 |
43,6 |
43,4 |
|
dont : - Impôts |
22,6 |
22,1 |
22,0 |
22,1 |
|
- Cotisations sociales |
18,6 |
18,2 |
18,0 |
17,8 |
|
Dépenses |
48,8 |
47,5 |
47,0 |
46,2 |
|
dont : - Transferts sociaux |
31,1 |
30,4 |
30,2 |
29,7 |
|
- FBCF |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
40,7 |
39,9 |
39,6 |
39,5 |
|
Croissance du PIB |
-0,1 |
1,6 |
0,8 |
1,6 |
Source : Services de la Commission européenne (Public Finances in EMV 2005)
Le taux de prélèvements obligatoires s'élevait en 2000 à 43 %. Il n'était plus en 2003 que de 40,7 % et a décliné en 2004 pour atteindre 39,9 %. En quatre ans, les prélèvements obligatoires ont été réduits de 3,1 points de PIB (-0,8 point par an en moyenne). Pour limiter la dégradation du solde public, un retour à la croissance et une stricte maîtrise des dépenses auraient été nécessaires.
Jusqu'à présent, la politique entreprise en ce dernier domaine n'a pas permis de compenser entièrement l'effet de la réduction des prélèvements obligatoires sur la position budgétaire allemande.
Quant à la croissance, elle est en dessous du potentiel de la croissance de l'économie allemande et de ses performances sur longue période. Il apparaît notamment que sur la période 2001-2006 le taux d'épargne des agents privés a augmenté de 2 points de PIB (soit 21,5 points en moyenne contre 18,9 points en 2000).
La baisse du taux de prélèvements obligatoires devrait être poursuivie sur un rythme ralenti 15 ( * ) . En 2006, le taux de prélèvements obligatoires serait inférieur de 0,4 point par rapport à 2004. Cette orientation combinée avec les objectifs de déficit public suppose une nette réduction du poids des dépenses publiques dans le PIB (de 1,3 point en deux ans). Même en maintenant inchangé l'effort d'investissement public, ce qui n'est pas a priori conforme aux engagements pris dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, l'inflexion des autres dépenses publiques devra être très nette, en particulier dans le domaine social. Ces conditions apparaissent comme la contrepartie des allègements fiscaux acquis depuis 2000 mais aussi comme nécessaires aux objectifs de réduction structurelle du déficit public.
II. UN RETOUR AU RYTHME DE CROISSANCE POTENTIELLE EN 2006
La croissance potentielle correspond au rythme de progression du PIB avec un plein emploi des facteurs de production, sans tensions inflationnistes, augmenté des gains de productivité du travail.
Un « déficit de croissance », dit « output gap négatif », se creuse lorsque la croissance est inférieure à son potentiel. Il tend à se résorber sur l'ensemble d'un cycle économique, ce qui signifie que la croissance annuelle peut être temporairement supérieure à son potentiel venant ainsi combler le déficit de croissance passé sans tensions inflationnistes.
Actuellement, l'« output gap négatif » est évalué pour la France à 2 % du PIB environ, ce qui autorise pour les prochaines années, et dans des conditions d'environnement extérieur « normales », une croissance supérieure à la croissance potentielle (donc supérieure à 2 %).
C' est à ce scénario que correspond la prévision du gouvernement pour 2006 .
Le Gouvernement a retenu une prévision de croissance pour 2006 comprise entre 2 et 2,5 % (+ 2,25 % précisément, si l'on additionne les contributions à la croissance prévues par le Gouvernement).
Cette prévision est supérieure à celle de la plupart des instituts indépendants, dont la moyenne est de 1,8 %. Seul l'OFCE présente une prévision de croissance du PIB identique à celle du Gouvernement (+ 2,2 %), qui sert de base aux projections à moyen terme exposées dans le présent rapport.
La prévision du MINEFI (comme celle de l'OFCE) s'appuie sur plusieurs facteurs conjoncturels favorables.
A. UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL PLUS PORTEUR
Les éléments d'environnement extérieurs qui ont pesé sur la croissance en 2005 (hausse de l'euro, hausse des prix du pétrole, « désinflation compétitive allemande ») s'estomperaient globalement en 2006. Au total, les contraintes extérieures se desserreraient, permettant à notre commerce extérieur de contribuer moins négativement à la croissance (-0,2 point de PIB en 2006 contre -0,8 point en 2005) :
en particulier, le redressement à l'oeuvre des comptes extérieurs américains, et la poursuite d'une activité dynamique aux États-Unis permettent d'espérer, au minimum, une stabilisation de la parité euro/dollar ;
malgré la hausse du pétrole, la croissance mondiale demeurerait solide ;
la hausse des profits des entreprises aux États-Unis ou en Allemagne, associée à des conditions de financement favorables, serait propice à un redémarrage de l'investissement.
B. UNE REPRISE EN FRANCE
1. Une demande intérieure solide
Les gains de productivité constatés depuis deux ans, devraient également rejaillir sur l' investissement des entreprises .
En 2006, les exportations françaises profiteraient du redressement de la demande mondiale adressée à la France (+ 6 % en 2006 contre + 4 % en 2005), en raison notamment d'un mouvement de reprise en zone euro. Les exportations progresseraient ainsi de 5 % (contre + 2,5 % en 2005), soit la plus forte progression depuis 2000.
Néanmoins, les importations resteraient dynamiques en lien avec la robustesse de la demande intérieure. Il en résulterait une nouvelle dégradation du solde des transactions courantes, qui passerait de -1,6 % du PIB en 2005 à -1,9 % en 2006. Cette dégradation est beaucoup moins marquée cependant qu'entre 2004 et 2005 (de -0,4 % du PIB en 2004 à -1,6 % en 2005) et devrait beaucoup plus à l'inertie des évolutions antérieures qu'à une mauvaise performance à l'exportation.
La contribution des échanges extérieurs à
la croissance resterait négative, bien que dans des proportions moindres
qu'en 2005 et 2004
(-0,2 point de croissance en 2006 contre -0,8 point
en 2005 et -0,9 point en 2004).
Les enquêtes de conjoncture paraissent favorablement orientées, notamment en matière de consommation des ménages.
La demande des ménages resterait bien orientée sous l'effet d'une flexion supplémentaire de leur taux d'épargne.
La montée en puissance du Plan de cohésion sociale et les nouvelles mesures pour l'emploi seraient de nature à enclencher une amélioration du marché du travail et, par conséquent, un redressement de la confiance des ménages qui se traduiraient par une nouvelle baisse du taux d'épargne (de 15,2 % du revenu à 14,9 %).
La prévision de croissance pour la France la situe ainsi aux environs de son potentiel. Mais elle ne permet pas d'entamer un mouvement de résorption du déficit de croissance passé. Dans ces conditions, elle ne peut être qualifiée de « volontariste ».
En regard de ces éléments, la prudence plus grande encore des instituts indépendants peut s'expliquer par des éléments qui relèvent de l'analyse conjoncturelle pure. La prévision pour 2006 est en fait liée à l'idée que chacun peut se faire de la fin de l'année 2005. En effet, plus l'activité sera dynamique aux troisième et quatrième trimestres 2005, plus l'« acquis de croissance » 16 ( * ) pour 2006 sera important, et inversement (cf. encadré ci-après).
|
IMPACT DE LA CONJONCTURE EN FIN D'ANNÉE
2005
Selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE, la croissance devait être de 0,4 et 0,3 %, respectivement aux troisième et quatrième trimestres. Cela laisserait l'acquis de croissance pour 2006 à 0,4 %. Sur cette base, pour atteindre une croissance de 2,2 % en moyenne17 ( * ) |
en 2006, il faudrait une croissance en glissement18 ( * ) de l'ordre de 3 % (soit 0,7 % à 0,8 % par trimestre) et donc une accélération de l'activité sur un rythme qui, malgré l'orientation favorable des dernières enquêtes de conjoncture, paraît relativement élevé.
Pour l'OFCE, à l'inverse, la fin d'année serait plus favorable : + 0,7 % et + 0,6 % pour la croissance respectivement aux 3e et 4e trimestres, ce qui laisserait l'acquis de croissance pour 2006 à 0,8 %. Dès lors, il « suffirait » que le PIB augmente de 0,6 % par trimestre en 2006 pour que la croissance atteigne 2,2 %.
Les instituts qui présentent une prévision de croissance en 2006 plus basse que celle du MINEFI ou de l'OFCE ont ainsi une vision moins optimiste de la conjoncture aux 3e et 4e trimestres 2005.
Entre-temps, la croissance du 3e trimestre 2005 a été publiée. Elle s'est élevé à + 0,7 % ce qui témoigne en soi d'une accélération du rythme de croissance, dont la persistance reste toutefois à vérifier, et minore les exigences de progression de l'activité pour atteindre en 2006 une croissance de 2,2 %.
On sait que, généralement, les épisodes de reprise se révèlent, avec le recul, plus sensibles que ce qui était perçu sur le moment.
C'est, d'une certaine manière, le pari sous-jacent à la prévision du MINEFI et à celle de l'OFCE.
2. La probable décrue du chômage
Le Gouvernement présente, comme les années précédentes, une prévision d'évolution de l'emploi mais non du chômage.
Après une stagnation en 2004 , l' emploi total progresserait de 0,5 % en 2005 et 1 % en 2006 (soit respectivement + 120. 000 et + 250.000 emplois environ).
Cette évolution favorable s'expliquerait pour partie par la montée en charge du Plan de cohésion sociale et de ses deux dispositifs en faveur de l'emploi dans le secteur non marchand : le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir.
Après avoir stagné en 2003 et 2004, l' emploi salarié dans le secteur non marchand augmenterait de 60.000 en 2005 et 120.000 en 2006 , concourant pour moitié à l'augmentation de l'emploi total .
Dans le secteur marchand, le MINEFI estime pour 2006 à 30.000 les créations nettes d'emploi imputables au contrat nouvelle embauche.
Les prévisions d'évolution en matière d'emploi des instituts indépendants sont plus basses, ce qui est en ligne avec des prévisions de croissance également plus basses. Néanmoins, certains prévisionnistes semblent considérer que le scénario de « croissance sans emploi » observé en 2004 19 ( * ) pourrait se poursuivre en 2005 et 2006, lorsque le MINEFI considère au contraire que le contenu en emplois de la croissance (soit, en creux, l'évolution de la productivité du travail) reviendrait sur sa tendance de long terme.
Concernant le chômage , il est utile de se reporter à la prévision de l'OFCE (dont la prévision de croissance est par ailleurs très proche de celle du MINEFI). De fin d'année à fin d'année, le taux de chômage baisserait de 0,2 point en 2005 et 0,6 point en 2006 (soit un taux de chômage à 9,8 % fin 2005 et 9,2 % fin 2006).
On peut, en particulier, observer dans le tableau ci-dessous :
- que l' impact de la loi portant réforme des retraites sur les retraits d'activité et, donc sur le taux de chômage, est significatif en 2005 comme en 2006 (le dispositif concourt à une baisse de 0,15 point du taux de chômage en 2005 et en 2006 ) ;
- que la politique de l'emploi et sa réorientation en faveur du secteur non marchand concourraient à une baisse de 0,2 point du taux de chômage en 2006 ; en 2005, l'effet de la politique de l'emploi sur le taux de chômage serait nul, la montée en puissance du Plan de cohésion sociale étant compensée par la réduction des effectifs en contrats emploi-solidarité ou emplois consolidés.
ÉVOLUTION DU CHÔMAGE
(en points de taux de chômage)
|
2005 |
2006 |
|
|
Évolution du chômage
|
-0,2 |
-0,6 |
|
dont : |
||
|
1. Effets de la politique de l'emploi
|
0 |
-0,2 |
|
2. Effets de retraits d'activité
|
-0,15 |
-0,15 |
|
3. Impact de la croissance |
-0,05 |
-0,25 |
Source : OFCE
Si la décrue du chômage ainsi décrite se confirmait, elle pourrait avoir un impact sur la confiance des ménages, entraîner une nouvelle baisse du taux d'épargne et un sursaut de la consommation, ces deux dernières évolutions constituant un aspect déterminant de la prévision du MINEFI.
C. DES DIVERGENCES SIGNIFICATIVES SUR L'ÉVOLUTION DU DÉFICIT PUBLIC
Le déficit des administrations publiques passerait de 3,6 % du PIB en 2004 à 3,0 % en 2005 selon le Gouvernement, soit une réduction importante du besoin de financement public de 0,6 point de PIB.
Cette amélioration s'explique d'abord par le versement d' une soulte par les industries électriques et gazières aux organismes sociaux au titre de l'adossement du régime de retraite de leurs agents aux régimes général et complémentaire des salariés du secteur privé (8,4 milliards d'euros, soit 0,45 % du PIB ). Par définition, une telle recette n'est pas reconductible, si bien que le niveau de l'effort structurel à entreprendre pour en conserver l'impact sur le solde public au cours des années suivantes reste le même. Autrement dit, en 2006, sans effort nouveau, le déficit public serait supérieur de 0,45 point de PIB.
Des mesures nouvelles et discrétionnaires sur les prélèvements obligatoires (hausse de la fiscalité locale et de la CSG notamment) interviennent également pour 0,2 % du PIB .
Une première divergence apparaît pour l'année 2005 entre le MINEFI et les instituts indépendants, pour lesquels le déficit public s'établirait en moyenne à 3,3 % du PIB.
Cette différence s'expliquerait par le dynamisme des prélèvements obligatoires en 2005 (recettes de TVA, impôts liés à l'immobilier et à la détention d'actifs), l'élasticité des recettes à la croissance étant ainsi légèrement supérieure à l'unité 20 ( * ) .
Il en résulterait une augmentation du taux des prélèvements obligatoires qui passerait de 43,4 % du PIB en 2004 à 43,9 % en 2005.
Le déficit public en 2005 est supérieur au solde qui permettrait une stabilisation de la dette (évalué à 1,9 % du PIB). La dette passerait ainsi de 64,7 % du PIB en 2004 à 65,8 % en 2005.
En 2006, le déficit public se réduirait encore à 2,9 % du PIB selon le Gouvernement. La baisse du déficit avec -0,1 % du PIB par rapport à 2005 peut paraître modeste. Mais elle s'élève à -0,55 % hors soulte EDF, chiffre qui situe mieux l'ampleur de l'effort de redressement.
Cette diminution s'expliquerait, selon le MINEFI, par l'inscription au compte des administrations de sécurité sociale d'une « provision pour soulte » de 2 milliards d'euros, soit 0,1 % du PIB (soulte versée pour l'essentiel par la Poste) et par la poursuite du dynamisme des impôts liés à l'immobilier ou à la détention d'actifs. Mais, l'essentiel de l'ajustement serait assuré par les mesures de « redressement » contenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2006 (déremboursements, nouveaux prélèvements sur les ménages à hauteur de 1,9 milliard d'euros et sur les entreprises à hauteur de 1 milliard). Cet effort paraît d'emblée important.
On peut en effet observer que l'objectif d'augmentation des dépenses maladie (ONDAM) retenu pour 2006, qui baisse de plus d'un point par rapport à 2005 (de +3,8 % à +2,5 %) - alors que la CNAM vient d'annoncer une augmentation des dépenses de remboursement du régime général d'assurance maladie, de 4,3 % sur les neuf premiers mois de 2005 - parait ambitieux.
Enfin, dans la prévision du Gouvernement, la dette publique atteint 66 % du PIB en 2006.
Pour la moyenne des instituts indépendants, le déficit public s'établirait à 3,3 % du PIB, soit à 0,4 point de PIB en plus que dans la prévision du Gouvernement pour 2006.
Le besoin de financement public resterait donc inchangé pour les instituts indépendants, ce qui n'en suppose pas moins une réduction du déficit structurel identique à celle de la prévision du Gouvernement.
En effet, contrairement à la prévision du Gouvernement, les « indépendants » estiment que la composante conjoncturelle du solde public se détériorerait de 0,1 point de PIB. En effet, dans leurs prévisions pour 2006, la croissance est de 1,8 % contre une croissance potentielle de 2 % et cet écart de perspective entraîne une légère dégradation du solde. Ainsi le maintien du déficit public au niveau de 2005 (3,3 % selon les « indépendants ») est conditionné à une réduction de la composante structurelle du déficit public visant à « effacer » la dégradation conjoncturelle des comptes publics (pour 0,1 point de PIB) et à compenser la disparition de l'effet-soulte (pour 0,45 point de PIB), qui atteindrait 0,55 point de PIB comme pour le Gouvernement.
En toute hypothèse, avec une impulsion budgétaire du même ordre, la prévision du Gouvernement et celle des instituts indépendants supposent une nette reprise de la croissance sous-jacente en 2006 dont seul le niveau diffère.
La prévision du Gouvernement suppose des comportements spontanés plaçant la croissance sur une trajectoire de l'ordre de 2,8 % ; pour les « indépendants » la croissance sous-jacente à leurs prévisions est d'environ 2,4 %.
III. LE PRINCIPAL ALÉA : PRIX DU PÉTROLE ET INFLATION
L'aléa évoqué ici porte moins sur une nouvelle hausse en 2006 du prix du pétrole que sur l'impact inflationniste de la hausse passée.
La prévision du prix du pétrole est aujourd'hui particulièrement incertaine. Certes, la majorité des économistes considèrent que le marché devrait rester tendu en 2006 du fait de la faiblesse des capacités disponibles. Mais, le manque de transparence et l'imprécision des données fondamentales sur le marché du pétrole (demande, production, stocks, capacités...) nuisent à sa visibilité et renforcent la volatilité des cours.
De faibles variations de l'offre ou de la demande pourraient entraîner des réactions de forte ampleur, ce qui rend incertaine toute prévision en la matière. Le Gouvernement et l'OFCE retiennent donc une hypothèse conventionnelle : celle d'une stabilité des prix au niveau moyen constaté en milieu d'année 2005 (60 dollars le baril). On peut simplement rappeler une estimation macroéconomique : si le prix du baril se maintenait à 70 dollars en 2006, la croissance s'en trouverait amputée de 0,2 point.
Moins incertaine est l'analyse de l'impact inflationniste à court terme de la hausse passée du prix du pétrole, équivalente dans son ampleur à celle du premier choc pétrolier.
Jusqu'à présent, la hausse du prix du pétrole n'a pas entraîné de nette accélération de l'inflation. L'indice des prix à la consommation a augmenté du fait de sa composante énergie mais de façon mesurée (+1,8 % en 2005 selon le MINEFI). Au-delà de ces effets mécaniques, dits de « premier tour », la hausse des prix du pétrole ne s'est pas traduite comme lors des deux premiers chocs pétroliers par l'enclenchement d'une boucle prix-salaires. Au contraire, le contexte parait actuellement désinflationniste : l'inflation sous-jacente (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires) s'inscrit actuellement à peine à plus de 1 % pour la zone euro, et moins de 2 % aux États-Unis où les craintes inflationnistes sont les plus vives.
Pour la zone euro, comme l'activité évolue en dessous de son potentiel, le contexte est nettement désinflationniste. Pour les États-Unis, et l'économie mondiale en général, l'accentuation de la concurrence, les gains de productivité et la modération salariale, la santé financière des entreprises ou le pincement des marges constituent, pour l'instant, une force de rappel face aux tensions inflationnistes.
Le MINEFI prévoit ainsi une stabilisation de l'inflation en France en 2006 à son rythme de 2005 (+ 1,8 %) rejoint sur ce point par la plupart des instituts.
Cependant l'hypothèse que la capacité de
résistance des ménages au renchérissement de
l'énergie s'éroderait, les conduisant à un renforcement
des revendications salariales et à l'enclenchement d'une spirale
prix-salaires
- effets dits de « second tour » -
ainsi que celle d'une réaction de la Banque Centrale Européenne
à la poussée inflationniste doivent être
envisagées.
On peut ainsi donner quelques conclusions d'une simulation conduite sur ce point par l'OFCE :
- l'apparition d'un effet de second tour inflationniste en France amputerait la croissance du PIB français de 0,6 point en 2006, le ramenant à uniquement 1,6 % (du fait de la dégradation de la compétitivité) ;
- l'apparition d'un second tour inflationniste dans l'ensemble des pays amputerait la croissance du PIB français de 0,4 point, la ramenant à 1,8 % (le choc est moins fort que précédemment car la France ne perd pas en compétitivité si le choc inflationniste est généralisé ; néanmoins la croissance mondiale s'en trouve ralentie) ;
- en cas de réaction de la Banque Centrale Européenne (hausse des taux), la croissance du PIB français serait ramenée à 1,6 % en 2006 (contre 2,25 % dans la prévision du Gouvernement).
PRÉVISIONS À
COURT TERME
2005-2006
|
Gouvernement |
Moyenne des Instituts |
||||
|
I - PRINCIPALES HYPOTHÈSES D'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
|
• TAUX DE CROISSANCE DES
|
|||||
|
- États-Unis |
3,4 |
3,1 |
3,1 |
2,8 |
|
|
- Zone euro |
1,4 |
1,9 |
1,3 |
1,6 |
|
|
dont Allemagne |
1,0 |
1,8 |
1,0 |
1,5 |
|
|
• TAUX DE CHANGE EURO/DOLLAR |
1,26 |
1,23 |
1,25 |
1,23 |
|
|
• PRIX DU PÉTROLE ($/baril) |
55,2 |
60,0 |
58,3 |
57,2 |
|
|
II - PRINCIPAUX RÉSULTATS DES PRÉVISIONS |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
|
POURCENTAGES ANNUELS
|
|||||
|
• P.I.B. ( volume ) |
1,5 / 2,0 |
2,0 / 2,5 |
1,5 |
1,8 |
|
|
• Importations ( volume ) |
5,5 |
5,6 |
5,3 |
4,5 |
|
|
• Consommations des ménages (volume ) |
2,0 |
2,3 |
2,0 |
2,0 |
|
|
• Investissements des entreprises (volume ) |
3,4 |
4,3 |
2,9 |
3,4 |
|
|
• Exportations (volume) |
2,5 |
5,0 |
2,3 |
4,3 |
|
|
• Contributions des stocks (en % du P.I.B.) |
+ 0,5 |
+ 0,1 |
+ 0,4 |
- 0,1 |
|
|
•
Prix à la
consommation
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
|
• Pouvoir d'achat du revenu disponible |
|||||
|
des ménages |
1,7 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
|
|
• Taux d'épargne des ménages |
15,2 |
14,9 |
15,4 |
15,2 |
|
|
•
Emplois salariés
|
0,4 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
|
|
• Emploi total (moyenne annuelle en %) |
0,5 |
1,0 |
0,2 |
0,5 |
|
|
• Taux de chômage (3) : en % |
nd |
nd |
nd |
nd |
|
|
CAPACITÉ DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS ( en % du P.I.B.) |
- 3,0 |
- 2,9 |
- 3,1 |
- 3,3 |
|
|
CAPACITÉ DE FINANCEMENT
|
- 1,6 |
- 1,9 |
Nd |
nd |
|
CHAPITRE II - LES VOIES ÉTROITES D'UNE CROISSANCE AUTONOME SOUTENUE
Les différentes projections de l'économie française proposées dans le présent rapport ont pour objectif de présenter différents scénarios de croissance (cinq au total) , qui, pour l'essentiel, permettraient, dans le contexte d'une politique budgétaire d'ajustement structurel , de rapprocher le rythme effectif d'activité de son niveau potentiel, voire, dans l'un d'entre eux de le dépasser.
A l'examen, ces conditions apparaissent exigeantes : l'environ-nement international de la France doit évoluer favorablement pour ne pas perturber la croissance intérieure ; en outre, celle-ci est dépendante de comportements des agents économiques nationaux nettement plus dynamiques que ceux observés en moyenne, même lorsqu'on imagine une contribution plus positive du commerce extérieur.
Ces modifications de comportements ne sont pas improbables, mais elles requièrent un contexte favorable et la politique économique doit les accompagner. Plus globalement, les autorités qui en ont la charge doivent tout entreprendre pour conforter la confiance des Français dans leur avenir.
Toutefois, les résultats des projections conduisent à s'interroger sur l'ordre des priorités des politiques économiques . Le contexte qui prévaut aujourd'hui est celui d'une économie française en retard sur le plan de sa croissance potentielle.
Un déficit de production de l'ordre de 2,5 points de PIB s'est accumulé. La croissance que décrivent le programme de stabilité du Gouvernement (dans son scénario qualifié de « bas ») et les projections, ne permettrait pas de combler ce retard alors que les conditions d'une croissance à 2,25 % l'an apparaissent difficiles à réunir quand on programme une réduction du déficit structurel de 0,4 point en moyenne chaque année.
Or, le premier défi à relever est celui d'un retour au niveau potentiel de production afin d'éliminer le chômage résultant du déficit passé de croissance. En effet, il faut retrouver les marges de manoeuvre qu'offre la croissance . Celle-ci permettrait d'accroître plus facilement le rythme de la croissance potentielle, objectif justifié par les perspectives démographiques mais dont le terme ne peut être immédiat, et de procéder à l'assainissement structurel des comptes publics, dans des conditions plus favorables.L' économie est cyclique et évolutive, et le calendrier des politiques économiques doit tenir compte de ces deux caractéristiques fondamentales . Pour remédier aux insuffisances structurelles de l'économie française, il faut d'abord retrouver un rythme de croissance plus élevé.
|
Cinq scénarios ont été élaborés sous les principales hypothèses suivantes : * le taux de croissance de la productivité du travail serait de 1,7 % entre 2007 et 2010, les salaires réels évoluant comme celle-ci, * les hypothèses de population active sont celles de la DARES (qui intègrent les effets de retraites anticipées), * les hypothèses d'emplois non marchands aidés sont celles de la DARES (baisse progressive de 100 000 entre début 2004 et fin 2008). On suppose qu'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ne sera pas remplacé, * les hypothèses de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires sont celles du programme de stabilité, * une réduction du déficit structurel de l'ordre de 0,4 point de PIB en moyenne, * l'hypothèse d'un taux de chômage structurel se situant aux alentours de 6 %, * sauf exception, une contribution du commerce à la croissance extérieure nulle. Dans le scénario 1 , les entreprises « font » la croissance. L'objectif de croissance de 2,25 % par an est atteint quasi exclusivement grâce à un comportement très dynamique des entreprises. En effet, le taux d'épargne des ménages se situe en moyenne sur la période 2007-2010 à 14,7 % de leur revenu disponible brut (RdB), soit son niveau atteint en 2006. L'objectif de croissance nécessite une forte augmentation du taux d'investissement des entreprises. Ce dernier doit augmenter de 0,8 point en moyenne annuelle, atteignant 21,4 % de la valeur ajoutée en 2010, niveau jamais atteint auparavant. Dans le scénario 2 , ce sont les ménages qui créent la croissance. L'objectif de croissance de 2,25 % par an est atteint quasi exclusivement grâce à un comportement très expansionniste des ménages alors que les entreprises restent neutres. Le taux d'épargne doit baisser considérablement au cours de la période 2007-2010. En cumulé sur quatre années, cette baisse doit être de 2,4 points, soit une baisse moyenne de 0,6 chaque année. Le taux d'épargne baisserait considérablement, pour atteindre 12,3 % du revenu disponible brut des ménages. Dans le scénario 3 , l'hypothèse de neutralité du commerce extérieur à moyen terme, standard dans ce type d'exercice, est abandonnée. En stabilisant le taux d'épargne des ménages et le taux d'investissement des entreprises, et compte tenu des hypothèses inchangées sur les finances publiques, la contribution positive du commerce extérieur (0,4 point en moyenne annuelle) ne permet cependant pas d'atteindre l'objectif de 2,25 % chaque année. La croissance serait de 1,9 %. De la même manière, le déficit public atteindrait, en 2010, 1,7 point de PIB contre 0,9 dans les scénarios 1 et 2. Le scénario 4 part du scénario précédent et consiste à évaluer le comportement des agents privés permettant de combler l'écart de croissance. D'après ce scénario, il serait alors possible de retrouver la croissance, le déficit et le taux de chômage des scénarios 1 et 2, avec un taux d'épargne qui s'établirait en moyenne à 14,9 % du RdB, soit 0,6 point en dessous de la moyenne des 20 dernières années. Le taux d'investissement des entreprises devrait, quant à lui, s'établir aux alentours de 18,6 % en moyenne sur la période 2007-2010, soit 1,4 point au-dessus de son niveau de long terme.
Enfin,
le scénario 5
est celui d'une
croissance à 3 %. Le chômage d'équilibre se situe aux
alentours de 5 %. Pour atteindre ce niveau en 2010, l'économie
française devrait croître à un rythme moyen de 3 % au
cours de la période 2007-2010. Cet objectif peut être atteint sous
les hypothèses de modifications des comportements des agents
privés des scénarios 1 et 2 et d'une contribution moins
restrictive des dépenses publiques, à objectif de solde public
inchangé.
|
I. UN CONTEXTE DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE D'AJUSTEMENT STRUCTUREL QUI FREINE LA CROISSANCE
Les projections sont construites sous l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une politique budgétaire d'assainissement structurel . Ce processus, conforme aux annonces du Gouvernement, représente, à l'horizon de la projection, un frein à la croissance , même s'il contribue aussi à installer les finances publiques sur une trajectoire prudente.
A. LE REDRESSEMENT STRUCTUREL DES COMPTES PUBLICS IMPLIQUE UNE CROISSANCE SPONTANÉE SUPÉRIEURE À LA CROISSANCE POTENTIELLE
Les scénarios de croissance présentés ici sont construits sous l' hypothèse qu'une politique budgétaire d'ajustement structurel serait mise en oeuvre , conformément aux engagements pris par la France dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance européen.
Pour l'essentiel, il s'agit de contenir la croissance en volume des dépenses publiques à 0,9 % par an, soit un rythme d'évolution sensiblement inférieur à celui de la croissance potentielle estimé à 2 % et à la croissance en projection, qui est de 2,25 % 21 ( * ) .
Ce différentiel de croissance entraînerait en soi une réduction du besoin de financement des administrations publiques à hauteur de 2,1 points de PIB, entre 2006 et 2009. Toutefois, la baisse discrétionnaire des prélèvements obligatoires atteindrait 0,6 point de PIB sur la période si bien que le retour à une tendance de « réépargne publique » et la réduction du déficit structurel sont plus modérés . Au total, le déficit structurel est réduit de l'ordre de 0,4 point de PIB par an et le solde budgétaire nominal s'améliorerait de 1,5 point de PIB. En revanche, la fonction distributive des administrations publiques serait très nettement réduite.
Une première conséquence directe s'ensuit. Le bilan des relations financières entre les administrations publiques et les autres agents économiques, en particulier les ménages, devient moins favorable à ces derniers.
La politique de redressement structurel des finances publiques exerce donc, au premier ordre, une contrainte sur l'activité économique. Cette impulsion budgétaire négative s'élève à environ 0,4 point de PIB en moyenne annuelle sur la période. Elle est le revers de la médaille du redressement structurel des comptes publics . S'y ajoute le jeu des stabilisateurs automatiques, la croissance projetée excédant la croissance potentielle de 0,25 point de PIB par an, une composante conjoncturelle de redressement du solde public nominal intervient, à hauteur d'environ 0,3 point de PIB sur la période.
La croissance sous-jacente, cohérente avec les performances retracées dans le « scénario central » à 2,25 % est ainsi de l'ordre de 2,8 %, soit un rythme supérieur à celui de la croissance potentielle telle qu'elle est estimée généralement.
Ces performances sont conditionnées à des enchaînements favorables dont le présent rapport rend compte dans sa partie consacrée aux finances publiques.
B. UNE POLITIQUE BUDGETAIRE PLUS NEUTRE ASSOUPLIRAIT LES CONDITIONS D'UN RETOUR À UNE CROISSANCE DYNAMIQUE...
Afin d'évaluer les conséquences d'une autre politique budgétaire, on peut indiquer les résultats associés à une évolution des comptes publics au fil de l'eau, sans ajustement structurel. Dans cette hypothèse, l'impulsion budgétaire, de négative devient neutre et seuls jouent les stabilisateurs automatiques.
HYPOTHÈSE D'UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE NEUTRE À PARTIR DE 2007
(en volume, en %)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Croissance du PIB |
1,7 |
2,0 |
2,4 |
2,8 |
3,0 |
3,1 |
|
Dépenses des administrations publiques |
1,7 |
1,6 |
1,4 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Variation du taux de PO (en pts de PIB) |
0,5 |
0,1 |
-0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde public (en pts de PIB) |
-3,0 |
-2,9 |
-2,9 |
-2,6 |
-2,2 |
-1,8 |
|
Variation du solde structurel |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Variation solde conjoncturel |
-0,2 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
* calculé hors effet des charges
d'intérêts
Source
: calculs OFCE
Le taux de prélèvement obligatoire est stable à partir de 2008 et les dépenses publiques évoluent au même rythme que la croissance potentielle. Le déficit structurel est donc constant sur la période 2008-2010.
1. La neutralité de la politique budgétaire favorise la croissance
Un surplus de croissance intervient . Il est engendré par un niveau plus élevé de la dépense publique qui enclenche un phénomène multiplicateur de type keynésien.
Le rythme de la croissance serait plus élevé et le niveau du PIB est supérieur (de 2,5 points) en fin de période à ce qu'il est dans le compte central .
PRINCIPAUX RÉSULTATS D'UNE VARIANTE
OÙ
LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE EST NEUTRE À PARTIR DE 2007
(en % cumulés, par rapport au compte central)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB |
0,1 |
0,8 |
1,6 |
2,5 |
|
Importations |
0,1 |
0,6 |
1,3 |
2,1 |
|
Consommation des ménages |
0 |
0,2 |
0,7 |
1,4 |
|
Consommation des APU |
0,4 |
2,5 |
5,0 |
7,5 |
|
FBCF productive |
0,2 |
1,2 |
2,1 |
2,7 |
|
FBCF logement |
-0,1 |
-0,5 |
-1,3 |
-1,7 |
|
Exportations |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
|
Variations de stocks (en contribution) |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Taux de chômage |
0 |
-0,2 |
-0,6 |
-1,0 |
|
Taux d'épargne |
0 |
0 |
-0,2 |
-0,3 |
En moyenne annuelle, la croissance est supérieure (de 0,65 point) sous l'effet d'une demande intérieure plus dynamique légèrement compensée par un accroissement du déficit extérieur.
La consommation des ménages progresse à un rythme plus élevé, de l'ordre de 0,4 point par an. Les gains de pouvoir d'achat des ménages sont plus importants suite au double effet d'une plus nette amélioration de la situation de l'emploi et d'un bilan moins défavorable de leurs relations avec les administrations publiques.
Le taux d'épargne des ménages se réduit encore ce qui soutient la consommation 22 ( * ) .
Les entreprises réagissent positivement à la demande soutenue qui leur est adressée. Leur effort d'investissement est plus important de l'ordre de 0,7 point par an. La valeur ajoutée des entreprises s'accroît plus vite, ce qui leur permet, dans un contexte de modération salariale à peu près maintenue, d'accroître leur taux de marge. Le taux d'autofinancement se replie, comme dans le compte central, mais sensiblement moins.
Le rythme accéléré de croissance provoque un écart d'activité économique avec le reste du Monde , qui, par hypothèse, connaît un développement identique à celui du scénario central. En outre, les prix du PIB sont plus dynamiques. Il s'ensuit un creusement du déficit extérieur, qui conduit à mettre en évidence une contribution négative des échanges internationaux sur la croissance 23 ( * ) . Cependant, en projection, elle ne compense que partiellement le supplément d'activité lié à la demande intérieure.
La croissance plus élevée entraîne une plus nette réduction du taux de chômage. Celui-ci est inférieur de 1 point à l'horizon 2010 par rapport au compte central.
2. ... et n'empêche pas une réduction du solde public nominal
a) Le solde public nominal se redresserait
Le déficit public baisse malgré le desserrement de la politique budgétaire. Il passe en effet de 2,9 points de PIB en 2007 à 1,8 point de PIB en 2010.
Le redressement du solde public devrait être a priori inférieur de 1,6 point de PIB par rapport à ce qu'il est dans le scénario central à 2,25 % de croissance, compte tenu de l'absence d'effort de réduction structurelle du besoin de financement public. Toutefois, le besoin de financement n'est, en fait, aggravé que de 0,4 point de PIB.
b) ...mais au prix d'un report de l'assainissement structurel des comptes publics.
Si le solde public se dégrade moins qu'escompté, on le doit à l' impact de la croissance supplémentaire due au moindre effort de réduction du déficit budgétaire. La composante structurelle du solde ne connaît, quant à elle, par hypothèse, aucune amélioration.
L'impact favorable de la variante sur la croissance et sur le niveau du PIB limite les conséquences du creusement du besoin de financement sur le poids de la dette publique.
*
* *
Les résultats de cette variante permettent de mesurer les freins à la reprise conjoncturelle de l'activité associés à une politique d'assainissement structurelle des finances publiques . Il est possible que cet exercice souffre de quelques approximations : selon toute vraisemblance, toutes les économies sur les dépenses publiques n'ont pas le même impact économique de court terme. Mais, l' essentiel est de s'interroger sur l'opportunité d'une politique des finances publiques restrictive .
Il est évident que la France doit réduire son déficit structurel 24 ( * ) . Mais, la gestion du temps importe autant que cet objectif. Une politique budgétaire plus neutre permettrait de hâter le comblement de l'écart de croissance accumulé par l'économie française . Ce résultat , qui est tributaire d'une flexion des comportements des agents analogue à celle décrite ci-après 25 ( * ) , peut être atteint sans tensions particulières sur les capacités de production, ni sur les prix . Il est donc crédible et vient confirmer l'idée selon laquelle nulle considération économique (au sens strict du terme) n'impose d'adopter une politique budgétaire restrictive quand l'économie est en retard sur sa production potentielle.
II. LES HYPOTHÈQUES INTERNATIONALES : QUELLE RÉSORPTION DES ÉQUILIBRES MONÉTAIRES INTERNA-TIONAUX ET QUELS RISQUES D'INFLATION ?
L'hypothèque sur la croissance 2006 que représente la hausse du prix du pétrole illustre l'une des conditions fortes des scénarios de croissance à moyen terme exposés dans le présent rapport : le retour à un environnement international apaisé.
La validité de toute projection à moyen terme est suspendue à la vérification des hypothèses qu'elle comporte. Il est d'usage d'écarter de celles-ci la survenance de risques qui, pourtant, comme le montre la multiplication des chocs économiques survenus ces dernières années, ont une forte probabilité d'advenir.
Les déséquilibres économiques ne manquent pas dans le monde contemporain, qu'il s'agisse, par exemple, du déficit courant des États-Unis ou des tensions sur les prix des matières premières.
Les projections réalisées pour le présent rapport sont donc conditionnées à la non survenance d'une série d'aléas dont certains, toujours pendants, ont été exposés dans le rapport consacré l'an dernier par votre Délégation aux perspectives économiques à moyen terme.
DES SCÉNARIOS ILLUSTRATIFS DES RISQUES SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE
|
2005 |
2006 |
|
|
Scénario central |
1,7 % |
2,0 % |
|
Appréciation de l'euro (1 € = 1,4 $) |
1,7 % |
1,6 % |
|
Prix du pétrole à 70$ le baril |
1,7 % |
1,8 % |
|
Chute de 15 % du prix de l'immobilier |
1,7 % |
1,8 % |
|
Apparition d'un effet de « second tour » inflationniste |
||
|
. uniquement en France |
1,6 % |
1,4 % |
|
. dans l'ensemble des pays sans réaction de la BCE |
1,6 % |
1,6 % |
|
. dans l'ensemble des pays avec réaction de la BCE |
1,6 % |
1,4 % |
|
Retour à un prix du pétrole à 45$ le baril |
1,7 % |
2,3 % |
Source : Calculs OFCE
|
L'année dernière, votre Délégation avait voulu tester l'impact sur la croissance de la réunion d'un certain nombre d'événements défavorables, jugés comme des aléas négatifs dans le contexte de prévision économique qui prévalait alors où : - la croissance aux États-Unis ralentissait de 0,5 point de PIB en 2006 et 2007 à la suite d'une réorientation des politiques économiques ; - le niveau du prix du pétrole se situait durablement à 40 dollars ; - le cours du dollar se dépréciait de 20 % pour se situer en moyenne à 1,5 dollar pour un euro selon un profil temporel où, après une forte dépréciation, la devise américaine rejoignait en fin de période son cours initial. Si aujourd'hui, le retour du pétrole à un prix de 40 dollars par baril serait un facteur favorable par rapport aux hypothèses des projections présentées dans le rapport, les deux autres événements, qui demeurent réalistes moyennant un horizon un peu différent, produiraient des effets négatifs sur la croissance. |
PRINCIPAUX RÉSULTATS D'UN CUMUL D'ALÉAS EXTÉRIEURS
(en %)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Moyenne
|
|
|
Croissance du PIB |
2,5 |
1,3 |
1,4 |
1,8 |
3,5 |
1,8 |
|
Inflation |
1,7 |
1 |
0,7 |
1,3 |
1,9 |
1,2 |
|
Chômage
|
9,4 |
9,5 |
10,4 |
10,6 |
9,9 |
10 |
|
Besoin de financement
|
- 2,9 |
- 2,5 |
- 3 |
- 3,6 |
- 2,9 |
- 3 |
|
Contribution à la croissance
|
0 |
- 0,4 |
- 0,8 |
0 |
+ 0,6 |
- 0,1 |
|
Consommation des ménages |
2,4 |
2,5 |
1,8 |
1,6 |
2 |
2 |
|
Investissement des entreprises |
4,8 |
2,7 |
1,4 |
3,7 |
8,7 |
4,1 |
|
Si les conditions de la projection réalisée l'an
dernier, du fait des hypothèses posées sur le prix du
pétrole et sur le taux de change euro-dollar
26
(
*
)
, différaient de celles
qui sont retenues cette année, il est possible de se
référer aux résultats de la variante en substituant aux
valeurs absolues des chocs alors testés leur ordre de grandeur
relatif.
|
DÉCOMPOSITION DES EFFETS SUR LA CROISSANCE DES ALÉAS
(en points de PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Moyenne
|
|
|
Ralentissement aux États-Unis |
0 |
- 0,2 |
- 0,2 |
0 |
0 |
- 0,1 |
|
Pétrole à 40 $ |
0 |
- 0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dépréciation du cours du dollar
|
1,24 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
1,25 |
1,5 |
|
Effet sur la croissance |
0 |
- 0,8 |
- 2,3 |
- 1 |
1,7 |
- 0,6 |
|
Total |
0 |
- 1,1 |
- 2,5 |
- 1 |
+ 1,7 |
- 0,7 |
VARIANTE 10 % DOLLAR (EFFET PIB FRANCE)
|
Année |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Année/année |
- 0,5 |
- 0,9 |
0 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0 |
|
Cumul |
- 0,4 |
- 1,2 |
- 1,2 |
- 1 |
- 0,7 |
- 0,4 |
0 |
|
Étant rappelé que l'éventualité d'un pétrole à 40$ représentait alors un choc d'augmentation de 10 % du prix du pétrole, le tableau ci-dessus présente la décomposition des effets économiques des différents aléas envisagés l'an dernier :. les effets du ralentissement transitoire de l'économie américaine sont relativement modérés avec une perte de PIB de 0,2 point les deux premières années consécutive à une croissance inférieure de 0,5 point de PIB aux États-Unis ; l' appréciation du pétrole exerce un effet, modéré lui aussi, de 0,1 point de PIB en raison de la nette dépréciation du dollar contre euro qui vient le compenser et sous certaines conditions exposées ci-après ; la chute du dollar suivie, en fin de période, d'un contrechoc, entraîne une perte de croissance élevée : elle atteint 0,7 point de PIB en moyenne sur la période. |
Cette année, l'actualité du débat économique invite à se pencher sur l' éventualité d'une résurgence inflation niste, même si le risque de surv enance d' un tel processus apparaît faible après analyse .
Des tensions sur les prix des matières premières, des produits énergétiques en particulier, ont haussé le rythme d'augmentation des prix.
Cependant, jusqu'à présent, les « effets de second tour » qui ont pu se déclencher dans le passé à l'occasion des précédents chocs pétroliers ne se sont pas produits. Les salaires ne se sont pas ajustés à l'augmentation des prix.
Si un tel enchaînement devait intervenir, une résurgence de l'inflation ne manquerait pas de survenir. La boucle « prix-salaires » serait à l'oeuvre.
Il vaut donc d'explorer les conséquences d'une élévation du niveau de l'inflation, même si sa probabilité apparaît faible.
A. UNE RÉSURGENCE INFLATIONNISTE SERAIT DÉFAVORABLE
Depuis 2000, l'indice des prix à la consommation dans la zone euro a toujours excédé le haut de la cible d'inflation que la Banque centrale européenne (BCE) s'est fixée.
COÛTS SALARIAUX ET INFLATION
(Variation en pourcentage par rapport à la période précédente)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Prévisions |
||
|
2005 |
2006 |
||||||
|
Déflateur du PIB |
1,4 |
2,4 |
2,5 |
2,0 |
1,9 |
1,5 |
1,7 |
|
Indice des prix à la consom-mation harmonisé (IPCH) |
2,2 |
2,4 |
2,3 |
2,1 |
2,1 |
1,8 |
1,3 |
|
Rémunération par salarié 1 |
2,3 |
2,6 |
2,4 |
2,2 |
1,7 |
1,7 |
1,9 |
|
Productivité du travail 1 |
1,4 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
1,1 |
0,6 |
1,1 |
|
Coûts unitaires de main-d'oeuvre 1 |
0,9 |
2,4 |
1,9 |
1,7 |
0,6 |
1,1 |
0,8 |
|
IPCH hors énergie, alimentation, alcool et tabac |
1,1 |
1,9 |
2,4 |
1,8 |
1,8 |
1,5 |
1,3 |
1 dans le secteur des entreprises
Source
: OCDE, base de données des
Perspectives économiques de l'OCDE, n° 77
(Zone Euro - ISBN
92-64-01171-4)
En outre, le rythme de l'inflation s'est notablement accéléré au cours de l'année 2005 et les perspectives, en ce domaine, sont incertaines, du moins pour certains analystes, en raison à la fois du flou qui entoure les prévisions des prix des matières premières et des incertitudes sur leurs effets sur le niveau général de l'inflation.
A supposer qu'elle se produise, la résurgence de l'inflation exercerait des effets plus ou moins négatifs selon ses conditions d'apparition, mais, dans tous les cas, elle pèserait sur l'activité.
Limitée à un seul pays - la France, en l'occurrence - une reprise de l'inflation représente un choc très défavorable à la croissance ; une élévation plus générale du rythme d'augmentation des prix, sans être souhaitable, n'a pas d'effets aussi négatifs.
Cependant, si les Banques centrales devaient resserrer leurs politiques monétaires pour répondre à un choc de cette nature, les effets récessifs de l'inflation seraient nettement amplifiés.
1. Le retour à l'inflation limité à la France exercerait des effets durablement défavorables
Une hausse du rythme d'inflation qui n'interviendrait qu'en France aurait un impact récessif marqué et durable selon une variante réalisée pour le présent rapport.
Même si un tel choc produit ses effets maximaux les premières années après sa survenance, le retour à l'équilibre semble devoir emprunter un long cheminement.
Dans cette variante, le choc initial, de 0,5 point d'inflation, se propage à travers la boucle « prix-salaires » de sorte qu'au bout de cinq ans le niveau des prix est supérieur de 1,4 point à ce qu'il est dans le compte central (sans supplément d'inflation).
IMPACT D'UNE HAUSSE DE L'INFLATION DE + 0,5 POINT LIMITÉE À LA FRANCE
(en écart au compte central, par année et en point)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB (en volume) |
-0,5 |
-0,9 |
-1,3 |
-1,5 |
-1,6 |
|
Contributions à la croissance : |
|||||
|
- Demande intérieure |
-0,3 |
-0,6 |
-1,0 |
-1,2 |
-1,3 |
|
- Solde extérieur |
0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
|
Variation de l'emploi total |
-0,3 |
-0,6 |
-1,0 |
-1,2 |
-1,3 |
|
Capacité de financement : |
|||||
|
- Entreprises non financières |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
|
- Ménages |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
- Administrations publiques |
-0,2 |
-0,5 |
-0,8 |
-1,0 |
-1,2 |
Une hausse du niveau de l'inflation de 0,5 point qui ne concernerait que la France aurait un impact fortement négatif sur le rythme de croissance .
Celui-ci serait inférieur de 0,5 point la première année, et les effets du choc inflationniste seraient durables. Ce n'est qu'à partir de la quatrième année qu'un rééquilibrage commencerait à se produire . Malgré celui-ci, en 2010, qui est le terme de la projection, le « déficit » de PIB resterait significatif avec un niveau de 1 point de PIB (en volume) en dessous du compte central.
Ces résultats s'expliquent par le cumul des effets d'une hausse de l'inflation sur toutes les composantes de la demande .
L'impact sur la demande intérieure est à la fois le plus important, dans une première phase, et le moins persistant.
Sous l'effet de l'accélération de l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages se trouve amputé : le salaire horaire est affecté même si le phénomène de non-indexation n'est pas complet ; les pertes d'emplois sont prononcées avec environ 0,3 % d'emplois par an en moyenne.
L'investissement des entreprises pâtit du ralentissement de la demande des ménages et des exportations.
Le ralentissement de la demande intérieure est maximal au bout de trois ans. Le choc inflationniste se dissipe rapidement même si le niveau des prix est durablement plus élevé. Après avoir reconstitué leur épargne dans un premier temps, les ménages réduisent leur taux d'épargne lorsque les perspectives économiques s'améliorent, en particulier quand les risques d'une perte de valeur de leurs actifs se résorbent.
Ce dernier phénomène explique la persistance de la dégradation du solde extérieur qui pèse sur toute la période de projection sur la croissance .
Les exportations sont affectées par une perte de compétitivité. La hausse du niveau des prix peut être assimilée à une appréciation du taux de change réel ; le choc étant limité à la France écorne sa compétitivité par rapport aux autres pays de l'U.E.M. ; en outre, la probabilité d'un ajustement compensatoire de l'euro par rapport aux autres monnaies étant des plus minimes, la perte de compétitivité concerne aussi le reste du Monde.
De leur côté, les importations rétrogradent sous l'effet du ralentissement de l'activité, mais moins que les exportations en raison des pertes de compétitivité subies par les produits nationaux. En outre, la reprise qui se dessine lorsque le choc inflationniste s'estompe entraîne rapidement un retour des importations alors que les exportations restent handicapées par un niveau de prix relativement défavorable.
Face au choc inflationniste, la situation financière des agents est différemment affectée .
La capacité de financement des entreprises est plus importante en raison des réductions d'emplois salariés qui dessinent un cycle de productivité classique 27 ( * ) .
L'impact du choc sur la capacité de financement des ménages est modeste du fait de la réduction à due proportion de leur consommation.
Ce n'est pas le cas de la capacité du financement des administrations publiques . Le solde des administrations publiques se creuse sous le double effet des pertes de recettes liées à la dégradation de la conjoncture et d'un niveau de dépenses publiques exprimées en points de PIB plus élevé. Ce dernier phénomène est cohérent avec la norme de gestion des dépenses publiques qui en lie l'évolution à celle des prix. Comme ceux-ci s'accélèrent alors que le PIB est moindre que dans le scénario central, il est logique, d'un point de vue comptable, que le poids des dépenses publiques dans le PIB s'accroisse.
Votre rapporteur veut souligner la conclusion qu'il faut tirer de cette variante . Il convient d'être attentif à ce que la formation des salaires reste compatible avec les données structurelles qui en conditionnent l'équilibre et qui sont les gains de productivité des entreprises. Il convient donc d'éviter d'indexer les salaires sur les hausses de prix, accidentelles et transitoires. Toute solution contraire ne manquerait pas de créer des tensions inflationnistes, qui seraient alors durables et exerceraient les effets négatifs qu'on vient d'exposer.
2. Un choc inflationniste général, sans être souhaitable serait moins défavorable.
La probabilité de survenance d'un choc inflationniste limité à la France apparaît assez faible. L'interdépendance renforcée des économies sans l'interdire éloigne la perspective de chocs inflationnistes isolés.
Une deuxième variante explore les conséquences d'un regain d'inflation plus généralisé. Dans cette variante, c'est l'économie mondiale qui connaît un taux d'inflation plus élevé de 0,5 point.
IMPACT SUR LA FRANCE D'UNE HAUSSE DE L'INFLATION DE +
0,5 POINT
GÉNÉRALISÉE À L'ENSEMBLE DES
PAYS
(en écart au compte central, par année et en point)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB (en volume) |
-0,3 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,9 |
-1,0 |
|
Contributions à la croissance : |
|||||
|
- Demande intérieure |
-0,3 |
-0,4 |
-0,6 |
-0,8 |
-1,0 |
|
- Solde extérieur |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
|
Variation de l'emploi total |
-0,2 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,8 |
|
Capacité de financement : |
|||||
|
- Entreprises non financières |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
- Ménages |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
-1,0 |
|
- Administrations publiques |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,7 |
L'accélération de l'inflation exerce un effet négatif sur la croissance , mais moins que lorsqu'elle est cantonnée à la France .
La contribution à la croissance du solde extérieur est en repli , mais plus modéré , que dans la variante précédente. Les pertes de compétitivité sont alors limitées puisque tous les pays sont touchés. La contribution du solde extérieur est toutefois négative. La demande mondiale est moins forte puisque le supplément d'inflation touche l'ensemble du pays.
La demande intérieure est elle aussi moins rapide mais le pouvoir d'achat du salaire horaire étant un peu plus faiblement entamé et les besoins d'ajustement du nombre d'emplois étant moindres, ces deux phénomènes se conjuguent pour que la demande des ménages soit moins détériorée que quand l'inflation est limitée à la France. Celle-ci offre, à son tour, un certain soutien à l'investissement des entreprises. Comme dans le cas où l'inflation ne se manifesterait qu'en France le choc inflationniste ne s'épuise que graduel-lement.
3. Un resserrement de la politique monétaire pour lutter contre le choc inflationniste amplifierait ses effets récessifs
Le scénario testé en variante est celui où, face à la résurgence inflationniste mondiale, les Banques centrales relèveraient leurs taux d'intervention de 1 point la première année.
IMPACT D'UNE HAUSSE DE L'INFLATION DE + 0,5 POINT
GÉNÉRALISÉE À L'ENSEMBLE DES PAYS
ET
ACCOMPAGNÉE D'UNE HAUSSE DE 1 POINT DES TAUX D'INTÉRÊT
(en écart au compte central, par année et en point)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB (en volume) |
-0,6 |
-0,8 |
-1,2 |
-1,5 |
-1,6 |
|
Contributions à la croissance : |
|||||
|
- Demande intérieure |
-0,4 |
-0,6 |
-1,0 |
-1,2 |
-1,3 |
|
- Solde extérieur |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
|
Capacité de financement des agents : |
|||||
|
- Entreprises non financières |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
|
- Ménages |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
- Administrations publiques |
-0,4 |
-0,7 |
-0,9 |
-1,2 |
-1,4 |
L'intervention des Banques centrales semble efficace pour contenir l'inflation, mais au prix d'un effet récessif plus fort sur l'économie mondiale et par là, sur l'économie française.
Les principaux mécanismes en jeu sont les mêmes que ceux présentés lors des variantes précédentes. S'y ajoute l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Dans le modèle, la politique monétaire restrictive joue principalement sur les entreprises. Elle entraîne une contraction de leurs dépenses d'investissement.
Au total, l'effet sur le PIB français est important, proche de celui observé quand le choc inflationniste ne concerne que la France. Autrement dit, le resserrement monétaire ampute, à lui seul, le PIB de 0,6 point au bout de cinq ans .
Il pourrait être plus négatif encore si on prenait en compte les effets sur les ménages du resserrement des conditions de crédit 28 ( * ) . Celui-ci dissuaderait sans doute un nombre important d'emprunteurs et, au contraire, pourrait inciter à une épargne plus abondante. La consommation des ménages se ressentirait de ces enchaînements financiers.
B. MAIS UN RISQUE QU'IL NE FAUT PAS SURESTIMER
La situation économique, qui se caractérise par un important écart de la production par rapport à la production potentielle, ne se prête pas à des tensions particulières sur les coûts de production nationaux.
Alors que dans l'environnement économique des précédents chocs pétroliers, les ingrédients de l'enclenchement inflationniste de la boucle prix-salaires étaient réunis, la désindexation des salaires prévient aujourd'hui, croyons-nous, une élévation durable du rythme d'inflation.
D'ailleurs, si l'inflation nominale accélère , l'inflation sous-jacente dans la zone euro se modère.
INFLATION SOUS-JACENTE
(IPCH sous-jacent, en glissement annuel)
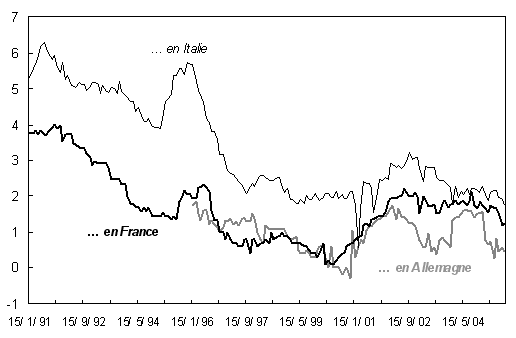
Dans ce contexte, il serait , par conséquent, particulièrement inapproprié que la Banque centrale européenne (BCE), relève ses taux .
L'une des conditions essentielles du retour à une croissance satisfaisante dans la zone euro réside dans le maintien de conditions monétaires accommodantes.
COMPOSANTES DE L'INDICATEUR DE CONDITIONS
MONÉTAIRES
DANS LA ZONE EURO
(en points de PIB)
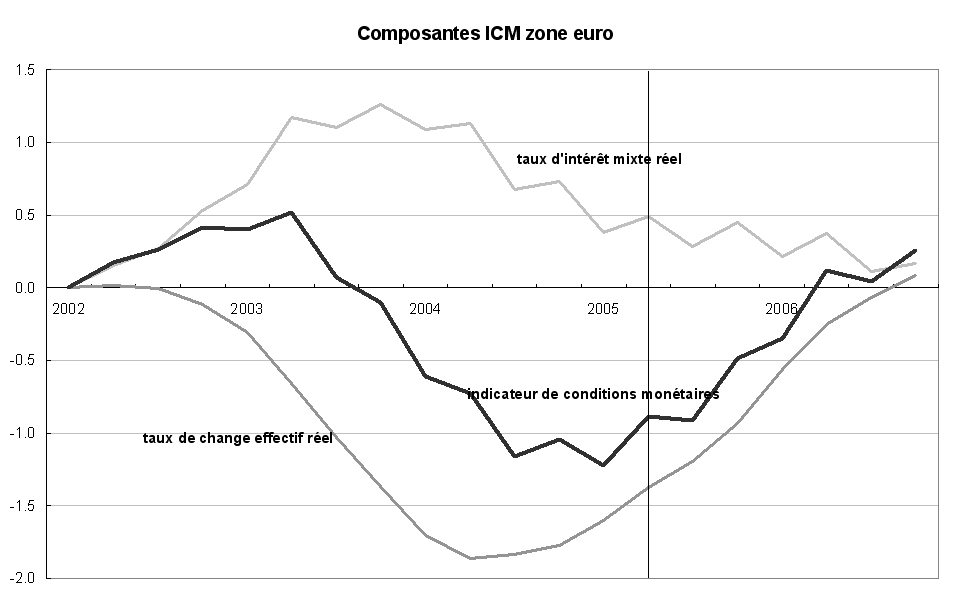
Les conditions monétaires ont été négatives depuis 2004, en raison de l'appréciation du taux de change de l'euro.
Le début d'amélioration enregistré en cours d'année 2005 doit se prolonger pour effacer le retard accumulé .
Une remontée des taux de la BCE pourrait avoir le double effet indésirable de dégrader les conditions de financement internes à la zone euro et de freiner le réajustement des taux de change internationaux.
La politique de resserrement progressif des conditions monétaires de la Fed ne saurait servir de modèle à la BCE . L'économie américaine navigue autour de son potentiel et l'inflation sous-jacente aux États-Unis est d'une autre ampleur qu'en zone euro.
INFLATION SOUS-JACENTE ZONE EURO ET ÉTATS-UNIS
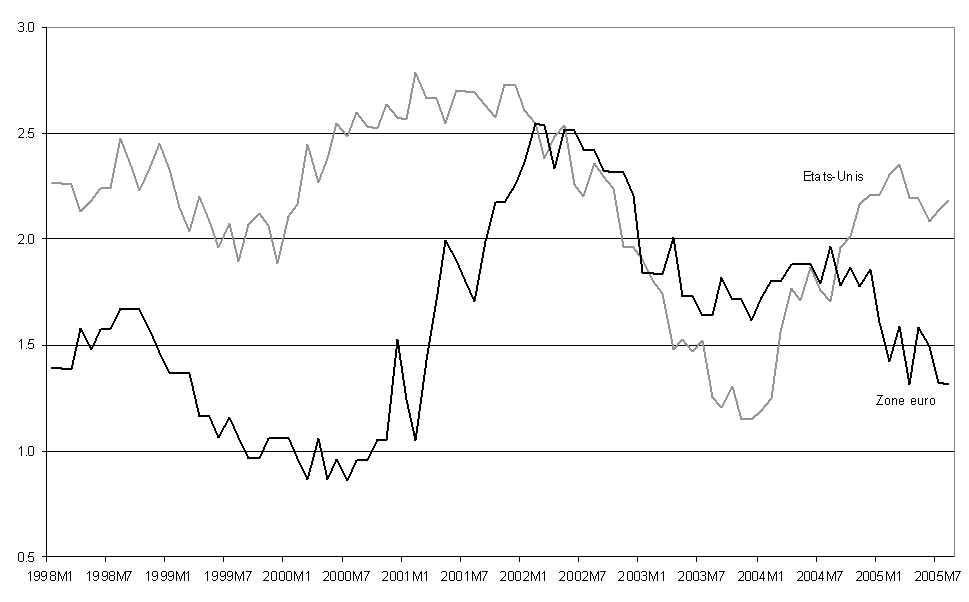
Source : Comptes nationaux
Au demeurant, la BCE devrait mesurer le risque de perte de crédibilité associé à l'éventualité d'un resserrement monétaire . Aux États-Unis où le resserrement graduel de la politique monétaire est en cours, les premiers « pas » dans la hausse des taux de la Réserve Fédérale ont eu pour effet une réduction du niveau des taux longs. En bref, les marchés ont, un temps, désavoué la FED alors que les orientations de celle-ci pouvaient être justifiées par un contexte économique de croissance autour du potentiel de l'économie américaine. Il est ainsi assez probable, et en tout cas entièrement justifié par la situation économique de la zone euro, qu'un tel désaveu, intervienne si la BCE avait la mauvaise idée de resserrer ses conditions d'intervention.
III. UNE HYPOTHÈQUE INTÉRIEURE : Y A-T-IL DES RÉSERVES POUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES ?
La consommation des ménages est le moteur principal du scénario central de croissance ici présenté . Son dynamisme est une condition primordiale mais il ne pourra pas reposer uniquement sur la progression des revenus des ménages. Une modification des comportements de consommation plaçant celle-ci sur une trajectoire plus rapide est nécessaire . Il convient alors d'élucider les conditions d'un tel scénario.
Cette dernière exigence est atténuée lorsqu' on imagine une reprise plus franche de l'investissement des entreprises, ou encore une contribution à la croissance du commerce extérieur plus favorable . Cependant, ces deux derniers scénarios sont suspendus à des enchaînements peu habituels. Et, même s'ils se réalisaient, les ménages devraient adopter des comportements de consommation particulièrement dynamiques.
A. DES SCÉNARIOS CONDITIONNÉS À UNE FORTE DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION DANS UN CONTEXTE DE PROGRESSION MODÉRÉE DU REVENU DES MÉNAGES
Dans l'ensemble des projections, la consommation des ménages est déterminante , ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son poids structurel dans les moteurs de l'activité. Elle doit être plus rapide que les gains de pouvoir d'achat des ménages. Une baisse importante de leur taux d'épargne doit intervenir, ainsi que le montre le graphique ci-dessous.
COMPORTEMENT D'ÉPARGNE DANS LES 5 SCÉNARIOS
(en %, mm4)
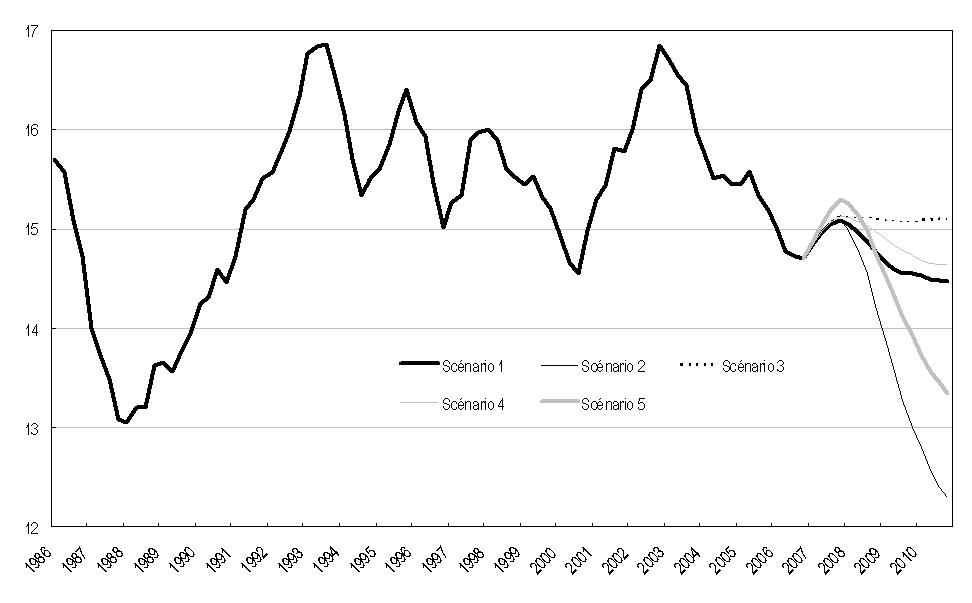
Source : INSEE, calculs OFCE
1. La consommation doit être particulièrement dynamique dans le scénario central...
Dans le scénario central , la progression de la consommation des ménages (+ 2,5 % par an en moyenne) doit être plus dynamique que celle observée sur longue période . Entre 1995 et 2005 , la consommation des ménages n'a progressé que de 2,2 % par an .
Surtout, elle est plus rapide que les gains de pouvoir d'achat du revenu des ménages . Ceux-ci sont limités à 1,8 %. Dans l'ensemble des projections présentées ici, l'ajustement structurel des comptes publics se traduit par un impact négatif des relations financières entre les administrations publiques et les ménages qui pèse sur la progression de leur revenu disponible.
Une baisse sensible du taux d'épargne des ménages 29 ( * ) apparaît nécessaire pour que leur consommation soit aussi robuste. Cette évolution nécessite que la tendance récente à la diminution du taux d'épargne des ménages se poursuive. Entre 1987 et 1994, le taux d'épargne des ménages était passé de 11 à 15,5 points de revenu. Après une certaine stabilité jusqu'en 1999, un nouvel épisode de hausse était intervenu. Toutefois, en 2004, une nette diminution s'est produite et, en 2005, un nouveau repli est attendu.
TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES FRANÇAIS
(en pourcentage du revenu disponible brut des ménages)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
15,8 |
15,8 |
16,8 |
16,0 |
15,4 |
15,2 |
Source : INSEE, base 1995 des Comptes nationaux
La perspective, souhaitable en projection, d'une baisse du taux d'épargne des ménages venant soutenir la croissance, invite à envisager quels sont les déterminants de la consommation et du taux d'épargne, afin de préciser quelles mesures d'ordre économique seraient susceptibles de baisser la propension à épargner des ménages français ou, ce qui revient au même, de dynamiser leur consommation.
2. ... mais aussi dans des scénarios alternatifs où les autres agents contribuent davantage à la croissance
Dans les scénarios où les entreprises ou le commerce extérieur contribuent davantage à la croissance, la condition de réduction du taux d'épargne des ménages, pour être un peu moins stricte, reste déterminante.
a) un scénario de forte croissance de l'investissement
(1) Les perspectives offertes par une plus forte reprise de l'investissement...
Dans tous les scénarios à 2,25 % de croissance, l'investissement doit progresser plus vite que dans sa tendance récente.
COMPORTEMENT D'INVESTISSEMENT DANS LES 5 SCÉNARIOS
(en %, mm4)
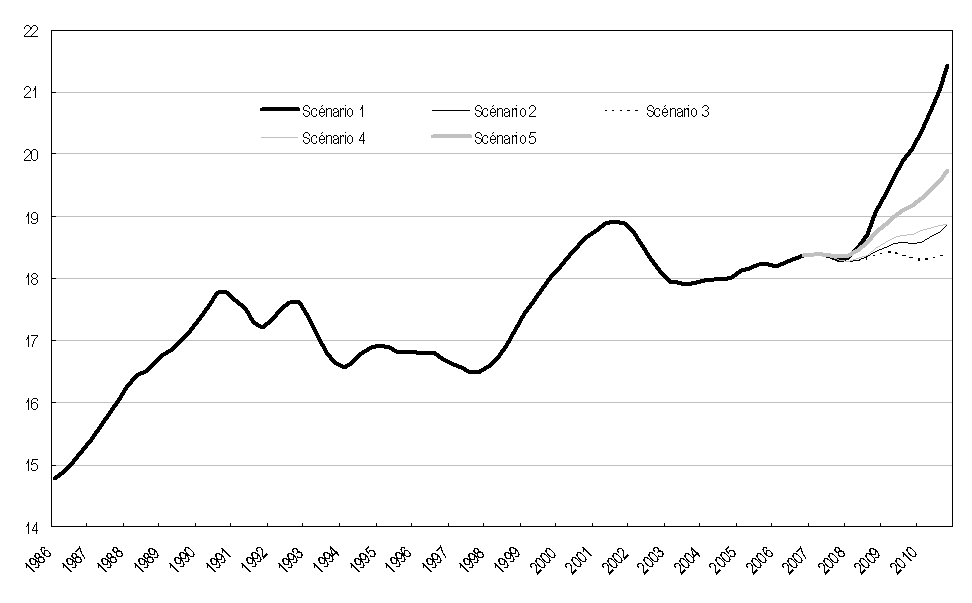
Source : INSEE, calculs OFCE
Dans le compte central , l'investissement des entreprises évolue sur un rythme de 4,3 % en moyenne annuelle. Sa progression est plus rapide que celle observée historiquement (3,5 % entre 1985 et 1995 ; 3,2 % entre 1995 et 2005). Le taux d'investissement des entreprises 30 ( * ) , qui est représentatif de la part de la richesse créée par elles, affectée à l'acquisition des moyens de production durables (bâtiments, équipements...) se redresserait à 18,5 % en moyenne (soit 0,7 point de plus que sur la période 1995-2005).
Si ces évolutions témoignent d'une orientation plus favorable de la demande des entreprises, elles restent mesurées au regard de ce qu'on observe dans les épisodes de reprise économique. Ainsi, entre 1997 et 2000, l'augmentation annuelle moyenne de l'investissement des entreprises s'est élevée à près de 7 % en volume.
Une progression plus rapide de l'investissement des entreprises est donc une perspective « normale » quand l'économie sort d'un point bas du cycle .
Dans une simulation alternative au scénario central, dans lequel la croissance repose principalement sur la consommation des ménages, on a souhaité illustrer dans quelle mesure une contribution de l'investissement à la croissance plus en ligne avec les épisodes de reprise passés pourrait minorer les ajustements du comportement des ménages.
En supposant une croissance de l'investissement supérieure de 3,5 % par rapport au compte central (soit une augmentation annuelle de 7,8 % au cours de la période 2007-2010), la baisse du taux d'épargne des ménages compatible avec une croissance à 2,25 % l'an serait réduite de moitié (-1 point contre -2,4 points quand l'investissement des entreprises progresse de 4,3 %).
Cette simulation a pour utilité principale de montrer dans quelle mesure une plus grande dynamique de l'investissement viendrait « détendre » les contraintes de désépargne des ménages que suppose l'objectif de croissance retenu dans les projections dans un contexte d'ajustement structurel des comptes publics. Ses résultats montrent que, si une demande dynamique des entreprises serait un élément favorable , elle n'exercerait pas un effet d'entraînement de la croissance tel que les ménages puissent conserver leurs préférences pour l'épargne .
Toutefois, il faut observer que la simulation ici exposée est en partie « conventionnelle » et que sa présentation n'implique pas de jugement sur la probabilité d'un tel scénario .
Sur le premier point, on doit indiquer qu'une hypothèse importante a été posée au terme de laquelle le rythme très rapide de l'investissement n'exercerait pas d'effet défavorable sur le commerce extérieur. Or, le contenu en importations des investissements est relativement élevé par rapport à celui de la consommation des ménages, ce qui, à court terme 31 ( * ) est susceptible de dégrader la contribution du commerce extérieur par rapport à une situation où la croissance est « tirée » par la consommation.
(2) ...ne doivent pas être surestimées
Surtout, la probabilité d'une reprise de l'investissement aussi sensible que celle qui a été simulée apparaît des plus incertaines, pour des motifs conjoncturels et structurels .
Il apparaît des plus improbables que l'investissement puisse connaître une dynamique indépendante de la consommation des ménages.
Le maintien d'une politique monétaire accommodante pourrait favoriser une reprise de l'investissement des entreprises, dans un contexte où leur situation financière est assainie et où des besoins de rattrapage existent.
Mais, si les entreprises sont aujourd'hui mieux à même d'investir après leur redressement financier récent, il faut conforter leurs perspectives, ce qui plaide pour une politique de croissance.
La réduction très rapide du déficit public structurel , à marche forcée en quelque sorte, n'offrirait pas un contexte propice à l'investis-sement .
Dans la vie économique mondialisée que nous connaissons, il y a naturellement une propension à investir dans les zones qui offrent des coûts de production réduits. Mais, l'importance des perspectives de chiffre d'affaires ne doit pas être négligée. Même si la croissance en zone euro est moins rapide que dans les pays émergents, une bonne orientation de l'activité, même sur un rythme moins élevé, y recèle encore des occasions d'augmenter les chiffres d'affaires qui se comparent avec d'autres zones.
Il faut ainsi veiller à orienter nos politiques économiques vers un objectif de forte croissance en France mais aussi en Europe.
b) L'impact d'une contribution positive du commerce extérieur
Au cours de ces dernières années, la contribution du commerce extérieur à la croissance a été fortement négative. Le rattrapage du déficit de croissance ainsi accumulé permettrait de « détendre » quelque peu les conditions des scénarios de croissance présentés dans le programme de stabilité et dans les projections de votre Délégation. Mais, la probabilité d'un retour à une forte contribution positive des échanges extérieurs est faible et suspendue à des conditions d'environnement international peu maîtrisables.
(1) Une plus forte contribution des échanges extérieurs à la croissance favoriserait la réalisation des scénarios envisagés.
|
LE COMMERCE EXTÉRIEUR,
Le solde des échanges de biens et services de la France s'est dégradé au cours des deux dernières années, passant d'un excédent de 17 milliards d'euros en 2003 à un déficit de 16 milliards d'euros en prévision pour 2005. Deux éléments, hausse du prix du pétrole et taux de change effectif de l'euro, expliquent une part importante de ces mauvais résultats. Toutefois, ces deux éléments n'expliquent pas pourquoi la France est le pays de la zone euro qui a le moins profité du dynamisme de la croissance mondiale. En 2004, la contribution du commerce extérieur à la croissance a été fortement négative en France (-0,9 point de croissance en 2004). En 2005, elle pourrait atteindre entre -0,8 et -1 point alors qu'elle a été neutre dans la moyenne des pays de la zone euro. Les raisons de cette sous-performance ne sont pas pleinement élucidées. Elles pourraient résider dans la spécialisation de la France : - spécialisation géographique , tout d'abord : les échanges de la France sont davantage centrés sur la zone euro que ceux de l'Allemagne par exemple, ce qui ne lui a pas permis de « profiter » de la même manière de la forte croissance des pays émergents, des pays d'Europe de l'Est ou des États-Unis ; - spécialisation géographique , tout d'abord : les échanges de la France sont davantage centrés sur la zone euro que ceux de l'Allemagne par exemple, ce qui ne lui a pas permis de « profiter » de la même manière de la forte croissance des pays émergents, des pays d'Europe de l'Est ou des États-Unis ; - spécialisation sectorielle, ensuite : compte tenu de sa forte spécialisation dans l'aéronautique et dans les biens de consommation sensibles à l'effet prix (agroalimentaire), la France a relativement plus souffert de la crise du secteur aérien et de l'appréciation de l'euro. Ces éléments - appréciation de l'euro et spécialisation - ne suffisent toutefois pas à expliquer en totalité les pertes de parts de marché enregistrées par la France depuis trois ans. Une explication complémentaire peut être recherchée dans la politique de restriction des revenus et de maîtrise des coûts salariaux conduite par l'Allemagne 32 ( * ) . A partir d'une estimation économétrique, l'OFCE évalue à 30 % des pertes de parts de marché subies par la France, l'impact de la politique de compétitivité conduite par l'Allemagne. |
Dans les exercices de projections, il est d'usage de neutraliser les effets du commerce extérieur. On a posé comme hypothèse que sa contribution à la croissance serait nulle 33 ( * ) pour élaborer les scénarios centraux.
Pourtant, de nombreux épisodes de reprise économique sont caractérisés par un effet initial d'entraînement du commerce extérieur . Ce type de configuration ne manque pas de logique, soit qu'un pays bénéficie in fine des efforts entrepris pour améliorer sa compétitivité, soit que le creux conjoncturel connu par ses partenaires soit surmonté, soit encore que les chocs ayant provoqué la dégradation de son commerce extérieur s'estompent.
L' environnement économique actuel, qui est aussi celui des projections confère une certaine vraisemblance à une amélioration de la contribution du commerce international de la France à sa croissance qui pourrait aller au-delà d'un simple effacement de ses effets négatifs.
L'éventualité d'une poursuite de l'augmentation du prix du pétrole au même rythme que celle enregistrée pour la période de projection, sans pouvoir être écartée, semble incertaine comme le montre le récent rapport de votre Délégation sur l'économie du pétrole. Un repli sensible du prix du baril que les projections décrites plus haut n'intègrent pas exercerait tous les effets d'un contrechoc pétrolier. Une baisse du prix du baril à 45$ (contre 60 dans les projections) ferait gagner 0,3 points de PIB dès la première année.
De la même manière, un retour durable à un niveau de parité de l'euro contre les autres monnaies, le dollar mais aussi les monnaies asiatiques, peut être raisonnablement envisagé en fonction notamment des perspectives naturelles de croissance dissymétriques entre la zone euro et le reste du Monde. Il serait favorable à la compétitivité des pays européens.
Enfin, il n'est pas interdit d'espérer qu' une meilleure coordination entre les politiques économiques des pays de la zone euro permette d'interrompre la concurrence déflationniste qu'ils se livrent en restaurant les conditions de politiques économiques orientées vers la croissance.
C'est pourquoi, sans négliger les risques contraires exposés par ailleurs, deux variantes ont été élaborées pour mesurer les effets d'une contribution à la croissance plus favorable du commerce extérieur.
On a supposé que , après avoir été négative en moyenne annuelle à hauteur de 0,4 point de PIB entre 1995 et 2006, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait positive entre 2007 et 2010 , dans la même proportion, et exercerait donc un effet favorable sur le PIB de 0,4 point en moyenne .
Dans un tel contexte, l' objectif d'une croissance à 2,25 % l'an continuerait à être conditionné à des modifications du comportement des agents économiques . Mais, leur ampleur serait assez nettement réduite par rapport à une situation de neutralité du commerce extérieur .
IMPACT D'UNE CONTRIBUTION POSITIVE DU COMMERCE
EXTÉRIEUR
DE 0,4 POINT DE PIB EN MOYENNE ANNUELLE SUR LA
PÉRIODE 2008-2010
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB |
|||
|
- Stabilisation du taux d'épargne
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
- Flexion du taux d'épargne et du taux d'investissement |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|
ÉVOLUTION DU TAUX
D'ÉPARGNE
1
|
|||
|
- dans le cas de contribution neutre du commerce extérieur |
14,2 |
13,1 |
12,3 |
|
- dans le cas de contribution positive du commerce extérieur |
15,0 |
14,8 |
14,6 |
|
ÉVOLUTION DU TAUX
D'INVESTISSEMENT
2
|
|||
|
- dans le cas de contribution neutre du commerce extérieur |
19,1 |
20,1 |
21,4 |
|
- dans le cas de contribution positive du commerce extérieur |
18,4 |
18,7 |
18,9 |
1
Le taux d'épargne serait de 15,1
points en 2007
2
Le taux d'investissement serait de 18,3 points
en 2007
Une contribution plus favorable du commerce extérieur, du moins si elle reste dans un ordre de grandeur envisageable, ne permet pas, à comportements inchangés des agents, d'atteindre l'objectif de croissance correspondant au scénario bas du programme pluriannuel des finances publiques. Pour rejoindre cet objectif, il faudrait que la contribution à la croissance du commerce extérieur s'élève durablement à 0,9 point par an.
(2) La probabilité d'une forte contribution du commerce extérieur à la croissance est faible et suspendue à des conditions d'environnement international plus ou moins maîtrisables.
Une telle perspective est peu vraisemblable.
Lorsque la contribution des échanges extérieurs à la croissance est nulle, le solde extérieur reste inchangé (lorsqu'il s'améliore, la contribution du commerce extérieur est positive). Partant d'une situation en 2005 où le solde est déficitaire, le retour à l'équilibre suppose que les exportations augmentent plus que les importations.
L'évolution des importations dépend de l'évolution de la demande intérieure, et l'élasticité de ces importations à la demande intérieure et de la compétitivité.
Selon le modèle, pour une demande intérieure qui augmente de l'ordre de 2,3 % par an en moyenne sur la période, les importations - à compétitivité inchangée - augmentent de 6,3 % par an en moyenne.
Pour rejoindre l'équilibre et s'y maintenir, il faut que les exportations augmentent plus rapidement - soit 6,5 % par an en moyenne - et toujours à compétitivité inchangée, il faut que la demande mondiale adressée à la France augmente de 7 % par an 34 ( * ) . Or, une progression annuelle de la demande étrangère adressée à la France de l'ordre de 7,5 % est caractéristique d'une phase haute du cycle de l'économie mondiale. Tendanciellement, la progression de la demande adressée à la France est plus proche de 6 % l'an.
Autrement dit, une croissance à moyen terme de l'économie française de 2,25 %, compatible avec une contribution nulle des échanges extérieurs à la croissance, suppose déjà une croissance de l'économie mondiale - et de la demande adressée à la France - plus rapide sur le moyen terme que sa tendance de longue période .
*
* *
L'effet d'entraînement du commerce extérieur sur la croissance permet de réaliser la croissance-cible moyennant une flexion moins accusée des comportements des agents. Mais, la détente des conditions pesant sur les agents domestiques est très limitée : le repli du taux d'épargne des ménages doit atteindre environ 1 point (contre -2,4 points dans le compte central) ; ou, si l'ajustement pèse sur elles, le taux d'investissement des entreprises doit augmenter de 0,8 point (contre 2,4 points dans le compte central).
B. RETOUR SUR LES CONDITIONS D'UNE RÉDUCTION DU TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES
Dans le contexte d'ajustement structurel des comptes publics, une des conditions déterminantes pour la croissance réside dans l'enclenchement d'un processus de désépargne des agents privés, en particulier des ménages .
La consommation des ménages doit évoluer plus rapidement que leur revenu disponible brut pour compenser la moindre contribution des administrations publiques à la croissance.
Or, cette exigence de désépargne privée intervient alors dans un contexte qui n'est a priori pas favorable à sa réalisation . Les objectifs d'ajustement structurel des comptes publics s'accompagnent d'une dégradation du bilan des transferts entre administrations publiques et ménages qui réduit le niveau disponible des ménages. La voie d'une désépargne privée semble alors particulièrement étroite.
En effet, la croissance de la consommation à long terme dépend traditionnellement du revenu, de l'inflation et, du moins, pour les biens durables, du chômage.
Toutefois, ces différentes variables ne permettent pas toujours d'expliquer correctement les évolutions de la consommation. Deux autres catégories d'éléments sont susceptibles de l'influencer :
- les éléments d'ordre financier, tels que les taux d'intérêt, la valorisation des actifs des ménages ou encore l'accès au crédit ;
- des éléments d'ordre qualitatif, réductibles à la notion de « confiance des ménages ».
Dans un passé récent , le taux d'épargne des ménages a diminué en France alors que, par exemple, nos voisins allemands n'ont pas relâché leur « effort » d'épargne .
L'OFCE a entrepris des travaux pour élucider ces deux phénomènes.
La baisse du taux d'épargne en France y est expliqué par la combinaison d'une réduction de l'écart entre les taux d'intérêt et le taux de progression du revenu des ménages, des effets de richesse immobilière et des mesures fiscales.
FACTEURS EXPLICATIFS DE LA BAISSE DU TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES
(en points de revenu disponible brut)
|
2003 |
2004 |
2005* |
2006* |
|
|
-0,9 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,4 |
|
|
Écart critique (g - r)** |
-0,5 |
-0,1 |
0,1 |
-0,1 |
|
Effet de richesse immobilière*** |
-0,2 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,2 |
|
Variation du chômage |
-0,2 |
0 |
0,1 |
-0,1 |
|
Mesures Sarkozy |
- |
-0,2 |
- |
- |
* Prévisions OFCE.
** L'écart critique est la différence entre le taux de croissance du revenu des ménages (g) et le taux d'intérêt à long terme (r). Cet écart illustre la capacité des ménages à emprunter.
*** En prévision, nous avons supposé une stabilisation des prix de l'immobilier.
Sources : Calculs OFCE, e-mod.fr.
Ces variables jouent très différemment en Allemagne. Évident pour les mesures fiscales, ce constat vaut surtout pour l'écart critique entre revenus et taux d'intérêt. Dans un contexte où les taux débiteurs sont proches, la différence porte principalement sur la progression des revenus des ménages, très faible en Allemagne.
POURQUOI LE TAUX D'ÉPARGNE BAISSE PLUS EN FRANCE QU'EN ALLEMAGNE ?
(en points de revenu disponible brut)
|
2003 |
2004 |
|
|
Écart de variation du taux d'épargne
|
-1,3 |
-1,0 |
|
Écart critique (g - r) |
-1,1 |
-0,5 |
|
Effet de richesse immobilière |
-0,2 |
-0,2 |
|
Mesures Sarkozy |
0,0 |
-0,2 |
|
Autres |
-0,1 |
-0,1 |
Sources : Calculs OFCE, e-mod.fr.
Les facteurs d'évolution de la consommation des ménages identifiés par l'OFCE montrent que la combinaison des politiques économiques revêt une grande importance et peut soutenir la consommation dans un contexte de croissance modérée des revenus .
Cet enseignement est d'autant plus encourageant que les effets sur les ménages des deux composantes de la politique économique peuvent être optimisés :
- la politique monétaire pourrait avoir plus d'efficacité dans la zone euro sous les conditions d'un meilleur accès des ménages au crédit ;
- la politique fiscale pourrait favoriser plus la consommation à contrainte budgétaire donnée .
1. Les variables traditionnelles échouent à rendre compte de la dynamique de la consommation
Une étude de l'INSEE portant sur les années 90 montre que le revenu disponible brut des ménages et la consommation ont alors connu, en France, une progression identique en moyenne annuelle (1,4 % en volume dans les deux ans).
Cependant, cette homogénéité peut être qualifiée d'accidentelle . En effet, les évolutions respectives des deux grandeurs ont été nettement disparates dans chacune des deux parties des années 90.
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DE LA CONSOMMATION TOTALE
(évolution moyenne annuelle en %)
|
1990-1999 |
1990-1994 |
1995-1999 |
|
|
Dépenses de consommation |
1,4 |
0,8 |
1,9 |
|
Contributions : |
|||
|
- Pouvoir d'achat du revenu |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
|
- Inflation |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
- Taux de chômage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- Libéralisation financière |
-0,3 |
-0,5 |
0,0 |
|
- Prime à la casse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- Résidu |
0,1 |
-0,3 |
0,4 |
Source : INSEE
Ainsi, dans les années 90 à 94, la contribution théorique du revenu disponible à la consommation excède de près de deux fois la consommation effective (de 1,5 % contre 0,8 %). Inversement, entre 1995 et 1999, la consommation est sensiblement plus dynamique que le pouvoir d'achat le laisse escompter. Elle progresse au rythme annuel de 1,9 % contre une contribution prévisible du pouvoir d'achat de seulement 1,3 %. Au cours de cette dernière période, la baisse de l'inflation exerce sans doute un effet favorable sur la consommation, mais ces deux variables ne permettent pas, à elles seules, d'expliquer le rythme de la consommation.
La déconnexion que suggèrent ces données entre revenu disponible brut des ménages, inflation et consommation est une conclusion robuste. Pour cerner les déterminants de la consommation, il faut, par conséquent, convoquer d'autres variables.
Celles qui sont évoquées dans l'étude mentionnée sont relatives à l'impact des opérations financières des ménages sur leur consommation et à une ligne dite « résidu » correspondant, dans l'étude, aux anticipations des ménages.
2. Les conditions d'accès des ménages au crédit
Selon l'étude mentionnée, les opérations financières des ménages récapitulées sous l'intitulé « libéralisation financière » auraient modifié le rythme de leur consommation. Elles auraient pesé négativement sur la consommation des ménages français au cours des années 90, après l'avoir stimulée auparavant.
Le point bas de l'épargne atteint à la fin des années 1980 aurait été le résultat d'un ensemble de réformes financières qui modifièrent, un temps, les comportements d'épargne et de crédit des ménages 35 ( * ) . Une fois la phase d'adaptation passée, le taux d'épargne aurait retrouvé un trend haussier, qu'il n'a pas quitté depuis.
De façon implicite, l' étude considère comme transitoire l'impact des réformes structurelles qui sont alors intervenues . L'accroissement de l'endettement des ménages et de leur consommation aurait été « temporaire » et « payé » à partir de 1990, lorsque le revenu a ralenti et la charge de la dette des ménages a augmenté par des tensions sur leur situation financière, qui auraient nécessité un ajustement de leur consommation.
Au fond, la contribution de la sphère du crédit à la trajectoire de consommation serait presque accidentelle 36 ( * ) .
Cette approche semble témoigner d'une filiation avec les théories monétaristes qui contestent l'utilisation conjoncturelle de la politique monétaire.
|
La théorie économique est loin de s'accorder sur les effets du crédit sur l'économie . 1. L'approche monétariste... Dans le camp des grands classiques , la monnaie est un « voile » qui n'a aucune vertu particulière sur la croissance. Les monétaristes parviennent aux mêmes conclusions et insistent sur les dangers d'une offre excessive de crédits en termes d'inflation. Les recommandations de politique monétaire de ces deux « écoles » sont marquées par la prudence : la politique monétaire doit être la plus stable possible ; elle doit distiller des liquidités de façon mesurée, en rapport avec le taux de croissance potentiel, voire effectif, de l'économie ; le taux d'intérêt réel ne doit pas s'écarter de ce taux de croissance. Appliquées à la situation des ménages, ces approches tendent à alerter sur l'inutilité et même, sur les dangers d'une dispensation de crédits qui suivrait un rythme supérieur à celui du revenu des ménages. La formulation doctrinale fondatrice de Milton Friedman veut que dans le cas contraire : l'injection monétaire soit au mieux inutile car la consommation des ménages est entièrement déterminée par leur revenu permanent, c'est-à-dire par les anticipations de revenus qu'ils peuvent former du fait de leur situation individuelle et de la situation globale de l'économie dans laquelle ils s'insèrent ; soit, au pire, inflationniste et récessive si le crédit dispensé est consommé car alors cette consommation provoque une hausse des prix, qui, à son tour, déclenche une spirale inflation-salaire, une perte de compétitivité, avec, à terme, le retour à un revenu prévisible inférieur à la situation ex ante . 2. ... est contestée Les approches néo-classiques s'appuient sur deux présuppositions , qui ne sont pas admises par les économistes keynésiens : il ne saurait exister de déséquilibres sur les différents marchés autres que volontaires ou liés à des rigidités des prix, si bien que toute impulsion sur la demande est incapable de les résoudre ; les comportements économiques sont ancrés dans la seule économie réelle et les stimulations monétaires (du crédit) ne représentent que des illusions auxquelles il convient de rester insensible. Les capacités de la politique monétaire , et du crédit, en termes de stimulation économique sont, au contraire, mises en évidence par les économistes de tradition keynésienne , ainsi que la maniabilité pratique de l'instrument monétaire, qui, d'ailleurs, n'est contestée que pour des motifs accessoires (les délais de transmission en particulier) par les monétaristes. Les canaux de transmission de la politique monétaire à l'activité réelle sont divers comme le résume fort bien une étude de la Direction de la prévision : Les évolutions de la politique monétaire se traduisent par des variations des taux directeurs qui se diffusent à l'ensemble des taux d'intérêt. Les mouvements des taux d'intérêt affectent à leur tour les conditions d'équilibre de nombreux marchés ainsi que les revenus et la situation patrimoniale des agents économiques. 1. Le canal du prix des actifs (y compris le canal du taux d'intérêt) Le canal traditionnel des taux d'intérêt Une politique monétaire expansionniste se traduit par une augmentation de l'offre de monnaie qui modère les taux d'intérêt réels d'équilibre sur le marché de la monnaie. Elle réduit le coût du capital pour les entreprises et favorise ainsi une augmentation des dépenses d'investissement dont la profitabilité se trouve améliorée. Par ailleurs, elle modère la charge d'intérêt pour les ménages emprunteurs et soutient donc leur revenu et leur consommation (à épargne inchangée). Ce canal correspond à la conception keynésienne la plus traditionnelle de la politique monétaire, mais joue à la fois sur la demande et sur l'offre. Le canal du taux de change En régime de taux de change flexible et avec mobilité internationale des capitaux, une baisse des taux d'intérêt se traduit toutes choses égales par ailleurs par une dépréciation du taux de change effectif réel de la monnaie nationale. Cette dépréciation soutient les exportations nettes et par conséquent la production globale. Le canal du Q de Tobin Une baisse des taux d'intérêt est susceptible d'avoir un effet favorable sur les cours des actions dans la mesure où le prix d'une action correspond à la valeur actualisée des dividendes futurs. Cette augmentation du prix des actions diminue le coût des fonds propres pour les entreprises et soutient leurs investissements (à l'instar du capital traditionnel mais via un mécanisme différent, la hausse des cours boursiers rendant les émissions d'actions plus attractives). Les effets de richesse La consommation des ménages peut aussi tirer profit d'une baisse des taux d'intérêt : l'augmentation du prix des actifs financiers ou immobiliers résultant d'une baisse des taux d'intérêt augmente la valeur de leur patrimoine et soutient leur consommation. Dans un modèle où les ménages cherchent à lisser leur consommation sur le cycle de vie, ils dépensent plus lorsque leur richesse augmente. 2. Le canal du crédit La présence de contraintes de liquidité peut venir renforcer et amplifier les effets de la politique monétaire. Le canal strict du crédit ou canal du crédit bancaire Dans une économie bancarisée, les changements de taux directeurs modifient les conditions de refinancement des banques sur les marchés financiers. En particulier, un durcissement des conditions de refinancement des banques pèse sur leur activité de création monétaire, sur leur production de crédit à l'économie et donc sur l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Le canal large du crédit ou canal du bilan (théorie de l'accélérateur financier) Les canaux de transmission de la politique monétaire à l'activité réelle dépendent aussi de la qualité de la structure du bilan des agents économiques. Une hausse des taux aura des effets dépressifs sensiblement plus importants si les agents privés sont auparavant déjà très endettés et peu solvables. Ainsi, l'impact défavorable d'un durcissement monétaire sur la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes (canal du taux d'intérêt) et sur le coût de leur capital (Q de Tobin) est renforcé par un redressement de la prime de risque que les banques font peser sur les nouveaux emprunteurs. Les comportements sur les marchés financiers liés à une évolution du risque peuvent accentuer les effets sur l'activité de la politique monétaire. Source : Direction de la Prévision Selon les économistes « keynésiens », ces enchaînements sont efficaces dès lors que l'économie peut se trouver en situation non désirée de sous-emploi. Ils contribuent à hausser le niveau de la demande et par là, l'offre n'étant rationnée que par une insuffisance ex ante de celle-ci, à la dynamisation de l'économie. |
Des travaux plus récents, ainsi que l'observation de l'impact des ajustements de politique monétaire intervenus ces dernières années conduisent à estimer que la contribution potentielle de l'accès des ménages au crédit au rythme de leur consommation est sous-estimée dans les conclusions de l'étude précitée .
Plus généralement, il semble que l'impact des conditions d'accès des ménages au crédit a été longtemps sous-estimé qu'il s'agisse du coût du crédit ou, plus largement, de la capacité des ménages à trouver auprès des systèmes bancaires les liquidités dont ils ont besoin.
Le récent épisode de contraction de l'activité, qui s'est accompagné d'une réaction de politique monétaire contracyclique, inégale selon les grandes zones économiques 37 ( * ) , mais vigoureuse dans l'ensemble, a conduit à porter une attention un peu nouvelle à la contribution du crédit aux ménages à la résistance de l'activité économique .
Celle-ci semble avoir été très disparate, ce qui justifie de se pencher sur les raisons structurelles des écarts constatés .
Les questions à envisager sont parfaitement résumées dans la préface aux Perspectives économiques de l'OCDE de juin 2004, signée par le Chef économiste de l'organisation :
« Par rapport au Royaume-Uni , à l' Australie , au Canada et à certains autres pays n'appartenant pas à la zone euro , les grandes économies d'Europe continentale ont eu beaucoup de difficultés à soutenir la demande en creux du cycle . Au-delà de certaines différences de politique macroéconomique , ces difficultés peuvent être imputables à des facteurs structurels tels que la fragilité du marché du travail en Allemagne, mais aussi à une flexibilité insuffisante des marchés hypothécaires . Outre sa nocivité pour le bien-être économique à long terme, l'incomplétude des marchés hypothécaires a sans doute émoussé l'impact de la politique monétaire ... Ce manque de réactivité des marchés hypothécaires et immobiliers contraste cruellement avec l'expérience des économies les plus résilientes de la zone OCDE où les marchés immobiliers se sont redressés lorsque le reste de l'économie a eu tendance à s'affaisser... » 38 ( * ) .
Dans un récent rapport, la commission des finances du Sénat 39 ( * ) a, quant à elle, souligné la sensibilité de la croissance au cycle immobilier, à partir d'une approche fondée sur la hausse de la valeur des actifs immobiliers, et confirmé les enjeux d'une transmission efficace des baisses de taux d'intérêt aux conditions du crédit aux ménages.
Une baisse des prix immobiliers se traduirait par un « effet de richesse » négatif qui viendrait assombrir les perspectives de croissance. Une étude de l'OFCE annexée au rapport montre en effet que la hausse des prix de l'immobilier constatée ces dernières années a permis de soutenir la croissance.
Pourtant, cette contribution n'a pas été aussi importante qu'ailleurs. Elle s'est appuyée presque exclusivement sur le seul mécanisme des négociations intervenues sur le marché immobilier (l'effet de richesse bénéficierait au vendeur ultime) alors que, dans d'autres pays la valorisation du patrimoine des actifs immobilier des ménages a, en outre, servi de contreparties à l'obtention de crédits, qui ont favorisé le dynamisme de leur consommation.
Un des ressorts déterminants du marché de l'immobilier et, par conséquent, des effets de richesse que l'augmentation du patrimoine immobilier des ménages est susceptible d'engendrer réside dans la détente des conditions d'accès au crédit.
En théorie, celle-ci permet aux ménages d'acquérir des actifs à meilleur compte ou de solvabiliser une demande confrontée à une hausse des prix des actifs. Dans l'un et l'autre cas, le patrimoine immobilier des ménages s'apprécie. Dans la première hypothèse, l'actif immobilier des ménages net de leurs dettes augmente ; dans le second, seul le patrimoine brut progresse. Mais, même dans ce cas, un effet de richesse se produit. Outre les bénéfices que tirent d'une telle évolution les « vendeurs nets », le patrimoine des ménages s'apprécie alors davantage que ne s'alourdissent leurs charges de remboursement périodiques. Par ailleurs, ils sont à même de présenter des contreparties dont la valeur s'est appréciée ce qui favorise l'extraction des liquidités, du moins dans les pays où ces pratiques sont courantes.
Il est donc important de vérifier si ces enchaînements théoriques se produisent et avec quelle ampleur pour identifier les rigidités éventuelles qui les préviennent .
Votre Délégation devrait en ce sens présenter prochainement un rapport consacré à l'accès des ménages au crédit .
D'ores et déjà, on peut constater que , malgré la forte progression des dettes contractées par les Français, ceux-ci sont nettement moins endettés que leurs homologues de l'OCDE .
ENDETTEMENT PAR HABITANT ET EN % DU REVENU DISPONIBLE BRUT (RDB)
|
Endettement par habitant
|
Encours d'endettement
|
|
|
Allemagne Autriche Belgique Danemark (2001) Espagne Finlande France Italie Pays-Bas Portugal (2001) Royaume-Uni 1 Suède |
18 507 10 917 9 812 31 832 9 422 9 266 9 592 5 254 28 301 8 025 23 186 16 293 |
111,5 66,1 60,6 194,2 86,4 72,4 59,4 34,1 198,2 105,2 120,2 113,6 |
|
Europe 2 |
17 963 |
109,6 |
1 Pour les données relatives au Royaume-Uni en euros, nous utiliserons dans tous les tableaux qui suivent le taux de change en fin d'années pour les données de stocks et la moyenne annuelle des taux de change courants pour les données de flux.
2 Moyenne des pays représentés pondérée par les encours d'endettement totaux en 2001.
Source : Comptes nationaux, OCDE
L'endettement par habitant est près de trois fois plus faible qu'au Danemark où il atteint son sommet européen, et encore environ deux fois moindre que pour l'Europe en moyenne .
Le « taux de financement » des ménages français 40 ( * ) confirme la faible place de leur recours au crédit.
Les taux de financement variaient en 2001 du simple (16,7 % au Royaume-Uni) au double (32,9 % aux Pays-Bas) .
TABLEAU DE FINANCEMENT BRUT DES MÉNAGES EN 2001 ET 2002
(en % du revenu disponible brut)
|
Ressources 2001 |
Ressources 2002 |
|||||||
|
Taux
|
Taux de
|
Transf.
|
Taux de finance-ment |
Taux
|
Taux de
|
Transf.
|
Taux de finance-ment |
|
|
Pays-Bas |
15,7 |
17,4 |
- 0,3 |
32,8 |
14,6 |
19,4 |
- 0,5 |
33,5 |
|
Portugal |
10,6 |
13,9 |
3,9 |
28,4 |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
Italie |
15,5 |
2,4 |
7,3 |
25,2 |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
Espagne |
9,8 |
9,8 |
1,8 |
21,4 |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
Belgique |
15,0 |
0,3 |
6,0 |
21,3 |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
France |
15,9 |
2,6 |
0,7 |
19,2 |
16,7 |
3,6 |
0,8 |
21,1 |
|
Allemagne |
15,8 |
1,5 |
1,4 |
18,7 |
16,2 |
1,1 |
1,2 |
18,6 |
|
Finlande |
9,2 |
4,1 |
4,6 |
17,9 |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
Royaume-Uni |
5,7 |
11,2 |
0 |
16,9 |
5,1 |
14,9 |
0,2 |
20,6 |
Source : Comptes nationaux, calculs OEE Études
Il est important d'élucider les causes de ce phénomène.
La diversité des taux de recours au crédit pourrait s'expliquer par les niveaux respectifs des taux d'épargne dans les différents pays. Le faible appel au crédit en France serait ainsi l e résultat du fort taux d'épargne des ménages français . Mais, la corrélation négative entre taux d'épargne et taux de recours au crédit peut jouer en sens inverse : le fort taux d'épargne français pourrait provenir d'un faible recours au crédit.
Plus le recours au crédit est important, moins la contrainte financière pèse sur les ménages , et moins ils ont à réserver une part de leur revenu courant pour financer leurs dépenses futures .
Dans cette perspective, si le constat d'un « sous-endettement » global des Français devait être confirmé par des analyses économiques complémentaires, il serait utile d'entreprendre une politique raisonnée favorisant l'endettement des ménages français .
Cette proposition peut sembler quelque peu « iconoclaste » dans un pays qui s'inquiète de ses dettes et a l'habitude de politiques favorisant l'épargne.
Pourtant, il n'est pas nécessaire de se référer aux exemples étrangers , où des dispositifs publics favorisent souvent l'endettement des ménages, pour se persuader que des politiques publiques sont entreprises pour fléchir le taux d'épargne des ménages français . Le présent rapport a ainsi déjà fait mention des mesures dites « Sarkozy » et on pourrait aussi citer la récente introduction, mesurée, de l'hypothèque rechargeable.
Par ailleurs, il faut dissiper une confusion . L'endettement de l'État (plus généralement de la sphère publique et de certaines entreprises publiques) ne doit pas conduire au constat , qui serait erroné, que la France est endettée . Depuis 1993, notre pays a, au contraire, accumulé une capacité de financement considérable. Elle atteint 12,4 points de PIB. Les agents économiques privés ont plus épargné que les administrations publiques ne se sont endettées . Le retour à une situation plus saine des comptes publics, qui suppose une réépargne publique, n'est viable, du point de vue économique, que moyennant une inversion des comportements des agents privés. Tel est l'un des enseignements de nos projections.
Il est, par conséquent, cohérent d' espérer que les ménages épargnent moins . En théorie, un tel objectif peut être atteint sans recours supplémentaire à l'endettement : il suffirait que la propension des ménages à consommer leur revenu s'élève. Toutefois, un faisceau d'indices conduit à établir un lien entre consommation et recours à l'endettement . En outre, le passage par l'endettement a une vertu qui ne doit pas être négligée : il permet de hausser la propension à consommer sans réduire la capacité de financement des ménages.
3. Questions sur la politique fiscale
Le programme de stabilité à moyen terme comporte un engagement de réduction des prélèvements obligatoires, qui atteindrait 0,6 point du PIB entre 2006 et 2009.
Une composante importante de cet engagement (0,3 point de PIB) porte sur l'aménagement de l'impôt sur le revenu qui, lui-même, consiste en :
une augmentation de la redistribution opérée par le truchement de la prime pour l'emploi (PPE) pour 1 milliard d'euros ;
un allègement de l'impôt sur le revenu, évalué à 3,6 milliards d'euros en 2007.
Toutes choses égales par ailleurs, de telles mesures devraient conforter le revenu des ménages et hausser leur niveau de consommation (via le multiplicateur fiscal), dans des propositions qui dépendent de leur propension à consommer.
La propension à consommer des ménages diffère selon le niveau de leur revenu. Les ménages à faible revenu consomment plus que l'intégralité de celui-ci (du fait d'un recours structurel au crédit) mais, plus on s'élève dans la hiérarchie des revenus, plus la propension à consommer se réduit.
Il importe donc, du moins sous le seul angle de la contribution des allègements fiscaux au dynamisme de la consommation (approche exclusive de l'attention qui peut être légitimement portée aux incitations au travail) de dresser le bilan des bénéfices de ces allègements par catégorie de revenus.
Par définition, la baisse de l'impôt sur le revenu ne bénéficie qu'aux redevables de cet impôt, qui représentent une fraction des ménages. La prime pour l'emploi et son augmentation sont susceptibles de profiter en partie à des ménages non imposables à l'impôt sur le revenu. Mais, au total, la redistribution opérée ne concernera que secondairement les ménages les moins fortunés, qui sont aussi ceux qui, probablement, auraient le plus consommé en supplément de revenu.
En conclusion, les allègements fiscaux entrepris semblent ne pas optimiser le multiplicateur fiscal, autrement dit, les conditions de recyclage dans la consommation des revenus rétrocédés par les administrations publiques.
Il conviendra donc de veiller à ce que les réductions à venir des prélèvements obligatoires qui pourraient atteindre un ordre de grandeur analogue à celui de la réforme de l'impôt sur le revenu prenne mieux en compte cet objectif .
Cette recommandation semble d'autant plus s'imposer que la réduction des prélèvements obligatoires devrait s'accompagner d'une importante flexion des dépenses publiques.
Il convient ici de rappeler ce que doit à la redistribution opérée par les administrations publiques la réduction des inégalités.
ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DES
TRANSFERTS
À LA RÉDUCTION DES ÉCARTS DE REVENU PAR
UNITÉ DE CONSOMMATION
ENTRE DÉCILES EXTRÊMES DES
MÉNAGES SALARIÉS (OU CHÔMEURS)
ENTRE 1975 ET
1996*
(en %)
|
1975 |
1996 |
|
|
Prestations familiales Allocations logement Minima sociaux Impôt sur le revenu Taxe d'habitation Total des transferts |
- 25 - 10 - 4 - 15 + 1 - 42 |
- 27 - 30 - 21 - 14 + 2 - 58 |
Lecture : En 1975, avant transferts, le rapport des revenus initiaux moyens par unité de consommation du dernier décile au premier décile est égal à 9,5. Tenir compte (seulement) de l'impôt sur le revenu réduit ce rapport de 15 %... Tenir compte de l'ensemble des transferts le réduit de 42 % compte tenu d'un rapport interdécile des revenus disponibles par unité de consommation de 5,5 en 1975 (5,5 = 9,5 (1 - 0,42)). La contribution de chaque transfert étant estimée indépendamment à partir du rapport des revenus initiaux, la somme des contributions n'est pas égale à la contribution du total (voir Breuil, 2000).
Note : (*) Les ménages dont le chef est salarié sont classés en fonction de leur revenu initial par uc (revenu d'activité et de remplacement hors revenus de patrimoine).
Source : Conseil d'analyse économique - Rapport n° 33.
IV. PRÉCISIONS SUR QUELQUES ASPECTS DU DÉBAT SUR LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Le débat économique sur les performances de croissance de l'économie française est « embué » par une succession d'approximations qu'il convient de dissiper, car elles obscurcissent la stratégie économique à mettre en oeuvre en brouillant l'ordre des priorités qu'il faudrait respecter 41 ( * ) .
Chacun sent bien que la croissance n'atteint pas le niveau qui pourrait être le sien et qu'elle n'est pas suffisante pour nourrir le revenu national, financer les forces à l'oeuvre dans le système de protection sociale et faire décroître le taux de chômage.
Dans ces conditions, il est légitime de se fixer un objectif de retour à une croissance durablement élevée .
Dans cette perspective, un taux de croissance de 3 % est usuellement mentionné .
Une telle performance écon omique n'est pas hors de portée, comme vient le rappeler l'épisode de forte croissance de la fin des années 90.
Les résultats des projections qu' expose le présent rapport montr ent qu' une croissance à 3 % est envisageable, sous certaines conditions .
Cependant, il est bien exact que cet objectif conduit à poser les questions de savoir comment il peut être atteint et si l'économie française peut croître durablement sur un rythme de 3 % en l'état de son fonctionnement.
Pour tenter de répondre à ces questions, on peut partir de l'analyse de la croissance potentielle .
La croissance potentielle annuelle, a-t-on indiqué, correspond au rythme de croissance qui serait réalisé si le contingent annuel nouveau de population active employable sans tensions inflationnistes était effectivement employé, compte tenu, par ailleurs, des gains de productivité du travail. Une économie connaissant continûment une croissance effective égale à sa croissance potentielle se trouverait produire, à chaque instant, exactement ce qu'elle peut produire. Autrement dit, son niveau de production, son PIB, serait à son niveau potentiel, qui est le niveau maximum de production dans des conditions données d'augmentation de la population active et de la productivité du travail.
Ces dernières conditions doivent être un peu précisées :
- Le niveau des gains de productivité par tête dépend de la durée du travail de chacun et de l'efficacité du système productif.
- Le niveau de population employable sans tensions inflationnistes dépend des effectifs de la population active et des modalités de fonctionnement du marché du travail, tout particulièrement de la formation des salaires.
Les évaluations pour la France de la croissance potentielle varient mais la situent autour de 2 % dans les années qui viennent . Cette valeur peut sembler faible, mais elle est plus élevée que chez pour beaucoup de pays européens , ce qui explique une partie de la « sur-performance » de croissance de notre pays par rapport à nos voisins de la zone euro.
|
POURQUOI LA PERFORMANCE DE CROISSANCE DE LA
FRANCE
Depuis 1997, l'économie française croît à un rythme supérieur de 0,4 point par an à celui de l'ensemble de la zone euro et supérieur de 1 point par an à celui de ses deux principaux partenaires de cette zone (Allemagne et Italie). Ce différentiel s'explique par un facteur conjoncturel et un facteur structurel : - depuis 2003, le taux d'épargne des ménages français a baissé, ce qui a contribué au dynamisme de la consommation, alors qu'une évolution inverse a été constatée en Italie et en Allemagne. L'explication de ce phénomène par la hausse des prix de l'immobilier en France - celle-ci a été faible en Allemagne et en Italie -, vient de trouver plusieurs confirmations économétriques 1 . Il apparaît ainsi que l'immobilier est un puissant canal de transmission de la politique monétaire : la baisse des taux d'intérêt et du coût du crédit rendent solvables nombre de ménages souhaitant acquérir un logement ; cet accès plus simple au crédit injecte des liquidités dans l'économie, ce qui stimule la consommation 2 . Elle stimule également la hausse des prix de l'immobilier : les ménages qui réalisent une partie de leur patrimoine sont ainsi plus riches que ce qu'ils anticipaient et affectent une partie de ces liquidités à la consommation ; les ménages « non vendeurs » ont un sentiment de richesse plus fort, du fait de la hausse des prix de l'immobilier, ce qui se traduit également par une baisse de leur épargne. - de manière plus structurelle, sur la période 1994-2004, la productivité apparente du travail comme l'augmentation de la population active ont été plus fortes en France qu'en Allemagne et en Italie, impliquant un potentiel plus important (cf. tableau ci-dessous). LE POTENTIEL DE CROISSANCE (EN %)
1 Voir notamment Rapport Sénat n° 6 (2005-2006) de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances sur « le marché immobilier français » et l'étude de l'OFCE présentée en annexe. 2 Néanmoins, l'expansion globale du crédit s'accompagne, en France, d'une concentration sur un nombre plus réduit de bénéficiaires contrairement à ce qui se produit dans plusieurs autres pays européens. Par ailleurs, la « recharge hypothécaire » est comparativement très peu développée en France ce qui limite l'impact favorable sur la croissance des taux d'intérêt bas. |
Source
: Synthèse des prévisions
à court terme, octobre 2005.
Service des Études
économiques et de la Prospective du Sénat.
Il faut observer que la croissance effective peut être différente de la croissance potentielle , sous l'effet de chocs économiques notamment. Deux situations doivent être distinguées :
- celle où la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle, ce qui est le cas en France depuis 2001 ;
- celle, inverse, où la croissance effective est supérieure à la croissance potentielle.
Ces deux situations ont des significations différentes mais aussi des propriétés qu'il faut distinguer.
Sous l'angle du diagnostic, il apparaît presque tautologique d'observer que, lorsque la croissance effective n'atteint pas le rythme de croissance potentielle , des moyens de production disponibles , en particulier du travail, ne sont pas employés .
Dans un tel cas, le remède immédiat ne consiste pas à augmenter l'offre de travail disponible. L'action publique peut éventuellement porter sur un meilleur appariement de la demande et de l'offre de travail. Elle peut surtout s'orienter vers la recherche d'une trajectoire de demande qui favorise le retour au rythme de croissance potentielle . La mobilisation des politiques conjoncturelles est alors justifiée dans la mesure de leur capacité à augmenter la demande. D'autres instruments peuvent être employés de nature plus qualitative comme la politique des revenus, la politique commerciale, le réglage du marché du travail 42 ( * ) , la diplomatie économique... Elle peut, enfin, ambitionner d'élargir la gamme d'activités accessibles.
Lorsque la croissance effective excède la croissance potentielle , le raisonnement inverse peut être privilégié. Le rythme de croissance n'est alors tenable que si des moyens de production supplémentaires peuvent être mobilisés, sans tensions inflationnistes, ou si les gains de productivité accélèrent.
En résumé, il faut augmenter la croissance potentielle, ce qui relève de politiques structurelles d'offre. Par ailleurs, la politique économique peut user d'outils conjoncturels visant à infléchir l'activité 43 ( * ) .
Un complément doit être ajouté. Sur moyen-long terme, l'économie connaît des évolutions cycliques. La croissance oscille autour de son rythme potentiel. Cela signifie que, pendant une période plus ou moins longue, la croissance effective peut être supérieure au potentiel sans qu'il faille nécessairement mobiliser des facteurs de croissance supplémentaires par rapport à une situation donnée . Ces épisodes permettent de résorber l'écart de croissance négatif d'une période antérieure. Ils s'achèvent lorsque l'activité a permis de rejoindre le PIB potentiel.
Inversement, des phases où la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle peuvent être nécessaires pour éliminer un excès de demande par rapport à une capacité de production donnée. Dans une telle configuration, une relance de la demande n'a pas d'effets autres que d'augmenter l'inflation et/ou de dégrader le commerce extérieur.
En conclusion, la qualité du diagnostic porté sur la situation conjoncturelle est de la plus haute importance pour adopter des politiques économiques adaptées.
Or, le constat qui, selon votre rapporteur, semble devoir s'imposer est celui d' une économie française dont le niveau de production est inférieur au potentiel , pour des motifs qui ne tiennent pas principalement à une insuffisance des capacités de production comme le chômage et le faible taux d'utilisation des investissements en témoignent, mais à une insuffisance de la demande .
Dans un tel contexte, la priorité devrait être de retrouver une croissance effective qui permette de rejoindre la production potentielle .
Soit un déficit de production de l'ordre de 2,5 points de PIB, une croissance à 2,5 % pendant cinq ans permettrait de combler ce déficit sans tensions. Si la croissance devrait atteindre 3 %, le retard de production de l'économie française serait plus rapidement effacé, en deux ans et demi, à peu près.
Ce n'est qu'après ces échéances que viendrait se poser la question légitime du niveau de la croissance potentielle . Tant que le déficit de croissance accumulé ces dernières années subsiste, il n'apparaît pas prioritaire que les potentialités de croissance de l'économie française soient relevées.
La seule objection concevable à cette conclusion serait que la croissance effective est bridée par les mêmes raisons qui limitent la croissance potentielle. La conviction de votre rapporteur est qu'il faut privilégier le point de vue inverse, selon lequel plus le rythme de croissance effectif sera élevé plus il sera possible d'augmenter la croissance potentielle de notre économie.
|
UNE PROCHAINE AUGMENTATION DE LA CROISSANCE
POTENTIELLE,
Le RESF envisage l'hypothèse, raisonnable , que, dans un futur proche (celui du programme de stabilité à l'horizon 2009), le niveau de la croissance potentielle en France passe des 2 %, auxquels selon lui il se situe, à 3 %. Cette perspective qui, n'est pas précisément étayée, s'offrirait en raison d'une augmentation de la population participant au marché du travail 44 ( * ) et d'un choc de productivité 45 ( * ) , selon un dosage de ces deux composantes qui reste inexpliqué. Le RESF estime que, dans cette hypothèse, la croissance effective viendrait rejoindre le rythme de la croissance potentielle qui serait plus élevé. Mais cette transmission de l'une à l'autre n'est pas explicitée. Elle suppose implicitement que : - l'augmentation du rythme des gains de productivité se transmette aux agents économiques dans des conditions propices à l'augmentation de leur demande, ce qui suppose un partage adapté du surplus de production ; - l'augmentation du taux d'activité permette d'augmenter le taux d'emploi ce qui implique des conditions économiques qui ne sont pas aujourd'hui réunies. Outre les questions relatives à la probabilité d'une augmentation prochaine, le scénario envisagé par le RESF conduit à s'interroger sur le point de savoir comment celle-ci pourrait entraîner une croissance effective, qui, en l'état, est insuffisante pour combler le déficit de croissance accumulé. |
Toute politique économique doit observer une contrainte de rareté. Lorsque la croissance est atone, cette contrainte est redoublée. Il est alors plus difficile d'allouer des moyens nécessaires aux réformes structurelles dont on a besoin ou aux impulsions qu'impliquent, dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de l'innovation, par exemple, des politiques visant à augmenter le potentiel de croissance d'une économie.
En outre, le déficit de croissance a un coût, que les économistes désignent sous le nom d'effets d'hystérèses, associé à la dégradation du capital humain ou à l'obsolescence des techniques installées. Une croissance effective durablement en berne réduit le potentiel de croissance d'une économie .
Il est risqué de promouvoir des politiques visant à augmenter le rythme de croissance potentielle au détriment d'un retour à une forte croissance effective.
Il existe une série de dilemmes entre ces deux politiques dont les horizons temporels ne sont pas les mêmes. A titre d'exemple, l'enrichissement de la croissance en emplois non qualifiés nécessaires pour réduire le chômage est favorable à un retour à une croissance effective plus rapide. Mais, dans la perspective d'une élévation du rythme de la croissance potentielle, ses effets sont plus ambigus. Il évite de subir des effets d'hystérèses qui pèsent sur celle-ci ; en contrepartie, il déforme la structure économique vers des emplois à faible valeur ajoutée peu propices à l'augmentation du niveau des performances de l'économie française.
De la même manière, la hausse du taux de participation au marché du travail permet d'augmenter la population active - ce qui est favorable à la croissance potentielle -, mais, sans modification du rythme de croissance effective, cette augmentation ne crée que du chômage.
Comme souvent, le bon chemin est celui d'une combinaison habile des politiques économiques qui doit pleinement prendre en compte la dimension du temps.
Dans l'esprit de votre rapporteur, la croissance d'aujourd'hui doit permettre l'accélération de la croissance de demain qui supposera des réformes structurelles dont le calendrier ne doit pas être précipité.
A. AFFRONTER LE DILEMME DE LA PRODUCTIVITÉ
L'évolution de la productivité 46 ( * ) est au coeur des évolutions macroéconomiques. Les gains de productivité traduisent en effet l' efficacité globale d'une économie et sa capacité à créer des richesses.
Ainsi, la croissance potentielle de l'économie dépend de l'évolution de la productivité du travail et de celle de la population active.
Mais l'évolution de la productivité indique également la quantité supplémentaire de biens que chaque travailleur est en mesure de produire une année donnée par rapport à l'année précédente.
En ce sens, l'évolution de la productivité détermine, à court terme , le contenu en emplois de la croissance . L'évolution de la productivité détermine aussi l'évolution de la croissance qui permet de stabiliser le chômage . Lorsqu'elle ralentit, la croissance permettant de stabiliser le chômage est plus faible. Quand les gains de productivité accélèrent, il faut une croissance plus rapide pour stabiliser le chômage.
Ces deux aspects de la notion de productivité expliquent certainement que les évolutions récentes de la productivité du travail en France aient suscité des commentaires contradictoires.
Jusqu'à la fin des années 1980, la France a bénéficié de gains de productivité par tête soutenus, supérieurs à ceux que connaissaient les États-Unis (cf. tableau page 85). Ainsi opposait-on un modèle français de croissance « intensif en emploi », c'est-à-dire concentrant l'emploi sur une fraction de la population active très productive, mais au prix d'un chômage élevé, à un modèle américain plus extensif mettant plus l'accent sur le nombre d'emplois que sur leur productivité.
L'évolution des rémunérations individuelles correspondait à ces deux modèles, avec une croissance plus rapide du salaire par tête en France qu'aux États-Unis.
Ce « modèle français » à trois composantes - forte productivité, faibles créations d'emplois, salaires « élevés » 47 ( * ) - s'opposait ainsi au modèle américain - faible productivité, fortes créations d'emplois, bas salaires - et traduisait selon certains, une « préférence française pour le chômage » 48 ( * ) .
Cette opposition n'est plus pertinente depuis le début des années 90 : la France a connu un fort ralentissement de la productivité par tête au moment où celle-ci s'accélérait aux États-Unis.
Ainsi peut-on considérer que la politique française de lutte contre le chômage visant à freiner la substitution du capital au travail non qualifié, puis à partager le travail au moyen de la réduction de sa durée - au total, à enrichir le contenu emplois de la croissance - a connu un succès certain. Mais au même moment la plupart des économistes considèrent, de manière évidente, que si la croissance de long terme était durablement affectée par une moindre progression de la productivité, il en résulterait une moindre progression du niveau de vie par rapport à nos partenaires, notamment les États-Unis. Ainsi, le succès d'une politique publique en réponse à une situation donnée - la pénurie d'emplois - contiendrait-il également une menace à long terme : l' appauvrissement relatif de la France.
L'année 2004 n'a pas contribué à la clarté des discours sur l'évolution de la productivité : cette année a été, pour des raisons conjoncturelles 49 ( * ) , une année de redressement de la productivité, donc « pauvre en emplois » 50 ( * ) , mais dans une tendance globale de ralentissement de la productivité.
Les analyses se sont ainsi en quelque sorte télescopées, les unes pour souhaiter une croissance « plus riche en emplois » , les autres, au contraire, pour regretter le décrochage tendanciel de la productivité française par rapport aux États-Unis.
Cette confusion montre l'importance qu'il y a, dans une réflexion sur la croissance à moyen terme, à dresser un constat sur les origines du ralentissement de la productivité au cours des années 90 (1) : est-il exclusivement un effet des politiques d'enrichissement de la croissance en emploi, et à ce titre de nature transitoire, ou résulte-t-il d'évolutions plus profondes comme l'incapacité à tirer parti des nouvelles technologies ou une efficacité médiocre de l'organisation de la production ?
Ce retour sur le ralentissement de la productivité au cours des années 1990 permettra ainsi d'apporter des éléments de réflexion pour le moyen terme (2).
Votre Rapporteur reviendra enfin sur des travaux
présentés par votre Délégation, concernant l'impact
de certaines politiques publiques, et plus particulièrement de la
politique en matière de recherche et développement, sur
l'évolution de la productivité et de la croissance potentielle
à
long terme
(3).
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA
PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE :
LE
« DÉCROCHAGE » DE LA FRANCE PAR RAPPORT AUX
ÉTATS-UNIS
|
1983-1990 |
1990-1995 |
1995-2000 |
1995-2001 |
|
|
France
|
2,48
|
1,01
|
0,91
|
0,65
|
Source
: France : INSEE
États-Unis : BLS, BEA et calculs INSEE
1. Retour sur le ralentissement de la productivité au cours des années 9051 ( * )
• La productivité par tête ralentit depuis 20 ans
Dans l'ensemble des branches marchandes non agricoles, la
productivité par tête a augmenté de 2,5 % par an en
moyenne entre 1983 et 1990, de 1 % entre 1990 et 1995 et 0,6 %
seulement de 1995 à 2002.
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS DE LA PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE
(en %)
|
Productivité par tête |
1983-1990 |
1990-1995 |
1995-2002 |
|
Industrie
|
3,5
|
3,8
|
3,1
|
Source : INSEE, comptes nationaux.
• Dans l'industrie, les gains de productivité restent soutenus.
Comme on peut l'observer dans le tableau ci-dessus , la productivité par tête dans l'industrie s'est accélérée au début de la décennie (+ 3,8 % par an entre 1990 et 1995, contre + 3,5 % entre 1983 et 1990). Le ralentissement observé depuis 1995 reste modéré (+3,1 % par an entre 1995 et 2002).
La productivité dans l'industrie manufacturière ne connaît pas d'infléchissement net dans la seconde moitié de la décennie 90. Par ailleurs, le diagnostic d'un « décrochage » par rapport aux États-Unis ne s'applique pas à l'industrie manufacturière (cf. tableau ci-dessous ), quelles que soient les périodes considérées. Néanmoins, la tendance d'évolution plus favorable de la productivité dans l'industrie manufacturière en France par rapport aux États-Unis masque des évolutions divergentes : aux États-Unis, le rythme de la productivité horaire résulte d'une croissance forte de la valeur ajoutée ; en France, la réduction massive d' heures travaillées assure comptablement le maintien des gains de productivité.
L'augmentation de la productivité dans l'industrie manufacturière française y apparaît ainsi de nature plus « défensive ».
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ DANS
L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
AUX ÉTATS-UNIS ET EN
FRANCE
(Taux de croissance annuels moyens en %)
|
1983-2000 |
1983-2001 |
1990-2000 |
1990-2001 |
|||||
|
France |
États-Unis |
France |
États-Unis |
France |
États-Unis |
France |
États-Unis |
|
|
Productivité horaire apparente |
4,4 |
3,4 |
4,4 |
3,2 |
4,6 |
3,8 |
4,5 |
3,5 |
|
Valeur ajoutée en volume |
2,6 |
3,6 |
2,6 |
3,1 |
2,4 |
3,6 |
2,5 |
2,7 |
|
Volume d'heures travaillées |
- 1,6 |
0,2 |
- 1,8 |
- 0,1 |
- 2,2 |
- 0,2 |
- 2,1 |
- 0,8 |
|
Nombre d'emplois
|
- 1,7 |
0,0 |
- 1,5 |
- 0,3 |
- 1,7 |
- 0,3 |
- 1,5 |
- 0,8 |
|
Productivité par tête apparente |
4,2 |
3,6 |
4,1 |
3,3 |
4,1 |
4,0 |
3,9 |
3,5 |
Le ralentissement de la productivité par tête dans l'ensemble de l'économie française semble donc essentiellement le fait des services marchands .
Les évaluations sectorielles de la productivité restent cependant extrêmement fragiles, compte tenu de la difficulté de mesurer la production et, donc la productivité, dans les services.
• La productivité horaire a moins ralenti que la productivité par tête
La productivité par tête est mesurée à partir du nombre de personnes impliquées dans la production. Cette mesure mélange ainsi un effet quantité -la variation de la durée du travail - à des effets qualité - la variation de l'efficacité d'une heure de travail.
Depuis vingt ans, l'effet quantité - variation de la durée du travail - est important et explique une partie de la baisse de la productivité par tête.
Le développement du temps partiel contribue à cet écart entre productivité par tête et productivité horaire. En effet en 2001, les actifs occupés travaillaient en moyenne 94,5 % d'un temps complet, contre 95,1 % en 1995, 96,7 % en 1990 et 97,1 % en 1983, ce qui traduit le développement du temps partiel depuis 20 ans, particulièrement dynamique au début des années 90.
Une productivité calculée par équivalent temps plein est ainsi plus élevée que la productivité par tête de 0,1 point par an entre 1983 et 1990, 0,3 point par an de 1990 à 1995 et 0,1 point de 1995 à 2001.
Mais, l' essentiel de l'écart entre productivité horaire et productivité par tête résulte de la baisse de la durée du travail liée à la mise en oeuvre des lois Aubry .
Une fois prise en compte cette baisse de la durée du travail, la productivité horaire ralentit certes au début des années 1990, mais moins sensiblement que la productivité par tête : son taux de croissance annuel moyen passe de 2,4 % sur la décennie 1983-1990 à 1,6 % sur la période 1990-1995, puis accélère légèrement depuis 1995 (1,8 %) (cf. tableau ci-après ).
ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA
PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE
ET DE LA PRODUCTIVITÉ
HORAIRE
(en % par an)
|
1985-1995 |
1995-2005 |
1995-2002 |
|
|
Productivité par tête SMNA* |
1,6 |
1,1 |
0,6 |
|
Productivité horaire SMNA |
2,4 |
1,6 |
1,8 |
*SMNA : ensemble des branches marchandes non
agricoles
Source
: INSEE.
• Les politiques de l'emploi ont contribué à enrichir significativement le contenu en emplois de la croissance
Deux facteurs ont contribué au ralentissement des gains de productivité par équivalent temps plein 52 ( * ) depuis 1990 (ou à l'enrichissement du contenu en emplois de la croissance, ce qui revient à dire la même chose) :
- l'INSEE estime que les allègements de charges sur les bas salaires, grâce à leur impact sur le coût relatif des non-qualifiés auraient pu se traduire entre 1992 et 2000 par une baisse de la productivité apparente du travail de 2 %, correspondant à la création ou à la préservation d'environ 330.000 emplois . Il s'agit là selon l'INSEE, « d'un effet toutes choses égales par ailleurs, qui ne distingue pas les allègements de charge des années 1992-1998 de ceux qui ont accompagné la mis en place de la RTT ;
- l'évolution de la productivité a été fortement déterminée par la mise en place de la RTT . Celle-ci a eu deux effets. Un effet dominant est l'effet direct sur la productivité par tête : il aurait été proche de -6 % sur la période 1996-2002 selon l'INSEE (soit -0,8 point environ de productivité par an). Un effet indirect résulte de l'accroissement du coût horaire moyen du travail consécutif à la mise en oeuvre de la RTT, ce qui incite les entreprises à économiser le facteur travail et à rechercher des gains de productivité. L'INSEE observe effectivement une augmentation de la contribution positive de l'évolution du coût horaire du travail à l'évolution de la productivité sur la période 1996-2001, par rapport aux périodes antérieures. Cet effet « coût du travail » a donc amoindri l'effet direct de la baisse de la durée de travail sur l'enrichissement du contenu en emplois de la croissance.
Toutefois, ces deux effets - allégements des charges et RTT -, ne suffisent pas à expliquer totalement le ralentissement de l'évolution de la productivité depuis le début de la décennie 1990.
Ceci conduit à envisager l' hypothèse d'un ralentissement « exogène » des gains tendanciels de la productivité du travail. Celui-ci pourrait résulter de facteurs communs à l'ensemble des pays développés. La France, et l'Europe plus globalement, est entrée à partir des années 1990 dans une phase d'achèvement du processus de rattrapage technologique de l'économie américaine. Sa productivité doit par conséquent ralentir et rejoindre la tendance d'évolution de la productivité américaine.
Ce diagnostic est cependant compliqué par la récente accélération de la productivité aux États-Unis. Mais celle-ci ne contredit pas l'explication du ralentissement de la productivité en France par la fin du rattrapage technologique des États-Unis, si l'on considère que l'accélération récente de la productivité américaine résulte des effets positifs des NTIC dont la France n'a pas encore pleinement profité.
2. Quelle productivité à moyen terme ?
Lorsqu'on construit un scénario à moyen terme à l'aide d'un modèle, il faut fixer préalablement une hypothèse d'évolution de la productivité du travail.
L'hypothèse de productivité retenue dans les exercices présentés dans ce rapport - 1,7 % par an - suppose une prolongation des évolutions de productivité constatées sur la période 1995-2003, hors effets de la baisse de la durée du travail et des allègements de cotisations sur les bas salaires.
Cette hypothèse s'appuie sur l'absence de visibilité à moyen terme concernant ces deux aspects de la politique de l'emploi :
• s'il est prudent d'exclure une nouvelle baisse de la durée du travail, il est aussi délicat de simuler dans quelles conditions une hausse de la durée du travail pourrait se produire : sans compensation salariale avec baisse du salaire horaire (« 36 heures payées 35 ») et avec compensation salariale et salaire horaire inchangé (« 36 heures payées 36 ») ? Avec rémunération au tarif des heures supplémentaires et donc hausse du salaire horaire ?
• de même, l'impact en termes de « contenu en emplois de la croissance », des nouveaux dispositifs d'allègement de charges mis en oeuvre par la loi Fillon et des réformes plus récentes du marché et du droit du travail (plan Borloo, contrats nouvelle embauche, amélioration du régime de la prime pour l'emploi) est difficile à apprécier. Globalement, les coûts des entreprises sont légèrement dégradés par la hausse du SMIC qui, en moyenne 2003-2005, a été plus généreuse que celle qui aurait eu lieu sans l'harmonisation du SMIC.
Les allègements de cotisations mis en oeuvre ces dernières années illustrent des politiques publiques évolutives (accompagnement du partage du travail, puis compensation de l'augmentation des coûts du travail) mais qui, en concernant surtout les non-qualifiés (par rapport à celui des salariés qualifiés) pourraient être favorables à la substitution peu qualifiés/qualifiés.
Toutefois, la prise en compte des réformes apportées au régime de la durée du travail conduisent à considérer, pour le moyen terme, que l'impact de ces mesures devrait être neutre sur la productivité (et le contenu en emplois de la croissance).
Ainsi, on a retenu une hypothèse d'évolution de la productivité sur 2005-2010 de 1,7 % par an, en nette accélération par rapport à la période 1995-2003 (+0,6 % par an).
Cette accélération de la productivité à moyen terme, qui rapprocherait la France des évolutions enregistrées aux États-Unis sur les dix dernières années, permettrait de soutenir la croissance potentielle de l'économie française et de compenser le ralentissement de l'augmentation de la population active à partir de 2007.
Enfin, même si cette hypothèse n'a pas été prise en compte en projection, il ne semble pas irréaliste d'espérer que la France pourrait à son tour, après les États-Unis, profiter des effets positifs des TIC, ce qui ramènerait la productivité sur sa trajectoire antérieure aux années 1990.
Au total, il semble bien aussi prématuré qu'exagéré de redouter un « décrochage » durable de la France en matière de productivité.
B. L'IMPORTANCE DE LA MODÉRATION SALARIALE
Une des questions posées par les projections est de savoir si la baisse du chômage à moyen terme qu'elles comportent est compatible avec une inflation stable.
Compte tenu de la croissance simulée dans le scénario central (2,25 % par an), de l'hypothèse d'évolution de la productivité par tête (1,7 % par an dans le secteur marchand) et de l'augmentation de la population active (+ 0,3 % par an en moyenne sur la période 2006-2010 contre 0,6 % par an en moyenne sur 1996-2005 53 ( * ) ), le taux de chômage diminue de 0,6 point par an (soit environ 120.000 chômeurs de moins chaque année) et reflue à 7,2 % en 2010.
Dans le même temps, l'inflation est stable sur la période (+ 1,6 % par an pour les prix de la consommation, soit une faible accélération par rapport à celle de la période 1996-2005).
Depuis les travaux de PHILLIPS en 1958, la liaison entre inflation et baisse du chômage est une des bases de l'analyse macroéconomique. Un demi-siècle plus tard, les débats entre économistes sur la nature et la pertinence de ce dilemme inflation-chômage sont toujours extrêmement nourris, mais finalement assez peu conclusifs.
Cette question peut être présentée aujourd'hui dans les termes suivants :
- il existe un niveau du chômage en dessous duquel apparaissent des tensions sur le marché du travail, des difficultés de recrutement et donc des revendications qui tendent à accélérer l'évolution des salaires et des prix ; ce niveau de chômage « accélérateur d'inflation » 54 ( * ) est actuellement estimé pour la France par la plupart des institutions économiques (OCDE ou Direction de la prévision) autour de 9 %. Donc, en première analyse, on pourrait craindre que le passage du chômage effectif en dessous de ce seuil n'entraîne des tensions inflationnistes ;
- néanmoins, les estimations de ce niveau de chômage « accélérateur d'inflation » - ou NAIRU - varient selon les époques : ainsi observe-t-on finalement que le NAIRU baisse lorsque le chômage effectif diminue ;
- par ailleurs, les périodes où le chômage effectif est passé au-dessous du seuil de l'estimation du NAIRU sont malheureusement trop rares et trop courtes pour en tirer des conclusions sur la robustesse de cette estimation ;
- enfin, la période 1998-2001 a montré qu'une forte baisse du chômage, bien en dessous des 10 % qui correspondaient à l'estimation du NAIRU en 1998, n'a pas entraîné de tensions inflationnistes.
Qu'en conclure pour le moyen terme ? Tout d'abord, que les mesures du niveau de chômage « accélérateur d'inflation » sont certainement valides à court terme, mais qu'elles ont néanmoins peu de sens pour le moyen terme. On en sait trop peu, en effet, sur le niveau du chômage d'équilibre pour en déduire dans quelle mesure une forte baisse du chômage pourrait engendrer à un horizon de cinq ans, une accélération de l'inflation.
Néanmoins, on perçoit a contrario que la compatibilité entre baisse du chômage et relative stabilité des prix, privilégiée dans cette projection, constitue aussi une incertitude de ce scénario .
Celui-ci suppose que l'économie pourra s'adapter à une baisse prolongée du chômage, et, ainsi, éviter des tensions sur le marché du travail.
Cela passe par une modération salariale 55 ( * ) à l'instar de la période 1998-2001 mais aussi par l'approfondissement des politiques visant à favoriser la rencontre entre les besoins et l'offre de travail. A cet égard, la fluidité du marché du travail doit être améliorée au moyen de politiques facilitant la mobilité géographique - la prime de déménagement est une bonne mesure en ce sens - et de politiques de formations, initiale et continue, plus performantes.
CHAPITRE III - FINANCES PUBLIQUES : LES ENSEIGNEMENTS DES PROJECTIONS ET DES TENDANCES RÉCENTES
Les projections sont construites sous l'hypothèse que la politique des finances publiques présentée par le Gouvernement dans le programme de stabilité à l'horizon 2009 serait appliquée.
Cette politique de réduction graduelle du déficit structurel repose principalement sur une volonté de maîtrise des dépenses publiques , mais aussi sur un engagement de baisse du taux des prélèvements obligatoires .
ÉVOLUTION DU SOLDE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
SCÉNARIO BAS ET HAUT
(en points de PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
Scénario
|
Déficit public |
-2,9 |
-2,7 |
- 2,1 |
- 1,4 |
|
Variation du coût structurel |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
||
|
Scénario haut |
Déficit public |
-2,9 |
-2,2 |
-1,3 |
-0,1 |
|
Variation du coût structurel |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
Source : Rapport économique, social et financier (PLF 2006)
PROGRESSION MOYENNE DES DÉPENSES PUBLIQUES*
(en volume par an)
|
Programmation 2007-2009 |
|
|
Dépenses publiques |
0,9 % |
|
Dont |
|
|
État (en comptabilité budgétaire) |
-1,5 % |
|
Administrations de Sécurité sociale |
1,2 % |
|
Collectivités locales |
1,5 % |
*
Scénario à 2,25 % de
croissance.
Source
: Rapport économique, social et
financier (PLF 2006)
ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
(en points de PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
Source : Rapport économique, social et financier (PLF 2005)
L' augmentation en volume des dépenses publiques serait contenue à 0,9 % par an , avec une réduction des dépenses de l'État de l'ordre de 1,5 % par an, une progression de 1,2 % des dépenses sociales et de 1,5 % pour celles des collectivités locales.
Le rythme de croissance des dépenses publiques serait ainsi nettement inférieur à celui de la croissance potentielle de l'économie, qui est estimée au cours de la période à 2 %.
Une telle configuration s'accompagne, sur le terrain économique , d' une impulsion budgétaire négative , sauf si les prélèvements obligatoires viennent plus que contrecarrer l'orientation donnée aux dépenses publiques.
Dans la programmation des finances publiques, tel est bien le cas. Mais, la réduction de la part des prélèvements obligatoires dans le PIB, pour être importante (-0,6 point), est sensiblement inférieure à celle des dépenses publiques, si bien que la programmation des finances publiques à moyen terme devrait , si elle était respectée, se traduire par une contribution à la croissance négative du solde des transferts entre administrations publiques et agents privés (ménages et entreprises) .
Le différentiel entre l'augmentation prévue des dépenses publiques et la croissance potentielle provoquerait , ainsi, une amélioration structurelle des comptes publics que viendraient toutefois modérer les baisses discrétionnaires d'impôts. Le solde structurel se redresserait de 1,1 point de PIB sur la période 2007-2009 (de 2,1 points dans un scénario haut) pour être ramené à 1,6 point de PIB contre 2,7 points en 2006.
En outre, comme la croissance prévue , avec 2,25 % l'an, est supérieure à la croissance potentielle telle qu'elle est usuellement estimée, la conjoncture entraîne , en soi, une réduction du besoin de financement public pour environ 0,4 point de PIB .
Au total , le solde public se redresse de 1,5 point dans la programmation du Gouvernement et de 2 points, mais à l'horizon 2010, dans les projections de votre Délégation.
Les objectifs de la gestion financière publique reposent sur l'hypothèse qu'en dépit d'une baisse du soutien public aux agents économiques, ceux-ci adopteront des comportements situant la croissance assez nettement au-dessus de son potentiel.
Les projections des finances publiques ici présentées ne remettent pas en question ces résultats dont on a élucidé plus haut les conditions.
Mais, des variantes ont été réalisées pour mettre en évidence leurs conditions de réalisation.
I. LES PROJECTIONS METTENT EN ÉVIDENCE LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA TRAJECTOIRE D'AJUSTEMENT DES COMPTES PUBLICS
Malgré quelques écarts dus à des hypothèses légèrement différentes, les projections réalisées pour le présent rapport sont en ligne avec les orientations du programme de stabilité à moyen terme présenté par la France dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance .
Les conditions de succès des objectifs de ce programme apparaissent exigeantes, d'autant que celui-ci met un accent particulier sur la réduction du poids des dépenses publiques.
A. LES RÉSULTATS DES PROJECTIONS SONT EN LIGNE AVEC LE PROGRAMME DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE DU GOUVERNEMENT.
Axé sur la réduction du déficit structurel , le programme de stabilité à l'horizon 2009 diffère sensiblement de ses devanciers en comportant une réduction prononcée des dépenses publiques . Les projections entérinent ce choix et le prolongent jusqu'en 2010.
Une variante montre qu'un surcroît de croissance permettrait d'atteindre les objectifs fixés en matière de solde public, sous des conditions d'évolution des dépenses publiques moins strictes.
1. Le programme de stabilité à horizon 2009
a) Un objectif traditionnel de retour graduel à l'équilibre...
Le programme de stabilité à horizon 2009 notifié par le Gouvernement se résume dans les graphiques ci-dessous portant, respectivement, sur le déficit public et la dette publique.
DÉFICIT PUBLIC
(en points de PIB)
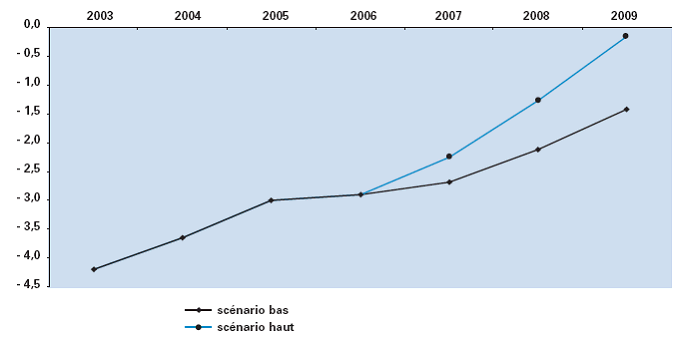
Source : Rapport économique, social et financier (PLF 2006)
Il comporte deux scénarios :
- un scénario, qualifié de « bas » 56 ( * ) , où la croissance atteindrait 2,25 % par an et l'effort d'ajustement structurel des comptes publics serait de 0,4 point par an ;
- un scénario dit « haut » où la croissance atteindrait 3 % en moyenne avec une réduction du déficit structurel de 0,7 point, l'an, supérieure à ce qu'il serait dans le premier scénario.
Par souci de simplicité, mais aussi de réalisme, on se calera principalement sur le « scénario bas » pour exposer les enchaînements prévus par le Gouvernement. En effet, même s'il est jugé « raisonnablement envisageable » dans le rapport économique, social et financier (RESF) joint au projet de loi de finances pour 2006, le scénario « haut » du programme de stabilité apparaît devoir être discuté dans sa vraisemblance et son opportunité.
Le besoin de financement des administrations publiques régresserait et atteindrait 1,4 point de PIB en 2009 (0,2 point dans l'hypothèse d'une croissance à 3 % l'an) 57 ( * ) .
Comme c'est la tradition, le retour vers l'équilibre financier est la tendance décrite par le programme.
Dans le « scénario bas » du moins, il s'opère essentiellement par un effort d'ajustement structurel des comptes publics et, en fin de période, le déficit structurel atteint environ 1,6 point de PIB .
|
I- Détermination du solde structurel Le solde des administrations publiques est affecté par la position de l'économie dans le cycle. On observe ainsi un déficit de recettes et un surplus de dépenses (notamment celles qui sont liées à l'indemnisation du chômage) lorsque le PIB est inférieur à son niveau potentiel et, à l'inverse, un surplus de recettes et une diminution des dépenses lorsqu'il lui est supérieur. L'indicateur usuel de solde structurel vise à corriger le solde public effectif de ces fluctuations liées au cycle. La méthode d'évaluation du solde structurel consiste à calculer, en premier lieu, la partie conjoncturelle du solde public, c'est-à-dire celle qui s'explique par la conjoncture, selon une méthodologie largement commune aux organisations internationales. En pratique, ce calcul repose notamment sur l'hypothèse que les recettes conjoncturelles évoluent au même rythme que le PIB, et que les dépenses - à l'exception notable des allocations chômage - ne sont pas sensibles à la conjoncture. Le solde structurel est ensuite calculé comme un « résidu », par différence entre le solde effectif et sa partie conjoncturelle. Cet indicateur constitue une référence internationale pour l'appréciation de l'orientation des politiques budgétaires. Une fois les effets de la conjoncture éliminés, on retrouve dans les évolutions du solde structurel : - l'effort de maîtrise de la dépense, mesuré par l'écart entre la progression de la dépense et la croissance potentielle : lorsque la dépense publique croît moins vite que la croissance potentielle, cela correspond bien à une amélioration structurelle des finances publiques ; - les mesures nouvelles concernant les prélèvements obligatoires. II- L'effort structurel Cependant, à côté de ces facteurs effectivement représentatifs de l'orientation de la politique budgétaire, le solde structurel en recouvre d'autres, sans doute moins pertinents : - Le solde structurel est affecté par des « effets d'élasticité » des recettes publiques. L'hypothèse, en pratique, d'élasticité unitaire des recettes au PIB 58 ( * ) , retenue dans le calcul du solde conjoncturel, n'est en effet valable qu'à moyen-long terme. À court terme en revanche, on observe des fluctuations importantes de cette élasticité. Pour l'État par exemple, l'amplitude de l'élasticité apparente des recettes fiscales est forte, du fait notamment de la variabilité de l'impôt sur les sociétés : l'élasticité des recettes fiscales nettes peut ainsi varier entre zéro et deux. Retenir l'hypothèse d'une élasticité unitaire revient donc à répercuter entièrement en variations du solde structurel les fluctuations de l'élasticité des recettes, alors même que ces fluctuations s'expliquent largement par la position dans le cycle économique. L'interprétation des variations du solde structurel s'en trouve donc sensiblement brouillée. - D'autres facteurs peuvent également intervenir comme les variations des recettes hors prélèvements obligatoires (les recettes non fiscales de l'État, par exemple). Par construction, ces évolutions n'étant pas tenues pour « conjoncturelles » viennent affecter le solde structurel. Afin de s'en tenir aux facteurs dont la nature structurelle est le mieux établie, on peut donc retirer du solde structurel les effets d'élasticité et les recettes hors prélèvements obligatoires. L'indicateur qui en résulte, que l'on peut qualifier d'« effort structurel » ou de « variation discrétionnaire du solde structurel » retrace les seuls effets de maîtrise des dépenses et de mesures nouvelles de prélèvements obligatoires décidées par les pouvoirs publics. L'écart entre l'indicateur de variation du solde structurel et celui de l'effort structurel peut être important. Source : d'après le Rapport économique, social, et financier, annexé au projet de loi de finances pour 2004. |
Les projections macroéconomiques du « scénario bas » sont prudentes puisque la croissance n'y excède que pour le potentiel de croissance prévisible pour la période. Au terme de la projection, le « déficit de croissance » accumulé par l'économie française n'est que très partiellement résorbé. Aujourd'hui, de l'ordre de 2,5 % du PIB, il est ramené à 1,75 % de PIB en 2009. Ainsi, la composante structurelle de l'amélioration des comptes publics décrites dans le scénario est minime, limitée à 0,4 point de PIB.
La dette publique connaîtrait un repli modéré , de 1,2 point de PIB par rapport au niveau atteint en 2005 (65,8 % du PIB), et de 1,4 point par rapport à 2006.
ÉVOLUTION DE LA DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en points de PIB)
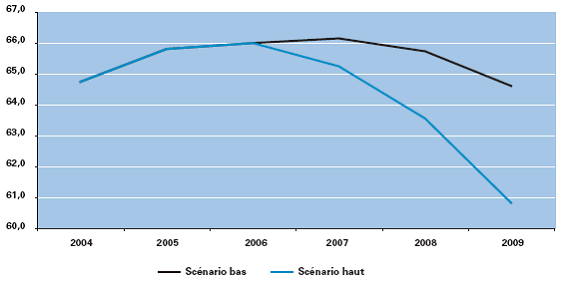
b) ... dans le cadre d'une gestion de finances publiques évoluant sensiblement dans ses composantes...
Le programme de stabilité à horizon 2009 contraste nettement avec le précédent programme 2006-2008 .
Malgré un objectif de réduction du déficit structurel un peu inférieur (-1,5 point au cours de la période 2006-2009 contre -2 points dans le précédent programme), la contrainte de maîtrise des dépenses publiques y est plus forte (une augmentation en volume de 0,9 % contre 1,2 %).
Ce supplément « d'effort » est rendu nécessaire par les engagements sur les prélèvements obligatoires . Dans le précédent programme, le taux de prélèvements obligatoires restait inchangé, à 43,7 points, alors qu'il devrait baisser de 0,6 point de PIB sur la période 2007-2009 pour se situer à 43,4 points de PIB à cette échéance.
Enfin, la cible de solde public nominal est moins rigoureuse que dans la programmation financière précédente , avec un besoin de financement de 1,4 point de PIB en 2009 contre 1 point en 2008.
Retardée, la réduction du déficit public est aussi moins importante. Cela tient, pour l'essentiel, à une plus faible décrue de la composante structurelle du déficit public 59 ( * ) (0,4 point de PIB par an contre 0,5 point dans le programme précédent.
PRINCIPAUX AGRÉGATS DE FINANCES
PUBLIQUES
DANS LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE (2005-2009)
(Scénario à 2,25 % de croissance - en points de PIB)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Capacité de financement |
- 3,0 |
- 2,9 |
- 2,7 |
- 2,1 |
- 1,4 |
|
Dette publique |
65,8 |
66,0 |
66,1 |
65,7 |
64,6 |
|
Dépenses publiques |
53,8 |
53,6 |
53,1 |
52,3 |
51,5 |
|
Progression en volume |
1,7 % |
1,6 % |
1,2 % |
0,8 % |
0,6 % |
|
Prélèvements obligatoires |
43,9 |
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
La décrue du poids des dépenses publiques dans le PIB (-2,1 points) est plus importante que celle du besoin de financement ( -1,5 point entre 2006 et 2009 ). En effet, le taux de prélèvements obligatoires se replierait de 0,6 point de PIB, notamment sous l'effet des mesures déjà annoncées.
ÉVOLUTION DU SOLDE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(Scénario à 2,25 % de croissance - en points de PIB)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Déficit public |
- 3,0 |
- 2,9 |
- 2,7 |
- 2,1 |
- 1,4 |
|
Variation du solde structurel |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
La réduction du besoin de financement proviendrait pour 1,1 point de PIB d'une amélioration du solde structurel. L'écart positif entre la croissance projetée (2,25 % l'an) et l'estimation de croissance potentielle (2 % par an) conduisant à estimer à environ 0,4 point de PIB la composante conjoncturelle , et donc non pérenne, de l'amélioration du solde public.
c) ...ce qui n'est pas sans d'importantes conséquences
Le trait saillant de la programmation du Gouvernement réside dans une réduction du poids de la sphère publique beaucoup plus nette que celle décrite dans les précédents programmes de stabilité .
Son vecteur principal est la baisse de la place occupée par les dépenses publiques dans la richesse nationale.
Elle autoriserait un allègement du taux des prélèvements obligatoires.
Dans leurs détails, ces orientations traduisent , d'une part, des prévisions de croissance de certaines dépenses publiques associées à des hypothèses techniques , et , d'autre part, l'engagement de mettre en oeuvre des mesures discrétionnaires visant la maîtrise des dépenses publiques .
Tant la probabilité des hypothèses techniques que l'ampleur des mesures volontaristes envisagées sont discutées plus loin dans le rapport mais, à ce stade, on peut noter :
- que les hypothèses techniques concernant certaines dépenses publiques supposent une inflexion sensible des dynamiques tendancielles qui sont les leurs ;
- et que le volontarisme budgétaire sous-jacent au programme de stabilité exigera des gains de productivité de la sphère publique , qui peuvent sembler difficiles à obtenir sans un « redimensionnement » de l'intervention publique pouvant aller très au-delà d'une simple amélioration de la gestion publique .
Il vaut, en tout cas, d'être relevé que les engagements pris sur les prélèvements obligatoires apparaissent correctement gagés , du moins en théorie, par des perspectives de baisse des dépenses publiques .
Sur le plan macroéconomique, le choix d'un ajustement structurel des comptes publics entraîne en soi un ralentissement par rapport à un choix de neutralité de la politique budgétaire ( v. infra ). Par ailleurs, ses modalités ne sont pas sans incidences sur la croissance envisageable.
Selon le modèle de l'OFCE, la portée restrictive d'un ajustement structurel est d'autant plus forte qu'il passe davantage par une restriction des dépenses publiques .
Dans la programmation à moyen terme, tel est le cas puisque la diminution programmée du taux des prélèvements obligatoires suppose un effort particulier de flexion des dépenses publiques.
Une variante a été réalisée par l'OFCE afin d' illustrer les effets d'un dosage différent de l'ajustement structurel où le taux des prélèvements obligatoires (PO) serait stabilisé à partir de 2008 .
IMPACT D'UN AJUSTEMENT STRUCTUREL
IDENTIQUE À
CELUI DU COMPTE CENTRAL,
MAIS AVEC UNE STABILISATION DU TAUX DE PO À
PARTIR DE 2008
(en volume, en %)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Croissance du PIB |
2,25 |
2,4 |
2,35 |
2,25 |
|
Dépenses des administrations publiques |
1,2 |
1,2 |
0,8 |
0,6 |
|
Variation du taux de PO (en points de PIB) |
-0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde public (en points de PIB) |
-2,8 |
-2,2 |
-1,5 |
-0,7 |
|
Variation solde structurel* |
0,2 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
|
Variation solde conjoncturel |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
* calculé hors effet des charges
d'intérêts
Source
: calculs OFCE
En variante, le taux de prélèvement obligatoire, qui diminue dans le compte central respectivement de 0,2 et 0,1 point de PIB en 2008 et 2009, est stable sur la période 2008-2010 dans cette variante. En contrepartie, la dépense publique peut croître légèrement plus vite à objectif inchangé de solde public.
Or une augmentation des dépenses publiques, financée par une hausse des prélèvements obligatoires, a au total un effet positif sur le PIB 60 ( * ) .
Le surplus de croissance engendré par le supplément des dépenses publiques en 2008 et 2009 permet une réduction plus prononcée du déficit public de 0,2 point de PIB à l'horizon de la prévision .
Le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2006 brouille un peu l'analyse de la politique des dépenses publiques. En effet, il évoque l'éventualité « raisonnable » d'une assez nette augmentation du niveau de la croissance potentielle sur la période 2007-2009. « Cependant, avec la mise en oeuvre des politiques engagées par le gouvernement pour le soutien structurel à la croissance - tant en matière de mobilisation de l'emploi que d'incitation à l'innovation -, il est raisonnablement permis d'escompter une augmentation de la croissance potentielle, qui approcherait 3 % en 2009 61 ( * ) » .
Il faut souligner que si tel devait être le cas, l'ajustement structurel des comptes publics serait nettement plus fort même en s'en tenant aux orientations de gestion publique retenues dans le scénario d'une croissance à 2,25 % l'an. La composante structurelle du déficit public se réduirait de 1,9 point contre 1,1 point. En revanche, l'écart entre une croissance effective à 2,25 % l'an et la croissance potentielle de 2,75 % creuserait la composante structurelle du solde public à objectif inchangé d'un déficit de 1,4 point de PIB à l'horizon 2009.
2. Les résultats des projections
Les résultats des projections sont en ligne avec la programmation pluriannuelle du Gouvernement.
a) Les résultats du « scénario central » à 2,25 % de croissance
Dans le « scénario central » à 2,25 % de croissance, hypothèse posée dans le programme du Gouvernement, le besoin de financement des administrations publiques s'efface progressivement . La trajectoire d'évolution du solde est parallèle à celle mise en évidence dans le programme de stabilité notifié à la Commission européenne 62 ( * ) .
Dans la projection de la Délégation, qui va au-delà jusqu'en 2010, le solde public atteint -0,9 point de PIB à cette échéance. Les prélèvements obligatoires sont en repli, mais le poids des dépenses publiques diminue davantage sous l'effet d'une progression en volume moins rapide que celle du PIB.
PRINCIPAUX AGRÉGATS DE FINANCES
PUBLIQUES
DANS LE SCÉNARIO À 2,25 % DE
CROISSANCE
(en points de PIB)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010
|
|
|
Capacité de financement |
-3,0 |
-2,9 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,7 |
-0,9 |
-2,1* |
|
Dette publique brute |
65,8 |
66,0 |
66,2 |
65,9 |
65,0 |
63,2 |
- 2,6 |
|
Dépenses publiques |
53,8 |
53,6 |
53,1 |
52,3 |
51,5 |
50,7 |
- 3,1 |
|
Progression en volume |
1,7 % |
1,6 % |
1,2 % |
0,8 % |
0,6 % |
0,6 % |
NS |
|
Prélèvements obligatoires |
43,9 |
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
- 0,5 |
La dette publique rétrograde. Elle diminue de 2,6 points de PIB entre 2005 et 2010 et se rapproche du ratio de 60 % du PIB mentionné dans le Pacte de stabilité et de croissance.
b) Quel serait l'impact d'une croissance supérieure ?
Avec une croissance à 3 % à partir de 2007 et un objectif de redressement du solde public identique, la contrainte de maîtrise des dépenses publiques serait sensiblement allégée 63 ( * ) . Elles peuvent progresser de 1,5 % par an, entre 0,9 % avec la croissance et le compte central, sans que soit remis en cause l'objectif de solde public.
Toutefois, l'ajustement structurel est de moindre ampleur ce qui pose problème au regard des engagements de réduction du déficit structurel pris lors de la réunion de l'Euro groupe du 7 octobre 2002. Pourtant, l'impact d'une conjoncture plus dynamique sur l'équilibre des finances publiques permet d'atteindre l'objectif de solde public nominal figurant dans le programme de stabilité et le poids de la dette publique dans le PIB se réduit sous l'effet d'une augmentation plus nette du PIB (dénominateur du ration dette publique/PIB).
PRINCIPAUX AGRÉGATS DE FINANCES
PUBLIQUES
DANS LE SCÉNARIO À 3 % DE
CROISSANCE
(en volume, en %)
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Capacité de financement |
-2,3 |
-1,7 |
-0,9 |
|
Dépenses publiques |
1,6 |
1,4 |
1,4 |
|
Solde public (en points de PIB) |
-2,3 |
-1,7 |
-0,9 |
|
Variation solde structurel
|
0,0 |
0,2 |
0,3 |
|
Variation solde conjoncturel |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Source : calculs OFCE
B. DES RÉSULTATS DONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION SONT CLAIREMENT IDENTIFIÉES PAR LES PROJECTIONS
Atteindre les objectifs de la programmation à moyen terme des finances publiques exigera plus que des progrès de productivité ordinaires . Compte tenu de l'inertie de certaines charges publiques, des arbitrages devront intervenir touchant le périmètre même de la sphère publique .
1. La maîtrise des dépenses publiques
La réduction de la place des dépenses publiques dans le PIB suppose des choix portant sur le périmètre d'intervention des administrations publiques.
La stratégie budgétaire de la France repose, depuis plusieurs années, sur la fixation d'un objectif de croissance modérée pour les dépenses publiques , devant s'accompagner d'une réduction significative de la part des dépenses publiques dans le PIB. En programmation, le rythme de croissance des dépenses est systématiquement inférieur à la croissance potentielle de l'économie .
Cet engagement est notablement renforcé dans le programme de stabilité à horizon 2009 puisque les dépenses publiques en volume devraient croître de 0,9 % l'an, contre 1,2 % dans la précédente programmation.
Le poids des dépenses publiques dans le PIB se réduirait de 2,1 points pour se rapprocher de 50 % (51,5 % en 2009).
Cependant, les cibles affichées dans les programmes de stabilité ont toujours été dépassées depuis 1999. Ce sont surtout les dépenses d'assurance maladie et celles des collectivités locales qui ont excédé les prévisions 64 ( * ) .
LES DÉRAPAGES EN DÉPENSE PAR RAPPORT AUX
OBJECTIFS AFFICHÉS
DANS LES PROGRAMMES DE STABILITÉ
SUCCESSIFS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. La simulation en variantes de quelques aléas relatifs aux dépenses publiques
Les occasions de dépassement de l'objectif de dépenses publiques ne manquent pas, comme le montre l'observation du passé.
En adoptant une classification sommaire, on peut les ranger en deux catégories : les dépassements consécutifs à des chocs exogènes ; ceux qui proviennent d'une insuffisance des politiques destinées à réduire leur rythme de croissance .
Si les chocs exogènes les plus défavorables à la maîtrise de la dépense publique sont ceux qui affectent le contexte de croissance, certains chocs spécifiques aux finances publiques peuvent survenir. Parmi ceux-ci figurent des chocs sur les taux d'intérêt, dont on présente ici l'impact.
En ce qui concerne les dépassements de dépenses dues à l'insuffisance des politiques mises en oeuvre à cet effet, l'absence de réformes concernant le champ de l'intervention publique est le plus souvent en cause. Il faut rappeler la pertinence des analyses de la Cour des Comptes, qui relève que la maîtrise des dépenses publiques suppose fondamentalement de redéfinir le format des interventions publiques .
Cette préconisation est illustrée en projection par les questions que conduit à se poser la réduction du poids des dépenses publiques dans le PIB.
a) L'impact d'une tension sur les taux d'intérêt
On a testé en variante au scénario central, l'impact d'un choc durable sur les taux d'intérêt à long terme . Cet impact est mesuré au second ordre, c'est-à-dire en tenant compte de l'impact du choc sur la croissance.
Dans l'hypothèse où un choc durable de taux d'intérêt se produit, les effets de premier ordre , c'est-à-dire sans tenir compte de l'impact du choc sur la croissance, viennent dégrader le solde public , les charges d'intérêt augmentant progressivement.
Une estimation réalisée l'an dernier permet d'évaluer à environ 0,35 point de PIB au terme de 5 ans l'impact d'un choc où les taux sont plus élevés de 1 point lorsqu'on part d'un niveau de dette publique de l'ordre de 65 points de PIB.
Dans ce cas, le renchérissement du coût de la dette oblige, à objectif de dette publique inchangé, à un effort supplémentaire de variation du solde primaire 65 ( * ) . On peut retenir comme ordre de grandeur que 2 points de taux d'intérêt supplémentaire contraindrait à baisser les dépenses publiques primaires 66 ( * ) de 0,7 point de PIB en plus (1/3 de l'effort programmé sur la période 2007-2009) ou à augmenter les prélèvements obligatoires dans une même proportion (soit un peu plus que la baisse des prélèvements obligatoires que comportent les engagements du gouvernement).
Ces résultats illustrent déjà la vulnérabilité des finances publiques et les orientations de politique budgétaire à un resserrement des conditions monétaires et financières.
Lorsqu'on prend en compte l'impact de la tension des taux d'intérêt sur la croissance, les enchaînements sont encore plus préoccupants. Le solde public est dégradé à hauteur de 1,2 point de PIB au bout de cinq ans lorsque les taux d'intérêt augmentent de 1 point.
Non seulement les charges d'intérêt augmentent mais le déficit primaire se creuse et l'augmentation de la dette publique est plus rapide. Comme le niveau du PIB (dénominateur du rapport dette publique/PIB) est réduit par rapport au compte central, l'alourdissement du poids de la dette publique dans le PIB est démultiplié.
b) Quelques questions sur la baisse de la part des dépenses publiques dans le PIB
L' objectif de réduire de 2,1 points de PIB le poids des dépenses publiques à l'échéance de 2009 consiste à revenir en quatre ans à la situation qui prévalait en 1991 . Il est d'autant plus ambitieux qu'une grande inertie touche plusieurs catégories de dépenses.
En projection, le poids des charges d'intérêt supportées par l'État reste stable. Elles s'accroissent parallèlement au PIB, soit de 2,25 % en volume par an. L'engagement d' une baisse du volume des dépenses de l'État ne peut s'exercer que sur les dépenses primaires et n'en est que plus ambitieux .
S'agissant des prestations sociales , elles augmenteraient plus vite que l'objectif global de progression des dépenses publiques, de 1,2 % par an contre 0,9 % pour l'ensemble des dépenses publiques. La croissance des dépenses de santé serait de 1 % ; les prestations retraites soumises à la dynamique du nombre des retraités accélèreraient progressivement et leur croissance serait en moyenne de 2,5 % entre 2007 et 2010.
ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES PRESTATIONS SOCIALES
|
Répartition |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
1985-1995 |
1996-2004 |
2005-2010 |
|
Retraites |
45 |
3,6 |
1,9 |
2,4 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
0,1 |
2,5 |
2,6 |
|
Maladie |
33 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,3 |
2,7 |
1,2 |
|
Chômage |
7 |
-0,6 |
-2,1 |
-3,1 |
-3,2 |
-4,3 |
-5,3 |
-1,2 |
2,4 |
-3,1 |
|
Famille, logement, pauvreté et exclusion |
15 |
1,6 |
1,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,1 |
1,6 |
0,9 |
|
Total des prestations |
100 |
2,4 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
-0,5 |
2,4 |
1,4 |
Cette dynamique, même si elle apparaît très inférieure à celle observée en tendance, et l'inertie de nombreuses charges budgétaires (charges d'intérêt, dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires) imposent une forte contrainte sur les autres dépenses publiques.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(SCÉNARIO À 2,25 %)
(déflatées par les prix de consommation)
|
En points de PIB |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
1985-1995 |
1995-2005 |
|
Ensemble des dépenses |
53,8 |
53,6 |
53,1 |
52,3 |
51,5 |
50,7 |
51,6 |
53,4 |
|
dont : |
||||||||
|
- Rémunération des salariés |
13,5 |
13,4 |
13,2 |
13,0 |
12,7 |
12,4 |
13,0 |
13,5 |
|
- Consommations intermédiaires |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,0 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
5,3 |
|
- Intérêts |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,9 |
3,0 |
|
- Prestations sociales en espèce |
17,9 |
17,8 |
17,6 |
17,4 |
17,2 |
16,9 |
17,1 |
17,7 |
|
- Transferts |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
4,9 |
5,5 |
|
- Subventions |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,9 |
4,8 |
|
- FBCF |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,4 |
3,1 |
Notamment , en fin de projection, la masse salariale se situe à 1,1 point de PIB au-dessous de sa moyenne pour 1995 à 2005 .
La norme de progression des dépenses publiques implique donc une nette réduction du volume de la masse salariale distribuée par les administrations publiques à partir de 2007. Sauf une très forte diminution des effectifs de la fonction publique, elle suppose une perte de pouvoir d'achat du salaire individuel des salariés des administrations publiques , compte tenu de l'augmentation de l'emploi non marchand due au « Plan Borloo » en 2005 et 2006.
Il est possible que la répartition des dépenses diffère de celle envisagée. Cependant les marges de manoeuvre sont faibles, compte tenu de l'importance des prestations retraites (leur montant est proche de celui des rémunérations des salariés des administrations publiques en 2003) et santé (leur montant est proche de 2/3 des rémunérations des salariés des administrations publiques en 2004).
La solution alternative, qui consisterait à opter pour une diminution plus prononcée du nombre de fonctionnaires, doit être envisagée au vu des expériences récentes caractérisées par un report quasi-systématique des programmes de réduction des emplois budgétaires qui montrent que ceux-ci ne s'improvisent pas. En outre, la récente proposition de rétrocéder aux agents des fonctions publiques la moitié des économies résultant de la réduction du nombre d'emplois publics, en limiterait l'impact. Enfin, leur succès est dépendant de la définition concertée de réformes structurelles qui semblent devoir passer nécessairement par une redéfinition du périmètre des interventions publiques.
c) Quelle évolution à moyen terme pour les dépenses de santé ?
En 2005, la progression de l'ONDAM (Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie) devrait atteindre 5,7 % en valeur (contre 6,8 % en 2003). La progression retenue pour 2006 par le PLFSS est de 4,3 % en valeur (2,5 % en volume). Sur la période 2007/2009, la programmation pluriannuelle des finances publiques retient une hypothèse d'augmentation de l'ONDAM sur un rythme annuel moyen de 1 % en volume (2,5 % en valeur).
Cette hypothèse suscite les commentaires suivants :
- les évolutions projetées pour 2006 à 2010 (+ 1 % en volume) traduisent une nette inflexion par rapport aux évolutions enregistrées depuis le début des années 2000 ( + 4 % par an en volume en moyenne) ;
- elles sont cependant plus cohérentes avec les évolutions enregistrées sur la période 1990-1999 (+ 2,6 % par an en volume en moyenne), qui se sont caractérisées par un net ralentissement ;
- ces évolutions sont justifiées par le Gouvernement par les effets que devraient produire les mesures prises dans le cadre de la loi de juillet 2004 portant réforme de l'assurance maladie et par les nouvelles mesures prises dans le cadre du PLFSS 2006 ;
- l'impact quantitatif de ces mesures est toutefois extrêmement difficile à apprécier et elles pourraient produire leurs effets à un horizon plus lointain que celui de la projection.
C'est pourquoi l' évolution des dépenses d'assurance maladie constitue certainement l' élément technique de la programmation pluriannuelle le plus incertain .
On doit rappeler ici les résultats d'une étude commandée au CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales) par le Service des Études et de la Prospective du Sénat consistant à simuler l' évolution des dépenses de santé à moyen terme en fonction de leurs principaux déterminants : taux de croissance du PIB par habitant, prix des soins médicaux, évolutions démographiques, progrès technique et facteurs institutionnels.
Si l'on se réfère à cette simulation, l'augmentation des dépenses de santé à moyen terme, et pour une croissance du PIB de 2,5 % par an, pourrait être de 3,8 % par an en volume en moyenne .
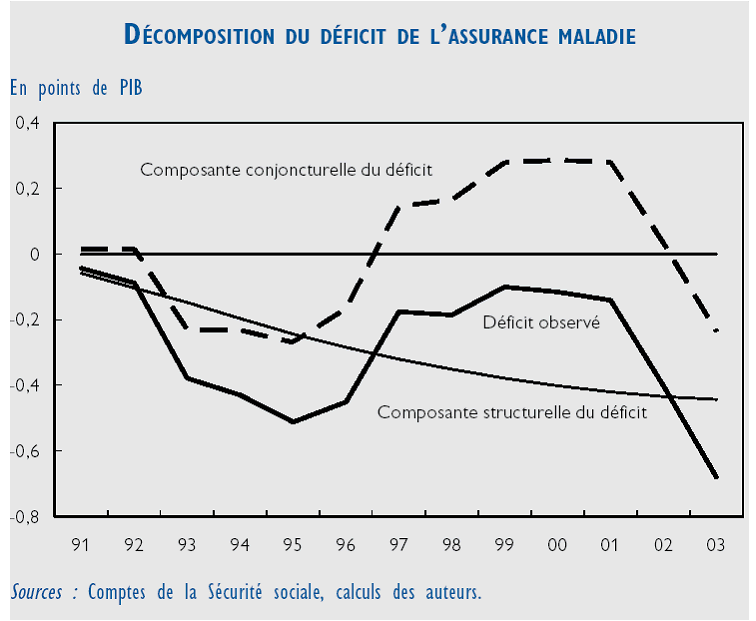
Source : Observatoire français des conjonctures économiques
Néanmoins, cette étude ne tient pas compte des mesures prises dans le cadre de la dernière réforme de l'assurance-maladie.
Surtout, la simulation du CEPII prolonge la tendance passée concernant les prix relatifs des soins, dans laquelle les prix des soins progressent moins vite que les prix du PIB, ce qui entraîne une forte dynamique de la demande de soins. Or, il apparaît hasardeux de prolonger cette tendance sur le moyen terme.
Pour ces deux raisons, votre Délégation a ainsi demandé à l'OFCE d'évaluer les conséquences d'une augmentation des dépenses de santé parallèle à la croissance du PIB , de 2,25 % contre 1 % dans la programmation à moyen terme du Gouvernement. Cette variante n'est pas arbitraire : s'agissant d'un « bien supérieur », il n'y a aucune raison que le poids des dépenses de santé dans le PIB diminue. Elle permet d' apprécier quantitativement l'incertitude associée à l'hypothèse de moyen terme retenue par le Gouvernement .
Sous cette hypothèse d'augmentation des dépenses de santé, la capacité de financement de l'assurance-maladie serait dégradée à hauteur de 11 milliards d'euros en 2010.
Afin de respecter l'objectif de solde public affiché par le Gouvernement, il serait nécessaire d' augmenter la CSG de 0,5 point sur la période, soit encore une augmentation de 9,2 %. Dans ces conditions, l' engagement de baisser les prélèvements obligatoires de 0,6 point de PIB devrait être reporté sur d'autres impositions, et, surtout, apparaîtrait assez rhétorique .
II. POUR UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE ACTIVE ET SOUTENABLE ET DES INTERVENTIONS PUBLIQUES EFFICACES
Les différents exercices d'exploration des problèmes de politique budgétaire exposés dans le présent rapport mettent en évidence l'impact de l' instrument budgétaire sur le rythme de croissance et, inversement, la sensibilité des finances publiques à celui-ci. Ils illustrent également un certain nombre de problèmes structurels auxquels est confrontée toute politique budgétaire.
Ces projections viennent confirmer, d'une part, l'existence d'objectifs partiellement contradictoires, d'autre part, la nécessité d'approfondir l'approche des questions posées par la politique budgétaire.
Plus large ment, l' utilité des interventions publiques , au sens fort du terme de la qualité de leur apport à la croissance et à la justice sociale, devrait être une préoccupation constante des Gouvernements . Nulle majorité politique ne viendra jamais contredire cette exigence et chacune d'entre elles prétendra toujours s'y conformer.
Il reste que notre pays gagnerait beaucoup à se doter des institutions indispensables à l'évaluation des politiques publiques . L'année 2006 est une année historique pour les finances publiques. Ce pourrait être aussi une année de déshérence de plus pour l'évaluation des politiques publiques. La pleine application de la nouvelle loi organique sur les lois de finances devrait entraîner une dynamique de contrôle et d'évaluation des actions publiques, impulsion bienvenue puisqu'elles sont encore trop limitées.
Cependant, la LOLF ne couvre pas, loin de là, la totalité du champ des interventions publiques, et son appareil de pilotage ne réunit pas, comme c'est normal vu son objet, l'ensemble des instruments auxquels recourent les processus d'évaluation des politiques publiques, quand ils sont convenablement organisés.
Votre rapporteur souhaite ici rappeler les propositions que la Délégation du Sénat pour la planification a formulé il y a déjà quelque temps 67 ( * ) afin de relancer l'évaluation des politiques publiques, véritable pivot de la réforme de l'État.
Elles ont reçu un bon accueil, semble-t-il, auprès des spécialistes nationaux et étrangers de l'évaluation mais n'ont pas reçu les prolongements qu'elles nous semblent encore mériter.
A. PRÉCISIONS SUR LES CRITÈRES DE JUGEMENT DE L'ORIENTATION DONNÉE À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
Il est justifié d'apporter quelques précisions sur les « grilles de lecture » permettant d'apprécier l'orientation conjoncturelle donnée à celle-ci.
En se plaçant au niveau d'une analyse très globale, qui mériterait d'être affinée en recourant à des études consacrées à la structure des recettes et de la dépense publique, on peut porter l'attention sur le solde des finances publiques . Celui-ci représente un indicateur agrégé du bilan des relations entre les administrations publiques 68 ( * ) et les autres agents économiques. En utilisant les termes de la comptabilité nationale, on attribue souvent à la variation du besoin de financement des administrations publiques le pouvoir d'expliquer l'orientation de la politique budgétaire . Une réduction du besoin de financement témoignerait d'une politique budgétaire restrictive ; inversement, une augmentation serait le signe d'une politique budgétaire expansive.
Cette décomposition est justifiée dès lors qu'on convient que, sur une période donnée, l'économie d'un pays doit se trouver sur une trajectoire lui assurant d' être, en moyenne, au niveau de sa production potentielle . Celle-ci correspond au produit du taux de croissance de la population active et des gains de productivité du travail. En pratique, les mouvements de l'activité économique situent celle-ci sur une trajectoire oscillant autour de la production potentielle, tantôt au-delà, tantôt en deçà. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'économie.
Le besoin de financement des administrations publiques est, quant à lui, sensible à la situation de la production effective . Dans l'hypothèse où la production effective est au-delà de la production potentielle (écart à la production positif), les recettes des administrations publiques sont supérieures à ce qu'elles seraient dans l'hypothèse, plus normale, et inéluctable, où la production se situerait à son potentiel. De même, certaines dépenses publiques sont alors transitoirement plus faibles qu'elles ne devraient être. Tel est le cas pour les dépenses de transferts 69 ( * ) . Lorsque la situation inverse (celle où la production effective est inférieure au niveau de la production potentielle) prévaut (écart à la production négatif), le niveau des recettes n'atteint pas celui qui, normalement, devrait être le sien et certaines dépenses atteignent, au contraire, un niveau plus élevé que celui qui est structurellement le leur.
Le cumul des écarts entre recettes effectives et potentielles et entre dépenses effectives et potentielles permet d'identifier la composante conjoncturelle du besoin de financement public. On en déduit la composante structurelle du besoin de financement.
Si la composante conjoncturelle est égale au besoin de financement observé, alors les administrations publiques sont à l'équilibre structurel 70 ( * ) ; si elle l'excède, il y a excédent structurel ; si elle lui est inférieure, alors le besoin de financement comporte une dimension structurelle en plus d'une dimension conjoncturelle.
B. BREF RETOUR SUR LES ENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
L'expérience récente de conduite de la politique budgétaire de soutien conjoncturel aux États-Unis permet d'illustrer quelques questions importantes relatives à la politique budgétaire. Votre Délégation a, dans ce domaine, une doctrine constante basée sur des approches pragmatiques. Les conclusions suivantes lui semblent s'imposer :
• la politique budgétaire peut être fortement activée ;
• elle est efficace sous certaines conditions ;
• les politiques budgétaires de soutien conjoncturel sont, par nature, insoutenables à terme, ce qui ne doit pas paralyser leur utilisation transitoire ;
• les politiques budgétaires contracycliques en période de basse conjoncture doivent être suivies d'ajustements structurels en phase de croissance élevée.
Ces convictions ont fondé les propositions de réforme du Pacte de stabilité et de croissance formulées dès 2002 par votre Délégation 71 ( * ) .
|
A - Les propositions de fond , qu'on pourrait baptiser « la règle des trois soldes », veulent répondre au souci d'instaurer une discipline budgétaire fondée sur une rigueur adaptée et une souplesse tempérée, et plus en harmonie avec les rythmes d'évolution du cycle économique. 1. La règle de retour à l'équilibre nominal des comptes publics, coûte que coûte, premier pilier du pacte de stabilité et de croissance, doit être abandonnée au profit d'une règle prescrivant le respect de deux soldes budgétaires : - Nul pays de la zone euro ne doit être autorisé à connaître un déficit supérieur à un certain niveau que nous suggérons de fixer à 2 points de PIB ; - Des exigences renforcées, à géométrie variable, pourront être définies chaque année, en fonction des perspectives économiques et des orientations souhaitées de politique budgétaire. Toutefois, nul pays ne pourra, au terme de ce processus, se voir contraint d'améliorer son solde structurel de plus de 0,5 point de PIB par an. 2. Par souci de disposer d'un filet de sauvegarde , il est proposé de considérer comme excessif tout déficit nominal de plus de 5 points de PIB (contre 3 points de PIB aujourd'hui). Étant donné l'exigence posée en matière de déficit structurel, ce filet ne devrait jouer d'exceptionnellement. B - Les propositions institutionnelles consistent : 1. A assortir le dépassement de chacun de ces soldes de sanctions alors qu'aujourd'hui, seuls les déficits excessifs sont sanctionnés . Ainsi, un État qui ne saisirait pas les opportunités d'assainissement de ses comptes en phase haute du cycle pourrait désormais être sanctionné. 2. En outre, la création d'un organisme de surveillance des positions budgétaires des États, respectant les critères de tout organe d'audit, en particulier l'indépendance, s'impose . La Commission, qui ne peut être juge et partie, conserverait l'ensemble des autres prérogatives qu'elle exerce en ce domaine de la coordination des politiques économiques. 3. Enfin, il faut rapprocher les organismes européens (Conseil, Commission et le nouvel organe de la surveillance dont la création est proposée) des citoyens de la zone euro , en leur imposant une obligation d'exposer régulièrement leurs décisions aux Parlements nationaux. |
Si votre Délégation peut se féliciter que certaines modifications du Pacte de stabilité et de croissance soient intervenues au cours de l'année 2005 qui montrent que l'éventualité d'une réforme envisagée par elle contre certaines opinions contraires était réaliste, et qui reflètent sur plusieurs points l'esprit de ses recommandations, elle estime que le chemin à parcourir pour rénover, de façon satisfaisante, le cadre de la politique budgétaire en Europe est encore très long .
Le document de la Commission, qui exige des États une « amélioration annuelle minimale » du solde budgétaire structurel sans nulle considération de leur position économique dans leur cycle, recèle des risques pro-cycliques récessifs.
Par ailleurs, elle s'inquiète des propositions de la Commission de mettre l'accent sur certains critères d'appréciation de la situation des finances publiques.
Ainsi en va-t-il de l'attention portée à la dette publique dont le niveau devrait, selon la Commission commander l'effort d'amélioration du solde public structurel (plus élevé il est, plus important devrait être cet effort), ce qui est de nature à amplifier encore la portée éventuellement récessive des exigences de la Commission.
1. La politique budgétaire est d'autant plus maniable qu'elle n'est pas bridée par des règles
Pour contrer le ralentissement économique aux États-Unis , la politique budgétaire a été particulièrement active , ce qui contraste fortement avec la situation observée en Europe et apporte la démonstration que les règles bridant l'activation de la politique budgétaire, privent les États européens d'un instrument que d'autres États développés savent utiliser 72 ( * ) .
Le solde des comptes publics est passé d' un excédent de 1,6 point de PIB en 2000 à un déficit de 4,6 points en 2003 , soit, au total, une mobilisation de la politique budgétaire à hauteur de 6,2 points de PIB.
Depuis 2004, une nouvelle diminution du déficit public est à l'oeuvre (à hauteur de 0,5 point de PIB). Elle se produit dans un contexte retrouvé de neutralité budgétaire, où n'étant pas expansée, l'impulsion budgétaire n'en est pas autant devenue restrictive. Le déficit structurel aux États-Unis est inchangé, malgré une croissance qui a « réaccéléré » un peu au-delà du potentiel .
2. La politique budgétaire peut être franchement contra-cyclique, avec succès
Au total, la
politique budgétaire des
États-Unis
s'est caractérisée par une
orientation délibérément contracyclique
: le
mécanisme des stabilisateurs automatiques a été
laissé libre de fonctionner ; en outre, le solde budgétaire
a été manié discrétionnairement pour soutenir
l'activité.
CAPACITÉ DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AUX ÉTATS-UNIS
(en points de PIB)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 1 |
|
1,6 |
- 0,4 |
- 3,8 |
- 4,6 |
- 4,3 |
- 4,1 |
1. Prévisions
Cette politique a largement contribué à la reprise économique des États-Unis, qui a été plus précoce et nettement et nettement plus forte qu'en Europe.
CROISSANCE DU PIB AUX ÉTATS-UNIS
(en %)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 1 |
|
|
En volume |
3,7 |
0,8 |
1,9 |
3,0 |
4,4 |
3,6 |
|
En valeur |
5,9 |
3,2 |
3,5 |
4,9 |
6,6 |
6,1 |
1 Prévisions
Source : OCDE
Les données suivantes relatives aux orientations des politiques budgétaires dans les principaux pays de l'OCDE ne laissent aucun doute sur l' ampleur comparée du recours à la politique budgétaire dans chaque zone .
IMPULSIONS BUDGÉTAIRES CUMULÉES DE 2000
À 2005
|
Impulsion cumulée |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Zone Euro |
0,5 |
1,0 |
1,1 |
0,8 |
0,7 |
0,4 |
|
Royaume Uni |
0,1 |
0,7 |
2,7 |
4,2 |
4,6 |
4,0 |
|
USA |
-0,7 |
0,7 |
3,9 |
4,7 |
5,0 |
5,0 |
|
Japon |
0,5 |
-1,1 |
0,3 |
0,2 |
-0,9 |
-0,8 |
Source
: Quarterly National Accounts, OCDE.
L'impulsion est la variation du déficit structurel primaire.
3. La politique budgétaire est d'autant plus efficace que certaines conditions sont réunies
L'efficacité de la politique budgétaire américaine apporte un démenti pratique aux constructions théoriques selon lesquelles la politique budgétaire discrétionnaire serait privée de toute efficacité.
Cette dernière approche est incarnée dans le théorème d'équivalence entre l'emprunt et l'impôt dit de « Ricardo-Barro » selon lequel les agents économiques augmenteraient leur épargne face à un creusement du déficit public, contrecarrant aussi les effets de relance liés à la dégradation de la capacité du financement des administrations publiques.
La très forte diminution du taux d'épargne des ménages américains au cours de ces trois dernières années apporte la démonstration que cette théorie n'a pas un pouvoir explicatif sans faille.
Pour autant, elle ne conduit à pas à établir que la politique budgétaire discrétionnaire est, en soi, dotée d'efficacité.
Trois éléments au moins pourraient être nécessaires pour qu'il en soit bien ainsi :
• la politique budgétaire doit être crédible , ce qui signifie qu'elle soit adaptée au contexte économique, et, par conséquent, systématiquement contra-cyclique , en phase basse de l'activité, comme lorsque le PIB excède son niveau potentiel ;
• la capacité de rebond de l'économie doit entrer dans les anticipations des agents , sans quoi leur confiance dans la contribution d'une reprise à venir à la résorption de la dette publique risque d'être amputée, pesant sur leurs comportements ;
• les conditions monétaires et financières doivent être favorables .
Cette dernière observation appelle quelques commentaires :
• l'aversion de la Réserve Fédérale américaine au déficit public semble nettement moins forte que celle de la Banque Centrale européenne, ce qui favorise l'efficacité de la politique budgétaire et permet entre autres à la politique monétaire américaine d'être plus réactive qu'en Europe ;
• une part croissante du besoin de financement public des États-Unis est couverte par des investisseurs étrangers, ce qui amène à mettre en évidence des éléments importants.
Si les deux tiers de la dette publique sont portés par des investisseurs résidents, y compris la Réserve Fédérale, 37 % sont financés par des non-résidents, dont 60 % seraient détenus, selon le département du Trésor des États-Unis, par des institutions gouvernementales.
Au début des années 90, 18 % de la dette étaient financés par l'étranger ; cette proportion a atteint 32 % en 1997. En 2003, la dette publique des États-Unis aux mains des non-résidents représente un montant de passif de plus de 13 points de PIB, dont 8 points sont la propriété d'autorités gouvernementales.
Deux conclusions s'imposent : le statut de la monnaie américaine simplifie le maniement de la politique budgétaire et l'intervention des Banques centrales, y compris la Réserve fédérale, favorise le financement du déficit budgétaire américain, alors qu'en Europe, les statuts de la BCE lui interdisent tout financement direct des administrations publiques.
Une partie importante de la dette publique des États-Unis est acquise par les Banques centrales asiatiques. Cela facilite grandement le maniement contra-cyclique de l'instrument budgétaire aux États-Unis. Les États de la zone euro ne bénéficient pas autant de la bienveillance des Banques centrales asiatiques, ce qu'on peut regretter. Les conditions de financement des déficits budgétaires des pays européens en sortent relativement plus tendues.
C'est en gardant ce contexte à l'esprit qu'il faut juger la perspective ouverte par la BCE de durcir les conditions de refinancement des banques privées commerciales, qui présenteraient à son guichet des créances sur les États insuffisamment vertueux à ses yeux .
Depuis l'adoption de l'euro , les primes de risques sur les dettes publiques de la zone se sont égalisées . Autrement dit, le placement des titres des dettes publiques nationales se fait à peu près au même coût pour les différents États. Le propos de la BCE est de recréer des primes de risques nationales .
Autrement dit, la Banque centrale européenne estime que les marchés se trompent dans leur traitement des dettes publiques des pays de la zone euro. Elle entend « faire payer » les États qui n'auraient pas le comportement budgétaire qui lui convient.
Cette intention peut être interprétée comme étant la réponse de la BCE aux aménagements du Pacte de stabilité et de croissance qui sont intervenus au cours de cette année, et que son Président a publiquement critiqués.
Ainsi, elle ne revient pas seulement à désavouer le jeu spontané des marchés , elle revient encore à sanctionner symboliquement les gouvernements européens , coupables collectivement d'avoir ôté un peu de leur rigidité aux règles qui encadrent la politique budgétaire en Europe.
In fine , si une telle « discrimination négative » devait être appliquée, ce sont les contribuables des pays concernés qui seraient ponctionnés à travers une augmentation des charges d'intérêt.
Or, ni les Traités, ni aucune autre source de légitimité n'autorisent la BCE à entrer dans un processus de sanctions individuelles des États, que ceux-ci se sont explicitement réservées quand il s'agit de leurs politiques budgétaires respectives.
4. Toutes les politiques budgétaires de soutien conjoncturel recourant au déficit peuvent être qualifiées d'insoutenables, ce qui ne suffit pas à les discréditer...
Les politiques budgétaires recourant à un déficit élevé ont naturellement pour effet d'augmenter la dette publique . Toutefois, cet enchaînement ne doit pas conduire à discréditer les politiques budgétaires conjoncturelles. La politique budgétaire contra-cyclique permet d'enrayer le ralentissement de la croissance, ce qui limite « ex post » les effets « ex ante » du déficit sur la dette publique.
Conséquence mécanique de la politique budgétaire américaine, la dette publique détenue par le public 73 ( * ) est passée entre fin 2001, point bas de la dette publique des États-Unis depuis 20 ans, et 2003 de 3.300 milliards à 3.900 milliards de dollars.
POIDS DE LA DETTE PUBLIQUE DÉTENUE PAR LE PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS DANS LE PIB
(en points de PIB)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
41 |
35 |
34 |
35 |
36 |
Source : Office of Management and Budget.
L'impact relativement limité du creusement du déficit public sur la dette doit être relevé et montre que l'efficacité de la politique budgétaire, en termes de stabilisation conjoncturelle, permet de limiter ses conséquences financières.
Le ratio dette publique/PIB varie en fonction de la dynamique de son numérateur, qui est influencé par les flux d'endettement supplémentaire. Mais, il varie aussi en fonction de la dynamique du dénominateur. Or, le PIB nominal des États-Unis s'est accru durant la période sur un rythme rapide, ce qui a limité le glissement du ratio dette publique/PIB.
En adoptant un point de vue purement comptable, on observe que si le solde public des États-Unis avait été constamment équilibré au cours de la période, la dette publique serait passée entre 2000 et 2003 de 35 à 29,4 points de PIB, avec la croissance observée (3,8 % en moyenne annuelle). Autrement dit, le déficit public stabilisant la dette, avec une croissance nominale de 3,8 % l'an, est, aux États-Unis de 1,9 point de PIB .
On observera, incidemment, que les « marges de manoeuvre » de la France sont, théoriquement, plus importantes . Avec une croissance nominale de 3,8 % par an entre 2000 et 2003 , le poids de la dette publique dans le PIB relevé en 2000 aurait été stabilisé avec un déficit public de l'ordre de 2,9 points de PIB.
En effet, plus le stock de dette initial est élevé, moins fort est l'impact d'un déficit public donné. Ainsi, comptablement, un déficit de 1 point de PIB augmente de 10 % une dette de 10 points tandis qu'il n'accroît que de 1 % une dette de 100 points de PIB. Ce « paradoxe de la dette » conduit à s'interroger sur la pertinence d'une appréciation de la politique budgétaire à partir d'un seul objectif de stabilisation de la dette publique , à l'heure où la Commission européenne propose d'emprunter une telle voie.
5. ...à la condition que les politiques budgétaires soient symétriques.
L'une des critiques justifiées adressées au pacte de stabilité et de croissance consiste à relever l'absence de règle de discipline invitant les États à pratiquer des politiques budgétaires contra-cycliques lorsque le PIB dépasse le potentiel d'une économie.
De telles politiques sont incontestablement nécessaires pour maîtriser l'évolution de la dette publique et dégager des marges de manoeuvre en cas de chute de l'activité.
C'est la raison pour laquelle votre Délégation souscrit, à quelques précisions près, à l'initiative du Ministre de l'économie et des finances de prévoir l'affectation de recettes inattendues et réclame un durcissement concerté et limité de la discipline budgétaire dans les phases de forte croissance.
6. Il n'existe pas de justification économique à un solde budgétaire structurel à l'équilibre
a) L'effacement de tout déficit structurel est un objectif abusivement « dérivé » du Pacte de stabilité et de croissance...
Le Pacte de stabilité et de croissance, constitué théoriquement de deux règlements financiers et d'une Déclaration du Conseil, a pourtant donné lieu à des codes de conduite à la nature juridique imprécise, qui représentent des sortes d'interprétations.
Mais, ils ont été le vecteur d'un durcissement doctrinal, qui est allé jusqu'à contrevenir aux règles du Pacte, ce qu'il faut regretter par principe.
Le Code de conduite révisé en 2001 illustre ce propos. Avec ce Code, le Conseil estime que « l'utilité d'un examen des positions budgétaires corrigeant les effets du cycle économique réside dans les possibilités qu'il offre pour s'assurer que la situation structurelle des comptes publics présente une marge suffisante pour qu'une dégradation conjoncturelle n'éloigne pas le solde public d'une situation budgétaire proche de l'équilibre à moyen terme. »
Cette recommandation peut être interprétée comme la consécration d'un principe d'équilibre permanent du solde nominal des comptes publics, qu'un excédent permanent du solde structurel doit garantir.
Avec cette recommandation, le Conseil, sur la proposition de la Commission, opère un renoncement de principe à tout déficit public, ce qui va bien au-delà des règles du Pacte de stabilité et de croissance.
b) ... qui est critiquable.
(1) Un affaiblissement des facultés stabilisatrices de la politique budgétaire...
Dans une telle conception, la politique budgétaire ne se voit plus reconnue de marges de manoeuvre lorsque son maniement contracyclique conduirait à l'apparition d'un déficit public.
Les propriétés de stabilisation conjoncturelle de la politique budgétaire en sont nettement affaiblies , au nom d'un objectif structurel qui est discutable .
La recommandation de réunir des marges de manoeuvre supplémentaires a pour objectif de viser un excédent structurel tel que se produise une rapide réduction du ratio dette publique/PIB.
(2) ... au nom d'un objectif financier plus que discutable
Le durcissement des exigences du Pacte est à comprendre en fonction des recommandations du Conseil européen de Stockholm (mars 2001) visant à un examen régulier de la soutenabilité des finances publiques , notamment au regard de l'impact sur les budgets publics du vieillissement de la population qui laisse présager une augmentation de plusieurs points de PIB de la charge des retraites.
La logique sous-jacente au Code révisé est que le niveau de la dette publique soit réduit dans des proportions telles que le surcroît de charges publiques résultant de l'alourdissement des retraites puisse être financé.
Une telle logique est critiquable.
Elle revient à estimer qu'il serait justifié de « pré-financer » des charges futures au moyen d'un supplément d'impôts et (ou) d'une réduction de dépenses immédiates.
Même en tenant pour acquise l'inéluctabilité des charges en cause, ce qui est une hypothèse d'autant plus forte que des réformes structurelles pourraient devoir intervenir afin d'élever le potentiel de croissance avec des effets sur la dynamique des dépenses concernées, l'arbitrage proposé par la Commission pourrait être sous-optimal.
Compte tenu du coût de la dette publique, qui détermine les économies à attendre d'une politique de désendettement, et des perspectives de « retour économique » d'une impulsion budgétaire positive, le bilan « ex ante » de la stratégie préconisée par la Commission est des plus incertains.
Il convient, par exemple, de ne pas négliger les effets pervers d'une excessive sévérité budgétaire sur certaines dépenses publiques.
La préoccupation d'éviter que la discipline budgétaire ne conduise à sacrifier les dépenses jugées utiles est aussi légitime que celle de réduire les coûts de la dette publique.
On peut également aborder la question des investissements publics .
Les règles de la surveillance budgétaire en Europe mentionnent d'ailleurs expressément ce type de dépenses que l'évaluation de la situation budgétaire des États peut être amené à prendre en compte. Par ailleurs, la règle d'or appliquée au Royaume-Uni permet, sous certaines réserves, le lancement d'emprunts publics susceptibles de financer l'investissement.
Enfin, si les investissements publics ne sont pas systématiquement porteurs de croissance, ils réunissent deux propriétés particulières :
• l'absence de récurrence de la dépense ;
• l'utilité prolongée des biens qu'ils produisent.
Il est donc raisonnable que la discipline budgétaire en Europe n'interdise pas de financer, au moins en partie, de telles dépenses par l'emprunt .
Fondamentalement, lorsque la Commission formule des propo-sitions tendant à accroître la sévérité des règles de politique budgétaire en Europe, le Conseil doit peser les pertes de marges de manoeuvre auxquelles conduirait l'acceptation de ce processus . L' augmentation du niveau de croissance potentielle , souhaitée par lui, appelle le financement de biens publics , tel que l'effort de recherche-développement. Une contrainte budgétaire excessive n'est pas compatible , il faut être réaliste, avec les objectifs fixés à Lisbonne de faire de l'Europe la zone la plus compétitive du monde .
On peut ajouter qu' un déficit structurel mesuré n'empêcherait en rien le reflux nécessaire du ratio dette publique/PIB .
Le besoin de financement des administrations publiques qui permettrait de stabiliser d'une année sur l'autre le poids de la dette sans le PIB se situe un peu au-delà de 2 %, lorsque la croissance évolue selon son rythme potentiel.
En outre, plus la croissance est forte, moins les niveaux de solde à atteindre pour satisfaire les critères de stabilisation de la dette publique sont élevés comme le montre le tableau ci-après.
SOLDE STABILISANT LA DETTE APU
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
Milliards d'euros |
-18,2 |
-23,4 |
-32,8 |
-24,6 |
-43,6 |
-31,6 |
-28,8 |
-21,3 |
-39,7 |
|
En point de PIB (en %) |
-1,5 |
-1,8 |
-2,5 |
-1,8 |
-3,0 |
-2,1 |
-1,9 |
-1,3 |
-2,4 |
Source : INSEE, base 2000, calculs direction du budget et DGTPE
Un déficit structurel de 2 points de PIB permettrait à la fois de financer des dépenses utiles pour élever le rythme de croissance potentiel et de réduire continûment le poids de la dette publique dans le PIB .
C. PROMOUVOIR ENFIN L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SERVICE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
1. Les enjeux de l'évaluation des politiques publiques
Il faut souligner l'importance des enjeux qui s'attachent à la promotion de l' évaluation des politiques publiques . Une fois de plus, l'évaluation des politiques publiques est en jachère alors que les besoins d'évaluation sont considérables si l'on souhaite retrouver le sens et l'efficacité des actions publiques et promouvoir une plus grande association des citoyens aux décisions publiques.
La réforme de l'État est, de longue date, un objectif politique majeur dont le principe, à défaut des modalités, est consensuel. L'évaluation des politiques publiques a trop souvent été considérée comme un élément, parmi d'autres, de ce projet sans cesse évoqué mais trop parcimonieusement mis en oeuvre. La diffusion de l'évaluation, comme élément essentiel de toute réforme de l'État, est à la fois une composante et un instrument de celle-ci.
En tant que telle , l'acclimatation réussie de l'évaluation des politiques publiques représenterait une novation majeure pour notre système politico-administratif. Elle ne peut intervenir qu'au prix d'une victoire sur les nombreuses forces qui lui font obstacle.
Ses apports seraient multiples : élever le niveau d'expertise de l'action publique, renforcer le fonctionnement de la démocratie en conférant aux décisions publiques un caractère plus transparent et participatif.
2. Un constat d'échec
Des moyens consacrés à l'évaluation des politiques publiques ont été développés. Mais, dans l'ensemble, ils n'ont pas efficacement contribué à l'essor de l'évaluation.
L'évaluation a été développée à plusieurs niveaux sans qu'on puisse réellement parler, à ces niveaux, d'institutionnalisation de l'évaluation. Les ressources ainsi déployées n'ont que peu fait progresser l'évaluation.
Au niveau des ministères , l'évaluation est devenue une préoccupation et a été très largement vulgarisée. Cette préoccupation a fait naître soit de nouvelles missions confiées à des structures existantes (inspections, services), soit de nouvelles entités positionnées dans la structure hiérarchique des départements ministériels ou en dehors (Haut conseil de l'évaluation de l'école, par exemple). Ce processus est parfaitement légitime mais il s'est déroulé sans qu'une stratégie cohérente ne vienne l'inspirer, en dépit des travaux consacrés à l'évaluation par le Comité interministériel à la réforme de l'État. Son apport à l'évaluation des politiques publiques est resté très limité.
Sauf exceptions, les ministères réalisent des travaux que leurs caractéristiques principales conduisent à ranger dans la catégorie des « auto-évaluations » . De telles réalisations, qui n'offrent que très peu de garanties de qualité pour leurs commanditaires (quasi-exclusivement, les ministres) ne peuvent, par nature, contribuer à la promotion de l'évaluation des politiques publiques au sens d'une évaluation pluraliste et experte. Ces derniers constats mis en regard de la situation de quasi-monopole de l'expertise par l'exécutif posent la question des moyens d'optimiser les ressources d'expertise attribuées à celui-ci .
Un meilleur partage de ces ressources est souhaitable . Deux voies sont possibles : la première consisterait à donner aux services d'études des ministères leur autonomie , la seconde à organiser les conditions de leur ouverture , autrement dit, de leur accessibilité aux citoyens et à leurs représentants.
Au niveau du Parlement , les essais de renforcement de l'institutionnalisation de l'évaluation se sont multipliés. Si, en effet, par nature, le Parlement exerce, à côté de sa fonction de législateur, une fonction de contrôle, il lui a semblé nécessaire de mieux organiser cette dernière mission et d'en dériver une fonction d'évaluation, qui a jusque très récemment été ignorée du droit positif déterminant les compétences du Parlement. La création d'un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, bicaméral, n'a pas réussi à institutionnaliser l'évaluation par le Parlement. Les solutions qui lui ont succédé, la Mission d'évaluation et de contrôle, à l'Assemblée nationale, le Comité d'évaluation des politiques publiques, au Sénat, représentent mieux que des « solutions de repli », mais sans avoir encore entièrement permis de consacrer l'évaluation dans l'activité parlementaire courante.
Le Parlement semble n'avoir pas encore pris la mesure des décisions qu'imposerait un développement satisfaisant de sa mission d'évaluation. En outre, des procédures d'évaluation qui ont été mises en place, le Parlement a été soigneusement écarté.
Il convient aujourd'hui de doter le Parlement de moyens institutionnels et matériels dédiés à l'évaluation, ainsi que l'a très justement proposé l'excellent rapport du Groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par notre collègue Daniel Hoeffel, et de consacrer pleinement son rôle dans les procédures à mettre en place pour favoriser l'essor de l'évaluation des politiques publiques.
3. La voie du succès : avant tout, réussir l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques
Si l'évaluation des politiques publiques a jusqu'à présent connu plutôt l'échec que le succès, c'est en raison des modalités inadaptées de son institutionnalisation . Celle-ci semble être le facteur déterminant de tout développement satisfaisant de l'évaluation.
Un choix d'institutionnalisation en « toile d'araignée » est préférable à une institutionnalisation monolithique
Deux systèmes d'évaluation se sont succédé. Ils ont été systématiquement décrits dans la littérature, y compris dans les présentations officielles, comme des dispositifs d'évaluation interministérielle, erreur 74 ( * ) à elle seule très significative d'une conception affadie de l'évaluation, qui explique pour une part importante l'insuccès final des deux formules expérimentées.
Cet insuccès est attribuable à deux éléments principaux :
- un accès dénié aux commanditaires les plus « naturels » de l'évaluation, le Parlement et le peuple ;
- une évaluation située dans des enceintes , certes éminentes, mais en prise trop indirecte avec les lieux de définition et les acteurs chargés de la mise en oeuvre des décisions publiques .
Le problème fondamental à régler est celui de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques . Cette institutionnalisation doit permettre d'atteindre les objectifs de l'évaluation des politiques au sens d'une appréciation élaborée , pluraliste et participative portant sur les politiques publiques.
A cet effet, plutôt qu'une institutionnalisation privilégiant le choix de localiser l'évaluation dans une sorte de « cathédrale », ou, si l'on veut, dans une enceinte nationale unique composée de « sages », il faut recommander une institutionnalisation en forme de « toile d'araignée » et réellement pluraliste .
La charge du pilotage de l'évaluation pourrait être confiée à des Commissions de l'Évaluation . Leur nombre, qui devrait rester modéré pour ne pas nuire à la lisibilité du dispositif, serait déterminé en fonction des choix de découpage rationnel des différents domaines des politiques publiques.
La composition de ces Commissions serait dictée par le souci d'assurer leur pluralisme. Même si ces Commissions n'ont pas vocation à être des enceintes de délibération politique, le Parlement devrait y être représenté, dans des conditions telles que l'opposition puisse participer aux travaux des Commissions.
Le rôle des Commissions serait celui aujourd'hui qui était il y a peu exercé par le Conseil National de l'Évaluation. Les Commissions seraient chargées d'animer et de piloter le dispositif d'évaluation mais elles ne procéderaient pas directement aux différentes évaluations, dont la charge incomberait à des instances d'évaluation , conformément à un schéma obéissant aux « bonnes pratiques » de l'évaluation.
Les Commissions nommeraient les membres des instances d'évaluation en respectant des critères définis, assurant le pluralisme et la qualité de leurs travaux. Les rapports des instances seraient publiés mais il appartiendrait aux Commissions de les discuter, d'en commenter les conclusions et d'établir les recommandations inspirées par eux. Plutôt que d'exclure a priori l'expression d'opinions dissidentes, il convient, au contraire, de garantir que celles-ci pourront librement s'exprimer à la demande des membres désireux de les formuler.
Les conditions de saisine des Commissions doivent permettre à l'évaluation d'être largement accessible dans la limite de considérations pratiques .
Celles-ci pourraient s'autosaisir, mais dans des proportions permettant aux autorités dotées de la capacité de saisine de voir aboutir leurs demandes. La saisine des Commissions serait largement ouverte, à l'exécutif (Président de la République, Premier Ministre, ministres), au Parlement (Présidents des assemblées, des commissions permanentes et des délégations parlementaires), au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux organisations syndicales nationales représentatives et, nouveauté majeure, au peuple, sous la condition de réunir un certain nombre de signatures.
Les Commissions exerceraient un « filtrage » des saisines en fonction de la qualité des projets évaluatifs soumis à elles, d'une hiérarchie des priorités établie en fonction des enjeux qualitatifs et quantitatifs des projets et de leur charge de travail. Un recours pourrait cependant être présenté à une Haute Autorité de l'Évaluation, en cas de refus.
Une fois le programme annuel arrêté, celui-ci devrait être mené à bien dans l'année, ce qui devrait permettre d'asseoir l'utilité des évaluations. Cette contrainte suppose que les Commissions soient dotées des moyens nécessaires et que ceux-ci puissent être délégués aux instances d'évaluation constituées par elles. Des moyens en personnel, financiers et les prérogatives nécessaires à tout travail d'évaluation (notamment en termes d'accès aux documents et données pertinents) devront leur être garantis.
L'évaluation des politiques publiques doit permettre de faire progresser la démocratie participative
Notre démocratie est essentiellement représentative. Ce principe est posé sans ambiguïté par l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice... ». La prééminence de principe de la représentation s'exerce pleinement dans le domaine de l'exercice de la souveraineté nationale qu'est l'activité normative. Elle est alors entière. En revanche, l'expression directe du corps social est consacrée dans d'autres domaines par les principes éminents énoncés dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et s'est trouvée juridiquement confortée par une série de dispositions destinées à lui assurer des prolongements concrets.
Sur le plan des principes, il faut mentionner les articles XIV et XV de la Déclaration de 1789.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Pour ce qui est des aménagements concrets, une multitude de dispositifs adoptés au coup par coup ont donné quelque substance à ces principes, qu'il s'agisse de la reconnaissance d'un droit de pétition, de l'instauration par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 du Médiateur de la République, de la reconnaissance de l'activité des partis politiques ou encore des multiples mesures associant telle fraction du corps social à un stade ou à un autre du processus de décision publique.
Les besoins exprimés et ressentis d'une expression plus directe de l'opinion publique ont par conséquent pu trouver quelques prolongements dans un contexte politico-constitutionnel qui en reconnaît la légitimité de principe tout en n'y étant pas fondamentalement propice.
L'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques peut être l'occasion de donner une substance supplémentaire à notre démocratie participative et elle peut grandement bénéficier d'un élan donné à celle-ci.
Les enjeux de la contribution de la société civile au développement de l'évaluation des politiques publiques ne doivent pas être négligés. Le désir d'organisations professionnelles ou de sections de l'opinion d'être mieux informées ou de participer au contrôle de l'action publique a engendré des initiatives. Dans un certain nombre de pays, elles ont débouché sur la création d'organes non institutionnels puissants.
Notre Délégation a consacré un rapport à l'information économique et sociale aux États-Unis dans lequel se trouvait décrit l'impressionnant potentiel d'appréciation des politiques publiques développées autour des Universités et des « Think tanks ». D'autres pays ont connu des développements intéressants de ce point de vue. Ainsi, le Canada s'est doté à la fin des années 80 d'un « Forum des politiques publiques », organisation non-partisane destinée à mobiliser les différents secteurs de l'opinion afin de discuter, plutôt que de rechercher le consensus, de l'efficacité des politiques publiques.
En France, de telles initiatives n'ont que rarement obtenu le soutien des pouvoirs publics. Un épisode exceptionnel doit toutefois être mentionné, celui ouvert par le rapport Lenoir-Baudoin Prot de juin 1979, qui peut être aussi considéré comme une tentative de démocratisation de l'expertise.
Garantir le respect des règles de déontologie et favoriser l'efficacité des évaluations sont deux composantes essentielles de processus d'évaluation fonctionnant correctement.
L'évaluation des politiques publiques est une démarche qui doit respecter quelques grands principes, qui sont constitutifs d'une réelle déontologie. Par ailleurs, les évaluations doivent pouvoir être efficaces.
Il importe par conséquent, tout d'abord, de définir les règles de déontologie applicables à l'ensemble du processus d'évaluation et de les inscrire dans notre droit positif . Les principes de pluralisme, d'indépendance et de transparence doivent trouver les multiples prolongements concrets qu'ils appellent. En particulier, la composition, les compétences et les rôles des différents animateurs de l'évaluation doivent être précisés dans des règles juridiquement sanctionnables. Parmi les nombreuses questions à traiter, il convient d'apporter toutes précisions utiles sur les rôles respectifs des commanditaires (les titulaires du droit de saisine), des pilotes de l'évaluation (les Commissions de l'évaluation) et des chargés d'évaluation (les instances d'évaluation).
Garantir l'efficacité des évaluations est une autre nécessité. Elle suppose, d'une part, que des règles favorisent le bon déroulement des travaux d'évaluation et, d'autre part, que l'utilité de ces travaux soit secondée par des dispositifs adéquats.
Dans la perspective de s'assurer de la déontologie des processus d'évaluation, mais aussi dans le but de favoriser l'efficacité de l'évaluation, il serait souhaitable en plus d'édicter quelques règles essentielles, de créer une Haute Autorité de l'Évaluation .
L'institution d'une Haute Autorité de l'Évaluation répond à plusieurs préoccupations :
Il s'agit, d'abord, de promouvoir les « bonnes pratiques » de l'évaluation .
Il s'agit aussi de favoriser l'efficacité de l'évaluation .
Les compétences attribuées à la Haute Autorité de l'Evaluation découlent de ces grandes missions. Elles doivent trouver tout leur soutien dans les modalités de composition de son collège et dans les moyens financiers, administratifs et juridiques qui devront leur être dévolus.
Ouvrir le « monopole public naturel » d'informations publiques
Des mesures doivent être prises pour mieux satisfaire la demande sociale d'informations. L'information statistique fait l'objet d'un monopole naturel, au sens économique du terme. Par ailleurs, les conditions juridiques de l'accès à l'information publique sont lacunaires ou éparses.
En outre, les moyens financiers publics sont principalement alloués aux administrations dans le domaine de l'expertise.
Il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour que ces différents « biens publics » soient plus accessibles et pour que la politique de développement d'une offre indépendante d'évaluation soit relancée.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa réunion du mercredi 23 novembre 2005 , tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin , président , la délégation pour la planification a procédé à l'examen du rapport d'information sur les perspectives de l'économie française et finances publiques à l'horizon 2010, de M. Joël Bourdin, rapporteur .
M. Joël Bourdin , rapporteur , a rappelé que l'économie française avait connu un regain de vigueur inattendu en 2004, mais que la croissance avait décéléré en 2005 et que son rétablissement devrait intervenir en 2006.
Concédant que ce scénario était controversé, il a indiqué qu'il était suspendu à deux conditions : une consolidation de la croissance mondiale, avec une croissance mieux répartie entre les zones, notamment entre les États-Unis et l'Europe et une demande intérieure dynamique.
Une partie de ces conditions avait été envisagée l'an dernier : les tensions sur les prix du pétrole et la « glissade » du dollar, qui risquaient de freiner la croissance mondiale et surtout européenne ; la capacité des ménages français à maintenir un rythme élevé de consommation dans un contexte de reprise molle et sans emplois.
Seul, le premier de ces risques s'est réellement produit, les prix du pétrole ayant flambé et l'euro s'étant apprécié, contre le dollar, mais aussi contre toutes les autres monnaies.
Ces deux événements ont essentiellement pesé sur le commerce extérieur, l'augmentation du prix du pétrole n'ayant pas impulsé à ce jour de poussée inflationniste susceptible de freiner la demande intérieure.
A l'effet du pétrole et du dollar, il faut ajouter la décevante atonie de la croissance de nos deux grands voisins de la zone euro, l'Italie et l'Allemagne.
Ces deux pays connaissent une croissance très lente pour des raisons en partie différentes.
Alors que l'Italie connaît une érosion de sa compétitivité extérieure, pour des motifs essentiellement structurels, mais qui relèvent aussi d'une insuffisante modération salariale, l'Allemagne ne connaît pas ce problème.
La politique économique en Allemagne n'est pas seulement caractérisée par une politique budgétaire restrictive, elle l'est aussi par une politique de désinflation compétitive qui vise à gagner des parts de marché. Cette politique connaît un certain succès, puisque l'Allemagne est redevenue le premier exportateur mondial. Mais ce succès est atteint au détriment des ménages allemands, dont le pouvoir d'achat régresse, et aux dépens des partenaires de l'Allemagne.
La politique économique allemande a une traduction très concrète pour la France. En 2005, elle lui coûtera 0,3 point de PIB, comme en 2003 et 2004. Ainsi, si l'environnement international de la France avait été plus favorable, la croissance aurait dépassé les 3 % en 2005.
La philosophie des projections à moyen terme présentées dans le rapport de la délégation étant d'explorer les possibilités de croissance autonome de l'économie française, que décrit la programmation économique du Gouvernement, l'hypothèse a été posée qu'à l'avenir, la croissance française ne serait plus handicapée par son contexte international.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a jugé qu'une contribution neutre du commerce extérieur serait déjà un heureux événement, puisqu'elle implique que la croissance mondiale soit supérieure à sa tendance et que la France soit capable d'exporter nettement plus que ce qu'elle importera. Telle est ainsi l'une des grandes hypothèques du futur économique de la France, qui ne dépend que partiellement d'elle-même. Son environnement international devra être favorable.
A ce sujet, M. Joël Bourdin , rapporteur , a souhaité insister sur deux points qu'il a jugés essentiels. En premier lieu, il est indispensable de retrouver, notamment avec l'Allemagne et l'Italie, des modes de coordination des politiques économiques axées sur la recherche de la plus forte croissance possible. Ceci doit passer notamment par un très sérieux effort pour lutter contre les politiques non coopératives dans la zone euro. La politique allemande s'inscrit dans une logique qui prévalait sous le régime de système monétaire européen où chaque pays s'efforçait de prendre des parts de marché aux voisins, tout en espérant que ceux-ci entreprennent une relance budgétaire que nul n'avait plus intérêt à pratiquer en solo.
Ces politiques ont engendré un formidable retard de croissance, ce dont l'Union Européenne ne se préoccupe pas suffisamment. Le projet allemand de TVA dite « sociale » incarne des politiques non coopératives de cette sorte.
En second lieu, il faut veiller à éviter toute contagion inflationniste après la hausse du prix du pétrole qui est intervenue. Des variantes, présentées dans le rapport, montrent d'abord, que, si des tensions salariales devaient se produire en France seulement, la croissance de notre économie serait assez nettement pénalisée à travers le supplément d'inflation qui ne manquerait pas de survenir. Il faut donc respecter la modération salariale sans laquelle se produiraient des pertes de compétitivité, de croissance et d'emplois.
Le scénario serait moins dramatique si l'inflation se propageait dans l'ensemble des pays. Toutefois, la croissance mondiale serait affectée et la croissance en France aussi. Celle-ci n'a donc pas intérêt à ce que l'inflation gagne le monde.
Dans cette dernière hypothèse, il est à craindre que les Banques centrales ne durcissent leur politique monétaire. Si elles augmentaient d'un point les taux, l'effet récessif serait important. L'inflation serait jugulée, mais au prix de pertes de croissance et d'emplois supplémentaires.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a alors estimé nécessaire de souligner qu'en l'état des choses, l'accélération des prix observée ces derniers temps ne témoignait en rien de l'existence de tensions inflationnistes profondes et qu'il serait, par conséquent, particulièrement inapproprié que la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a alors rappelé que, si les aléas internationaux ne survenaient pas, il faudrait, malgré tout, des conditions internes particulières pour obtenir une croissance de 2,25 %, dans un contexte marqué par un ajustement structurel des comptes publics. Celui-ci, de l'ordre de 0,4 point par an à horizon 2009, se traduit, dans les modèles économiques, par une diminution du rythme de croissance, d'un montant à peu près équivalent à l'ajustement structurel. Ainsi, pour avoir une croissance de 2,25 % sur la période à venir, il faudra, en réalité, des comportements économiques spontanés des agents domestiques qui déboucheraient sur une croissance de l'ordre de 2,8 % si la politique budgétaire était neutre.
Il s'ensuit que les ménages doivent consommer et les entreprises investir nettement plus que sur la période récente si l'on souhaite atteindre l'objectif de croissance mentionné dans le programme de stabilité à l'horizon 2009.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a alors abordé la question décisive, selon lui, de savoir s'il existe des réserves pour la consommation des ménages. Ayant remarqué que dans l'hypothèse d'une croissance à 2,25 %, le pouvoir d'achat du revenu des ménages ne progresserait pas assez pour que la consommation atteigne le rythme nécessaire, il a indiqué qu'une baisse du taux d'épargne des ménages, à hauteur de 2,4 points, serait alors indispensable.
Une telle évolution suppose que les propensions à consommer et à épargner s'équilibrent dans un sens plus favorable à la consommation.
La forte diminution du chômage qui intervient en projection, l'engagement de réformes structurelles qui peuvent atténuer les inquiétudes des ménages, sont des éléments favorables. Mais il faudra sans doute réunir d'autres conditions.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a en ce sens abordé certaines politiques structurelles, et notamment celles destinées à élargir l'accès au crédit des ménages. Dans de nombreux pays, si la propension à consommer des ménages est à un niveau structurellement élevé, c'est, semble-t-il, que l'accès au crédit des ménages est plus facile et qu'ils y bénéficient davantage de la politique monétaire quand celle-ci est accommodante.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a estimé que la mauvaise réputation du crédit dans notre pays pouvait être rapprochée des attitudes hostiles que manifestent les économistes classiques, et les monétaristes, à son égard, puisqu'ils considèrent que la monnaie et le crédit n'ont pas de vertus particulières.
Il a indiqué que cette approche avait eu une traduction très concrète dans l'édifice de la construction monétaire européenne, où il est prohibé de monétiser les déficits publics. Si cette contrainte s'impose également aux États-Unis, le Trésor américain s'en affranchit aisément, puisque les Banques centrales asiatiques acquièrent directement une grande partie de la dette publique américaine. Cela facilite grandement le maniement contra-cyclique de l'instrument budgétaire aux États-Unis.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a estimé qu'il fallait garder présent à l'esprit ce contexte pour juger la perspective ouverte par la BCE de durcir les conditions de refinancement des banques privées commerciales qui présenteraient à son guichet des créances sur les États insuffisamment vertueux à ses yeux. Il a estimé que le but de la BCE était ainsi de recréer des primes de risques nationales, estimant implicitement que les marchés se trompaient dans leur traitement des dettes publiques des pays de la zone euro.
Il a interprété cette intention comme une sorte de réponse de la BCE aux prétendus assouplissements du Pacte de stabilité et de croissance qui sont intervenus au cours de cette année et que son Président avait publiquement critiqués.
Ainsi, le projet de la BCE ne revient pas seulement à désavouer le jeu spontané des marchés, il revient encore à sanctionner symboliquement les gouvernements européens, coupables collectivement d'avoir ôté un peu de leur rigidité aux règles qui encadrent la politique budgétaire en Europe. M. Joël Bourdin , rapporteur , a souligné qu'in fine, si une telle discrimination négative devait être appliquée, les contribuables des pays concernés seraient lésés à travers l'augmentation des charges d'intérêt qui se produirait.
Il a jugé que ni les Traités ni l'expertise technique de la BCE n'autorisaient celle-ci à entrer dans un processus de sanctions individuelles vis-à-vis des États, dont ceux-ci se sont explicitement réservé la mise en oeuvre dans le cadre de la surveillance des situations budgétaires.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a alors remarqué que la prédominance des approches monétaristes avait pour conséquence, plus sourde et diffuse, de nourrir la défiance face aux dynamiques d'endettement des agents privés, des ménages en particulier.
Sur ce point, il a indiqué que, si les Français étaient de plus en plus endettés, avec un ratio de l'ordre de 60 % de dettes rapportées à leur revenu, ce ratio atteignait en Allemagne 111 %, 120 % au Royaume-Uni et 194 % au Danemark.
Il s'est demandé si ces données et ces comparaisons ne traduisaient pas une sorte de « sous-endettement » des ménages français, qui semble être une spécificité structurelle de notre pays.
Cette spécificité est en relation directe avec les questions que posent les projections présentées dans le rapport, a-t-il fait observer. L'OCDE a récemment souligné le coût pour la croissance de la zone euro de l'insuffisante dynamique du crédit. Celle-ci a pour effet d'y minorer l'impact de la politique monétaire.
Or, si la politique monétaire était plus efficace, les taux d'épargne des ménages de la zone euro connaîtraient sans doute des ajustements contra-cycliques plus prononcés, ce qui est précisément l'une des conditions majeures des scénarios à moyen terme exposés dans le rapport de la délégation.
Parmi les autres conditions internes, M. Joël Bourdin , rapporteur , a voulu rappeler la nécessité d'un plus fort investissement des entreprises. Plus celui-ci sera dynamique, moins strictes seront les contraintes de désépargne des ménages compatibles avec l'objectif de croissance poursuivi. Cependant, l'investissement ne peut se passer de perspectives de consommation bien orientées. Si les entreprises sont aujourd'hui mieux à même d'investir après leur redressement financier récent, il faut renforcer leurs perspectives, ce qui plaide pour une politique qui soutienne la demande des ménages. La réduction très rapide du déficit public structurel n'offrirait pas un contexte propice à l'investissement. En effet, dans le contexte de mondialisation, s'il y a naturellement une propension à investir dans les zones qui offrent des coûts de production réduits, il ne faut pas oublier l'importance des perspectives de chiffre d'affaires. L'Europe et la France devraient ainsi mieux veiller à orienter leurs politiques économiques vers un objectif de forte croissance.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a insisté sur le fait qu'en l'état actuel d'insuffisance de production, l'objectif prioritaire des politiques économiques devrait être le retour à une croissance effective permettant de retrouver le niveau de production potentielle, condition pour que le chômage se résorbe.
Ceci devrait être l'un des critères principaux d'appréciation des politiques économiques.
Sous cet angle, s'il est nécessaire d'assainir les comptes publics, on peut nourrir quelques doutes sur le calendrier qui est imposé par le Pacte de stabilité et de croissance et qui devrait peser significativement sur la demande en Europe.
En tout cas, cette contrainte budgétaire doit inviter à des choix de priorité avisés en matière de dépenses publiques, choix qui devraient aussi être évalués en fonction de leur contribution au retour le plus rapide possible à une croissance forte.
S'il ne faut pas être indifférent à l'objectif de moyen-long terme d'élever le rythme de la croissance potentielle de l'économie française, et s'il faut d'ores et déjà préparer l'avenir en finançant l'innovation, il est moins urgent d'augmenter l'offre sur le marché du travail.
En conclusion, M. Joël Bourdin , rapporteur , a remarqué que, si la productivité de demain se construisait dès aujourd'hui, sans un sursaut du rythme de croissance dès maintenant, les défis visant à augmenter le rythme de la croissance potentielle seraient beaucoup plus difficiles à relever.
Un large débat s'est alors ouvert.
M. Bernard Angels s'est félicité que le rapporteur ait délibérément choisi de privilégier une approche dénuée de partis pris doctrinaux et ait évité de céder à un catastrophisme ambiant qui apeure les Français et mine leur confiance dans l'avenir.
Il s'est rallié à l'idée selon laquelle un maniement contra-cyclique de la politique budgétaire devrait être systématiquement entrepris. Il a insisté sur la nécessité d'instaurer une meilleure coordination des politiques économiques en Europe et de faire prévaloir des politiques plus coopératives entre des États liés par une destinée politique commune. Il a estimé que la politique budgétaire annoncée par le gouvernement hypothéquait le dynamisme de la consommation des ménages, tant par son orientation restrictive que par le choix de sacrifier les catégories de la population ayant le plus besoin du soutien de l'État. Il a enfin regretté qu'une forte proportion des Français ait des difficultés pour accéder au crédit.
Sur ce dernier point, M. Joël Bourdin , rapporteur , a souhaité souligner la contribution très positive des mesures prises par le précédent ministre de l'économie et des finances pour faire circuler davantage de liquidités dans la mécanique de l'économie française.
M. Gérard Bailly s'est inquiété des perspectives du pouvoir d'achat des ménages et a déploré l'endettement excessif de la France. Il s'est enfin inquiété des perspectives des prix de l'immobilier.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a observé que la modération salariale était une condition impérative d'une croissance équilibrée. Il a remarqué que si l'État était endetté, il n'en allait pas de même de la France, qui avait accumulé des capacités de financement au cours des dernières années. Il a insisté sur la nécessité de voir les agents privés prendre le relais de l'État si celui-ci devait s'orienter vers une réépargne, en réduisant les déficits et la dette publique.
M. Jean-Pierre Plancade s'est interrogé sur la représentativité des outils de mesure du pouvoir d'achat des ménages. Il a souligné que les catégories sociales les plus handicapées ne ressentaient pas les progressions du pouvoir d'achat décrites par les indicateurs macroéconomiques.
M. Joseph Kergueris a, sur ce point, remarqué que les approches par catégories sociales étaient évolutives et qu'il convenait de tenir compte des transformations démographiques, en particulier de l'importance grandissante des familles monoparentales, pour mesurer le pouvoir d'achat tel qu'il est réellement perçu.
M. Joël Bourdin , rapporteur , a rappelé que, dans le précédent rapport sur le moyen terme adopté par la délégation, ces questions de méthode avaient été étudiées. Il a remarqué que, désormais, l'attention se portait plus qu'avant sur la mesure du pouvoir d'achat de chaque ménage, alors qu'auparavant, seul, le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages était couramment évoqué.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur les perspectives économiques et des finances publiques à l'horizon 2010, de M. Joël Bourdin, rapporteur.
ANNEXE OFCE

Perspectives de l'économie
française
à l'horizon 2010
OFCE 75 ( * )
Rapport pour le Service des Études économiques du Sénat
Novembre 2005
Conception générale de l'exercice
Cette projection de l'économie française à l'horizon de six ans - 2010 en est le terme - a été réalisée par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) à l'aide de son modèle de simulation de l'économie française, e-mod.fr . Elle est de nature essentiellement macro-économique.
Les experts se sont toutefois attachés à en tirer le maximum d'indications sur l'évolution de la population active, du marché du travail et des finances publiques.
Si les résultats affichés pour les deux premières années (2005 et 2006) peuvent être considérés comme une prévision, les quatre années suivantes ne décrivent pas le scénario le plus probable, mais plutôt une extrapolation des tendances à l'oeuvre jusqu'en 2004. Il s'agit d'illustrer, par une projection à cinq ans, les questions et les choix devant lesquels se trouvent aujourd'hui les responsables de la politique économique.
Dans le but de mettre à disposition du Sénat une telle « illustration », les évolutions macroéconomiques ont délibérément un caractère tendanciel.
Ce choix influence notamment deux catégories d'hypothèses :
- Le scénario d'environnement international à moyen terme, qui sert de cadre à la projection de l'économie française, a été élaboré à partir des estimations de croissance potentielle réalisées par l'OCDE ou par le FMI pour les zones hors OCDE pour les années 2007 à 2010. Le scénario d'environnement international prolonge donc les évolutions constatées sur le passé par une hypothèse médiane.
- Les prix des partenaires étrangers de la France évolueraient de manière telle que la compétitivité prix de l'économie française serait stable à partir de 2007. Une hypothèse de cette nature a évidemment un caractère conventionnel, mais il est hasardeux d'en bâtir une autre dans le cadre d'un exercice de moyen terme.
Au regard des choix opérés, il est logique que les évolutions macroéconomiques décrites par la projection prolongent les tendances lourdes à l'oeuvre dans l'économie française.
A - UN SCÉNARIO POUR LES ANNÉES 2005-2006
Par convention, la projection prolonge à l'horizon du moyen terme les prévisions à court terme (2005-2006) de taux d'intérêt et de taux de change que l'OFCE vient de présenter 76 ( * ) .
A.1. Le scénario général : un résumé
La capacité de résistance de l'économie mondiale aux chocs a été durement éprouvée depuis 2000. Que l'on songe à l'éclatement de la bulle Internet en 2000, aux attentats du World Trade Center en septembre 2001, à la guerre en Irak en mars 2003, aux scandales financiers, à la montée des prix du pétrole depuis 2004, les occasions n'ont à chaque fois pas manqué de s'interroger sur la pérennité de la croissance.
Mais l'économie mondiale a pu maintenir le cap de l'expansion sans tensions inflationnistes majeures. Emmenée par les États-Unis où les réactions de politique économique face aux chocs ont été vigoureuses, la croissance s'est diffusée aussi aux autres zones développées, le Japon et l'Europe, où pourtant l'accompagnement de la politique économique a été bien moins volontariste.
Aux États-Unis, la politique monétaire a réagi dès les premiers signaux d'inflexion du cycle économique au début de 2001, la FED entrant dans une phase d'abaissement continu des taux d'intérêt. Au contraire, la réaction de la Banque Centrale Européenne a été beaucoup plus timorée, le recul des taux ayant été plus tardif et moins ample qu'aux États-Unis. Le même constat vaut pour la politique budgétaire, l'impulsion positive initiée par les baisses d'impôt et relayée par la hausse des dépenses publiques en réaction aux attentats du 11 septembre s'étant prolongée jusqu'en 2003. De fait, de 2001 à 2003, l'impulsion budgétaire aux États-Unis a été de plus de 5 points de PIB. La zone euro, où l'impulsion budgétaire n'a été que de 0,8 point de PIB sur la même période, s'est enfermée dans l'inaction, contrainte par les exigences du Pacte de stabilité et de croissance.
Tableau 1 : impulsions budgétaires cumulées de 2000 à 2005
|
Impulsion cumulée |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Zone Euro |
0.5 |
1.0 |
1.1 |
0.8 |
0.7 |
0.4 |
|
RU |
0.1 |
0.7 |
2.7 |
4.2 |
4.6 |
4.0 |
|
USA |
-0.7 |
0.7 |
3.9 |
4.7 |
5.0 |
5.0 |
|
Japon |
0.5 |
-1.1 |
0.3 |
0.2 |
-0.9 |
-0.8 |
Source : Quarterly National Accounts,
OCDE.
L'impulsion est la variation du déficit structurel
primaire.
Si la politique monétaire a été plus volontariste aux États-Unis que dans la zone euro, elle y a trouvé aussi un terrain plus fertile pour agir sur la croissance. La sensibilité de l'économie américaine aux taux d'intérêt est plus forte qu'en Europe, au travers notamment d'une inclination plus répandue des ménages américains à s'endetter, de la possibilité de recharger les hypothèques 77 ( * ) , ou la facilité de renégociation d'emprunts déjà contractés. Bien que l'endettement bancaire des ménages se soit alourdi dans certains pays, comme en Espagne du fait de l'exubérance du marché immobilier, le taux d'endettement moyen des ménages de la zone est resté très inférieur à celui des ménages anglo-saxons et a peu évolué depuis la baisse franche des taux d'intérêt amorcée en 2000 (graphique 1).
1. Variation de l'endettement et du taux d'épargne
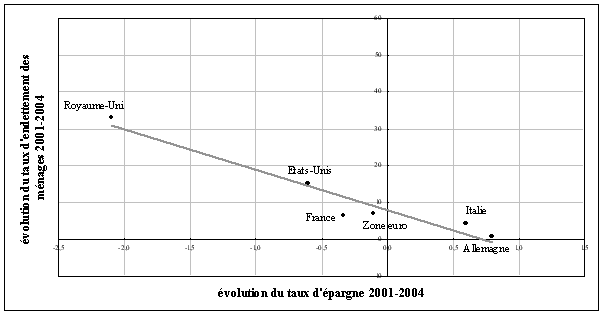
Sources : Comptabilités nationales, banques centrales, calculs OFCE.
La hausse des prix de l'immobilier et de l'endettement s'est avérée être l'essence du mécanisme de transmission de la politique monétaire : les patrimoines immobiliers jusque là potentiels ont été rendus liquides par l'augmentation de l'endettement des ménages acquéreurs. Cette liquidité accrue du patrimoine a induit la baisse de l'épargne des vendeurs finaux et apporté un soutien direct à la consommation 78 ( * ) . La hausse des prix de l'immobilier est le signe que la stimulation monétaire, impulsée par la baisse des taux d'intérêt, fonctionne. Là où la hausse des prix immobiliers est plus vigoureuse, la stimulation est plus efficace.
Le différentiel de croissance en faveur des États-Unis s'est toutefois maintenu au prix d'un creusement de leur déficit courant qui aurait pu aboutir à une crise financière majeure : effondrement du dollar, durcissement de la politique monétaire pour contrecarrer la fuite des capitaux, neutralisation du levier d'action budgétaire résultant de la nécessaire réduction du déficit public, hausse des taux longs assortie d'une prime de risque majorée sur les titres publics américains.
Dans cette partie, dangereuse si elle n'est orchestrée que par un seul joueur contre tous les autres, les États-Unis se sont trouvé des alliés de circonstance qui avaient un intérêt propre à mener un jeu coopératif. Les pays asiatiques, et en particulier la Chine dont le modèle de développement est fondé sur la conquête de marchés extérieurs et l'accumulation d'excédents courants, ne pouvaient laisser se déprécier le dollar contre leur monnaie. En achetant des titres publics américains pour recycler l'excédent courant de leurs économies, les banques centrales asiatiques ont financé le déficit américain, empêché la remontée des taux d'intérêt à long terme, ancré leur monnaie sur le dollar... et maintenu leur devise sous-évaluée par rapport aux autres monnaies, et en particulier l'euro. Le perdant du jeu, qui, passivement, a laissé se dégrader sa compétitivité, a donc été l'Europe.
Cependant, les États-Unis et la Chine n'ont-ils pas encouragé l'accumulation de déséquilibres et différé une crise financière qui sera d'autant plus destructrice qu'elle aura été artificiellement contenue ?
Les déséquilibres pourraient se résorber sans douleur
Les derniers développements de l'économie américaine dissipent ce scénario noir. Les entreprises américaines ont complètement digéré maintenant les excès de la fin des années 90. La forte croissance de la productivité et la dépréciation passée du dollar mordent sur le déficit courant américain. Le dollar, maintenu sous perfusion par les interventions des banques centrales asiatiques, s'apprécie maintenant. Les entreprises américaines ont retrouvé une rentabilité élevée et assaini leurs positions compétitives. Elles regagnent des parts de marché, tant à l'exportation qu'à l'importation et doivent à nouveau investir, appelant des flux de capitaux étrangers. A nouveau, le territoire américain devient plus attractif aux yeux des investisseurs que les pays en voie de développement ou que d'autres zones en croissance. A nouveau les États-Unis peuvent financer leur expansion productive avec un déficit courant important (cf encadré).
|
Encadré : situation des entreprises L'heure est maintenant aux profits, à une dette de qualité, un capital bon marché et à la hausse des indices boursiers. Au regard de différents indicateurs (indices boursiers, endettement, notations de la qualité de la dette obligataire, rendements financiers des sociétés cotés), les entreprises ont touché le fond à la fin 2002 - début 2003. Depuis, leur redressement a été spectaculaire entraînant dans leur sillage les marchés boursiers. Les résultats des sociétés cotées, négatifs en 2002, ont augmenté de plus de 20% en Europe et aux États-Unis en 2004. Ce mouvement de hausse des profits, accompagnée d'une politique de désendettement - entamée dès le début de l'année 2002 aux États-Unis et à partir de 2003 dans la zone euro a amélioré la qualité du crédit obligataire des deux côtés de l'Atlantique comme l'indique le différentiel de « notation » de la dette obligataire des entreprises réalisé par l'agence Moody's (graphique). La rentabilité financière du capital des entreprises cotées, fortement négative en 2002, a connu un rebond spectaculaire en 2003-2004. Si les signaux concernant la situation opérationnelle et financière des entreprises sont bons des deux cotés de l'Atlantique, il existe cependant des divergences notables entre ces deux zones à la fois en matière de politique d'investissement et plus récemment d'évolution des indices boursiers. Notation des entreprises*
*Pourcentage des entreprises dont la notation a été améliorée déduit du pourcentage des entreprises dont la notation a été dégradée. Source : Moody's Les entreprises européennes, qui dégagent des profits élevés, en particulier au niveau des sociétés cotées, les utilisent assez peu pour financer des projets d'investissement en Europe. L'incertitude des perspectives de débouchés et les risques pesant sur la croissance font défaut à une reprise vigoureuse de l'investissement productif des SNF en Europe. Aux États-Unis, le rebond de la FBCF productive a été sans commune mesure avec celui de la FBCF des entreprises européennes (graphique taux investissement). Taux d'investissement productif
Sources : Comptes nationaux Depuis un peu plus d'un an, on observe un décrochage des indices boursiers américains et européens. Entre la mi-août 2004 et la mi-octobre 2005, le Dow Jones ne s'est apprécié que de 2% alors que l'Eurostoxx a augmenté de 30%, le Cac 40 de 27% et le Dax de 34%. Un des éléments d'explication est que le prix des entreprises américaines était surévalué au regard des bénéfices réalisés, à la différence des sociétés européennes qui étaient sous évaluées. Cette différence d'évolution observée sur les places boursières ne serait alors qu'un mouvement de correction vers une situation d'équilibre. Une autre explication est que le rendement financier du capital des sociétés cotées américaines (graphique) est, depuis la fin de l'année 2004, devenu plus faible que celui des pays européens. Cette situation devrait progressivement s'estomper, les entreprises européennes payant dans les mois à venir une politique d'investissement plus frileuse que celle engagée par les sociétés américaines. Rendements financiers des sociétés cotées
Source : Comptes nationaux |
Concrétisation de cette dynamique, le déficit courant cesse de se dégrader et s'est même amélioré au début de l'année 2005. Hors importations pétrolières nettes, l'amélioration est plus significative. La banque centrale du Japon a cessé d'intervenir massivement, le Yen ne présentant plus de tendance à l'appréciation relativement au dollar.
La Chine continue d'accumuler à la fois des excédents extérieurs et des réserves de change. C'est là la condition pour surseoir à l'ouverture de son système financier et l'ouverture de son économie à des capitaux mobiles. Les excédents commerciaux ont pour contrepartie une épargne interne considérable, les réserves de changes permettent de garantir et de soutenir le système financier interne autorisant l'intermédiation de cette épargne vers les investisseurs. Le taux d'intérêt implicite ou explicite proposé aux agents internes est moins élevé que celui que proposeraient les marchés financiers. La stratégie chinoise va donc continuer. Le déficit commercial se creusera avec les pays développés, dont les États-Unis, mais la banque centrale chinoise continuera d'accumuler des réserves et financera en particulier son principal client, les États-Unis.
Les déséquilibres accumulés subsistent, mais la perspective d'une normalisation progressive de la situation gagne en probabilité. Tous les sujets d'inquiétude ne se sont pas évanouis pour autant.
Un risque d'inflation alimentée par un choc pétrolier
Le renchérissement des prix du pétrole en est un. Jusqu'à présent les économies n'ont eu qu'à subir des effets dits de « premier tour », liés à la hausse directe des carburants et des produits dérivés du pétrole. La spirale prix-salaires, à l'oeuvre lors des premiers chocs pétroliers, ne s'est pas mise en place depuis le démarrage de la vague de hausse du pétrole au début 2004. Il n'est bien sûr pas exclu que les hausses quasi-continues du pétrole n'aient finalement raison de la capacité de résistance des agents au renchérissement de l'énergie. La discipline des agents économiques est surprenante, imposée par la rigueur des banquiers centraux ou découlant des pressions déflationnistes qui pèsent par le chômage, la menace de la délocalisation ou la course à la productivité.
Dans le contexte de « règlement pacifique » des déséquilibres de l'économie mondiale, la résurgence de l'inflation au-delà des objectifs fixés par les banques centrales serait particulièrement malvenue car elle pousserait les autorités monétaires à durcir davantage la politique monétaire et à freiner une croissance américaine qui, à partir de 2004, s'était affranchie des impulsions de politique économique et avait gagné en autonomie. Mais au-delà de ces conséquences conjoncturelles, se profile un risque plus important encore. L'économie mondiale a tissé une toile d'endettements et de créances très serrée. Une résurgence de l'inflation induirait de telles tensions entre créditeurs et débiteurs que la résolution de ces conflits plongerait le monde dans une récession sévère. Le débouclage brutal de ces positions est un risque systémique pour l'ensemble du système économique et financier mondial.
Ou une déflation européenne
Paradoxalement, l'autre risque majeur de l'économie mondiale est la déflation. La zone euro illustre ce schéma par lequel elle suivrait, 15 ans après, l'économie japonaise dans une lourde crise dont il est difficile de s'extraire. La faiblesse des performances économiques européennes est liée à l'impuissance de l'Europe à réguler les fluctuations brutales que le capitalisme moderne semble condamné à engendrer. La faiblesse de la croissance en retour accroît le chômage et compromet le pacte de redistribution. Explicitement (réformes structurelles en tout genre) ou implicitement (poids du chômage sur les salaires réels menace de délocalisation), le partage de la valeur ajoutée se fait au profit des producteurs. Les ressorts internes de la croissance sont brisés et la pression de la concurrence ronge les salaires et les prix. Alors que le prix du pétrole flambe, l'inflation « sous jacente » en Europe ralenti à des rythmes qui sont pratiquement indiscernables de la décroissance. Que cela se prolonge, ou que le prix du pétrole chute brusquement, l'économie de la zone euro entrera dans une dangereuse spirale déflationniste.
2: Inflation sous jacente zone euro et États-Unis
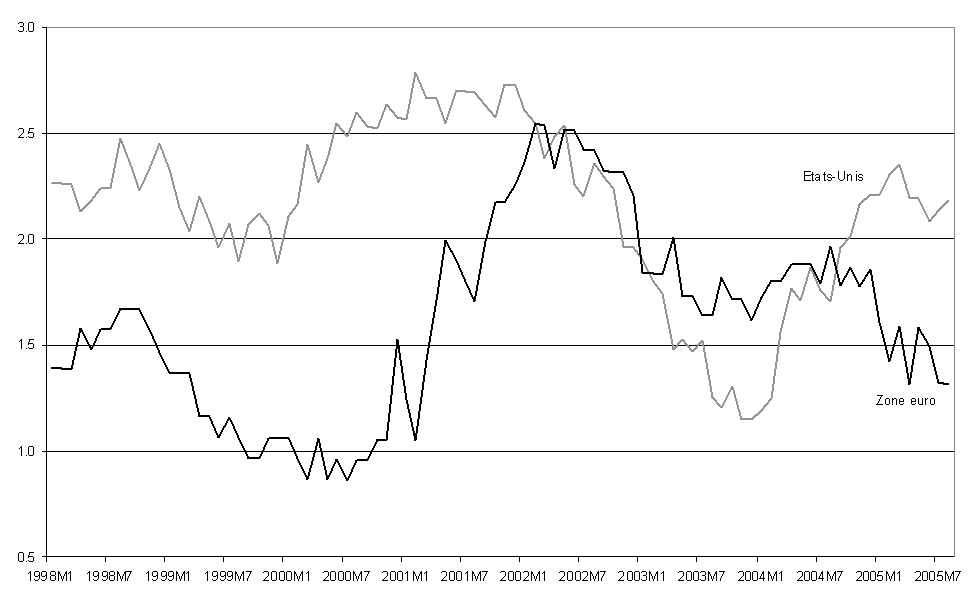
Source : Comptes nationaux
A plus long terme encore, la faible croissance pèse sur les capacités d'investissement de chacun, que ce soit les entreprises, les Etats ou les individus et entame le potentiel de croissance (voir encadré). L'absence de régulation conjoncturelle, fait ainsi courir des risques bien plus forts qu'avoir des cycles plus marqués autour d'une tendance immuable. Oublier également que la régulation conjoncturelle doit lutter contre l'inflation autant que contre la déflation est une position dangereusement asymétrique.
|
Encadré : Le grand écart des croissances potentielles Les faibles performances de croissance du Pib dans la zone euro comparées à celles enregistrées aux États-Unis et au Royaume-Uni sont à relativiser au regard des différentiels de croissance potentielle : un des principaux moteurs de cette dernière, les fluctuations de la population active, éclaire les différences observées entre économies. Le ralentissement de la croissance de la population active observé au cours de la dernière décennie dans la plupart des pays industrialisés - causé entre autres par le vieillissement des populations, la réduction des soldes migratoires, la fin du rattrapage de l'emploi féminin - pèse sur la potentiel de croissance (voir tableau 1). Tableau E1. Evolution de la croissance potentielle |
|
Croissance potentielle |
Population active |
Productivité potentielle du travail |
||||
|
Variation annuelle moyenne en % |
1992 - 2000 |
2001 - 2004 |
1992 - 2000 |
2001 - 2004 |
1992 - 2000 |
2001 - 2004 |
|
France |
2,0 |
2,1 |
0,7 |
0,9 |
1,3 |
1,2 |
|
Allemagne |
1,6 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,4 |
|
Espagne |
2,9 |
3,0 |
1,6 |
1,6 |
1,3 |
1,4 |
|
Italie |
1,4 |
1,2 |
-0,3 |
0,7 |
1,7 |
0,5 |
|
États-Unis |
3,3 |
3,0 |
1,4 |
0,8 |
1,9 |
2,2 |
|
R-U |
2,6 |
2,5 |
0,4 |
0,9 |
2,2 |
1,6 |
Sources : OCDE et données nationales
|
Malgré une réduction récente dans la plupart des pays industrialisés, la croissance potentielle demeure plus vigoureuse chez nos partenaires anglo-saxons. En particulier, la productivité potentielle du travail (différentiel entre la croissance potentielle et celle de la population active) - plus élevé aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'en Europe - accélère chez notre partenaire américain tandis qu'elle se réduit sur notre continent. Ce ralentissement européen n'est pas lié aux arguments de « structure » couramment employés concernant les rigidités spécifiques du marché du travail mais à une faiblesse récente de la productivité globale des facteurs79 ( * ) |
: alors qu'elle progressait plus rapidement en France et en Allemagne qu'aux
|
États-Unis jusqu'au tournant du millénaire, un très fort écart se creuse depuis 2000 (voir graphique 1). La rupture observée en 2000 ne traduit pas uniquement des éléments conjoncturels - bien que les États-Unis n'aient pas connu la fin de cycle économique observée en Europe - mais présente des explications et effets structurels.
Graphique E1. Productivité globale horaire des
facteurs
(glissement sur cinq ans, en %)
Sources : OCDE et données nationales, calculs OFCE
La productivité globale horaire des facteurs (ð) du
secteur privé est calculée via son taux de croissance
La baisse de la productivité en Europe est pour partie due à des effets réversibles. Le creux conjoncturel y ayant duré davantage qu'aux États-Unis, l'investissement privé a été plus durement touché. Par ailleurs, les contraintes du pacte de stabilité et de croissance ont pesé sur finances publiques : ne pouvant faire face à l'augmentation de l'écart entre recettes et dépenses en période de faible croissance, les gouvernements ont rogné sur les investissements. Le rebond observé aux États-Unis (voir graphique 2) est donc exceptionnel au regard des autres économies. Le nouveau régime de croissance fondé sur l'investissement et la productivité observés aux États-Unis leur a permis de maintenir leur économie à flot pendant la crise : par effet d'hystérèse, l'absence de fluctuation de court terme soutient le potentiel de croissance à plus longue échéance. A l'opposé, l'absence de régulation conjoncturelle en Europe pèse sur le potentiel de croissance des prochaines années. Ayant préféré soutenir l'emploi en période de chômage massif, la France et l'Allemagne ont connu une déqualification et une baisse de la productivité (voir graphique 3). Ainsi, puisque la croissance du PIB est liée au produit des croissances du taux d'emploi et de la productivité, le maintien du taux d'emploi, voire son augmentation, permet de compenser les baisses de productivité. Malheureusement, l'Allemagne a perdu sur les deux tableaux. En ce qui concerne les États-Unis, ce dernier graphique nuance la forte hausse de la productivité qui s'est réalisée au prix d'une chute du taux d'emploi ; l'impact en terme de croissance en est donc moindre. Graphique E 2. Part de l'investissement brut hors logement dans le PIB Indice 100 en 2000
Source : OCDE, calculs OFCE L'investissement est la somme des investissements public et privé hors logement. Graphique E 3. Taux d'emploi et productivité globale horaire des facteurs En %, moyennes sur la période et régression linéaire sur 2001-04
Source : OCDE et données nationales, calculs OFCE Le taux d'emploi est le rapport du nombre de personnes employées sur la population active. |
Tour du monde : vers le rééquilibrage ?
Après une année 2004 de croissance record à 5%, l'économie mondiale retrouverait à l'horizon 2006 un rythme de croissance plus proche de son potentiel (4,2% en 2005 et 4,1 % en 2006). Les pays en voie de développement et l'Asie en particulier continueraient de tirer vers le haut la croissance mondiale. S'ils représentent moins de la moitié du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat (PPA), ils contribuent à hauteur de 68% à la croissance totale. La Chine à elle seule y contribuerait à hauteur de 28% en 2005. Parmi les pays industrialisés, les États-Unis resteront le premier pôle de croissance, contribuant pour plus de moitié à la croissance de la zone OCDE, et pour 18% à la croissance mondiale.
Après une année 2004 exceptionnelle (4,2%), la croissance aux États-Unis se stabiliserait autour de son rythme potentiel (3,5% en 2005 et 3,2% en 2006). Si l'écart se resserre avec la zone euro, les performances outre-atlantique resteraient nettement supérieures à celles du vieux continent (voir plus bas : « Une zone euro toujours en petite forme »). Derrière ce dynamisme se cache une demande intérieure solide, soutenue par un rebond des investissements depuis 2004 - les entreprises ont assaini leur situation financière et profitent du bas niveau des taux d'intérêt longs - et par la vigueur de la consommation des ménages - la progression du revenu et la baisse du taux d'épargne font plus que compenser la hausse du niveau général des prix. La flambée des prix du pétrole n'a jusqu'à présent pas généré d'effets de second rang sur l'inflation, mais le risque n'est pas exclu à l'horizon 2006. Autre point à surveiller : le taux d'endettement des ménages atteint des sommets avec l'engouement des américains pour l'immobilier. La reprise du marché du travail et la poursuite du cycle d'investissement comptent parmi les facteurs qui viendront soutenir la croissance jusqu'en 2006. Le ralentissement serait imputable au resserrement modéré des conditions monétaires. En outre, l'économie américaine est désormais moins dépendante de l'impulsion budgétaire et le déficit courant cesse de se dégrader - il se stabilise autour de 6,3% du PIB.
Au Royaume-Uni, l'économie a fortement ralenti au deuxième trimestre 2004, et la bonne performance de 2004 (3,2%) ne sera pas renouvelée en 2005 et 2006 (1,7% et 2,2%). La hausse des taux d'intérêt a freiné l'activité intérieure, alors qu'aucun soutien à la croissance n'est venu de l'environnement extérieur. La consommation des ménages a nettement ralenti et l'industrie manufacturière se trouve au bord de la récession. L'impulsion budgétaire serait légèrement négative en 2005 et 2006, et seule une politique monétaire accommodante permettrait à l'économie de redémarrer doucement en 2006. L'économie outre-manche semble aujourd'hui moins profiter de la croissance américaine, et ses performances se rapprochent de celles de la zone euro.
L'économie japonaise, au contraire, sort enfin la tête de l'eau. La croissance au premier semestre 2005 a été supérieure aux prévisions grâce à la bonne tenue de la consommation des ménages et à la poursuite des investissements productifs. Le commerce extérieur, moteur traditionnel de la reprise nippone, a joué un rôle moins important au début de l'année, les exportateurs nippons ayant pâti des ajustements en cours dans le secteur des NITC. Le taux d'épargne se réduit progressivement tandis que la situation s'améliore sur le front de l'emploi, avec une augmentation des embauches en contrats réguliers. L'assainissement du secteur financier a permis aux entreprises d'emprunter pour financer leurs investissements. Après une première année de reprise en 2004 (2,6% de croissance), l'économie nippone resterait dynamique en 2005 et 2006 (2,2% et 1,9%), soutenue par le redémarrage du commerce extérieur, de plus en plus orienté vers l'Asie. La confiance des ménages et la reprise de l'investissement logement permettraient à la demande intérieure de prendre le relais de la croissance. Si l'évolution des prix est aujourd'hui encore négative, le Japon devrait sortir de la déflation à l'horizon 2006.
La croissance en Asie continue sa course en tête, entraînée par la performance chinoise. La forte demande des États-Unis pour les exportations asiatiques, une inflation modérée et une position financière extérieure largement excédentaire ont permis à l'Asie d'atténuer l'impact négatif des prix élevés du pétrole. Après une performance exceptionnelle de 7,9% en 2004, la croissance se maintiendrait à 7,3% en 2005 et 7,1% en 2006. L'économie serait soutenue dans plusieurs pays d'Asie du sud-est par la phase de reprise du cycle des semi-conducteurs. Mais la Chine resterait le moteur de la zone, grâce au dynamisme de la consommation et à des gains toujours aussi forts de parts de marché. L'inflation demeure modérée en Asie, mais les politiques de subventions des prix de l'énergie pratiquées par de nombreux pays pourraient bien faire l'effet d'une bombe à retardement.
L'envolée des prix du brut profite à l'Amérique latine, exportatrice nette de pétrole, qui accumule des excédents commerciaux très élevés en 2005. Outre le soutien de l'environnement international, la consolidation des dynamiques de demande intérieure s'est poursuivie, avec un boom de l'investissement productif et une consommation privée bien orientée. Après des performances exceptionnelles en 2004 (6,2% de croissance en moyenne), l'activité progresserait à un rythme toujours soutenu en 2005 et 2006 (4% et 3,6%). Ce ralentissement serait imputable à l'appréciation des taux de change effectifs réels et à des politiques économiques relativement restrictives dans les pays les plus inflationnistes. Les exportations continueront cependant d'être portées par le dynamisme de la croissance aux États-Unis et en Chine, la part de l'Asie dans les exportations sud-américaines ayant presque doublé en 4 ans.
Quant aux pays d'Europe centrale et orientale, leur phase de rattrapage se poursuit, mais à un rythme moins effréné qu'en 2004. Les nouveaux pays membres de l'Union européenne tirent leur épingle du jeu en 2006, avec une croissance de 4,5% après 3,7% en 2005 et 4,5% en 2004. La discipline budgétaire et fiscale, la forte productivité du travail et l'appréciation des taux de change effectifs contiennent les pressions inflationnistes, mais pèsent sur la demande intérieure. La reprise progressive des importations de la zone euro dynamise les exportations des nouveaux pays membres et contribuent à l'accélération de la croissance en 2006. La situation a plutôt tendance à se dégrader pour les autres pays de la zone : la Roumanie et la Bulgarie demeurent dans une situation macroéconomique incertaine et les autres économies de l'ancienne sphère soviétique souffrent d'instabilité monétaire et politique et sont contraintes d'engager des mesures pour stabiliser l'inflation. Quant à la Russie, on anticipe un ralentissement de ses revenus d'exportations énergétiques, et la demande interne ne prendrait pas le relais.
Une zone euro toujours en petite forme
Confirmant le ralentissement initié au second semestre 2004, la croissance a été atone au premier semestre 2005 (0,3% chaque trimestre). La reprise n'aura donc pas eu le temps de s'installer, la zone euro restant nettement à la traîne des autres zones (avec une croissance de seulement 1,8% en 2004, soit inférieure à son rythme potentiel). Ce schéma devrait se poursuivre à l'horizon de notre prévision, avec une croissance de 1,3% en 2005 et de 1,9% en 2006. Une croissance plus vigoureuse n'est cependant pas à exclure, selon les prévisions de croissance de l'indicateur avancé pour le second semestre 2005 (encadré 1). La consommation des ménages, qui avait jusqu'alors soutenu la croissance, a commencé à montrer des signes de faiblesse début 2005 (0,1% chaque trimestre). Certes les créations d'emplois ont un peu accéléré -avec pour conséquence une légère baisse du taux de chômage depuis fin 2004, pour atteindre 8,7% au deuxième trimestre 2005 -, mais face aux incertitudes pesant sur l'activité économique, les ménages ont augmenté leur taux d'épargne. L'amélioration progressive de l'emploi et la baisse du taux d'épargne en 2006 permettraient à la consommation de réaccélérer un peu, mais elle resterait bridée par un faible pouvoir d'achat. Quant à l'investissement, un léger mieux se dessine depuis quelques trimestres, malgré un trou d'air au premier trimestre 2005. Mais, la faiblesse de la consommation et des débouchés extérieurs a empêché une véritable reprise. Avec la dépréciation de l'euro et donc une croissance des exportations plus forte en 2006, ainsi qu'avec le léger mieux attendu concernant la consommation, l'investissement accélèrerait. Le commerce extérieur cesserait de peser sur la croissance en 2006, avec une contribution légèrement positive (+0,3 point).
Alors que la plupart des exportateurs avaient comprimé leurs marges à l'export depuis 2002, la dépréciation de l'euro leur a donné un peu d'air, leur permettant d'augmenter leurs prix à l'extérieur de la zone (graphique 1). Cependant, du fait du renchérissement du prix du pétrole, les indices de valeur unitaire à l'import extra-zone ont fortement augmenté, conduisant à une dégradation des termes de l'échange. Au premier semestre 2005, ce n'est donc pas tant la mauvaise performance à l'exportation de la zone qui a plombé le solde commercial que la facture énergétique : alors qu'en 2004, la dégradation du solde des produits énergétiques par rapport à 2003 avait atteint 17 milliards d'euros, sur les seuls six premiers mois de l'année 2005, elle a représenté 26 milliards par rapport à la même période de 2004.
Graphique 3 : taux de change de l'euro et indices de valeur unitaire
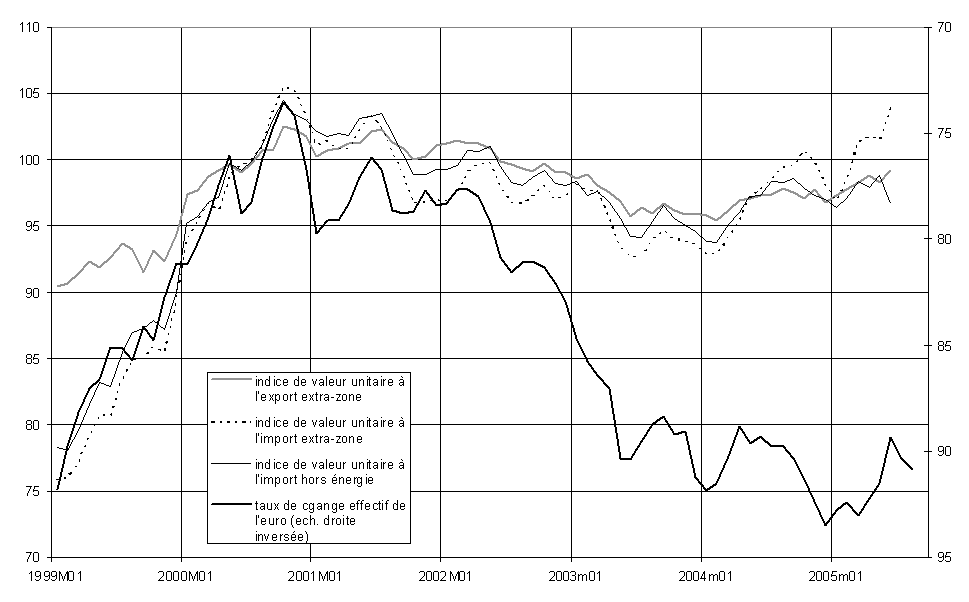
Sources : Eurostat, calculs OFCE.
Malgré la hausse du prix de l'énergie, les prix à la consommation n'ont que peu accéléré depuis le début de l'année 2005 dans la zone euro (graphique 2). Aucun effet de second rang ne s'est pour l'instant mis en place. Au contraire, le renchérissement du prix du pétrole cache même un net ralentissement des prix des produits manufacturés, qui croissent désormais à un rythme annuel nul, poussés à la baisse par la chute du prix de ces importations. Ils sont même en recul en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, pays où les coûts salariaux unitaires dans l'industrie se contractent nettement. L'inflation sous-jacente est donc plutôt en ralentissement, à 1,3% en août 2005. Avec la stabilisation du cours du pétrole, l'inflation ralentirait en 2006 (à 1,6% en moyenne annuelle).
Graphique 4 : inflation dans la zone euro
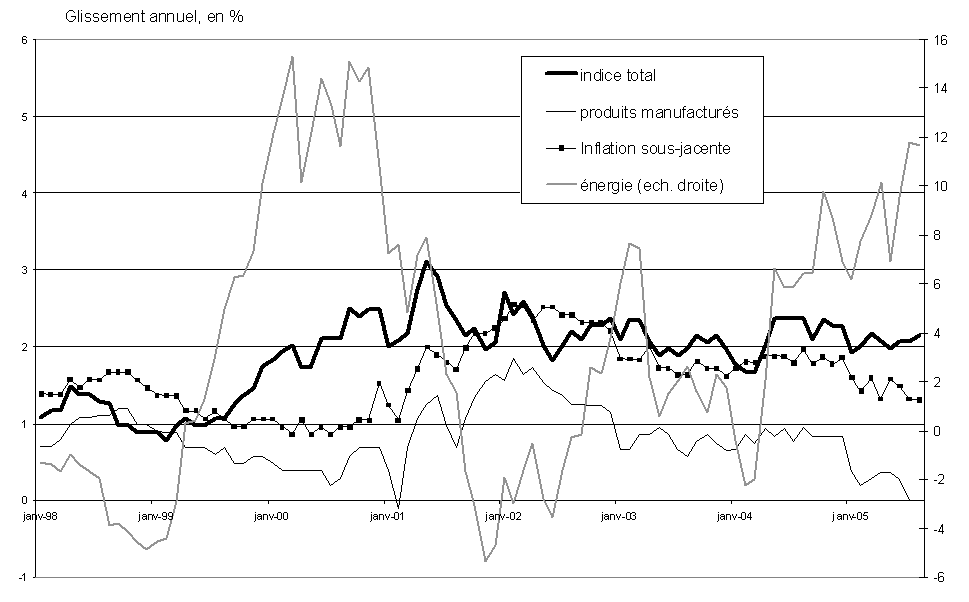
Sources : Eurostat .
Des performances hétérogènes au sein de la zone euro
En 2006, parmi les principaux pays de la zone, ce sont surtout la France et l'Espagne qui tireront la croissance (respectivement 2,2% et 2,9%). Mais, alors que la France verrait sa croissance accélérer, celle de l'Espagne ralentirait, sous le poids de déséquilibres croissants (endettement élevé des ménages notamment). Les Pays-Bas croîtraient au même rythme que la zone euro, après une année 2005 morose. Quant à l'Allemagne et à l'Italie, leur croissance accélèrerait, mais elle resterait bien inférieure à celle de la zone euro (respectivement 1,4% et 1,2%).
Si les divergences en terme de taux de croissance devraient s'atténuer entre les pays, ce serait moins le cas en ce qui concerne les sources de cette croissance. Les Pays-Bas et l'Allemagne continueraient de bénéficier d'une contribution des échanges extérieurs nettement positive (respectivement 1 point et 1,3 point en 2006). Pour l'Allemagne, ce serait son principal soutien : la stratégie de réduction des coûts mise en place par les entreprises pour préserver leur compétitivité a durablement plombé la demande intérieure. Certes, la croissance de la consommation privée et celle de l'investissement productif redeviendraient positives en 2006, mais ceci ne suffirait pas à enclencher une vraie dynamique interne, d'autant plus que l'investissement en construction resterait déprimé. En Italie, aucun soutien de l'extérieur n'étant à attendre (avec une contribution nulle en 2006), tout repose sur la demande intérieure. Celle-ci accélèrerait, principalement du fait d'une meilleure tenue de l'investissement, mais elle resterait relativement faible, en raison notamment d'une moins bonne orientation du marché du travail que précédemment. Enfin, la France et surtout l'Espagne, qui ont beaucoup pâti d'une contribution extérieure négative en 2003 et 2004, verraient cette situation s'améliorer grâce à la dépréciation de l'euro, la contribution extérieure devenant moins négative en 2006 (respectivement -0,4 point et -1,4 point). La demande intérieure resterait le moteur de la croissance dans ces pays, même si elle décélèrerait un peu en Espagne.
Les divers schémas à l'oeuvre dans les principaux pays de la zone euro se reflètent dans la situation de leur balance courante (graphique 3). L'Allemagne, qui gagne dorénavant des parts de marché, notamment au détriment de ses principaux partenaires de la zone euro, accumule un excédent courant de plus en plus important, malgré la facture énergétique. Il a ainsi atteint 4,2% du PIB au deuxième trimestre 2005. C'est aussi le cas des Pays-Bas, avec un excédent représentant plus de 6% du PIB. En revanche, en Italie et en France, le solde courant est légèrement négatif, autour de 2,5% du PIB. Face à l'appréciation de l'euro, les exportateurs français ont plus souffert que ceux allemands, subissant de nettes pertes de parts de marché. En effet, si les entreprises françaises ont réduit leurs coûts, ce mouvement a été moindre qu'en Allemagne, entraînant une détérioration de la compétitivité des produits français par rapport à ceux allemands. De plus, l'orientation des exportations françaises est toujours pénalisante, avec une part plus élevée que l'Allemagne de ventes vers les pays de la zone euro et encore peu d'exportations vers les pays de l'est ou l'Asie. Quant à l'Espagne, la dégradation du déficit courant est impressionnante, celui-ci atteignant 8,1% du PIB au deuxième trimestre 2005. Non seulement l'Espagne perd des parts de marché depuis 2002, les avantages liés à son entrée sous-évaluée dans la zone euro s'épuisant peu à peu du fait du différentiel d'inflation avec ses principaux partenaires, mais la demande intérieure très dynamique conduit aussi à de fortes importations, ce qui explique l'ampleur de ce déséquilibre.
Graphique 5 : solde courant en % du PIB
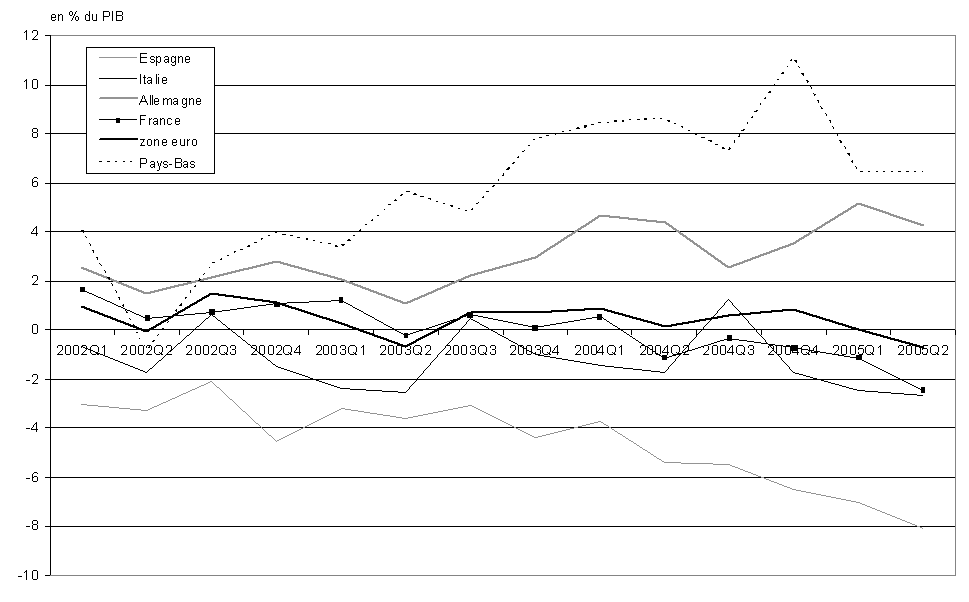
Sources : Banques centrales nationales, Global Insight.
A.2. Politiques budgétaires
En 2005, l'orientation de la politique économique s'est inversée des deux cotés de l'Atlantique (graphique 6). Aux États-Unis, les contributions de la politique budgétaire et des conditions monétaires à la croissance ont été négatives (encadré 3). Dans la zone euro, la neutralité budgétaire s'est couplée d'une sensible détente des conditions monétaires. La politique économique n'apparaît donc plus comme l'élément dominant de la différence des performances de croissance entre les deux zones (tableau 2). Au Royaume-Uni, la politique budgétaire ne soutient plus la croissance et le déficit public se réduit légèrement, tout en restant à 3 % du PIB. Au Japon, en revanche, malgré un certain ralentissement de la croissance, la politique budgétaire abandonne son orientation fortement restrictive de 2004 pour devenir neutre, ce qui ne permet aucune amélioration des comptes publics.
Tableau 2. Positions budgétaires aux
États-Unis,
en Europe et au Japon
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Moyenne
|
|
|
Croissance du PIB (en %) |
|||||
|
Zone euro |
0,7 |
1,8 |
1,3 |
1,9 |
1,4 |
|
États-Unis |
2,7 |
4,2 |
3,5 |
3,2 |
3,4 |
|
Royaume-Uni |
2,5 |
3,2 |
1,7 |
2,2 |
2,4 |
|
Japon |
1,4 |
2,6 |
2,2 |
1,9 |
2,0 |
|
Solde public (en % du PIB) |
|||||
|
Zone euro |
-3,0 |
-2,7 |
-2,9 |
-2,8 |
-2,9 |
|
États-Unis |
-5,0 |
-4,7 |
-4,2 |
-4,4 |
-4,5 |
|
Royaume-Uni |
-3,2 |
-3,1 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,1 |
|
Japon |
-7,7 |
-6,1 |
-6,1 |
-5,3 |
-6,3 |
|
Impulsion budgétaire
|
|||||
|
Zone euro |
0,1 |
-0,4 |
0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
|
États-Unis |
1,1 |
0,4 |
-0,4 |
0,1 |
0,3 |
|
Royaume-Uni |
1,5 |
0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
0,3 |
|
Japon |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,5 |
1. Opposé de la variation du solde structurel primaire. Un chiffre positif indique une politique budgétaire expansionniste.
Sources : Comptes nationaux, Eurostat, calculs et prévision OFCE octobre 2005.
Graphique 6. Indicateurs de rigueur monétaire et budgétaire 2003-2006
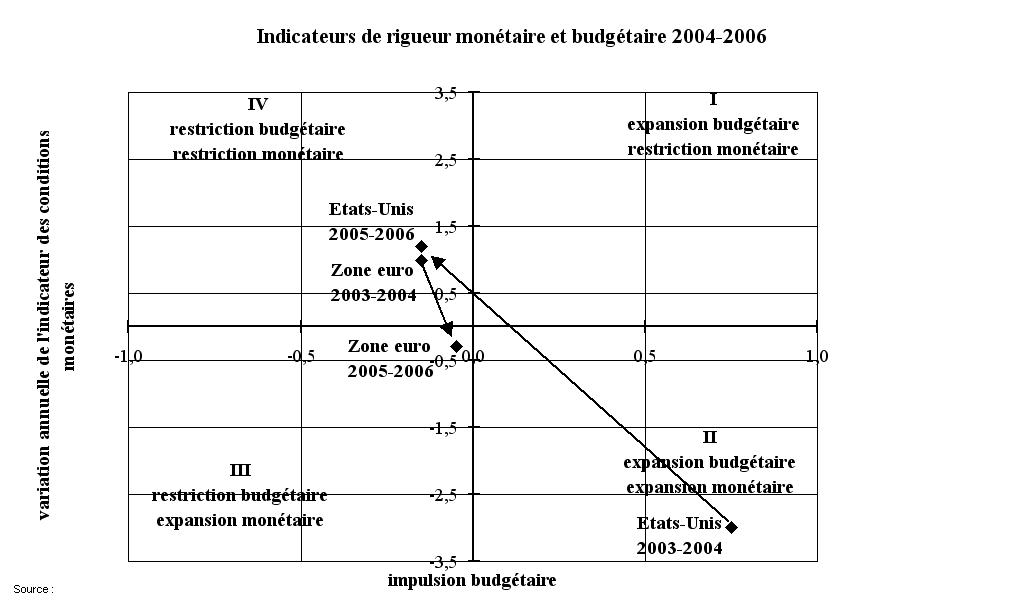
Source : BEA, Réserve fédérale,
BLS, OCDE, Eurostat, calculs et prévision OFCE,
octobre
2005.
2005 : la tenue du nouveau PSC
En 2005, le déficit budgétaire de la zone euro (2,9 % du PIB) se détériorerait, érodant ainsi l'amélioration engrangée en 2004 (2,7 % après 3 % en 2003). Par rapport à 2004, lorsque la politique discrétionnaire entraînait 0,4 point d'amélioration du solde public, l'orientation budgétaire s'inverserait, fournissant une impulsion à peine positive (0,1 point de PIB, tableau 2). L'impact plus négatif de la conjoncture sur le solde (-0,3 point de PIB contre -0,1 en 2004) témoigne de l'opportunité de cet arrêt de la restriction budgétaire. Les pays de la zone euro bénéficieraient d'un recours accru aux recettes exceptionnelles (+0,1 point de PIB contre -0,2 point en 2004), mais pas de la baisse des charges d'intérêts, qui s'interromprait. En effet, malgré le bas niveau des taux longs européens, la hausse de la dette priverait, pour la première fois depuis 1997, les pays de la zone de cette voie d'amélioration du solde.
3. Contribution à la variation du solde public en 2005
|
En % du PIB |
États-Unis |
Zone euro |
|
Solde des APU 2005 |
-4,2 |
-2,9 |
|
Solde des APU 2004 |
-4,7 |
-2,7 |
|
Variation 2004-2005 |
0,5 |
-0,2 |
|
Mesures exceptionnelles* |
0,0 |
0,2 |
|
Impact de la conjoncture |
0,2 |
-0,3 |
|
Charges d'intérêts |
0,0 |
0,0 |
|
Mesures discrétionnaires |
0,5 |
-0,1 |
Un impact négatif de la conjoncture prend le signe (-) car il détériore la composante cyclique du solde ; une hausse de la charge d'intérêts prend le signe (-) car elle dégrade le solde public ; une politique discrétionnaire expansionniste prend le signe (-) car elle détériore le solde structurel primaire.
Sources : Comptes nationaux, Eurostat, calculs et prévision OFCE, octobre 2005.
* Il s'agit de mesures de nature temporaire, ayant pour effet une hausse de recettes, le plus souvent, ou une baisse de dépenses, plus rarement, et conduisant à une amélioration non structurelle du solde public (soultes, titrisations...).
Cinq pays appartenant à la zone euro, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce, présenteraient un déficit encore supérieur à 3 % en 2005 (tableau 7). Les Pays-Bas et l'Autriche s'approcheraient de cette valeur. La Finlande parviendrait à réduire significativement son excédent, tout comme la Belgique et l'Irlande qui le transformeraient même en déficit.
A l'exception de l'Espagne, qui ramènerait son solde à l'excédent, ainsi que de la France, de l'Allemagne et de la Grèce, dont le déficit de réduirait, tous les autres pays de la zone euro connaîtraient une détérioration de leurs finances publiques. Tous les pays dont le déficit est prévu en hausse pratiqueraient une impulsion budgétaire positive, ou nulle, à l'exception des Pays-Bas qui poursuivraient une restriction budgétaire de même ampleur qu'en 2004 (0,7 point). L'orientation budgétaire expansionniste serait particulièrement marquée en Autriche (impulsion budgétaire égale à +1,2 point de PIB), en Irlande (1,1 point) et au Portugal (0,8 point). Mais au Portugal, la fin du recours aux recettes exceptionnelles, comprises entre 1 et 2 points de PIB depuis 2002, expliquerait en grande partie la dégradation du déficit public.
En France, et surtout en Grèce, la politique budgétaire serait restrictive, mais la réduction du déficit s'appuierait sur des recettes exceptionnelles de l'ordre de respectivement 0,5 et de 1,0 point de PIB. En Allemagne également, des recettes extraordinaires se montant à 0,5 point de PIB permettraient une baisse du déficit, malgré la neutralité de la politique budgétaire. Cette même neutralité en Italie contribuerait à la forte hausse du déficit, en l'absence de recettes exceptionnelles, en rupture avec la moyenne de 1,3 point de PIB par an sur les quatre dernières années. Il n'y a qu'en Espagne que l'impact positif de la conjoncture sur le solde public permettrait de dégager un excédent, malgré une politique expansionniste. Dans tous les autres pays, la composante conjoncturelle du solde public se dégraderait, notamment en Italie, en Finlande et en Grèce, où le taux de croissance du PIB serait le plus éloigné du potentiel. Les charges d'intérêts contribueraient encore positivement aux finances publiques dans la plupart des pays de la zone euro, à l'exception des Pays-Bas, du Portugal et de la Finlande, où la hausse de la dette en a interrompu le mouvement à la baisse.
Globalement, la politique budgétaire en 2005 serait moins restrictive qu'annoncée dans les Programmes de stabilité de décembre 2004. Mais la dérive du déficit ne serait pas que de nature structurelle, car la plus faible croissance du PIB dégraderait de 0,5 point le solde public (tableau 4). La politique discrétionnaire moins restrictive de 0,4 point de PIB serait en partie compensée par une plus forte baisse des charges d'intérêts qu'anticipée, mais aussi par un déficit en 2004 moins important qu'annoncé dans les Programmes.
Les plus grands écarts par rapport au déficit prévu dans les Programmes ont été réalisés par le Portugal, la Grèce, l'Italie et la Finlande. Pour la Grèce, la dérive est principalement imputable à la révision à la hausse des déficits passés. L'effet négatif de la révision des prévisions de croissance a été assez significatif dans tous ces pays, et particulièrement en Italie. Cependant, l'orientation beaucoup moins restrictive de la politique budgétaire discrétionnaire a creusé d'autant le déficit italien et, au Portugal, elle explique plus des deux tiers de la déviation du déficit de son objectif. La France et l'Allemagne n'ont pas non plus respecté leur objectif, mais cela est principalement dû à une conjoncture plus dégradée que prévu. L'Espagne, les Pays-Bas et l'Irlande ont au contraire surpassé leurs engagements, principalement grâce à un meilleur résultat de leurs comptes publics passés.
4. écart entre prévisions pour 2005 et
Programmes de stabilité
de décembre 2004 dans la zone
euro
|
En % du PIB |
|
|
Croissance du PIB en 2005 prévue dans le Programme de stabilité de décembre 2004 |
2,2 |
|
Croissance du PIB en 2005 (prévision OFCE) |
1,3 |
|
Solde des APU en 2005 prévu dans le Programme de stabilité de décembre 2004 |
-2,3 |
|
Solde des APU en 2005 (prévisions OFCE) |
-2,9 |
|
Écart du solde des APU |
-0,6 |
|
Dû à : effet de base (révision déficit 2004) |
0,2 |
|
impact de la conjoncture |
-0,5 |
|
variation de la charge d'intérêts |
0,1 |
|
mesures discrétionnaires |
-0,4 |
Un impact négatif de la conjoncture prend le signe (-) car il détériore la composante cyclique du solde ; une hausse de la charge d'intérêts prend le signe (-) car elle dégrade le solde public ; une politique discrétionnaire expansionniste prend le signe (-) car elle détériore le solde structurel primaire.
Sources : Comptes nationaux, Programmes de
stabilité, calculs et prévisions OFCE,
octobre 2005.
Suite à l'assouplissement du volet répressif du Pacte de stabilité lors de la réforme intervenue au mois de mars 2005, certains ont craint le recours à de plus amples marges de manoeuvre en matière budgétaire. Cependant, les prévisions pour l'année 2005 ne montrent pas une dérive plus importante cette année que lors de l'ancienne version du Pacte de stabilité. L'écart par rapport aux objectifs des Programmes y est certainement plus grand en 2005 qu'en 2004, mais il est nettement moindre que de 2001 à 2003 (graphique 7).
Graphique 7. Ecart entre prévisions des
Programmes de stabilité
et
réalisations*
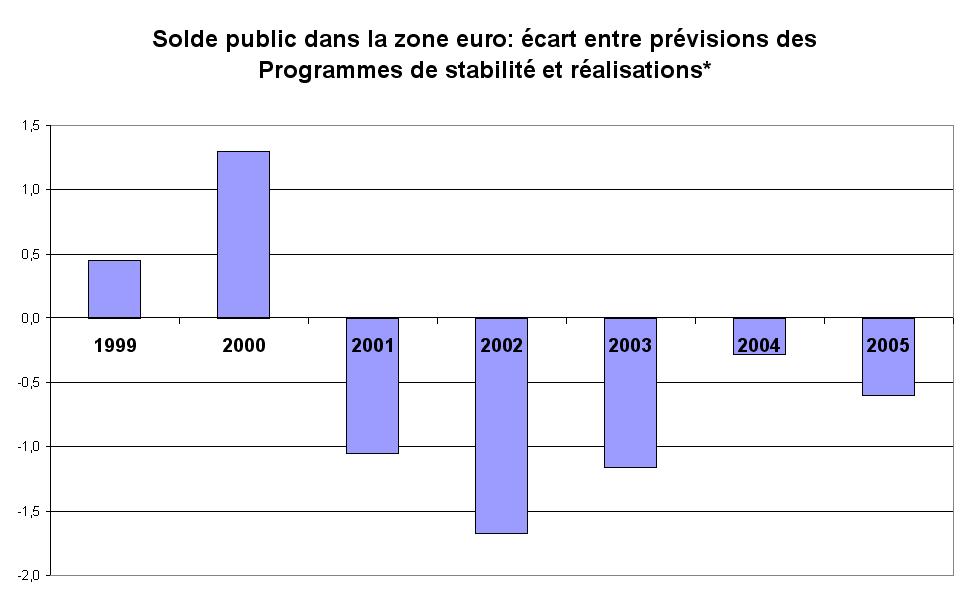
* Pour l'année 2005, les engagements des Programmes de stabilité et de croissance sont comparés aux prévisions d'octobre 2005 de l'OFCE
Sources : Comptes nationaux, Programmes de
stabilité, calculs et prévisions OFCE,
octobre 2005.
Ce résultat est d'autant plus évident si l'on corrige l'écart du solde public par rapport aux objectifs des Programmes de stabilité des effets des erreurs de prévision de la croissance du PIB : les écarts ont été plus importants sur la période 2001-2004 qu'en 2005 (graphique 8).
Graphique 8. écart entre prévisions des
Programmes de stabilité
et réalisations* corrigé des
erreurs de prévision de croissance
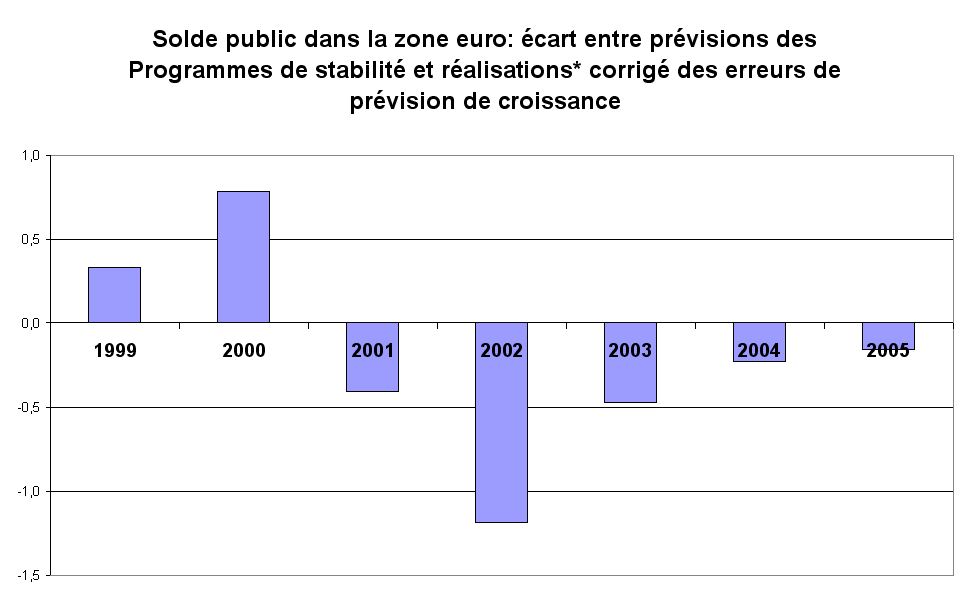
Sources : Comptes nationaux, Programmes de stabilité, calculs et prévisions OFCE, octobre 2005.
La surveillance multilatérale en 2005
Deux autres pays appartenant à la zone euro, l'Italie et le Portugal, font l'objet d'une procédure de déficit excessif au cours de l'année 2005. Deux autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Hongrie, ont vu s'ouvrir une procédure à leur encontre. Les Pays-Bas et la Grèce, qui présentaient aussi un déficit excessif respectivement en 2003 et en 2003 et 2004, ont vu la procédure respectivement close et suspendue en raison de leurs efforts budgétaires. Le gouvernement hollandais avait, pour sa part, déjà mis en place en 2004 un collectif budgétaire réduisant le déficit structurel de 0,6 point de PIB en 2004 et annoncé des mesures dans la Loi de finances de 2005 conduisant à une baisse de 0,5 point en 2005. En Grèce, bien que les mesures annoncées dans la Loi de finances pour 2005, 1,9 point de PIB, n'aient pas été jugées suffisantes pour corriger le déficit excessif dès 2005, au mois de février 2005, la Commission a reporté l'échéance pour ramener le déficit sous les 3 % du PIB à 2006. Ce délai vise à permettre à la Grèce de corriger son déficit excessif « de manière durable et équilibrée ». Un collectif budgétaire de 0,5 point de PIB est intervenu en mars 2005, conduisant aussi à une amélioration de 0,9 point de PIB du solde public en 2006, bloquant ainsi le passage à l'étape de sanction de la procédure.
L'Italie, qui présente un déficit supérieur aux 3 % prévus par le PSC depuis 2003, a bien profité du récent assouplissement du volet répressif du Pacte de stabilité. Celui-ci permet à un pays d'alléger les contraintes de la procédure de déficit excessif, non seulement en cas de forte récession (baisse de 2 % du PIB), mais aussi en cas de faiblesse prolongée de la croissance. La stagnation de l'économie italienne permet donc la reconnaissance de l'existence de circonstances exceptionnelles autorisant le report de l'échéance pour corriger l'excès de déficit à 2007. Par conséquent, le gouvernement italien a aligné son objectif de déficit en 2005 sur les prévisions de 4,3% du PIB de la Commission sans pratiquer de mesures additionnelles de restriction budgétaire. La loi de Finances pour 2006 annonce des mesures pour 0,8 point de PIB afin de réduire le déficit, en ligne avec les recommandations de la Commission, qui préconise une baisse du déficit structurel de 1,6 point à l'horizon 2007,
Le Portugal renoue avec l'expérience d'une procédure de déficit excessif dont il avait déjà été frappé en 2001. Après avoir maintenu pendant trois années, de 2002 à 2004, son déficit dans la limite du 3 %, à l'aide de recettes exceptionnelles égales à 2,1 points de PIB en moyenne par an, le Portugal affiche une prévision de déficit à 6,2 % en 2005 dans la version révisée de juin 2005 de son Programme de stabilité. En effet, le nouveau gouvernement, installé depuis mars, a révisé à la hausse l'objectif de déficit de 2,8 % de la majorité sortante, renonçant à l'utilisation d'un montant assez conséquent de mesures temporaires, destinées à masquer la dégradation tendancielle du déficit. L'ouverture de la procédure est justifiée par l'existence d'un déficit éloigné de 3 %, non temporaire et non exceptionnel, car le ralentissement de l'économie portugaise n'a produit qu'un faible impact sur la composante conjoncturelle du déficit. Cependant, des circonstances exceptionnelles, sont évoquées, car l'abandon des recettes exceptionnelles oblige les autorités portugaises à un puissant redressement du déficit structurel dans une phase de faiblesse cyclique. Le report à 2008 de l'échéance pour revenir dans la limite de 3 %, contraint néanmoins le Portugal à pratiquer une impulsion négative de 1,5 point de PIB en 2006 et de 0,8 point en 2007 et 2008.
2006 : le retour du politique ?
Nous prévoyons pour l'année 2006 une croissance du PIB de la zone euro de 1,9 % qui, contrairement à ce qui était annoncé dans les Programmes de stabilité de décembre 2004 (2,3 %), revient à peine à son rythme potentiel. Le déficit, prévu de 2,8 % du PIB contre 1,8 % annoncé, résulte en partie de la révision à la hausse de 2005. Mais l'impulsion budgétaire (-0,2 point de PIB) serait aussi moins négative que prévu (-0,4 point). L'impact de la conjoncture sur le solde serait nul, mais il creuserait le solde de 0,2 point de PIB le différentiel par rapport aux engagements de la fin 2004.
Les objectifs de finances publiques présents dans les projets de lois de Finances pour 2006 déjà disponibles intègrent la dérive des comptes publics de 2005, en n'y apportant en général que des corrections marginales. L'amélioration des comptes publics est donc reportée au-delà de l'horizon de la prévision et cinq pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce, ne parviendraient toujours pas à ramener leur déficit en deçà de 3 % en 2006. Certes, le cycle électoral est clos au Portugal et en Allemagne. Mais, s'annonçant en Italie en 2006 ainsi qu'en France en 2007, il constitue un risque de dérive par rapport aux objectifs affichés dans les lois de Finances pour 2006.
La légère réduction du déficit de la zone euro prévue en 2006 (2,8 % après 2,9 % en 2005) est le résultat d'une baisse du déficit ou d'une hausse de l'excédent dans la plupart des pays membre, à l'exception de l'Italie, de la Belgique et de l'Irlande. En Espagne aussi, l'excédent budgétaire enregistrerait une certaine érosion. La politique budgétaire discrétionnaire serait le principal déterminant de ces évolutions. L'impulsion serait en effet négative dans tous les pays, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et de l'Irlande. Les plus fortes restrictions budgétaires auraient lieu au Portugal et en Grèce. Puisque la plupart des pays croîtraient à un rythme proche de leur potentiel, l'impact de la conjoncture sur le cycle serait à peine négatif, exception faite de la Grèce et de l'Irlande, où la composante cyclique du solde public se dégraderait davantage. La Finlande serait le seul pays à pouvoir compter sur une contribution positive du cycle à l'amélioration de ses comptes publics. Le souhait exprimé par la Commission d'un moindre recours aux recettes exceptionnelles semble avoir été satisfait. Seuls trois pays feraient encore appel à ces mesures temporaires en 2006 : la Grèce (1,5 point de PIB), l'Allemagne (0,3 point) et la France (0,1 point).
7. Politiques budgétaires dans la zone euro
|
2004 |
2005 |
2006 |
Moyenne 2004-2006 |
|
|
Croissance du PIB, en % |
||||
|
Allemagne |
1,1 |
0,9 |
1,4 |
1,1 |
|
France |
2,0 |
1,7 |
2,2 |
2,0 |
|
Italie |
1,0 |
0,1 |
1,2 |
0,8 |
|
Espagne |
3,1 |
3,3 |
2,9 |
3,1 |
|
Pays-Bas |
1,7 |
0,7 |
1,9 |
1,5 |
|
Belgique |
2,7 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
|
Autriche |
2,1 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
|
Finlande |
3,5 |
1,6 |
4,1 |
3,1 |
|
Portugal |
1,2 |
1,0 |
1,6 |
1,3 |
|
Grèce |
4,2 |
2,8 |
2,6 |
3,2 |
|
Irlande |
4,9 |
4,7 |
4,5 |
4,7 |
|
Zone euro |
1,8 |
1,3 |
1,9 |
1,7 |
|
Solde public, en points de PIB |
||||
|
Allemagne |
-3,7 |
-3,5 |
-3,2 |
-3,5 |
|
France |
-3,6 |
-3,2 |
-3,2 |
-3,3 |
|
Italie |
-3,2 |
-4,7 |
-5,1 |
-4,3 |
|
Espagne |
-0,1 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
|
Pays-Bas |
-2,1 |
-2,3 |
-1,7 |
-2,0 |
|
Belgique |
0,0 |
-0,6 |
-0,8 |
-0,5 |
|
Autriche |
-1,0 |
-2,4 |
-2,0 |
-1,8 |
|
Finlande |
2,1 |
0,6 |
1,9 |
1,5 |
|
Portugal |
-3,0 |
-6,2 |
-4,8 |
-4,7 |
|
Grèce |
-6,6 |
-4,5 |
-3,9 |
-5,0 |
|
Irlande |
1,4 |
-0,6 |
-0,8 |
0,0 |
|
Zone euro |
-2,7 |
-2,9 |
-2,8 |
-2,8 |
|
2004 |
2005 |
2006 |
Moyenne 2004-2006 |
|
|
Impulsion budgétaire*, en points de PIB |
||||
|
Allemagne |
-0,3 |
0,0 |
-0,4 |
-0,2 |
|
France |
-0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
|
Italie |
-1,0 |
0,0 |
0,4 |
-0,2 |
|
Espagne |
-0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
|
Pays-Bas |
-0,7 |
-0,7 |
-0,4 |
-0,6 |
|
Belgique |
0,0 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
Autriche |
-0,1 |
1,2 |
-0,2 |
0,3 |
|
Finlande |
1,1 |
0,6 |
-0,5 |
0,4 |
|
Portugal |
-0,1 |
0,8 |
-1,5 |
-0,3 |
|
Grèce |
1,1 |
-1,6 |
-0,7 |
-0,4 |
|
Irlande |
-0,7 |
1,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Zone euro |
0,4 |
0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
*Opposé de la variation du solde structurel primaire, Un chiffre positif indique une politique budgétaire expansionniste,
Sources
: Comptes nationaux, Programmes de
stabilité, calculs et prévision OFCE,
octobre 2005.
Malgré cette faible restriction de la politique budgétaire et un moindre relâchement des conditions monétaires en 2006, le policy mix serait plus favorable à la croissance dans la zone euro qu'aux États-Unis. Bien que la politique budgétaire américaine revienne à la neutralité (0,1 point de PIB, encadré 3), le durcissement des conditions monétaires de l'autre coté de l'Atlantique contribuerait à un certain ralentissement de la croissance (graphique 6).
Au Royaume-Uni, l'impulsion de la politique budgétaire serait aussi un peu plus négative, sans pour autant ramener le déficit public en deçà de 3 %. En revanche, au Japon une plus franche restriction budgétaire permettrait une baisse du déficit (de 6,1 % en 2005 à 5,3 % en 2006).
|
Encadré 3 : Politique budgétaire
américaine :
L'amélioration des finances publiques américaines depuis la mi-2004 semblait sur une bonne voie, grâce à la combinaison d'une conjoncture favorable et d'une politique discrétionnaire moins expansionniste. Entre 2003 et 2004, le déficit public est ainsi passé de 5 à 4,7 % du PIB, l'effet du cycle comptant pour 0,6 point dans cette amélioration alors que l'impulsion budgétaire était encore positive à hauteur de 0,4 point, après une impulsion de + 1,1 point de PIB en 2003. En 2005, le déficit public se réduirait encore, à 4,2 % du PIB, pour une petite partie seulement grâce à la conjoncture (+ 0,1 point) : l'impulsion budgétaire serait en effet négative et contribuerait à hauteur de 0,4 point à l'ajustement. Ces évolutions, tant conjoncturelles que structurelles, profitent surtout des importantes rentrées fiscales. Il y a six mois, une poursuite de la discipline budgétaire à l'horizon 2006 était anticipée, laissant espérer que l'objectif d'une réduction de moitié du déficit fédéral d'ici 2008 serait tenu. Les violents ouragans qui se sont abattus, entre la fin août et la mi-octobre, sur le Golfe du Mexique et les côtes du sud-est américain ont néanmoins changé la donne. Les 62,3 milliards de dollars d'aides déjà débloqués, premiers signes de la volonté exprimée de l'administration Bush de tout mettre en oeuvre pour répondre à la détresse des sinistrés, vont directement peser sur le budget fédéral en 2006 et au-delà. Selon la manière dont ces sommes seront effectivement dépensées et comptabilisées, le déficit public au mieux se stabiliserait à son niveau de 2005, voire se détériorerait quelque peu. Nous avons retenu cette dernière hypothèse (le déficit atteignant 4,4 % du PIB en 2006), sur la base d'une impulsion budgétaire désormais légèrement positive, et en l'absence d'annonces de coupes drastiques ailleurs dans le budget et/ou d'un renoncement à la pérennisation en l'état des baisses d'impôts antérieures. A l'horizon 2006, le choix de la compassion au détriment de celui de la discipline est légitime, mais il entame la crédibilité de l'administration et ses marges de manoeuvre, ce que les marchés et la politique monétaire pourraient sanctionner. La politique budgétaire a une responsabilité similaire à celle assumée par la politique monétaire dans le redressement attendu du déséquilibre interne épargne - investissement. Le policy mix a été jusqu'ici plutôt bien coordonné et propice à la croissance : 2006 est donc une année décisive où cette qualité du policy mix serait mise à l'épreuve, d'autant plus qu'il se fera avec un nouveau gouverneur de la Réserve fédérale. |
A.3. Politiques monétaires
La Réserve fédérale a, jusqu'à présent, prudemment mais résolument resserré sa politique monétaire, et pu le faire grâce au comportement des taux longs. En ne montant pas, ils ont en effet facilité l'absorption de ce resserrement par l'économie américaine. La phase de normalisation n'est néanmoins pas encore tout à fait achevée, la Réserve fédérale jugeant toujours accommodante sa politique. Ce n'est qu'au tournant de 2005 - 2006 que cette dernière deviendrait restrictive, soit au bout d'un an et demi. Parti de 1 % début 2004, le taux des Federal Funds se situerait, à partir de la fin 2005, à 4 %. Confrontée à la langueur de la croissance de la zone euro, la Banque centrale européenne a également fait montre de prudence et n'a toujours pas modifié sa politique. Le taux d'intérêt sur les opérations principales de refinancement est à 2 % depuis juin 2003, ce qui serait, selon les termes de J. C. Trichet, le niveau approprié. Cependant, ce niveau n'est pas jugé spécialement accommodant, en tout cas pas pour tous les pays de la zone euro. Cette diversité des situations nationales et la crainte d'une dynamique interne déflationniste nous amène à privilégier l'hypothèse de la poursuite du statu quo jusque fin 2006.
Si ces hypothèses semblent bien balisées, elles sont pourtant soumises à un risque important : celui d'une inflation supérieure à ce qui est anticipé pour cause de prix du pétrole plus élevé et/ou de l'enclenchement d'effets de second rang. Ce risque conditionne la poursuite du resserrement monétaire américain au-delà d'un taux directeur de 4 % et le maintien du statu quo monétaire de la zone euro à 2 %, avec, au final, une remontée potentiellement plus forte des taux d'intérêt longs des deux côtés de l'Atlantique. Dans notre scénario central, ce risque est maîtrisé : l'inflation américaine, ici mesurée par le glissement sur un an du déflateur du PIB, redescendrait d'un pic de 3 % au troisième trimestre 2005 à 1,7 % fin 2006 ; l'inflation dans la zone euro passerait d'un glissement légèrement supérieur à 2 % jusque début 2006 à 1,8 % fin 2006. Les taux courts réels américains deviendraient ainsi franchement positifs tandis que les taux réels européens resteraient proches de zéro.
L'objectif de la Réserve fédérale de maintenir la croissance américaine autour de son rythme potentiel serait atteint mais pas celui de son rééquilibrage, c'est-à-dire d'une moindre dépendance à l'endettement. S'il y a bien une raison pour laquelle les taux d'intérêt longs doivent remonter, c'est celle-là. Mais, à l'horizon 2006, le processus ne ferait que s'amorcer. Côté zone euro, le minimum que l'on puisse anticiper est que la politique monétaire n'entraverait pas le redémarrage attendu de la croissance.
Les taux passent, les questions restent
La main de fer dans un gant de velours n'est plus britannique mais américaine : la Réserve fédérale a en effet maintenu le cap et le rythme d'une hausse de son taux directeur d'un quart de point à chaque FOMC (Federal Open Market Committee). Le taux des Federal Funds se situe donc à 3,75 % (graphique 1). La Banque d'Angleterre, toujours avec un cran d'avance sur les autres, a baissé d'un quart de point son taux directeur à 4,5 %. Ni la BCE, ni la Banque du Japon n'ont modifié leur politique. Du printemps jusqu'au début de l'été, les discours de la BCE ont laissé anticiper une possible baisse des taux. Depuis, ils se sont faits plus inquiets face au risque inflationniste, et une hausse des taux est de nouveau anticipée. La Banque du Japon, quant à elle, réfléchit plus ouvertement depuis peu à la possibilité d'interrompre sa politique quantitative, dès le début de la prochaine année fiscale peut-être.
Graphique 9. Taux d'intérêt directeurs
En %
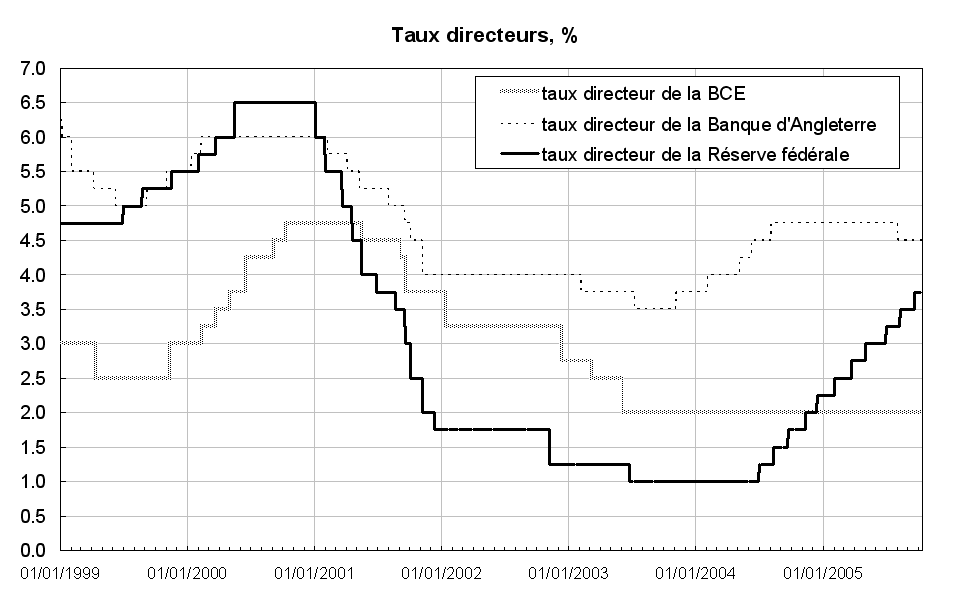
Sources : Instituts d'émission nationaux.
La résolution de la Réserve fédérale
Le fait que la Réserve fédérale ait, malgré Katrina, augmenté son taux directeur à sa réunion du 20 septembre est révélateur de sa résolution à poursuivre la normalisation de la politique monétaire dans un environnement potentiellement plus inflationniste du fait de la hausse des prix de l'énergie. Elle a adapté en conséquence le communiqué issu du FOMC, mentionnant le drame humain et les impacts économiques possibles de cette catastrophe, mais n'a pas jugé utile d'aller jusqu'à faire une pause. Les arguments pour une pause étaient la crainte d'un choc profond sur la confiance des ménages et les bons chiffres sur la période récente de l'inflation sous-jacente. La liste des arguments justifiant ce geste est bien plus longue :
• avant même Katrina, la Banque centrale souhaitait durcir les conditions monétaires et financières et était inquiète des signes inflationnistes
• les conditions monétaires et financières resteront accommodantes même après une hausse de taux supplémentaire
• les ouragans Katrina et Rita sont des chocs d'offre, qui accroissent autant le risque inflationniste que le risque d'un ralentissement de la croissance
• le relance budgétaire induite de la participation de l'Etat à la reconstruction des zones sinistrées devrait se traduire par plus de croissance et plus d'inflation que prévu d'ici la fin de l'année
• la politique monétaire n'est d'aucune aide à la reprise de la croissance dans les zones sinistrées
• tout stimulus, même indirect, du marché immobilier ajouterait à la pénurie locale de matériaux de construction
• l'incertitude n'excuse pas l'inaction alors même que les conditions monétaires et financières sont, à première vue, encore souples
• une pause rendrait plus difficile encore la tâche du prochain gouverneur 80 ( * ) (Alan Greenspan prenant sa retraite fin janvier 2006)
• une pause créerait le précédent d'une réaction de l'autorité monétaire à un choc régional, en écart à ses objectifs de croissance et d'inflation à l'échelle nationale
• cela pourrait compromettre la crédibilité de la Réserve fédérale dans sa course contre l'inflation.
Cette course contre l'inflation est réelle. En 2004, le resserrement de la politique monétaire américaine pouvait en effet apparaître comme légèrement en retard par rapport à l'accélération de l'inflation (graphique 2). Ce retard apparent de réaction vient pour partie du chemin que la Réserve fédérale a dû parcourir pour corriger l'important relâchement antérieur. Si ce n'est plus le cas en 2005, la partie est loin d'être terminée compte tenu de l'évolution des prix de l'énergie. Alors que les marchés obligataires se focalisaient, jusqu'à récemment, plus sur l'impact de leur hausse sur la seule croissance, la Réserve fédérale a manifesté plus d'inquiétudes quant au risque inflationniste 81 ( * ) . La flambée des prix du pétrole, en dehors de l'épisode Katrina, est, en effet, le produit d'une forte demande, sur laquelle la politique monétaire peut agir. Et à chaque nouvelle hausse des prix de l'énergie s'accroît le risque d'une transmission à l'inflation sous-jacente. Celle-ci semble ne pas se faire, l'accélération de l'inflation sous-jacente tout au long de l'année 2004 ayant exclusivement et logiquement accompagné le mouvement de fermeture de l'écart de production. Cependant, l'inflation s'est rapprochée, à 2 % en glissement 82 ( * ) , du haut de la fourchette tolérée par la Réserve fédérale.
Graphique 10. Politique monétaire préventive et inflation aux États-Unis
En points de pourcentage
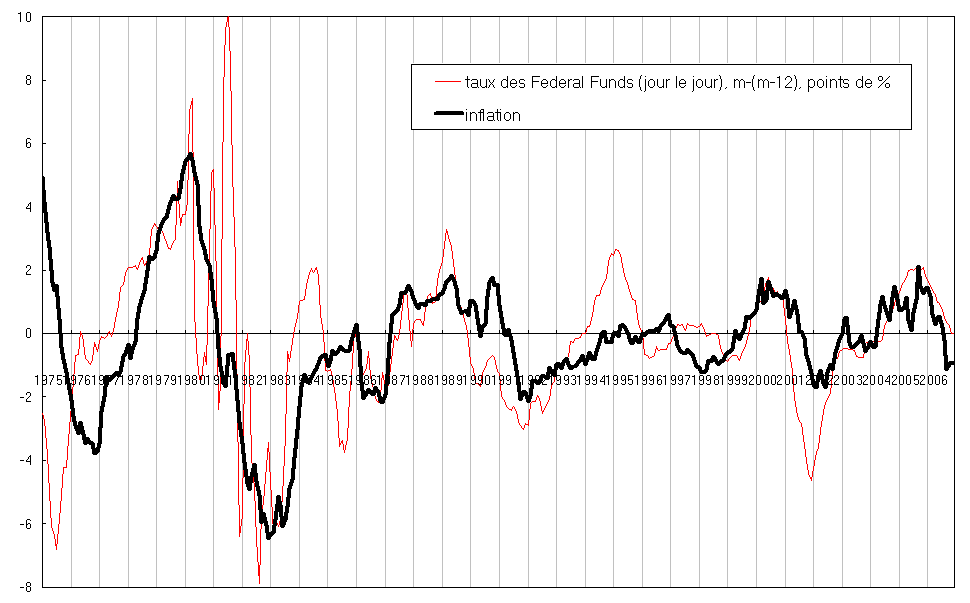
* L'accélération de l'inflation est ici mesurée à partir de l'IPC, comme l'écart entre l'inflation en glissement annuel et la moyenne sur les 36 derniers mois de ce glissement. Le degré de prévention de la politique monétaire est mesuré par la variation absolue sur un an du taux des Federal Funds .
Sources : Réserve fédérale, BLS, calculs et prévision OFCE octobre 2005.
De plus, du point de vue de la Banque centrale, plus les marchés obligataires sembleront anticiper la fin du cycle de hausse, abaissant ainsi le coût du capital et les taux hypothécaires, plus la Réserve fédérale sera, au contraire, incitée à le prolonger pour obtenir un même degré de restriction. Cela fait maintenant un an et demi que la Réserve fédérale est confrontée à ces problèmes, qu'elle cherche à freiner en douceur l'endettement des ménages en cessant d'alimenter le boom immobilier et obligataire. Plus que le récent risque inflationniste, c'est la raison première de la détermination de la Réserve fédérale à mener à terme sa campagne.
La vigilance de la BCE
En surface, les problèmes que la BCE mentionne dans ses déclarations sont les mêmes que ceux de la Réserve fédérale : inflation, évolution de l'endettement, bas niveau des taux d'intérêt. Mais la comparaison s'arrête là. Relativement à la politique monétaire menée, le bas niveau des taux d'intérêt longs est une énigme de l'autre côté de l'Atlantique, pas de ce côté-ci. Le soutien qu'il apporte à la croissance est de même nature, mais il diffère en revanche dans son ampleur et sa longévité. Entre le premier trimestre 2002 et le deuxième trimestre 2005, l'encours de dette des ménages américains a progressé de presque 40 %, ce chiffre est de 26 % pour les ménages de la zone euro. Le taux d'endettement de ces derniers restant très inférieur à celui des ménages américains (80 % du revenu pour les premiers contre 120 % pour les seconds), une poursuite de la hausse semble tolérable côté zone euro, alors qu'elle ne l'est plus aux États-Unis. La même attention est portée des deux côtés de l'Atlantique à l'enclenchement éventuel d'une spirale prix-salaires causée par la hausse des prix de l'énergie, pourtant le risque est loin d'être le même. Il est vrai que la BCE n'a pas dépassé le stade des mots alors que la Réserve fédérale en est à son onzième relèvement de taux directeur, mais la BCE n'a cessé de tendre son discours au cours des six derniers mois, annonçant désormais une grande vigilance à l'égard de la stabilité des prix à moyen - long terme et de ce qui pourrait la compromettre.
Graphique 11. Evolution de l'encours de dette des
ménages
aux États-Unis et dans la zone euro
Glissement, en %
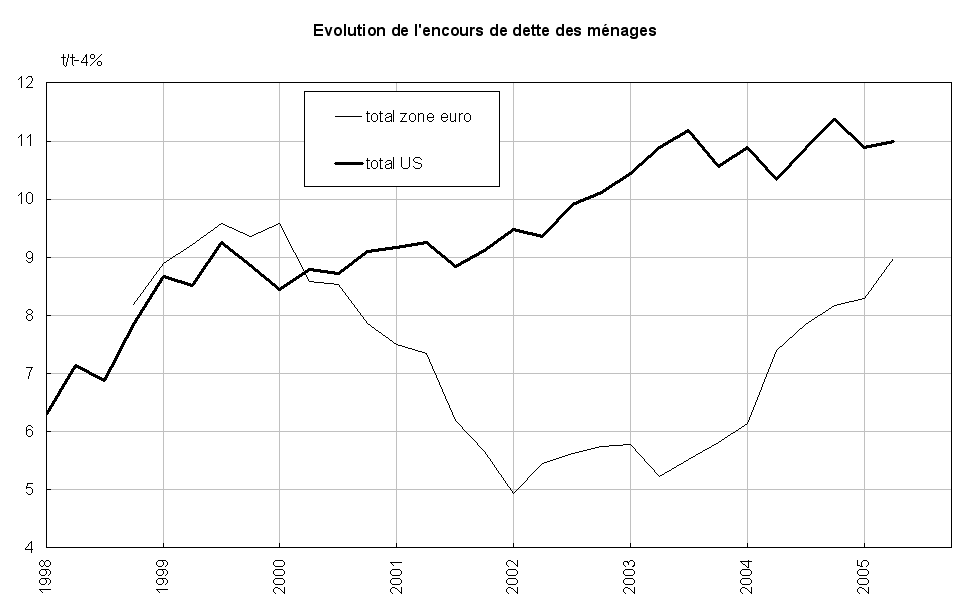
Sources : Réserve fédérale, BCE.
Jusqu'à présent, la BCE a répondu au dilemme auquel elle doit faire face par le pragmatisme : compte tenu du dogme monétariste, elle aurait pu déjà resserrer sa politique, et, même sans être monétariste, elle aurait pu le justifier par le dépassement, limité mais récurrent, de sa cible d'inflation. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas de pressions inflationnistes internes sous-jacentes et parce qu'elle est également sensible au manque de dynamisme de la croissance au niveau agrégé. Jusqu'à maintenant, face à l'évolution des prix de l'énergie, et comme anticipé il y a un an dans un contexte similaire à celui d'aujourd'hui, la BCE et la Réserve fédérale privilégient la voie de la croissance (même si les résultats ne sont guère visibles dans la zone euro). A l'horizon 2006, ce choix serait reconduit mais il s'accompagnerait d'une vigilance accrue à toute information remettant en cause le diagnostic d'une inflation de second rang inexistante (dans la zone euro) ou réduite (aux États-Unis).
Réserve fédérale : début de restriction
Il y a six mois, alors que le taux des Federal Funds était à 2,75 %, le point d'arrivée de la campagne de hausse était anticipé à 4 % fin 2005, sur la base d'une hausse d'un quart de point à chaque FOMC jusqu'à celui du mois de novembre. Maintenant que le terme est proche (le taux directeur est à 3,75 %), que la Réserve fédérale n'a guère avancé dans la résolution de ses problèmes, et que le risque inflationniste est plus prononcé, ce point d'arrivée peut sembler bas. Les marchés à terme anticipent, par exemple, depuis fin septembre - début octobre une poursuite du resserrement jusque 4,5 %. Au regard d'une règle de Taylor, et avec nos prévisions de croissance et d'inflation, le point d'arrivée de 4 % semble pouvoir être maintenu, la politique monétaire devenant ainsi restrictive au tournant 2005 - 2006. Le double objectif de simultanément prendre le contrôle de la remontée des taux longs pour prendre celui du ralentissement de l'endettement des ménages n'est pas remis en cause. Combinée à l'appréciation du dollar et au ralentissement attendu de l'inflation, la hausse anticipée des taux d'intérêt courts et longs suffit à peser de manière non négligeable sur la croissance.
Graphique 12. Règle de Taylor aux États-Unis*
En %, sauf écart de production (en points)
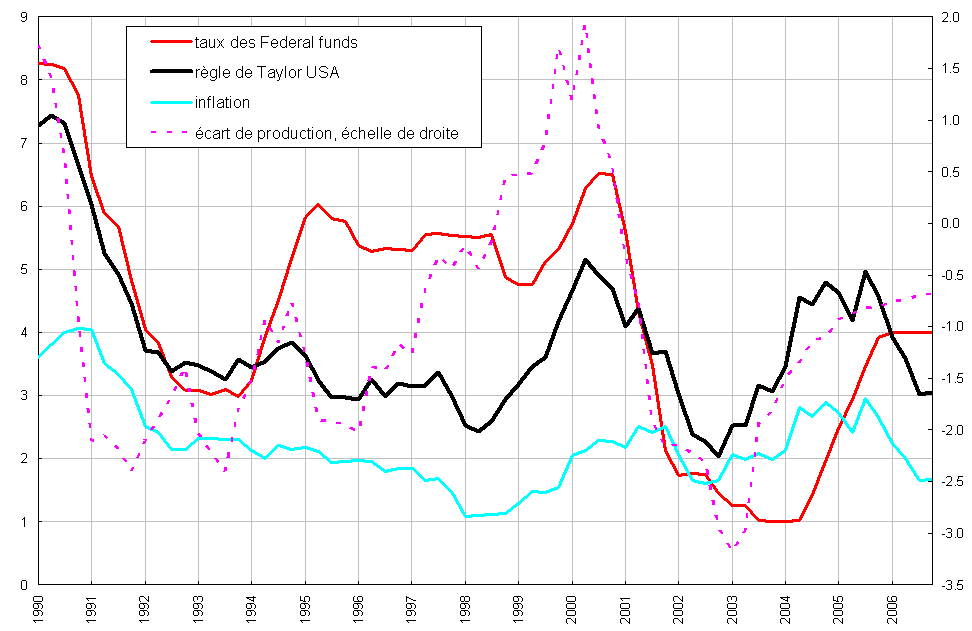
*
La règle est calibrée sur la base des
coefficients indiqués par Taylor :
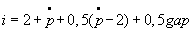 avec i le taux directeur de la Réserve fédérale ; 2
le taux d'intérêt réel d'équilibre de longue
période ;
avec i le taux directeur de la Réserve fédérale ; 2
le taux d'intérêt réel d'équilibre de longue
période ;
 l'inflation, en
glissement sur un an, mesurée par le déflateur du PIB ;
l'inflation, en
glissement sur un an, mesurée par le déflateur du PIB ;
 l'écart de l'inflation à la cible
implicite de 2 % de la Réserve fédérale ; gap
l'écart au potentiel (tel que mesuré par l'OCDE).
l'écart de l'inflation à la cible
implicite de 2 % de la Réserve fédérale ; gap
l'écart au potentiel (tel que mesuré par l'OCDE).
Sources : BEA, Réserve fédérale, OCDE, calculs et prévision OFCE octobre 2005.
Graphique 13. Composantes de l'indicateur de conditions
monétaires
aux États-Unis
En points de PIB
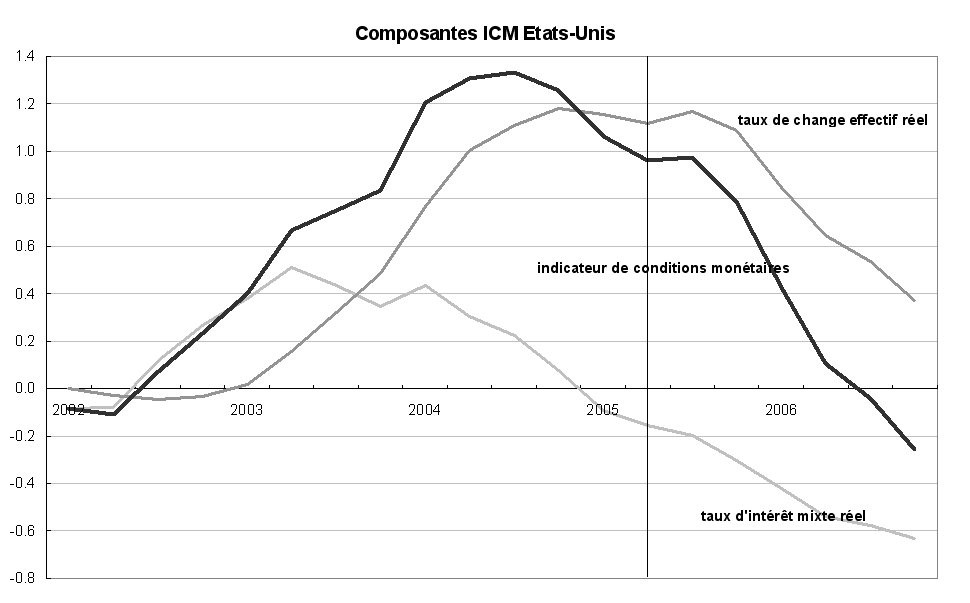
* Lecture du graphique : une hausse (baisse) de l'indicateur, et de chacune de ses composantes, correspond à une contribution positive (négative) des conditions monétaires à la croissance.
Sources : calculs et prévision OFCE octobre 2005.
BCE : prolongation de statu quo
Faisant écho aux inquiétudes de la BCE quant au risque inflationniste et à une tonalité qui se veut optimiste quant aux perspectives de croissance, les marchés à terme anticipent un resserrement de la politique monétaire. Ils anticipaient déjà un tel resserrement il y a six mois, qui n'a pas eu lieu. Nous continuons donc de privilégier l'hypothèse du statu quo, qui s'est avérée juste jusqu'à présent. Notre scénario de croissance pour 2005 et 2006, d'un redémarrage sans reprise, correspond au milieu de la fourchette prévue par la BCE mais avec une inflation inférieure en 2005 et proche de la fourchette basse en 2006. Selon une règle de Taylor, ce profil de l'inflation autoriserait même une détente de la politique monétaire (graphique 12). Mais, compte tenu de l'amorce du mouvement de fermeture de l'écart de production et de la persistance de la diversité des situations nationales, un statu quo sur les taux nous paraît justifié.
8. Différents jeux d'hypothèses
Moyenne annuelle, en %
|
BCE - juin 2005 |
BCE - sept. 2005 |
OFCE - oct. 2005 |
||||
|
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
|
Croissance |
1,1 / 1,7 |
1,5 / 2,5 |
1,0 / 1,6 |
1,3 / 2,3 |
1,3 |
1,9 |
|
Inflation |
1,8 / 2,2 |
0,9 / 2,1 |
2,1 / 2,3 |
1,4 / 2,4 |
2,0 |
1,6 |
Graphique 14. Règle de Taylor dans la zone euro*
En %, sauf écart de production (en points)
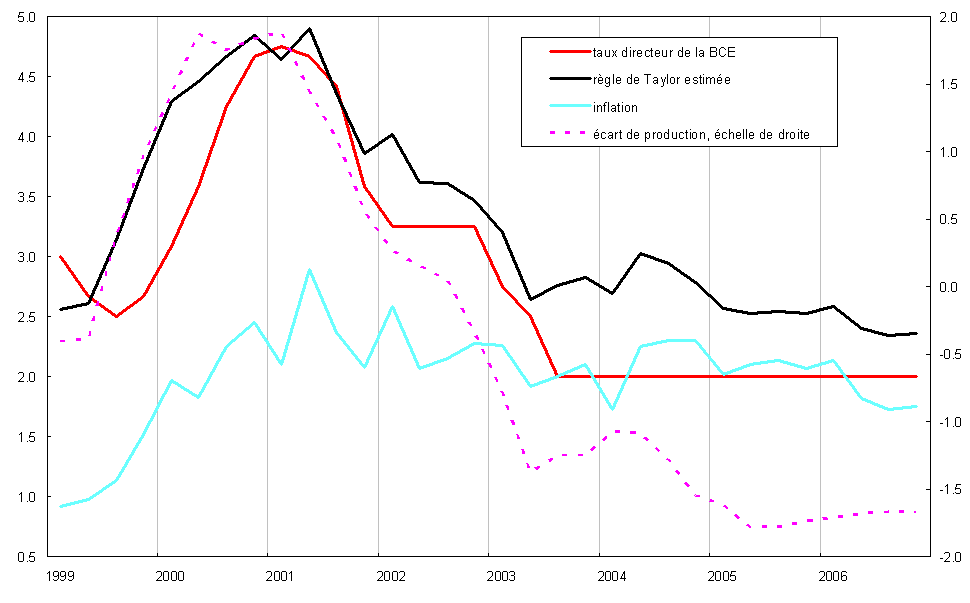
*
La règle estimée est la
suivante :
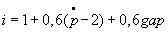 avec i le taux directeur de la
BCE ; 1 le taux d'intérêt réel d'équilibre de
longue période ;
avec i le taux directeur de la
BCE ; 1 le taux d'intérêt réel d'équilibre de
longue période ;
 l'inflation, en
glissement sur un an, mesurée par l'IPCH ;
l'inflation, en
glissement sur un an, mesurée par l'IPCH ;
 l'écart de l'inflation à la cible de 2 % de la BCE ;
gap l'écart au potentiel (tel que mesuré par l'OCDE).
l'écart de l'inflation à la cible de 2 % de la BCE ;
gap l'écart au potentiel (tel que mesuré par l'OCDE).
Sources : Eurostat, OCDE, calculs et prévision OFCE octobre 2005.
Ce statu quo doit se comprendre, comme il y a six mois, comme le meilleur moyen pour la BCE de contribuer à sortir la zone euro de son atonie, et de répondre, implicitement, au risque rémanent de déflation. Ce faisant, elle accroîtrait les chances d'une transmission complète de sa politique dans les pays où elle n'a pas encore mordu (c'est-à-dire jusqu'aux ménages, les entreprises ayant profité du bas niveau des taux d'intérêt pour se refaire une santé) et d'une consolidation de la croissance sur des bases autonomes dans les autres. La progression de l'endettement est d'autant plus soutenable que la BCE ne met aucun frein à l'expansion, qu'elle s'appuie sur le jeu des effets richesse pour stimuler plus encore l'activité, et qu'elle encourage les ménages, plus confiants, à baisser leur taux d'épargne. Elle serait aidée dans cette tâche par la dépréciation de l'euro. L'ensemble des conditions monétaires serait ainsi plus favorable à la croissance qu'il y a six mois (graphique 13).
Graphique 15. Composantes de l'indicateur de conditions
monétaires
dans la zone euro
En points de PIB
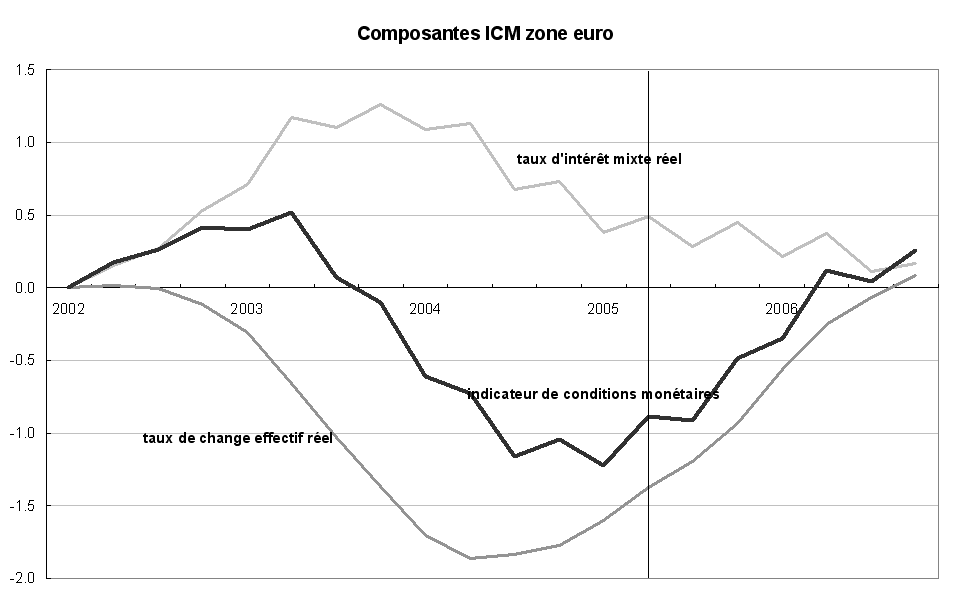
* Lecture du graphique : une hausse (baisse) de l'indicateur correspond à une contribution positive (négative) des conditions monétaires à la croissance.
Sources : calculs et prévision OFCE octobre 2005.
A.4. L'économie française
Depuis près de 10 ans, la France connaît des performances économiques supérieures à celles de ses partenaires européens (graphique 16 et tableau 13) et tout particulièrement à l'Allemagne et l'Italie (tableau 9). Ainsi, depuis 1997, l'économie française enregistre un surplus annuel de croissance de 0,4 point par rapport à l'ensemble de la zone euro et de plus d'un point par rapport à ses deux principaux partenaires.
Graphique 16. Croissance du PIB en France et dans la zone euro
Glissement annuel %
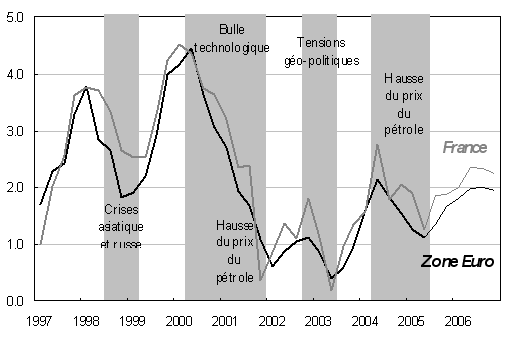
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE, e-mod.fr de 2005 à 2006.
Cette meilleure performance trouve son origine dans un grand dynamisme de la demande intérieure. Par leurs investissements pour les uns ou leurs achats pour les autres, les agents français, essentiellement les ménages, dépensent plus que leurs homologues Allemands ou Italiens. Si entre 1998 et 2002, ce surplus a été alimenté principalement par de plus fortes créations d'emplois dans l'hexagone que chez nos partenaires, la situation sur le marché du travail, s'est en revanche plus fortement dégradée en France depuis deux ans.
9. Comparaisons Européennes
En %
|
PIB |
Consommation |
Investissement |
|||||||
|
FRA |
ALL |
ITA |
FRA |
ALL |
ITA |
FRA |
ALL |
ITA |
|
|
1992-1997 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
0,7 |
1,7 |
1,0 |
- 0,7 |
0,7 |
- 0,2 |
|
1998-2003 |
2,5 |
1,4 |
1,5 |
2,8 |
1,4 |
1,9 |
4,2 |
- 0,2 |
2,8 |
|
2004 |
2,1 |
1,1 |
1,0 |
2,3 |
0,2 |
1,0 |
2,1 |
- 1,6 |
1,9 |
|
2005 * |
1,7 |
0,9 |
0,1 |
2,3 |
- 0,1 |
1,1 |
2,8 |
- 1,0 |
- 0,8 |
|
2006 * |
2,0 |
1,4 |
1,2 |
2,5 |
0,3 |
1,3 |
3,2 |
0,9 |
3,1 |
* Prévisions OFCE.
Sources : Comptabilités nationales.
Le maintien d'une plus forte consommation dans l'hexagone est alors le fruit d'un comportement d'épargne des ménages différent : alors que les ménages français ont fortement puisé dans leur épargne au cours des deux dernières années - le taux d'épargne a baissé de 0,9 point en 2003 et de 0,5 point en 2004, s'établissant à 15,2 % en fin d'année - dans le même temps les ménages allemands et italiens épargnaient davantage (0,4 point supplémentaire en 2003 et 0,5 point en 2004 en Allemagne et 0,2 point en 2003 et 2004 en Italie).
Selon notre équation économétrique, la baisse du taux d'épargne enregistrée depuis 2003 en France s'explique principalement - pour 70 % - par les effets induits de la hausse du prix de l'immobilier (tableau 10).
Ces effets sont de deux ordres :
- Premièrement, l'immobilier est un vecteur puissant de transmission de la politique monétaire. Le bas niveau des taux d'intérêt rend, d'un côté, l'achat de logements rentable par rapport à la location et, de l'autre, solvables les ménages qui veulent se porter acquéreurs. Ce phénomène se traduit par une augmentation de l'écart critique (g - r) - différence entre le taux de croissance du revenu des ménages et le taux d'intérêt -, indiquant une plus forte capacité d'emprunt des ménages. Ces derniers, en accédant massivement au crédit - la part des nouveaux crédits dans le revenu disponible brut (RDB) des ménages est en 2004 à son maximum historique - injectent des liquidités dans l'économie, stimulant la consommation 83 ( * ) . Selon nos estimations, cet effet explique plus de 40 % de la baisse du taux d'épargne depuis 2003.
- Deuxièmement, selon un effet de richesse souvent évoqué, les ménages propriétaires se sentent plus riches ce qui stimule leur consommation. Cet effet participe à près de 30 % de la baisse enregistrée du taux d'épargne.
10. Pourquoi le taux d'épargne baisse-t-il en France ?
|
En points |
2003 |
2004 |
2005* |
2006* |
|
- 0,9 |
- 0,5 |
- 0,1 |
- 0,4 |
|
|
Écart critique (g - r) ** |
- 0,5 |
- 0,1 |
0,1 |
- 0,1 |
|
Effet de richesse immobilière *** |
- 0,2 |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 0,2 |
|
Variation du chômage **** |
- 0,2 |
0,0 |
0,1 |
- 0,1 |
|
Mesures Sarkozy 84 ( * ) |
-- |
- 0,2 |
-- |
-- |
* Prévisions OFCE.
** L'écart critique est la différence entre le taux de croissance du revenu des ménages (g) et le taux d'intérêt à long terme (r). Cet écart illustre la capacité des ménages à emprunter.
*** En prévision, nous avons supposé une stabilisation des prix de l'immobilier.
Sources : Calculs OFCE, e-mod.fr.
Ces deux éléments expliquent également la différence d'évolution du taux d'épargne en France et en Allemagne (tableau 11) : ainsi, les prix de l'immobilier ayant moins progressé en Allemagne qu'en France, cela a limité l'impact positif du faible niveau des taux d'intérêt sur la consommation 85 ( * ) et effacé un potentiel « effet de richesse immobilière ». Par ailleurs, la faiblesse de la croissance du revenu en Allemagne, résultant des réformes engagées depuis 2003 outre-Rhin, a limité la capacité d'emprunt des ménages et par là, la consommation des ménages.
11. Pourquoi le taux d'épargne baisse plus en France qu'en Allemagne ?
|
En points |
2003 |
2004 |
|
Écart de variation du taux d'épargne entre la France-Allemagne |
- 1,3 |
- 1,0 |
|
Écart critique (g - r) |
- 1,1 |
- 0,5 |
|
Effet de richesse immobilière |
- 0,2 |
- 0,2 |
|
Mesures Sarkozy |
0,0 |
- 0,2 |
|
Autres |
- 0,1 |
- 0,1 |
Sources : Calculs OFCE, e-mod.fr.
Si la croissance a été plus dynamique en France depuis 10 ans, le niveau de l'output gap en 2004 - c'est-à-dire l'écart entre la production effective et la production potentielle - est du même ordre de grandeur que celui enregistré en Allemagne et en Italie, traduisant un potentiel nettement supérieur en France (cf. graphique 17).
17 : Ecart entre la production effective et la production potentielle...
Ecart en % entre la production effective et la production potentielle
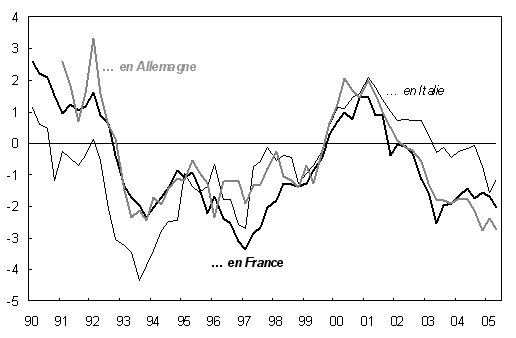
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OCDE.
D'après les statistiques fournies par l'OCDE, la France dispose en effet depuis 1994 d'un potentiel de croissance supérieur de 0.8 point en moyenne annuelle par rapport à l'Allemagne et l'Italie. Ce supplément de potentiel trouve son origine dans une plus forte croissance de la population active mais aussi de la productivité apparente du travail (tableau 12).
12. Quel potentiel de croissance ?
En %
|
Population active |
Productivité apparente travail |
Croissance potentielle |
|||||||
|
FRA |
ALL |
ITA |
FRA |
ALL |
ITA |
FRA |
ALL |
ITA |
|
|
1994-2004 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
1,6 |
1,3 |
1,0 |
2,1 |
1,5 |
1,3 |
Sources : Comptabilités nationales, OCDE.
Les deux principales conséquences du maintien d'une croissance effective en dessous de son potentiel pendant 5 ans - et partant, d'un output gap toujours négatif -, sont :
1. Une dégradation du marché du travail : la phase d'amélioration du marché du travail constatée entre 1997 et 2001 (baisse de 3,4 points du taux de chômage, création de 2,1 millions d'emplois salariés) a laissé place à une nouvelle dégradation depuis (hausse de 1,3 point du taux de chômage et 160 000 créations d'emplois salariés).
2. Une pression désinflationniste : en réduisant les tensions au niveau de l'offre et le pouvoir de négociation des salariés, cette situation tend à réduire la progression des prix.
A cet égard, la lecture des indices des prix confirme qu'en dépit d'un choc a priori inflationniste, les pressions à l'oeuvre actuellement au sein de l'économie française sont désinflationnistes (cf. graphique 18). Ainsi, avec une nouvelle poussée qui a porté les prix du pétrole à un niveau supérieur de plus de 50 % à celui de l'année précédente à la même époque, les craintes d'un regain d'inflation ont, comme elles le font à chaque vague de hausse du brut, resurgi, renforçant l'inquiétude exprimée sur une croissance déjà mise à mal au deuxième trimestre 2005. Pourtant, l'accélération de l'inflation ne s'est pas produite. L'indice des prix à la consommation s'est bien sûr ressenti de la hausse de sa composante énergie, mais ces effets dits de « premier tour » ne se sont pas diffusés à l'ensemble de l'économie, éloignant le spectre de l'enclenchement d'une spirale prix-salaires. Un tel mécanisme, qui avait pleinement joué lors des chocs de 1974 et 1980, ne s'est pas mis en place depuis le démarrage de la vague de hausse du pétrole au début 2004. Et même dans certains secteurs, comme les biens de consommation, les prix reculent depuis le début de 2005. Rien à l'heure actuelle ne laisse présager l'enclenchement du phénomène, sauf à envisager que les hausses quasi-continues du pétrole n'aient finalement raison de la capacité de résistance des agents au renchérissement de l'énergie.
18 : Inflation sous-jacente ...
IPCH sous-jacent, en glissement annuel
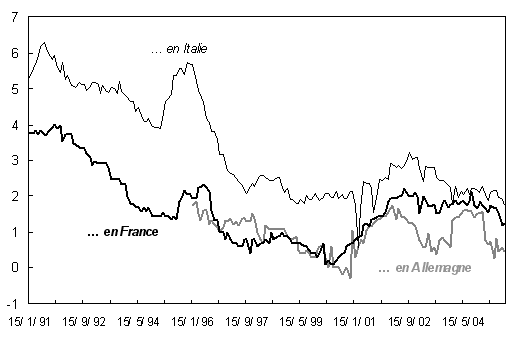
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OCDE .
Pourtant, les performances de l'économie française restent médiocres ...
Bien que toujours supérieures à celles de nos partenaires européens, les performances économiques de la France en 2005 resteront, à l'image de celles des cinq dernières années, médiocres. Le taux de croissance de l'économie française devrait s'établir à 1,7 % cette année, résultat proche des 1,6 % observés depuis 2001 mais loin des performances enregistrées au cours des vingt dernières années (2,1 %) ou de la dernière décennie (2,2 %).
Le redémarrage de l'économie observé au premier semestre 2004 (2,8 en moyenne annuelle) n'a malheureusement pas résisté à la forte hausse des prix du pétrole et à l'appréciation continue de l'euro face au dollar. Aussi, et même si les fondements intérieurs sont restés bien orientés, l'environnement extérieur a bridé, sans la rompre, cette phase de reprise de l'activité, empêchant l'économie française de rattraper une partie de son retard de production accumulé depuis 2001 (cf. graphique 17).
13. Contribution à la croissance du PIB
|
En %, moyenne annuelle |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Taux de croissance du PIB |
1,3 |
0,9 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
|
Dépenses des ménages |
1,3 |
1,1 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
|
Investissements et stocks des entreprises |
- 0,7 |
- 0,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
|
Dépenses des administrations |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
|
Total de la demande intérieure |
1,3 |
1,8 |
3,2 |
2,7 |
2,5 |
|
Solde extérieur |
0,0 |
- 0,9 |
- 1,1 |
- 0,9 |
- 0,5 |
|
Taux de croissance du PIB (zone euro) |
0,9 |
0,7 |
1,8 |
1,3 |
1,9 |
Sources : INSEE, comptes trimestriels de 1998 à 2004 ; prévision OFCE en 2005-2006, septembre 2005.
... en raison de chocs extérieurs négatifs...
Faisant suite à trois années de faible croissance, la vigueur de la reprise amorcée en 2004 a été décevante. Si le dynamisme interne a été satisfaisant, il n'en va de même de la contribution extérieure. Pour la première fois depuis 1991, le solde extérieur est redevenu déficitaire. Plus grave, au cours des deux dernières années, la France est le pays de la zone euro qui a le moins bénéficié du dynamisme de la demande mondiale : en 2004, les échanges extérieurs ont amputé la croissance de 1,2 point de PIB dans l'hexagone alors qu'ils ont été neutres pour la zone euro.
Ce résultat s'explique principalement par trois chocs extérieurs qui sont venus rogner la compétitivité française et ainsi entraver sa croissance économique.
Une reprise entravée en 2004 et 2005 par la hausse de l'euro ...
En premier lieu, la hausse progressive de la monnaie unique entre mi 2001 et début 2005 a pesé fortement sur les croissances européenne et française. Son impact négatif a été maximal en 2004, amputant la croissance française de -0,7 point de PIB (graphique 19 et tableau 6). En 2005, son impact est encore important puisqu'elle rogne la croissance de -0,6 point.
19. Impact des chocs extérieurs sur l'économie française...
En moyenne annuel %
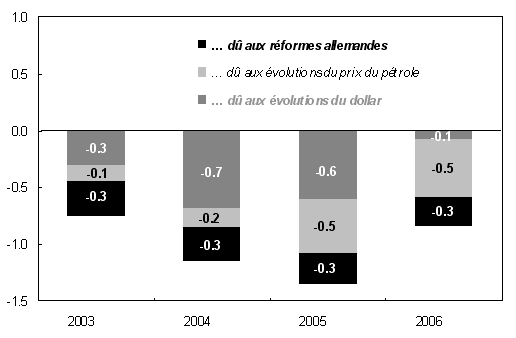
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE, e-mod.fr de 2005 à 2006.
... et en 2005 par celle du pétrole ...
Fortement dépendant de la courroie de transmission des échanges mondiaux, Le cycle de croissance de l'économie française a alors été atténué, et ce d'autant plus que la hausse des prix du pétrole est venue rogner l'activité de 0,2 point en 2004 et surtout de 0,5 point en 2005 (graphique 4 et tableau 6). Au total, ces deux chocs extérieurs ont amputé de près d'1 point la croissance dans l'hexagone en 2004 et de 1,1 point en 2005, empêchant l'économie française de rattraper une partie de son retard de production accumulé depuis 2001 (cf. graphique 17).
... et des conséquences des réformes allemandes.
Ces deux éléments, appréciation du taux de change effectif de l'euro et hausse du prix du pétrole expliquent une grande part des mauvais résultats de la France en termes de commerce extérieur depuis 2003. En revanche ils n'expliquent pas pourquoi la France est le pays de la zone euro qui a le moins bénéficié du dynamisme de la demande mondiale. Les raisons sont à chercher du côté de la spécialisation géographique et sectorielle de la France mais aussi de la politique menée par l'Allemagne depuis deux ans : en centrant davantage ses échanges sur la zone euro et dans des secteurs moins adaptés à la demande actuelle des pays émergents, la France n'a pas profité pleinement, contrairement à l'Allemagne par exemple, de la reprise engagée dès le second semestre 2003 aux États-Unis et surtout en Asie et dans les pays de l'Est. Compte tenu également de sa spécialisation sectorielle forte dans l'aéronautique et dans les biens de consommation sensibles à l'effet-prix, la France a également plus souffert que ses partenaires de la crise du secteur aérien liée aux événements du 11 septembre et de l'appréciation de l'euro. Cette désaffection pour les produits français a renforcé l'érosion de la compétitivité prix, et explique une partie de la forte baisse des parts de marché de la France au cours de ces deux dernières années.
Les pertes de marché non expliquées par les effets de taux de change et de spécialisation sont liées à la situation économique allemande : engagée depuis 2003 dans une thérapie visant l'amélioration de l'offre par la restriction des revenus et des transferts, l'Allemagne a vu ses coûts salariaux unitaires diminuer en niveau absolu mais aussi relativement à ses autres partenaires européens dont la France. Selon notre équation économétrique, cette politique expliquerait 30 % des pertes de parts de marchés françaises enregistrées au cours des deux dernières années. Par ailleurs, les baisses de salaires ont conduit à une forte contraction de la demande intérieure allemande et par là-même des importations de notre principal partenaire. Au total, depuis 2003, les réformes allemandes coûtent chaque année environ 0,3 point de PIB à l'économie française.
... qui devraient globalement s'estomper en 2006.
A l'horizon de notre prévision, nous faisons l'hypothèse d'un arrêt du mouvement haussier de l'euro au cours du second trimestre 2005 et nous supposons qu'il s'échangera à 1,19 dollar en fin d'année 2006. En conséquence, les variations du dollar ne devraient quasiment plus affecter la croissance dans l'hexagone l'année prochaine. Nous faisons également l'hypothèse que le prix du baril se stabiliserait à 60 dollars, stabilisant également son impact sur la croissance (-0,5 point). De même, les réformes entreprises outre-Rhin ne devraient pas peser plus en 2006 qu'en 2005.
Au total, l'impact cumulé de l'ensemble des contraintes extérieures amputera la croissance de -0,9 point en 2006, soit 0,5 point de moins que celui enregistré en 2005 et 0,3 point en 2004 (graphique 19 et tableau 14).
Quel scénario à l'horizon 2006 ?
Avec le desserrement des contraintes extérieures étudié précédemment, la stabilisation de la situation opérationnelle des entreprises, le net redressement de leur situation financière et la réactivation de la politique de l'emploi, le second semestre 2005 ne démarre pas sans atouts.
Comme l'illustrent les perspectives personnelles de production dans l'industrie et dans les services, même si le contexte global reste hésitant, la tendance est sur une pente ascendante (graphique 20).
20. Perspectives personnelles de production...
mm3
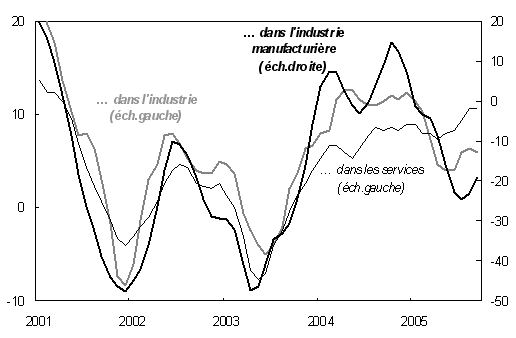
Source : INSEE.
L'indicateur avancé de l'OFCE, qui exploite l'information contenue dans les enquêtes de conjoncture, confirme ce schéma : l'économie française devrait connaître un rebond au cours du second semestre 2005, avec des hausses du PIB de 0,8 % et 0,6 % respectivement aux troisième et quatrième trimestres (cf encadré).
|
L'indicateur avancé de l'OFCE pour l'économie française 86 ( * ) Selon l'indicateur avancé, actualisé avec les données disponibles jusqu'à la fin septembre, la croissance française aurait dû rebondir au 2ème trimestre. Après une modeste hausse du PIB de 0,4 % au 1er trimestre, une accélération à 0,7 % était attendue au deuxième. Mais contre toute attente, la croissance a ralenti à 0,1 % selon les comptes trimestriels de l'INSEE. Un tel écart entre les prévisions de l'indicateur et les résultats des comptes nationaux s'est déjà produit dans le passé. Il peut s'expliquer par le caractère provisoire des comptes trimestriels, susceptibles d'être révisés en hausse lors des versions ultérieures. Mais cette explication n'est pas suffisante. L'écart peut aussi provenir d'un décalage entre la reprise déjà ressentie par les industriels à l'enquête de juin, en fort redressement, et sa traduction effective dans les comptes nationaux qui, de fait, n'apparaîtrait qu'au troisième trimestre. Ici, la méthode de trimestrialisation de l'enquête mensuelle conditionne le résultat de l'indicateur. En prenant comme valeur trimestrielle celle de juin, en fort redressement, l'indicateur donne l'image d'une nette reprise de l'économie française, avec un taux de croissance estimé de 0,7 %. En revanche, en sélectionnant la valeur de mai qui correspond au point bas de l'enquête, la croissance estimée ne serait plus que de 0,3 %, beaucoup plus proche de la croissance donnée par l'INSEE. Finalement, nous avons retenu comme valeur de l'indice de confiance au deuxième trimestre la moyenne sur avril, mai et juin, pour une croissance estimée à 0,4 %. Au-delà de l'imprécision des estimations, il semble bien néanmoins que l'économie française se soit engagée à la toute fin du deuxième trimestre sur un rythme de croissance sous-jacent voisin de 0,6 %. Ce rythme pourrait se poursuivre jusqu'à l'horizon de la prévision dès lors que la confiance dans l'industrie s'est très peu ressentie de l'envolée du prix du baril de pétrole durant l'été. La croissance sur l'ensemble de l'année 2005 pourrait alors atteindre 1,8 %. |
|
Le taux de croissance trimestriel du PIB observé et prévu En %
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE |
La baisse du taux d'épargne des ménages ...
La forte baisse du taux d'épargne observée depuis 2003 s'est quelque peu s'essoufflée en début d'année 2005 avec l'accélération du revenu des ménages. En 2006, les ménages continueraient toutefois de puiser dans leur épargne. Sous l'effet conjugué de la baisse du taux de chômage et d'un taux d'intérêt maintenu à un faible niveau, le taux d'épargne devrait baisser de -0,4 point en 2006, s'établissant à 15 % en moyenne sur l'année (graphique 21). La croissance de la consommation atteindrait 2,5 % en 2006, rythme qui reste toutefois inférieur à celui observé au cours des huit dernières années avec des pics à plus de 3,5 % entre 1998 et 2000.
Malgré une situation financière des entreprises en nette amélioration - illustrée par les bénéfices record de celles du CAC 40 ainsi qu'une amélioration de leur ratio de solvabilité - et de bonnes conditions de financement, l'investissement productif devrait croître à un rythme plus que modeste, atteignant 3,6 % en 2006, rythme également très largement inférieur à ceux observés au cours des dernières périodes de reprise (9 % en moyenne au cours de la période 1998-2000).
21. Taux d'investissement et taux d'épargne
En % de la VA des SNF-EI En % du RDB
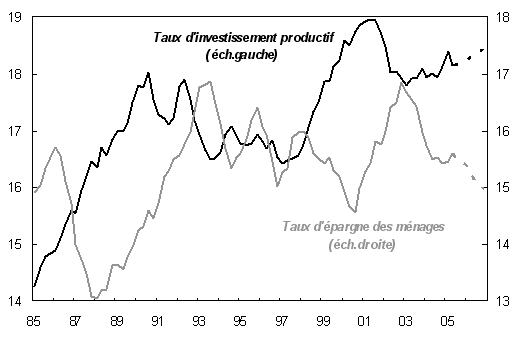
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE, e-mod.fr de 2005 à 2006.
... ainsi que la réactivation de la politique de l'emploi...
Enfin, la réactivation de la politique de l'emploi, devrait permettre à la croissance en 2006 de créer, proportionnellement plus d'emplois que celle des années précédentes.
En instaurant un nouveau contrat - le contrat d'avenir, destiné aux allocataires de minima sociaux - réservé au secteur non marchand, la politique de l'emploi menée par le gouvernement change de cap. Son orientation du secteur non marchand vers le secteur marchand (non-renouvellement des emploi-jeunes, réduction importante des effectifs en Contrats Emploi Solidarité, création des contrats jeunes en entreprise) engagée depuis 2002 s'est avérée insuffisante pour améliorer la situation sur le marché du travail. Pire, menée dans un contexte de ralentissement de l'activité, cette politique a globalement amplifié de 0,2 point le taux de chômage qui ne s'est stabilisé qu'en raison d'une conséquence secondaire de la réforme des retraites, engendrant 100 000 retraits d'activité en 2004 en raison des retraites anticipées des personnes ayant eu des carrières longues.
Compte tenu du retard pris pour lancer les contrats d'avenir et des baisses d'effectifs en CES et en emploi jeune, la politique de l'emploi, impulsée par plusieurs mesures d'urgence pour l'emploi adoptées en juin 2005, ne contribuerait à la baisse du taux de chômage qu'à partir du second semestre 2005 (graphique 22). Cumulée à la reprise de l'emploi marchand et à la suite des effets de la réforme des retraites, le taux de chômage baisserait de 10% de la population active fin 2004, à 9,8 % fin 2005, puis à 9,2 % fin 2006.
22. Cumul des créations de postes dues à la politique de l'emploi *
En milliers, stocks
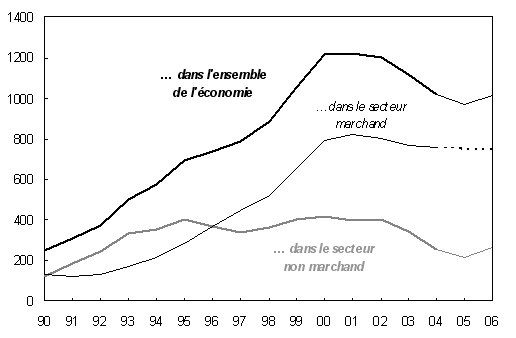
* La politique de l'emploi correspond aux emplois aidés, aux effets sur l'emploi des 35 heures et des baisses de charges.
Sources : DARES, calculs OFCE
... devraient permettre à l'économie française de croître à son potentiel
En moyenne annuelle, l'économie française devrait croître en 2006 à son rythme potentiel (2,2 %).
Une croissance inférieure à 3% alors que l'activité au cours des quatre dernières années a été très inférieure à son potentiel, est une performance modeste (graphique 17). Le redémarrage de l'économie française est encore tempéré dans notre prévision par l'environnement international et la politique budgétaire, et son rythme est inférieur à ce qui serait possible après une phase de fort ralentissement. Une comparaison avec les précédents scénarios de reprise le confirme (graphique 23). A l'horizon 2006, la reprise anticipée est très en deçà de celle constatée à la fin des années 80 ou plus récemment en 1997. Fin 2006, soit 14 trimestres après le creux conjoncturel, le déficit de croissance cumulé par rapport aux dernières reprises s'élève à plus de 5 points de PIB, soit 2 point de taux de chômage supplémentaires.
23. 2004-2006 : Une reprise "molle"
Indice 100 au creux conjoncturel
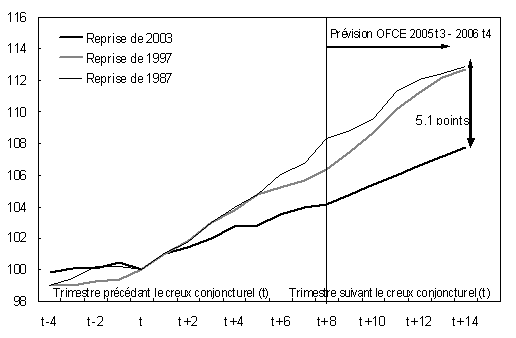
Sources : INSEE, calculs OFCE.
14. Les raisons d'une reprise « entravée »
|
Moyennes annuelles en % |
2005 |
2006 |
|
Taux de croissance du PIB en reprise |
3,2 |
3,2 |
|
Effet de l'euro |
- 0,6 |
- 0,1 |
|
Effet pétrole |
- 0,5 |
- 0,5 |
|
Effet de la politique budgétaire |
- 0,2 |
- 0,4 |
|
Effet de la politique monétaire |
0,1 |
0,1 |
|
Effet des réformes allemandes |
- 0,3 |
- 0,3 |
|
Taux de croissance du PIB prévu |
1,7 |
2,0 |
Source : Calculs OFCE .
Les risques
Bien entendu des risques existent qui pourraient conduire à une remise en cause de notre scénario à l'horizon 2006. Ils sont, pour l'essentiel, relatifs à l'environnement international : crise pétrolière majeure, ralentissement marqué de la croissance dans le monde, chute prolongée du dollar etc. Ils pourraient remettre en cause les perspectives positives, amputant la croissance à l'horizon 2006 d'un demi point si le prix du pétrole se maintenait à 70 dollars le baril et si l'euro s'établissait à 1,4 dollar (tableau 15).
15. Des scénarios illustratifs des risques sur la croissance française
|
2005 |
2006 |
|
|
Scénario central |
1,7 % |
2,0 % |
|
Appréciation de l'euro (1 € = 1,4 $) |
1,7 % |
1,6 % |
|
Prix du pétrole à 70 $ le baril |
1,7 % |
1,8 % |
|
Chute de 15 % du prix de l'immobilier |
1,7 % |
1,8 % |
|
Apparition d'un effet de « second tour » inflationniste |
||
|
• Uniquement en France |
1,6 % |
1,4 % |
|
• Dans l'ensemble des pays sans réaction de la BCE |
1,6 % |
1,6 % |
|
• Dans l'ensemble des pays avec réaction de la BCE |
1,6 % |
1,4 % |
|
Retour à un prix du pétrole à 45 $ le baril |
1,7 % |
2,3 % |
Source : Calculs OFCE.
Un scénario de dynamique interne plus noir est également envisageable (tableau 15). Il suppose un enchaînement d'évolutions très négatives qui pour l'heure ne transparaissent ni dans les enquêtes ni dans les statistiques fournies par l'INSEE.
Un premier risque réside dans une baisse du prix de l'immobilier. Dans notre prévision, nous avons supposé une stabilisation de ce dernier. Si en revanche celui-ci connaissait une baisse de 15 % en 2006, cela viendrait amputer la croissance de 0,2 point de PIB.
Un deuxième risque est que s'enclenche une spirale inflationniste prix-salaire en France suite à l'augmentation enregistrée du prix du pétrole. Un tel mécanisme, qui avait pleinement joué lors des deux précédents chocs pétrolier, ne s'observe pas, pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles (cf. partie sur les prix), depuis le démarrage de la vague de hausse du pétrole au début 2004, et donc n'a pas été retenu dans notre scénario. Ainsi, sauf à envisager que les hausses quasi-continues du pétrole n'aient finalement raison de la capacité de résistance des agents au renchérissement de l'énergie, rien à l'heure actuelle ne laisse donc présager l'enclenchement du phénomène. Si toutefois tel était le cas, cela pourrait se traduire par une hausse d'un demi point d'inflation qui viendrait rogner le pouvoir d'achat des ménages et par là limiter la croissance de l'économie française en 2006. Pour illustrer un tel mécanisme, trois variantes ont été menées. La première, limite ce mécanisme à la France. A l'effet sur le pouvoir d'achat vient s'ajouter un effet de perte de compétitivité : au total la croissance en 2006 serait amputée de plus d'un demi point. Dans la deuxième nous supposons que l'ensemble des pays partenaires subissent cet effet de deuxième tour. Dans ce cas de figure, les pertes de compétitivité disparaissent mais sont en partie compensées par un ralentissement mondial, diminuant la croissance d'environ 0,4 point. Enfin, si l'inflation progresse dans l'ensemble des pays et notamment les pays européens, la banque centrale européenne (BCE) pourrait resserrer sa politique monétaire. Une hausse de 1 point des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année 2005 amputerait alors de 0,2 point supplémentaire la croissance en 2006.
A moyen terme cinq scénarios sont envisagés
Si, comme nous allons le développer par la suite, cinq scénarios ont été bâtis, certaines hypothèses sont communes à ces scénarios :
Les hypothèses communes sont les suivantes
1. Nous maintenons une hypothèse de taux de croissance de la productivité du travail de 1,7% entre 2007 et 2010. Les salaires réels évoluent comme celles-ci.
2. Les hypothèses de population active sont celles de la DARES (elles intègrent les effets des retraites anticipées).
3. Les hypothèses d'emplois non-marchands aidés sont celles de la DARES (baisse progressive de 100 000 entre début 2004 et fin 2008). On suppose qu'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ne sera pas remplacé.
4. Les hypothèses de dépenses publiques et prestations obligatoires sont celles du programme pluri annuel.
5. Il est fait également l'hypothèse de le taux de chômage structurel se situe aux alentours de 6 %.
B.1. QUATRE SCÉNARIOS DE CROISSANCE MODÉRÉE
Les scénarios envisagés sont doublement contraints :
1. La première contrainte porte sur la croissance du PIB qui est celle retenue dans le programme de stabilité (scénario bas), à savoir 2,25 % par an.
2. La seconde est relative au compte des administrations publiques (APU), à savoir les dépenses publiques, le taux de prélèvements obligatoires et le déficit public.
PRINCIPALES HYPOTHÈSES CONCERNANT LES FINANCES PUBLIQUES À MOYEN TERME
La maîtrise des dépenses de l'Etat et de la Sécurité Sociale, notamment l'assurance maladie, devrait permettre de ramener le déficit public de 3,6% du PIB en 2004 à 0.9% en 2010 (tableau 16). Le solde structurel (calculé hors charges d'intérêts) s'améliorerait de 2,5 points de PIB entre 2005 et 2010, dont les trois quarts entre 2008 et 2010. Les baisses de prélèvements, à partir de 2007, seraient plus que compensées par la baisse des dépenses publiques.
Ce scénario repose sur une croissance de 2,25% par an à partir de 2006, rythme supérieur d'un quart de point à celui de la croissance potentielle. Le gouvernement retient en effet une croissance potentielle à 2% à partir de 2007. Le solde conjoncturel s'améliorerait ainsi de 0,4 point de PIB entre 2007 et 2010.
16. Evolution du solde public et décomposition conjoncturelle - structurelle
|
En points de PIB |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Solde public |
-3.0 |
-2.9 |
-2.8 |
-2.3 |
-1.7 |
-0.9 |
|
Variation des taux de PO |
0.5 |
0.1 |
-0.3 |
-0.2 |
-0.1 |
0 |
|
Variation des dépenses publiques |
0.3 |
-0.2 |
-0.5 |
-0.7 |
-0.8 |
-0.8 |
|
dont dépenses publiques primaires |
0.4 |
-0.1 |
-0.5 |
-0.7 |
-0.9 |
-0.9 |
|
Variation solde structurel (hors charges d'intérêts) |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
0.4 |
0.7 |
0.8 |
|
Variation solde structurel (y compris charges d'intérêts) |
0.4 |
0.3 |
0.1 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
|
Variation solde conjoncturel |
-0.2 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Impact des recettes non fiscales sur le solde public |
0.4 |
-0.3 |
-0.1 |
0 |
0 |
0 |
Sources : PLF 2006, programmation pluriannuelle des finances publiques 2007-2009, calculs OFCE.
Notre prévision de déficit public diffère quelque peu de celle du gouvernement à partir de 2007 avec pourtant les mêmes évolutions de croissance, de dépenses publiques, de taux de prélèvements obligatoires. La différence s'expliquerait par les recettes non fiscales exceptionnelles. Il semblerait que dans la prévision du gouvernement, les recettes non fiscales exceptionnelles reçues en 2006 et qui représentent 2,2 milliards d'euros, aient été reconduites chaque année jusqu'en 2009. Notre prévision n'intègre pas une reconduite systématique de ces recettes exceptionnelles, ce qui explique que le solde public de notre compte soit, en 2009, de 0,3 point de PIB inférieur à celui affiché dans le programme pluriannuel des finances publiques.
Evolution des prélèvements obligatoires
Les nouvelles mesures fiscales sont connues pour 2006 et les mesures de la réforme fiscale annoncée par le gouvernement pour 2007 ont été évaluées. Elles représentent une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2006 et de 6,2 milliards en 2007 (tableau 17). En 2007, les piliers de la réforme fiscale qui vont au total baisser les prélèvements sur les ménages de 4,85 milliards d'euros sont :
- la modification du barème de l'impôt sur le revenu qui sera réduit à quatre tranches d'imposition effective et l'intégration de l'abattement de 20% dans le barème de l'impôt. Cette modification se traduira par un gain fiscal de 3,6 milliards d'euros pour les ménages ;
- la revalorisation de la prime pour l'emploi à hauteur de 500 millions d'euros (après 500 millions d'euros également en 2006) ;
- la mise en place d'un « bouclier fiscal » qui plafonne à 60% les impôts (IRPP, ISF et taxes foncières et d'habitation) par rapport aux revenus. Ce bouclier représente une baisse des prélèvements de 400 millions d'euros pour les ménages ;
A cette réforme fiscale s'ajoute la mesure décidée antérieurement du dégrèvement de la taxe professionnelle pour investissement nouveau qui représente, en 2007, une réduction des prélèvements à la charge des entreprises de 1,1 milliard d'euros.
Le taux de prélèvement obligatoires augmenterait de 0,1 point de PIB en 2006 et baisserait de 0,3 point en 2007, avant de diminuer respectivement de 0,2 et 0,1 point de PIB en 2008 et 2009 et de se stabiliser en 2010.
17. Mesures concernant les prélèvements en 2006 et 2007
(en millions d'euros)
|
En millions d'euros |
2006 |
2007 |
|
Etat |
-4730 |
-6180 |
|
PLF 2006 |
400 |
-5080 |
|
Mesures d'allègement en faveur des ménages |
-590 |
-4850 |
|
Mesures d'allègement en faveur des entreprises |
-210 |
-230 |
|
Mesures d'harmonisation et de simplification |
1200 |
|
|
Plan d'urgence pour l'emploi |
-470 |
|
|
Autres mesures prises antérieurement |
-3800 |
-1100 |
|
Allègement de cotisations sociales |
-860 |
|
|
Sécurité sociale |
3210 |
|
|
PLFSS 2006 |
1660 |
|
|
Hausses de cotisations au régime général |
1330 |
|
|
Hausses de cotisations décidées (partenaires sociaux) |
280 |
|
|
Autres mesures de sécurité sociale |
-30 |
|
|
Autres mesures |
40 |
|
|
Total |
-1480 |
-6180 |
Source : PLF 2006.
La réduction du déficit structurel est tirée par le ralentissement accru des dépenses publiques qui repose à la fois sur la réduction tendancielle des dépenses de l'Etat et la maîtrise des dépenses sociales. Après une baisse de 0,3 point de PIB en 2006, les dépenses publiques diminueraient de près de 3 points de PIB entre 2007 et 2010.
B - ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR SOUS-SECTEURS
A partir des informations contenues dans le PLF 2006 et dans le programme pluriannuel des finances publiques, nous avons recalculé l'évolution des dépenses publiques pour chaque sous-secteur en tenant compte des effets des transferts entre administrations publiques (tableau 18). Les dépenses de chaque sous-secteur intègrent en effet les transferts versés à d'autres sous-secteurs des administrations publiques et qui n'ont pas lieu d'être lorsqu'on regarde l'évolution consolidée des dépenses publiques de l'ensemble des administrations publiques. Ce point n'est pas négligeable, car les transferts représentent environ 15% de la dépense publique. C'est pourquoi, il peut exister des différences significatives entre les dépenses publiques par sous-secteurs affichées dans le PLF 2006, qui intègrent les transferts mais du coup ne bouclent pas sur les dépenses publiques des APU consolidées, et les dépenses recalculées par sous-secteur en neutralisant les effets de ces transferts.
18. Dépenses publiques en volume par sous-secteurs hors effets des transferts
|
En volume, en % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Etat |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
-0.5 |
-1.0 |
-1.0 |
|
Organismes divers d'administration centrale |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
Administrations publiques locales |
2.5 |
2.9 |
2.0 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
|
Administrations de sécurité sociale |
2.4 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
Administrations publiques consolidées |
1.7 |
1.6 |
1.2 |
0.8 |
0.6 |
0.6 |
Sources : PLF 2006, programmation pluriannuelle des finances publiques 2007-2009, calculs OFCE.
La stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat est inscrite dans le PLF 2006, comme pour les deux années précédentes. Cependant, si l'on neutralise les effets des transferts, les dépenses publiques augmentent de 0,6% en volume en 2005 et 2006. La programmation 2007-2009 s'appuie sur la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la volonté accrue de réaliser des économies au niveau de l'Etat. Le gouvernement a donc retenu comme objectif, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques 2007-2009, une stabilisation en valeur des dépenses de l'Etat (y compris transferts) au-delà de 2007.
Les dépenses des administrations de sécurité sociale ralentiraient sous l'effet du net infléchissement de celles de l'assurance maladie (tableau 19). Le redressement de la branche maladie amorcé en 2005 se poursuivrait et contribuerait à ramener l'équilibre des comptes sociaux à partir de 2008. Les prestations chômage diminueraient avec le recul du chômage et les dépenses de la branche famille s'infléchiraient avec le retour à l'équilibre de la branche. En revanche, la branche vieillesse resterait dynamique avec l'arrivée progressive à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom.
19. Dépenses des administrations de
sécurité sociale
en volume par sous-secteur
|
En volume, en % |
20 05 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dépenses Maladie |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
Dépenses Vieillesse |
3.6 |
1.9 |
2.4 |
2.4 |
2.6 |
2.8 |
|
Dépenses Famille |
2.7 |
2.3 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
Dépenses Chômage |
-0.6 |
-2.1 |
-3.1 |
-3.2 |
-4.3 |
-5.3 |
|
Dépenses administrations de sécurité sociale |
2.4 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
Sources : PLF 2006, programmation pluriannuelle des finances publiques 2007-2009, PLFSS 2006, calculs OF CE.
Enfin, les dépenses des administrations publiques locales crôiraient de 1,5% en volume par an. L'investissement public resterait relativement dynamique jusqu'en 2007, avant de s'infléchir à partir de 2008.
Au total, les dépenses publiques évolueraient à rythme annuel moyen de 0,8% entre 2007 et 2010.
Les quatre scénarios présentés ci-dessous illustrent le comportement que doivent adopter les agents privés pour arriver à rendre ces contraintes cohérentes et réalisables.
Comme l'OFCE l'a déjà exploré dans des travaux antérieurs, une croissance supérieure à la croissance potentielle suppose deux types de conditions :
• D'une part, une demande et une offre soutenues sont nécessaires tant du côté des ménages (via leur consommation) que des entreprises (à travers leur investissement qui est une partie de la demande et qui permet d'augmenter les capacités de production afin de pouvoir satisfaire la demande).
• D'autre part, une évolution structurelle dans la formation de prix et des salaires est nécessaire. Le taux de chômage n'accélérant pas l'inflation doit se réduire afin de permettre une baisse du chômage observé sans que des tensions inflationnistes ne se déclenchent et compromettent le processus de croissance.
Les hypothèses de productivité étant identiques dans l'ensemble des scénarios, les différences de performances sur le marché du travail s'expliquent exclusivement par le différentiel de croissance.
Enfin, dans les deux premiers scénarios, nous retenons comme hypothèses une stabilisation de la compétitivité et des parts de marché ainsi qu'un retour des économies partenaires vers leur sentier de croissance potentielle. La contribution du solde extérieur à la croissance est nulle. Compte tenu de ces hypothèses habituelles dans une projection à moyen terme, il est difficile de tirer des enseignements significatifs des échanges extérieurs.
Scénario 1 : l'effort sur les entreprises
Dans ce scénario, l'objectif de croissance de 2,25 % par an est atteint quasi exclusivement grâce à un comportement très expansionniste des entreprises. En effet, la contribution extérieure est supposée nulle et le taux d'épargne se situe en moyenne sur la période 2007-2010 à 14,7 %, soit son niveau atteint en 2006.
Comme l'illustre le graphique ci-dessous, compte tenu de ces contraintes, auxquelles il faut rajouter celles concernant les finances publiques, l'objectif de croissance nécessite une forte augmentation du taux d'investissement des entreprises.
Ce dernier doit augmenter de 0.8 point en moyenne annuelle, atteignant 21,4 % de la valeur ajoutée en 2010, niveau jamais atteint auparavant.
24. Comportement d'investissement dans les 5 scénarios
En %, mm4
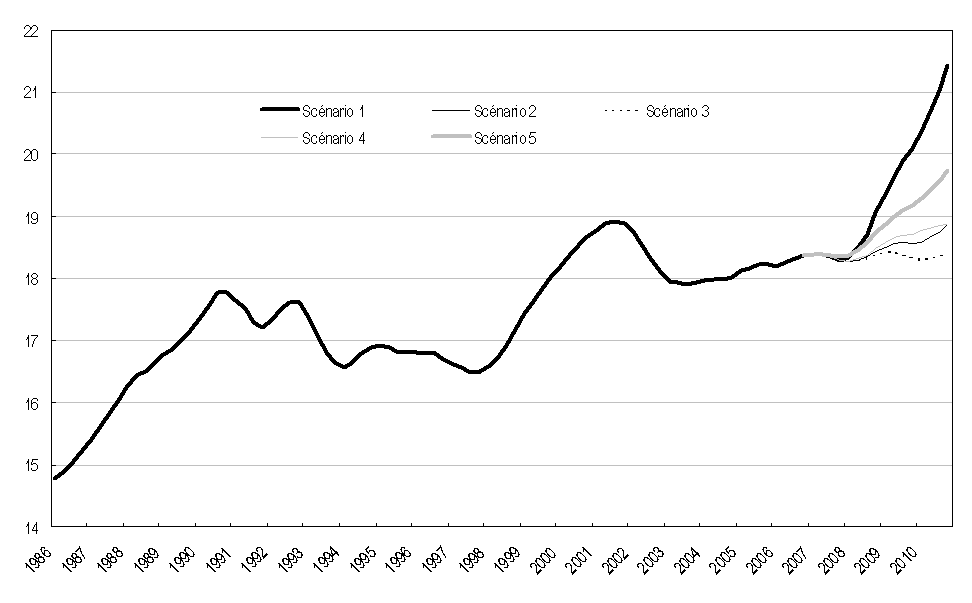
Sources : INSEE, calculs OFCE.
Scénario 2 : l'effort sur les ménages
Dans ce scénario, l'effort bascule des entreprises vers les ménages. L'objectif de croissance de 2,25 % par an est atteint quasi exclusivement grâce à un comportement très expansionniste des ménages alors que les comportements de l'extérieur et des entreprises restent neutres.
Le graphique 25 illustre ce scénario. Le taux d'épargne doit baisser considérablement au cours de la période 2007-2010. En cumulé sur quatre années, cette baisse doit être de 2,4 point, soit une baisse moyenne de 0,6 chaque année. Le taux d'épargne atteindrait 12,3 % du revenu disponible brut des ménages.
25. Comportement d'épargne dans les 5 scénarios
En %, mm4
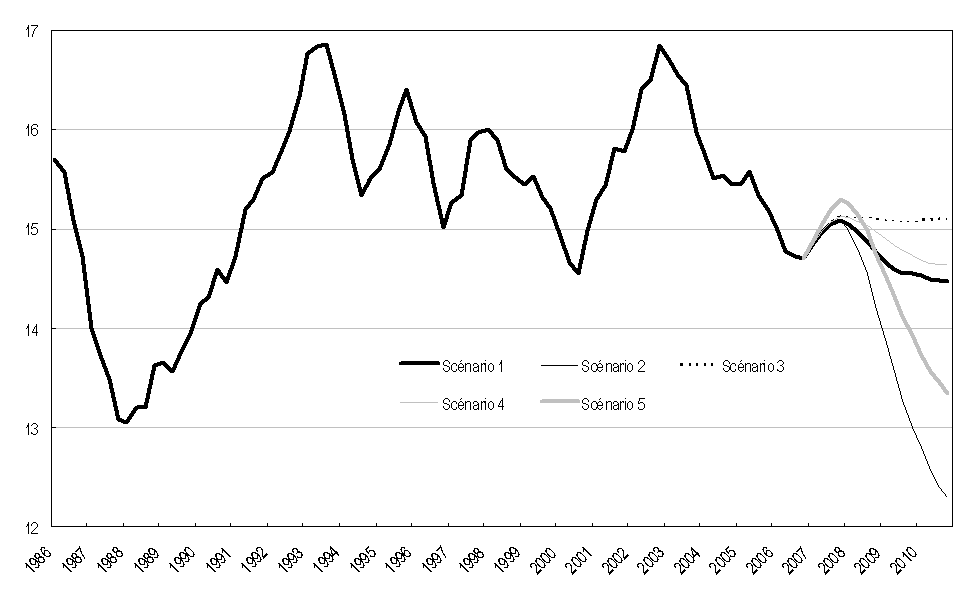
Sources : INSEE, calculs OFCE.
Scénario 3 : l'effort sur l'extérieur
Dans ce scénario nous avons levé l'hypothèse, standard dans ce type d'exercice, de neutralité de l'extérieur à moyen terme. Celle-ci a été remplacée par une neutralité non plus entre 2007 et 2010 mais sur une décennie. La contribution extérieure étant assez négative ces dernières années, cette hypothèse permet une contribution positive au cours de la période 2007-2010.
En stabilisant le taux d'épargne des ménages et le taux d'investissement des entreprises, et compte tenu des hypothèses inchangées sur les finances publiques, la contribution positive du commerce extérieur (0,4 point en moyenne annuelle) ne permet cependant pas d'atteindre l'objectif de 2,25 % chaque année. La croissance serait de 1,9 %, proche du potentiel de croissance de l'économie française. La baisse du chômage serait alors moindre, de -0.1 point par an, contre -0,6 dans les scénarios 1 et 2.
De la même manière, le déficit public atteindrait en 2010 1,7 point de PIB contre 0,9 dans les scénarios 1 et 2.
Scénario 4 : Effort réparti
Partant du scénario précédent, il est possible d'évaluer le comportement des agents privés permettant de combler l'écart de croissance.
D'après ce scénario, il serait alors possible de retrouver la croissance, le déficit et le taux de chômage des scénarios 1 et 2, avec un taux d'épargne qui s'établirait en moyenne à 14,9 % du RdB, soit 0,6 point en dessous de la moyenne des 20 dernières années. Le taux d'investissement des entreprises devrait quant à lui s'établir aux alentours de 18,6 % en moyenne sur la période 2007-2010, soit 1,4 point au dessus de son niveau de long terme.
|
Impact d'une hausse des dépenses de l'ONDAM par rapport au compte central On retient l'hypothèse dans ce compte que les dépenses de santé (dans le champ de l'ONDAM) en volume augmentent au même rythme que le PIB à partir de 2006 (tableau 12), alors que dans le compte central, elles croissent de 1% par an à partir de 2006. Ce surcroît de dépenses de santé engendre une hausse supplémentaire des dépenses publiques de près de 11 milliards en 2010, soit 0,5 point de PIB à l'horizon de notre prévision. Pour maintenir l'objectif de l'équilibre des comptes sociaux en 2008 avec des dépenses de santé plus dynamique que dans le compte central, il serait nécessaire d'augmenter la CSG de 0,1 point de PIB chaque année à partir de 2006.
20. Impact d'une hausse des dépenses de l'ONDAM
|
|
En volume, en % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dépenses ONDAM |
2.0 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
|
Dépenses administrations de sécurité sociale |
2.4 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
Dépenses des APU |
1.7 |
1.8 |
1.4 |
1.0 |
0.8 |
0.8 |
|
Dépenses publiques (écart au cc , milliards d'euros) |
0 |
1.9 |
3.9 |
6.0 |
8.3 |
10.8 |
|
Dépenses publiques (écart au cc en points de PIB) |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
|
Source : calculs OFCE. |
B.2. UN SCÉNARIO ALTERNATIF DE CROISSANCE PLUS RAPIDE
Dans ce scénario, nous supposons que le chômage d'équilibre se situe aux alentours de 5%. Pour atteindre ce niveau en 2010, l'économie française devrait croître à un rythme moyen de 3 % au cours de la période 2007-2010.
Hypothèses de taux de chômage à 5 %
Nous avons fait ici l'hypothèse d'un taux de chômage s'établissant à 5,0 % en 2010 avec un maintien de l'inflation au dessous de 2 % par an. Ce résultat, dans notre analyse modélisée, suppose une baisse du taux de chômage d'équilibre. Ce concept, issu de la théorie du « chômage naturel » de Milton Friedman (1968), a connu des appellations diverses : NAIRU, NAWRU, chômage de long terme ou chômage structurel. Elle repose sur l'idée selon laquelle au-dessous de ce niveau « naturel », toute baisse du chômage observé a, dans un premier temps, pour contrepartie une accélération de l'inflation ; puis dans un deuxième temps, du fait de la spirale prix-salaires qui découle de cette inflation, le taux de chômage revient à son niveau structurel initial. Au total, la baisse du chômage, n'aura donc été que transitoire, tandis que ses conséquences inflationnistes seraient définitives. Selon cette théorie, les politiques actives de la demande d'inspiration keynésienne sont inadéquates pour combattre le chômage d'équilibre ; seules des réformes structurelles permettraient de diminuer ce niveau « naturel ». Cette analyse a fait l'objet d'abondantes controverses quant à ses soubassements théoriques mais également sur sa validité empirique. Par ailleurs, certains éléments théoriques permettent d'entrevoir une baisse du chômage non inflationniste. Les théories de l'hystérèse montrent comment ce chômage a augmenté avec le taux de chômage observé, du fait de son impact sur le capital humain. A l'inverse, une baisse du taux de chômage devrait amener une baisse du taux de chômage d'équilibre. Avec l'expérience d'une longue période d'absence d'inflation et le renforcement de la crédibilité de la banque centrale européenne, les anticipations sur les prix se modifient, permettant une baisse du chômage d'équilibre. Les baisses passées de taux d'intérêt permettent une augmentation progressive du taux d'investissement, ce qui limite les tensions potentielles sur l'appareil productif. Le NAIRU peut baisser graduellement en réaction aux politiques structurelles sur le marché du travail (réforme de l'indemnisation du chômage en 1993, abaissement de charges patronales, prime à l'emploi, PARE...). Les politiques structurelles sur le marché des biens (politique de concurrence, dérégulation) et sur les marchés financiers (dérégulation) peuvent aussi diminuer le NAIRU.
En l'absence de baisse du taux de chômage d'équilibre et dans l'hypothèse où il n'y a pas de réponse de la banque centrale qui viserait à ralentir fortement l'évolution des prix, l'inflation augmenterait, entraînant une perte de compétitivité et amputerait alors la croissance. A terme, le taux de chômage reviendrait alors à son niveau d'équilibre, proche du scénario central.
Dans le scénario alternatif, la croissance de la population active est légèrement supérieure à celle de la population en âge de travailler au fur et à mesure que le taux de chômage diminue et donc se rapproche de son niveau de plein emploi. En effet, en période de ralentissement de l'activité et d'augmentation du chômage, des actifs potentiels peuvent renoncer à se présenter sur le marché du travail (« travailleurs découragés », allongement de la durée des études) ; inversement, en période d'amélioration conjoncturelle, des personnes jusque-là découragées se présentent sur le marché du travail, entraînant ainsi une évolution de la population active observée supérieure à celle de la population en âge de travailler.
Hypothèses des dépenses publiques dans le scénario 5
Dans le scénario 5, nous avons retenu une croissance du PIB de 3% à partir de 2007 (tableau 21). Le profil du solde public n'est pas modifié. En revanche, la répartition entre le solde structurel et conjoncturel est changée. Le surplus de croissance, qui améliore automatiquement le solde public, est contrebalancé par une impulsion du côté des dépenses publiques moins forte que dans le compte central.
21. Hypothèses des dépenses publiques dans le scénario 5
|
En volume, en % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Croissance du PIB |
1.7 |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
Dépenses des APU |
1.7 |
1.6 |
2.0 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
|
Solde public (pts de PIB) |
-3.0 |
-2.9 |
-2.8 |
-2.3 |
-1.7 |
-0.9 |
|
Variation solde structurel (y compris charges d'intérêts) |
0.4 |
0.3 |
-0.3 |
0.0 |
0.2 |
0.3 |
|
Variation solde conjoncturelle |
-0.2 |
0.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
Source : calculs OFCE.
Les dépenses des APU seraient donc plus importantes et permettraient une contribution plus forte à la croissance (plus de 0,3 % en moyenne annuelle). Cependant, cela ne permettrait pas, à elles seules, d'arriver à 3% de croissance annuelle. Comme cela est illustré dans les graphiques 24 et 25, une forte baisse du taux d'épargne (0,3 point en moyenne annuelle) couplée à une forte hausse du taux d'investissement (0,3 point en moyenne annuelle).
II. VARIANTES
Deux types de variantes ont été réalisés pour illustrer certains risques.
Le premier tente de mesurer l'impact d'une hausse de l'inflation dite de « deuxième tour » liée à la hausse du prix du pétrole. Le deuxième type de variante porte sur des scénarios alternatifs d'évolution des finances publiques.
C.1. Variantes « inflation »
Les variantes ci-dessous mesurent l'impact d'un choc de 0,5 point d'inflation la première année.
Choc limité à la France
Dans cette première variante, nous faisons l'hypothèse que l'effet de second tour n'a lieu qu'en France. Le choc initial de 0,5 point d'inflation se propage les années suivantes par l'intermédiaire de la boucle prix-salaire : la hausse de l'inflation provoque une hausse des salaires nominaux qui à son tour se propage dans les prix de production puis dans les prix de consommation. Au bout de cinq ans, ce choc initial se stabilise à 1,5 point d'inflation. Ce surplus d'inflation, qui se limite à la France, induit une perte de compétitivité de l'hexagone. La baisse des exportations qui en découle provoque une contribution négative du commerce extérieure d'environ -0.3 point chaque année.
Par ailleurs, ce choc inflationniste vient rogner le pouvoir d'achat des ménages, la hausse des salaires nominaux étant inférieure à celle de l'inflation. Cela induit une baisse de la consommation des ménages, qui vient peser sur la croissance en moyenne d'environ -0.4 point chaque année.
Les dégradations du commerce extérieur et de la consommation des ménages viennent ralentir l'activité des entreprises qui, à leur tour, limitent leurs investissements de capacité.
Au total, le choc sur l'économie française s'élève à -0.5 point de PIB la première année et -1.6 point en 2010.
22. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation en France
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB total en volume |
-0.5 |
-0.9 |
-1.3 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Importations |
-1.2 |
-2.0 |
-2.4 |
-2.6 |
-2.4 |
|
Dépenses des ménages |
-0.3 |
-0.6 |
-1.1 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Investissement des entreprises |
-0.7 |
-1.4 |
-2.0 |
-2.4 |
-2.4 |
|
Exportations |
-1.9 |
-3.1 |
-3.4 |
-3.5 |
-3.4 |
|
Contributions à la croissance |
|||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
-0.3 |
-0.6 |
-1.0 |
-1.2 |
-1.3 |
|
Solde extérieur |
-0.2 |
-0.3 |
-0.3 |
-0.3 |
-0.3 |
|
Prix de la consommation des ménages |
0.5 |
1.2 |
1.5 |
1.6 |
1.4 |
|
Prix du PIB |
0.5 |
1.1 |
1.4 |
1.4 |
1.3 |
|
Salaire horaire réel |
-0.3 |
-0.9 |
-1.4 |
-2.0 |
-2.6 |
|
Productivité horaire, marchand |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Effectifs totaux (en milliers, en moyenne) |
-69 |
-146 |
-225 |
-289 |
-318 |
|
Effectifs salariés (en milliers, en moyenne) |
-60 |
-127 |
-197 |
-254 |
-279 |
|
Effectifs totaux (en %, en moyenne) |
-0.3 |
-0.6 |
-1.0 |
-1.2 |
-1.3 |
|
Taux de chômage BIT (en point, en moyenne) |
0.2 |
0.5 |
0.7 |
0.9 |
1.0 |
|
Capacité de fin. (niveau en point de PIB) |
|||||
|
Sociétés non financières |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.7 |
|
Sociétés financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
APU |
-0.2 |
-0.5 |
-0.8 |
-1.0 |
-1.2 |
|
Ménages et EI |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
-0.1 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.4 |
-0.4 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
|
Taux d'investissement SQSEI (volume) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
0.0 |
|
Demande mondiale |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Parts de marché exports |
-1.8 |
-3.0 |
-3.4 |
-3.5 |
-3.3 |
22b. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation en France (suite)
(en milliards d'euros)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Recettes des APU |
||||||
|
TVA |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.1 |
-0.2 |
|
|
Impôts sur les importations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Autres impôts sur les produits |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
-0.1 |
|
|
Impôts sur la production |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
-0.1 |
-0.3 |
|
|
Impôts sur le revenu des ménages |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
-0.2 |
-0.8 |
|
|
IS des SNF |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
|
|
IS des SF |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Autres impôts courants |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
|
|
Cotisations sociales reçues |
0.0 |
-0.1 |
-1.0 |
-2.3 |
-4.1 |
|
|
Transferts en capital et divers |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
|
|
Revenus divers de la propriété |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Dépenses des APU |
||||||
|
Salaires bruts |
0.6 |
1.3 |
1.7 |
1.8 |
1.6 |
|
|
Cotisations sociales versées |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
Cotisations sociales fictives |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
Conso. intermédiaires APU |
0.4 |
0.9 |
1.2 |
1.2 |
1.1 |
|
|
Prestations sociales en espèce |
1.3 |
3.4 |
4.9 |
5.4 |
5.4 |
|
|
Intêrets nets versés |
0.0 |
0.3 |
0.7 |
1.4 |
2.1 |
|
|
FBCF des APU |
0.1 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
Transferts courants nets |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Sources : Calculs OFCE
Choc dans l'ensemble des pays
Dans cette deuxième variante, nous faisons l'hypothèse que l'effet de second tour a lieu dans l'ensemble des pays.
23. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation dans l'ensemble des pays
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB total en volume |
-0.3 |
-0.5 |
-0.7 |
-0.9 |
-1.0 |
|
Importations |
-0.8 |
-1.1 |
-1.3 |
-1.3 |
-1.6 |
|
Dépenses des ménages |
-0.3 |
-0.5 |
-0.8 |
-1.1 |
-1.4 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Investissement des entreprises |
-0.4 |
-0.6 |
-0.8 |
-1.0 |
-1.2 |
|
Exportations |
-1.0 |
-1.5 |
-1.5 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Contributions à la croissance |
|||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
-0.3 |
-0.4 |
-0.6 |
-0.8 |
-1.0 |
|
Solde extérieur |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
0.0 |
|
Prix de la consommation des ménages |
0.5 |
1.3 |
1.9 |
2.2 |
2.4 |
|
Prix du PIB |
0.5 |
1.2 |
1.7 |
1.9 |
2.1 |
|
Salaire horaire réel |
-0.3 |
-0.7 |
-1.2 |
-1.6 |
-2.0 |
|
Productivité horaire, marchand |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Effectifs totaux (en milliers, en moyenne) |
-43.2 |
-79.4 |
-115.6 |
-151.9 |
-185.1 |
|
Effectifs salariés (en milliers, en moyenne) |
-37.5 |
-68.8 |
-100.6 |
-132.8 |
-162.4 |
|
Effectifs totaux (en %, en moyenne) |
-0.2 |
-0.3 |
-0.5 |
-0.7 |
-0.8 |
|
Taux de chômage BIT (en point, en moyenne) |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
|
Capacité de fin. (niveau en point de PIB) |
|||||
|
Sociétés non financières |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
|
Sociétés financières |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
|
APU |
-0.2 |
-0.3 |
-0.4 |
-0.5 |
-0.7 |
|
Ménages et EI |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
Taux d'investissement SQSEI (volume) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Demande mondiale |
-1.0 |
-1.5 |
-1.5 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Parts de marché exports |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Contrairement à la variante précédente, les entreprises françaises ne perdent plus en compétitivité mais le ralentissement étant mondial, cela réduit la demande adressée à la France. Toutefois, le premier effet semble l'emporter sur le second.
En effet, au total, l'effet est moins récessif que lors de la variante précédente. L'impact est de -0.3 point de PIB la première année et -1 point en 2010.
23b. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation
dans l'ensemble des pays (suite)
(en milliards d'euros)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Recettes des APU |
||||||
|
TVA |
0.0 |
0.5 |
0.8 |
1.0 |
0.9 |
|
|
Impôts sur les importations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Autres impôts sur les produits |
0.0 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
|
|
Impôts sur la production |
0.1 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
|
|
Impôts sur le revenu des ménages |
0.0 |
0.2 |
0.5 |
0.9 |
0.8 |
|
|
IS des SNF |
0.0 |
0.2 |
0.9 |
1.0 |
1.5 |
|
|
IS des SF |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Autres impôts courants |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Cotisations sociales reçues |
0.3 |
1.1 |
1.3 |
1.0 |
0.4 |
|
|
Transferts en capital et divers |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
|
|
Revenus divers de la propriété |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Dépenses des APU |
||||||
|
Salaires bruts |
0.6 |
1.4 |
2.0 |
2.4 |
2.7 |
|
|
Cotisations sociales versées |
0.1 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
|
|
Cotisations sociales fictives |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
|
|
Conso. intermédiaires APU |
0.4 |
1.0 |
1.5 |
1.7 |
1.8 |
|
|
Prestations sociales en espèce |
1.2 |
3.2 |
4.8 |
5.7 |
6.5 |
|
|
Intêrets nets versés |
0.0 |
0.2 |
0.5 |
0.8 |
1.2 |
|
|
FBCF des APU |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
|
|
Transferts courants nets |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
Sources : Calculs OFCE
Choc dans l'ensemble des pays et intervention des banques centrales
Dans cette dernière variante, nous considérons que les Banques Centrales interviennent pour enrayer la spirale inflationniste. Cette intervention est calibrée à un point de taux d'intérêt dès la première année.
Si cette intervention semble efficace pour contenir l'inflation, elle vient cependant rajouter un effet récessif sur l'économie mondiale et par là, sur l'économie française.
Les principaux mécanismes en jeu sont les mêmes que ceux présentés lors des variantes précédentes excepté pour l'investissement des entreprises. Le principal canal de transmission de la politique monétaire restrictive passe par une contraction des dépenses d'investissement des entreprises.
Au total, l'effet sur le PIB français est proche de celui observé dans la première variante : la moindre perte de compétitivité étant compensée par un ralentissement de l'investissement.
24. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation
dans l'ensemble des pays et interventions des banques centrales
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
PIB total en volume |
-0.6 |
-0.8 |
-1.2 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Importations |
-1.3 |
-1.7 |
-2.4 |
-2.5 |
-2.5 |
|
Dépenses des ménages |
-0.5 |
-0.7 |
-1.2 |
-1.5 |
-1.6 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Investissement des entreprises |
-0.9 |
-1.2 |
-2.0 |
-2.4 |
-2.6 |
|
Exportations |
-2.0 |
-2.5 |
-3.0 |
-3.3 |
-3.5 |
|
Contributions à la croissance |
|||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
-0.4 |
-0.6 |
-1.0 |
-1.2 |
-1.3 |
|
Solde extérieur |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.3 |
|
Prix de la consommation des ménages |
0.2 |
0.6 |
0.5 |
0.2 |
-0.3 |
|
Prix du PIB |
0.3 |
0.6 |
0.5 |
0.2 |
-0.3 |
|
Salaire horaire réel |
-0.4 |
-0.7 |
-1.1 |
-1.5 |
-1.9 |
|
Productivité horaire, marchand |
-0.2 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Effectifs totaux (en milliers, en moyenne) |
-73.2 |
-131.4 |
-199.3 |
-263.4 |
-299.2 |
|
Effectifs salariés (en milliers, en moyenne) |
-63.6 |
-114.4 |
-174.3 |
-231.5 |
-263.8 |
|
Effectifs totaux (en %, en moyenne) |
-0.3 |
-0.6 |
-0.9 |
-1.1 |
-1.3 |
|
Taux de chômage BIT (en point, en moyenne) |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
0.9 |
|
Capacité de fin. (niveau en point de PIB) |
|||||
|
Sociétés non financières |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.4 |
0.5 |
|
Sociétés financières |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
APU |
-0.4 |
-0.7 |
-0.9 |
-1.2 |
-1.4 |
|
Ménages et EI |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.3 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
Taux d'investissement SQSEI (volume) |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Demande mondiale |
-2.1 |
-2.5 |
-3.0 |
-3.3 |
-3.4 |
|
Parts de marché exports |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24b. Impact d'une hausse de 0,5 point d'inflation dans l'ensemble des pays et interventions des banques centrales (suite )
(en milliards d'euros)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Recettes des APU |
||||||
|
TVA |
-0.2 |
-0.1 |
-0.6 |
-1.1 |
-1.8 |
|
|
Impôts sur les importations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Autres impôts sur les produits |
-0.1 |
-0.1 |
-0.4 |
-0.7 |
-1.1 |
|
|
Impôts sur la production |
-0.1 |
-0.1 |
-0.4 |
-0.7 |
-1.1 |
|
|
Impôts sur le revenu des ménages |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
-1.1 |
-2.0 |
|
|
IS des SNF |
0.0 |
-0.1 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
|
IS des SF |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
|
|
Autres impôts courants |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.4 |
|
|
Cotisations sociales reçues |
-0.7 |
-1.0 |
-2.6 |
-4.4 |
-6.8 |
|
|
Transferts en capital et divers |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
|
|
Revenus divers de la propriété |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Dépenses des APU |
||||||
|
Salaires bruts |
0.4 |
0.7 |
0.6 |
0.2 |
0.1 |
|
|
Cotisations sociales versées |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Cotisations sociales fictives |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Conso. intermédiaires APU |
0.2 |
0.5 |
0.4 |
0.1 |
0.0 |
|
|
Prestations sociales en espèce |
1.0 |
2.1 |
2.4 |
2.1 |
1.4 |
|
|
Intêrets nets versés |
1.7 |
2.4 |
3.2 |
4.1 |
5.1 |
|
|
FBCF des APU |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
-0.1 |
|
|
Transferts courants nets |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
Sources : Calculs OFCE
C.2. VARIANTES DES FINANCES PUBLIQUES
Les deux variantes ci-dessous mesurent l'impact sur l'économie et les finances publiques d'une modification de la politique budgétaire menée par les pouvoirs publics.
Variante finance publique 1 : Politique budgétaire neutre à partir de 2007
Dans cette variante, les impulsions budgétaires (y compris charges d'intérêts) sont neutres à partir de 2007, ce qui revient à injecter 1,8 point de PIB de dépenses publiques supplémentaires par rapport au compte central. Le taux de prélèvement obligatoire est stable à partir de 2008 et les dépenses publiques évoluent au même rythme que la croissance potentielle. Le déficit structurel (y compris charges d'intérêts) des APU est donc constant sur la période 2007-2010. Le surplus de croissance engendré par la dépense publique supplémentaire et l'effet du multiplicateur keynésien de la dépense publique sur le PIB permettent un net redressement du déficit public : il passe en effet de 2,9 points de PIB en 2007 à 1,8 point de PIB en 2010 alors même que le solde structurel reste stable (tableau 25).
25. Hypothèse d'une politique budgétaire neutre à partir de 2007
|
En volume, en % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Croissance du PIB |
1.7 |
2.0 |
2.4 |
2.8 |
3.0 |
3.1 |
|
Dépenses des administrations publiques |
1.7 |
1.6 |
1.4 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
Variation du taux de PO (en pts de PIB) |
0.5 |
0.1 |
-0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Solde public (en points de PIB) |
-3.0 |
-2.9 |
-2.9 |
-2.6 |
-2.2 |
-1.8 |
|
Variation solde structurel (y compris charges d'intérêts) |
0.4 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Variation solde conjoncturel |
-0.2 |
0.0 |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
Source : calculs OFCE
Dans le compte emplois ressource associé à cette variante (tableau 26), on retient l'hypothèse selon laquelle le surplus de dépenses publiques se fait sous la forme de consommation publique dans les services. Les prélèvements obligatoires supplémentaires (0,3 points de PIB) prennent la forme d'une hausse de la TVA. Le surplus de croissance du PIB est de 2,5 % en 2010 par rapport au compte central. Il est tiré par la consommation supplémentaire des APU mais aussi par la consommation des ménages. Les ménages bénéficient en effet d'un supplément de revenu grâce aux créations d'emplois, à la hausse des salaires. La baisse du taux d'épargne, en grande partie attribuable à la réduction du taux de chômage, provoque une demande plus soutenue qui joue également positivement sur l'investissement des entreprises. Enfin, la croissance plus rapide de notre économie bénéficie également au reste du monde, le commerce extérieur venant amputer la croissance de 0,7 point de PIB à l'horizon 2010.
26. Compte variantiel emplois ressources issu
de
la variante finance publique 1
|
En % (par rapport au compte central) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
PIB |
0.1 |
0.8 |
1.6 |
2.5 |
|
Importations |
0.1 |
0.6 |
1.3 |
2.1 |
|
Consommation des ménages |
0.0 |
0.2 0. |
0.7 |
1.4 |
|
Consommation des APU |
0.4 |
2.5 |
5.0 |
7.5 |
|
FBCF productive |
0.2 |
1.2 |
2.1 |
2.7 |
|
FBCF logement |
-0.1 |
-0.5 |
-1.3 |
-1.7 |
|
Exportations |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
|
Variations de stocks (en contribution) |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Commerce extérieur (en contribution) |
0.0 |
-0.2 |
-0.4 |
-0.7 |
|
Taux de chômage |
0.0 |
-0.2 |
-0.6 |
-1.0 |
|
Taux d'épargne |
0.0 |
0.0 |
-0.2 |
-0.3 |
Sources : e-mod.fr, calculs OFCE.
Variante finances publiques 2 : Stabilisation du taux de prélèvement obligatoire à partir de 2008 avec une impulsion budgétaire identique à celle du scénario central
Le taux de prélèvement obligatoire, qui diminue dans le compte central respectivement de 0,2 et 0,1 point de PIB en 2008 et 2009, est stable sur la période 2008-2010 dans cette variante (tableau 27). En contrepartie, la dépense publique croît légèrement plus vite que dans le compte central (0,3 point de PIB). Or une augmentation des dépenses publiques, financée par une hausse des prélèvements obligatoires, a au total un effet positif sur le PIB (théorème de Haavelmo). Le surplus de croissance généré par l'augmentation du budget en 2008 et 2009 permet une réduction supplémentaire du déficit public de 0,1 point de PIB à l'horizon de notre prévision.
27. Stabilisation du taux de PO à partir de 2008 avec une impulsion budgétaire identique à celle du scénario central
|
En volume, en % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Croissance du PIB |
1.7 |
2.0 |
2.25 |
2.4 |
2.3 |
2.2 |
|
Dépenses des APU |
1.7 |
1.6 |
1.2 |
1.2 |
0.8 |
0.6 |
|
Variation du taux de PO (pts de PIB) |
0.5 |
0.1 |
-0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Solde public (en points de PIB) |
-3.0 |
-2.9 |
-2.8 |
-2.2 |
-1.6 |
-0.8 |
|
Variation solde structurel (y compris charges d'intérêt) |
0.4 |
0.3 |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0.7 |
|
Variation solde conjoncturel |
-0.2 |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
Source : calculs OFCE
Dans le compte emplois ressources associé à cette variante (tableau 28), on retient également l'hypothèse selon laquelle le surplus de dépenses publiques se fait sous la forme de consommation publique dans les services. Les prélèvements obligatoires supplémentaires prennent la forme d'une hausse de la TVA. Le surplus de croissance du PIB est de 0.2 % en 2010 par rapport au compte central, une hausse des dépenses publiques financée par une augmentation des prélèvements ayant globalement un effet positif sur la croissance.
28. Compte variantiel emplois ressources
issu de la
variante finance publique 2
|
En % (par rapport au compte central) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
PIB |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
|
Importations |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Consommation des ménages |
0.0 |
-0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
Consommation des APU |
0.0 |
0.7 |
1.1 |
1.1 |
|
FBCF productive |
0.0 |
0.2 |
0.1 |
-0.2 |
|
FBCF logement |
0.0 |
-0.3 |
-0.7 |
-0.7 |
|
Exportations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
|
Variations de stocks (en contribution) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Commerce extérieur (en contribution) |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Taux de chômage |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Taux d'épargne |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
Sources : e-mod.fr, calculs OFCE.
ANNEXE I : PROJECTION DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL EN FRANCE AU NIVEAU SECTORIEL À L'HORIZON 2015
L'objectif de ce rapport est d'expliciter la méthode retenue pour projeter la productivité du travail à l'horizon 2015 et d'exposer les résultats qui ont été retenus dans l'exercice de projection de l'économie française à l'horizon 2010.
Cette annexe comporte deux parties. Dans la première, nous présentons une estimation à long terme du taux de croissance de la productivité horaire du travail pour l'économie française (A). Ce travail s'appuie sur l'estimation d'équations économétriques donnant le taux de croissance trimestriel de la productivité horaire en fonction de séries de la comptabilité nationale d'un côté, et de l'autre de séries issues de l'enquête emploi. Dans la seconde partie, nous présentons les résultats de projections de la productivité horaire du travail à l'horizon 2015 pour l'économie française (B).
A. Une décomposition de la productivité horaire du travail au niveau sectoriel
I. Le modèle théorique
Nous partons d'une fonction de production standard ou Q représente la production, L le niveau de l'emploi et K le stock de capital.
1.1. Le modèle simple : la fonction Cobb-Douglas
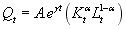 (1)
(1)
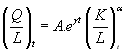 (2)
(2)
En notant IC, l'intensité capitalistique (K/L) et en log-linéarisant la relation (2), on obtient la formulation suivante :
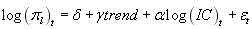 (3)
(3)
Dans cette formulation, comme c'est la cas le plus fréquent en économie appliquée, le progrès technique est supposé neutre au sens de Hicks, id est augmentant le produit à quantités de facteurs inchangées.
1.2. La fonction Cobb-Douglas avec durées d'utilisation
Il est possible d'enrichir la formulation simple en intégrant les degrés d'utilisation des facteurs de production, à savoir la durée du travail (hl) et la durée d'utilisation des équipements (DUE) de manière à prendre en compte non pas que les stocks des facteurs mais l'ensemble de leur service producteur.
La formulation (2) s'écrit alors :
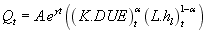
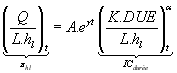 (4)
(4)
Puis, en log-linéarisant la relation (4), on obtient :
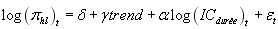 (5)
(5)
1.3. Le modèle complet
Enfin, le modèle complet enrichit l'équation (5) d'un certain nombre de variables, comme par exemple la part des non qualifiés, leur coût relatif ou encore les taux d'utilisation des capacités de production.
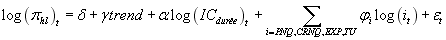
II. Les variables utilisées
Nous répertorions dans le tableau suivant l'ensemble des données utilisées lors de nos estimations. Nous avons également menés pour chacune d'entre elles des tests de stationnarité. A cet égard, il ressort que l'ensemble des séries utilisées au cours de cet exercice sont toutes intégrées d'ordre 1.
|
Variables |
Mnémonique |
Source |
Intégration |
|
Industrie |
|||
|
Productivité horaire du travail |
hl |
INSEE |
I(1) avec drift |
|
Intensité capitalistique |
IC |
INSEE |
I(1) avec Drift |
|
Intensité capitalistique horaire |
IC horaire |
INSEE |
I(1) avec cons |
|
Part des non qualifiés (profession) |
PNQ chardon |
Enquête emploi |
I(2) sans drift |
|
Part des non qualifiés (diplôme) |
PNQ diplome |
Enquête emploi |
I(1) avec cons |
|
Coût relatif des non qualifiés |
CRNQ |
Gafsi et alii (2004) |
I(1) avec drift |
|
Taux d'utilisation des capacités |
TU |
INSEE |
I(1) sans drift |
|
Durée d'utilisation des équipements |
DUE |
Banque de France |
I(1) avec cons |
|
Durée du travail |
Hl |
DARES |
I(1) sans drift |
|
Construction |
|||
|
Productivité horaire du travail |
hl |
INSEE |
I(1) sans drift |
|
Intensité capitalistique |
IC |
INSEE |
I(1) avec cons |
|
Intensité capitalistique durée du travail |
IC horaire |
INSEE |
I(1) avec drift |
|
Part des non qualifiés (profession) |
PNQ chardon |
Enquête emploi |
I(1) avec conc |
|
Part des non qualifiés (diplôme) |
PNQ diplome |
Enquête emploi |
I(1) sans drift |
|
Coût relatif des non qualifiés |
CRNQ |
Gafsi et alii (2004) |
I(1) sans drift |
|
Taux d'utilisation des capacités |
TU |
INSEE |
I(0) avec cons |
|
Durée du travail |
Hl |
DARES |
I(2) sans drift |
|
Services |
|||
|
Productivité horaire du travail |
hl |
INSEE |
I(1) avec drift |
|
Intensité capitalistique |
IC |
INSEE |
I(1) avec drift |
|
Part des non qualifiés (profession) |
PNQ chardon |
Enquête emploi |
I(1) sans drift |
|
Part des non qualifiés (diplôme) |
PNQ diplome |
Enquête emploi |
I(2) sans drift |
|
Coût relatif des non qualifiés |
CRNQ |
Gafsi et alii (2004) |
I(1) sans drift |
|
Taux d'utilisation des capacités |
TU |
INSEE |
I(0) avec cons |
|
Durée du travail |
Hl |
DARES |
I(1) avec drift |
III. Productivité horaire du travail
Le modèle à correction d'erreurs indique une relation de cointégration entre la productivité horaire dans l'industrie et l'intensité capitalistique horaire, de la part des non qualifiés, des variations des taux d'utilisation des capacités de production et du coût relatif des non qualifiés. Deux variables muettes sont nécessaires, certaines irrégularités, particulièrement fortes, demeurant non reproductibles par le modèle. Les variables ont toutes des coefficients significativement différents de zéro et de signe attendu.
III.1. Productivité horaire du travail pour l'industrie
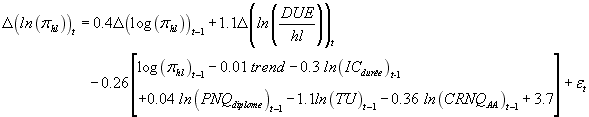
La statistique de student associé au coefficient devant le crochet s'élève à -4.43 87 ( * ) , validant l'hypothèse d'une relation de cointégration entre les variables figurant entre les crochets.
Diagnostic statistique
LM (1) = 0.138 LM (4) = 1.523 ARCH (4) = 0,258
[ p > 0,71] [ p > 0,21] [ p > 0,90]
WHITE = 1,735 RESET (4) = 1,116 BERA JARQUE (2) =1,559
[ p > 0,11] [ p > 0,36 ] [ p > 0,46 ]
 = 0,007
= 0,007
 = 0,009
= 0,009
Cette équation a des propriétés statistiques satisfaisantes. Les tests LM conduisent au rejet de l'hypothèse d'auto-corrélation des résidus de l'équation. Ces résidus sont homoscédastiques au regard du test de White et du test ARCH. La forme fonctionnelle de l'équation est validée par le test Reset. Enfin, selon le test de Bera Jarque, les résidus de l'équation suivent une loi normale.
Graphique A1 : Productivité horaire du travail dans l'industrie...
En log
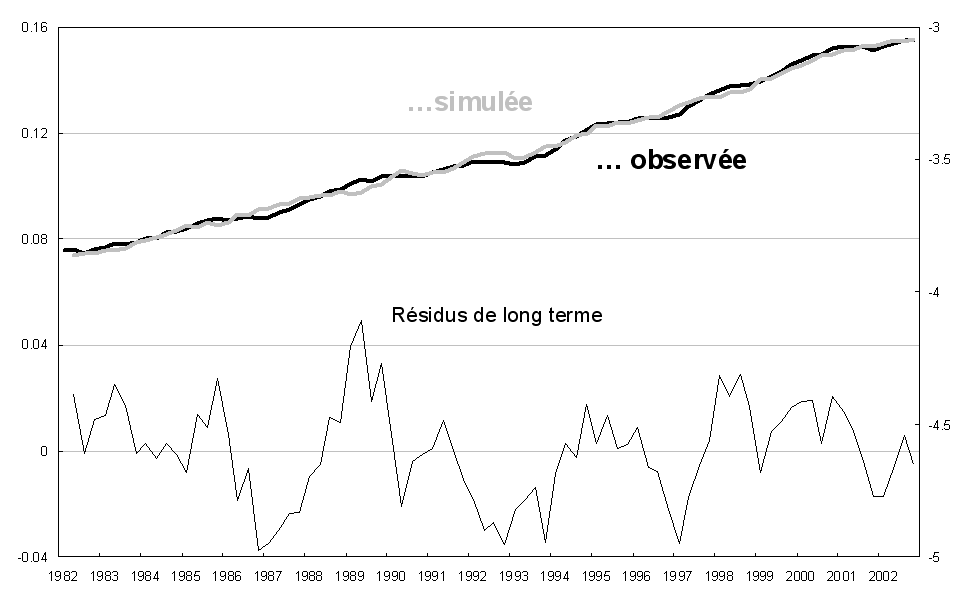
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Graphique A2 : Taux de croissance de la
productivité horaire
du travail dans l'industrie
En %
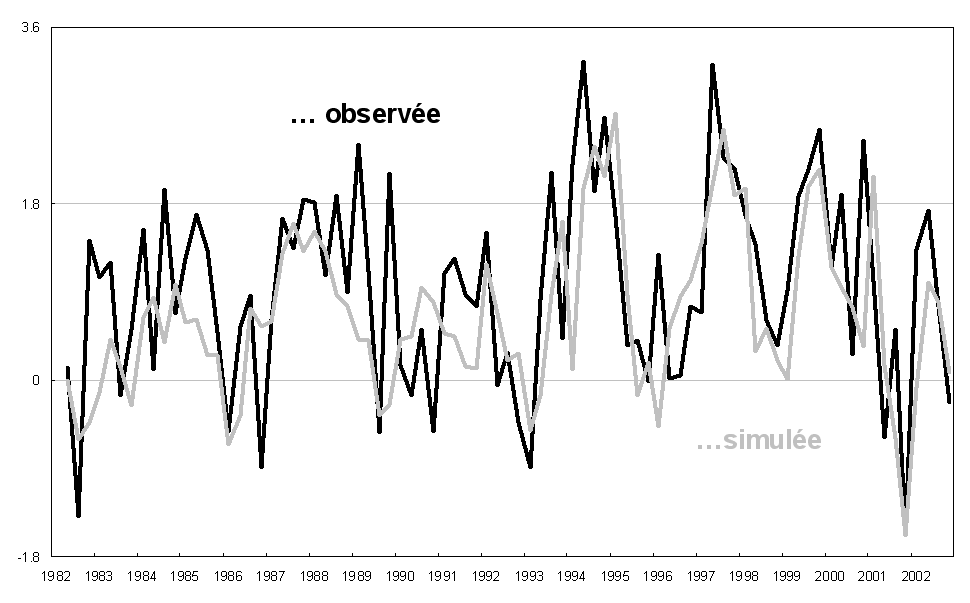
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
III.2. Productivité horaire du travail pour la construction
 (5.07)
(8.09) (-6.51) (12.49)
(5.07)
(8.09) (-6.51) (12.49)
Graphique A3 : Productivité horaire du travail dans la contruction...
En log
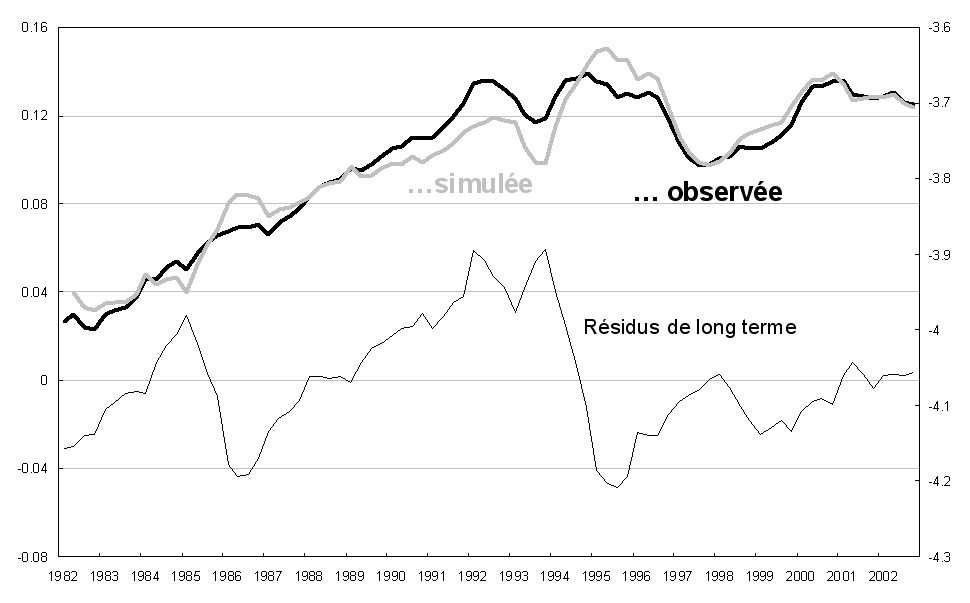
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
III.3. Productivité horaire du travail dans les services
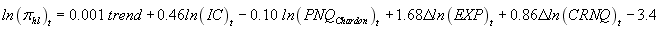 (10.79) (6.11)
(-2.43) (2.53)
(3.04)
(10.79) (6.11)
(-2.43) (2.53)
(3.04)
Graphique A4 : Productivité horaire du travail dans les services...
En log
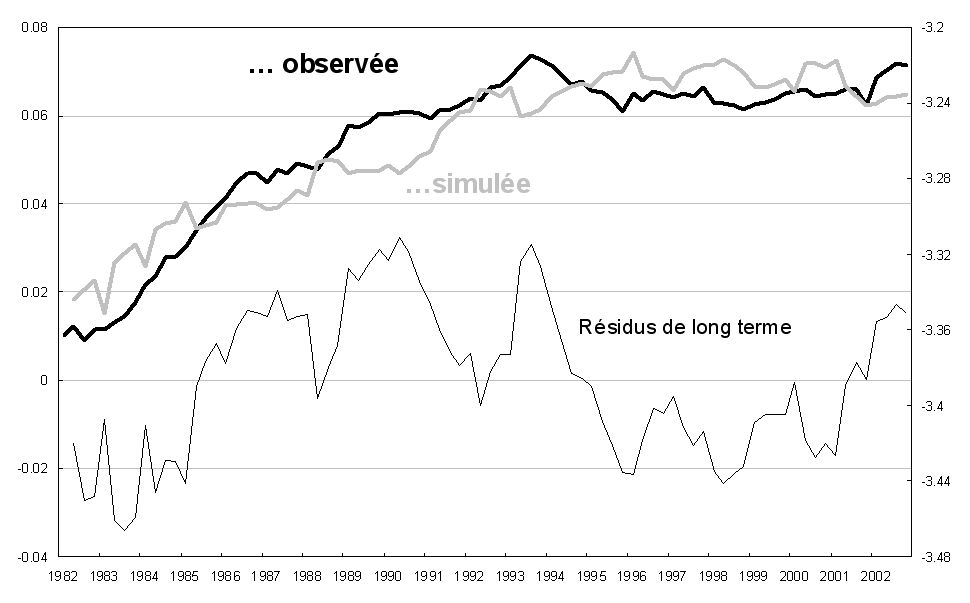
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
B. Résultats des projections sectorielles de la productivité horaire du travail
I. La méthode retenue
Pour les projections, nous avons procédé en deux temps : dans un premier temps, nous avons projeté sectoriellement la valeur ajoutée et le PIB. Puis, dans un second temps nous avons calé la productivité horaire du travail sur celle du compte central pour le court terme (2004 et 2005) pour les 3 secteurs. Nous en déduisons ensuite les projections de l'emploi à l'horizon 2015.
I.I. Projections sectorielles de la valeur ajoutée à l'horizon 2015
I.I.1 PARTAGE DE LA VAB ENTRE LA VA MARCHANDE ET LA VA NON MARCHANDE À PARTIR DU COMPTE CENTRAL
Graphique A5 : Partage de la VA marchande et non marchand e
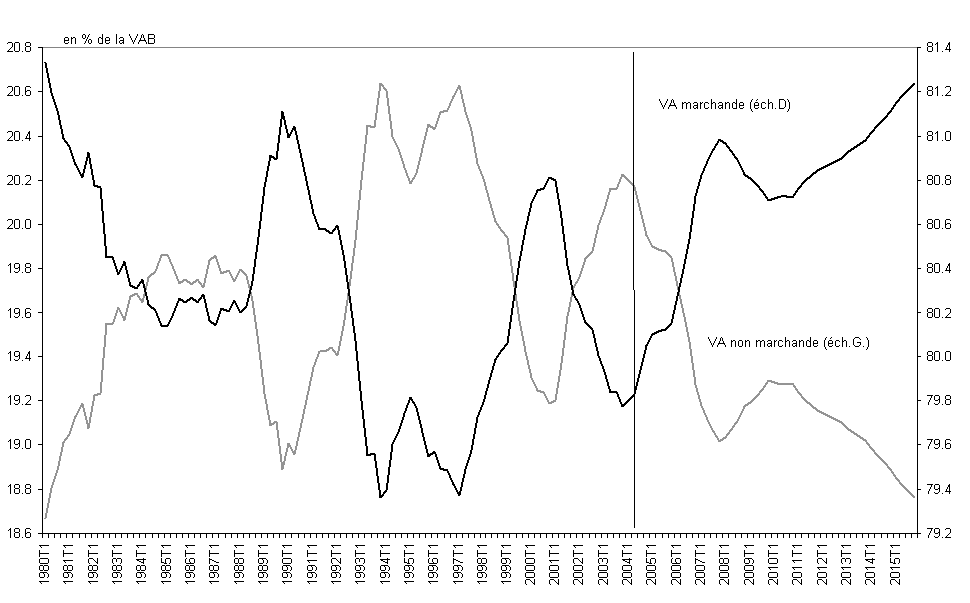
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
I.1.2. RÉPARTITION DE LA VA MARCHANDE NON CORRIGÉE DES INTÉRIMS ENTRE LES 4 GRANDS SECTEURS MARCHANDS
L'objectif est ici de déterminer les grandes tendances pour chacun des secteurs.
A la lecture des graphiques A6 et A7, nous constatons une rupture de tendance dans la plupart des secteurs depuis 1998.
Graphique A6 : Part de l'industrie et des services marchands
dans la VA marchande
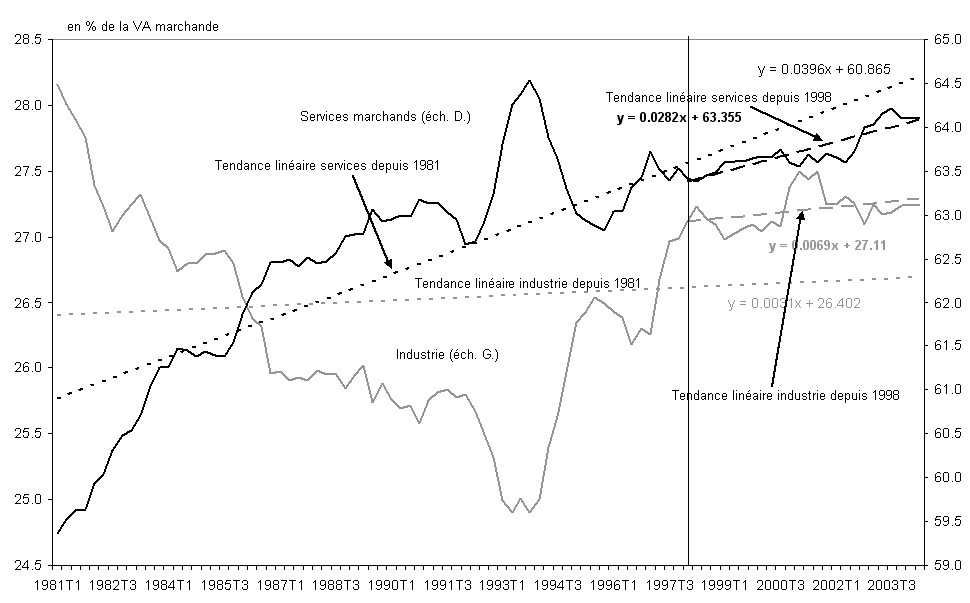
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Graphique A7 : Part de la construction et de
l'agriculture
dans la VA marchande
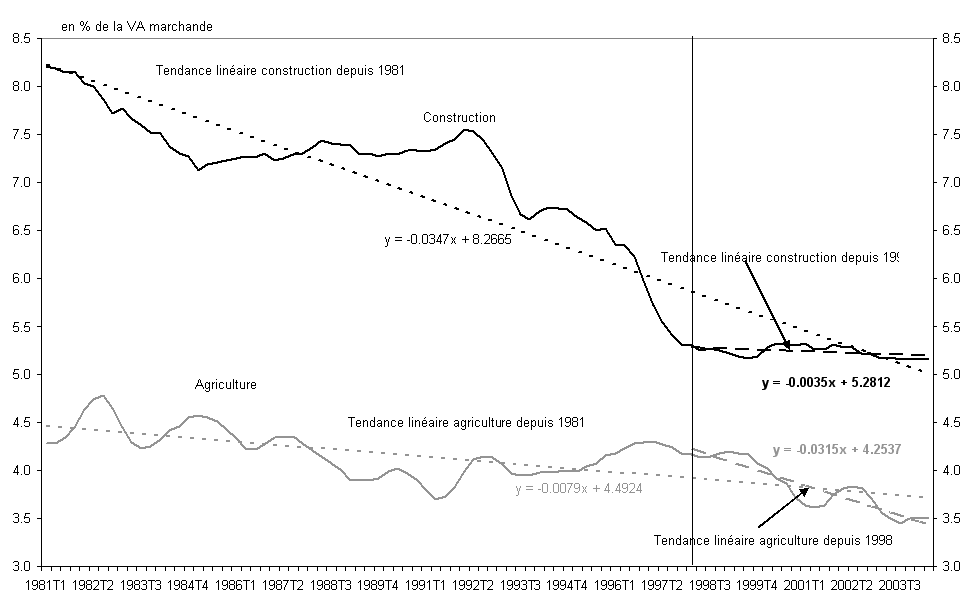
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Finalement, nous avons retenu les évolutions sectorielles suivantes :
- la part de l'industrie dans la VA marchande est maintenue constante en projection ;
- la part des services marchands dans la VA marchande évolue comme la tendance observée depuis 1998 ;
- la part de la construction dans la VA marchande évolue comme la tendance observée depuis 1998 ;
- la part de l'agriculture dans la VA marchande évolue comme le résidu du total.
I.1.3. RÉPARTITION SOUS SECTORIELLE DANS L'INDUSTRIE ET LES SERVICES MARCHANDS
On étudie les tendances pour 5 sous secteurs dans l'industrie et pour 1 sous-secteur dans les services. Les 5 sous-secteurs industriels sont mesurés en pourcentage de l'industrie et le secteur des transports en pourcentage des services.
Graphique A8 : Part de l'industrie agricole et
alimentaire et de l'industrie
des biens de consommation dans
l'industrie
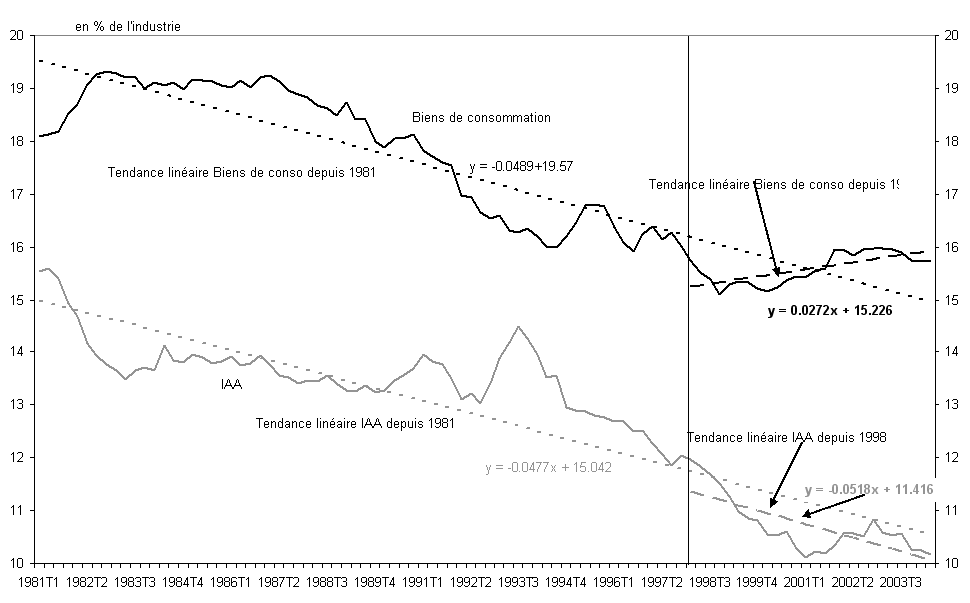
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Graphique A9 : Part de l'industrie des biens
de consommation
et de l'industrie automobile dans
l'industrie
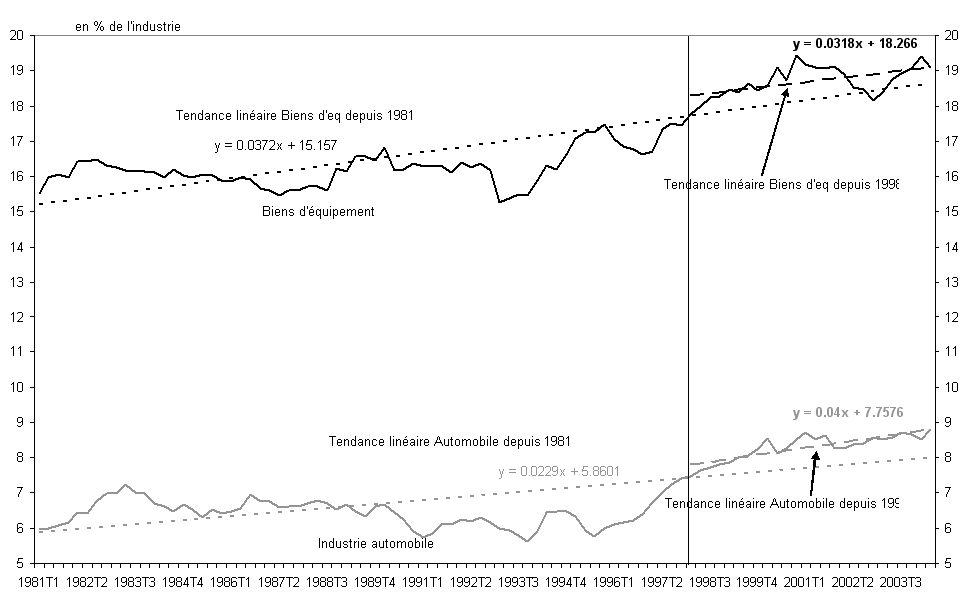
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Graphique A10 : Part de l'industrie des biens intermédiaires dans l'industrie et des transports dans les services marchands
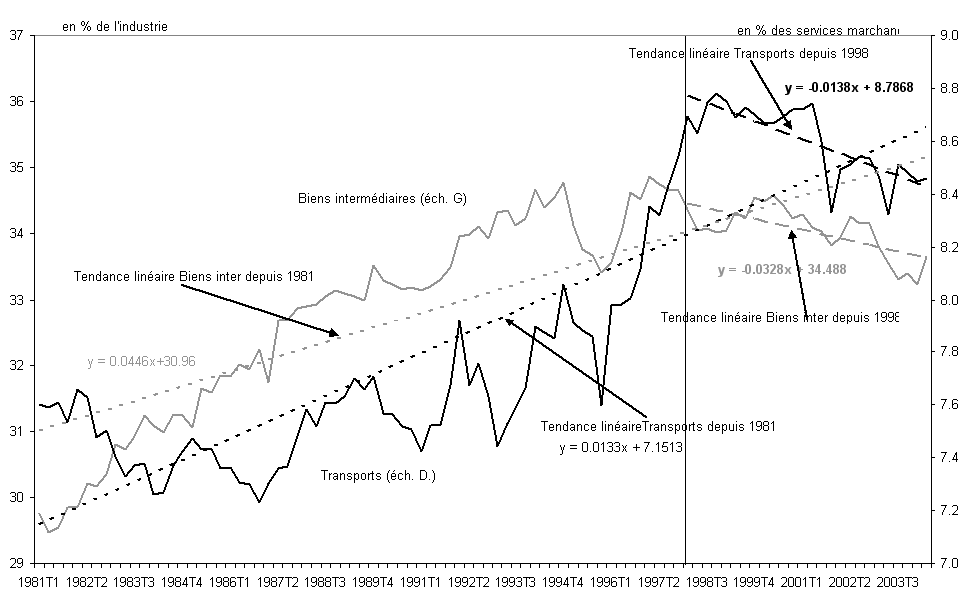
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Les tendances retenues en projection pour tous les sous-secteurs étudiés sont celles observées depuis 1998.
I.2 Les résultats des projections sectorielles à l'horizon 2015
I.2.1. PART DE CHAQUE SECTEUR DANS LE PIB
Graphique A11 : Part de l'industrie, des
services marchands
et non marchands dans le PIB
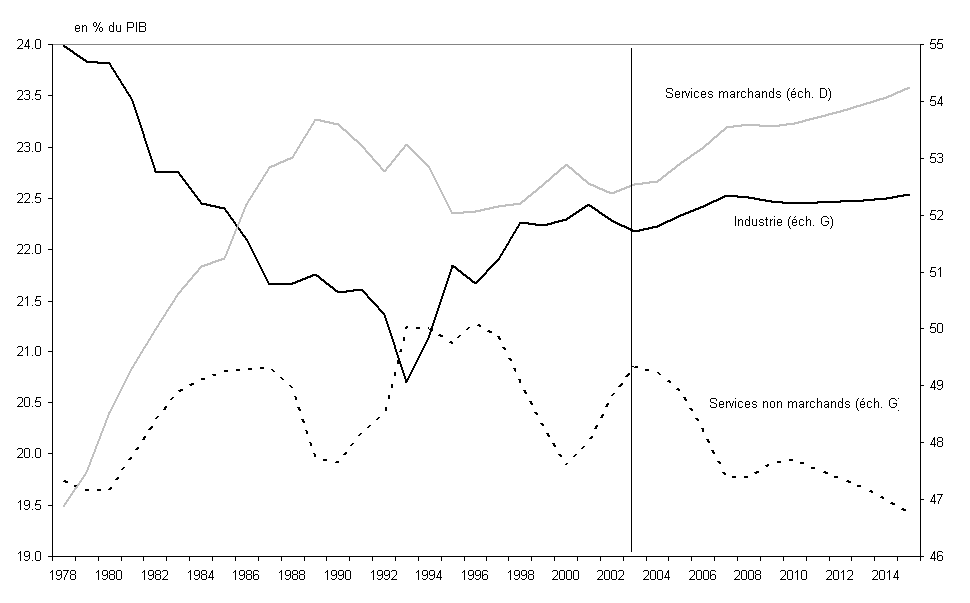
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
Graphique A12 : Part de la construction et de l'agriculture dans le PIB
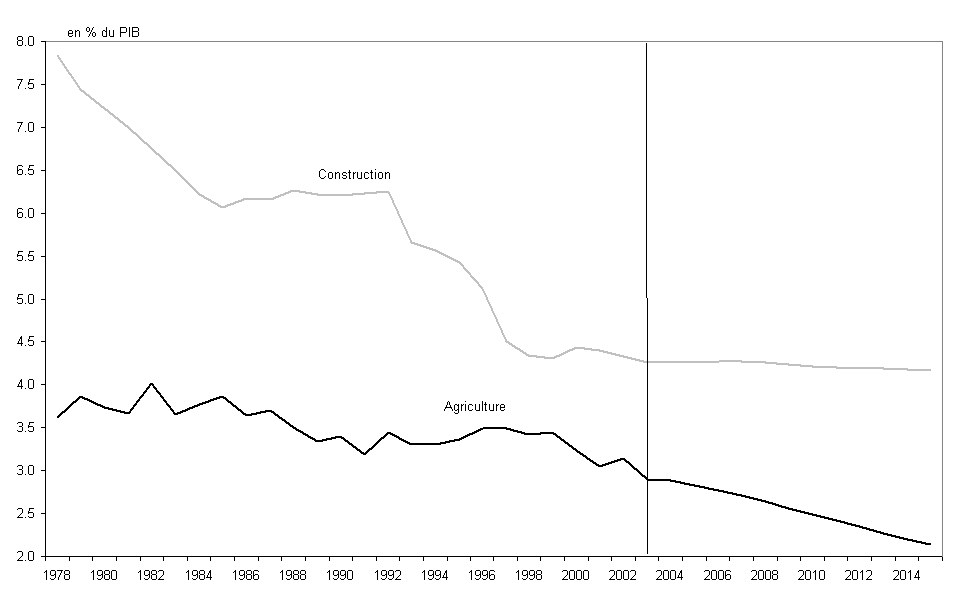
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
I.2.2. PART DE CHAQUE SOUS-SECTEUR DANS LE PIB
Graphique A13 : Part de chaque sous-secteur dans le PIB
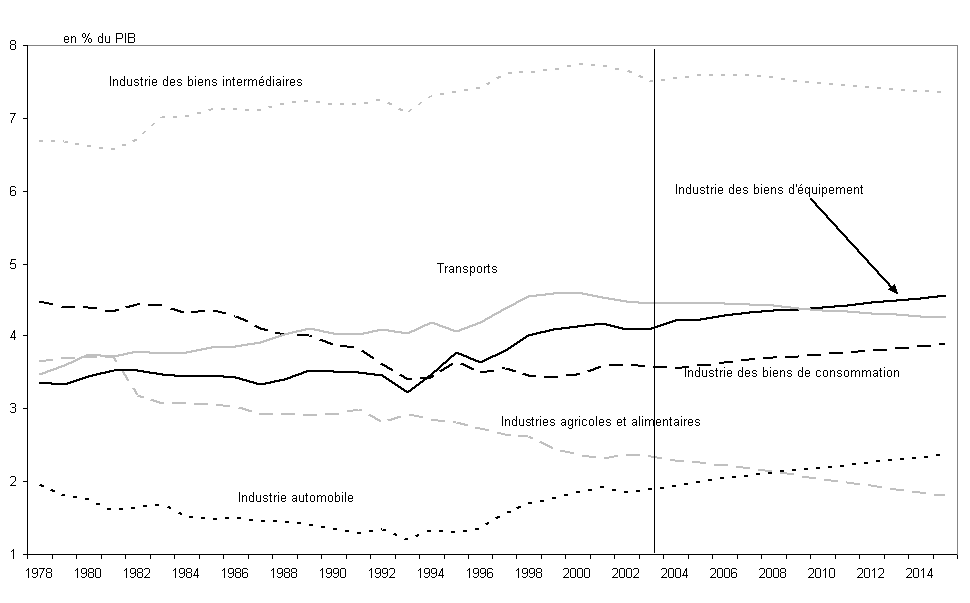
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
I.3. Les résultats des projections sectorielles de la productivité horaire du travail
Pour les projections, nous avons calé la productivité horaire du travail sur celle du compte central pour le court terme (2005 et 2006) pour les 3 secteurs. De 2007 à 2010, nous avons retenu la relation de long terme de notre MCE.
Graphique A14 : Productivité horaire dans l'indus trie
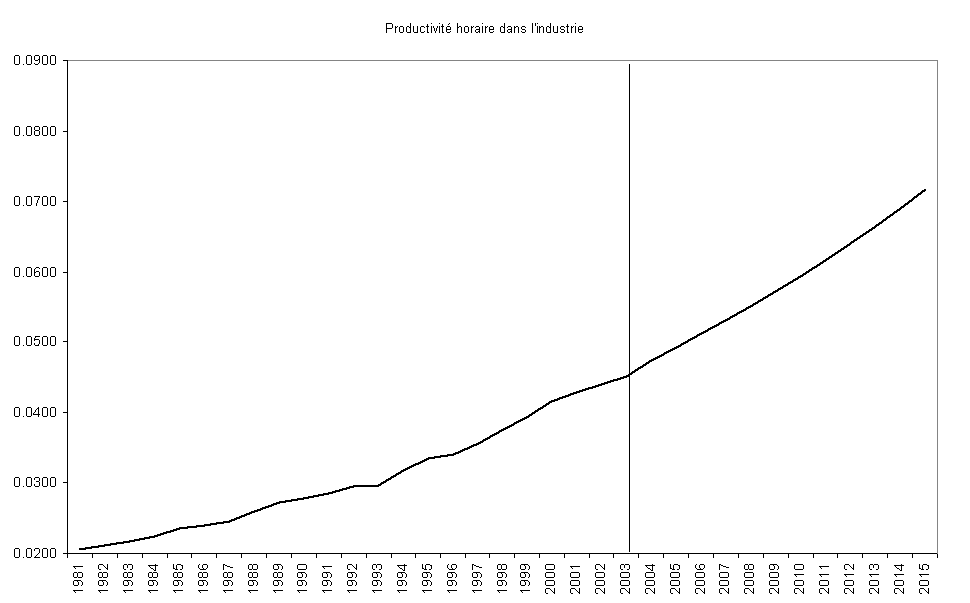
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
La productivité horaire du travail tendancielle dans l'industrie croît au rythme de 3,8% par an
Graphique A15 : Productivité horaire dans la construction
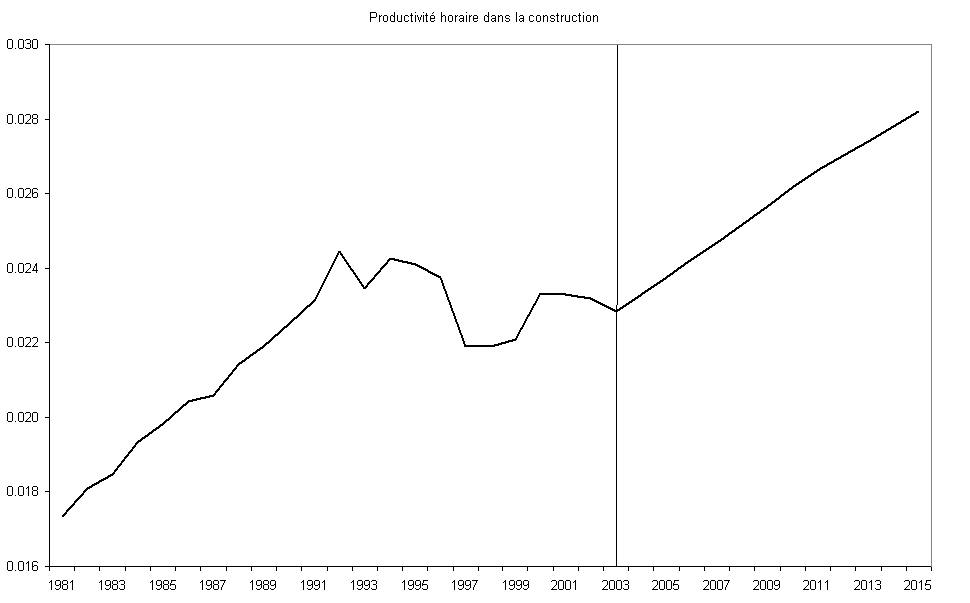
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
La productivité horaire du travail tendancielle dans la construction croît au rythme de 1,5% par an. De 2006 à 2015, le taux de croissance annuel moyen est de 1,7%.
Graphique A16 : Productivité horaire dans les services marchands
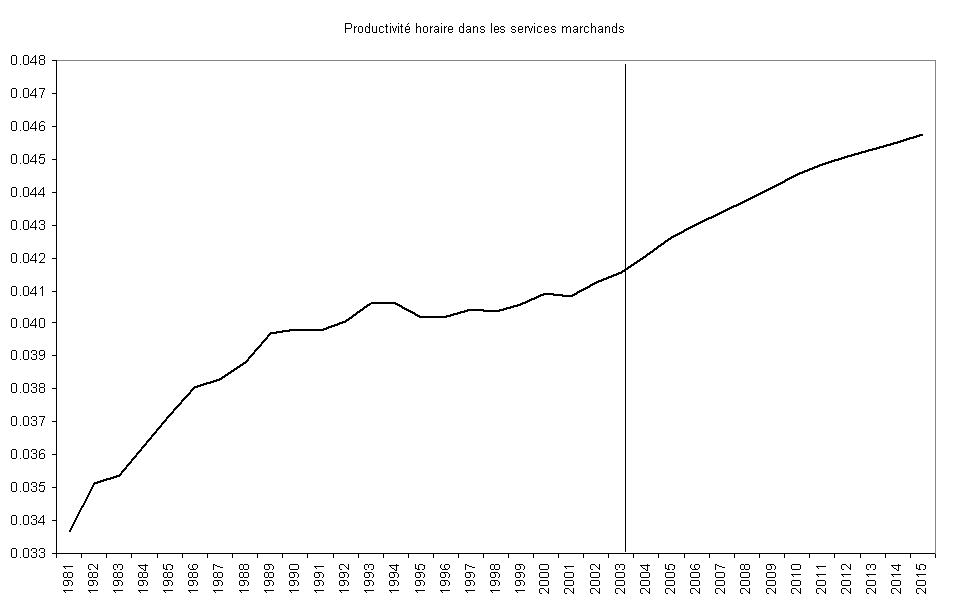
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
La productivité horaire du travail tendancielle dans les services marchands croît au rythme de 0,5% par an. De 2006 à 2015, le taux de croissance annuel moyen est de 0,7%.
Les productivités horaires du travail des 5 sous-secteurs de l'industrie (industries agricoles et alimentaires, industries des biens de consommation, industrie automobile, industries des biens d'équipement et industries des biens intermédiaires) sont calées en projection sur le taux de croissance de la productivité horaire du travail de l'industrie. De même, la productivité horaire du travail dans les transports est calée en projection sur le taux de croissance de la productivité horaire du travail des services principalement marchands.
Graphique A17 : Productivité horaire dans les sous-secteurs
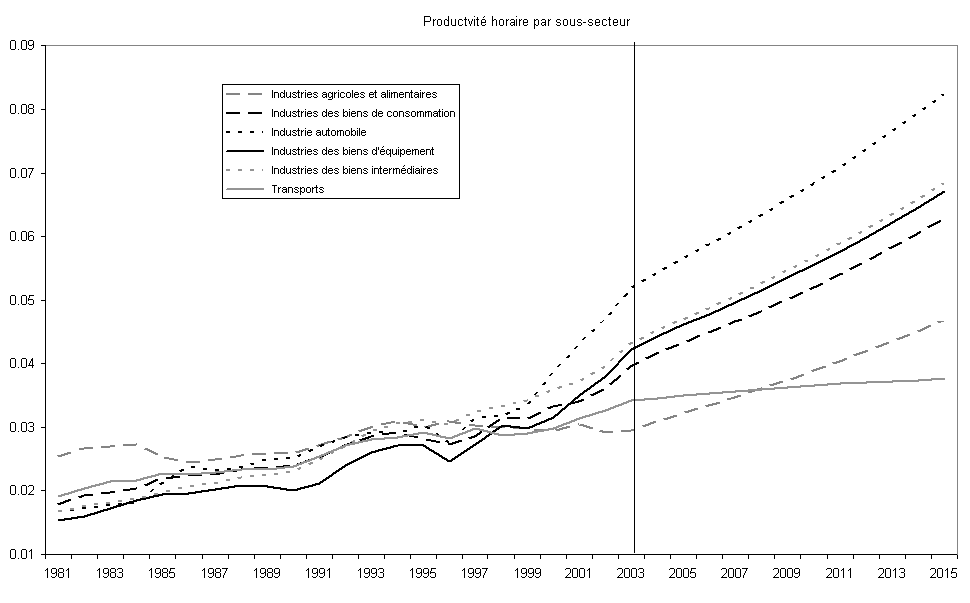
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs OFCE
ANNEXE II : TABLEAUX FINANCES PUBLIQUES
II.1. Principaux agrégats de finances
publiques pour la projection
à moyen terme 2005-2010 dans le
scénario de croissance à 2,25%
|
En points de PIB |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
?????? ?????? |
|
Capacité de financement |
-3,0 |
-2,9 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,7 |
-0,9 |
-2,1* |
|
Dette publique |
65,8 |
66,0 |
66,2 |
65,9 |
65,0 |
63,2 |
-2,6 |
|
Dépenses publiques |
53,8 |
53,6 |
53,1 |
52,3 |
51,5 |
50,7 |
-3,1 |
|
Progression en volume |
1,7% |
1,6% |
1,2% |
0,8% |
0,6% |
0,6% |
|
|
Prélèvements obligatoires |
43,9 |
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
-0.5 |
* la variation de la capacité de financement des APU est de 2,6 points de PIB hors soulte.
II.2.Evolution du pouvoir d'achat des prestations sociales
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
1985-1995 |
1996-2004 |
2005-2010 |
|
|
Répartition |
||||||||||
|
Retraites |
45 |
3.6 |
1.9 |
2.4 |
2.4 |
2.6 |
2.8 |
0.1 |
2.5 |
2.6 |
|
Maladie |
33 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.3 |
2.7 |
1.2 |
|
Chômage |
7 |
-0.6 |
-2.1 |
-3.1 |
-3.2 |
-4.3 |
-5.3 |
-1.2 |
2.4 |
-3.1 |
|
Famille, logement, pauvreté et exclusion |
15 |
1.6 |
1.4 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.1 |
1.6 |
0.9 |
|
Total des prestations |
100 |
2.4 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
-0.5 |
2.4 |
1.4 |
II.3.Evolution des dépenses des administrations publiques
|
En points de PIB |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
85- 95 |
95 -05 |
05- 10 |
|
Ensemble des dépenses dont : |
53.8 |
53.6 |
53.1 |
52.3 |
51.5 |
50.7 |
51.6 |
53.4 |
52.5 |
|
Rémunérations des salariés |
13.5 |
13.4 |
13.2 |
13.0 |
12.7 |
12.4 |
13.0 |
13.5 |
13.0 |
|
Consommations intermédiaires |
5.4 |
5.3 |
5.2 |
5.0 |
4.9 |
4.8 |
4.8 |
5.3 |
5.1 |
|
Intérêts |
2.6 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
2.9 |
3.0 |
2.5 |
|
Prestations sociales en espèce |
17.9 |
17.8 |
17.6 |
17.4 |
17.2 |
16.9 |
17.1 |
117.7 |
17.5 |
|
Transferts |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.8 |
5.7 |
4.9 |
5.5 |
5.8 |
|
Subventions |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.7 |
4.6 |
4.5 |
4.9 |
4.8 |
4.7 |
|
FBCF |
3.3 |
3.4 |
3.4 |
3.3 |
3.2 |
3.2 |
3.4 |
3.1 |
3.3 |
* 1 On relèvera que le Sénat a historiquement contribué financièrement au développement des modèles utilisés par les services de l'exécutif en contrepartie d'un droit d'accès à ces outils.
* 2 A l'inverse de la plupart des instituts indépendants de prévision.
* 3 Le MINEFI présente une fourchette de prévisions pour la croissance du PIB (de 1,5 % à 2 % par exemple en 2005). Toutefois, pour la commodité de la lecture, et parce que les comptes de la Nation sont associés à un chiffre, on se réfèrera au milieu de la fourchette.
* 4 En revanche, l'évolution des salaires dans le secteur abrité constitue une limite évidente à toute politique alternative à celle d'un maintien dans la zone euro.
* 5 Le conseil des experts en économie a été créé en 1963. C'est une instance indépendante de conseil dans le domaine économique : il a pour double mission d'analyser le développement économique de l'Allemagne et de faciliter la prise de décision de tout organisme responsable en matière de politique économique. Chaque année, il remet à la mi novembre un rapport sur la situation économique de l'Allemagne et son évolution. Il est composé de cinq membres nommés par le président de la République sur proposition du chancelier.
* 6 Elle avait perdu son rang de premier exportateur mondial depuis 1992.
* 7 La compétitivité prix est calculée à partir des cours de change effectifs corrigés par l'indicateur des prix associé aux ventes totales (Preisdeflator des Gesamtabsatzes) par groupe de pays (pays de l'Union monétaire, autres pays que ceux de l'Union monétaire et ensemble des pays).
* 8 L'impact des importations de biens ensuite réexportés ou de biens semi-finis utilisés pour la fabrication du produit final est donc pris en compte dans ce calcul.
* 9 Une augmentation de 100 en volume ne représente plus que 62,2 en valeur ajoutée nationale (contre 74,3 en 1991) mais il suffit d'exporter 120 en volume pour avoir une valeur ajoutée nationale supérieure à 74,3.
* 10 Il s'agit de la Biélorussie, de la Bosnie Herzégovine, de la Bulgarie, de la république populaire de Chine, des pays baltes, du Kazakhstan, de la Croatie, de la Macédoine, de la Pologne, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Slovaquie, de la république tchèque, de l'Ukraine, de la Hongrie et de l'Ousbékistan.
* 11 Marin.D (2004) : « A nation of poets and thinkers - less so with eastern enlargement ? Austria and Germany », Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 4358
* 12 Le critère utilisé pour définir si les investissements sont verticaux est le fait que l'Allemagne exporte dans ces pays des biens de consommation intermédiaire et puis les importe après traitement. Si l'on fixe un critère plus strict, à savoir un taux d'importation de minimum 20 % des biens travaillés dans les pays de l'Est, seulement 10 % des investissements en république tchèque, 7 % des investissements en Russie et 2 % des investissements en Ukraine peuvent être considérés comme des investissements horizontaux. Globalement, 32 % des investissements allemands peuvent alors être considérés comme des investissements horizontaux.
* 13 Les pays concernés ne se limitent pas aux PECO.
* 14 Avec toutefois des années où cet objectif n'est pas atteint, comme en 2004.
* 15 Il existe toutefois de nombreuses incertitudes sur ce point, compte tenu de la situation politique allemande et des incertitudes qui entament la crédibilité de la politique entreprise.
* 16 On entend par acquis de croissance pour une année donnée ce que serait la croissance moyenne si le PIB se stabilisait au niveau atteint en fin d'année précédente.
* 17 Une prévision de croissance s'exprime en moyenne, car cette approche est plus représentative dans la mesure où elle lisse les évolutions infra-annuelles.
Une croissance en moyenne compare le niveau moyen du PIB au cours de l'année n+1 au niveau moyen du PIB au cours de l'année n.
* 18 Une croissance en glissement indique l'évolution du PIB entre le 1 er janvier et le 31 décembre d'une année.
* 19 En 2004, pour une croissance du PIB de 2,3 %, la progression de l'emploi salarié non marchand a été nulle (alors que pour une croissance du PIB de 2,25 % en 2006, l'emploi augmenterait de 1,1 %). L'évolution comparée du PIB et de l'emploi en 2004, traduit une hausse de la productivité. Celle-ci est vraisemblablement transitoire, et habituelle dans une période de reprise (« cycle de productivité »). Ce point est détaillé dans la note de synthèse du Service des Études économiques et de la Prospective d'avril 2004).
* 20 Alors que les instituts indépendants se basent généralement sur une élasticité unitaire (une augmentation de 1 % du PIB entraîne une augmentation de 1 % des recettes). En 2005, l'élasticité réelle serait, selon le MINEFI, comprise entre 1,1 et 1,2.
* 21 Dans l'hypothèse où la croissance atteindrait 3 %, le gouvernement prévoit une hausse des dépenses publiques plus modérée encore, de 0,6 % par an en volume.
* 22 Si le taux d'épargne des ménages devait rester stable par rapport au compte central, la croissance atteindrait 2,9 % l'an contre 3 %.
* 23 Alors que dans le compte central, la contribution du commerce extérieur est supposée nulle par convention.
* 24 Cet objectif, qui est justifié par une série de considérations exposées dans le chapitre consacré aux finances publiques, ne signifie pas pour autant que le solde structurel des finances publiques doive retrouver l'équilibre.
* 25 Ces conditions sont difficiles à réunir. Mais, un supplément de croissance est de nature à en favoriser sa survenance.
* 26 L'an dernier, le prix du pétrole retenu en projection s'élevait à 37 dollars par baril et le cours euro-dollar à 1,25 dollar par euro contre 60 dollars et 1,20 dollar par euro cette année.
* 27 Face à une variation de l'activité, dans un sens ou dans l'autre, les entreprises n'ajustent pas immédiatement leurs effectifs proportionnellement.
* 28 Voir le III du présent chapitre pour ses développements sur l'impact de la politique monétaire sur la consommation des ménages.
* 29 - 2,4 points en cumulé dans le « scénario central » entre 2006 et 2010, soit un taux d'épargne à 12,3 % du revenu disponible des ménages contre 15,7 % en moyenne entre 1995-2005.
* 30 Le taux d'investissement des entreprises rapporte leur investissement à leur valeur ajoutée.
* 31 A plus long terme, à supposer qu'il existe un lien entre progrès de productivité et accumulation de l'investissement, un effet de compétitivité positif est susceptible de s'enclencher ce qui est favorable à une contribution positive du commerce extérieur.
* 32 Les coûts salariaux unitaires allemands ont diminué depuis 2003, en niveau absolu comme par rapport à ses partenaires européens, dont la France.
* 33 Cette hypothèse suppose une nette amélioration du solde extérieur par rapport à la période la plus récente puisqu'en 2004 et 2005 la contribution à la croissance a été négative, de 1,1 et 1 point de PIB respectivement.
* 34 L'écart entre la progression de la demande mondiale et celle des exportations (7 % contre 6,5 %) traduit la perte tendancielle de parts de marché consécutive à l'émergence de nouveaux concurrents et l'ouverture des échanges.
* 35 Les années 1985-1986 furent en effet marquées par la fin de l'encadrement du crédit, et par la réforme des marchés financiers. Les banques ont cessé d'être limitées dans le montant des crédits qu'elles pouvaient prêter aux ménages. Dans le même temps, les entreprises ont développé leur recours aux marchés financiers afin de lever des capitaux directement par émission d'actions ou d'obligations, de sorte que les banques ont disposé de capitaux inemployés qu'elles ont proposés aux ménages.
* 36 Pour expliquer le caractère simplement temporaire de l'effet favorable de la dynamique du crédit sur la demande des ménages, l'étude ne se contente pas de suggérer l'implacabilité des variables lourdes de la consommation (et donc de confirmer les approches traditionnelles) mais affirme encore que : « la libéralisation financière aurait entraîné un accroissement temporaire de l'endettement des ménages et de leur consommation, le temps que les banques s'adaptent aux nouvelles conditions des marchés . » Cette dernière formule, pour le moins allusive, paraît signifier que le développement des crédits aux particuliers, intervenu après la libéralisation financière du milieu des années 80, serait à mettre au compte d'une période d'apprentissage des banques, elle-même transitoire ou, du moins, non reproductible.
* 37 La réaction de la politique monétaire a été plus tardive et moins prononcée en zone euro que dans le reste de l'OCDE.
* 38 Les passages mis en gras sont soulignés par l'auteur.
* 39 « Le marché immobilier français en situation de retournement : analyse et conséquences », de M. Philippe Marini, Rapporteur général (n° 6 - 5 octobre 2005).
* 40 Les « taux de financement » des ménages agrègent leur taux d'épargne et leur taux d'appel au crédit.
* 41 De ce point de vue, le rapport économique, social et financier inclut un développement exemplaire dans sa partie, au demeurant intéressante, consacrée aux écarts de dynamisme économique entre les États-Unis, la zone euro et la France.
Ces écarts sont présentés comme imputables à un certain nombre de variables, de productivité et de taux d'activité principalement.
CONTRIBUTIONS À L'ÉCART DE RICHESSE PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS
|
Différentiel
|
Écart de productivité horaire |
Contribution à l'écart entre productivité et PIB par habitant |
Écart de PIB par habitant |
|||
|
Heures travaillées |
Chômage |
Participation |
Population 15-64 ans |
|||
|
Zone euro |
- 3 % |
- 17 % |
- 3 % |
- 7 % |
1 % |
- 28 % |
|
France |
11 % |
- 22 % |
- 4 % |
- 6 % |
- 2 % |
- 25 % |
Source : Rapport économique, social et financier PLF 2006.
Il s'agit de résultats statistiques , qui d'ailleurs sont présentés comme tels, précieux bien que contestables. Il est donc regrettable que les commentaires qui les accompagnent prétendent leur attribuer une portée explicative des écarts de performances de croissance entre les zones étudiées. Une telle présentation manque de rigueur : un simple décompte statistique de variables ne peut avoir une portée explicative sans interprétation. Il est ainsi dangereux d'insinuer qu'il suffirait, par des politiques avisées, de modifier les valeurs prises par ces variables pour combler le déficit de dynamisme économique de part et d'autre de l'Atlantique. En réalité, les variables dont il s'agit, plutôt que d'être explicatives pourraient bien n'être que les conséquences d'une croissance trop faible.
* 42 Toutefois, de façon générale, on estime que les politiques structurelles sont relativement inefficaces dans ce cas et que la politique conjoncturelle est un outil plus adapté.
* 43 L'intervention de la politique conjoncturelle est alors une sorte de « mal nécessaire » puisqu'elle revient à se résigner à une croissance moins rapide que ce qu'elle pourrait être.
* 44 En bref, les perspectives de diminution naturelle de la population active seraient plus que compensées par une hausse du taux d'activité.
* 45 Choc auquel le retard d'investissement et dans l'effort de recherche-développement et d'innovation confère une dimension seulement éventuelle.
* 46 La productivité apparente du travail rapporte une mesure en volume de la valeur ajoutée brute (on ne déduit pas la consommation de capital fixe) à une estimation du facteur de production « travail ». Quand le facteur travail est exprimé par le nombre de personnes impliquées dans la production, on mesure la productivité par tête . Quand on ramène la valeur ajoutée au volume d'heures travaillées, on calcule la productivité horaire ; c'est l'indicateur généralement retenue par les comptes nationaux.
* 47 Il serait plus rigoureux d'écrire : salaires évoluant comme la productivité.
* 48 Comme on évoque aujourd'hui une « préférence française pour le loisir » et comme si les évolutions macroéconomiques relevaient d'un libre-arbitre des salariés...
* 49 2004 est une année de reprise : l'adaptation des effectifs à cette reprise s'effectue avec un décalage, ce qui entraîne une accélération transitoire de la productivité (« cycle de productivité »).
* 50 La croissance du PIB devrait être de 2,5 %, celle de la productivité de 2,3 %, donc celle de l'emploi de 0,2 % seulement.
* 51 Le dossier présenté par l'INSEE dans le Rapport sur les comptes de la Nation de 2003 propose sur ce thème une analyse claire et complète, dont les principales conclusions sont reprises ici.
* 52 On évoque ici la productivité par équivalent temps plein, ce qui signifie qu'on ne tient pas compte ici de l'impact du développement du temps partiel sur le ralentissement de la productivité par tête.
* 53 Soit 60.000 personnes supplémentaires environ sur le marché du travail entre 2006 et 2010 contre 140.000 personnes supplémentaires environ sur 1996-2005.
* 54 Ou NAIRU pour « Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment »
* 55 C'est-à-dire que la progression du salaire moyen par tête sera, au mieux, égale à celle de la productivité par tête : dans ce cas, le taux de marge des entreprises est, au minimum, stable.
* 56 Il suppose pourtant une croissance spontanée de 2,7 % l'an environ, soit nettement plus que la croissance potentielle évoquée dans le rapport économique, social et financier (qui est de 2 %).
* 57 En l'absence de réduction des prélèvements obligatoires, hors bouclage macroéconomique, le besoin de financement s'établirait à 0,8 point de PIB en 2009 dans le « scénario bas » et ferait place à une capacité de financement de 0,4 point de PIB dans un contexte de croissance à 3 % l'an.
* 58 Cela signifie qu'une hausse nominale de 1 % de l'activité se traduit par une hausse de 1 % des recettes publiques.
* 59 L'an dernier, le scénario de croissance du gouvernement retenait un rythme plus rapide de 2,5 % l'an contre 2,25 % cette année. Mais, la croissance potentielle était alors estimée à 2,25 % contre seulement 2 % dans le programme à horizon 2009. On rappelle que l'évaluation de l'ajustement des comptes publics entre variation structurelle et variation conjoncturelle est fondée en comparant la croissance effective telle que prévue et la croissance potentielle. Il n'y a pas de différence de ce point de vue entre la programmation 2009 et la programmation 2008. Dans l'un et l'autre cas, la croissance effective est supérieure de 0,25 point par an à la croissance potentielle. Ainsi, la composante conjoncturelle de l'évolution du solde public devrait, en bonne logique, être identique dans les deux scénarios.
Or tel n'est pas le cas puisque, cette année, l'amélioration de la composante conjoncturelle n'est que de 0,4 point de PIB contre 0,5 point dans la programmation précédente.
Cet écart vient sans doute de problèmes d'arrondis mais, il est également envisageable qu'ils portent sur le calcul de la composante structurelle de la programmation des finances publiques que sur celui de sa composante conjoncturelle. Dans cette hypothèse celle qui est prévue à l'horizon 2009 serait proche de celle programmée l'an dernier.
* 60 Ainsi que le montre le théorème de Haavelmo qui met en évidence une sensibilité de la croissance par rapport aux dépenses plus forte que par rapport aux prélèvements.
* 61 Le chiffre précis est celui d'une croissance potentielle à 2,75 % l'an en moyenne.
* 62 La projection diffère légèrement de celle du Gouvernement à partir de 2007. En 2006, le Gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances 2,7 milliards d'euros de recettes non fiscales, qualifiées d'exceptionnelles. La projection ne retient pas l'hypothèse que cet « exceptionnel » puisse durer. L'écart, de 0,3 point de PIB, entre l'ajustement du solde public en projection et dans le programme de stabilité s'explique par ce parti pris. Dans les projections exposées dans le présent rapport, ce « manque à gagner » dégrade le solde public de 0,3 point de PIB, ce qui facilite le retour à une trajectoire de croissance à 2,25 % l'an, par rapport à une situation où il serait compensé par un supplément de prélèvements obligatoires ou une baisse plus accusée du poids des dépenses publiques. La programmation financière à moyen terme du Gouvernement, où la croissance atteint 2,25 %, comporte donc des exigences sous-jacentes, plus fortes. Pour le dire autrement, la demande des agents privés doit apporter une contribution plus élevée, de 0,3 point de PIB sur la période, que dans les projections de la Délégation.
* 63 Dans le rapport économique, social et financier joint au PLF 2006, à l'hypothèse d'une croissance plus rapide est associée une réduction plus forte des dépenses publiques passant par une décélération des dépenses encore plus importante que dans le scénario bas. La variante présentée ici ne peut donc pas être considérée comme reflétant les choix de politique budgétaire envisagés dans le RESF, qui méritent discussion.
* 64 Une partie importante de cet écart est attribuable aux transferts de charges supportées par les Collectivités locales ainsi qu'au dynamisme, non anticipé par l'État, de prestations nouvelles, dont elles supportent le financement. Il est également le résultat d'une progression des dépenses de santé qui est structurellement supérieure à celle du PIB, et, généralement, plus dynamique que celle retenue par des lois de financement de la sécurité sociale.
* 65 Soit le solde public nominal hors charges d'intérêt.
* 66 Soit les dépenses publiques hors charges d'intérêt.
* 67 « Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'État », rapport d'information n° 392 du 30 juin 2004, MM. Joël Bourdin, Pierre André et Jean-Pierre Plancade.
* 68 Le solde des ressources et des emplois des administrations publiques dégage une capacité de financement lorsque les premières sont supérieures aux seconds. Dans la réalité historique récente, c'est la situation inverse qu'on a observée le plus souvent. Les administrations publiques ont connu un besoin de financement. On évoquera donc ici les mouvements du besoin de financement des administrations publiques pour rendre compte de l'orientation de la politique budgétaire. En termes d'impulsion conjoncturelle, une réduction du besoin de financement est équivalente à une augmentation de la capacité de financement, et vice versa.
* 69 Les dépenses le plus souvent mentionnées étant les dépenses d'indemnisation du chômage sans qu'on puisse réduire à ces seules dépenses le champ de l'analyse.
* 70 Autrement dit, si le besoin de financement conjoncturel est plus important que le besoin de financement observé, il y a un excédent standard qui compense partiellement l'impact de l'écart à la production.
* 71 « Rapport sur les Perspectives économiques à l'horizon 2007 et le pacte de stabilité et de croissance ». Rapport d'information n° 66, du 20 novembre 2002, M. Joël Bourdin.
* 72 Cette remarque de bon sens est toutefois assez systématiquement perdue de vue.
* 73 Ce concept est le plus proche du concept européen de dette publique.
* 74 Les deux dispositifs successifs d'évaluation étaient ouverts à d'autres acteurs que les ministères et pouvaient s'intéresser à des politiques autres qu'interministérielles, soit qu'elles ne relèvent que d' un ministère, soit qu'elles concernent d'autres administrations publiques, voire des agents privés.
* 75 Ce travail a été réalisé par Eric Heyer et Mathieu Plane de l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) pour le compte de la Délégation du Sénat pour la planification. Il n'engage que ses auteurs.
* 76.Cf. Lettre de l'OFCE, n°268, octobre 2005.
* 77.La recharge hypothécaire consiste à emprunter avec comme collatéral un bien déjà engagé et remboursé partiellement ou dont l'appréciation dégage de nouvelles marge d'endettement. Aux États-Unis, cette possibilité d'extraction hypothécaire est renforcée par le fait que les sommes extraites peuvent être utilisé à autre chose que de l'immobilier.
* 78. Ce mécanisme est décrit et formalisé dans le document de travail de l'OFCE 2005-16 d'octobre 2005 « L'immobilier, pilier de la croissance ou épée de Damoclès »
*
79. Nous évaluons le taux
de croissance de la productivité globale des facteurs sur la base d'une
fonction de production de Cobb-Douglas. La productivité globale
horaire des facteurs (ð) du secteur privé est calculée via
son taux de croissance
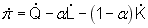 où Q est la
valeur ajoutée du secteur privé, á la part des salaires
dans cette VA, L l'emploi en heures et K le stock de capital. Ce calcul
comporte des lacunes en ce qui concerne la mesure de la croissance du stock de
capital. Les données utilisées proviennent de l'OCDE et des
comptes nationaux.
où Q est la
valeur ajoutée du secteur privé, á la part des salaires
dans cette VA, L l'emploi en heures et K le stock de capital. Ce calcul
comporte des lacunes en ce qui concerne la mesure de la croissance du stock de
capital. Les données utilisées proviennent de l'OCDE et des
comptes nationaux.
* 80. Il s'agit de Ben Bernanke.
* 81. Il y a un cas qui donnerait raison aux marchés obligataires : si la hausse continue des prix de l'énergie s'avérait avoir un impact non linéaire sur la croissance (ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, mais ce qui a alimenté les craintes d'un retournement brutal de la croissance au moment des ouragans). De plus, le rebond récent des taux longs, entre début septembre et la mi-octobre, donne, au contraire, raison à la politique monétaire. Il correspond à un réveil tardif mais normal des marchés obligataires à l'activisme monétaire.
* 82. Mesurée par le déflateur implicite de la consommation, indicateur privilégié de la Réserve fédérale.
* 83. Ce phénomène profite tout particulièrement à ceux qui ont un patrimoine et qui le réalisent.
* 84. M. Nicolas Sarkozy a présenté le 4 mai 2004 un plan de relance de l'économie française. Ce plan vise à abaisser le taux d'épargne des français pour stimuler la croissance dans un contexte de rigueur budgétaire. Dans un document de travail de l'OFCE (Valérie Chauvin et alii (2004) : « Évaluation du plan de relance de l'économie française », document de travail de l'OFCE, n°2004-04, mai), nous avons évalué principalement trois mesures. 1) Le crédit d'impôt sur les intérêts versés au cours des années 2004 et 2005 au titre du crédit à la consommation. Ce crédit d'impôt pourrait augmenter la consommation de 1 milliard d'euros pour un coût budgétaire de l'ordre de 400 millions d'euros par an. 2) L'exonération de droits sur les donations anticipées inférieures à 20 000 euros. Cette mesure induirait un transfert des plus âgés vers les plus jeunes compris entre 0 et 8,8 milliards d'euros pour un effet sur la consommation de 0 et 500 millions d'euros. 3) Le déblocage anticipé des réserves de participation. Cette mesure pourrait conduire à l'injection de 3 milliards d'euros de réserves de participation et avoir un impact comparable sur la consommation.
D'après l'INSEE, sur les 15 milliards d'euros rendus à la consommation par ces mesures, seul 1,5 à 2 milliards ont été réellement dépensés et auraient alors permis une baisse de 0.2 point du taux d'épargne en 2004.
* 85. D'après nos estimations, la sensibilité de la consommation au taux d'intérêt est de toute façon plus forte en France qu'en Allemagne. Une baisse permanente de 1 point des taux d'intérêt provoque à l'horizon de 5 ans une baisse de 0,16 point du taux d'épargne en France contre 0,09 point en Allemagne. Cela engendre une augmentation d'un demi point du PIB français contre 0,4 outre Rhin;
* 86 . Les prévisions issues de l'indicateur, réactualisées chaque mois, sont élaborées selon une méthodologie indépendante de celle mise en oeuvre avec le modèle e-mod.fr pour les prévisions de mars et septembre. Elles n'en sont pas une actualisation.
Pour une présentation de la méthodologie de l'indicateur voir : E. Heyer et H. Péléraux, « Un indicateur de croissance infra-annuelle pour l'économie française », Revue de l'OFCE, n° 88, janvier 2004, pp. 203.218.
* 87 Les valeurs critiques calculées par Ericsson et MacKinnon (2002) sont de -3.67, -3.98 et 4.58 à respectivement 10%, 5% et 1%.








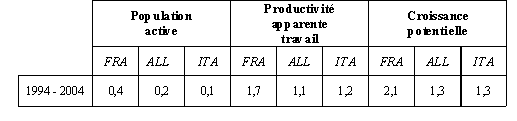
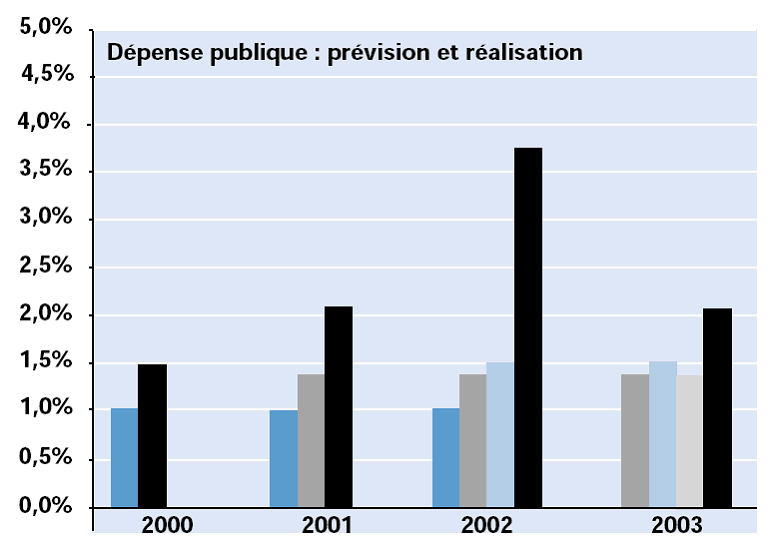
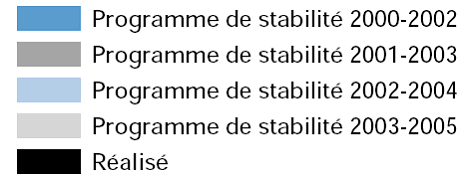
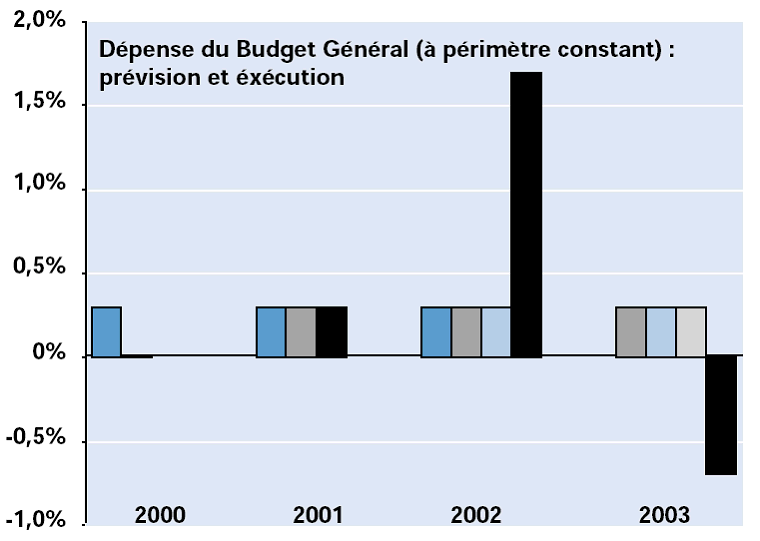
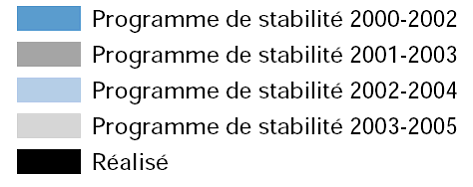
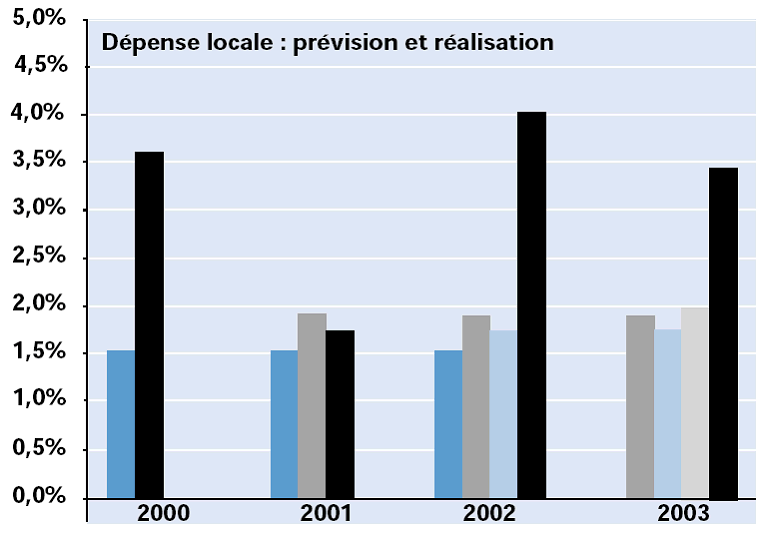
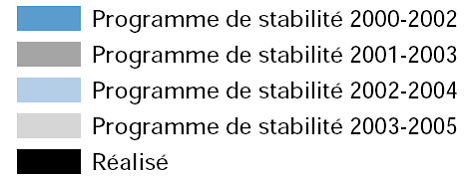
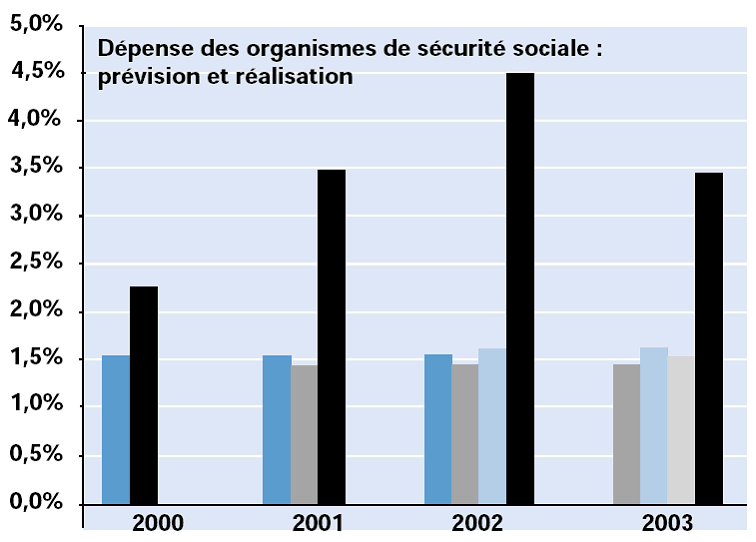
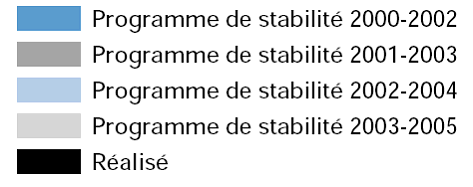
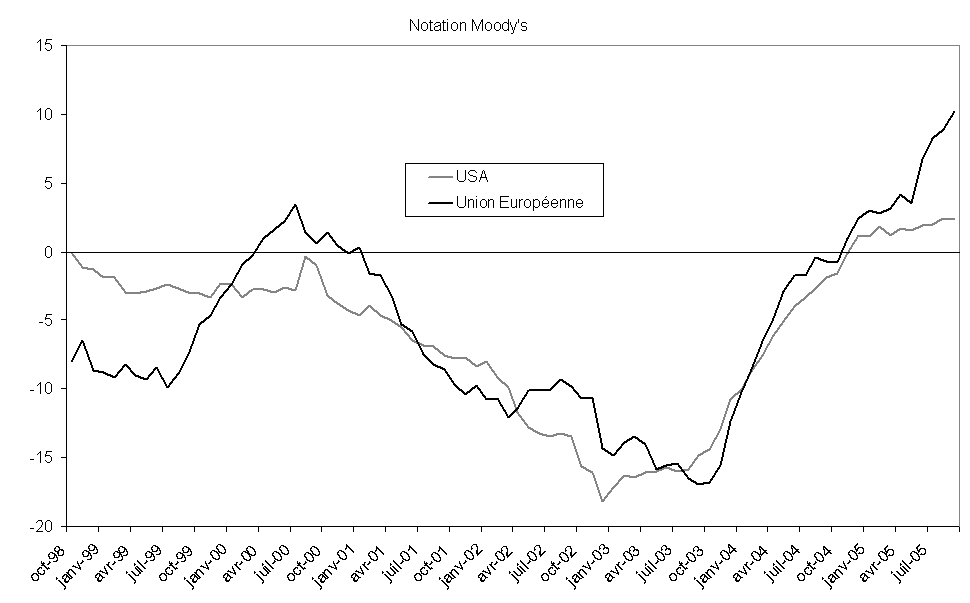
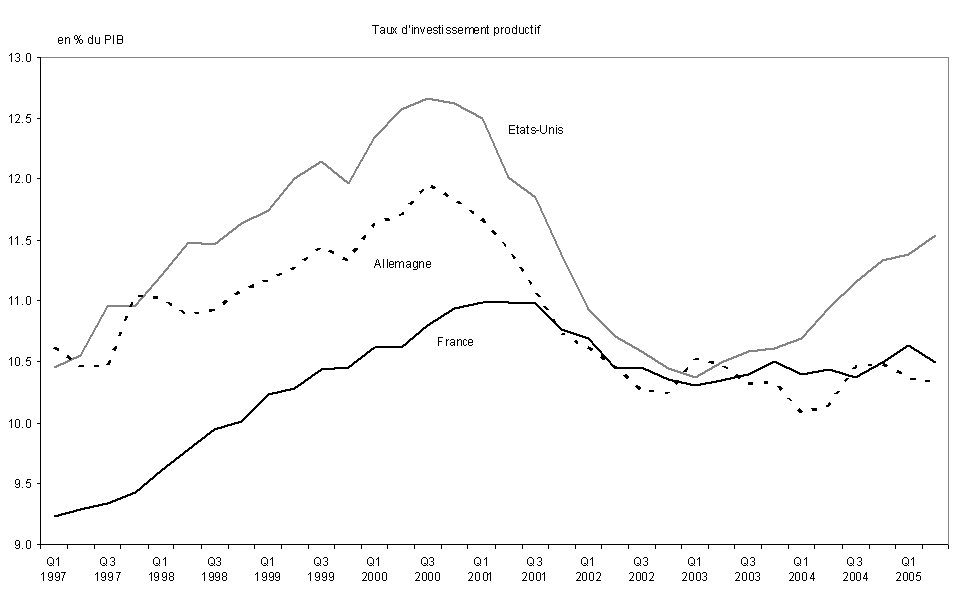
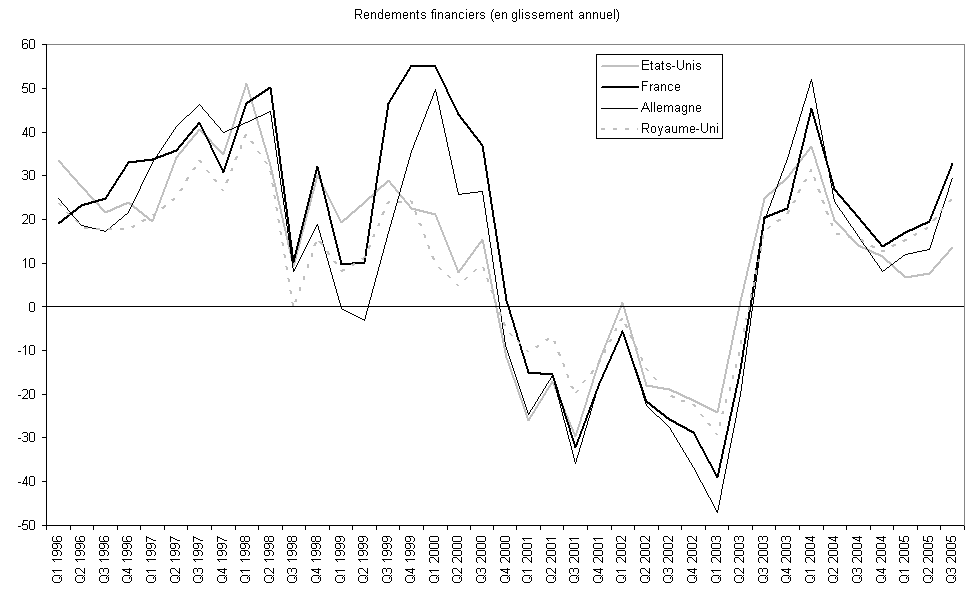
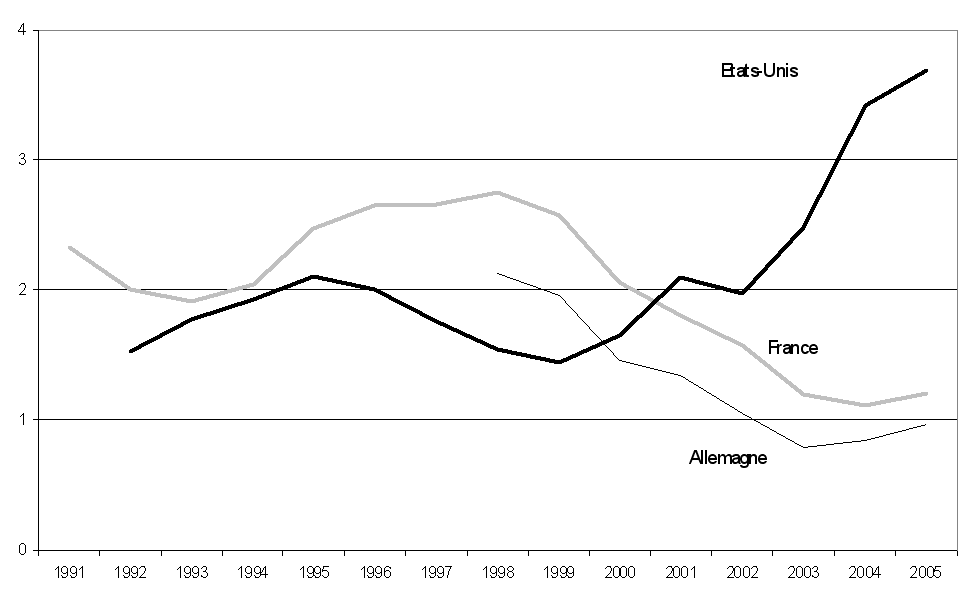
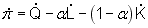 où Q est la valeur ajoutée du secteur
privé, á la part des salaires dans cette VA, L l'emploi en heures
et K le stock de capital.
où Q est la valeur ajoutée du secteur
privé, á la part des salaires dans cette VA, L l'emploi en heures
et K le stock de capital.