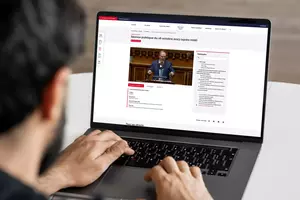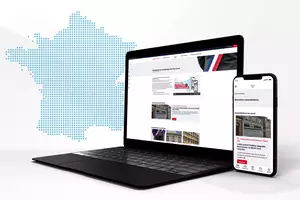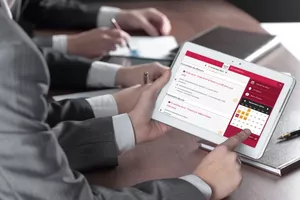B. UN CADRE DE PERFORMANCE DE LA LOI ORE QUI LAISSE À DÉSIRER
1. Le « péché originel de la loi ORE » : un enjeu de définition de la réussite étudiante qui n'a jamais été tranché
Dans la mesure où l'objectif premier de la loi ORE est d'améliorer la réussite étudiante, il importait en premier lieu de définir le concept de réussite, qui ne peut selon le rapporteur spécial être réductible au passage à l'année supérieure.
Or, la mise en oeuvre de la loi n'est pas allée de pair avec une définition claire de ce qui constitue, pour un étudiant, la réussite de son année.
Ainsi, en 2019, le comité de suivi de la loi ORE indiquait ainsi : « il s'agit bien de comprendre, en définitive, si la mobilisation des outils de la loi ORE par les acteurs de terrain produit des modifications significatives des trajectoires étudiantes qui, elles-mêmes, s'accompagnent d'une amélioration mesurable de la réussite. Question sensible, qui conduit à aborder le problème des données aujourd'hui encore peu accessibles et insuffisamment centrées sur les élèves, la pertinence des indicateurs de mesure aujourd'hui utilisés et, in fine, d'interroger la notion même de « réussite » étudiante ».
Interrogée sur la liste et le déploiement des indicateurs de performance liés à la loi ORE, la DGESIP a uniquement répondu au rapporteur spécial que « des indicateurs de suivi [avaient] été définis de manière spécifique selon les mesures ». À la même question, la sous-direction des systèmes d'information et d'études statistiques (SIES) a répondu que les indicateurs utilisés se basaient sur le suivi de la réussite des étudiants en premier cycle, le nombre de contrats pédagogiques signés, le nombre d'étudiants bénéficiant de dispositifs « oui si », le nombre de licences ayant individualisé leurs parcours, le nombre d'étudiants en licence aménagée, le déploiement de l'approche par compétences.
Le SIES a indiqué disposer de remontées d'informations annuelles des universités, sur les inscriptions et sur les résultats des étudiants inscrits en 1ère année de licence. Il est en capacité de connaître le nombre d'ECTS33(*) acquis en fin d'année et si l'étudiant a été présent à au moins un examen de chaque unité d'enseignement (UE). Les difficultés d'accès aux données ne sont pas non plus inexistantes sur ce point. Ainsi, le SIES indique que, concernant la présence à au moins un examen de chaque UE, les résultats « laissent douter de la qualité des remontées d'information sur ce point. Des étudiants « non-assidus » étant retrouvés massivement en 2ème année pour certaines disciplines et/ou certains établissements ».
2. Une évaluation encore complexifiée par la crise sanitaire et la réforme du lycée
Au-delà de la question de l'absence d'indicateurs de performance, la mesure globale de l'impact du changement des modalités d'accès au supérieur mis en place par la loi ORE sur les évolutions démographiques et sur la réussite étudiante doit tenir compte de deux changements majeurs.
D'une part, la réforme du lycée, qui n'a été pleinement achevée que cette année avec la mise en place des épreuves de spécialité, a modifié dans certaines universités les critères d'intégration en licence et a pu nécessiter de nouveaux aménagements de parcours, entraînant parfois des évolutions dans les formations proposées par les universités qui ont percuté les créations de places.
D'autre part, la crise sanitaire de 2020 a fortement modifié les conditions de passage du baccalauréat, entraînant un afflux de bacheliers supplémentaires en 2020 et 2021 dans l'enseignement supérieur.
Ainsi, si diverses notes du SIES soulignent une hausse globale du taux de passage en L2 en 2019 et 2020, il est difficile d'isoler les effets de la loi ORE des facteurs extérieurs.
Taux de passage en L2 des néo-bacheliers entrant en licence
(en %)
Source : commission des finances d'après le SIES
* 33 Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS)