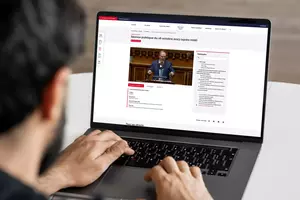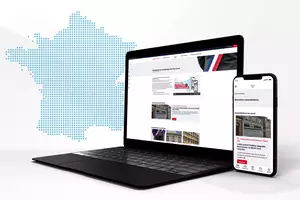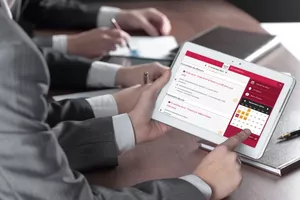E. MISE EN oeUVRE DES ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
1. Intervention de M. Bertrand Bouyx
Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues,
L'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme est très clair : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. » Au-delà de l'engagement des parties, le système de la Convention est doté d'un mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions.
Pourtant, il faut bien le dire, la tendance n'est pas bonne. En effet, la résolution fait état d'un nombre d'arrêts devant le Comité des Ministres passant, je cite, de 5 231 à la fin de 2019 à 6 256 au 1er mars 2023. La Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Hongrie comptent le plus grand nombre d'arrêts de la Cour non mis en oeuvre.
Nombre de ces pays connaissent des situations de guerre et il apparaît évident qu'ils doivent faire face à de graves problèmes structurels ou complexes pour faire appliquer les décisions. Cependant, ce n'est toujours pas le cas et encore trop souvent, la non mise en oeuvre des arrêts est le reflet d'une volonté politique, voire d'une réticence à appliquer des principes auxquels on a pourtant souscrit.
Je mets ici en garde, à la suite d'autres, contre cette tentation d'opposer la souveraineté - et singulièrement la souveraineté judiciaire - au respect des principes fondamentaux qui structurent notre continent. Non, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des États. Elle n'a à connaître qu'une partie infinitésimale des affaires. Le juge de la CEDH est avant tout le juge national. C'est à lui de faire appliquer les principes que nous avons tous en partage. La CEDH est une justice subsidiaire. Elle n'intervient qu'en dernier recours et respecte les traditions politiques et juridiques de chaque État représenté ici.
Alors, d'où vient cette tentation qui existe dans chacun de nos États, au sein de partis plus ou moins représentatifs, de contester la CEDH et ses arrêts ? Tout simplement de pouvoir porter atteinte à la séparation des pouvoirs et porter atteinte à l'indépendance de la justice, chose qu'ils ne peuvent pas faire avec la CEDH. Regardons, une fois n'est pas coutume, en dehors de notre continent. Le projet de réforme judiciaire en Israël, après d'autres pays, n'a-t-il pas pour but de soumettre l'autorité judiciaire à la volonté politique du gouvernement ? Je pose la question. La vigueur de la résistance à ce projet de loi montre bien qu'il s'agit d'une bataille décisive pour la démocratie. Elle nous concerne.
Pour conclure, respecter les arrêts et décisions de la CEDH, c'est pour nous tous une garantie que l'État de droit et les valeurs démocratiques seront respectés. Nous ne pouvons laisser les juridictions nationales seules face à des gouvernements qui se raidissent partout dans le monde, y compris au sein de notre propre continent, face aux menaces extérieures, mais également aux forces centrifuges qui minent la cohésion des nations.
Cette résolution est donc très importante : il faudra y revenir régulièrement.
Je vous remercie.
2. Intervention de Mme Marie- Christine Dalloz
Madame la Présidente / Monsieur le Président,
Monsieur le Rapporteur,
Chers collègues,
En vertu de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose aux États membres du Conseil de l'Europe et le Comité des Ministres est chargé de veiller à la bonne exécution de ces arrêts.
Ce 11ème rapport en est l'illustration et je félicite le rapporteur pour la qualité de son travail.
Les statistiques qui nous sont livrées ne surprennent pas car elles reflètent une situation qui évolue peu. 70 % des arrêts non-exécutés concernent six pays seulement, dont la Russie.
La typologie des arrêts non-exécutés révèle que plus de la moitié des affaires pendantes concernent soit des affaires interétatiques, soit des affaires relatives à une limitation abusive de droits et libertés, soit des affaires relevant de problèmes systémiques qui impliquent souvent l'institution judiciaire, l'administration pénitentiaire ou la police. Monsieur le rapporteur, vous proposez que l'APCE prépare des rapports sur ces cas afin de promouvoir des solutions possibles. J'y suis tout à fait favorable car trouver des solutions permettant de dénouer ces affaires entraînerait une amélioration bienvenue de la situation.
Le projet de recommandation n'appelle aucune remarque de ma part.
Le projet de résolution insiste sur les obligations qui incombent aux États. Je souhaite commenter le point 7.8 qui incite les États à veiller à ce que leur législation nationale renforce la capacité nationale d'exécuter les arrêts de la Cour. Je ne remets bien évidemment pas en cause la primauté des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur les décisions des juridictions nationales. J'attire cependant votre attention sur le fait que les arrêts concernant des affaires sensibles peuvent parfois être perçus comme difficiles à accepter par les citoyens. Le sentiment de se voir imposer des décisions supranationales remettant en cause le système judiciaire national est de plus en plus fréquent et engendre un rejet viscéral de l'Europe au sens large, rejet malheureusement entretenu par les formations politiques extrêmes. La démocratie est fragile et dangereusement menacée par le populisme. Veillons à ne pas l'encourager. Ainsi appeler à une éventuelle modification de la législation nationale peut paraître intrusif. Il me semble que si l'on veut une meilleure acceptation des arrêts de la Cour, il faut également faire preuve de pédagogie et expliquer aux citoyens en quoi une décision vise en fait à permettre le respect des valeurs essentielles pour la démocratie. La Convention européenne garantit des droits fondamentaux (le droit à la vie, la liberté d'expression, etc.) et protège contre des abus intolérables (détention arbitraire, torture, esclavage, etc.). Les valeurs qu'elle promeut sont belles. Il faut constamment les mettre en avant. C'est à cette condition que les modifications législatives nationales nécessaires pourront être accueillies favorablement.
Je vous remercie.
3. Intervention de M. Bernard Fournier
Discours non-prononcé mais intégré au compte rendu officiel
Ce rapport présente une vision objective et panoramique de la mise en oeuvre des arrêts de Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans les États membres de notre organisation.
La mise en oeuvre des arrêts de la CEDH est une obligation dont les États membres ne sauraient s'exonérer en invoquant des difficultés techniques ou le droit interne. Il en va de la crédibilité du Conseil de l'Europe.
Le Comité des Ministres a la charge de s'assurer que ces arrêts sont mis en oeuvre. Notre Assemblée doit lui apporter son soutien dans cette tâche mais aussi, autant que nécessaire, lui servir d'aiguillon.
La croissance récente du nombre des arrêts pendants devant le Comité des Ministres est la manifestation du souhait de certains États de remettre en cause l'autorité des arrêts de la Cour, mais elle est également le fruit des tensions géopolitiques actuelles qui traversent notre continent.
Nombre d'affaires pendantes devant le Comité des Ministres sont des affaires interétatiques liées à des situations de conflits internationaux. Ainsi, le Comité des Ministres examine depuis juin 2015 la mise en oeuvre de deux arrêts concernant le conflit militaire qui a opposé de 1988 à 1994 l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Ces arrêts ont permis de reconnaître la responsabilité de chacun des belligérants dans les territoires où la Cour a considéré qu'ils exerçaient respectivement un contrôle effectif. À ce jour, aucun des deux belligérants n'a indemnisé les requérants.
Je trouve ceci particulièrement regrettable car la reconnaissance des violations des droits commises par chacune des parties est indispensable pour construire la paix. La réactivation des tensions au Haut-Karabakh ne simplifie évidemment pas la situation, et pourtant, solder les anciennes affaires constituerait un premier pas.
Je regrette également les manoeuvres procédurières auxquelles ont recours certains États membres pour éviter de mettre en oeuvre les arrêts de la Cour. C'est le cas notamment de la Turquie, qui refuse de libérer M. Osman Kavala au prétexte que son maintien en détention serait lié à une autre affaire. Le Comité des ministres a désigné un groupe de liaison d'ambassadeurs pour engager un dialogue avec la Turquie sur cette question. Je souhaite que celui-ci puisse aboutir rapidement.
Aucun État membre ne peut s'affranchir de la règle commune. Je forme le voeu que le Sommet de Reykjavik soit l'occasion de réaffirmer leur attachement à la Cour et d'endosser un suivi renforcé de la mise en oeuvre de ses arrêts.