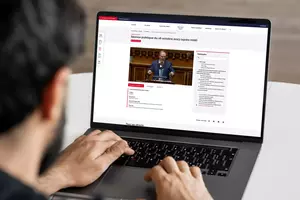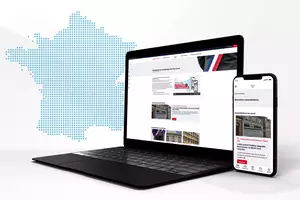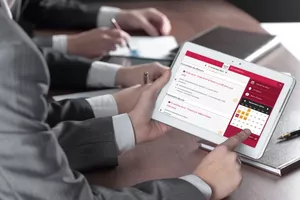Née le 7 janvier 1908 à Constantine (Algérie). Elle est Conseiller de la République élue par l’Assemblée nationale de 1946 à 1948, puis Sénateur de la Seine de 1948 à 1958 et Député de la Seine de 1958 à 1962. Elle est enfin membre du Conseil économique et social de 1963 à 1979.
Après des études au lycée de Constantine, puis à la faculté de lettres de Grenoble, Marcelle Gougenheim épouse Stanislas Devaud, professeur agrégé de philosophie, élu député de Constantine en 1936.
En 1940, le couple regagne la France, s’installe à Clermont-Ferrand, puis à Paris en 1943. Engagé dans la Résistance, il contribue, avec l’aide du Secours National, à soustraire aux recherches policières des évadés, des résistants, des israélites ou des réfractaires au STO.
A la Libération, Marcelle Devaud, qui avait secondé son mari dans l’exercice de son mandat parlementaire, est sollicitée par le Parti Républicain de la Liberté (PRL) pour exercer une action politique : elle est élue par l’Assemblée nationale au Conseil de la République pour y représenter ce parti.
Elle rejoint alors le groupe du PRL, dont elle est vice-présidente du 1946 à 1952, et siège à la commission de l’intérieur et à la commission du travail et de la sécurité sociale.
Elle se spécialise dans les questions sociales et intervient sur l’instauration des différents régimes de sécurité sociale, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou sur l’allocation de vieillesse pour les personnes non salariées.
Elle contribue notamment à la décision d’octroyer aux étudiants certaines prestations de sécurité sociale.
Lors des élections du 7 novembre 1948, elle est candidate au Conseil de la République en troisième position de la liste présentée par le Rassemblement du Peuple Français (RPF) dans la Seine, qui remporte huit des vingt sièges à pourvoir.
Elle accède alors à l’une des vice-présidences du Conseil de la République, fonction qu’elle occupe jusqu’à la fin de l’année 1951.
Son rôle au sein de cette assemblée est alors particulièrement actif, car le Président du groupe PRL, Georges Pernot, très absorbé par ses mandats locaux, lui délègue fréquemment le soin de présider le groupe, jusqu’à ce qu’elle rejoigne le groupe du RPF, créé au mois d’août 1951.
Elle reste néanmoins très active dans les débats publics, en étant notamment rapporteur du projet de loi relatif aux conventions collectives et au règlement des conflits du travail et en s’exprimant sur l’institution d’un code du travail dans les territoires d’outre-mer ou sur la réorganisation des services des œuvres sociales en faveur des étudiants.
La France est alors le seul pays européen à s’être doté d’une sécurité sociale spécifique aux étudiants. Marcelle Devaud contribue également à la création de la Mutuelle Nationale des Etudiants de France.
Ses principaux autres sujets d’intervention sont l’évolution des relations internationales et la naissance des tensions en Algérie. Elle s’exprime ainsi sur la prolongation de l’état d’urgence en Algérie, en 1955, et sur les institutions de l’Algérie, en janvier 1958.
Les 2 et 3 juin 1958, Marcelle Devaud vote pour les pleins pouvoirs et la révision constitutionnelle.
Réélue le 18 mai 1952, en cinquième position de la liste présentée par le RPF dans la Seine, elle ne retrouve pas son siège le 8 juin 1958 : elle est alors en quatrième position sur la liste d’appel à un Gouvernement de Salut public présidé par le Général de Gaulle. Présentée par les Républicains sociaux, cette liste n’obtient que trois des vingt sièges à pourvoir.
Elle est toutefois élue député UNR de la Seine (circonscription de Colombes-Gennevilliers) et siège à l’Assemblée nationale jusqu’en 1962.
Elle se présente aux élections municipales de 1959 et est élue maire de Colombes, fonction qu’elle exercera jusqu’en 1965.
Marcelle Devaud est membre du Conseil économique et social de 1963 à 1979.
Par ailleurs, elle préside ou participe à la création de nombreuses associations telles que le Comité de liaison des associations féminines, l’Amicale des élues municipales, le Comité du travail féminin, l’Accueil familial des jeunes étrangers.