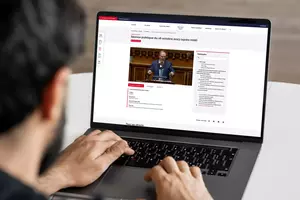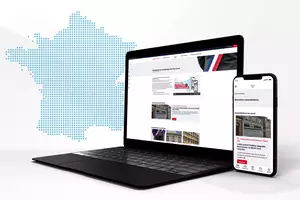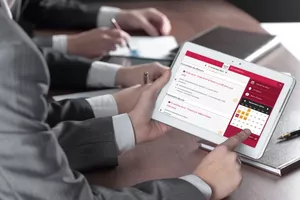Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte européenExamen : 06/12/2012 (commission des affaires européennes)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : n° 200 (2012-2013) : voir le dossier legislatif
Justice et affaires intérieures
Création d'un Parquet européen
(Réunion du jeudi 6 décembre 2012)
Rapport d'information et proposition de
résolution européenne
de Mme Sophie Joissains
M. Simon Sutour, président. - Notre ancien collègue Pierre Fauchon suivait autrefois ce dossier, auquel il était favorable.
Mlle Sophie Joissains. - Cet enjeu juridique est très présent dans le cadre de la construction européenne. Il a été abordé à de nombreuses reprises : l'Assemblée nationale a voté une résolution, Mireille Delmas-Marty a constitué en 1997 un Corpus Juris minimal, et le Conseil d'Etat a rédigé un excellent rapport sur le sujet. Le traité de Lisbonne a ouvert la voie à la création d'un parquet européen et la Commission européenne tente d'accélérer le processus, qui a pris un nouvel élan en septembre dernier, notamment grâce à l'action de Robert Badinter qui multiplie les déplacements dans les Etats membres pour susciter leur adhésion au projet.
Le traité entend protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, en particulier depuis la décision prise en 1970 de remplacer les contributions nationales des Etats membres par des ressources propres. Les obligations des Etats membres ont été précisées par la convention du 27 novembre 1995. L'office de lutte anti-fraude (OLAF) est né en 1999.
Les irrégularités sont en effet nombreuses : un pic a été atteint en 2010, où elles ont été évaluées à 600 millions d'euros par an. Les plus nombreuses (54% du total) sont réalisées dans le cadre de la politique de cohésion. Elles sont aussi celles qui ont l'impact financier le plus élevé (69% du total). Tous les cas n'étant pas détectés, le montant réel est sans doute supérieur. En outre, les montants varient selon la définition donnée aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Seulement 7% des recommandations faites par l'OLAF donnent lieu à une enquête pénale. En outre, les définitions des infractions pénales concernées, comme le détournement de fonds ou l'abus de pouvoir, sont très différentes d'un pays à l'autre, ce qui explique que le taux de condamnation varie de 14 % à 80%.
En juillet 2012, la Commission européenne a présenté une proposition de directive définissant des infractions communes à tous les Etats membres assorties de sanctions. Sa proposition de mars 2012 privilégie la confiscation comme moyen de lutte contre la criminalité organisée.
D'une part, le nombre d'infractions des Etats membres concernant les fonds européens est en augmentation, et, d'autre part, la criminalité transfrontière porte une atteinte beaucoup plus directe à la souveraineté nationale.
Le renforcement de la coopération judiciaire pénale constitue un autre enjeu majeur. La convention du 29 mai 2000 et son protocole additionnel de 2001 ont renforcé les mécanismes d'entraide judiciaire. Depuis le Conseil européen de Tampere, en 1999, le principe de reconnaissance mutuelle constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire européenne. La principale réalisation demeure le mandat d'arrêt européen, établi en 2002, et qui connaît un succès croissant.
Cependant, l'hétérogénéité des normes d'incrimination et de sanction constitue une vraie difficulté qu'il faut lever, comme le soulignait Mme Delmas-Marty. La disparité des procédures pénales est un obstacle encore plus sensible : l'harmonisation est difficile entre des traditions juridiques latines ou anglo-saxonnes. La coopération judicaire s'est développée à travers les magistrats de liaison et le réseau judiciaire européen (RJE), créés respectivement en 1996 et en 1998, améliorant les échanges d'informations. Un système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), a également été créé en 2009, tandis que le rôle d'Eurojust (unité de coopération judiciaire de l'Union européenne) s'affirmait. D'après sa présidente, Mme Michèle Coninsx, que nous avons reçue, sa situation a beaucoup évolué ces dix dernières années, notamment grâce à un climat de confiance qu'il importe de ne pas briser par une approche trop autoritaire : une armature générale doit suffire.
La coopération policière fonctionne très bien dans un cadre bilatéral : Europol fournit aux services répressifs des États membres des renseignements sur les phénomènes criminels, et le traité de Lisbonne, conformément à l'exigence démocratique, prévoit expressément l'association des parlements nationaux à son contrôle. Sur proposition de notre commission, le Sénat a adopté, en juin 2011, une résolution européenne soulignant que cette association devait être effective et permanente. Enfin, les équipes communes d'enquête, créées par une décision-cadre du 13 juin 2002, permettent aux autorités judiciaires et policières d'un Etat membre d'intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre avec l'accord de cet Etat, ce qui constitue un progrès notable par rapport aux souverainetés nationales. La participation d'Europol et d'Eurojust devrait toutefois être plus systématique.
Fruit d'un compromis entre les Etats membres, la rédaction du traité de Lisbonne laisse de nombreuses questions ouvertes. La création du parquet européen peut être décidée par le Conseil à l'unanimité et l'approbation du Parlement européen. Si cette dernière est vraisemblable, l'unanimité au Conseil est improbable. L'obstacle peut cependant être contourné par une coopération renforcée entre neuf Etats membres au minimum, ce qui paraît possible.
Le Parquet européen doit être créé à partir d'Eurojust, conformément à l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cette exigence pose quelques problèmes aux organismes européens, notamment l'Olaf, chargée des enquêtes administratives. A ce titre, une harmonisation entre Europol, Eurojust et l'Olaf serait la bienvenue.
Le traité précise les missions du Parquet européen. Celui-ci sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Il exercera devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions. Cependant, les infractions concernées ne sont pas définies. Il reviendra aux règlements qui créeront le Parquet européen de les déterminer.
Très clairement, le traité se concentre en priorité sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Tel était également le choix du livre vert de 2001. Mais le Conseil européen pourra décider, simultanément ou ultérieurement, d'étendre les attributions du parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière.
Quelle démarche pouvons-nous promouvoir ?
La criminalité transfrontière fait l'objet d'une coopération judiciaire importante, mais les Etats ne souhaitant pas aller au-delà pourraient compromettre son renforcement ou la création d'un parquet européen. Une démarche progressive, consistant à se concentrer dans un premier temps sur la défense des intérêts financiers de l'Union, pour traiter par la suite la question de la criminalité transfrontière, me semble préférable.
Parallèlement, la Commission européenne proposera vraisemblablement une réforme d'Eurojust pour l'adapter à une coopération judiciaire renforcée.
Même avec un champ d'intervention limité aux intérêts financiers de l'Union, la création d'un parquet européen devrait se heurter à l'opposition de certains Etats membres, rendant inévitable le recours à une coopération renforcée. Celle-ci permettra d'évaluer le parquet européen et ouvrira la voie à l'extension de ses compétences et de son champ géographique d'intervention. Notons que le champ des compétences est lui-même soumis à interprétation et que la différence est grande entre une conception stricte ou extensive des intérêts financiers.
Les conceptions de la structure du Parquet européen et des règles applicables sont diverses. Peu de pays prônent une structure centralisée, dont l'efficacité pourrait être remise en question par la susceptibilité des Etats membres. Si elle était centralisée, la structure de ce parquet serait extrêmement lourde sur le plan financier, et nous avons besoin d'une structure légère pour que chaque Etat membre puisse y participer. Nous avons proposé à nos auditeurs une structure comportant un procureur de chaque Etat membre, élisant en son sein son président, avec une possibilité de présidence tournante, à un rythme pluriannuel pour garantir la stabilité de l'institution. En outre, des procureurs référents seraient désignés sur le territoire national.
Il paraît nécessaire de mettre en place un socle minimal de règles harmonisées au niveau européen, notamment concernant la définition des infractions et l'admissibilité des preuves. En effet, si le droit britannique encadre le régime de la preuve, le droit français privilégie la liberté de la preuve.
Les actes du Parquet européen devront faire l'objet d'un contrôle juridictionnel soit en cours de procédure soit devant la juridiction de jugement. Ses actes adoptés en amont et en sa qualité d'organe de l'Union européenne pourraient relever du contrôle d'une juridiction spécialisée de l'Union européenne dont le traité permet la création.
Cela ne sera-t-il pas trop lourd ? Ne peut-on prévoir que le renvoi en appel se fasse devant les juridictions nationales et que les actes de procédures orchestrés par le Parquet européen puissent bénéficier, en cas de recours, d'un contrôle de régularité par la Cour européenne avec une chambre spécialisée ? Ceci éviterait des lourdeurs et permettrait que des actes de procédures supranationaux soient évalués par une juridiction supranationale. La saisine serait ouverte aux Etats membres, de même qu'une capacité d'autosaisine, et pourquoi pas par les justiciables, avec sans doute un filtre.
M. Simon Sutour, président. - Le sujet présente une certaine difficulté technique mais son objet fait consensus parmi nous. Je me réjouis que le dossier avance ; il ne faut jamais désespérer ! En 2007, quand M. Haenel présidait la délégation, nous avons fait un déplacement fort instructif à La Haye pour voir comment fonctionnent Europol et Eurojust. Depuis, la situation semble avoir beaucoup évolué, et justifierait un nouveau déplacement, sous votre conduite.
M. Jean Bizet. - Ce travail est très intéressant, y compris pour les non juristes.
Mme Sophie Joissains. - La démarche est autant philosophique que juridique.
M. Simon Sutour, président. - Nous sommes tous d'accord sur le principe, la difficulté est d'harmoniser. Votre exemple sur le droit de la preuve est parlant.
M. André Gattolin. - Comment fonctionnerait concrètement l'instruction dans un parquet européen ?
Mme Sophie Joissains. - Plusieurs hypothèses sont possibles, mais nous n'en sommes pas encore là ! Selon nous, un tel parquet ne pourrait être que collégial avec des délégués nationaux. La coopération judicaire fonctionne bien au sein d'Eurojust.
M. Simon Sutour, président. - Les progrès sont constants.
M. Jean Bizet. - Je ne puis qu'être d'accord avec la proposition de résolution. L'harmonisation est impérative, la criminalité ayant une longueur d'avance sur le juge... et la criminalité financière, dix bonnes longueurs ! En outre, c'est une réforme qui ne nécessite pas de modification constitutionnelle : un argument de poids par les temps qui courent.
M. Simon Sutour, président. - La proposition de résolution sera transmise à la commission des lois.
A l'issue du débat, la commission des affaires européennes, à l'unanimité, a autorisé la publication du rapport d'information paru sous le numéro 203 et adopté la proposition de résolution dans la rédaction suivante :
Proposition de résolution européenne
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 85 et 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives (COM (2011) 293 final) du 26 mai 2011,
Rappelle que la mise en cause des intérêts financiers de l'Union européenne et le développement de la criminalité grave transfrontalière constituent pour l'Union européenne des défis majeurs qu'elle doit combattre avec des moyens adaptés ;
Considère que la création d'un Parquet européen peut apporter une contribution essentielle à la construction d'un espace judiciaire européen, répondant aux attentes des citoyens, respectueux des droits fondamentaux et des systèmes et traditions juridiques des États membres ;
Souligne tout l'intérêt d'une démarche ambitieuse étendant, comme le permet l'article 86 du TFUE, les compétences du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave transfrontière, afin de promouvoir une action efficace contre cette criminalité et surmonter les entraves créées par le morcellement de l'espace judiciaire européen ;
Juge toutefois possible une démarche par étapes qui concentrerait dans un premier temps les compétences du Parquet européen sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne avant de les étendre à la lutte contre la criminalité grave transfrontière ; relève qu'un Parquet européen serait un instrument efficace pour assurer une meilleure protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
Considère qu'à défaut d'unanimité au Conseil, une coopération renforcée prenant la forme d'un Parquet européen devrait être lancée entre les États membres volontaires dans les conditions prévues par l'article 86 du TFUE ;
Estime que, dans le même temps, les compétences de l'unité de coopération EUROJUST devraient être étendues, comme le permet l'article 85 du TFUE, en lui reconnaissant en particulier le pouvoir de déclencher des enquêtes pénales ;
Est favorable à un Parquet européen de forme collégiale, désignant en son sein un président, le cas échéant avec une rotation par pays, et s'appuyant sur des délégués nationaux dans chaque État membre ;
Rappelle que, conformément à l'article 86 du TFUE, le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ; que les juridictions nationales des États membres demeureront compétentes pour se prononcer sur le fond ; que le Parquet européen exercera devant ces juridictions l'action publique relative à ces infractions ;
Considère que le Parquet européen devrait mener ses investigations pour l'essentiel avec le concours des services d'enquêtes nationaux ; qu'un service d'enquête européen pourrait, le cas échéant, être constitué à partir de structures existantes pour appuyer l'action des services d'enquête nationaux ;
Juge nécessaire de réaliser une harmonisation minimale des règles applicables, en particulier en matière de définition des infractions et d'admissibilité des preuves, en la complétant par une application du principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres ;
Souligne que les règlements pris pour l'application de l'article 86 du TFUE devront respecter les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels, ainsi que celles de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Relève que les actes du Parquet européen devront faire l'objet d'un contrôle juridictionnel soit en cours de procédure soit devant la juridiction de jugement ; estime que les actes du Parquet européen adoptés en amont et en sa qualité d'organe de l'Union européenne pourraient relever du contrôle d'une juridiction spécialisée de l'Union européenne créée sur le fondement de l'article 257 du TFUE ;
Juge nécessaire que l'action du Parquet européen, dans l'esprit de l'article 85 du TFUE, puisse faire l'objet d'un contrôle démocratique sous la forme d'une évaluation associant le Parlement européen et les parlements nationaux.